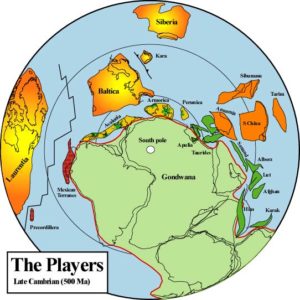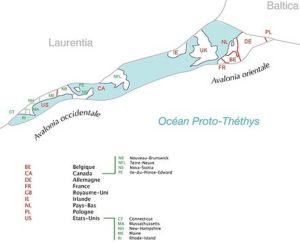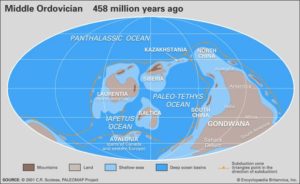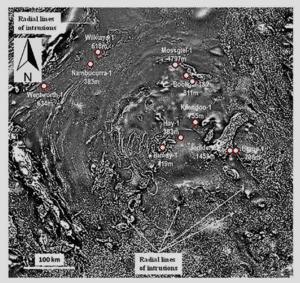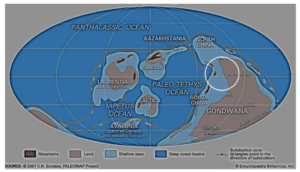| Par l.peltier dans (100 : Préfaces) le 31 décembre 2008 | (0) Commentaires | En savoir plus |
L’ANTIQUITE
CLAUDE MOSSÉ, professeur à l’université de Paris VIII
Présenter une histoire du monde est a priori un pari hasardeux, tant nous sommes accoutumés aux découpages géographiques et aux périodisations de notre histoire, celle du monde occidental, dans laquelle nous comptons l’Antiquité méditerranéenne. Mais c’est un pari qui méritait d’être tenu, car il est bon, aujourd’hui où les distances s’amenuisent, où l’on peut faire le tour du monde en un seul jour ou presque, que l’on prenne conscience de l’unité du monde qui est le nôtre, de cette Terre où l’homme est né il y a des millénaires, mais dont l’histoire ne commence vraiment qu’avec l’apparition de l’écriture.
C’est en Mésopotamie, dans cette région comprise entre le Tigre et l’Euphrate, que l’on commence, au IV° millénaire av. J.-C., à utiliser des signes, le plus souvent pour tenir à jour des comptes ou relater les hauts faits de tel ou tel souverain. Dans le même temps, ou presque, l’écriture fait aussi son apparition en Égypte, au moment où se constitue l’unité du pays sous les pharaons des premières dynasties (l’Ancien Empire). Ailleurs, des monuments mystérieux, les mégalithes, témoignent de sociétés déjà organisées et de rites religieux dont l’essentiel nous échappe. Vers la fin du III° millénaire, c’est le bassin méditerranéen oriental qui devient le centre de brillantes civilisations. Alors qu’en Mésopotamie les pouvoirs rivaux se déchirent, le monde égéen voit naître les premiers palais crétois et cette civilisation minoenne raffinée qui imprégnera la civilisation grecque. Au début du III° millénaire, c’est Babylone qui domine en Mésopotamie, avec Hammourabi, dont les premiers codes de lois attestent les progrès de l’organisation sociale. Dans le même temps, la Chine émerge de l’obscurité, cependant que l’Égypte, après les crises du Moyen Empire, connaît un regain de puissance avec les pharaons du Nouvel Empire. En Grèce se développe alors la civilisation dite mycénienne, du nom de la plus puissante des cités du Péloponnèse. Ces cités, Mycènes, Tirynthe, Pylos dans le Péloponnèse, Orchomène et Athènes en Grèce centrale, sont organisées autour de palais imposants, centres du pouvoir, de la vie religieuse, économique et culturelle. Des Mycéniens réussissent vers 1 450 av. J.-C. à s’emparer de la Crète, dont ils adoptent l’écriture pour transcrire leur propre langue. Leurs navires fréquentent les côtes de l’Asie Mineure, celles de Sicile et d’Italie méridionale. Mais, sans qu’on en connaisse encore aujourd’hui les raisons, la plupart des palais mycéniens disparaissent brusquement à la fin du XIII° siècle av. J.-C. Entre 1 400 et 1 200, l’Égypte traverse une grave crise religieuse sous le règne d’Akhenaton, le pharaon adorateur du Soleil. C’est aussi à ce moment qu’un petit peuple nomade, venu du centre de l’Asie, se retrouve asservi en Égypte ; il se libérera sous la conduite de Moïse, qui saura s’attirer les faveurs du pharaon. Belle histoire, qui fonde l’élection du peuple juif et donnera naissance, quelques siècles plus tard, à la première religion monothéiste.
Tandis que la Grèce traverse ce que les archéologues appellent les siècles obscurs (XII°-IX° siècle), à l’autre extrémité du monde, la Chine commence à s’organiser politiquement autour de la cité de Xi’an. Sur le continent que l’on nommera plus tard l’Amérique apparaissent les premières sociétés constituées. À l’est de la Méditerranée, c’est le début du grand Empire assyrien : pendant plus d’un siècle, grâce à une force militaire qui recourt aux moyens les plus brutaux, celui-ci étend son autorité à l’ensemble de la Mésopotamie. Au même moment, le royaume établi en Palestine par les Hébreux connaît son apogée sous le règne de Salomon.
Mais, au début du VIII° siècle, c’est surtout la renaissance de la Grèce qui mérite de retenir l’attention. En deux siècles et demi, les Grecs s’installent sur les rives septentrionales de la Méditerranée (Grande-Grèce, Gaule) et fondent des cités, organisations politiques d’abord apparues en Grèce puis sur les côtes d’Asie Mineure à la fin du IX° siècle. La cité grecque est caractérisée par le partage de l’autorité entre les membres de la communauté civique. Ceux-ci se réunissent à intervalles plus ou moins réguliers pour y débattre des décisions qui engagent la vie de tous. À l’origine, seuls ont la parole ceux qui se disent eux-mêmes les meilleurs (aristoi). Mais leurs rangs ne tarderont pas à s’élargir, à la faveur des transformations sociales et des nécessités militaires. Les Grecs ont ainsi inventé la politique (de polis, cité), fondée sur le libre débat et la prise de décision commune.
Entre le VIII° et le VI° siècle, l’Orient traverse une série de bouleversements : l’Empire assyrien décline et Babylone redevient le centre d’un État puissant, la Babylonie, qui atteint son apogée sous le règne de Nabuchodonosor. L’Égypte, après une période de troubles, connaît au début du VI° siècle une renaissance provisoire sous la dynastie saïte. Mais c’est du plateau de l’Iran que provient l’ébranlement le plus important : à partir de son avènement, en 558 av. J.-C., Cyrus s’empare en quelques décennies de la Babylonie, du puissant royaume lydien de Crésus et de la côte syro-palestinienne. Après sa mort, son fils Cambyse conquiert l’Égypte. À cette même époque, dans la seconde moitié du VI° siècle, Confucius et le Bouddha dispensent leur enseignement en Extrême-Orient, tandis que dans les cités grecques d’Asie Mineure naissent la science et la philosophie avec les Milésiens Thalès, Anaximandre et Anaximène. À la fin du VI° siècle, la petite cité de Rome, en Italie, se libère de ses rois et crée la République (509 av. J.-C.) ; au Moyen-Orient, la menace perse se manifeste de façon de plus en plus pressante. Mais les Perses se heurtent à la résistance des Grecs. Les victoires de Marathon et de Salamine fondent les prétentions de l’Athènes démocratique – principal artisan de la victoire – à dominer le monde égéen. Ce sont aussi ces prétentions qui, après l’âge d’or que constitue le règne de Périclès, entraînent le monde grec dans la guerre du Péloponnèse, guerre qui marque le début d’une crise et l’affaiblissement des cités grecques face à la puissance macédonienne.
Avec les conquêtes d’Alexandre de Macédoine (356-323) s’ouvre la période hellénistique. De vastes États monarchiques se constituent sur les ruines de l’Empire perse, centres d’une brillante civilisation à dominante grecque, mais où se fait sentir l’influence de l’Orient. En Occident, Rome entreprend la conquête de l’Italie, puis transforme bientôt la Méditerranée occidentale en une mer romaine, avant de se lancer à la conquête de l’Orient dès la fin du deuxième siècle av. J.-C. Dans le même temps apparaît le premier Empire chinois, tandis que l’Inde des Maurya réalise une synthèse entre l’héritage bouddhique et l’apport des Grecs venus avec les armées d’Alexandre. Alors que 1a Chine connaît son apogée sous la dynastie de Han, Rome, déchirée par les guerres civiles voit la République tomber entre les mains de généraux ambitieux. La conquête de la Gaule par César et celle de l’Égypte par Octave Auguste scellent les destinées du monde méditerranéen. À la fin du I° millénaire avant notre ère, Auguste fait régner la paix romaine sur tout le territoire de l’Empire. Pourtant, cette paix ne fait que dissimuler les mouvements qui couvent sous l’apparente unité. Dans la Palestine soumise à Rome, ces révoltes, influencées par des prophètes inspirés, prennent un caractère religieux. L’un d’entre eux, Jésus de Nazareth condamné au supplice de la croix par le procurateur romain Pilate, deviendra, grâce à la diffusion de son enseignement par ses disciples, le fondateur d’une foi nouvelle qui bientôt gagnera des fidèles dans tout le monde romain. Mais tandis que se répand le christianisme et que sont écrasées les dernières révoltes juives, l’Empire, qui n’a jamais trouvé un réel équilibre après la mort d’Auguste, traverse des périodes de désordres culminant sous le règne de Néron et de ses successeurs immédiats.
Au II° siècle de notre ère, l’Empire romain connaît une période de paix relative sous le règne des Antonins. C’est aussi l’âge d’or en Inde, alors que dans le lointain Mexique se succèdent de brillants empires. Au III° siècle, la pression des peuples barbares commence à se faire sentir aux frontières de l’Empire romain, et le pouvoir devient le jeu de rivalités entre chefs militaires. La crise sociale, le dépeuplement des campagnes, l’infiltration lente des barbares dans l’armée romaine ne font qu’aggraver la situation. Au moment où le christianisme, jusque-là persécuté, devient, après la conversion de Constantin, la religion officielle, c’est tout le système qui se désagrège. Lorsque les peuples germaniques auront déferlé sur les provinces occidentales de l’Empire, l’Église seule maintiendra pendant quelques siècles la tradition gréco-romaine en Orient, où l’Empire romain subsiste avec Constantinople redevenue Byzance, pour capitale.
MOYEN AGE
Georges DUBY, de l’Institut
Depuis la fin XVI° siècle, les Européens se sont peu à peu accoutumés à nommer Moyen Âge la très longue période de leur histoire comprise entre le début du V° et la fin du XV° siècle. Pourquoi ? Moyen, dans cette expression, veut dire médian, intermédiaire. Ce mot signifie aussi médiocre, négligeable. Pour les hommes d’étude qui, les premiers, parlèrent de Moyen Âge, la haute culture, la culture classique, avait fait naufrage avec l’effondrement de l’Empire romain, et c’est la Renaissance, au XVI° siècle, qui l’avait revivifiée. Dans l’entre-deux, la barbarie, pensaient-ils, avait régné pendant onze siècles, qui, pour cette raison, ne méritaient à leurs yeux aucune attention. Aussi cette partie de l’histoire européenne fut-elle négligée, et elle l’est encore : les œuvres de penseurs aussi considérables qu’un Abélard ou un Thomas d’Aquin n’occupent pratiquement aucune place dans nos histoires de la philosophie. Le Moyen Age demeure dans notre esprit l’époque oubliée, mystérieuse, et c’est peut-être bien la raison principale de l’engouement dont il est aujourd’hui l’objet.
Forgée en fonction de l’évolution de notre culture, la notion de Moyen Âge ne s’applique évidemment qu’à l’Europe. Il n’y a pas de Moyen Âge indien, persan, soudanais, il n’y a pas non plus de Moyen Âge chinois ou encore japonais ou, s’il y en a un, il n’a pas lieu au même moment que le nôtre. L’un des mérites essentiels de l’Histoire du monde est de mettre en évidence ces disparités et ces discordances, de montrer la nécessité, spécialement pour la période que nous continuons d’appeler Moyen Âge, de reconsidérer la place de la civilisation européenne par rapport aux autres civilisations du monde. Car, durant très longtemps, l’Europe occidentale fut l’une des régions les plus démunies de la planète. Elle fut certes emportée, au XI°, au XII°, au XIII° siècle, par un puissant élan de croissance qui lui permit de rattraper son retard. Pourtant, à la fin de cette phase de bouleversants progrès, Marco Polo était émerveillé par les raffinements qu’il découvrait alors en Chine.
À l’échelle du monde, l’histoire, tout au long de ces onze siècles, reste dominée par l’opposition et le conflit permanents entre nomades et sédentaires, entre les peuples errant dans la steppe ou la forêt et ceux qui sont enracinés dans une campagne. Pour les premiers, aguerris par le danger constant et par la difficile recherche de la subsistance, les seconds sont des proies faciles. Les nomades convoitent les richesses produites par le travail agricole et qui s’accumulent dans les cités. De temps en temps, on les voit se jeter sur les villes, piller, parfois s’établir durablement en conquérants, dominer alors, exploiter des populations dont il arrive que la part la plus misérable accueille favorablement les envahisseurs, car ceux-ci sont porteurs d’une religion plus simple, sans clergé, moins exigeante et donc séduisante. De la forêt sont ainsi sorties les tribus barbares qui s’infiltrèrent dans les provinces occidentales de l’Empire romain et les soumirent au V° siècle au pouvoir de leurs rois ; puis, aux VIII°-IX° siècle, les Scandinaves, qui fondèrent un peu plus tard, en Angleterre, en Normandie, en Russie, en Italie du Sud, des États vigoureux et agressifs ; au XV° siècle, enfin, les Incas, qui subjuguèrent les peuplades des hauts plateaux andins. Des déserts et des steppes, on vit surgir successivement les Arabes au VII° siècle, les Hongrois au X°, les Turcs Seldjoukides au XI°, les Aztèques au XII°, les Mongols de Gengis Khan au XIII°. Certaines de ces migrations violentes et ravageuses aboutirent à la création d’empires démesurés. Mais toutes finirent par buter contre les môles que formaient les pays de forte paysannerie. Ainsi furent épargnées la Chine du Sud et l’Inde du Sud. Ce fut la chance de l’Europe occidentale de l’être aussi, à partir de l’an mille. Elle est la seule région du monde qui pendant tout le dernier millénaire n’ait jamais subi le joug d’envahisseurs étrangers. Ce privilège insigne explique le développement continu qui lui permit d’étendre son pouvoir. Elle doit cette expansion principalement à un prodigieux essor de l’agriculture, assez puissant dès le XIII° siècle pour arrêter sur les lisières orientales de la Pologne et de la Hongrie le flot des Mongols.
À l’étonnante aventure de Gengis Khan, fondateur d’empire, succéda au XIV° siècle celle de Tamerlan. Une centaine d’années auparavant, les Turcs, venus des steppes de l’Asie centrale, étaient apparus en Asie Mineure. Il y avait alors quelques générations que, par l’effet de leur réussite agricole, et grâce aux ferments de hardiesse vagabonde que les pirates vikings y avaient introduits, l’Europe était devenue à son tour conquérante. Les agents de son expansion furent de jeunes guerriers, des missionnaires ardents et des marchands qui, dans ce monde entièrement ruralisé, étaient les plus mobiles. Ce petit groupe, très marginal par rapport à ensemble de la population, grossit et se renforçât dans la poursuite du développement général. Le jeu de la fiscalité seigneuriale, les donations pieuses, le courtage, le prêt à usure transféraient entre les mains de ces aventuriers la plus grande part des profits de la croissance rurale. Ils bénéficiaient en outre d’un progrès continu qui affectait principalement les techniques du combat, de la marine, du commerce et de la communication écrite et orale. Ces hommes de guerre, ces prêtres, ces trafiquants s’élancèrent par prédilection vers les pays extérieurs les plus riches, la péninsule Ibérique islamisée, l’Italie méridionale et la Sicile, enfin l’Orient méditerranéen. Ils repoussèrent vers la Méditerranée les frontières de la chrétienté latine, et leurs entreprises contribuèrent de manière décisive à l’essor de la civilisation européenne. Ceux qui revinrent de ces expéditions lointaines rapportèrent avec eux de beaux objets, certes, mais surtout une masse de connaissances nouvelles, un immense trésor que les hommes d’Église découvrirent et traduisirent de l’arabe dans les bibliothèques de Tolède ou de Palerme, les œuvres des philosophes et des savants de la Grèce antique et celles de leurs successeurs sarrasins.
Le rêve des croisés de se fixer en Terre sainte s’effondra à la fin du XIII° siècle. Mais, à cette époque, le Levant constituait un vaste et fructueux marché pour les négociants italiens, dont certains commençaient de se risquer par les routes de la soie vers les provinces fortunées de l’Inde et de la Chine.
Les Ottomans étaient alors en marche. Ils s’avançaient irrésistiblement. Cette dernière vague d’invasion fut arrêtée, difficilement, dans les Balkans et les Carpates. La menace cependant devait subsister de longs siècles et, dès lors, l’énorme et pesante domination établie sur le monde grec et musulman ferma l’accès du Proche et de l’Extrême-Orient aux Européens. Les plus aventureux d’entre eux durent se tourner vers l’Ouest et regardèrent vers l’Océan. Les perfectionnements de la cosmologie, de la cartographie, de l’architecture navale et des techniques de navigation permettaient de tenter l’aventure. Les Portugais se lancèrent les premiers au XV° siècle. En 1487, les caravelles portugaises doublèrent le cap de Bonne Espérance et pénétrèrent dans l’océan Indien. Quelques mois plus tard, persuadé que la Terre était ronde, Colomb allait cingler droit vers le couchant. Il tomba par hasard sur un nouveau monde, ouvrant ainsi la voie à une invasion conquérante, plus brutale et beaucoup plus destructrice que celle dont l’Europe avait failli être l’objet de la part des Mongols et des Turcs.
LES TEMPS MODERNES
Jean DELUMEAU, professeur au collège de France
C’est une évidence que beaucoup de problèmes qui se posent actuellement à la communauté humaine se sont noués plusieurs siècles auparavant, et notamment durant la période qu’en France nous appelons moderne (par opposition à la période contemporaine). Et c’est à bon escient que nous lui appliquons le qualificatif de moderne. Non, bien sûr, par mépris pour la longue séquence antérieure. Heureusement, le Moyen Age n’est plus l’objet aujourd’hui d’aucune dépréciation. Il a produit dans les domaines de la spiritualité, de l’art et de la pensée des œuvres admirables, voire inimitables. D’autre part, le Moyen Âge s’est assez largement prolongé dans la période suivante, malgré le sentiment d’avoir créé une coupure que nourrirent avec un peu trop d’orgueil les créateurs du vocable Renaissance, le premier d’entre eux étant Pétrarque. Il reste que la découverte de l’Amérique en 1492, la cassure religieuse créée par l’excommunication de Luther en 1521 et la publication en 1543 de l’ouvrage où Copernic exposait son système astronomique constituèrent des faits d’une importance immense dont nous continuons à vivre les conséquences. En un demi-siècle se trouvèrent ainsi réunies les conditions d’un énorme changement en profondeur – qualitatif et quantitatif – de l’histoire humaine, et pas seulement européenne.
Généralisons cette méthode rétroactive qui consiste à regarder derrière nous et nous apercevrons rapidement combien nous restons tributaires de situations créées il y a trois ou quatre cents ans, c’est-à-dire durant la période moderne. Soit le cas de l’Irlande que nos journaux écrits ou télévisés évoquent si souvent : à quand remonte le problème irlandais ? Aux XVI° et XVII° siècles, quand successivement Elisabeth I° en 1594 et 1603, puis Cromwell en 1649 matèrent les révoltes des Irlandais qui voulaient rester catholiques et ne pas être anglais. Les vaincus durent souvent abandonner leurs terres aux nouveaux arrivants. Quant à la situation tragiquement complexe de l’ex-Yougoslavie, elle s’explique notamment par les progrès réalisés dans les Balkans aux XV° et XVI° siècles par la puissance ottomane : la Serbie indépendante détruite en 1459, la Bosnie en 1463, Belgrade (alors hongroise) occupée en 1521. Des populations turques s’installent désormais dans les régions auparavant exclusivement chrétiennes. A quoi s’ajoutent les effets toujours actuels du schisme qui sépara en 1054 l’Église romaine (celle des Croates) de l’Église byzantine (celle des Serbes).
On n’efface pas facilement l’histoire dans la mémoire collective de ceux qui héritent de ses injustices. La preuve la plus évidente en est sans doute le problème noir, legs d’une période (XVI°-XIX° siècle) qui arracha au continent africain entre 10 et 15 millions d’esclaves (voire davantage), pour les transporter brutalement outre-Atlantique. Qui pourra jamais établir le bilan – culturel et économique – de cette transplantation forcée dont les conséquences marquent toujours notre temps ? Mais, Dieu merci ! l’héritage du passé n’a pas que ces couleurs sombres. Et, en Europe notamment, ce legs est d’une richesse exceptionnelle. Nous ne pourrons aborder avec des chances de succès l’avenir – forcément mystérieux – qui s’ouvre devant nous sans nous appuyer sur ce que la foi, l’intelligence et le sens artistique de nos devanciers ont produit chez nous de meilleur. Il s’agit là d’un patrimoine dont il est impossible de faire le tour tellement il est vaste. On ne peut que suggérer quelques voies pour y pénétrer, libre ensuite à chacun d’aller avec prédilection dans tel ou tel coin de ce merveilleux jardin. Jamais auparavant dans le temps et dans l’espace on n’avait produit autant d’œuvres d’une indiscutable valeur artistique que dans l’Europe des XVI°-XVIII° siècles, qui vit se succéder la fin du gothique, la Renaissance, le baroque, le rococo et le néoclassicisme. Cette prodigieuse fécondité et cette accumulation de chefs-d’œuvre constituent un fait d’histoire dont nous prenons, heureusement, de plus en plus conscience. Ce n’est pas par hasard que, de nos jours, nous agrandissons et nous multiplions les musées, et que nous restaurons amoureusement les monuments du passé. Ils sont les témoins de notre histoire, notre capital pour affronter les tâches de l’avenir. Or, de Léonard de Vinci à Tiepolo, de Bramante à Soufflot, de Michel-Ange à Houdon, de Palestrina à Mozart, quel stupéfiant itinéraire artistique ! quelle variété de talents ! quelle richesse d’inspiration ! quelle maîtrise dans chacun des beaux-arts !
Mais la période moderne, c’est aussi la foi chrétienne réaffirmée dans les deux versions catholique et protestante; la naissance de la science avec les travaux de Galilée, Descartes, Leibniz, Newton ; les progrès décisifs de la technique (la lunette de Galilée est de 1609, la machine à vapeur de Watt, de 1769) ; l’émergence des notions sur lesquelles est fondée la démocratie moderne : la tolérance et les «droits de l’homme. Longtemps le vocable tolérance avait été affecté d’une connotation péjorative : on tolère ce qu’on ne peut empêcher.
Avec Locke, qui écrivit, en 1689, ses Lettres sur la tolérance le mot commença à prendre la signification positive que nous lui donnons aujourd’hui : le respect de l’opinion d’autrui lorsqu’il ne cherche pas à l’imposer par la force. Quant à la célèbre Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789, elle avait été précédée par un long mouvement des idées qui avait progressivement, en particulier au cours du XVIII° siècle, dégagé – et d’abord sur des bases chrétiennes – la valeur irréductible de chaque être humain.
Une des grandes qualités de la collection l’Histoire du monde est sa présentation en triptyque largement ouvert sur les continents autres que l’Europe : un parti méthodologique qui évite de rétrécir l’histoire du monde à celle de l’Occident. Car, longtemps encore après les deux premiers voyages autour du monde – celui de Magellan en 1519-1522 et celui de Drake en 1577-1581 -, l’Empire chinois continua sa carrière autonome et le remplacement, en 1644, des Ming par les Qing venus de Mandchourie fut indépendant de toute influence européenne. La même évidence vaut pour l’essor de l’Iran chiite dont l’apogée se situe sous Abbas I°, qui accède au trône en 1587 et règne jusqu’en 1629. C’est l’âge d’or des miniatures persanes, des velours brodés, des marqueteries en bois et métaux précieux, des arabesques en céramique colorée. En 1598, Abbas fait d’Ispahan sa capitale dont la place Royale, la mosquée de l’Imam avec sa coupole de faïence bleue, les palais et les parcs continuent d’émerveiller les visiteurs. Abbas I° a été, pendant quelques années au moins, le contemporain d’Akbar, le Grand Moghol, qui régna sur l’empire des Indes de 1556 à 1605, au moment où la France se déchirait dans les guerres de Religion et où l’Europe catholique s’efforçait de contenir difficilement l’avance turque. Assurément, Akbar connaissait quelque chose de l’Occident. Tolérant sur le plan religieux, cherchant même à développer un culte syncrétique, il reçut amicalement des jésuites venus de Goa. Mais ses succès militaire – il étendit son empire du Bengale à l’Iran et de l’Afghanistan au Gujerat -, ses réformes administratives, sa politique souple d’association des élites hindoues au pouvoir musulman se développèrent en dehors des grands courants de la civilisation occidentale. C’est à l’influence persane qu’il ouvrit largement son empire et celle ci se manifesta aussi bien dans la littérature que dans la peinture et l’architecture.
La percée européenne en direction de l’Orient et de l’Extrême-Orient, qui néanmoins se manifestait de plus en plus depuis le début du XVI° siècle, suscita parfois des réactions de rejet dont la plus connue est celle du Japon. Les shoguns d’Edo – les Tokugawa -, qui gouvernent à partir de 1600, interdisent le christianisme, expulsent les étrangers, décrètent un isolement qui durera jusqu’au XIX° siècle. Cet isolement s’accompagna cependant de prospérité économique et de floraison artistique.
Ainsi l’histoire s’est longtemps déroulée à l’échelle mondiale dans des compartiments séparés les uns des autres et selon des rythmes qui n’étaient pas synchrones. Toutefois – vérité évidente -, le monde se rétrécit de plus en plus. Or ce mouvement de contraction de notre planète sur elle-même, peu sensible avant la Renaissance, s’est sans cesse accéléré depuis. La période dite moderne, avec la réalisation pour la première fois d’une économie monde, selon la formule de Fernand Braudel avec l’émigration européenne en Amérique du Sud et du Nord, avec la déportation de millions de Noirs outre-Atlantique, avec des transferts culturels de plus en plus intenses en latitude et en longitude, a créé les conditions de notre civilisation d’aujourd’hui. C’est pourquoi on est justifié à la séparer du Moyen Age. À partir du XVI° siècle, les aiguilles de l’horloge se sont mises à tourner plus vite sur un cadran dont le périmètre a été en se raccourcissant.
Le XIX° siècle
Théodore ZELDIN, professeur à l’Université d’Oxford.
Traduit de l’anglais par M.-F. Dréano
On ne peut plus considérer le XIX° siècle comme une époque héroïque. Certes, chaque génération est tentée de changer d’avis sur le passé, comme le font certains enfants qui, ayant grandi, ont de leurs parents une image différente de celle, idéalisée, de leur jeunesse, tandis que d’autres refusent cette lucidité et préfèrent vivre avec des souvenirs d’emprunt. Quoi qu’il en soit, il est aujourd’hui impossible de continuer à croire en l’idée que le XIX° siècle se faisait de lui-même.
Tout d’abord, ce siècle croyait avoir raison. Il était convaincu de s’améliorer constamment, et cela l’encourageait à penser que, lorsqu’il faisait quelque chose de grandiose et de spectaculaire, c’était forcément un progrès. En réalité, il s’égarait souvent. Il a certes accompli plus de progrès dans les domaines de la technologie et de la science qu’aucun autre siècle précédent, mais, en 1820 déjà, le langage même de la science commençait à devenir incompréhensible pour la plupart des gens. La spécialisation tendait à créer, dans le monde de la connaissance, une ségrégation aussi dangereuse que la ségrégation sociale, source de tant de luttes.
Au début du XIX° siècle vécut un homme qui fut probablement le dernier à avoir une vue générale de toutes les civilisations et toutes les sciences. Les sympathies d’Alexander von Humboldt (1769-1859) étaient aussi étendues que sa curiosité. Allemand, il choisit de vivre à Paris parce qu’il pouvait y mener les débats les plus intéressants avec les gens les plus divers.
Il n’y a pas de races inférieures disait-il, au moment où ses contemporains se persuadaient de la supériorité de la race blanche sur toutes les autres, et il se consacra à l’exploration de la Sibérie et de l’Amérique latine alors même que la plupart de ses contemporains succombaient à la nouvelle idéologie nationaliste qui les décourageait de s’intéresser à autrui.
On se fit à cette époque un devoir de penser que sa nation était meilleure que toutes les autres. Dorénavant, la première chose qu’apprirent les écoliers fut l’histoire de leur propre pays avant tout le reste, et cela continua ainsi. Le XIX° siècle est toujours vivant.
Le XIX° siècle rêvait de paix, mais croyait aux vertus de la guerre. Il admirait la force, la violence, la victoire. Certes quelques femmes eurent le courage de protester, mais elles étaient pénétrées des valeurs mêmes qui les opprimaient, et croyaient qu’en s’unissant, en formant une armée, elles auraient la force de vaincre l’oppresseur mâle. C’était oublier que la législation ne peut pas changer les mentalités. Inconsciemment, elles empruntaient leurs méthodes à la classe ouvrière, qui elle-même empruntaient les siennes aux riches et aux puissants. Nous comprenons aujourd’hui que la victoire produit presque invariablement des effets pervers, et qu’on ne peut obtenir par la force ce que la civilisation a de plus désirable.
Quant aux relations entre hommes et femmes, le XIX° siècle romantique offre un modèle chimérique; la plupart des gens de ce temps continuèrent à se marier comme il l’avaient toujours fait : pour assurer avant tout la transmission des patrimoines. La révolte romantique contre cet état de fait donna l’impression d’une libération, mais elle présentait de sérieux inconvénients ; le mariage fondé sur l’amour-passion était bien, en effet, pour un individu qui ne suivait que ses élans les plus profonds, une révolte contre les parents et les traditions, mais c’était aussi en quelque sorte, une aliénation : les romantiques voulaient que le couple fusionnât, devînt une seule personne, au risque pour l’un et l’autre de perdre sa personnalité. D’autre part, l’amour romantique étant fondé sur l’idéalisation des femmes, les hommes ne se donnaient-ils pas le mal de découvrir la véritable femme derrière leur idole ? Les frustrations, les échecs sentimentaux et l’incommunicabilité de notre siècle perpétuent ceux du XIX° siècle.
À une époque où, comme tant de fois auparavant, la famille était en crise – ce qui signifie qu’elle était en train de changer – le XIX° siècle définit un idéal familial, et condamna comme immoral tout non-conformisme.
Nous sommes injustes quand nous critiquons cette époque pour avoir refusé le changement, alors que nous sommes nous-mêmes si troublés par ceux de notre propre temps. En fait, les contemporains eurent le plus grand mal à comprendre le changement de statut des enfants, qui d’atout économique chargés d’augmenter le revenu familial, se transformaient en objets d’amour, dont les caprices font la joie et le cauchemar des parents.
Ce siècle était convaincu de connaître toutes les réponses, ou d’être sur le point de les découvrir, mais il vivait dans la peur. Découvrant l’anesthésie, il eut plus que jamais peur de la douleur, découvrant l’antisepsie, il vit partout de dangereux microbes, et l’hypocondrie fut la contrepartie des progrès médicaux. Épousant l’idée de bonheur personnel, il ne trouva souvent que la solitude. Siècle de l’éducation, il fut autant celui de l’opium. Grande époque de migrations, il donna à certains une vie nouvelle, mais en déçut beaucoup.
Le mépris et l’ignorance à l’égard des étrangers furent le contrepoids aux courageux voyages d’exploration et à la tolérance qui naissait à l’intérieur des frontières nationales. Si les Britanniques, par exemple, n’avaient pas utilisé les hindous contre les musulmans aux Indes, détruisant ainsi le modus vivendi que les deux communautés avaient à peu près établi à leur satisfaction mutuelle, on aurait épargné à notre époque le million de vies perdues lorsque les luttes recommencèrent. Le colonialisme fait partie de notre héritage. De nos jours comme au XIX° siècle, nombreux sont ceux qui voient dans les conflits un stimulant nécessaire au progrès, et parmi eux, les tenants de la tradition républicaine en France. Persister dans de telles opinions équivaut à garder de l’univers une vision que récuse la science contemporaine. Il est en effet évident que ce n’est pas tant la force qui cause les changements les plus importants, que de subtiles combinaisons de molécules. À cette époque, les relations entre individus, entre nations restèrent tendues, celles qui s’établirent entre continents et civilisations étaient porteuses de terribles avertissements.
La bureaucratie qui se développa au XIX° siècle fut d’abord authentiquement libératrice, elle essaya d’abolir le népotisme et le favoritisme : l’impersonnalité devait apporter la justice et le fit dans une certaine mesure. Mais c’est surtout par des moyens financiers que l’État Providence tenta d’abolir la pauvreté et l’insécurité, mais ni l’argent ni l’administration ne pouvaient suffire à compenser tant de vies gâchées et frustrées. Nous voyons maintenant les limites de la compassion institutionnelle, qui n’a pas le temps de communiquer avec ceux qu’elle aide. Le XIX° siècle perdure dans notre vie quotidienne, quand nous nous rendons à l’usine ou au bureau chaque jour à la même heure. On imaginait alors que la régularité était la clé de la prospérité et il est vrai qu’elle rendit possible la production sans cesse accrue de biens identiques. La plupart des hommes qui résistaient à l’idée d’être transformés en machines durent céder et devinrent un nouveau type d’esclaves volontaires. Aujourd’hui, nous avons perdu tout intérêt pour les routines monotones qui nous ont été léguées, nous souhaitons avant tout avoir des métiers intéressants – et pas seulement bien payés – et rêvons d’inventer des professions qui feront passer l’épanouissement de l’être humain avant les impératifs de production. Le XIX° siècle nous a légué sa manie de classifier, de faire des distinctions entre les personnes comme entre les groupes. Aujourd’hui, il nous faut au contraire découvrir ce que les hommes ont en commun.
Beaucoup de gens courageux et extraordinaires vécurent en ce siècle. Son art, sa science, sa littérature témoignent d’une recherche constante de la beauté et de la vérité. Nous ne pouvons pas souhaiter que le XIX° siècle n’ait pas eu lieu : il y a énormément à apprendre de ses expériences, de ses déceptions comme de ses triomphes. Mais nous ne pouvons plus y penser comme à la Belle Époque à moins d’ignorer délibérément les grandes souffrances qu’il a causées. Chaque siècle commet des erreurs : c’est pourquoi l’histoire est intéressante, et son étude nécessaire. Mais, s’il est impossible de ne pas commettre d’erreurs, il est inexcusable de les répéter. Au travers des événements décrits dans ce volume de l’Histoire du monde, les lecteurs peuvent se découvrir eux-mêmes, comprendre plus clairement ce qu’ils acceptent et ce qu’ils rejettent.
Le XX° siècle.
Jean Pierre RIOUX, inspecteur général de l’Éducation nationale
Ce XX° siècle, le nôtre, né dans le sang de la Grande Guerre de 1914-1918, est mort avant son terme, entre 1989 et 1991, avec l’effondrement spectaculaire, médiatisé, si peu violent et si peu pleuré, de sa dernière idéologie mortifère, le communisme. Depuis lors, nous sommes en quelque sorte orphelins, jetés sans soutiens ni repères dans une fin de siècle numérique qui n’en est plus une, transis dans l’attente d’un 2001 qui remettra peut-être à l’heure la pendule de l’histoire. Or cette incertitude d’un présent envahissant et trop peu signifiant, cette latence du temps nous taraude, entretiennent l’impuissance et brouillent l’espoir. C’est donc elles qu’il faudra bien apprendre à surmonter. Et l’histoire devrait être alors – elle l’est déjà – d’un vrai secours pour renouer le fil entre passé et avenir, pour faire taire la cacophonie d’un actuel si irrésolu.
Cette conviction court tout au long de ce dernier volume de l’Histoire du monde dont les auteurs ont su fort bien déplier toute la trame et décrire les déchirures de notre temps. Il donne, je crois, à chacun d’entre nous tous les éléments utiles à une réflexion active. Car il ne s’agit plus d’exhumer des valeurs mortes ou de chercher des racines douteuses, de suivre avec nostalgie le jeu des références : c’est plutôt une prise en charge et une mise en compte lucides de ce siècle qui importent. En un mot : faisons une lecture à la hache, qui élague le bois mort mais laisse aussi perler la sève des rameaux vifs.
De quelles constantes historiques du XX° siècle faudrait-il à la fois nous imprégner et nous départir pour relancer le cours du temps ? J’en vois quatre présentes à toutes les pages de ce livre : le tragique inouï, le progrès unificateur, l’inégalité chronique et la déraison affichée.
Le tragique ? C’est l’évidence la plus affreuse.
La violence collective a prospéré comme jamais depuis 1914, avec deux guerres déchaînées sur l’ensemble du globe, qui ont tué, mutilé, violenté et broyé d’une manière sans égale dans toute l’histoire de l’humanité. Notre siècle a inventé la planète en feu et l’Apocalypse en suspens, avec engrenage fatal des crises, industrialisation de la mort, centaines de millions d’hommes jetés dans la tourmente, massacre des civils innocents, cumul des vieilles haines nationales et des nouveaux racismes, jusqu’à la double angoisse inédite de 1945, celle d’Hiroshima, puis des équilibres de la terreur nucléaire, puis celle qu’a laissée la solution finale, crime des crimes contre l’humanité. Cette singularité guerrière et bestiale n’a d’ailleurs pas suffi à l’économie séculaire de la tragédie : des drames permanents ont sous-tendu les paroxysmes de 1914-1918 et de 1939-1945. Voilà que les idéologies sont devenues folles sous le choc insurmontable de 14-18 et qu’elles ont nourri, de 1920 à 1990, ces destructions programmées de l’homme qu’il a fallu apprendre à nommer les totalitarismes. Voilà aussi les économies déréglées, bousculées deux fois par des crises mondiales dans les années 1930 et depuis le début des années 1970, qui engendrent elles aussi la violence du chômage et du doute. Voici l’inépuisable vague des nationalismes, révolutionnaires ou simplement tueurs de l’Autre, habillés de tous les oripeaux du racisme, du progressisme, du populisme ou de l’intégrisme. Voici encore les famines périodiques, les carences chroniques, les nuisances dévoreuses d’ozone et d’environnements qui ajoutent à la longue liste des sources constantes de tensions promptes à dégénérer. Comment pourrions-nous demain désarmer cette vocation tragique, sinon d’abord en connaissant historiquement et intimement ses ravages ?
Nonobstant, ce fut aussi un siècle de progrès en spirale tout aussi inouïs. Cette constante il est vrai, est de lecture moins évidente, car notre culture et nos enseignements ont mal intégré la rapidité et la complexité des avancées du savoir et du mieux-être, car les médias en parlent peu ou mal, alors qu’elle a tant marqué notre vie de tous les jours. Dès lors aussi que la science et les techniques ont été mises au service de tant de destructions, jusqu’à la bombe comprise, elle reste marquée au sceau de la tragédie du siècle et le doute s’est ainsi insinué dans nos esprits. Il faudra bien pourtant mesurer l’étonnante explosion et la croissance exponentielle des savoirs qui ont nourri l’âge contemporain et dont témoignent, en bel exemple, les domaines aussi divers que la physique théorique, la génétique ou les sciences humaines. Et comment ne pas penser fièrement à tout l’aval, quand les victoires des techniques ont transformé le travail, bouleversé le train-train quotidien et donné à la vie tant de capacités à triompher ? Quelles qu’aient pu être les désillusions de ces progrès, si légitimes que soient les questions qu’il faut poser depuis Orwell aux sociétés techniciennes, si forte qu’ait été la cascade des défis nouveaux engendrés par la science, on ne peut guère se lasser de découvrir le cheminement irrésistible de ces progrès-là, si proches, qui ont réchauffé et élevé l’homme moderne.
Ce relatif optimisme scientifique et technique mérite qu’on s’y attache aussi parce qu’il fut le plus puissant facteur d’unification de la très belle orange bleue qu’ont contemplée les astronautes. Sans victoires scientifiques sur la mort, sans développement des techniques de santé, notre monde ne serait pas aussi plein comme un œuf, après une explosion démographique sans précédent dont le rythme a décollé après 1940 et s’est fixé dans les années 1960 aux alentours de ces 2 % annuels qui conduisaient mathématiquement à un doublement de la population du globe tous les trente ans, soit à chaque génération. Sans focalisation des progrès et du mieux-être d’abord dans les villes, le monde urbain n’aurait jamais attiré tant de ruraux en quête d’une autre vie et son explosion nous eût sans doute été épargnée. Sans techniques enfin, l’unité du monde ne se serait pas faite sous le signe de la vitesse vibrionnante, qui a aboli les distances, facilité l’échange et bousculé tous les modes de la communication entre les hommes : plus que les transports physiques eux-mêmes, ce sont les messages écrits, parlés et imagés, fruits d’une sophistication technicienne et véhiculés par les médias, multipliés par la télématique, l’informatique ou, demain, les autoroutes de l’info, qui ont hâté l’unification de la planète, l’ont inondée de produits et de sensations communes, et l’ont peut-être promise ainsi au rajeunissement.
Et pourtant, ce monde a engendré en continu le privilège et la soumission, sans que son ardeur communicative ait pu réduire ses inégalités foncières. Des hommes, des collectivités, des nations en ont ressenti l’humiliation, et le sentiment d’une injustice permanente a joué un rôle majeur dans le déroulement des drames, des crises et des progrès. Qu’il s’agisse de produit national brut, d’espérance de vie, de patrimoine ou d’accès au savoir et à la culture, l’échange inégal perdure tout en étant de plus en plus mal supporté. On s’en convaincra en lisant tout ce qui est dit ici sur la question lancinante du sous-développement, fut-elle rhabillée en contraste Nord-Sud ; sur les dominations et l’impérialisme des Grands, plus ou moins défaits par la décolonisation, la chute du dollar et la déliquescence de Moscou ; sur les situations d’injustice qui pullulent toujours dans un pays développé comme la France. Aujourd’hui, sous l’apparente unification du monde par le libéralisme du marché et de l’argent depuis la chute du mur de Berlin et l’échec de Gorbatchev, se dissimulent encore ou se manifestent déjà les très vieilles frustrations nées du mauvais partage de tous les gâteaux, qui a sans cesse enrichi les riches et fait payer les pauvres. De ce vice de répartition aussi il faut prendre la mesure exacte et la claire conscience à travers un rappel historique.
Enfin, faire un bilan du siècle nous oblige à quelque retour sur ses usages, si inégaux eux aussi, de la raison et de la déraison, au point de devoir conclure que la seconde l’a sans doute emporté sur la première. Ce panorama culturel, qui signale tout ce qui a armé ou désarmé les cœurs et les esprits, doit peser le rôle des avant-gardes et des masses, opposer les cultures des grandes interrogations sur l’avenir à la monotonie de la culture, grande consommation inlassablement médiatisée, dire le poids exact des valeurs revendiqué qui ont jeté l’homme dans des combats collectifs aux objectifs et au dénouement incertains ou fatals et le rôle de celles qui n’ont pas cessé, de retrouver l’individu et la personne broyés par les pouvoirs sans âme et les idéologies de fer. C’est le cheminement chronologique même de ce siècle qui doit être alors être questionné, dans sa kyrielle de trahisons et de dénégations. Pourquoi la modernité multiforme qu’exprimèrent superbement les années 1920 a-t-elle été impuissante, occultée puis négligée ? Pourquoi restons-nous si entêtés des décennies suivantes, où l’ombre des totalitarismes a failli tuer la pensée ? Et comment ne pas saluer cette culture de l’homme et de ses droits, fille de l’Europe, qui affronte à armes si inégales depuis les vingt dernières années les retours offensifs et intégristes du religieux, tandis que la culture de masse et les modes de consommation universels brisent tant de particularismes ?
Décidément, le XX° siècle n’a pas cessé d’enterrer l’homme occidental. Ses techniques et des drames ont fait éclater les patrimoines, les communautés et les groupes sociaux. À nous de dire, dès à présent, si ses décombres bien explorés et soigneusement triés pourront servir à des reconstructions.
Épilogue de l’Histoire inachevée du monde. Hugh THOMAS
Les hommes et l’Histoire. Robert Laffont 1986
Beaucoup de nos comportements possèdent un précédent – même les craintes que nous croyons spécifiques à notre époque. La crainte de la destruction du monde à la suite d’une guerre atomique, à l’approche de l’an 2000 est comparable à l’appréhension ressentie par la chrétienté à l’aube de l’an 1000. Il est d’ailleurs étonnant que certains hommes d’Église n’aient pas vu dans l’histoire du XX° siècle, la marque de l’Antéchrist, dont le terrible empire, selon la croyance de l’Europe du Moyen-Âge, devait précéder l’avènement du royaume de Dieu. La situation du monde actuel, avec ses nations en lutte, est comparable à celle de la Méditerranée orientale à l’époque de Platon, transposée à l’échelle du globe. Tout comme aujourd’hui, il existait alors une multitude d’États de tailles diverses, aux constitutions différentes, qui se querellaient entre eux tandis que quelques grands empires agissaient en coulisses. Le reste de l’univers est pour nous ce que les déserts d’Afrique, la toundra russe ou les mers situées au-delà des colonnes d’Hercule, étaient aux Grecs. À l’époque, comme aujourd’hui, comme le dit Gilbert Murray à propos de la Grèce après la guerre du Péloponnèse, le monde était plein de superstitions occultes, et de culture de l’irrationnel ». On croyait à la chance et des orateurs, promettant tout, attiraient de vastes auditoires.
Il est cependant bon de noter quelques innovations. En premier lieu, si le monde semble plus amèrement divisé qu’aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été depuis la Renaissance au moins, il existe déjà néanmoins une société mondiale. Dans le monde non communiste en tout cas, les nouvelles se propagent vite et les rumeurs plus vite encore, tandis que les modes et les tendances traversent et retraversent le monde comme des vagues de mercure. Les pays sont en relation plus étroites les uns avec les autres que ne l’étaient les habitants d’un pays européen de taille moyenne avec leur capitale voilà cinquante ans. Le monde constitue une seule grande scène stratégique. Certes, il existe de multiples langues, mais l’anglais semble déjà être une langue universelle. La mesure du temps et les calendriers sont déjà presque les mêmes dans la majeure partie du monde, tandis que la mesure des distances, des poids et des surfaces semble devoir rendre hommage à Napoléon et suivre le système métrique. La tendance croissante des peuples à se prononcer de façon catégorique sur les agissements des autres pays est le signe d’une société mondiale. S’il s’oppose au nationalisme culturel inculqué par les mass media, et au nationalisme commercial encouragé par la politique intérieure des régimes collectivistes, cet état de choses n’en existe pas moins.
Certains aspects de la situation politique sont nouveaux aussi. Disparues, les tribus nomades, les cités de la majorité des monarchies tribales qui florissaient en 1750 dans la majeure partie du globe. Disparue aussi l’ambiguïté relative au droit de tel ou tel peuple à tel ou tel territoire. Les terres du globe, et une grande partie des eaux sont clairement réparties entre quelque cent soixante-dix Etats dont les institutions s’inspirent des États qui existaient déjà en Europe au XVIII° siècle et au XIX° siècle. Même les régimes tyranniques ont un ministère des finances, des services diplomatiques et des holdings traitant différentes affaires. La nature de ces États a elle aussi subi un changement radical. Environ cinquante d’entre eux sont des démocraties. Trente autres sont totalitaires : l’État s’y permet de contrôler la vie du peuple dans l’intérêt de ce que l’administration décrète être le bien de celui-ci. Les États restants sont autoritaires ou autocratiques ou sont des monocraties. Bien qu’il n’y ait généralement aucun moyen pacifique d’y changer le gouvernement, il y existe quelques sources d’autorité indépendantes – Église, hommes riches, grandes sociétés, syndicats, aristocrates. On trouve aussi dans beaucoup de pays des peuples privés d’État, et les revendications de ces derniers en faveur de ce concept moderne constituent l’un des pires problèmes du mode. Tant les démocraties que les États totalitaires sont apparues au début de l’ère industrielle, les unes reposant sur l’éducation de masse, et les autres sur un emploi habile de la technologie. Avant l’apparition des chemins de fer, du télégraphe et du téléphone, la difficulté des communications en général empêcha les tsars d’imposer à la Russie une dictature répressive de l’ampleur de celle que les communistes instituèrent au XX° siècle ! La technologie incite les démocraties comme les régimes autocratiques à la centralisation et au contrôle étatique. Une chose est certaine : si certains États autocratiques (ou démocratiques) se convertissent au totalitarisme dans l’avenir, ce sera la technologie qui aura permis ce changement, même s’il avait été auparavant prôné par l’idéologie.
En troisième lieu, presque tous les États modernes disposent de constitutions écrites comptant une vaste somme de lois écrites. Nous sommes là bien loin des conditions de vie de 1750, où aucun État ne disposait de tels documents, même si certains avaient des lois constitutionnelles. La plupart des pratiques politiques, à l’époque, reposaient essentiellement sur la coutume. L’aspect paradoxal de cette évolution est que la Grande Bretagne demeure le seul pays important du monde sans constitution écrite, alors que ce sont les pratiques britanniques qui ont inspiré la constitution américaine, laquelle inspira elle-même, de façon directe ou indirecte, les constitutions de la moitié du monde, et l’idée même du bien-fondé d’une constitution écrite.
En quatrième lieu, il est devenu plus difficile que jamais d’établir des comparaisons salutaires entre pays riches et pays pauvres. Et ceci n’est pas simplement dû au fait que les pays agricoles pauvres achètent désormais du blé aux pays industriels riches. En effet, tandis que les dirigeants des pays richesse demandent comment prévenir un accroissement de la délinquance chez des petits bourgeois ou des cols bleus à l’abri du besoin, mais désœuvrés, les pays pauvres cherchent à donner un emploi aux millions de paysans pauvres qui se pressent, pleins d’espoir, vers des villes déjà surpeuplées. La communication audio-visuelle de masse offre des rêves de possibilités illimitées aux pays riches comme aux pays pauvres mais elle les met en même temps à la merci du charisme de certains dirigeants. Plus les gouvernements possèdent de facultés de contrôle, et plus la faculté de discernement du chef d’État prend d’importance. Malgré cette similitude, pays pauvre et pays riches possèdent désormais des préoccupations d’ordre différent. Il n’existe pas, d’un côté, un monde développé sans véritable problème, et de l’autre, un monde sous-développé nécessitant une aide extérieure. Il est impossible de dresser en toute honnêteté une liste énumérant les pays responsables du sous-développement ou du développement. Peut-être les choses seraient plus faciles si on le pouvait. Les problèmes pressants des pays riches semblent dérisoires face à ceux des pays pauvres, lesquels paraissant incompréhensibles, voire enviables, aux pays riches. Combien de fois des voyageurs sont-ils arrivés dans des régions reculées pour envier la simplicité rurale de quelques doux Auburn non déserté de la montagne péruvienne ! Les pays pauvres ne se rendent pas compte que s’ils peuvent souffrir de la faim faute d’attention, les pays riches peuvent tout aussi bien se trouver ruinés par un mauvais gouvernement. Cuba, qui se présente comme le chef de file du monde en voie de développement, est un bon exemple d’un pays riche ayant décliné jusqu’à connaitre une révolution, et non d’un pays pauvre toujours voué à la pauvreté.
Les femmes du XX° siècle ont assurément une vie différente de celle qu’elles étaient généralement contraintes de mener dans le passé. Nous avons simplement noté plus haut certaines des innovations techniques – dans le domaine de la cuisine et ailleurs – ayant participé à cette évolution. Mais le changement capital est que les femmes ont désormais beaucoup plus de chances qu’elles n’en ont jamais eu d’accomplir des choses par elles-mêmes, indépendamment des avantages procurés par le hasard de la naissance ou du mariage.
Une autre nouveauté de notre époque consiste en ce que la plupart des hommes politiques à la tête des États modernes sont perdus dans le labyrinthe scientifique et technique où leurs pays puisent leur puissance et leur débouchés – Hitler fut probablement le dernier conquérant en puissance à vouloir absolument connaître le fonctionnement des armes qu’il utilisait. Ce handicap des politiciens illustre bien la perplexité du public. Chaque année apporte désormais sa moisson de légendes et de rumeurs miraculeuses. Se pouvait-il que la présence simultanée dans le ciel d’un petit nombre d’avions supersoniques risque d’entraîner la désintégration de l’écorce terrestre ? Ce type d’histoire abonde. La formation scientifique de l’homme de la rue est généralement si pauvre qu’il est incapable d’en juger la véracité. Tout se passe donc comme si le monde vivait sous une sorte de censure où les ragots circulent avec empressement de bouche à oreille. Ainsi nous dit-on que la quantité d’oxyde de carbone augmente, et qu’il serait passé d’une concentration de 290 parties par million à 330 parties et pourrait s’approcher de 600 parties en l’an 2020. On pensait autrefois que cette augmentation était due à la combustion des combustibles fossiles. On l’attribue maintenant à la destruction des forêts. Le profane a toujours eu l’intuition de telles choses. Où donc en Angleterre se trouvent les grandes forêts de Knaresborough, de Charnwood, de Sherwood, de Cranceborne Chase, de Bere, demande-t-il vainement depuis des générations avec une ironie désabusée. Elles ont toutes disparues, plus complètement que les familles nobles du Moyen-Âge. On dit qu’il en résultera un accroissement de la chaleur et de l’aridité des terres. C’est en tout cas ce qu’il paraît. Mais chacun choisit sa propre rumeur funeste. Cet état de choses diffère du rationalisme du XIX° siècle, même s’il rappelle le Moyen Âge, et si beaucoup de ces craintes possèdent un fondement rationnel.
Il est caractéristique que les grands progrès scientifiques de ces quelques dernières années aient été accomplis dans un domaine incompréhensible au profane : l’électronique. Les minuscules antennes résultant de ces recherches ont permis à l’homme de se poser sur la Lune, de construire des satellites qui tournent autour de la Terre et de créer des engins balistiques intercontinentaux. Toutes les sociétés riches disposent maintenant d’ordinateurs, de machines à calculer, de satellites de transmission et de montres à affichage numérique, même si elles s’avèrent incapables de conserver leur sentiment de continuité. La robotique paraît être un des principaux progrès des années 1980. Tous ces systèmes dérivent du transistor (conçu en 1948 par les laboratoires Bell Telephone) qui remplaça le tube à vide, et de l’ordinateur, dont la première version mise au point en temps de paix fut construite à l’Université de Pennsylvanie, succédant à l’ordinateur construit avec succès pendant la guerre à Bletchley pour venir en aide aux grands spécialistes du décodage. La portée de ces récents événements et le nom des grands mathématiciens qui en ont permis la réalisation – Charles Babagge au XIX° siècle, Zuse, Schreyer, Howard Ayken et Alan Turing parmi d’autres au XX° siècle – éclipseront sans doute avec le temps une grande partie des autres faits décrits dans ce livre.
Le prix de ces systèmes de calcul, de mémoire et d’analyse, comme celui d’autres appareils tout aussi exceptionnels, ne cesse de baisser. L’ordinateur est désormais à la portée de toutes les bourses. Chaque maison pourra sans doute avoir bientôt accès par ordinateur à la bibliothèque du Congrès. Les microprocesseurs connaissant déjà un développement rapide. Tous ces progrès encourageront une collaboration internationale : si un ordinateur tombe en panne à Zürich, peut-être l’ingénieur téléphonera-t-il à un ordinateur de New-York pour trouver une solution. Les littéraires accomplis ont le sentiment, pour parodier Voltaire que l’une après l’autre, d’incompréhensibles machines viennent se succéder sur les rives de l’Hudson. Il deviendra d’ailleurs de plus en plus important d’avoir une connaissance de l’informatique : tous les étudiants de l’Université Harvard, y compris les étudiants en lettres, apprennent déjà à établir un programme d’ordinateur élémentaire. Les avions fonctionnant à l’énergie humaine, les bicyclettes volantes, la voiture à piles, la machine à écrire fonctionnant au son de la voix de son propriétaire (déjà mise en vente au Japon), le remède contre le moindre rhume et l’usine de dessalement à bas coût ne sont surement pas loin. Dans un avenir plus lointain, peut-être trouverons-nous le moyen d’assurer éternellement les conditions atmosphériques nécessaires à la survie de la terre dans l’univers d’après l’extinction du soleil
| Par l.peltier dans (101 : origine à l'an 01) le 31 décembre 2008 | (0) Commentaires | En savoir plus |
Ovide – 43 av. J.C. 18 ap. J.C. – Métamorphoses Livre premier
La matière, inerte pendant 15 milliards d’années, est devenue vivante vers 4 milliards d’années, se compliquant et s’organisant de plus en plus jusqu’à devenir pensante.
Notre histoire a 4 milliards d’années pendant lesquelles la vie, à l’origine unique, s’est étonnamment diversifiée, entraînant un nombre considérable d’êtres vivants, tous construits sur le même modèle moléculaire, aux formes très variées, de plus en plus complexes, de mieux en mieux organisées.
Après les êtres unicellulaires qui vivent dans l’eau, viennent les pluricellulaires qui sortent de l’élément liquide. Se fixent des plantes, s’égayent des insectes, apparaissent aussi les premiers vertébrés : des amphibiens comme les grenouilles, puis des reptiles, des sauriens comme les lézards, des dinosaures et toutes sortes de mammifères.
Les continents dérivent, s’éloignent ou se rapprochent ; plus tard, ils se soudent en d’immenses territoires entraînant de considérables changements de température et de climat. La position de la Terre sur son axe et son orbite comme les événements climatiques du Soleil suscitent des bouleversements de l’environnement terrestre qui provoquent la disparition de nombreuses espèces.
Les survivants s’adaptent, évoluent, constituant un immense arbre généalogique aux innombrables rameaux : des bactéries aux virus, des végétaux aux animaux, tous les êtres vivants sont parents. […]
Tout être vivant n’est en équilibre que dans un milieu : si celui-ci change, il se déstabilise et doit conquérir un nouvel équilibre ; cette évolution va le transformer : il acquiert peu à peu une autre forme, mieux adaptée au changement subi. Cette transformation participe aux divisions, aux ramifications de l’arbre généalogique dont nous faisons tous partie.
Yves Coppens Avant-propos de Nos ancêtres. L’Histoire des singes Odile Jacob 2009
vers 13.78 milliards [1] BIG BANG
L’Univers, jusqu’alors très chaud et très concentré, entre en expansion, ne cessant dès lors de se dilater et de se refroidir. L’univers primordial était un gaz formé de particules et d’antiparticules animées de mouvements désordonnés à des vitesses proches de celle de la lumière. Au gré d’incessantes collisions, certaines particules s’annihilèrent tandis que d’autres apparurent. Protons et neutrons commencèrent à se combiner une seconde après le Big Bang. Dans les minutes suivantes, une intense activité nucléaire permit la formation de noyaux atomiques légers, principalement d’hydrogène et d’hélium. Cette étape dura moins d’un quart d’heure.
À ces premières minutes exceptionnellement mouvementées succéda une longue période tranquille, fréquemment nommée les temps obscurs, car les étoiles n’étaient pas encore allumées. Ce n’est que 300 000 à 400 000 ans plus tard, lorsque la température s’abaissa au-dessous de 3000 kelvin, que le rayonnement put enfin se propager librement. Les premières galaxies se seraient formées un milliard d’années environ après le Big Bang.
Le Petit Larousse 2005
La chose la plus incompréhensible concernant l’Univers est qu’il est compréhensible… et qu’il ruisselle d’intelligence.
Albert Einstein
L’histoire de l’Univers peut se lire comme le récit de la métamorphose de l’inimaginable chaos des temps anciens en l’état formidablement associé des structures contemporaines. […]
Avant la première seconde de l’histoire du cosmos, une succession de transition de phases, accompagnées de pertes de symétrie, ont octroyé aux particules et aux forces les propriétés que nous leur connaissons aujourd’hui.
Un épisode particulièrement important se situe à la température critique de 1028 degrés quand l’Univers a quelque 10^-35 seconde d’âge. La force nucléaire se différencie alors des autres forces et prend progressivement sa puissante intensité. Cette différentiation dite de grande unification, provoque une division des particules en deux classes : d’une part, les quarks, sensibles à la force nucléaire, d’autre part, les électrons et les neutrinos, qui lui sont insensibles.
Vers 1015, lors d’une nouvelle transition de phase, dite électrofaible, la force faible se distingue de la force électromagnétique. Les électrons, sensibles aux deux forces, se différencient alors des neutrinos, qui ne réagissent qu’à la force faible. Quant à la force de gravité, sa différentiation remonte peut-être à l’époque de Planck. On ne sait pas bien.
Vers 1012 degrés, une troisième transition de phase associe les quarks, trois par trois, pour donner naissance aux nucléons (protons et neutrons). Au-dessus de cette température, les quarks nagent librement dans l’espace, comme les molécules dans l’eau liquide ; en dessous, ils sont assignés à demeure dans un nucléon comme les molécules dans la glace.
[…] Remontons une fois de plus jusqu’à la première seconde du cosmos. La température est de plusieurs dizaines de milliards de degrés. La matière cosmique se présente sous la forme d’une soupe de protons et de neutrons libres. Aucun noyau lourd n’existe encore. Quand la température atteint 10 milliards de degrés, une transformation majeure se produit appelée nucléosynthèse primordiale. Protons et neutrons se joignent [rencontres créatrices !] pour donner un début de variété nucléaire. Quatre noyaux se forment : de l’hydrogène lourd [deutérium], deux variétés d’hélium et une variété de lithium. Mais rien d’autre. La grande majorité des protons [75 %] n’est pas affectée. Ces particules demeurent comme dans un état de sursis grâce auquel nous avons des étoiles d’hydrogène.
[…] Les protons survivants de la nucléosynthèse primordiale constituent le carburant des astres. Si tous les protons et neutrons primordiaux avaient été transmutés en fer pendant cette première seconde du cosmos, la vie n’aurait jamais pu apparaître. […] L’hégémonie de la stabilité et son inséparable compagne, la monotonie, prévalent quand tout ce qui peut se passer a le temps de se passer. Dans un univers stationnaire, ces régimes s’imposeraient inévitablement. Même les réactions les plus extraordinairement lentes, les événements les plus fantastiquement improbables, se produiraient tôt ou tard. Les états d’équilibre auraient été depuis longtemps atteints et aucune variété n’existerait dans notre Univers. Les arabesques glacées de mes fenêtres illustrent le rôle des régimes de déséquilibre pendant l’évolution du cosmos. Comme l’eau déposée sur la fenêtre se refroidit trop vite pour s’étaler régulièrement sur la surface vitreuse, l’Univers se refroidit trop vite pour que l’hydrogène ait le temps de se transformer entièrement en fer.
Hubert Reeves. Oiseaux, merveilleux oiseaux. Seuil 1998
380 000 ans plus tard,
[…] Nulle étoile, nulle galaxie, pas le moindre caillou. La matière est chaude, à environ 3 000° et elle n’est faite que de particules microscopiques, des électrons et des protons qui, des millions d’années plus tard, s’assembleront en atomes lourds et en molécules.
Elle est même totalement opaque, car nul grain de lumière ou photon ne peut en sortir. Ceux-ci sautent d’électron en électron sans pouvoir s’extraire de la mélasse bouillonnante. Mais ces électrons jouent aussi avec les protons et finissent par se regrouper avec eux, privant les photons de leurs partenaires. La lumière jaillit. Les instruments du satellite Planck envoyé en 2009 à quelques 1.5 millions de kilomètres de la Terre, n’ont plus qu’à l’enregistrer.
C’est finalement comme s’approcher d’une boite de nuit bien insonorisée et d’ouvrir la porte : soudain un bruit assourdit les tympans. Reste à déduire de ce vacarme combien il y a de personnes, combien d’hommes et de femmes, ou l’heure qu’il est…
[…] L’Univers est composé de 4.8 % de la matière ordinaire que sont nos atomes, de 25.8 % de matière dite noire, invisible aux télescopes (et de nature encore inconnue), et de 69.4 % d’énergie noire, qui le pousse à grossir. Cet univers est également plat comme une gigantesque crêpe, alors que les estimations précédentes laissaient entrevoir la possibilité d’une légère courbure. Les chercheurs estiment aussi la vitesse avec laquelle les galaxies s’éloignent les unes des autres à quelque 66 kilomètres par seconde.
[…] Les analyses valident l’hypothèse qu’un phénomène incroyablement spectaculaire a bien eu lieu juste après le big bang et bien avant 380 000 ans : l’inflation.
Cette phase, encore floue, correspond à une fantastique dilatation de l’espace. Quelques milliardièmes de milliardièmes de milliardièmes de seconde après le big bang (le chiffre précis n’est pas encore connu), l’Univers passe d’une tête d’épingle à sa taille presqu’actuelle. Les mots en fait ne suffisent pas à décrire l’événement, car l’expansion correspond en réalité à une multiplication des distances par 10²5, un 1 suivi de 25 zéros.
David Larousserie Le Monde du 22 mars 2013, à l’occasion des photos communiquées par le satellite Planck, d’un rayonnement de l’Univers 380 000 ans après le Big Bang.
Au cœur des étoiles géantes, des noyaux d’atomes d’hydrogène fusionnaient pour devenir des noyaux d’atomes d’hélium. Quand l’hydrogène disponible a été épuisé, les noyaux d’hélium ont fusionné pour donner du béryllium, lequel en fusionnant avec de l’hélium a constitué des noyaux d’atomes de carbone. Et ainsi de suite. Peu à peu des noyaux d’atomes de plus en plus lourds sont apparus : oxygène, souffre, calcium jusqu’au fer. Ces étoiles massives étaient instables. Elles ont explosé, générant de gigantesques nuages, les nébuleuses. Il y a 4.5 milliards d’années, l’une d’elles s’est condensé et a donné naissance à notre système solaire. Les noyaux d’atomes les plus légers ont formé le soleil et les planètes gazeuses. Les plus lourds ont formé les planètes telluriques, comme la Terre.
Ça m’intéresse n° 464 Octobre 2019
Vers le milieu des années 1970, l’Américaine Vera Rubin, qui étudie la vitesse des astres autour du centre de leur galaxie, constatera que les étoiles et le gaz périphériques de la galaxie vont bien trop vite par rapport aux prédictions théoriques. La loi de la gravitation, formulée par Isaac Newton, qui rend compte du mouvement des astres, implique que plus les étoiles sont distantes du centre, plus leur vitesse de rotation est faible. Celles que Vera Rubin observe vont si vite qu’elles devraient même quitter la galaxie ! Si elles ne le font pas, c’est donc qu’une matière invisible leur apporte un supplément de masse qui les retient, assurant ainsi leur cohésion. Une masse invisible que l’on doit théoriquement retrouver autour d’elles, dans le halo galactique. L’énigme de la matière noire venait de naître ! […] Tout ce qui émet de la lumière, c’est-à-dire tout ce que les télescopes et lunettes peuvent déceler – les étoiles, galaxies, amas et superamas -, qui peuplent l’espace, ne représentent que 5 % de la matière existante dans l’Univers. Sous quelle forme se trouvent les 95 % restants, répartis en 25 % d’une énigmatique matière noire et 68 % d’énergie noire qui dilaterait de plus en plus l’espace. Comment s’y prendre pour les détecter ?
Si la Lune ne tombe pas sur la Terre, c’est parce que la vitesse de sa rotation lui procure une force centrifuge qui contrecarre exactement la force de gravité exercée par notre planète. Forts de cette loi, les scientifiques parviennent à calculer la masse de la Terre à partir de la vitesse de rotation de la Lune. Ce raisonnement est applicable à tout objet gravitant autour d’un autre, notamment aux étoiles prises dans le filet gravitationnel des centres galactiques, sujets des observations de Vera Rubin. Or la masse que la chercheuse comptabilisait dans chaque galaxie par cette déduction ne suffisait pas à rendre compte de la vitesse de rotation de ces étoiles : cette dernière était plus élevée que ne le prévoyait la théorie. Dit autrement, si seule la masse des étoiles influait, les galaxies devraient irrémédiablement se déliter, et les étoiles s’échapper pour se perdre dans l’infinité de l’espace intergalactique. Ainsi, les mesures de Vera Rubin contestaient l’existence même des galaxies !
Pour résoudre ce paradoxe, la scientifique conclut que les galaxies contiennent une matière actuellement invisible aux instruments de détection, qui exerce pourtant une influence gravitationnelle sur son environnement. Pour que l’équilibre de la matière en rotation autour du noyau galactique soit retrouvé, cette composante inconnue doit en outre être beaucoup plus massive que la seule masse de toutes les étoiles et nébuleuses réunies. À cette inconnue, les scientifiques ont donné le nom de matière noire. Si on sait aujourd’hui évaluer sa répartition dans l’Univers, sa nature reste un mystère.
Blandine Pluchet Le grand récit des Montagnes. Flammarion 2022
Dans la nature, une sorte d’art est à l’œuvre, une sorte de capacité technique orientée qui travaille la matière du dedans. La forme s’empare de la matière, elle refoule l’indétermination.
Aristote
Pendant à peu près 100 millions d’années, l’Univers traverse son Âge sombre :
C’est comme si nous étions sur une colline et que nous regardions une nappe de fumée étendue dans le fond d’une vallée. Il y a bien des photons dans cette nappe, mais ils diffusent dans des particules alentour et on ne peut voir que la surface de l’écran de fumée.
Benoît Semelin, astrophysicien à l’Observatoire de Paris.
vers 13.5 milliards d’années.
Naissance de la galaxie de la Voie lactée – la nôtre -.
Voici 10 milliards d’années, une titanesque collision a donné à la Voie lactée sa forme actuelle. Tel est le résultat annoncé, dans la revue Nature du 31 octobre 2018, par une équipe franco néerlandaise après la mise au jour, parmi les centaines de milliards d’étoiles qui tournent autour de son centre, d’un groupe de trente mille astres circulant à rebours. Amina Helmi de l’université de Groningue (Pays Bas) et ses collègues affirment que ces objets stellaires proviennent d’une ancienne galaxie, Gaia Enceladus, qui aurait percuté la nôtre avant d’être entièrement absorbée. Ces astronomes ont bénéficié des données de la mission d’astrométrie GAIA. Ce satellite de l’Agence spatiale européenne est chargé, depuis 2013, de constituer un catalogue de 1 % des étoiles de notre galaxie. Un labeur qui a abouti, en avril 2018, à livrer la position ultra précise, sur la voûte céleste, de 1,7 milliard d’astres. Pour plusieurs millions d’étoiles, GAIA a aussi fourni d’autres chiffres comme la distance, la vitesse, la luminosité, la température. Schématiquement, la Voie lactée peut être représentée comme un immense œuf au plat dont le bulbe – traversé par une barre colorée et renfermant un trou noir super massif – occuperait le centre, tandis que la périphérie serait constituée d’un disque mince, jeune et riche en gaz, et d’un disque épais un peu plus vieux. Tout autour, des objets stellaires isolés âgés, des galaxies naines et des amas globulaires (de grands regroupements de vieilles étoiles) constituent les halos interne et externe. C’est en plongeant dans cet océan de données qu’Amina Helmi et ses confrères sont tombés sur ces étoiles du halo interne aux étranges propriétés. Celles-ci circulaient à contre-courant des autres, sur des orbites plus allongées, et avaient des spécificités en termes de température de surface et de luminosité, raconte Carine Babusiaux de l’Institut de planétologie et d’astrophysique de Grenoble, qui a cosigné l’article. De cet objet extragalactique ne subsistent plus de nos jours que ces étoiles étranges du halo et quelques centaines d’amas globulaires repérés sur des trajectoires similaires. Mais son rôle n’en fut pas moins considérable. L’arrivée de Gaia Enceladus aurait provoqué un échauffement du disque mince de la jeune Voie lactée dont des millions d’étoiles auraient été déplacées, donnant naissance à une nouvelle structure, le disque épais, une région dont l’origine était fortement controversée parmi les astronomes. En septembre 2018, la même équipe a pu établir, à partir de l’analyse des mouvements de 6 millions d’étoiles, que le disque mince avait conservé la trace d’un autre événement cosmique, le passage de la galaxie naine du Sagittaire à proximité de la nôtre, il y a 300 à 900 millions d’années.
Vahé ter Minassian. Le Monde du 3 01 2019
vers 13.03 milliard d’années.
Les premières sources de lumière – étoiles massives, mini-quasars – commencent à se former. Ici et là, de petits surcroits de densité attirent peu à peu la matière alentour. En grossissant, ces poches de densité finissent par s’effondrer sur elles-mêmes sous l’effet de leur propre masse. Le phénomène de fusion nucléaire s’enclenche en leur sein, donnant naissance aux étoiles de première génération : hypermassives (environ 100 fois le soleil), excessivement brillantes, elles dépensent leur énergie à si grande vitesse qu’elles s’éteignent en quelques millions d’années. Les régions où naissent ces étoiles ont sans doute amassé assez de matière pour allumer en même temps des grappes d’étoiles, qui composent ainsi les premières galaxies. C’est le début de la Renaissance cosmique : le ciel s’illumine peu à peu d’étoiles et de galaxies.
Sylvie Rouat. Science et Avenir Février 2011
Ces premières galaxies peuvent être d’un diamètre supérieur à 300 000 années-lumière.
De 10 à 4 milliards d’années. Ce serait la durée pendant laquelle des générations d’étoiles se succédèrent, explosant à la fin en supernovae, diffusant ainsi de la matière différenciée : gaz, atomes et poussières qui fertilisent l’univers de la plupart des éléments chimiques connus : hydrogène, hélium, carbone, oxygène, néon, sodium, magnésium, silicium, phosphore. On dit les étoiles plus nombreuses que les grains de sable de l’ensemble de nos déserts…
4,567 milliards d’années. Le magazine Sciences et Avenir, dans son numéro spécial 208 Janvier à Mars 2022, fait un résumé de l’histoire du monde depuis la création du système solaire il y a 4.6 milliards d’années jusqu’à 7 millions d’années ; il est repris sur ce site en mettant chaque chapitre chronologiquement à sa place, en bleu. Les textes sont de William Rowe-Pirra.
La grande aventure de la vie sur Terre
1. Il y a 4.6 milliards d’années, la terre se forme.
C’est dans une vaste soupe de poussières et de gaz que la Terre se forme progressivement, en même temps que les autres astres du Système solaire ; au fil des collisions entre particules, la matière s’accumule et se condense par la force de gravité. Notre planète ne revêt pas encore les beaux atours que nous lui connaissons ; pas d’océans à sa surface, ni d’oxygène dans son atmosphère. Bombardée de corps célestes, soumise à une très forte activité volcanique et géologique, ce n’est pour des millions d’années encore qu’une énorme boule de roches en fusion. Son refroidissement progressif permettra la condensation de vapeur d’eau en nuages et la formation des tout premiers océans, berceau de la vie.
William Rowe-Pirra. Sciences et Avenir n° 208 de janvier à mars 2022
Formation du système solaire, de la condensation d’un nuage de gaz et de poussières : une nébuleuse. Cela commence par la concentration gravitaire d’une supernova avec une augmentation de la température des bords vers le cœur, et cela donne le soleil. Autour du soleil, huit planètes, dont 4 rocheuses – Mercure, Vénus, Mars et Terre – et 4 gazeuses (Hélium et Hydrogène) – Jupiter, Saturne, Uranus, et Neptune.

Distance des planètes au soleil, et trucs mnémotechniques pour se souvenir de leur première lettre. (vu à la Cité de l’Espace de Toulouse):
| MERCURE | 58 000 000 km | Mon | Mon | |
| VENUS | 108 000 000 km | Violoncelle | Vieux | |
| TERRE | 150 000 000 km | Tombe | Toutou | |
| MARS | 228 000 000 km | Mais | Médor | |
| JUPITER | 778 000 000 km | Il | Joue | |
| SATURNE | 1 427 000 000 km | Sauve | Sur | |
| URANUS | 2 869 000 000 km | Une | Un | |
| NEPTUNE | 4 500 000 000 km | Note | Nuage |
En 2006, une nouvelle définition des planètes amènera à exclure Pluton, qui devient une simple UA – Unité Astronomique – car il n’est pas seul sur son orbite, dégagé de tout débris. Pluton a un diamètre de 2 370 km, donc plus petit que la lune et se trouve à 6 milliards de km du soleil, soit 40 fois la distance de la terre au soleil. Par contre on se mettra à envisager l’existence d’une nouvelle planète, nommée, faute d’imagination, planète 9, dans les parties les plus froides et les plus éloignées du système solaire. Il faudra attendre la mise en service de l’observatoire Vera-Rubin en 2026, à 2 680 m dans la cordillère des Andes chiliennes.
4,560 milliards d’années
Quand Ciel eut été éloigné de Terre
Quand Terre eut été séparée de Ciel
Quand le nom d’Homme eut été fixé
Quand An eut emporté Ciel
Quand Enlil eut emporté Terre…
Épopée de Gilgamesh
Formation du soleil et de la Terre et des 8 autres planètes dans la foulée, de l’agglomération de poussières, de blocs gravitant à la périphérie du soleil naissant. Leur chute libère de l’énergie, qui se traduit par une température d’environ 2 000°C à la surface de la terre. Au maximum de l’échauffement, le fer fondu s’enfonce par percolation vers le cœur pour former le noyau liquide, qui serait un assemblage de cristaux de fer, de nickel et d’un peu de soufre. Au cœur, la graine, solide, dont le frottement avec le noyau liquide, induirait – c’est le cas de figure de la dynamo – le champ magnétique terrestre.
Le champ magnétique terrestre est un formidable bouclier invisible qui nous protège des agressions du cosmos, c’est à dire des flux de particules à haute énergie. Sans ce bouclier, la vie sur notre planète serait impossible. À 3 000 km sous nos pieds, nous avons une chance incroyable d’avoir une masse liquide métallique qu’on appelle le noyau externe. Ce noyau externe tourne autour d’un noyau central plus dense et plus petit. Il est métallique et solide. Et parce que le premier tourne autour du second, le centre de notre planète se comporte comme une dynamo qui génère un puissant champ magnétique, qui agit jusqu’à 40 000 kilomètres d’altitude environ. Toute la terre est donc enveloppée dans son propre champ magnétique qu’on appelle la magnétosphère. C’est ce champ magnétique qui arrête la plupart des particules à haute énergie produites par le Soleil, notre étoile. Mais il stoppe également celles des milliards d’autres étoiles. Sans ce bouclier, pas de vie sur Terre. Il est important de le savoir.
Michel Cabaret, directeur de l’Espace des Sciences. Ouest France du 19 novembre 2021
Il peut paraître étrange que Michel Cabaret en 2021, parle du magnétisme d’une façon plutôt simple, déjà dénoncée par les scientifiques, comme le rapporte David Larousserie début 2016 dans l’article qui suit ; l’auteur de ce site se gardera bien de trancher entre les deux ; le lecteur qui voudrait en savoir plus cherchera par lui-même. Dans les années 2010, la recherche scientifique montrera que cette explication plutôt simple dans son principe ne correspondait pas à la réalité, qui était beaucoup plus complexe :
Depuis plus de 3,5 milliards d’années, voire 4 milliards ou plus, la Terre est protégée par un champ magnétique qui repousse la plupart des particules venues de l’espace, rayons cosmiques ou autres nuées de poussières poussées par les tempêtes solaires. Mais l’origine de ce bouclier qui a rendu la vie possible reste un mystère. Dans la revue Nature du 21 janvier 2016, David Stevenson et Joseph G. O’Rourke, de l’université Caltech, en Californie, décrivent un mécanisme original qui résout cette énigme. Dave Stevenson présente cette idée depuis plusieurs années. La nouveauté est qu’elle est maintenant quantifiée, estime Stéphane Labrosse, professeur de géophysique à l’École normale supérieure de Lyon. Nous espérons que notre étude serve de base à une solution complète, même s’il y a encore du travail à faire, répond modestement Joseph Rourke, actuellement en thèse. L’histoire de ce phénomène est en effet semée de fausses bonnes idées.
Dès le XIX° siècle, les géophysiciens comprennent que les lignes de champ sur lesquelles s’aligne l’aiguille d’une boussole ne viennent pas de la surface de la Terre, mais de ses entrailles, à plus de 5 000 km de profondeur. Ils imaginent que, au centre, existe une sorte de barreau aimanté. Erreur : à la température régnant à ces profondeurs (au moins 5 000 °C), aucun métal ne peut maintenir une aimantation permanente.
Nouvelle tentative avec le modèle de la dynamo : à l’inverse de celle d’un vélo, dans laquelle la variation d’un champ magnétique crée un courant électrique, pour la Terre, la variation d’un champ électrique crée un champ magnétique. Le courant électrique est porté par le fer et le nickel en fusion dans le noyau terrestre. Quant au mouvement, ses causes restent à trouver…
L’un de ces mécanismes, très simple, est très efficace. Telle l’eau chauffée dans une casserole, le liquide du cœur de la Terre s’agite de mouvements de convection ; les éléments montent et descendent. Mais cela dépend de la capacité du métal à conduire la chaleur. S’il conduit trop, la chaleur s’évacue sans créer de convection. Lorsque l’on chauffe du mercure au lieu de l’eau, la convection disparaît, indique ainsi James Badro, de l’Institut de physique du globe de Paris. Or en 2012, deux équipes ont montré que la conductivité thermique du fer, l’élément dominant du noyau, était sous-évaluée de deux à trois fois. Exit l’agitation par ce biais…
Qu’à cela ne tienne, une autre idée a été proposée, analogue à celle qui explique les vastes courants marins dans les océans. Le sel des mers n’aime pas la glace. Lorsque, en hiver, celle-ci se forme, l’eau se charge en sel et s’alourdit, plongeant ainsi dans les profondeurs et entraînant le tapis roulant maritime. Dans le noyau de la Terre, point de sel, mais des éléments légers, mal connus, mais probablement du silicium, du carbone, du soufre… Lorsque le fer liquide se refroidit, une graine se solidifie au centre de la Terre. Comme ces éléments légers préfèrent le liquide, ils modifient la densité du fluide : une partie monte et enclenche une convection, initiatrice de la dynamo magnétique. Fin de l’histoire ?
Non, car cette graine solide n’a pu apparaître très tôt dans l’histoire de la Terre. Elle explique le champ magnétique d’aujourd’hui et jusqu’à 1 ou 2 milliards d’années en arrière, mais pas plus. D’où le moteur alternatif proposé par les Californiens.
C’est encore une histoire d’impureté. Cette fois, il s’agit d’oxyde de magnésium, l’un des ingrédients principaux du manteau terrestre. Lors de la formation de la Terre, il s’est dissous dans le métal liquide. Puis, la température baissant, cette solubilité a diminué et le magnésium n’a eu qu’une envie, sortir du liquide. Comme le gaz sort d’une bouteille lorsqu’on l’ouvre, décrit Stéphane Labrosse. Finalement, le magnésium est remonté, créant le flux de matière espéré. La dynamo a commencé à tourner !
Les simulations des physiciens montrent que l’énergie ainsi générée est suffisante pour créer et maintenir le champ depuis l’origine. J’étais fou de joie de voir que nos calculs précis confirment notre intuition, souligne Joseph O’Rourke. Sans doute que de prochains travaux modifieront des détails, mais je suis optimiste sur le fait que nous avons planté une graine qui grossira en un modèle réaliste.
C’est une idée géniale ! Je les avais pris pour des fous au début mais ils ont raison, s’enthousiasme, quant à lui, James Badro, qui a présenté en décembre, lors d’une conférence, des travaux corroborant ce modèle théorique. Ses mesures à hautes pression et température montrent que le magnésium se dissout effectivement dans le fer dans les conditions primordiales de formation de la Terre. La dynamo peut continuer de tourner.
David Larousserie. Le Monde du 27 janvier 2016
Les mensurations de la Terre :
| Circonférence à l’équateur | 40 076 594 m |
| Circonférence au tropique | 36 778 000 m |
| Circonférence au cercle polaire | 15 996 000 m |
| Circonférence d’un méridien | 40 009 152 m |
| Rayon moyen | 6 370 000 m |
La superficie – 4x 3.1416 x R2 – totale de la Terre est de 540 000 000 kilomètres², partagés en 391 000 000 km² de mer et 149 000 000 km² de continental.
Son volume – 4/3 x 3.1416 x R³ – est de 1 098 320 000 000 de km cube dont 1 350 100 000 km cube d’eau salée. L’eau recouvre donc 72 % de la surface du globe, mais seulement 3 % de cette eau est douce, et sur ces 3 %, seul 0.1 % nous est accessible. Si l’on admet comme densité moyenne de la Terre la valeur de 5,52, la masse totale de la Terre est de 5.96 x 1021 tonnes.
Sa composition : 90 % de la masse terrestre est composée de 4 éléments : oxygène, silicium, aluminium et fer.
La croûte, d’une épaisseur allant de 5 à 60 km est composée pour l’essentiel de 8 éléments : 46.6 % d’Oxygène, 27.7 % de Silicium, 8.1 % d’Aluminium, 5 % de fer, 3.6 % de Calcium, 2.7 % de Magnésium, 2.3 % de Sodium, 1.7 % de Potassium, 0.9 % de titane et 1.4 % d’autres éléments.
Il s’ensuit que les oxydes, comme l’hématite (Fe²O³) et la goethite (FeOOH) qui, associés, constituent la rouille, et les silicates, dont le radical de base est SiO4, sont les minéraux les plus abondants à la surface de la Terre. Bien souvent les silicates sont des aluminosilicates, l’atome d’aluminium se substituant aisément à celui de la silice du fait de leur diamètre comparable. Dans le monde minéral, c’est la petitesse de l’ion Si et sa capacité à se lier fortement à 4 oxygènes qui rend compte de l’abondance des silicates. Dans le monde organique, c’est la capacité de l’ion C à se lier avec les ions hydrogène et oxygène qui explique l’importance des longues chaînes carbonées rencontrées par exemple dans les produits pétroliers.
Quant aux roches, elles sont des associations plus ou moins complexes de minéraux. Ainsi le calcaire est constitué principalement de calcite, le granite de quartz et d’aluminosilicates variés comme les feldspaths, les micas, etc.
En se promenant dans la campagne, on rencontre fréquemment, au détour d’un chemin, ce que le géologue dénomme un affleurement. Sur quelques mètres carrés sont exposées une roche, ou une association de roches : par exemple un granite et des roches métamorphiques ou une alternance de bancs redressés de calcaire et d’argile.
Le principe de classification des roches est génétique. Les roches sédimentaires sont déposées à la surface du globe, sur la terre ferme ou, plus fréquemment, dans les océans. Elles comprennent :
- des roches constituées de fragments issus de la désagrégation de roches plus anciennes qui sont dites élastiques, le prototype en est le grès,
- des roches précipitées ou chimiques dont les prototypes sont les évaporites (sel de table, gypse SO4Ca, 2H2O) et certains calcaires. On imagine aisément que l’eau de mer puisse être sursaturée en calcium, magnésium ou sodium entraînant la précipitation de calcite, de gypse, de dolomite ou de sel de cuisine. Pourtant, dans la nature, c’est rarement le cas. Le plus souvent la précipitation est induite par des organismes, par exemple des huîtres ou des oursins désireux de se construire une coquille et, pour ce faire, sont amenés à capter les atomes de calcium dissous dans l’eau de mer. Dans de nombreux cas, ce sont des bactéries qui favorisent la précipitation.
Les roches magmatiques sont issues de la cristallisation de magmas provenant de la fusion de matériaux de l’écorce terrestre ou du manteau sous-jacent. Elles comprennent les laves, ou roches volcaniques, mises en place à la surface du globe où un refroidissement rapide, qui ne permet pas aux atomes de se ranger rationnellement, engendre une structure vitreuse (verre) ou faite de tout petits cristaux comme dans les basaltes, et les roches plutoniques comme les granités intrusifs au sein de l’écorce. Chez ces dernières, un refroidissement lent et progressif donne le temps aux minéraux de cristalliser largement. Ces roches sont grenues.
La Terre est une planète vivante où les roches sédimentaires et magmatiques, aujourd’hui à la surface, seront tôt ou tard entraînées en profondeur. Là, l’augmentation de pression et de température, la circulation de fluides chauds induiront de profondes transformations qui donneront naissance aux roches métamorphiques. Dans un premier temps, à faible profondeur, les roches sédimentaires et magmatiques ayant subi un début de transformation restent reconnaissables. À forte profondeur, on assiste à un complet réarrangement de la structure originelle de la roche avec, notamment, la recristallisation de minéraux plus denses, stables aux conditions de la profondeur. Ces transformations drastiques peuvent déboucher sur la fusion des roches. Ainsi le granité a-t-il une double origine. Il peut être associé à la formation et différenciation de magmas ayant lieu profondément, à la partie supérieure du manteau terrestre. Il peut aussi provenir de la fusion de roches sédimentaires ou/et magmatiques de composition chimique adéquate. Dans ce cas, il apparaît comme participant des processus de métamorphisme intervenant dans la croûte, c’est-à-dire plus superficiellement.
Ainsi faut-il bien distinguer les minéraux et les roches. Les premiers, constitués d’atomes, ont une forme géométrique rigoureusement fixée, même si, en s’associant, ils peuvent édifier des structures irrégulières et complexes comme, par exemple, les roses des sables formées par l’agrégation de cristaux de gypse. Quant aux roches, associations plus ou moins complexes de minéraux, elles arment les reliefs terrestres : massifs granitiques du Limousin, calcaires du Vercors, coulées basaltiques de l’Aubrac, de la région du Puy dans le Massif central. Elles habillent aussi les devantures de nos boutiques, de nos hôtels et de nos stations de métro (marbres, granités, quartzites, etc.). Érodées, désagrégées en fines particules, elles forment les grains de sable de notre littoral et les galets de nos plages et rivières, morceaux de roche de taille variable transportés et usés par l’eau ou le vent, constitués des minéraux les plus résistants à l’érosion comme le quartz et certains silicates.
[…] Trois grandes discontinuités, dénommées du nom de leurs découvreurs, séparant des milieux de nature ou/et de viscosité différentes, ont été mises en évidence au sein du globe. Ce sont, de la surface vers l’intérieur :
- La discontinuité d’Andrija Mohovici, ou Moho, qui, entre 5 et 80 km de profondeur, sépare l’écorce du manteau.
- La discontinuité de Beno Gutenberg qui, autour de 2 900 km, sépare le manteau du noyau.
- La discontinuité de Inge Lehmann qui, à 5 000 km de profondeur, sépare le noyau externe liquide du noyau interne, ou graine, solide.
[…] Localement, les racines de chaînes de montagnes anciennes sont visibles à la surface du globe et il est possible d’y relever une coupe complète de l’écorce terrestre comprenant le Moho. Certains volcans, et notamment les cheminées de kimberlites, roches mères des diamants, ramènent à la surface suite à une sorte de ramonage, des échantillons de manteau provenant de 50 à 300 km de profondeur.
En laboratoire, des cellules dites à enclume de diamants montées sur des presses hydrauliques et insérées dans des fours électriques permettent de recréer des températures de 5 000° et des pressions de 106 bars correspondant approximativement aux conditions régnant dans le noyau terrestre. On peut ainsi soumettre des matériaux variés – silicates, métaux, alliages métalliques, mélange de silicates et métaux – aux diverses conditions de pression et température rencontrés à l’intérieur du globe. On enregistre à quelle vitesse et fréquence des vibrations, assimilées à des ondes sismiques, s’y propagent. Il est alors possible, en comparant ces données expérimentales avec les vitesses et les fréquences des ondes sismiques, de formuler des hypothèses quant à la nature des roches constituant les enveloppes terrestres.
Roland Trompette, Daniel Nahon. Science de la Terre, Science de l’Univers. Odile Jacob 2011
L’étude des ondes sismiques, qui changent de vitesse ou de direction à la jonction des couches de nature différente, révèle les interfaces croute/manteau et manteau/noyau, et jusqu’à l’existence de la graine, à 5 150 km de profondeur. Cette boule d’environ 2 200 km de diamètre, essentiellement composée d’un alliage de fer et de nickel, est entourée d’un océan de fer en fusion de la même épaisseur. Brassé par de puissants mouvements de convexion et animé par la rotation du globe, ce noyau produit le champ magnétique terrestre, indispensable à la vie puisqu’il dévie les particules de haute énergie du vent solaire et des rayons cosmiques. Au-dessus s’étend le manteau avec deux étranges formations rocheuses, épaisses de 1 000 km et large de plusieurs milliers de km. Ces cryptocontinents, les Large Low Shear Velocity Provinces (LLSVP), seraient formés de roches denses. Le manteau recèlerait aussi d’immenses quantités d’eau, enfermées dans deux minéraux : la wadsleyite et la ringwoodite. Jusqu’à quatre fois le volume des océans ! Enfin, la croûte terrestre grouille de vie, avec des millions d’espèces différentes prospérant dans l’obscurité.
François Folliet. Sciences et Avenir 209 Avril/Juin 2022
Le PRECAMBRIEN couvre les périodes allant de 4,6 à 0,57 milliard d’années. C’est la classification la plus globale de l’histoire de la Terre, avec la période qui le suit : le Phanérozoïque. Le Précambrien couvre la période où la vie se limite à des bactéries. Le Phanérozoïque couvre la période où sont apparues des organismes pluricellulaires (métazoaires) diversifiés, pouvant atteindre de grandes tailles.
HADÉEN , de 4,6 à 4 milliards d’années
Ainsi nommé du nom du dieu grec de l’enfer, car des comètes monstrueuses et des météorites gigantesques – des chondrites : assemblage de billes de silicates et d’un alliage fer-nickel – qui apportent de l’eau bombardent en rafales la planète, ce qui ne signifie pas obligatoirement que la surface de la Terre soit en fusion perpétuelle : on a retrouvé des zircons, minuscules cristaux de silicate de zirconium, presque aussi durs que le diamant et plus stables, dans les Jack Hills en Australie, datant de 4,4 milliards d’années, soit 200 millions après la naissance de notre planète : donc, à cette époque, tout n’était pas en fusion. Notre planète aurait peut-être été à cette époque solide, froide et humide.
Parmi les premiers impacts d’astéroïdes, probablement le plus grand, – de la taille de Mars, et à incidence rasante – celui qui créa la Lune, aux environs de 4.533 milliards d’années : les parties centrales ou noyaux de l’astéroïde et de la jeune Terre auraient fusionné pour former le noyau terrestre métallique. On sait aujourd’hui que la composition chimique de la Lune est en gros identique à celle du manteau terrestre. En 2014, un nouveau mode de mesures viendra positionner cette formation de la lune à 95 millions d’années [+ ou – 32 millions d’années] après le début du système solaire, soit 4.472 milliards d’années [2]. Des analyses de roche de la mission Apollo XIII en 1971 viendront appuyer cette théorie, sans toutefois pouvoir en faire une certitude scientifique [voir à 31 janvier 1971].
Des morceaux denses de Théia auraient sombré au plus profond du manteau, mobilisant alors de grandes remontées de magma en panaches, bloqués en surface par la couche externe rigide. Celle-ci aurait été fracturée et poussée par ces panaches avant qu’ils ne replongent dans le manteau, déclenchant ainsi le début de la subduction, c’est-à-dire de l’enfoncement d’une plaque tectonique sous une autre.
Sciences et avenir n°915. Mai 2023
Le plus grand champ de cratères d’impact se trouve à Sikhote-Alin, en Sibérie : on en compte 159, mais le second, dans l’hémisphère sud, dans la zone volcanique de Bajada del Diablo, dans la province de Chubut, en Patagonie, a une centaine de cratères sur 400 km², mais ils sont de plus grande taille, entre 100 et 500 mètres de diamètre, et 30 et 50 mètres de profondeur.
Ainsi donc, printemps, été, automne, hiver, nos quatre saisons, sont le résultat tout d’abord de l’impact d’un énorme astéroïde créateur de la Lune, et d’une séance de putching ball à laquelle la terre fut livrée des millions d’années durant ; au cours de cette raclée cosmique, fatiguée, groggy, elle se pencha de 23°27’ sur le plan de l’écliptique et en resta là, pour le plus grand bonheur des habitants des régions tempérées.
vers 4,46 milliards
Sur la surface des eaux primordiales,
la Déesse première laisse apparaître son genou.
Le Canard, dieu de l’Air, y dépose six œufs d’or.
La Vierge plonge, les œufs se brisent et
le bas de la coque de l’œuf forma le firmament sublime,
le dessus de la partie jaune devint le soleil rayonnant,
le dessus de la partie blanche fut au ciel la lune luisante :
tout débris détaché de la coque fut une étoile au firmament,
tout morceau foncé de la coque devint un nuage de l’air
le temps avança désormais…
Kalevala, épopée finnoise
Hiemdal se tenait à une des extrémités de l’arc-en-ciel ;
il dormait plus légèrement qu’un oiseau ;
il apercevait les objets le jour et la nuit
à une distance de plus de deux cents lieues,
et avait l’oreille si fine,
qu’il entendait croître l’herbe des prés et la laine des brebis.
Edda [mythologie islandaise]
La légende inuite raconte que Malina (le soleil) et Anningan (la lune), respectivement sœur et frère, étaient depuis leur prime jeunesse très unis, mais furent séparés une fois grands pour vivre dans les zones attribuées aux hommes et aux femmes. Un jour, pendant qu’Anningan observait les femmes, il se rendit compte que sa sœur était la plus belle de toutes. Il décida donc d’aller lui rendre visite dans son lit pendant la nuit. Profitant de l’obscurité, il abusa de la pauvre Malina, qui n’avait pas la moindre idée de son identité. Lorsque cela se reproduisit, Malina était prête : elle recouvrit ses mains de cendres de façon à tacher le visage du violeur et pouvoir le reconnaitre le jour suivant. Elle attendit patiemment et, quand Anningan se détourna d’elle, elle lui recouvrit le visage de noir.
Le lendemain, Malina commença sa recherche parmi les hommes du village et, à son grand désarroi, se rendit compte que le coupable était son frère. Poussée part la colère, elle s’amputa les seins et les lui offrit en disant : Puisque je te plais tant que ça, mange les donc ! Sur ce, elle s’enfuit. Anningan, lui aussi en rage, la poursuivit et tous deux se mirent à courir si vite qu’ils finirent par décoller : c’est ainsi qu’ils devinrent les deux astres qui encore aujourd’hui continuent à se suivre dans le ciel.
Marco Tedesco, Alberto Flores d’Arcaïs. Ice Humen Sciences 2022
Chez les Égyptiens, c’est un peu plus compliqué :
À l’origine du monde était un chaos liquide. Aton, le soleil, en sortit de sa propre volonté et se posa sur une pierre verticale. De la semence d’Aton naquit un couple divin : Shout, l’Atmosphère, et Tefnout, l’Humidité, qui engendrèrent à leur tour deux autres couples. Le deuxième couple est formé de Geb, dieu de la Terre, dont la légende fait le premier pharaon, et Nout, déesse du ciel, dont le corps est parcouru durant la journée par le soleil, qu’elle avale chaque soir pour le mettre au monde chaque matin.
*****
Un dieu, ou la nature la meilleure, mit fin à cette lutte ; il sépara du ciel la terre, de la terre les eaux et il assigna un domaine au ciel limpide, un autre à l’air épais. Après avoir débrouillé ces éléments et les avoir tirés de la masse ténébreuse, en attribuant à chacun une place distincte, il les unit par les liens de la concorde et de la paix. La substance ignée et impondérable de la voûte céleste s’élança et se fit une place dans les régions supérieures. L’air est ce qui en approche le plus par sa légèreté et par sa situation ; la terre, plus dense, entraîna avec elle les éléments massifs et se tassa sous son propre poids ; l’eau répandue alentour occupa la dernière place et emprisonna le monde solide.
Lorsque le dieu, quel qu’il fût, eut ainsi partagé et distribué l’amas de la matière, lorsque de ses différentes parts il eut façonné des membres, il commença par agglomérer la terre, pour en égaliser de tous cotés la surface, sous la forme d’un globe immense. Puis il ordonna aux mers de se répandre, de s’enfler au souffle furieux des vents et d’entourer de rivages la terre qu’ils encerclaient. Il ajouta les fontaines, les étangs immenses et les lacs, enferma entre des rives obliques la déclivité des fleuves, qui, selon les contrées, sont absorbés par la terre elle-même, ou parviennent jusqu’à la mer et, reçus dans la plaine des eaux plus libres, battent, au lieu de rives, des rivages. Il ordonna aux plaines de s’étendre, aux vallées de s’abaisser, aux forêts de se couvrir de feuillage, aux montagnes rocheuses de se soulever. Deux zones partagent le ciel à droite, deux autres à gauche, avec une cinquième plus chaude au milieu d’elles ; la masse qu’il enveloppe fut soumise à la même division par les soins du dieu et il y a sur la terre autant de régions que couvrent les zones d’en haut. L’ardeur du soleil rend celle du milieu inhabitable ; deux autres sont recouvertes de neiges épaisses ; entre elles, il plaça encore deux, à qui il donna un climat tempéré, en mélangeant le froid et le chaud.
Au-dessus s’étend l’air ; autant il est plus léger que la terre et l’eau, autant il est plus lourd que le feu. C’est le séjour que le dieu assigna aux brouillards et aux nuages, aux tonnerres, qui épouvantent les esprits des humains, et aux vents qui engendrent les éclairs et la foudre. Aux vents eux-mêmes l’architecte du monde ne livra pas indistinctement l’empire de l’air ; aujourd’hui encore, quoiqu’ils règnent chacun dans une contrée différente, on a beaucoup de peine à les empêcher de déchirer le monde, si grande est la discorde entre ces frères. […]
Au-dessus des vents, le dieu plaça l’éther fluide et sans pesanteur, qui n’a rien des impuretés d’ici-bas. Dès qu’il eut enfermé tous ces domaines entre des limites immuables, les étoiles, longtemps cachées sous la masse qui les écrasait, commencèrent à resplendir dans toute l’étendue des cieux. Pour qu’aucune région ne fût privée de sa part d’être vivants, les astres et les dieux de toutes formes occupèrent le céleste parvis ; les eaux firent une place dans leur demeures aux poissons brillants ; la terre reçut les bêtes sauvages ; l’air mobile, les oiseaux.
Ovide – 43 av. J.C. 18 ap. J.C. – Métamorphoses. Livre premier
de 4.2 milliards à 3 milliards d’années.
Des millions d’années de pluie, condensation due au refroidissement d’une atmosphère riche en vapeur d’eau, donnent naissance aux océans. La forte proportion de CO² provoque un effet de serre amenant l’eau de mer à des températures entre 60 et 90°C. La pression atmosphérique est proche de 200 bars [1 kg/cm²] et la température de surface aux environs de 350°. Longtemps, il n’y eut qu’une enveloppe d’eau – l’hydrosphère – car la pluie, à peine tombée, se vaporisait sur des surfaces encore trop chaudes. L’apparition de l’eau sous forme de mares, d’étangs puis d’océans se fera vers 3 milliards d’années.
Eau, tu n’es pas nécessaire à la vie, tu es la vie.
Antoine de Saint Exupéry. Terre des Hommes
Chacun de nous porte dans ses veines un fluide salin qui combine le sodium, le potassium et le calcium dans presque la même proportion que l’eau de mer
Rachel Carson (1907-1964), biologiste. La Mer autour de nous 1952.

Christelle Enault
On connait plusieurs hypothèses quant à l’origine de l’eau sur notre planète Terre. La première suggérait que l’eau de la Terre soit apparue avec la formation des planètes, par les vapeurs d’eau émises par les éruptions de magma volcaniques. Pourtant, dans les années 1990, l’attention des scientifiques se déplace vers des sources extérieures, avec la découverte du potentiel rôle des comètes glacées qui après s’être réchauffé auprès du Soleil, auraient percuté la Terre.
Mais une question demeure : comment, et par quels mécanismes célestes, ces comètes ont-elles percuté la Terre ? Dans une étude publiée dans la revue Astronomy and Astrophysics, l’équipe de recherche de Quentin Kral, astrophysicien à l’observatoire de Paris-PLS, révèle un nouveau scénario possible.
Jusqu’ici, l’hypothèse la plus probable de l’origine de l’eau suggérait que dans la ceinture d’astéroïdes et la ceinture de Kuiper – deux zones de l’univers composées de nombreux corps glacés – des interactions gravitationnelles tumultueuses auraient disloqué ces objets et les auraient envoyés vers la Terre. De son côté, dans un article publié dans The conversation, Quentin Kral soutient que bien qu’il soit évident que la formation des planètes ait impliqué des bouleversements et des impacts significatifs, il est possible que l’apport d’eau sur Terre se soit produit de manière plus naturelle et moins dramatique.
La théorie de Quentin Kral repose sur des données recueillies par le réseau de radiotélescopes ALMA à l’observatoire du Chili. Ces observations montrent que dans les ceintures les plus froides, comme celle de Kuiper, les comètes glacées aussi appelées planétésimaux transforment le monoxyde de carbone en état gazeux.
Mais dans les ceintures proches du Soleil, comme celle des astéroïdes, l’eau glacée est plus facilement libérée sous forme de vapeur. Ensuite, à l’aide d’un modèle numérique, les chercheurs ont simulé le dégazage de la glace et la dispersion de la vapeur d’eau afin de prouver que ce phénomène était responsable de l’arrivée de l’eau sur la Terre.
Grâce à ces observations, les scientifiques ont pu valider leur théorie selon laquelle l’eau serait apparue sur terre par le réchauffement naturel des astéroïdes. Au commencement de notre système solaire, le Soleil aurait été entouré d’un disque protoplanétaire composé de gaz et de poussière qui est responsable de la formation des planètes.
Ce disque, riche en hydrogène, protégerait les astéroïdes pendant leur formation. Après quelques millions d’années, lorsque ce cocon protecteur se serait dissipé, et en se réchauffant, les astéroïdes auraient fait fondre leur glace, la transformant directement en vapeur. Un disque de vapeur d’eau se serait alors formé autour de la ceinture d’astéroïdes et se serait dirigé vers les planètes proches du Soleil. C’est ainsi que le disque de vapeur aurait arrosé les planètes internes, comme Mars, Vénus, Mercure et la Terre.
L’idée de cette théorie a été confirmée par des données des missions Hayabusa 2 et OSIRIS-REx, qui ont détecté des minéraux hydratés sur des astéroïdes similaires à ceux qui auraient formé le disque de vapeur d’eau initial.
Adélie Clouet d’Orval GEO du
Homme libre, toujours tu chériras la mer !
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame,
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer.
Tu te plais à plonger au sein de ton image ;
Tu l’embrasses des yeux et des bras, et ton cœur
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur
Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage.
Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets :
Homme, nul n’a sondé le fond de tes abîmes ;
Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes,
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets !
Et cependant voilà des siècles innombrables
Que vous vous combattez sans pitié ni remord,
Tellement vous aimez le carnage et la mort,
Ô lutteurs éternels, ô frères implacables !
Charles Baudelaire
L’océan sonore
Palpite sous l’œil
De la lune en deuil
Et palpite encore
Tandis qu’un éclair
Brutal et sinistre
Fend le ciel de bistre
D’un long zig zag clair
Et que chaque lame,
En bonds convulsifs,
Le long des récifs
Va, vient, luit et clame
Et qu’au firmament
Où l’ouragan erre,
Rugit le tonnerre
Formidablement
Paul Verlaine. Marine Poèmes saturniens
Depuis qu’il y a des hommes, aucun d’entre eux jamais n’a pu, me semble-t-il, sincèrement affirmer avoir vu à la mer cet air de jeunesse que prend la terre au printemps. Mais il en est, parmi nous, qui, regardant l’océan avec entendement et tendresse, lui ont vu l’air si vieux que les siècles immémoriaux semblaient avoir émergé du limon inviolé de ses profondeurs. Car c’est un coup de vent qui donne un air de vieillesse à la mer.
Dans le recul des jours, évoquant les aspects des tempêtes survécus, c’est là ce qui se dégage clairement de cet ensemble d’impressions que m’ont laissé tant d’années d’un commerce intime avec la mer.
Si vous voulez savoir l’âge de la terre, regardez la mer en furie. Son immensité grise, les lames où le vent creuse de longs sillons, les larges traînées d’écume, agitées, emportées, comme des boucles emmêlées, donnent à la mer l’apparence d’un âge innombrable, sans lustre et sans reflet, comme si elle avait été créée avant la lumière elle-même.
Joseph Conrad. Le miroir de la mer. 1906
La première nécessité pour la vie est de disposer d’une source d’énergie. À la surface de la Terre, l’énergie la plus aisément disponible est l’énergie solaire. Fort logiquement, les premières formes de vie l’ont utilisée. L’eau est le deuxième besoin pour la vie, ce qui explique que celle-ci soit apparue dans une eau suffisamment peu profonde pour que les rayons du Soleil y pénètrent encore.
L’eau n’est pas un produit ordinaire. Il s’agit certainement de la seule molécule de cette taille, aussi simple en apparence que sa formule (H20) le laisse supposer, à combiner autant de propriétés aussi particulières. Tout d’abord, si cette molécule se comportait exactement selon les propriétés tableau périodique des éléments, l’eau gèlerait à – 100 °et s’évaporerait dès 70°. Elle doit ses propriétés à la liaison hydrogène qui intervient dans l’architecture moléculaire de tous les êtres vivants. Cette interaction de type faible relie les molécules d’eau liquide entre elles en un gigantesque réseau. Des attractions électrostatiques relient un atome d’hydrogène d’une molécule d’eau (à polarisation positive) à un atome d’oxygène (à polarisation négative) d’une autre molécule. La formule chimique n’est qu’une simplification et la réalité change ses propriétés d’ébullition 170 °C ! On imagine facilement l’importance de ce fait pour les cellules. Mais les températures de congélation et d’ébullition ne sont pas les seules particularités de cette molécule d’eau. En effet, quand l’eau refroidit sa densité augmente, comme celle de n’importe quel liquide. Cependant, quand la température de l’eau descend au-dessous de 4 °C, le volume de l’eau augmente de nouveau, et cette augmentation continue quand l’eau gèle. Les conséquences sont importantes pour la vie. Nous citerons deux exemples.
En hiver, quand la température tombe, l’eau d’un lac commence à se refroidir en surface. Comme elle devient plus dense, l’eau froide coule et assure une homogénéisation de la température sur toute la profondeur d’eau. Ce processus s’observe tant que la température de l’eau ne descend pas en dessous de 4 °C, car alors l’eau superficielle devient moins dense et reste en surface. Même si la température continue de descendre, la glace qui se forme reste elle aussi en surface. Ainsi, même lors d’hivers extrêmement rigoureux et longs, le fond du lac reste à 4 °C. Ce comportement de l’eau contribue à la conservation de la vie. Quand l’eau gèle, la glace augmente de volume. Dans les fissures des massifs rocheux où l’eau s’est infiltrée, cet accroissement de volume fait éclater la roche – c’est le processus de la gélifraction – et facilite l’érosion, accélérant d’autant la formation de sols meubles dans lequel des plantes peuvent se développer. Le renouvellement continu du relief est en effet une caractéristique unique de notre planète, qui ne présente donc pas l’aspect grêlé de la Lune ou de Mars, dû aux impacts de météorites dont certaines traces datent de plusieurs milliards d’années.
Les premiers organismes ont utilisé la puissance du Soleil pour convertir l’eau et le dioxyde de carbone en glucides. Ils ont alors transformé l’énergie lumineuse, fugace, en une énergie chimique susceptible d’être stockée. Mais ce processus de transformation libère un sous-produit – un déchet, en quelque sorte -, l’oxygène. Ce rejet très oxydant a bien entendu été nocif pour les organismes d’alors. Mais la vie s’adapte à tout et certains organismes ont même fini par adopter ce produit toxique pour leur métabolisme et leurs échanges énergétiques, à tel point que l’on pourrait croire que l’oxygène est un élément fondamental de toute vie. L’eau l’est, l’oxygène non. Cette production d’oxygène a modifié la composition et partant l’aspect de l’eau des océans entre 2,4 et 2 milliards d’années. En effet, avant l’activité photosynthétique des organismes, l’atmosphère terrestre était dominée par le C02 et les eaux réductrices contenant des substances qui consomment de l’oxygène, en l’occurrence, riches en fer dissous puisque, sous sa forme réduite, le fer ferreux de couleur verte, est soluble dans l’eau.
Avec l’arrivée de ce dioxygène (de formule chimique 02) dans l’eau, le fer ferreux s’oxyde, devient ferrique, rouge. Le fer, sous cette forme oxydée, est insoluble dans l’eau. Il précipite donc au fond de l’océan où il s’accumule en couches rouges très épaisses. Aujourd’hui, plus de 80 % de l’exploitation du minerai de fer exploité dans le monde proviennent de gisements formés de cette façon. Le fait que le fer disparaisse ainsi de l’eau la rend plus limpide et permet donc à la lumière solaire de pénétrer plus profondément. La photosynthèse peu donc s’opérer sur une plus grande profondeur, ce qui accélère la production d’oxygène. Quand le fer a précipité, l’eau se charge en oxygène, puis celui-ci pourra s’échapper dans l’atmosphère. Le dioxygène gagnera les hautes couches où, sous l’action des rayons solaires, il deviendra en partie du trioxygène : l’ozone. Le ciel terrestre passera de marron orangé à bleu. La captation d’une dose de rayons solaires par cet ozone permettra à la vie de s’exprimer et de se développer sur la terre ferme.
Les premiers organismes vivants captant du C02 et rejetant de l’oxygène (O) introduisent dans l’environnement un déséquilibre chimique dont la marque la plus visible est le dépôt de carbonates de calcium (matières calcaires) à proximité immédiate des zones où la synthèse chlorophyllienne est active. Ces calcaires portent donc la marque des organismes vivants, ne serait-ce que par leur forme : ils apparaissent finement laminés et mamelonnés. Cette allure leur a fourni leur nom : les stromatolithes (du grec stromato – tapis, et lithos – roche). Ce ne sont pas des êtres vivants mais des structures sédimentaires élaborées par un tapis de filaments bactériens. Ces constructions représentent parfois des couches très épaisses. On les retrouve dans des roches de plusieurs milliards d’années. Outre le déséquilibre introduit par le dégagement d’O2, le piégeage du CO2 dans le calcaire conduit à une nette diminution de la quantité de CO2 dans l’air. La réduction de ce gaz à effet de serre induit une diminution de la température terrestre. Cette baisse est parfois si importante que la température descend jusqu’à -50°C pendant quelques dizaines de milliers d’années. L’eau gèle. La couleur globale de la Terre devient alors bien plus blanche qu’avant et elle renvoie davantage d’énergie solaire. Le processus s’emballe, jusqu’à avoir une Terre complètement gelée, pareille à une boule de neige de -10 °C pendant quelques millions d’années. L’action des volcans sous la glace semble permettre une accumulation de C02 qui, lorsqu’il s’échappera, permettra un retour à la normale. La vie s’est d’abord manifestée dans l’océan. Pendant plus de 3 000 millions d’années, elle ne s’est développée que dans le milieu liquide ; la surface continentale était alors exempte de toute forme de vie, seules affleuraient les roches. Les paysages terrestres devaient ressembler à nos grands déserts actuels : Takla-Makan, Hoggar ou Namib.
Il y a environ 500 millions d’années, des lichens se sont installés, un peu comme on en voit aujourd’hui dans certains déserts, qu’ils soient chauds ou très froids ; ce sont eux qui nourrissent les rennes des régions polaires. Des lichens, des mousses ont proliféré, accrochés aux rochers par le simple fait qu’ils en épousent les moindres détails de la forme, puis par des crampons. L’eau ne circule pas encore dans leurs tissus, elle les imprègne seulement, quand il y en a. En effet, ces organismes sont capables de reviviscence, c’est-à-dire qu’ils se dessèchent totalement quand l’eau manque et semblent ne plus vivre, mais ils se réhydratent et revivent à la première pluie. Ils ont parfois été comparés à de petits laboureurs mobilisant une très fine couche superficielle. Il y a environ 450 millions d’années, à l’Ordovicien, les végétaux se répandent un peu plus largement sur les continents. Ce sont d’abord des organismes très simples, sans vaisseaux conducteurs. Quelques arthropodes terrestres – acariens, araignées et scorpions primitifs – se sont aventurés à terre : leur carapace leur permettait de résister aux rayonnements solaires nocifs, la couche d’ozone n’étant pas encore formée. Il y a environ 400 millions d’années, la Terre se remet tout doucement d’une crise orogénique, c’est-à-dire d’une période où des reliefs importants se sont créés : on retrouve des restes de cette chaîne calédonienne en Écosse, en Bretagne, etc. La surface terrestre retrouve donc son état habituel : elle redevient plate, extrêmement plate. Le relief est si peu important qu’à la moindre tempête les eaux envahissent de grandes surfaces continentales. Quand la tempête se calme, les flots regagnent leur réceptacle marin habituel, abandonnant ici et là quelques flaques d’eau dans lesquelles des organismes sont restés prisonniers. Lors de leur assèchement ces êtres périront, sauf certains chanceux qui possèdent des embryons de poumons. On est loin de l’image volontariste qu’insidieusement suggère l’expression conquête du milieu terrestre, ou même celle de sortie des eaux ! Quoi qu’il en soit, ceux qui ont survécu vont finir par s’adapter à l’environnement aérien. Les tétrapodes, vertébrés à quatre membres, s’installent désormais sur les continents : ils le peuvent parce que des plantes les ont précédés, qui leur offrent la nourriture nécessaire. Vers la même période, au milieu du Dévonien, apparaissent les premières plantes dotées de vaisseaux conducteurs de sève, les rhyniophytes, qui ne dépassent guère 50 centimètres de haut. 15 millions d’années plus tard, des forêts de lycopodes de 10 mètres de haut s’étendent déjà sur les continents. Les plantes grandissent pour une large part en remplissant d’eau des sacs intracellulaires, les vacuoles. En retour, celles-ci exercent une pression sur les parois des cellules qui s’allongent alors selon un axe déterminé, donnant ainsi leur forme à chacune des plantes.
Les végétaux se suffisent à eux-mêmes pour la nourriture : on les dit autotrophes. Ce qui leur importe le plus est de disposer de lumière. Il ne faut donc pas qu’ils soient recouverts au moindre coup de vent par un autre végétal ou par du limon, mais au contraire qu’ils puissent s’élever vers la lumière. Ils développent une stratégie de surface. D’abord simples tiges, ils gagnent progressivement un grand nombre d’épines puis des feuilles : autant de panneaux solaires utiles à la photosynthèse. Les animaux qui se sont retrouvés hors de l’eau doivent partir en quête de nourriture et donc se déplacer. Par ailleurs, ils ne sont pas sûrs de trouver chaque jour leur nourriture : ceux qui réussissent à se constituer des réserves sont donc avantagés. Les végétaux ont développé une stratégie d’ancrage et de surface, les animaux ont développé une stratégie de mobilité et de volume. Les végétaux se sont affranchis de l’eau en développant un système vasculaire, en interne, et en adoptant des pores d’ouverture contrôlée avec l’externe. Leur reproduction peut se faire par des graines susceptibles d’attendre longtemps dans un environnement très sec. Les animaux ont aussi adopté un système circulatoire et ils se procurent de l’eau par une nourriture hydratée ou en buvant. Pour leur reproduction, cependant, ils restent tributaires d’un passage dans l’eau. Ce n’est qu’il y a environ 300 millions d’années qu’une nouveauté va autoriser certains organismes à s’affranchir de l’eau pour leur reproduction, comme l’attestent les fossiles d’Hylonomus de Joggins (Nouvelle-Écosse, Canada). Cette innovation s’appelle l’amnios. Elle est caractérisée par un œuf qui possède des membranes annexes lui permettant de se développer en dehors du milieu aquatique. L’embryon, protégé par un œuf à coquille dure ou par l’utérus maternel, se développe en milieu aqueux à l’intérieur de l’amnios. Il se retrouve chez certains groupes de vertébrés tels que les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Désormais, les organismes vont pouvoir s’éloigner des points d’eau, ils ne seront plus tributaires du milieu liquide, comme les amphibiens, et pourront gagner des territoires qui leur étaient inaccessibles jusqu’alors. L’eau est, avec les composés à base de carbone, la molécule la plus importante pour la réalisation des processus vitaux. Les êtres vivants sont en effet composés d’eau à 70 voire 80 % – certaines plantes atteignent même 90 % et quelques organismes aquatiques, telles les méduses, jusqu’à 99 %. Le cycle géoécologique de l’eau est régi par les précipitations, l’infiltration, le ruissellement, l’évapotranspiration, la condensation … Les organismes, surtout les végétaux qui dominent par leur biomasse, contribuent au cycle de l’eau en la prélevant activement, en la stockant et en la restituant dans l’atmosphère.
Généralement, la vie tire son énergie du Soleil, par voie directe ou indirecte. Les êtres vivants sont capables de transformer l’énergie lumineuse du Soleil en énergie chimique, puis de la stocker. Ce sont les producteurs primaires de la chaîne alimentaire, les plantes vertes et certaines bactéries. D’autres organismes puisent à leur tour cette énergie stockée sous forme chimique en se nourrissant des plantes et en en digérant les sucres peuvent aussi consommer l’oxygène produit par les végétaux pour brûler leur nourriture dans des réactions qui dégagent de l’énergie. Plus loin dans la chaîne alimentaire, d’autres animaux mangent ces herbivores, et ainsi de suite. Même les bactéries qui dégradent le pétrole brut ne font rien d’autre qu’utiliser l’énergie chimique que les plantes ont stockée des millions d’années auparavant. De même, quand nous exploitons des énergies fossiles comme le charbon, le pétrole ou le gaz naturel, c’est la réaction inverse de la photosynthèse effectuée par les végétaux il y a très longtemps qui se produit : en brûlant le carbone dont les plantes se sont servies pour fabriquer des molécules organiques, nous formons du dioxyde de carbone à partir de l’oxygène produit par ces mêmes plantes. Quand nous brûlons un charbon du Carbonifère, c’est de l’énergie solaire d’il y a 300 millions d’années qui nous chauffe. L’évolution de la biodiversité est marquée par des crises où l’eau (niveau des océans, réchauffement, refroidissement) joue un rôle majeur.
S’il paraît évident que la vie est influencée par les conditions qui existent à la surface de la Terre, il l’est moins d’admettre que la vie gère aussi en partie le fonctionnement de la partie externe la planète. On a vu comment le dégagement d’oxygène a modifié la composition de l’eau et de l’atmosphère. La vie participe une sorte d’autorégulation des conditions environnementales ! Dans les cycles de rétroactions complexes, l’eau joue un rôle de premier ordre. Outre les aspects d’évapotranspiration régis par les plantes, les nuages y prennent une part conséquente.
Une sorte de régulation de la température terrestre fonctionne en relation avec eux. Les régions sombres – les montagnes en été, les forêts ou même l’océan – tendent à absorber l’énergie calorifique du Soleil. Les régions claires – les déserts, les zones nuageuses ou les calottes polaires – tendent à réfléchir l’énergie solaire de la Terre. Cette réflexion, appelée albédo, n’est pas la même partout. La couverture nuageuse est l’un des facteurs qui la modifient. Si les nuages sont abondants, beaucoup de lumière est réfléchie et la Terre refroidit ; s’il y a peu de nuages, beaucoup de chaleur atteint la surface terrestre, qui se réchauffe. Les facteurs qui contrôlent l’abondance des nuages sont nombreux. L’interaction de l’atmosphère et de l’océan est l’un des principaux : il suffit de penser au brouillard qui se forme au début de l’été le long des côtes pour en avoir une idée. D’autre facteurs, comme l’ombrage créé par la pluie, les fronts météorologiques (séparation de masses d’air ayant des propriété différentes), contribuent à la couverture nuageuse de la planète. Étant donné que les océans en couvrent près des trois quarts il est raisonnable de penser que tout ce qui contribue à la formation de nuages sur l’océan a un impact majeur sur la température terrestre. Un tel mécanisme est par exemple l’émission de produits générateurs de noyaux de condensation nuageuse par certains groupes de phytoplancton, algues microscopiques comme les coccolithophoridés ou les Phaeocystis.[3]
Les nuages se forment quand la vapeur d’eau de l’atmosphère condense ou gèle. Cependant, pour que des nuages se forment, une particule, ou germe, doit être présente pour rassembler l’eau dans une gouttelette. Ces particules, appelées noyaux de condensation nuageuse, sont de petites particules de l’atmosphère qui conduisent à la formation de nuages. Une substance qui agit ainsi est le sulfure de diméthyl (en anglais dimethyle sulphide, d’où l’abréviation DMS fréquemment rencontrée). On sait en effet que des algues phytoplanctoniques produisent ce gaz en quantité. La libération dans l’atmosphère d’aérosols soufrés à partir de ce gaz est suffisante pour former des nuages. Ces minuscules organismes marins ont entre leurs mains le thermostat terrestre ! Quand le soleil brille généreusement, le phytoplancton croît rapidement et relâche du DMS en quantité, produisant des nuages. L’accroissement de la couverture nuageuse peut être tel que la température terrestre diminue, mais en même temps le développement nuageux correspond à une diminution de l’insolation, ce qui ralentit la croissance du phytoplancton. Il s’ensuit que la production biologique diminue et par conséquent la quantité de DMS. Il y a alors moins de nuages et la température augmente de nouveau. Le cycle se poursuit d’une manière autorégulée et équilibrée. Ainsi le phytoplancton contrôle-t-il, au moins en partie, la formation des nuages qui couvrent l’océan, et la température terrestre. Ces effets illustrent des interactions qui existent entre la Terre et la vie. D’autres processus abiotiques interviennent comme facteurs régulateurs sur une plus longue échelle de temps. Ainsi, par exemple, la Terre connaît des périodes pendant lesquelles de grandes provinces basaltiques, conséquence d’une expulsion colossale de flots de basalte, se mettent en place. L’une des plus célèbres, qui n’est cependant ni la plus importante, ni la plus grande, date de 65 millions d’années et se trouve en Inde, où elle forme des falaises qui ressemblent à de grands escaliers, d’où le nom de trapps (escalier en Scandinave) qui leur a été donné. Lors de cette gigantesque émission de lave, d’énormes quantités de gaz carbonique (7.1013 t de CO2) et d’eau ont été émis pendant une période qui s’est étendue sur un million d’années. Le climat s’en est trouvé modifié, notamment par une augmentation de la température. Néanmoins, les laves émises en région intertropicale ont été soumises à l’action de l’eau et se sont donc altérées. Cela a résorbé le C02 injecté par l’éruption dans l’air, après un délai dû à la lenteur des réactions d’altération. Ce modèle fait ressortir qu’en l’espace de quelques millions d’années la nature a réparé la mise en place massive de ce CO2 susceptible d’augmenter la température de la Terre. Le bilan global, après éruption et altération, est même un taux de CO2 atmosphérique plus bas qu’avant l’éruption. Le climat de notre planète a été suffisamment stable pour entretenir la vie pendant des millions d’années mais il a changé à diverses reprises, comme l’attestent les données géologiques, sédimentologiques, paléontologiques, géochimiques, etc. Les données fournies par les fossiles ou la largeur des cernes des arbres, les taux de croissance des organismes marins et les types de végétation révélés par les pollens fossiles, par exemple, prouvent que le climat de la Terre est caractérisé, depuis des centaines de millions d’années, par une alternance de périodes de temps chaud et de temps froid. Il y a plus de 250 millions d’années, vers la fin du Paléozoïque, les glaciers recouvraient la plus grande partie des tropiques actuels. Cependant, par la suite, et jusqu’il y a environ 2 millions d’années, les températures étaient bien plus élevées qu’elles ne le sont aujourd’hui. Pendant toute l’ère secondaire, la précipitation globale moyenne était bien inférieure à ce qu’elle est actuellement, puis elle a connu un pic entre 60 et 30 millions d’années. À partir de là elle a varié autour des valeurs actuelles.
Au cours du dernier million d’années, le climat de la Terre a été caractérisé par des périodes de temps froid durant lesquelles les glaciers continentaux couvraient de vastes surfaces. L’eau ainsi piégée ne se trouvait plus dans l’océan, dont le niveau baissait d’autant. Chacune de ces périodes froides durait entre 80 000 et 100 000 ans et était entrecoupée de phases plus brèves de temps plus chaud, de 10 000 à 15 000 ans chacune. Au dernier maximum glaciaire, il y a environ 18 000 ans, le niveau des océans était inférieur de 130 mètres à ce qu’il est aujourd’hui. À cette époque, les Bahamas étaient une énorme masse de terres émergées et la région sahélienne de l’Afrique était un désert. Les glaciers continentaux ont commencé à se retirer il y a à peu près 10 000 ans. Il y a environ 6 000 ans, alors que les glaciers étaient encore en phase de retrait, la Terre est entrée dans une période durant laquelle les températures moyennes étaient à peu près égales à celles d’aujourd’hui, mais avec des étés légèrement plus chauds et des hivers plus froids. Les précipitations ont alors augmenté dans le Sahel africain et le niveau du lac Tchad est monté jusqu’à plus de 40 mètres au-dessus de celui d’aujourd’hui. Les plaques de glace ont continué à se retirer vers le nord, le Sahel est redevenu une région à faible pluviosité et ses zones septentrionales ont été envahies par le désert du Sahara. À cette échelle de temps, nous sommes dans une phase de retour à une période glaciaire.
À une échelle de temps qui nous est plus familière, celle de quelques siècles, le climat et la pluviosité ont aussi varié. En effet, d’après les données historiques, au cours des 1 100 dernières années la Terre a connu des variations climatiques, du moins à l’échelon régional, suffisamment stables et d’assez longue durée pour être considérées comme des changements climatiques. Durant le Moyen Age, un climat chaud, qui a duré à peu près de 900 à 1 200, a dominé la plus grande partie de l’Europe ; il a été appelé Optimum médiéval. Cette période a permis à l’homme de s’installer dans des régions qui seraient aujourd’hui considérées comme trop rudes sur le plan climatique. Durant l’Optimum médiéval, on cultivait l’avoine et l’orge en Islande et des fraises sur le territoire de l’actuelle Alsace. Les forêts canadiennes s’étendaient beaucoup plus loin vers le nord qu’aujourd’hui, les colonies agricoles prospéraient dans les hautes terres du nord de l‘Écosse et des colonies vikings étaient établies au Groenland – d’où son nom de Terre verte. L’Optimum médiéval s’est terminé au XIII° siècle et a été suivi par six siècles de refroidissement prononcé. Le froid s’intensifiant, cette période est connue sous le nom de Petit Age glaciaire.
La couverture de neige et de glaciers n’avait jamais été aussi étendue depuis le Pléistocène. Les colonies Vikings du Groenland de 985 à 1 500 après J.C. ont disparu. Les forêts d’Amérique du Nord se sont rétractées vers le sud et, dans le nord de l’Europe, les canaux étaient souvent gelés pendant tout l’hiver, bloquant les transports par voie d’eau. La moitié des tableaux de Bruegel, comme le Trebuchet, avec ses patineurs sur une rivière, représentent la neige ou la glace. Lorsque le Petit Âge glaciaire relâche son emprise sur le climat de l’Europe, au milieu du XIX° siècle, on observe une tendance au réchauffement dans les deux hémisphères.
Patrick de Wever. De l’eau et des hommes. Éditions de Monza 2011
Mais l’exploration des fonds marins – il s’agit ici du centre du Pacifique – réservera de grandes surprises aux scientifiques quant à l’origine de l’oxygène :
Dans l’océan Pacifique, à quatre kilomètres de profondeur et dans l’obscurité la plus totale, des scientifiques ont découvert avec stupeur de l’oxygène provenant non pas d’organismes vivants mais de sortes de galets contenant des métaux, ce qui questionne la théorie sur les origines de la vie sur Terre.
La vaste plaine abyssale qui s’étend entre Hawaï et le Mexique a été explorée par les scientifiques et les sociétés minières. Ils ont démontré que les profondeurs océaniques sans lumière étaient loin d’être stériles.
Une découverte qui nous incite à repenser la manière dont est apparue la vie sur Terre, rien de moins. Le professeur Nicholas Owens, directeur de l’Association écossaise pour les sciences marines (SAMS), est enthousiaste. À l’occasion d’une campagne scientifique sur le fonctionnement du fond des océans, il a observé un phénomène tout à fait fascinant décrit dans un article paru dans la revue Nature Géoscience le 22 juillet2024. De l’oxygène créé au fond de l’océan par… des galets.
Reprenons. Un navire de la SAMS était mandaté par les sociétés The Metals Compagny et UK Seabed Resources pour effectuer des prélèvements à plus de quatre kilomètres de profondeur, dans la plaine abyssale de la zone de fracture géologique de Clarion-Clipperton, dans le centre du Pacifique. Cette zone revêt un intérêt particulier pour l’industrie minière. L’exploitation des abysses est sujet à d’âpres négociations internationales. On y trouve des nodules polymétalliques, des concrétions minérales riches en métaux (manganèse, nickel, cobalt…) nécessaires notamment à la fabrication des batteries pour véhicules électriques, éoliennes, panneaux photovoltaïques et téléphones portables.
L’objectif des recherches était d’évaluer l’impact d’une telle prospection sur un écosystème où l’absence de lumière empêche la photosynthèse et donc la présence de plantes, mais qui regorge d’espèces animales uniques. On essayait de mesurer la consommation d’oxygène du plancher océanique, en mettant les sédiments qu’il contient sous des cloches appelées chambres benthiques, explique Andrew Sweetman, premier auteur de l’étude. En toute logique, l’eau de mer ainsi emprisonnée aurait dû voir sa concentration en oxygène diminuer, à mesure que ce dernier était consommé par les organismes vivants à ces profondeurs. C’est pourtant l’inverse qui a été observé : le taux d’oxygène augmentait dans l’eau au-dessus des sédiments, dans le noir complet et donc sans photosynthèse, développe le professeur Sweetman, responsable du groupe de recherche sur l’écologie et la biogéochimie des fonds marins de l’association SAMS.
La surprise a été telle que les chercheurs ont d’abord pensé que leurs capteurs sous-marins s’étaient trompés. Ils ont mené des expériences à bord de leur navire pour voir si la même chose se produisait en surface, en faisant incuber, dans le noir, ces mêmes sédiments et les nodules qu’ils contenaient. Et constaté une nouvelle fois que le taux d’oxygène croissait. À la surface des nodules, nous avons détecté une tension électrique presque aussi élevée que dans une pile AA, décrit Andrew Sweetman, en comparant ces nodules à des batteries dans la roche. Ces étonnantes propriétés pourraient être à l’origine d’un processus d’électrolyse de l’eau, soit la séparation des composants de la molécule d’eau (H2O), en molécules d’hydrogène et d’oxygène à l’aide d’un courant électrique. Cette réaction chimique intervient à partir de 1,5 volt – la tension d’une pile – que les nodules pourraient atteindre quand ils sont regroupés, selon un communiqué de l’association SAMS joint à l’étude. Ils ont appelé ce gaz produit si profondément que les rayons du soleil ne pénètrent pas jusque-là, l’oxygène sombre.
Et voilà tout le récit moderne sur l’apparition de la vie qui est remis en cause. La vision conventionnelle étant que l’oxygène a été fabriqué pour la première fois il y a environ 3 milliards d’années par des cyanobactéries qui ont mené au développement d’organismes plus complexes, explique Nicholas Owens. La vie aurait pu commencer ailleurs que sur la terre ferme et près de la surface de l’océan, s’enthousiasme Andrew Sweetman. Pour lui, cette découverte ouvre également des perspectives sur l’existence de vie extraterrestre. Puisque ce processus existe sur notre planète, il pourrait générer des habitats oxygénés dans d’autres mondes océaniques comme Encelade ou Europe (des lunes de Saturne et de Jupiter) et y créer les conditions d’apparition d’une vie extraterrestre. Le rêve est permis. Plus prosaïquement, ce résultat plaide, une fois de plus, pour un strict encadrement des fonds marins, une zone fragile, largement méconnue, mais qui attise la convoitise des industriels.
Libération 22 07 2024
Et au fait, quid de la salinité de l’eau de mer ?
Les fleuves venant se jeter dans les océans, on peut raisonnablement imaginer que la salinité de ces derniers provient de la concentration par évaporation des eaux douces continentales. Or les eaux continentales renferment essentiellement des ions bicarbonate HCO3, calcium Ca2+ et potassium K+ alors que la chimie des eaux salées est largement dominée par les ions chlorure Cl- et sodium Na+. Impossible donc de fabriquer de l’eau de mer par simple concentration d’eaux douces continentales !
L’origine de la salinité de l’eau de mer s’inscrit dans le cadre plus vaste de l’évolution des océans. Les plus anciennes roches sédimentaires déposées en milieu marin sont âgées d’environ 4 000 m.a. Les premiers océans, pas nécessairement ceux que nous connaissons aujourd’hui – se sont donc formés dans l’intervalle 4 600 (âge de la formation de la Terre) – 4 000 m.a. Ils sont très anciens. L’eau originelle provenait pour une petite part du dégazage de la jeune Terre chaude et visqueuse, via les premières éruptions volcaniques et pour l’essentiel des apports de pluies de météorites échappées de la ceinture des astéroïdes et nombreuses en ces temps anciens. Il s’y ajoutait certainement la contribution des comètes, grosses boules de neige sale. Ces affirmations s’appuient notamment sur la composition de l’eau exprimée au travers de celle de son rapport isotopique deutérium/hydrogène. Celui-ci est très voisin de celui des chondrites carbonées, une variété de météorites riche en eau.
L’eau primordiale, qui a alimenté les jeunes océans, provenait donc essentiellement des météorites et accessoirement du manteau terrestre et non, comme le bon sens le suggérerait, de l’écorce terrestre superficielle. En effet celle-ci semble incapable de fournir les stocks d’ions chlorure, bromure, et sulfure contenus dans l’eau de mer, ni même la totalité des sels.
Venons-en à la salinité proprement dite des océans jeunes et actuels. Les éruptions volcaniques, et rappelons que le volcanisme sous-marin représente 80 % du magmatisme terrestre actuel, ont apporté, à côté de la vapeur d’eau, du dioxyde de carbone CO2, des chlorures et des sulfates. Il s’y ajoutait la contribution des sources hydrothermales, encore appelées fumeurs noirs, éparpillées le long des dorsales océaniques, qui enrichissaient l’eau de mer en cuivre, nickel, chrome, manganèse, calcium, baryum, lithium… À cela il faut ajouter la contribution des eaux continentales, évoquée en introduction.
L’analyse chimique des roches sédimentaires marines suggère que, depuis 4 000 m.a. la composition des océans a peu varié. Or les rivières déversant annuellement dans les océans 2,5 x 109 tonnes de matières dissoutes, leur salinité devrait croître régulièrement. Cela ne se vérifie pas. Un équilibre s’établit entre les apports, principalement celui des fleuves et le soutirage représenté par les précipitations et la sédimentation marine. Examinons la nature des dépôts océaniques :
La silice, le calcium, et le phosphore sont utilisés par de nombreux animaux marins pour bâtir leurs coquilles et/ou leurs squelettes ; ainsi une partie des formations carbonatées marines du globe contient des restes de fossiles : elles sont d’origine biogénique.
Du potassium, sodium et magnésium se combinent avec des oxydes de silice et d’aluminium, SiO2 et Al2O3, pour former une grande variété de silicates, notamment les nombreux minéraux argileux.
La salinité de l’eau de mer résulte donc de la conjonction de plusieurs phénomènes :
- l’apport de matières dissoutes variées provenant du lessivage des sols et des roches du continent ;
- les apports du volcanisme sous-marin concentré le long des dorsales océaniques ;
- les prélèvements des organismes marins construisant leurs coquilles et squelettes ;
- les prélèvements nécessaires à la formation de minéraux, notamment les minéraux silicates argileux ;
- les prélèvements opérés par des précipitations locales d’évaporites (roches constituées principalement de chlorures et sulfates de potassium, sodium et magnésium) lorsque l’eau de mer est sursaturée.
La résultante est une eau océanique contenant en moyenne 35 grammes de sels au litre. Mais attention ! Il faut bien distinguer le sel (NaCl ou chlorure de sodium), il y en a environ 30 grammes dans un litre d’eau de mer, et les sels responsables de la salinité de l’eau de mer voisine de 35 grammes au litre et composée, par ordre d’importance, par les anions Cl- (chlore), SO4 (sulfate) et HCO3 (bicarbonate) et les cations Na+ (sodium), Mg2+ (magnésium), Ca2+ (calcium) et K+ (potassium).
L’eau de mer n’est pas uniformément salée. La salinité varie généralement entre 30 g/l (Atlantique Nord) et 40 g/l (mer Morte). Elle confère à l’eau de mer une masse spécifique moyenne de 1,025 g/ml supérieure d’environ 2,5 % à celle de l’eau douce. Ainsi, autour du Groenland et de l’Antarctique les eaux superficielles tendront à être moins salées et plus légères, alors qu’en Méditerranée les fortes évaporations conduiront à des eaux plus salées et plus lourdes. Ces particularités influeront grandement sur la circulation océanique.
Enfin, sur les côtes françaises de l’Atlantique, en face des embouchures de la Loire et de la Gironde, d’énormes bulles d’eau douce ou saumâtre, aux contours irréguliers, pouvant atteindre une centaine de kilomètres de diamètre, pénètrent l’océan jusqu’à une centaine de kilomètres des côtes. La localisation de ces eaux douces d’origine fluviale, riches en matière organique et en sels minéraux, est vitale pour la pêche. Le plancton s’y développe rapidement attirant les poissons, et notamment les bancs d’anchois et de sardines.
Terminons par une curiosité chimique. Pour obtenir du sel de table, on évapore de l’eau de mer. Lors de cette évaporation le premier sel à précipiter n’est pas, comme on pourrait le croire le chlorure de sodium, NaCl, de loin le plus abondant, mais le carbonate de calcium CaCO3, puis le sulfate de calcium CaSO ou gypse déshydraté. Le chlorure de sodium ne précipitera que lorsque 90 % de l’eau de mer seront évaporés. L’ordre de précipitation des sels dépend de leur plus ou moins grande solubilité – les moins solubles vont précipiter les premiers – et non de leur relative abondance dans l’eau de mer.
Roland Trompette, Daniel Nahon. Science de la Terre, Science de l’Univers. Odile Jacob 2011
Vers 1660, le physicien et chimiste anglo-irlandais Robert Boyle (1627-1691) étudie des échantillons d’eau de mer prélevés par des capitaines à différentes profondeurs au travers de l’Atlantique. Il établit clairement que, contrairement à ce que l’on pensait jusqu’alors, les eaux marines ne sont pas constituées d’une couche superficielle salée recouvrant de l’eau douce profonde. Ce n’est que vers 1770 que le chimiste français Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794) parvient à analyser des prélèvements de l’eau de la Manche et à en isoler le chlorure de sodium et quatre autres composants. Aujourd’hui, les géologues et les chimistes s’accordent à penser que la salinité, ou salure, des mers est due principalement aux phénomènes de dégazage, de volcanisme, d’attaque acide des roches et de dissolution de gaz atmosphériques qui façonnaient la Terre à l’époque de sa formation. Cette hypothèse a néanmoins été récemment remise en cause : contrairement à ce que les géologues admettaient jusqu’à la fin des années 1990, la salinité a fortement varié au cours des temps géologiques. Elle n’a donc pas été héritée de l’époque de la formation de la Terre. On estime désormais que la salinité de l’eau de mer est déterminée par la vitesse à laquelle se forme le nouveau plancher des océans (selon l’axe des dorsales océaniques).
Yves Gautier. Histoire des sciences de l’Antiquité à nos jours. Tallandier 2005
En 2014, Rosetta nous apportera quelques précisions sur l’eau qu’on trouve sur l’astéroïde 67P/Tchourioumov-Guérassimenko :
Dans l’H2O de l’eau, les hydrogènes, symbolisés par un H, ne sont pas tous exactement les mêmes. Ces atomes ont en effet des cousins, appelés isotopes, deux fois plus lourds, les deutérium, symbolisés par la lettre D. Ceux-ci peuvent remplacer un hydrogène léger pour former des molécules apparentées à l’eau, comme HDO. Dans nos mers, on pèche trois atomes lourds sur 10 000 molécules d’eau. Mais sur Tchouri, c’est trois fois plus, selon les chercheurs.
Cette mesure du ratio de deutérium par rapport à l’hydrogène – D/H – dans l’eau est l’un des résultats les plus fondamentaux de la mission, dont c’était l’un des objectifs majeurs, rappelle Olivier Mousi. Ce résultat écarte probablement l’hypothèse que les comètes ont apporté l’eau sur Terre. Celle-ci a pu arriver à la suite d’un bombardement d’astéroïdes plutôt que par des comètes, a expliqué Kathrin Altwegg.
Il est vrai que jusqu’à présent, les mesures concernant des astéroïdes, ou tout du moins des météorites récupérées sur Terre, ne montrent pas de différence dans la composition de leur contenu en eau avec celle des océans.
Les astéroïdes sont des corps orbitant plus près de la Terre que les comètes ; les premiers étant au-delà de l’orbite martienne, les secondes, comme Tchouri, stationnant généralement bien au-delà de celle de Neptune. Ils sont également moins actifs, leur noyau, qui contient moins de glace, ne dégazant pas son eau comme le font les comètes. C’est lors de la période dite du grand bombardement, que, 800 millions d’années après le début de la formation du système solaire, des astéroïdes seraient tombés en grand nombre sur Terre.
Exit donc les comètes comme source principale d’eau pour la Terre. Mais pas comme source de mystère. Ce résultat n’est en effet pas compatible avec des mesures publiées en 2011 sur une autre comète de la même famille que Tchouri, Hartley-2. Cette dernière a aussi peu de deutérium que les océans terrestres – trois fois moins que trouvé aujourd’hui par Rosetta !
Certes, les techniques utilisées ne sont pas identiques. Hartley-2 a été étudiée à l’aide du télescope spatial Herschel qui repère la couleur du gaz émis à des millions de kilomètres de distance. Alors que la composition de l’eau de Tchouri a été déterminée par une balance électronique : les molécules sont comptées en fonction de leur masse, à moins de cent kilomètres de la cible. On ne peut que constater que pour l’instant, la composition en eau d’une même comète n’a pu être mesurée par deux instruments différents, rappelle Dominique Bockelée-Morvan, qui a travaillé avec Herschel et est impliquée dans Rosetta au sein du Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en astrophysique à Paris.
Mais l’explication la plus plausible est que les astronomes doivent réviser leurs modèles. Bien que les deux comètes aient des orbites assez semblables et des voyages courts autour du Soleil, elles ne se seraient pas formées au même endroit autour du Soleil. La première sans doute plus près de l’étoile que la seconde.
Les théories prévoient en effet que les processus chimiques échangeant le deutérium en hydrogène dépendent de la distance au Soleil, l’enrichissement étant plus fort loin de l’étoile. Ensuite, une histoire gravitationnelle compliquée les aurait en quelque sorte rapprochées. Ces événements ou d’autres expliqueraient aussi qu’à l’inverse, des comètes d’orbites bien plus lointaines comme celle de Halley, ont des rapports deutérium sur hydrogène intermédiaires entre Hartley-2 et 67P/Tchourioumov-Guérassimenko !
David Larousserie. Le Monde 12 12 2014
Le progrès des télescopes, qu’ils soient terrestres ou spatiaux, permet évidemment des découvertes de plus en plus éloignées : en 1990, les télescopes terrestres permettaient de découvrir jusqu’à 7.8 milliards d’a.l. [a.l. : année-lumière, soit 9 460 milliards de kilomètres]. À partir de 1995, avec Hubble et ses différents perfectionnements, on est passé de 12.3 milliards d’a.l. à 13.6 milliards d’a.l. avec la découverte de la Galaxie GN-z11. [4]
En 2021, les télescopes terrestres programmées : ELT – Extremely Large Telescope – est en construction au Chili -, avec un miroir six fois plus grand que le JWST [James Web Space Telescope], télescope spatial qui devrait être lancé en octobre 2021, avec un miroir de 6.5 mètres quand celui de Hubble est de 2.4 mètres.
Pour la tradition arabe, ces histoires-là sont trop compliquées et ils préfèrent croire qu’au début les eaux étaient douces, et, lorsque que les hommes se sont mis à naviguer, ce sont les larmes des veuves de marins qui ont salé la mer.
L’atmosphère terrestre est essentiellement composée d’eau : 80 % et des gaz évacués par les volcans : 12 % de gaz carbonique, 5 % d’azote, les 3 % restant en oxygène, méthane, ammoniaque, et autres gaz acide de type sulfure d’oxygène tout aussi peu favorables à la vie, – dans les conditions où elle s’exerce de nos jours -. Ce 1 % d’oxygène ne suffit pas à créer une couche d’ozone, et donc la terre reçoit en totalité les ultraviolets. Orages, éclairs, volcans, nombreuses météorites … ainsi passaient les jours, ainsi passaient les nuits.
Essentielle à la vie, l’eau douce reste remplie de mystères. Sur la planète bleue, l’eau navigue entre la terre, les océans et l’atmosphère par l’évaporation et les précipitations : un processus connu sous le nom de cycle de l’eau. Seulement, on ne sait pas exactement quand celui-ci a débuté.
D’après une récente étude publiée dans la revue britannique Nature Géoscience, l’eau douce serait quant à elle apparue il y a environ quatre milliards d’années, soit 500 millions d’années plus tôt que ce que les scientifiques pensaient jusqu’alors. De quoi remettre en cause la théorie actuelle, selon laquelle la Terre était entièrement recouverte par un océan à cette période.
Ces résultats se basent sur l’analyse de cristaux anciens issus des Jack Hills, une chaîne de collines du Mid West, en Australie occidentale. Il s’agit du plus ancien site minéral d’origine terrestre trouvé à ce jour.
Les chercheurs ont mesuré la composition en oxygène du zircon, un minéral qui s’est formé dans certaines roches constituant les premières masses continentales de la Terre, il y a 3,2 à 4,2 milliards d’années. Les roches chaudes et fondues dans lesquelles ces minéraux se sont formés ont été en contact avec de l’eau douce au cours de leur formation. Cela repousse la date d’apparition de l’eau douce à quelques centaines de millions d’années seulement après la formation de la planète.
L’auteur principal de l’étude, Hamed Gamaleldien, est chercheur associé à l’École des sciences de la Terre et des planètes de l’université Curtin (Australie) et professeur adjoint à l’ université Khalifa (Émirats arabes unis). En examinant l’âge et les isotopes de l’oxygène dans de minuscules cristaux de zircon, nous avons trouvé des signatures isotopiques exceptionnellement légères remontant jusqu’à quatre milliards d’années. De tels isotopes légers de l’oxygène sont généralement le résultat de l’altération par l’eau douce et chaude de roches situées à plusieurs kilomètres sous la surface de la Terre.
The independant, quotidien britannique. Mai 2024
ARCHÉEN, de 4 à 2,5 milliards d’années [5]
LUCA – Last Universal Common Ancestor – à l’origine de tout le vivant
Une étude publiée dans Nature Microbiology par deux chercheurs de l’Université de Düsseldorf nous en apprend plus sur le fameux ancêtre commun, Last Universal Common Ancestor (LUCA), dont on connaissait l’existence, sans connaître sa composition ni son environnement.
La théorie selon laquelle tous les êtres vivants partagent un ancêtre commun est acceptée par la majorité de la communauté scientifique, mais son patrimoine génétique ainsi que l’environnement nécessaire à son développement restent de grandes inconnues. Bill Martin et son équipe ce chercheurs de l’Université de Düsseldorf ont fait un immense tri parmi 286 000 protéines présentes dans près de 2000 types de bactéries et d’archées (une bactérie sans noyau) pour découvrir qui est LUCA.
En ne conservant que les protéines présentes dans deux types d’archées et deux types de bactéries au moins, ils en ont gardé 355. Une chaîne ADN qui pourrait être celle de LUCA, et qui fait dire à Bill Martin que c’était un organisme qui n’avait pas besoin d’oxygène. Il consommait de l’hydrogène, de l’azote et du C0². De quoi nous faire comprendre un peu mieux l’environnement de notre ancêtre commun, visiblement friand de sources chaudes, comparables à celles que l’on trouve aujourd’hui au fond des océans.
LUCA était donc thermophile, autrement dit, il aimait les fortes chaleurs, et se nourrissait de métaux, comme le fer ou le sélénium. Toutes ces indications, déduites d’un potentiel ADN, donnent des indices sur l’âge de notre plus vieil ancêtre : entre 3,8 et 4 milliards d’années, une période où la Terre était si chaude que les océans n’existaient plus, s’étant évaporés après le grand bombardement tardif de notre planète par des comètes.
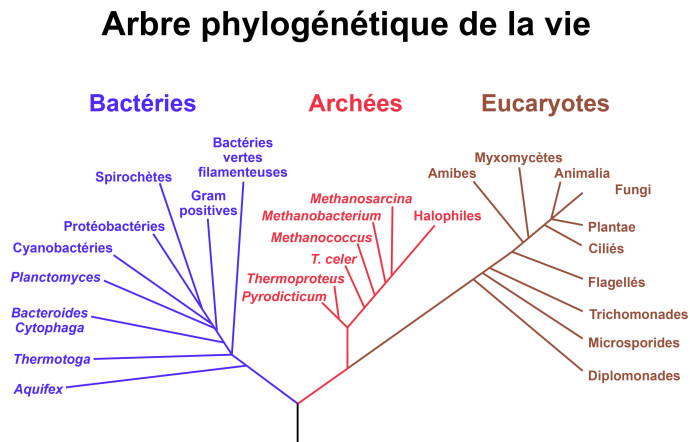
LUCA serait le premier être vivant, ayant ensuite donné naissance aux bactéries, et aux archées elles mêmes à l’origine des eucaryotes, les organismes micro cellulaires les plus complexes qui composent aujourd’hui les végétaux et les animaux. Wikimedia
La découverte des chercheurs de Düsseldorf ne fait pas l’unanimité, et certains scientifiques soutiennent que l’environnement dans lequel vivait LUCA était plus hospitalier, et qu’il avait besoin d’oxygène. Ils justifient leur désaccord en avançant que Bill Martin et son équipe ne peuvent prouver que les 355 protéines qu’ils ont sélectionnées étaient en effet toutes présentes dans l’ADN de LUCA.
A défaut de convaincre tout le monde, cette découverte apporte de nouveaux indices sur l’origine de la vie sur Terre, et entraînera certainement d’autres études pour déterminer plus précisément l’identité génétique de l’ancêtre commun à tous les êtres vivants. Pour cela, le tri impressionnant effectué par les équipes de Bill Martin constitue déjà un grand pas en avant…
Julien Chassagne, Lifestyle, The good Life. le 26 juillet 2016
La grande aventure de la vie sur Terre
2. De 3.8 à 3.5 milliards d’années, apparaissent au fond des océans les premières brique de la vie.
Après le vaisseau Terre apparaît son premier passager : la cellule. La vie dans sa plus simple expression ! Mais déjà dotée d’une excellente capacité à maintenir son intégrité dans un milieu fluctuant, d’une machinerie pour se fournir en énergie et, surtout, du pouvoir de se répliquer. Une apparition que les scientifiques – il y a consensus – attribuent… au hasard. Quelque part près de sources hydrothermales sous-marines, sortes de geyser situés au fond des océans, où tous les ingrédients auraient été réunis : des molécules précurseurs de l’ADN s’y seraient retrouvées encapsulées dans une enveloppe de lipides avec l’équipement nécessaire à leur subsistance. À côté des espèces ayant prospéré à l’époque, dont nous ne savons rien, les plus vieilles représentantes du vivant connues sont des cyanobactéries – des unicellulaires capables de photosynthèse. Des fossiles minéralisés en ont été découverts en Australie. Des structures similaires, âgées de 4.1 milliards d’années, pointeraient vers une origine encore plus précoce de la vie.
William Rowe-Pirra. Sciences et Avenir n° 208 de janvier à mars 2022
La vie sur Terre est née dans les océans. Reste à savoir quand et où. La découverte de structures tubulaires et filamenteuses dans des roches canadiennes vieilles d’au moins 3,77 milliards d’années offre de nouveaux indices pour mieux cerner les conditions de son apparition. Décrites dans la revue Nature du 2 mars 2017, ces formes microscopiques sont présentées par l’équipe internationale qui les a étudiées comme les plus anciens microfossiles connus.
Notre découverte renforce l’idée que la vie a émergé de sources hydrothermales chaudes au fond des océans, peu de temps après la formation de la Terre – il y a environ 4,5 milliards d’années -. Cette apparition rapide concorde avec d’autres indices, comme la découverte récente de formations sédimentaires vieilles de 3,7 milliards d’années, qui auraient été créées par des micro-organismes, souligne le thésard Matthew Dodd (UCL, London Centre for Nanotechnology), premier signataire de l’article dans Nature. Cette même revue, en septembre 2016, avait annoncé la découverte au Groenland de ces stromatolites, des structures sédimentaires attribuées à l’activité de matelas de colonies bactériennes.
Les stromatolites ne sont pas à proprement parler des fossiles : ces formations résultent de l’activité de bactéries, dont la trace directe n’a pas subsisté. En revanche, la nouvelle découverte porte sur les restes de micro-organismes eux-mêmes, fossilisés dans la roche. En l’occurrence, celle de la ceinture de roches vertes de Nuvvuagittuq, située sur la côte est de la baie d’Hudson, au Québec. En 2008, les plus anciennes de ces roches ont été datées à 4,3 milliards d’années (et au minimum à 3,77 milliards d’années), ce qui en fait les plus vieilles connues.
Les microfossiles se présentent sous plusieurs formes, tubes et filaments, faits d’hématite, que l’on retrouve chez des microbes peuplant aujourd’hui encore le fond des océans, à proximité des fumeurs, ces cheminées hydrothermales, qui exhalent des eaux chargées en nutriments, assurent la subsistance d’oasis de vie sous-marine. Ces tubes et filaments seraient des assemblages de cellules individuelles.
La démonstration ne convainc cependant pas Kevin Lepot, de l’université Lille-1, pour qui les fossiles décrits pourraient tout aussi bien être des microlithes, des structures géologiques issues d’un refroidissement rapide du magma. Je favoriserais une interprétation non biologique des objets étudiés, avance le chercheur, pour qui l’étude de Nature ne permet pas d’exclure leur origine volcanique.
Pascal Philippot, de l’Institut de physique du globe de Paris, est, lui, plus convaincu par la nouvelle étude que par celle publiée en septembre décrivant les stromatolites. Le système de Nuvvuagittuq contient des roches sédimentaires dont l’ancienneté n’est pas contestée, rappelle-t-il. Il est toujours difficile de prouver une origine biologique avec des critères purement minéralogiques, mais les auteurs en présentent un certain nombre qui vont dans le bon sens.
Hervé Morin. Le Monde du 3 03 2017
3.7 milliards.
Une molécule acquiert le pouvoir de se dupliquer : l’ADN, et c’en est fini de la bouillie des océans, (dixit Hubert Reeves) et de l’anarchie permanente caractérisée principalement par l’instabilité : les premières traces de vie apparaissent : des bactéries, à cellule procaryote (pas de noyau, division cellulaire par scissiparité, pas d’organites subcellulaires, paroi glycoprotéïque, pas de cytosquelette), au fond des mers, dans des stromatolites fossilisés en Australie : c’est probablement la combinaison des acides aminés des sources hydrothermales – qui libèrent une multitude de gaz et de micrométéorites qui a crée ces bactéries. On a un début de photosynthèse, anaérobie, c’est à dire, sans production d’oxygène, produisant des sucres. L’ADN est nécessaire pour une reproduction à l’identique, mais aussi pour gérer toute l’existence de la cellule, dont la synthèse des protéines, sans laquelle la vie n’est pas possible. C’est le début de la phase sédimentaire de la Terre. Ces premiers organismes microscopiques peuvent se contenter de peu d’oxygène, lequel se diffuse directement à travers leur paroi. Les associations de procaryotes donnent des filaments.
Avant le début de l’ère primaire, la Terre n’était qu’un seul continent, aujourd’hui nommé Rodinia, entièrement recouvert de glace : on a retrouvé en Australie des roches de 700 m.a. érodées par la glace, dont l’empreinte magnétique prouve qu’elles étaient alors proches de l’équateur. En 2011, un chercheur américain avancera la date de 3 milliards d’années pour les premiers frémissements de la tectonique des plaques. Cela ne signifie nullement la mise en place des actuelles lignes de fracture, de conduction ou de subduction, puisque pendant des millions d’années, les continents n’ont cessé de se constituer, puis de se fragmenter pour à nouveau se reconstituer et ainsi de suite… Il s’agit de la mise en place d’un type précis de transformation de la croûte terrestre, qui donnera lieu à de multiples continents, souvent nommés cratons avant de parvenir aux pourtours que nous connaissons actuellement, et qui, eux-mêmes continuent à évoluer.
Les glaciations réduisent les surfaces des mers et intensifient de ce fait la lutte pour l’espace vital, faisant disparaître les espèces les plus faibles et laissant ainsi la place à d’autres, mieux adaptées.
Des géologues australiens découvriront en 2016 au Grœnland des traces d’une activité microbienne remontant à 3,7 milliards d’années, soit 200 millions d’années de plus que les records précédents trouvés dans des roches d’Australie ou d’Afrique du Sud. Et 800 millions d’années environ seulement après la formation de la planète.
Ces formes très particulières se trouvent dans la ceinture de roches vertes d’Isua, une île située au sud-ouest du Grœnland, des structures géologiques dont l’âge avancé a été déterminé par datation isotopique. Le trésor ne mesure que quelques douzaines de centimètres, gravé sur une surface de deux mètres de large. Il a la forme d’une succession de cônes pointus et de bosses écrasées marron, posés sur une sorte de mille-feuille bleuté ; l’ensemble étant recouvert à nouveau de couches de roche irisée.
Les spécialistes parlent de stromatolites et imputent ces formes à des micro-organismes. Ces derniers, en modifiant leur environnement proche, favorisent la précipitation de fines pellicules de carbonates (de la famille du calcaire), qui au fil du temps se superposent et forment ces structures, que l’on retrouve aussi dans les récifs coralliens. Les stromatolites ne sont donc pas à proprement parler des fossiles, qui enregistrent, eux, directement la forme des organismes.
Ces microbes anciens sont loin d’être aussi complexes que les coraux. Il faut les voir plutôt comme formant une sorte de tapis gluant organique, déposé dans des étendues d’eau peu profondes. Leur métabolisme les rendait capables d’assimiler le CO2 de l’atmosphère, gaz plus abondant à l’époque, pour le transformer en carbonate.
Ces cellules primitives n’avaient sans doute même pas besoin de l’énergie solaire, c’est-à-dire de la photosynthèse, pour réaliser ces réactions chimiques. Ces stromatolites sont créés par des colonies de micro-organismes. Dans ces temps reculés, il y avait donc une sorte de collaboration. La vie avait déjà une longue histoire ! estime Allen Nutman, repoussant donc potentiellement plus loin dans le temps l’arrivée d’une première cellule vivante sur Terre.
La communauté scientifique a mis en fait des années à se mettre d’accord sur les critères à étudier pour savoir si des stromatolites sont d’origine biologique ou non.
De telles formes peuvent en effet apparaître naturellement, sous l’effet de plissements de terrain sédimentaires, par exemple. Un de ces critères consiste à regarder au microscope les bosses et à repérer de fins feuillets à l’intérieur. Ils sont bien présents dans ces roches du Grœnland, comme dans celles plus jeunes d’Afrique du Sud ou d’Australie.
C’est un indicateur biologique puissant, même si ces feuillets sont moins visibles que ceux trouvés précédemment en Australie, reconnaît Kevin Lepot, enseignant-chercheur à l’université de Lille, qui a expertisé d’autres stromatolites.
Dans l’article de Nature présentant la découverte, Abigail Allwood, de la NASA, qualifie les implications de cette découverte de stupéfiantes. Avec son regard affûté, elle relève aussi que les sédiments semblent s’être déposés entre les bosses, un autre indice en faveur d’une origine biologique. Mais cela n’empêchera pas les controverses, prévoit celle qui, au milieu des années 2000, a fortement contribué à clarifier l’origine des stromatolites âgés de 3,4 milliards d’années.
Pascal Philippot, de l’Institut de physique du globe de Paris, note aussi que ces stromatolites grœnlandais sont seulement présents sur une très courte distance, alors que, en Australie, par exemple, ils courent sur plusieurs centaines de kilomètres.
Ironie de l’histoire, Allen Nutman avait déjà annoncé en 1996 avoir trouvé une trace de vie à 3,7 milliards d’années dans des roches d’une autre région du Grœnland et sans rapport avec les stromatolites. Dix ans plus tard, il était revenu sur son hypothèse. Avant donc, par une autre preuve, de renfoncer le clou. Nous pensons avoir de bonnes preuves. Chacun peut les regarder et les étudier, estime le chercheur.
Pour gagner en certitude, il faudrait trouver d’autres stromatolites, ce qu’espère l’équipe si elle obtient les financements pour de nouvelles expéditions.
En revanche, il n’y a guère d’espoir de dénicher des indices prouvant plus directement l’origine biologique, comme l’équipe de Kevin Lepot et Pascal Philippot avait pu le faire en 2008 sur les stromatolites australiens âgés de 2,7 milliards d’années. Ils avaient découvert de petits globules de matière organique associés à des nanocristaux de carbonate de calcium, impossibles à fabriquer par des processus physico-chimiques. Malheureusement, l’histoire des roches du Grœnland s’oppose a priori à une telle trouvaille.
Les roches du Groenland sont métamorphiques – elles ont été enfouies sous des kilomètres d’autres roches et sous des chaînes de montagnes -, faisant grimper leur température à plus de 500 degrés Celsius, avant d’être déformées par divers mouvements de terrain. Elles ont fini par revenir en surface, mais ces processus ont modifié irrémédiablement leur composition chimique.
Reste que ce saut dans le temps de 200 millions d’années est un horizon que bon nombre de chercheurs avaient déjà en tête. Il prouve que la vie a pu apparaître très tôt sur Terre, dans des conditions difficiles, avec une atmosphère dépourvue d’oxygène, un bombardement intense de météorites, un rayonnement solaire destructeur…
David Larousserie. Le Monde du 2 09 2016
L’hypothèse d’une origine de la vie au fond des océans refait surface. Une équipe française de l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP), du Laboratoire de géologie de Lyon et du synchrotron Soleil a en effet mis la main sur une molécule-clé du vivant, mais non fabriquée par des organismes biologiques, comme elle l’explique dans Nature du 8 novembre 2018.
Cela pourrait compléter ou remplacer l’autre scénario selon lequel cette cuisine aurait pu avoir lieu loin de la Terre, dans les comètes ou astéroïdes qui, en tombant sur la planète, auraient apporté les précieuses molécules.
Parmi celles-ci se trouvent les acides aminés, briques élémentaires pour élaborer des protéines. Et c’est l’un d’eux, le tryptophane, que les chercheurs ont trouvé au fond d’un chaudron océanique, chauffé à environ 100° et situé à 170 mètres dans la croûte terrestre, dans l’Atlantique Nord. L’endroit a été découvert par hasard en 2000, à mi-chemin entre la Floride et l’Afrique, au sommet d’une montagne de 4 000 mètres d’altitude, le massif Atlantis, près de la dorsale médio-atlantique, à près de 800 mètres de profondeur. Il a été baptisé Lost City, la cité perdue, car il est hérissé de cheminées blanches de plusieurs dizaines de mètres de hauteur, évoquant des constructions abandonnées.
À l’époque, première surprise, des flux abondants d’hydrocarbures, comme du méthane, sont détectés. Ils résultent de la dissociation de l’eau de mer, en contact avec une roche riche en fer, en silicium, en magnésium… qui est remontée du manteau supérieur. L’hydrogène dégagé réagit alors avec le CO2 pour produire les hydrocarbures.
Puis une vie florissante, profitant notamment de l’hydrogène dégagé, est démasquée. Nous voulions étudier ces populations, et notamment savoir jusqu’à quelle profondeur dans la croûte ces micro-organismes persistent, explique Bénédicte Menez, de l’IPGP. C’est là que nous avons été surpris de trouver du tryptophane d’origine non biologique.
Plusieurs techniques ont servi pour identifier cette molécule à onze atomes de carbone, deux d’azote et d’oxygène, coincée dans des pores microscopiques de la roche issue d’un carottage effectué en 2004. L’une consiste à éclairer en ultraviolet les échantillons et à enregistrer la lumière émise par fluorescence, dans l’ultraviolet. La réponse signe les molécules. Une autre, dite de spectrométrie de masse, a permis d’identifier des morceaux caractéristiques de cet acide aminé.
Enfin, l’absence d’autres résidus biologiques, comme des sucres ou des lipides, a convaincu les chercheurs que cette molécule complexe n’avait pas été élaborée par un micro-organisme, mais bien par une réaction chimique, dont ils proposent en outre le mécanisme.
La cité perdue réunit en effet les bonnes conditions. D’abord, un catalyseur solide riche en fer, ce qui est le cas des minéraux de la roche étudiée. Ensuite, de l’hydrogène, qui abonde car, on l’a vu, il est produit par la dissociation de l’eau au contact du manteau. Puis il y a besoin de carbone, matériau abondant qui, sous forme de carbonate, donne la couleur blanche aux cheminées. Enfin, une température pas trop élevée et un milieu alcalin sont nécessaires. Une fois ces ingrédients réunis, la recette conduit à la synthèse d’un produit intermédiaire, lui aussi retrouvé dans les échantillons. Puis au tryptophane lui-même. Ce dernier, l’un des vingt acides aminés utilisés dans la synthèse des protéines, est également un intermédiaire pour fabriquer d’autres molécules, comme, chez l’homme, des sucres.
Le scénario alternatif, privilégiant le fond des océans, est donc en place.
David Larousserie. Le Monde 20 novembre 2018
3.5 milliards.
La croûte et le manteau de la planète Mars basculent du nord vers le sud : elle est alors âgée d’un milliard d’années. Cette rotation est d’environ 20 à 25 degrés de latitude, soit un mouvement de plus de 1 400 kilomètres.
C’est comme si la chair d’un abricot tournait autour de son noyau.
Ce basculement est différent d’autres chamboulements comme l’inversion des pôles magnétiques d’une planète ou la modification de l’axe de rotation de la planète sur elle-même. Celle-ci a d’ailleurs déjà eu lieu pour Mars, sur une plus grande amplitude, il y a quelques millions d’années seulement, entraînant des changements climatiques majeurs.
Ici, il s’agit d’un effet de gravitation dû à un surpoids colossal qui a commencé il y a environ 3,7 milliards d’années avec la naissance du dôme dit Tharsis.
Ce point chaud a accumulé pendant des centaines de millions d’années d’énormes quantités de lave, provoquant une excroissance atteignant 5 000 kilomètres de diamètre et 12 kilomètres d’épaisseur. Un bubon géant d’une masse équivalant à 1/70° de celle de la Lune. Cette région est traversée aujourd’hui par l’équateur martien.
À son voisinage se trouve la plus haute montagne du système solaire, Olympus Mons, qui mesure plus de 21 kilomètres d’altitude. En l’absence de tectonique des plaques comme sur Terre, cette énorme concentration de matière a déformé la croûte et modifié son équilibre gravitationnel, entraînant le basculement.
Les chercheurs ont calculé la position du pôle Nord de Mars en remettant la chair de l’abricot à sa place, c’est-à-dire en calculant sa nouvelle position d’équilibre en l’absence de Tharsis. Ils ont alors trouvé au nouveau pôle un point autour duquel des observations antérieures avaient indiqué la présence de glaces souterraines. Comme attendu pour un vrai pôle glaciaire.
D’autre part, ils ont analysé la répartition et l’orientation des restes de vallées fluviales martiennes. Aujourd’hui, celles-ci sont localisées sur une bande d’environ 2 000 kilomètres de large située dans l’hémisphère Sud. En décalant cette zone d’une vingtaine de degrés vers le nord, elle se trouve alors au niveau d’une zone tropicale sous-équatoriale. Or, justement, des simulations du climat martien prévoient une accumulation de précipitations (pluie, neige, glaces) au niveau d’une telle bande (un peu comme pour les tropiques terrestres). L’hypothèse du basculement remet donc en quelque sorte les choses à l’endroit.
Enfin, l’analyse des rivières change aussi la vision commune de l’histoire de la Planète rouge. Les chercheurs ont en effet montré que celles-ci coulent majoritairement du sud vers le nord, même en l’absence du renflement de Tharsis. Cela est dû aux différences d’altitude de quelque 6 kilomètres en moyenne entre les deux hémisphères. Beaucoup pensaient jusque-là que l’apparition de Tharsis avait précédé la création de cours d’eau. En fait, les deux phénomènes, volcanisme et précipitations, sont probablement contemporains. Ce qui augmente la durée de la période pendant laquelle l’eau se trouvait à l’état liquide et donc les chances d’apparition de la vie.
Il y a deux planètes Mars, souligne François Forget, directeur de recherches au CNRS. Aujourd’hui, elle est aride, froide, quasiment sans atmosphère. Hier, il y a plus de 3,5 milliards d’années, à l’époque de l’apparition de la vie sur Terre, elle était propice à la présence d’eau liquide. Ces travaux fournissent une nouvelle carte de cette époque-clé. Mais l’enquête n’est pas finie, ajoute-t-il, car il nous faut comprendre pourquoi de l’eau liquide a pu apparaître dans un climat froid. Il nous faut quelque chose pour le réchauffer.
David Larousserie. Le Monde du 5 mars 2016
3.26 milliards
Une colossale météorite – 37 à 58 km de large, soit 200 fois plus grosse que la météorite de Chixculub, il y a 65 m.a. – frappe la terre. On la nommera S2. Elle laissera des traces dans la ceinture de roches vertes de Barberton en Afrique du Sud, favorisant la prolifération des micro-organismes métabolisant le fer et le phosphore.
vers 3 milliards
Un astéroïde géocroiseur (NEO, de l’anglais Near Earth Object : objet du système solaire que son orbite autour du Soleil mène au voisinage de la Terre), s’écrase par 65°15’ N, 51°50’ O, à l’emplacement de l’actuel Maniitsoq, au sud de la côte ouest du Groënland.
Une région d’une centaine de km de large […] centrée sur 65°15′N, 51°50′W près de la ville de Maniitsoq dans l’Ouest du Groenland comprend un ensemble de formations géologiques inhabituelles créées au cours d’un unique événement impliquant une intense compression et un chauffage. Il n’est pas compatible avec des procédés orogéniques de la croûte terrestre. Les éléments de la structure de Maniitsoq actuellement exposés étaient enfouis à 20-25 km sous la surface lorsque l’événement a eu lieu il y a 3 milliards d’années.
Earth and Planetary Science Letters, vol. 337–338, 1° juillet 2012
2.4 milliards
Un astéroïde s’écrase par 63° 7’ N, 33°23’E : c’est dans l’actuelle Carélie, au nord-est de Saint Petersburg ; le lac Suavjärvi, d’une largeur d’environ 3 km, viendra occuper le centre du cratère de 16 km de diamètre.
PROTÉROZOÏQUE 2,5 milliards à 541 millions d’années.
ère géologique : Sidérien : 2.5 milliards à 2.3 milliards d’années.
La grande aventure de la vie sur Terre
3. Il y a 2.4 milliards d’années, la Grande Oxydation.
Déjà un milliard d’années que les cyanobactéries, véritables usines de photosynthétiques, dégradent les molécules de dioxyde de carbone (CO²), conservent le carbone (C) et rejettent le dioxygène (O²) dans leur environnement. Le fer présent dans les océans capture ce gaz et réagit avec lui pour former des minéraux. Mais rien n’est éternel, et, une fois le fer épuisé, le dioxygène va se répandre dans l’atmosphère. Cette crise écologique change le visage de la Terre à jamais ! Toxique pour la plupart des organismes, le dioxygène précipite l’extinction d’innombrables espèces puis, en réagissant avec le méthane déjà présent dans l’atmosphère, engendre une glaciation – dite huronienne – qui durera 300 millions d’années. Enfin, cette grande oxydation entraîne la formation de la couche d’ozone – un bouclier atmosphérique nécessaire contre les radiations venues de l’espace, sous l’égide duquel la vie va pouvoir se diversifier. Et comme le vivant s’adapte, de nouvelle espèces de bactéries et d’archées – autre forme de vie unicellulaire -, à présent dépendantes de l’oxygène, se mettent à prospérer.
William Rowe-Pirra. Sciences et Avenir n° 208 de janvier à mars 2022
2.229 milliards
Proche de la côte ouest de l’Australie centrale, une météorite s’écrase par 27°10’56 » S, 118°50’04 » E, formant le cratère Yarrabubba, de 30 à 70 km de diamètre. La datation a été faite à l’uranium et au plomb.

27°10’56 » S, 118°50 »04″ E
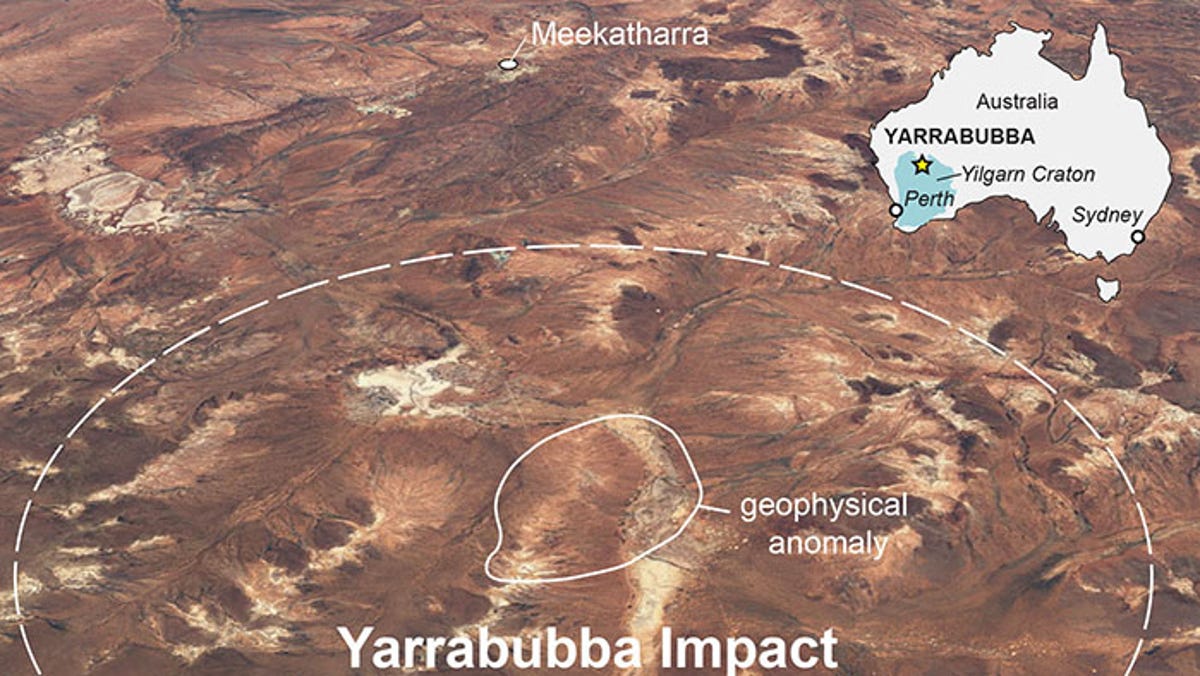
La grande aventure de la vie sur Terre
4. Entre 2.1 et 1.6 milliard d’années, les eucaryotes apparaissent et avec eux, la sexualité.
Une nouvelle page se tourne dans l’histoire du vivant avec l’apparition des eucaryotes. Ces cellules sont dotées d’un noyau protecteur contenant leur matériel génétique. Sont-elles issues d’archées ou plutôt de bactéries ? Difficile à dire, mais l’implication d’un processus biologique particulier, l’endosymbiose, ne laisse aucun doute. Celui-ci permet à une cellule d’assimiler un corps étranger en son sein. Or – et c’est ce qui les différencie, outre le noyau, des bactéries et des archées -, des éléments d’origine probablement étrangère, les eucaryotes, en ont à revendre ! On les appelle organites, et ils jouent dans la cellule un ou plusieurs rôles précis. Les mitochondries pour la respiration cellulaire résulteraient ainsi de l’assimilation d’une bactérie par un eucaryote primitif. Une révolution en appelant une autre, cette nouvelle forme de cellule s’accompagne d’une façon inédite de se répliquer : la reproduction sexuée. Le mélange des gènes qui en découlent produit de nouvelles combinaisons : un véritable avantage évolutif face à un environnement en perpétuel changement.
William Rowe-Pirra. Sciences et Avenir n° 208 de janvier à mars 2022
ère géologique : Rhyacien : 2.3 milliards d’années à 2.05 milliards d’années.
2.1 milliards
En janvier 2008, dans une carrière de grès proche de Franceville, au Gabon, Abdelrazzak El-Albani, chercheur au CNRS, découvre quantité de fossiles, avec une densité de 80/m², dont certains peuvent attendre 12 cm. Leur origine biologique est certaine, ils sont constitués de multiples cellules et leur datation les ferait remonter à 2.1 milliards d’années quand, jusqu’à présent, les premières cellules eucaryotes étaient datées à 1.6 milliards d’années ! La différence est de taille et vient bousculer toute la chronologie jusqu’alors admise par la communauté scientifique. Tout cela est encore trop neuf et exige l’emploi d’un conditionnel prudent.
Il est envisageable que les formes de vie les plus complexes, donc les plus fragiles, aient disparu au profit des organismes les plus archaïques.
Abdelrazzak El-Albani. Le Monde 3 juillet 2010
[…] Six ans plus tard, il n’est plus permis de douter. L’équipe internationale de chercheurs conduite par le géologue Abderrazak El Albani (CNRS de Poitiers), composée d’une cinquantaine de scientifiques et de quelques pointures, vient de confirmer et de préciser, dans la revue spécialisée Plos One, la nature exacte de l’exceptionnelle découverte. Et non seulement il s’agit d’organismes pluricellulaires relativement complexes mais, en plus, ces fossiles gabonais, exhumés dans les argiles de la baie de Franceville – une zone tout à fait exceptionnelle pour la recherche de la vie primitive, car la tectonique des plaques ne l’a pas remodelée -, témoignent de l’existence d’une véritable biodiversité.
Vous avez là des organismes microscopiques de l’ordre de quelques dizaines de microns et des organismes macroscopiques dont la taille varie entre 1 et 17 centimètres. Circulaires, allongés, lobés, cloisonnés, leurs formes sont aussi très variées. Tant et si bien que l’on en a déjà repéré, au moins, huit types différents, explique Abderrazak El Albani, fraîchement débarqué du Gabon avec les plus de quatre cents précieux fossiles dans ses bagages. […] À Franceville ils disposent non seulement de l’empreinte des fossiles mais aussi de leur contre-empreinte : en clair, grâce à l’activité de bactéries, les organismes eux-mêmes ont ici été changés en pierre – pyritisation – et cela permet d’étudier non seulement leur aspect externe mais aussi leur structure interne, tout comme on scrute un cerveau au scanner. Nous pouvons, par exemple, dire que ces organismes étaient de type médusaire, indique le géologue. C’est-à-dire qu’il s’agissait non pas de méduses mais qu’ils étaient, comme elles, mous et gélatineux. On note clairement des plissements flexibles, précise-t-il. Et, grâce à l’étude des roches, les scientifiques sont également capables de dire que ces organismes composaient il y a très, très longtemps un écosystème marin de faible profondeur, entre 30 et 40 mètres.
Mais alors, comment et pourquoi ce foisonnement de vie, puis plus rien de complexe pendant 1,5 milliard d’années ? Pour les chercheurs, la clé du mystère pourrait résider dans la concentration de l’atmosphère en oxygène. Car les organismes complexes du biotop gabonais sont apparus quelques centaines de millions d’années après une grande glaciation suivie d’une élévation du taux d’oxygène dans l’atmosphère. Selon un scénario très similaire à celui qui a précédé l’apparition des désormais seconds plus vieux fossiles d’organismes complexes, découverts en Australie dans les Monts Ediacara, et datés d’environ 665 millions d’années.
La lessivation des continents sous atmosphère oxydante libère d’importantes quantités de nutriments, note Abderrazak El Albani. La coïncidence troublante devrait donc relancer le débat scientifique sur l’impact de l’oxygène sur le vivant. D’autant que si l’on ne trouve plus trace d’organisme complexe entre ces deux périodes, cela correspond également à une chute brutale de la concentration en oxygène vers – 2 milliards d’années. Voilà qui devrait donner du grain à moudre aux exobiologistes qui cherchent à mieux comprendre l’origine du vivant sur Terre.
Chloé Durant Parenti. Le Point 4 07 2014
Hélas, dix ans plus tard, l’ANR – Agence Nationale de la Recherche – ne sera plus à même de lui fournir les financements nécessaires à ses recherches – pas moins de cinq demandes refusées – et il lui faudra se résigner à voir américains, japonais, norvégiens, se faire une joie de lui passer devant en raflant le bénéfice de ses découvertes.…
Son programme ne manquait pourtant pas d’intérêt :
Elucider les raisons de l’apparition de ces formes de vie multicellulaires et complexes, leur règne de près de 200 millions d’années, puis leur disparition : les gènes de ces organismes ont-ils disparu ou ont-ils été réactivés lors du redémarrage de la vie multicellulaire, plus d’un milliard d’années après ?

Structures tubulaires de quelques millimètres de diamètre, visualisées en 3D par microtomographie aux rayons X au sein de roches vieilles de 2,1 milliards d’années. Photo publiée par Abdelrazzak El-Albani et ses collègues le 11 février 2019 dans la revue PNAS
ère géologique : Orosirien 2.05 milliards d’années à 1.8 milliard d’années.
2.023 milliards
Un astéroïde s’écrase sur la terre par 27°00’ S et 20° 37’ E, au sud de l’actuel Parys, sud- ouest de Johannesburg, en Afrique du Sud. Il a un Ø de 10 à 15 km, et s’enfonce jusqu’à 30 km de profondeur. Le cratère ainsi créé fait 300 km de Ø. La ville de Vredefort se posera au milieu du cratère auquel on donner le nom de Dôme de Vredefort.




éjectas partiellement fondus
_________________________________________________________________________________________
[1] Par commodité, le signe moins ~ par rapport à l’an 0, n’a été adopté qu’à partir de ~ 10 000 ans. Pour les temps plus anciens, il ne sert à rien, puisqu’il ne peut y avoir confusion avec le temps présent. Il est aussi utile de savoir que la nouvelle utilisation de AP – avant le présent – qui tend à remplacer le av. J.C. ou ap. J.C. prend comme référence le temps présent, c’est à dire l’an 1950 [parce que c’est l’année de la découverte de la datation au carbone 14], et non l’an 0.
[2] En 2017 une autre théorie de la formation de la lune reprendra une théorie émise dans les années 1970, venant d’un laboratoire israélien, plus complexe : celle de collisions multiples avec des planétoïdes plus petits.
[3] Quantité de mots fantastiques au sein de ce plancton : cocolithophores, diatomées, foraminifères, chaetognathes, radiolaires, appendiculaires, siphonofores, [minces filaments qui peuvent mesurer jusqu’à cinquante mètres de long) phronimes, pyrosomes, porpites. Symbiose, parasitisme, prédation ou photosynthèse, tous les comportements et les stratégies du monde vivant se retrouvent dans ces flore et faune du monde vivant.
[4] Les milliards d’années sont une unité de temps, une durée, par exemple celle que mettent la lumière émise par une galaxie pour nous parvenir. Pendant cette durée la lumière va à la vitesse de 300 000 km/sec, d’où l’unité de lieu, de distance, qu’est l’année-lumière.
[5] Si l’on contracte l’histoire de la terre en une année, la formation du système solaire se plaçant au 1° janvier à 0 heure et l’an 2000 au 31 décembre à minuit, la vie surgit dès le 23 mars, les premiers êtres multicellulaires seulement le 15 novembre et Lucy, le 31 décembre, en début de soirée…
On peut reprendre encore ce schéma mais, avec comme point de départ le Big Bang où un mois équivaut à 1.15 milliard d’années, une journée à 37.8 millions d’années ; une heure à 1.6 million d’années. Et cela donne :
- 1° janvier : Big Bang.
- 15 mars : formation de la voie lactée.
- 9 septembre : naissance du système solaire.
- 14 septembre : formation de la terre.
- 2 octobre : première forme de vie sur terre.
- 18 décembre : premières plantes terrestres.
- 25 décembre : dinosaures. 26 décembre : mammifères.
- 29 décembre : disparition des dinosaures.
- 31 décembre :
- 12 h : apparition des primates,
- 21 h australopithèque,
- 23 h 50′ le feu.
- 23 h 56′ Homo sapiens.
- 23 h 59′ 35″ L’Agriculture.
- 23 h 59′ 51″ : L’Alphabet.
- 23 h 59′ 53″ Jésus-Christ.
- 23 h 59′ 59″ : la Renaissance
On a plus facilement une idée de la durée géologique en prenant la vitesse de sédimentation du calcaire des ères secondaires et tertiaires : 2 millimètres par siècle.
Les classifications de l’histoire de l’univers sont fonction de l’objet regardé : si l’on observe la nature de la terre, on a une classification géologique, faite d’ères – du primaire au quaternaire -, elles-mêmes subdivisées en époques – du cambrien à l’holocène-, elles-mêmes encore subdivisées en étages, du géorgien au flandrien. Si l’on considère l’homme, la classification – stade culturel -, part du début du tertiaire – 65 m.a., la principale étant le paléolithique, de 2 m.a à 0.15 m.a. Ces catégories ont elles aussi des subdivisions en périodes culturelles, partant du début du quaternaire, vers 1.64 m.a. Les classifications relatives au monde animal, partent du Paléozoïque, à l’ère primaire, passent au Mésozoïque à l’ère secondaire et au Cénozoïque aux ères tertiaire et quaternaire.
Les scientifiques ont récemment éprouvé le besoin d’introduire une nouvelle classification basée sur l’Eon. Ce qu’en dit Wikipedia :
L’éon est l’intervalle de temps géochronologique correspondant à la plus grande subdivision chronostratigraphique de l’échelle des temps géologiques, l’éonothème.
L’histoire de la Terre est découpée en quatre éons. Les trois premiers, qui couvrent les quatre premiers milliards d’années de l’histoire de la Terre sont parfois regroupés au sein d’un superéon nommé le Précambrien. Pour un même intervalle de temps géologique, les éons et les éonothèmes portent des noms identiques.
Le terme éon est également utilisé dans le cadre de la planétologie pour permettre de décrire l’histoire des planètes.
Les quatre éons terrestres sont les suivants, du plus ancien au plus récent :
- Hadéen (de −4,6 à −4 milliards d’années)
- Archéen (de −4 à −2,5 milliards d’années)
- Protérozoïque (de −2,5 à −0,541 milliards d’années)
- Phanérozoïque (depuis l’explosion biologique cambrienne il y a 541 millions d’années, jusqu’à nos jours).

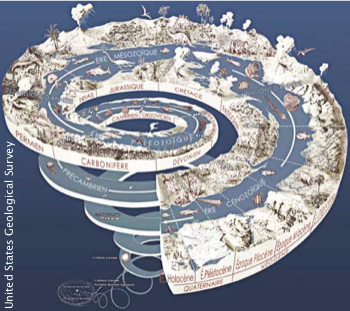


| Par l.peltier dans (101 : origine à l'an 01) le 31 décembre 2008 | (0) Commentaires | En savoir plus |
2 milliards
Une grosse bactérie capte deux minuscules bactéries, peut-être tout simplement pour s’en nourrir. L’une est une algue bleue capable d’effectuer la photosynthèse ; l’autre, une bactérie [1] performante du point de vue énergétique. Le résultat de cette symbiose est la cellule végétale telle que nous la connaissons aujourd’hui, équipée de ces deux symbiotes [2] présumés : le chloroplaste [3] vert et la mitochondrie [4] énergétique. Il n’existe aujourd’hui aucun type intermédiaire entre les cellules bactériennes, les protocaryotes, et les cellules complètes pourvues d’un noyau, de chloroplastes et de mitochondries, dites eucaryotes.
Jean Marie Pelt. La solidarité chez les plantes, les animaux, les humains. Fayard 2004
La cellule eucaryote se reproduit par mitose et ou méiose ; parmi les organites qui la composent, outre les mitochondries, on a encore le reticulum, le dictyosomer et plastes chez les végétaux ; elle est pourvue d’une paroi cellulaire pectocellulosique et elles ont un cytosquelette (actine, microtubule)
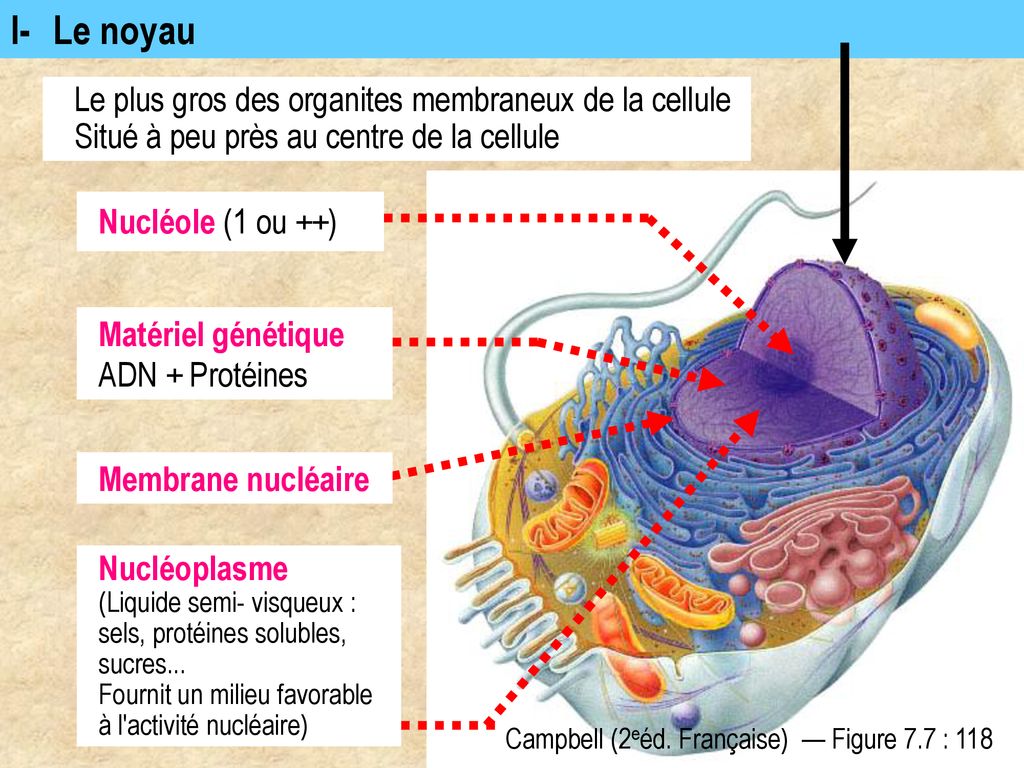
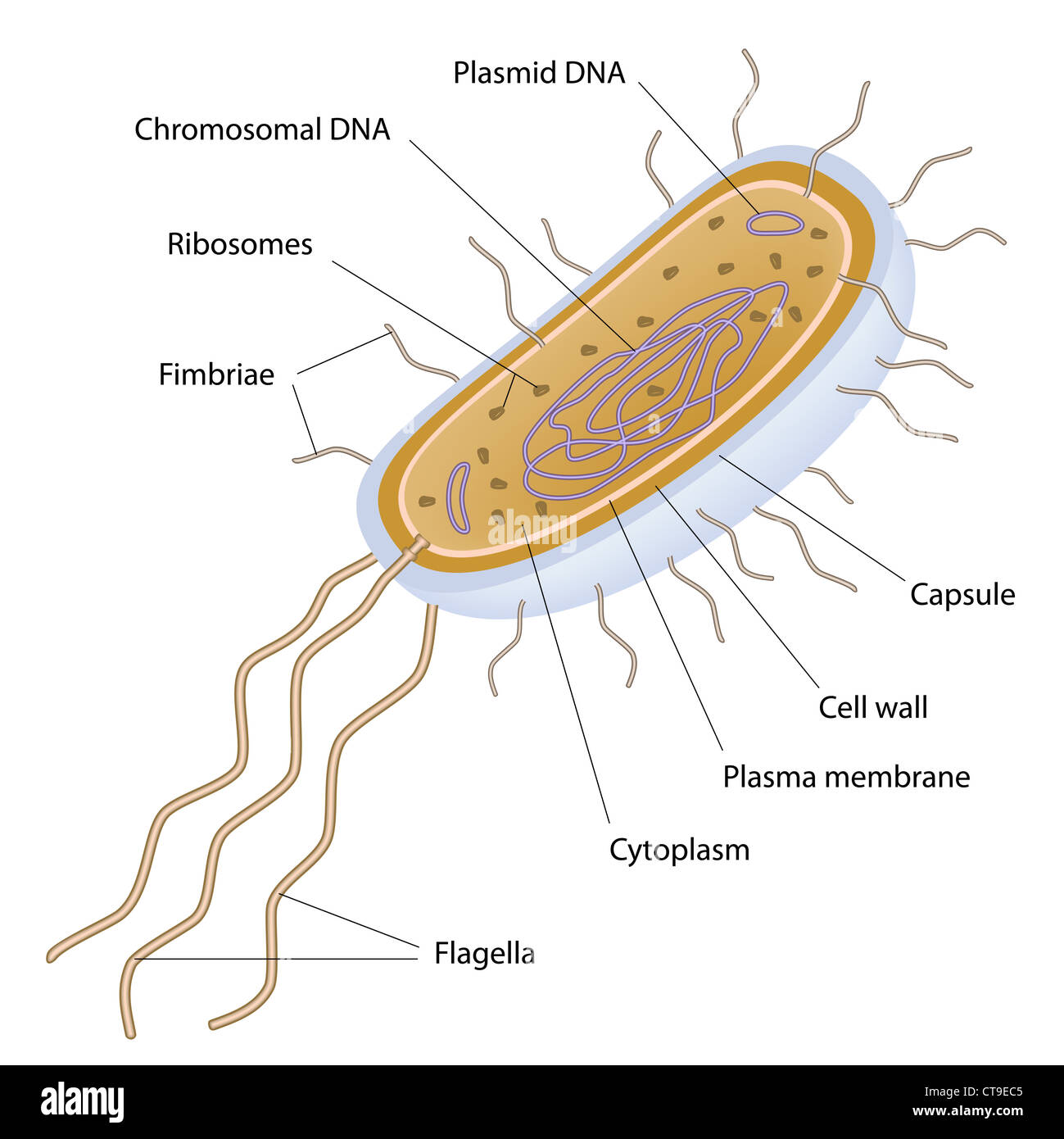
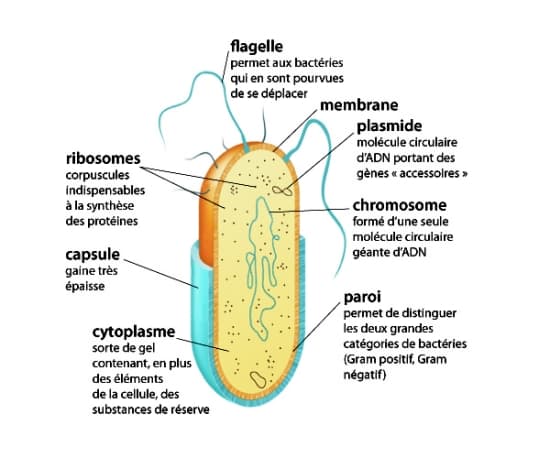
L’apparition d’un pigment particulier, la chlorophylle, entraîne une véritable révolution provoquant une inévitable mutation du monde végétal, mais aussi des changements climatiques et des modifications de la composition de la croûte terrestre. Le processus auquel ce pigment est associé s’appelle photosynthèse. Les premiers organismes capables de réaliser la photosynthèse – la plante absorbe du gaz carbonique, fabrique des sucres et libère de l’oxygène – utilisaient donc l’énergie solaire, ils étaient en mesure de produire une quantité d’énergie dix fois supérieure à celle qui pouvait être obtenue par fermentation, mais cette énergie pouvait être stockée comme réserve énergétique sous la forme d’un composé carboné, le glucose. Ces organismes dépendaient seulement de la disponibilité d’eau et de gaz carbonique. Certains dépôts très anciens appelés stromatolites témoignent de l’activité très importante de ces organismes unicellulaires.
Le début de la photosynthèse signifie l’apparition, à dose conséquente dans l’atmosphère, d’oxygène, véritable poison pour le monde vivant de l’époque. Le taux dans la composition de l’atmosphère va atteindre progressivement le taux actuel de 18 %, obligeant les organismes vivants à évoluer pour survivre. Les oxydes de fer sont les témoins de cette augmentation du taux d’oxygène, et les principaux acteurs des changements de la composition de la croûte terrestre. Dans la haute atmosphère, le dioxygène O² se transforme en trioxygène O³ – l’ozone -. Une couche d’ozone, cela signifie que les ultra-violets sont filtrés et que les cellules végétales, jusqu’alors brûlées, peuvent désormais continuer à vivre.
La Terre s’est formée il y a 4,6 milliards d’années. Son atmosphère était composée de vapeur d’eau et de gaz carbonique. Après refroidissement, la vapeur d’eau s’est condensée en eau liquide, inondant la croûte terrestre et engendrant les océans. Le gaz carbonique s’est dissout dans l’eau, et en présence d’ions calcium (Ca++) a formé du calcaire (CaCO³).
La vie dans la mer est apparue il y a 3,8 milliards d’années sous forme de bactéries. Cette vie était sans oxygène : anaérobie.
Ces bactéries possédaient certes des systèmes biochimiques d’oxydo-réduction, mais leur potentiel n’était pas suffisant pour oxyder l’eau en oxygène et hydrogène grâce à l’énergie des photons du soleil.
C’est alors qu’apparut chez certaines bactéries il y a 2,8 milliards d’années, une nouvelle molécule biochimique : la chlorophylle. Ces bactéries étaient et sont toujours des cyanobactéries appelées aussi algues bleues.
La chlorophylle de ces organismes unicellulaires captant l’énergie solaire va permettre, par son potentiel d’oxydo-réduction élevé, d’oxyder l’eau (H²O) en Oxygène (O²) et Hydrogène (H²). Grâce toujours à la molécule de chlorophylle, les cyanobactéries vont réaliser une photosynthèse en utilisant l’énergie solaire pour transformer le gaz carbonique et l’hydrogène en molécules organiques. Ces cyanobactéries sont dites autotrophes, c’est-à-dire capables de transformer des substances minérales CO2 et H2 en matière organique pour vivre. L’énergie lumineuse se trouve convertie en énergie chimique dans les maisons chimiques constituant les molécules organiques.
La vie était cantonnée dans l’eau. Mais l’oxygène produit au cours de l’oxydation de l’eau n’était pas utilisé, c’était un déchet.
C’est à cette époque, à cause de l’oxygène non utilisé, que la plus grande catastrophe écologique de tous les temps se produisit.
L’oxygène est transformé en ion superoxyde, radical libre possédant un électron célibataire, doué de propriétés destructives de molécules organiques en rompant des liaisons chimiques. Un poison d’une extrême toxicité a envahi la mer.
Mais des bactéries anaérobies, rescapées de cet holocauste, se mirent à développer un système de défense : la chaîne d’oxydo-réduction phosphorylante des cytochromes : la respiration naquit.
Les molécules organiques synthétisées à partir du gaz carbonique et de l’hydrogène sont métabolisées en CO2 et libèrent des H2. Ces H2 vont être scindés en protons et électrons 2H+ et 2e-. Ces électrons vont s’écouler sur des systèmes d’oxydo-réduction de potentiel décroissant jusqu’à l’oxygène 1/2 O2 qu’ils réduiront en O–.
Les protons 2H+ libérés formeront avec O– une molécule d’eau H²O.
La majorité des molécules d’oxygène est neutralisée, la toxicité de l’oxygène par le biais de la production de radicaux libres disparaît : la vie aérobie peut avoir lieu.
De plus l’écoulement des électrons n’est pas comme une rivière tranquille, il y a des chutes d’eau qui sont ici des chutes de potentiel d’oxydo-réduction.
À chaque chute de potentiel d’oxydo-réduction une énergie sera libérée et emmagasinée dans une molécule d’ATP Adénosine Tri Phosphate.
L’homme est un être dont l’organisme est pluricellulaire. Il ne possède pas de chlorophylle et doit puiser son énergie à partir de l’oxygène qu’il respire et des aliments qu’il consomme. Ces aliments sont des glucides, des lipides et des protides. Au cours de la digestion ces constituants seront dégradés en glucose, acides gras, acides aminés et seront catabolisés dans le cytoplasme cellulaire en CO2 et en dérivés d’hydrogène AH2. Le CO2 sera expiré et passera dans l’atmosphère. AH2 se dissociera dans les mitochondries en A et H2 et ensuite H2 donnera 2H+ et 2 e-. Ces mitochondries dont les ancêtres étaient des bactéries possèdent la chaîne des cytochromes d’oxydo-réduction phosphorylante. Le bilan de cette chaîne respiratoire est la réduction de l’oxygène Vz 02 + 2e– = O– et la production d’énergie sous forme d’ATP.
L’oxygène réduit O- avec les 2 H+ formera de l’eau H2O. L’ATP hydrolyse en ADP et P04—et fournira par rupture de la liaison (riche en énergie) l’énergie nécessaire pour la vie, énergie reconvertie en énergie chimique, cinétique, thermique, électrique,
En plus pour que la vie apparaisse sur la terre ferme il fallait que l’intensité du rayonnement solaire riche en ultra-violet diminue. Une barrière protectrice s’est mise en place grâce à l’oxygène. Dans la stratosphère, des molécules d’oxygène se dissocièrent et les atomes d’oxygène libérés (O) se combinèrent à des molécules d’oxygène (O2) pour former de l’ozone O3.
Cette couche d’ozone va progressivement s’épaissir et permettre par absorption des rayonnements U.V.
Si la majorité des molécules d’oxygène sont, par la respiration transformées, en ions O—, il demeure que des molécules d’oxygène peuvent dans les mitochondries, au cours de certaines circonstances (mode de vie, environnement) évoluer en radicaux libres sous forme d’ions superoxyde, de radical hydroxyl.
Ces radicaux libres vont alors s’attaquer aux constituants vitaux de nos cellules.
Ils peuvent rompre des liaisons chimiques de l’ADN, perturbant sa réplication et entraînant mutations et cancers. Ils peuvent également oxyder les protéines et les lipides des membranes cellulaires.
Heureusement ces actions sont partiellement contrées par l’élaboration d’enzymes capables de neutraliser ces dérivés toxiques de l’oxygène. Citons comme enzymes : la superoxyde dismutase (SOD), la peroxydase, la catalase. Cependant ces enzymes peuvent elles-mêmes être dégradées par ces radicaux libres, et surtout elles diminuent d’activité au cours de notre vieillissement. Les actions délétères des radicaux libres de l’oxygène appelées stress oxydant vont alors entraîner de nombreuses pathologies souvent mortelles.
Des recherches en nutrition et en pharmacologie ont proposé d’enrichir notre alimentation par des anti-oxydants qui neutraliseraient les radicaux libres.
Citons les acides gras essentiels Oméga 3 et Oméga 6, les vitamines A, C, E.
En conclusion l’oxygène nous fait vivre, mais par ses dérivés en radicaux libres nous conduit à la mort.
Un jour les progrès de la médecine permettront d’éliminer de notre organisme la production de radicaux libres de l’oxygène.
Mais l’homme doit absolument préserver les organismes marins et terrestres contenant de la chlorophylle qui sont les poumons de notre planète. Ces poumons sont les forêts anciennes type forêt amazonienne et surtout le picoplancton marin constitué de cyanobactéries.
Dans le cas de leur disparition par la pollution engendrée par l’homme, la vie de tous les êtres consommant l’oxygène disparaîtra et comme au commencement, seules les bactéries anaérobies subsisteront.
Robert Engler. Association Mycologique et botanique de l’Hérault et des Hauts Cantons. Bulletin N° 17. 2012
Une brève [et catastrophique] histoire du vert.
Le vert des végétaux, dû à la chlorophylle, permet la photosynthèse qui, à partir du gaz carbonique atmosphérique et de l’énergie lumineuse, fabrique des molécules carbonées, bases du vivant, et des molécules riches en énergie. Je propose, au prix de nécessaires simplifications, de conter l’histoire des organismes chlorophylliens et de leur influence sur les climats. […]
La photosynthèse est apparue il y a quatre milliards d’années chez des algues bleues, en réalité des bactéries (Cyanobactéries) d’après les nouvelles classifications, et sans doute à peu près en même temps chez divers organismes unicellulaires, dans une ambiance étouffante due au gigantesque effet de serre causé par l’énorme concentration en gaz carbonique (dioxyde de carbone, CO2), une teneur de 30 % soit mille fois l’actuelle.
La source de dioxyde de carbone est le dégagement volcanique, qui n’a cessé de faiblir au fur et à mesure des temps géologiques.
Le taux d’humidité élevé, les nuages épais, et le taux d’oxygène infinitésimal qui régnaient alors ont sans doute dicté les caractéristiques de la photosynthèse.
Commençons par une caractéristique sans conséquence néfaste. Le rendement maximum de la photosynthèse intervient dès le premier pour cent de l’énergie lumineuse atteint, une nécessité sous le couvert nuageux hyperdense d’alors, qui plus est dans l’eau de mer, laquelle filtre une part importante de l’énergie lumineuse dès que la profondeur s’accroît.
Ainsi, en théorie, une plante de sous-bois ne devrait pas rencontrer de difficultés de croissance puisqu’arrive au sol environ 1 % de l’énergie lumineuse. Mais deux raisons viennent s’y opposer. Tout d’abord, l’essentiel des radiations utiles à la photosynthèse, bleu et rouge, a déjà été utilisé. Ensuite, la disposition des feuilles n’est jamais optimale, les deux tiers de l’énergie lumineuse étant perdues. En pratique, il subsiste à peine 1/3 de l’énergie solaire, qui plus est à 80 % dans le vert, qui n’est pas absorbé (c’est pourquoi les feuilles nous paraissent vertes).
La suite est moins rose. Tout d’abord, la photosynthèse, née dans l’eau, en consomme beaucoup, de par sa spécificité biochimique, puisque la photosynthèse est une oxydation de l’eau, et de par la diffusion du CO2, également dans l’eau, et qui aujourd’hui encore nécessite de l’eau.
La réaction chimique se résume ainsi : l’eau est oxydée avec l’aide de l’énergie lumineuse, oxydation qui libère des électrons lesquels, grâce à une chaîne de transferts d’électrons, permettent de former des composés riches en énergie. Ces composés sont par la suite dégradés et l’énergie ainsi libérée permet de carboxyler le CO2, c’est-à-dire de le transformer en matière organique, sous la forme de sucres à 3 carbones, chez les plantes dites C3. Mais le CO2 doit donc parvenir au bon endroit et être utilisé de suite.
La diffusion du CO2 ne comporte aucune difficulté pour un organisme unicellulaire en milieu aqueux. Il n’en va pas de même pour les plantes, qui absorbent le CO2 par des stomates sous les feuilles. Les stomates ne sont pas de simples ouvertures car leurs sont associées des chambres stomatiques saturées en vapeur d’eau. Le CO2, qui se dissout d’abord dans la vapeur, passe ensuite dans le liquide intracellulaire.
Ainsi, autant la photosynthèse est adaptée au milieu aquatique, autant elle ne l’est pas à la vie terrestre. Hélas, aucun nouvelle voie ne s’est développée chez les végétaux, à part deux améliorations.
La voie dite des plantes C4 disjoint l’oxydation de l’eau de la carboxylation (assimilation du CO2) et permet ainsi d’utiliser le CO2 plus profondément dans les tissus, et donc d’en stocker dans davantage de cellules. La photosynthèse peut alors se poursuivre en milieu de journée par temps chaud, stomates fermés. Les plantes C4 (Maïs, Sorgho) continuent de pousser en plein midi quand les autres, les C3, la grand majorité, se mettent à l’arrêt à partir de 30 °C. Au soleil, une telle température est atteinte chez nous l’été de 10 h à 18 heures et nos légumes ne poussent guère…
Autre amélioration, celle des plantes dites CAM, qui concerne des plantes crassulescentes, chez lesquelles la disjonction entre l’oxydation de l’eau et la carboxylation est temporelle. Le CO2 est alors assimilé la nuit quand les stomates peuvent rester grand ouverts.
Ensuite, la photosynthèse se caractérise par l’émission d’oxygène.
Or il s’agit d’un corps chimique hautement toxique, du fait de son pouvoir oxydant élevé, au point qu’il a donné son nom au processus d’oxydation. Songez qu’il corrompt le fer, qui rouille, et qu’il détruit nos cellules par l’intérieur, lors du processus de vieillissement, d’où la vente à prix d’or d’anti-oxydants par des commerçants avisés. Ajoutons que les plantes actuelles consomment une énergie non négligeable à éliminer l’oxygène des cellules. Il est donc probable que dans une atmosphère oxygénée, une autre forme de photosynthèse aurait été sélectionnée ; mais, dans l’ambiance quasi anoxique originelle, la toxicité de l’oxygène s’avérait sans grand risque, en tout cas sans pression de sélection.
En outre, les formes de vie demeurant à l’époque limitées, avec à la fois peu d’individus et peu d’espèces, le tout dans une abondance de ressources, aucune compétition n’existait, donc aucune pression de sélection autre que celle exercée par le milieu physique et chimique.
Enfin, la photosynthèse consomme beaucoup de CO2, un point certes inévitable puisqu’il est transformé en matière organique mais qui, en l’absence à l’époque de capacités de recyclage (chaînes de décomposition) s’est traduit par de grandes pertes de carbone, dont nous brûlons une partie aujourd’hui, et dont une partie a été dissoute dans les océans (coquilles d’organismes morts) ou stockée au fond (voir le problème des clathrates en fin d’article).
Les volcans constituent la source unique de CO2, tout le reste du cycle du carbone consiste en une consommation et un recyclage partiel, soit directement par les végétaux et le vivant (atmosphère, sols, etc.), soit, pour sa plus grande part, via les océans et les roches sédimentaires sous forme principalement de carbonates, qui trouvent leur origine dans le vivant ou son action. Si on représente le cycle du carbone de manière statique, comme dans TOUS les schémas proposés sur Internet ou dans les livres, les végétaux et le vivant apparaissent peu ; par contre, si on tient compte de l’histoire du cycle, les végétaux représentent alors le flux majoritaire, un point oublié du fait de la représentation statique – comme quoi, un simple schéma peut influencer la manière de penser !
Dans une autre atmosphère, une pression de sélection aurait sans doute abouti à un processus moins dispendieux, gaspillage éhonté, mais avec une concentration atmosphérique de 30 %, nul besoin d’économiser le CO2 n’est intervenu.
Il est d’ailleurs à noter que d’autres voies chimiques existent, chez des bactéries, aussi bien quant à la fourniture d’énergie que dans la manière de créer de la manière organique ; mais ces voies, moins efficaces et limitées quant à leurs ressources (H2S, carbonates dissous), sont demeurées minoritaires.
Par ailleurs, la vie demande divers minéraux, dont notamment l’azote (sous forme d’ammoniac ou de nitrate selon le cas), abondant dans l’atmosphère mais indisponible dans les roches (présent à l’état de traces dans les roches magmatiques, il n’existe que dans les roches sédimentaires sous des formes inatteignables à la vie). Face à un tel besoin (pas de protéines sans azote), par chance et par nécessité, est apparue presque en même temps que la photosynthèse la possibilité d’assimiler l’azote atmosphérique. La réaction chimique, liée aux conditions à cette époque, demande l’absence d’oxygène (anaérobie stricte), condition qui deviendra un problème par la suite.
Seules les Légumineuses et environ deux cents espèces, de diverses autres familles, dont l’Aulne et l’Argousier, ont trouvé la parade, par la mise sous séquestre des bactéries dans des nodules en partie étanches, qui plus est, chez les seules Légumineuses, nettoyées de leur oxygène par une substance proche de l’hémoglobine, la leghémoglobine.
Quoi qu’il en soit, malgré les défauts de la voie photosynthétique, la vie s’est développée.
Le processus semble même miraculeux, d’où notre manque de recul habituel à son propos. Pensez-donc, n’est-il pas magique que des organismes assimilent l’énergie lumineuse, surabondante, et un gaz, surabondant, et ainsi, d’amour et d’eau fraîche, en quelque sorte, créent la matière organique, base du vivant ? Un tel procédé, quasiment divin, fait oublier ses inconvénients, de même que la nécessité de l’azote pourtant peu abondant, un talon d’Achille donc. Mais les plantes et la photosynthèse continuent aujourd’hui, même et surtout en cours de sciences naturelles, à être présentées comme des miracles, l’exemple même de la nature bienfaisante et autres fadaises rousseauistes.
Pendant longtemps, la concentration atmosphérique de CO2 a légèrement diminué tandis que celle de l’oxygène augmentait, des changements presque imperceptibles vu la faible biomasse des organismes impliqués. Au bout de 1,5 milliards d’années toutefois, le dégagement d’oxygène a été suffisant pour éliminer par oxydation le méthane, puissant gaz à effet de serre (dix à vingt fois plus que le CO2), d’où une diminution dudit effet, accentuée par la diminution de la teneur en CO2, situation qui, additionnée à des causes volcaniques, a produit la première glaciation, la plus terrible d’ailleurs, il y a 2,5 milliards d’années, la glaciation huronienne.
La planète a été entièrement recouverte de glace sans le moindre endroit d’eau ou de roche libre pendant trois cent millions d’années. Il semble que la perte d’effet de serre due à l’oxydation du méthane ait été accrue par une plus faible activité volcanique, avec donc moins de libération de CO2.
Des éruptions volcaniques ayant rechargé l’atmosphère en CO2, les chlorophylliens ont repris leur travail dès la glaciation terminée, et le dégagement d’oxygène a favorisé le développement de la vie, avec les premiers êtres multicellulaires.
Si l’oxygène est toxique (dans sa forme ionisée), il recèle beaucoup d’énergie, libérée puis stockée dans le cadre de la respiration. Toutefois, d’autres types de respiration existent, sans oxygène. Ainsi, la respiration que nous connaissons peut être vue comme l’exploitation d’une ressource abondante, ou bien comme une manière de consommer le surplus d’un toxique ; et en effet, sans respiration, les végétaux se seraient rapidement intoxiqués à l’oxygène, et nous n’aurions jamais connu de forêts ni de légumes (et pour cause puisque nous n’aurions pas même existé !).
Il y a 700 millions d’années, une nouvelle glaciation intervient, dite Varanger, dont les causes semblent être plutôt géologiques cette fois (suite à des ouvertures océaniques, précipitation de carbonates entraînant la chute de la teneur en CO2), encore que la vie ait probablement joué un rôle plus important que généralement accepté.
Puis, au Cambrien, il y a 540 millions d’années, toutes les conditions furent réunies pour un développement intense des divers organismes. L’explosion de nouvelles formes de vie, presque toutes consommatrices d’oxygène et productrices de CO2, a masqué le problème que pose la photosynthèse.
En conséquence, sans réel besoin et donc sans pression de sélection, aucune modification n’est apparue dans les mécanismes d’assimilation de l’énergie solaire (photosynthèse) et de l’azote atmosphérique (assimilation bactérienne). Peu à peu, la vie sort de l’eau (au Silurien, vers 430 millions d’années) et se développe à la surface terrestre.
La vie résout alors deux problèmes majeurs : la lutte contre la dessication (hors de l’eau… il y a moins d’eau) et contre les UV. Une épaisseur infime d’eau (un simple film) suffisait à protéger des radiations et donc des mutations, sur terre d’autres moyens doivent être inventés, pigments (flavonoïdes) et cuticules chez les végétaux, écailles, plumes ou peau couverte de poils chez les animaux ou pigmentée (mélanine) chez l’homme, ainsi que diverses stratégies d’évitement, en particulier une vie nocturne plus intense que la vie diurne.
D’une manière générale, dans tout écosystème l’essentiel de la biomasse provient des végétaux. Aussi, l’énorme développement de la vie a conduit à deux conséquences, la diminution du taux de CO2 atmosphérique et l’augmentation de la teneur en oxygène, conséquences toutes deux négatives, non seulement pour le climat mais pour les organismes eux-mêmes, à des niveaux différents.
Premier niveau, l’impact de la teneur en dioxyde de carbone, à partir d’un certain seuil, limite la photosynthèse.
Second niveau, l’augmentation de la teneur en oxygène crée la photo-oxydation (dénommée à tort photorespiration), un moyen pour le végétal d’éliminer l’oxygène en excès, mais un moyen qui consomme en pure perte une partie de l’énergie assimilée (jusqu’à un tiers).
Troisième niveau, l’abondance de l’oxygène dans l’eau et dans les sols empêche l’assimilation de l’azote (puisque le processus est anaérobie). Ainsi, l’oxygène produit par les végétaux orchestre le futur manque vital en azote qui limite leur développement.
Bien entendu, de telles limites n’interviennent au début qu’à la marge, et n’empêchent pas le développement de la vie, c’est sans doute la raison pour laquelle elles sont ignorées ou présentées comme secondaires dans l’enseignement, et dans la plupart des ouvrages.
Au Carbonifère, il y a environ 320 millions d’années, l’explosion de la vie a consommé une part importante de l’oxygène fourni par les végétaux, mais pas au point d’empêcher l’augmentation de sa teneur atmosphérique. Parallèlement, le taux de dioxyde de carbone a diminué, jusqu’à 10 % lors de la pullulation arborée carbonifère. Les végétaux étaient partis pour consommer tout le CO2 et donc se détruire eux-mêmes.
Quand on invoque l’absorption du CO2 par les végétaux, mis à part la pullulation carbonifère qui voit l’explosion de formes arborées, on songe surtout au phytoplancton, aux prairies et aux pelouses, ou encore à la toundra et la taïga qui, soit de par leur dynamique consomment beaucoup de CO2 pour les premières, soit, pour les deux dernières, séquestrent le carbone par accumulation à cause de la faiblesse de la décomposition, limitée par le froid. Il en va de même, mais dans une moindre mesure, par accumulation dans les marécages ou les tourbières, cette fois par manque d’oxygène.
Les forêts, quant à elles, consomment peu de CO2 pour les formations tempérées et n’en consomment pas voire en dégagent dans les régions chaudes (parce que la décomposition y est très rapide).
Après diverses extinctions, dues à d’autres causes, et qui ont évité finalement le problème majeur d’une glaciation généralisée, la nouveauté notable pour l’histoire de la planète intervient à la fin du Jurassique, il y a environ 160 millions d’années : l’apparition des plantes que nous connaissons aujourd’hui, les plantes à fleurs ou Angiospermes. Une chance. Pourquoi, puisqu’elles ont continué à consommer le gaz carbonique ? Eh bien parce que les plantes à fleurs devraient, du point de vue des grands phénomènes écologiques, être plutôt nommées plantes à feuilles. Car une feuille se décompose.
Revenons un peu en arrière. Pendant le Carbonifère, le carbone assimilé par les végétaux s’est accumulé, à la fois à cause des conditions anoxiques dans les vases et les tourbières, et à cause du caractère coriace desdits végétaux (les pins que nous connaissons, avec leurs dures aiguilles, en fournissent une image édulcorée). Le carbone s’accumulait, donc il ne revenait pas à l’atmosphère, qui s’en appauvrissait.
Au contraire, 170 millions d’années plus tard, les feuilles tendres des Angiospermes forment des litières que des myriades de décomposeurs transforment, libérant du CO2 dans l’atmosphère ; et, au passage, créant les sols que nous connaissons aujourd’hui, dont nous héritons, et qui nous ont permis quelques milliers d’années d’agriculture facile, jusqu’à leur épuisement en un petit siècle avec la révolution agricole.
Cependant, les Mésopotamiens avaient déjà transformé leur Croissant fertile en désert par des irrigations intempestives qui ont causé une salinisation en surface, et les Africains avaient créé le Sahel à partir d’une quasi forêt, qu’ils ont méthodiquement brûlée. Les Européens n’ont dû la relative pérennité de leurs terres qu’à leur climat tempéré. Quant aux Indiens, ils ont réussi à stériliser plus de la moitié des terres très fertiles de la vallée du Gange. Les sols américains, eux, ou ce qu’il en reste, sont sous perfusion. Les plantes à feuilles constituent la meilleure, et pour tout dire la seule, invention des végétaux propre à limiter les pertes de CO2, en le recyclant dans des chaînes de décomposeurs.
Sans eux et sans les feuilles, la terre ne serait plus qu’une boule de glace depuis au moins cent millions d’années.
Bénissons donc les sols, et leur cortège de bactéries, champignons, protozoaires, nématodes, insectes, vers… Mais, si nous tenons à limiter l’effet de serre, une attitude absurde comme nous le verrons, nous pourrions utiliser un moyen idiot mais simple, peu coûteux et radical : anéantir la vie des sols. Curieux que personne n’y ait encore songé…
Bon an mal an, le taux de CO2 atmosphérique a donc diminué moins vite que l’assimilation photosynthétique ne l’aurait fait craindre, mais il a diminué tout de même jusqu’à une valeur que nous connaissions avant la révolution industrielle, moins de trois pour dix mille (0,027 pour cent ou 270 ppm).
L’action de l’homme a porté la concentration à 410 ppm soit, à l’échelle du vivant, une modification infime, bien qu’assez pour modifier légèrement le climat.
Autant dire que, par rapport aux 30 % de départ, la teneur atmosphérique récente en CO2 en fait un gaz résiduel. Le CO2 est devenu alors LE facteur limitant du développement de la vie végétale, et donc par ricochet de la vie animale.
On pourrait juger osé à première vue de ramener le cycle du carbone au seul vivant.
Mais d’une part les entrées par les volcans sont faibles sur un temps court, d’autre part, si d’autres causes interviennent dans les bilans, en particulier la dissolution ou non du CO2 dans l’eau avec éventuelle séquestration sous forme de carbonates, ces causes connues et prévisibles n’expliquent pas les variations… sauf quand elles sont dues à l’activité du plancton (par exemple pour la précipitation de la craie).
Parallèlement, du fait de la haute concentration d’oxygène dans l’atmosphère (21 %), l’assimilation d’azote atmosphérique devenait anecdotique, une carence heureusement atténuée, mais pas compensée, par la décomposition de la matière organique permise, donc, par la nature tendre des feuilles (le recyclage animal compte pour 10 % dans le bilan), ainsi que par le développement des Légumineuses.
Sans doute étions-nous arrivés au taux minimum de CO2 compatible avec le couvert végétal de la planète.
On estime d’ailleurs que la teneur actuelle en CO2 atmosphérique divise par cent le potentiel de croissance des végétaux, mais d’autres causes interviennent également, comme le manque d’azote.
Nous sommes alors au Quaternaire où, justement, le fait de parvenir à une telle limite va déterminer les climats : les glaciations et âges interglaciaires se succèdent à des vitesses incompatibles avec les temps géologiques, mais en harmonie avec l’évolution des forêts, quelques centaines d’années ; toutefois, dans l’hémisphère Nord seulement. Pourquoi ?
Outre diverses autres raisons (en écologie, les causes s’avèrent toujours multiples et intriquées), les végétations (forêts, mais pas seulement) au Nord et au Sud fonctionnent tout à fait différemment. Au Nord, du fait de températures peu élevées, la décomposition lente crée des sols mais y séquestre le carbone, d’où une diminution de l’effet de serre, suffisante pour enclencher une glaciation. Au Sud, du fait des températures élevées, la décomposition est si rapide qu’aucun sol ne se crée. Le carbone n’est pas séquestré, l’effet de serre perdure. On peut ajouter que la plus grande humidité atmosphérique des forêts équatoriales, dites ombrophiles, ou forêts humides, contribue également à l’effet de serre (l’humidité à saturation est due à la densité du couvert végétal qui empêche toute circulation d’air).
Le mécanisme, bien que mal connu dans les détails et insuffisamment documenté dans ses déterminants, est donc le suivant : une fois parvenu à un quasi épuisement du CO2, l’effet de serre disparaît, la température chute, la végétation meurt. L’augmentation de l’albedo qui en résulte (une forêt ou une prairie reflètent moins la lumière solaire qu’un sol nu ou, pire, enneigé) accroît la chute de température. Une glaciation se produit, le CO2, qui n’est plus consommé, mais continue à être restitué à l’atmosphère par divers mécanismes, décompositions, océans, éruptions volcaniques, accroît peu à peu sa teneur ; l’effet de serre augmente, la température également, l’interglaciaire arrive, devient vite chaud. Une explosion de la vie se produit, principalement chlorophyllienne puisque la biomasse végétale représente 90 % du total ; par suite, le taux de CO2 baisse et enclenche la future glaciation.
Certes, le Quaternaire correspond par ailleurs à un minimum de température sur le plan géologique, minimum mal expliqué mais probablement dû à des causes cosmotelluriques.
C’est justement l’existence d’un tel minimum qui rend critique le niveau de CO2 atteint en grande partie sous l’influence des végétaux. Dans une période géologique chaude, le problème serait minimisé voire masqué. Si une telle période intervient, l’évolution se fera sur des temps géologiques, c’est-à-dire sur des millions et plutôt des dizaines ou centaines de millions d’années. Ainsi, l’impact géologique (cosmotellurique) peut être supérieur à l’effet végétal ou le déterminer, mais sur des échelles de temps sans aucune commune mesure.
À l’époque actuelle, nous étions toujours bloqués à l’intérieur d’un tel mode oscillatoire, à la fois par la pénurie en CO2 et par celle en azote due à l’excès d’oxygène. On peut dire que les végétaux ont modifié la planète au point d’en parvenir à se limiter eux-mêmes. À conditions géologiques égales, rien n’aurait empêché les cycles glaciaires de s’enchaîner indéfiniment. Mais l’homme a consommé en un siècle une petite part du carbone stocké au carbonifère, rejetant le CO2 et augmentant l’effet de serre. L’augmentation de la teneur en CO2 est très favorable à la vie. L’effet de serre perdurera car les végétaux ne consommeront pas tout, de plus un effet retard existe, du fait que nous étions à une époque interglaciaire avec une couverture végétale importante, du fait également que l’azote manque, et enfin que la teneur en CO2 demeure modeste, mille fois moins qu’à l’origine. Rien ne pouvait arriver de mieux à la vie qu’un relarguage intensif de CO2 dans l’atmosphère…
On peut en conclure que les plantes ont modifié, voire détruit, la planète. On constate le même phénomène avec tous les organismes importants, bactéries, champignons, plancton, qui modifient le milieu à leur avantage, mais au détriment des autres formes de vie, et finalement à leur propre détriment. L’homme ne constitue donc pas une exception, constat qui rend pessimiste quant à sa capacité à se sortir du piège dans lequel il s’est fourré : en toute logique, il ira jusqu’à la destruction totale de ses conditions de vie.
Ajoutons pour noircir le tableau que tout organisme épuise les ressources dont il dispose s’il n’est pas limité par des prédateurs, des parasites ou d’autres causes. De simples bactéries, si elles n’étaient pas dévorées avant, consommeraient en moins de 24 heures l’ensemble du vivant de la planète… Il nous aura fallu deux siècles !
Bien sûr, on peut également voir les choses autrement : les végétaux ont créé tous les milieux de vie qui existent à la surface de la planète et, sans eux, la diversité serait probablement moindre, voire minime. Tout dépend en fait de l’échelle à laquelle on raisonne : à l’échelle de la planète, les végétaux ont épuisé leurs ressources ; à l’échelle d’une forêt, d’une prairie ou d’un sol, ils ont créé et entretiennent un milieu de vie. Qu’on détruise la forêt et le sol s’érode rapidement, l’essentiel de la vie est alors anéantie. Aussi n’y a-t-il pas incompatibilité entre les deux raisonnements, l’un qui voit (à grande échelle) les végétaux comme responsables de cataclysmes planétaires, l’autre (à petite échelle) qui les considère comme la matrice de la vie.
Note : jusque récemment, les causes invoquées des glaciations étaient multiples, mais aucune explication ne satisfaisait personne. Les glaciations apparurent dans des configurations cosmiques et géologiques diverses, qui les éliminent donc en tant que facteurs déterminants. Elles coïncident par contre avec les fluctuations des teneurs atmosphériques en CO2 et en O2. On alors tenté d’expliquer lesdites fluctuations par des causes cosmiques ou géologiques, sans succès. La seule cause majeure des changements des teneurs en CO2 et en O2 est le vivant. Rappelons aux sceptiques que malgré le quasi minimum que représente l’effet de serre actuel, sans lui, la température moyenne du globe, indépendamment de la latitude et de la saison, serait de – 18 °C. Ainsi la photosynthèse, à elle seule, détermine la température moyenne et donc le régime glaciaire ou non. Les phénomènes cosmiques et géologiques accroissent ou limitent les effets mais ne les déterminent pas. Par contre la géologie, notamment par la position des continents, détermine les climats locaux (local à l’échelle de la planète, donc au sens de continental).
Bien sûr, l’effet de serre nous sera moins favorable, à nous, humains. Espérons toutefois que l’humanité, si elle survit, n’arrêtera pas totalement de dégager du CO2 dans l’atmosphère, au risque de créer une glaciation dans quelques centaines d’années… Ce serait un comble, non ?
L’action de l’homme, elle n’a d’effet que sur lui-même (du moins si on la limite au dégagement de CO2 et qu’on met temporairement de côté la chimie et les destructions), et encore l’effet n’est-il que géopolitique (gérer des déplacements de populations). Mais, si les choses étaient faciles, nous pourrions tous migrer, en quelques générations donc de manière indolore, vers les toundras actuelles : l’exploitation des terres libérées par le dégel du permafrost nous offrira une agriculture prospère et sans nécessité d’intrants pendant au moins mille ans (et plutôt dix mille, même en les surexploitant à outrance).
Malheureusement, la propriété privée et les revendications des états compliqueront les choses, d’autant que l’immense majorité desdites terres se situe en Russie……
Le permafrost (ou pergélisol) résulte de l’accumulation de matière organique peu décomposée à cause du froid qui ralentit l’activité microbienne, puis de sa prise en masse par le gel sur de grandes épaisseurs, jusqu’à 500 mètres. Le méthane, qui résulte de la dégradation anaérobie de la matière organique avant le gel, conditions anaérobies dues à l’accumulation de matière organique, s’organise avec la matière organique sous forme de clathrates, stables. Un tel piégeage de la matière organique existe également dans les fonds marins.
Chaque m³ de clathrates renferme 0,164 m³ de méthane, gaz à effet de serre 10 à 20 fois plus puissant que le CO², rappelons-le. Si le permafrost fond, il sera rapidement exploitable car le dégagement de méthane créera un emballement de l’effet de serre et une augmentation très rapide de la température, de l’ordre de 5 à 15 °C en moins d’un siècle, augmentation extrêmement favorable à la vie (en moyenne, mais pas partout ni toujours). Ainsi sera le monde si une partie du CO2 séquestré par l’intermédiaire de la photosynthèse retourne à l’atmosphère sous sa forme initiale ou via le méthane.
L’homme n’est pas le seul à disposer du pouvoir de causer la libération des clathrates.
Dans un passé récent, un volcan sous-marin a fondu des clathrates avec à la clé un réchauffement rapide de 5 °C (Maximum thermique du Paléocène tardif il y a 55 millions d’années). Nous sommes donc assis sur des bombes à retardement que nous laissent les végétaux à force d’avoir dilapidé le CO², désormais stocké un peu partout sous forme de matière organique…
Didier Vereeck, Association Mycologique et botanique de l’Hérault et des Hauts Cantons. Bulletin N° 22. Mai 2017
Les grands changements climatiques vont être dus pour le principal à l’excentricité de l’orbite terrestre : variation de l’axe des pôles par rapport au plan de l’écliptique – le plan sur lequel la terre tourne autour du soleil – . On parle aussi de variations de la circulation des courants océaniques : la convection thermohaline.
Sur le site actuel d’Oklo, proche de Franceville, au Gabon, se mettent en activité en 16 endroits différents des réactions de fission nucléaire en chaîne auto-entretenue dans une veine d’uranium encadrée de grès et de granits. C’est un phénomène naturel, du au ruissellement des eaux de surface sur l’uranium, unique à notre connaissance, tout à fait identique à ce qui se passe dans nos réacteurs nucléaires, en beaucoup moins puissant, qui sera découvert en juin 1972, et qui aura cessé quand commencera l’exploitation de l’uranium au XX° siècle. C’est à dire que cette pile naturelle aura produit pendant deux milliards d’années des déchets nucléaires qui n’ont pas perturbé outre-mesure les vies locale, végétale, puis animale et enfin humaine.
L’idée d’une espèce de réacteur nucléaire (d’origine non humaine) fonctionnant à l’intérieur de la Terre peut sembler absurde. Pourtant, elle ne l’est pas… Il existe en effet une preuve indiscutable que le phénomène est possible. Dans la mine d’uranium d’Oklo, en République Gabonaise, ont été retrouvés les résidus d’une réaction de fission nucléaire auto-entretenue s’étant déroulée dans la roche il y a environ 1,7 milliard d’années.
La découverte date de juin 1972, lorsque l’on a constaté qu’une partie du minerai était anormalement pauvre en 235U. Il fallut rapidement se rendre à l’évidence, comme le montrèrent les analyses ultérieures : pendant plus de 400 000 ans une série de petits réacteurs nucléaires naturels avaient spontanément démarré puis fonctionné pendant de longues périodes. Originellement dispersé dans du grès, de l’uranium 235 s’était retrouvé rassemblé dans certaines zones jusqu’à atteindre la concentration nécessaire au démarrage de la fission. La présence de circulation d’eau avait servi de modérateur et permis aux réactions en chaîne de se produire lentement mais de façon stable.
https://matierevolution.fr/spip.php?article4338. 1 février 2017
ère géologique : Stathérien : 1.8 à 1.6 milliard d’années
1.75 milliard
Première fragmentation de la terre émergée, qui donne naissance à deux ensembles continentaux : la Laurasie (aujourd’hui Amérique du Nord, Europe du sud, Asie) et le Gondwana (aujourd’hui Amérique du Sud, Afrique, Inde/Madagascar, Arabie, Australie, Antarctique), qui vont être séparés par un océan, zone de fractures : le Paléo-Téthys. On voit circuler plusieurs noms sur ces premiers âges de fragmentation des terres ; ils correspondent en fait à des périodes différentes, les unités de temps utilisées étant plutôt de l’ordre du milliard d’années que du siècle : il faut surtout garder à l’esprit que, dès cette première fragmentation, la croûte terrestre n’a jamais cessé de se fractionner, tel un puzzle qui se déferait et se referait indéfiniment ; ainsi, il y aurait eu en premier lieu un continent unique nommé Nuna – ou Hudsonie -, de 1,8 à 1,5 milliard d’années, suivi d’un autre, Rodinia, de 1,5 milliard d’années à 750 m.a., lequel engendrera la Pangée qui engendrera le Proto Laurasie, soit en gros, l’hémisphère nord et le Proto Gondwana, – l’hémisphère sud -, ce dernier devenant le Gondwana vers 510 m.a. qui se fracturera au début du Crétacé, vers 136 m.a. Ces assemblages de cratons ne se font pas comme celui d’un puzzle dont les pièces ont été prédécoupées pour s’ajuster avec précision les unes aux autres, mais dans une grande bousculade de plaques qui se rencontrent avec une puissance inimaginable, s’enchevêtrant les unes les autres ; pour le Gondwana, c’est l’origine des montagnes du cap Horn pour l’Amérique du sud, du Cap pour l’Afrique du Sud, des îles Shetland pour l’Antarctique.

Cratons du Mésoprotérozoïque (+ de 1,3 Ga) en Afrique et Amérique du Sud.
http://www.syti.net/EvolutionStory.html
1.7 milliard
Les roches sédimentaires qui se sont déposés à l’emplacement de l’actuel cañon du Colorado se métamorphisent sous l’action de la chaleur du magma et de la pression. Ce sont les schistes et les grès que l’on retrouve aujourd’hui tout au fond du cañon.
Mésoprotérozoïque : 1,6 à 1 milliard d’années.
1.6 milliard
Premières cellules eucaryotes (avec un noyau) : ancêtre commun aux animaux, aux plantes, aux champignons et aux protistes.
ère géologique : Calymnien : 1.6 à 1.4 milliard d’années.
ère géologique : Ectasien : 1.4 à 1.2 milliard d’années.
1.3 milliard
Des algues productrices de chlorophylle a et de chlorophylle b donnent naissance aux premières algues vertes.
ère géologique : Sténien : 1.2 à 1 milliard d’années.
1.2 milliard
Une mer peu profonde occupe l’actuel site du cañon du Colorado, dans le fond de laquelle s’accumulent 4 000 mètres de sédiments et de laves volcaniques.
La grande aventure de la vie sur Terre
5. Il y a 1.2 milliard d’années, les premières algues et la photosynthèse.
On a longtemps considéré les cyanobactéries comme des algues, peut-être les toutes premières. Les scientifiques savent aujourd’hui qu’elles en sont plutôt les précurseurs, car leur structure est celle des bactéries, ou procaryotes, c’est-à-dire des organisme unicellulaires dépourvus de noyau. Leur capacité à exploiter la lumière du soleil pour se fournir en énergie va cependant bel et bien précipiter l’apparition de tout un pan du règne du vivant : les plantes. La première fut sans nul doute une sorte d’algue unicellulaire ; un eucaryote primitif qui assimila une cyanobactérie par endosymbiose. Cette bactérie devint peu à peu la structure qu’on appelle aujourd’hui chloroplaste, l’organite permettant la photosynthèse chez les plantes et les algues.
William Rowe-Pirra. Sciences et Avenir n° 208 de janvier à mars 2022
ère géologique : Tonien : 1 milliard d’années à 720 millions d’années
1 milliard
Les conditions thermodynamiques au niveau de l’interface lithosphère/manteau terrestre qui permettent les phénomènes de subduction, sont en place.
Les roches passent d’une forme à une autre selon un processus continu, ou cycle des roches. En surface, les roches subissent l’érosion ; devenues sédiments, elles sont transportées et cimentées en une roche sédimentaire. Celle-ci peut être transformée par la pression et la chaleur en une roche métamorphique, puis fondue en magma et rejetée enfin à la surface sous forme de lave volcanique. Dès que le magma se solidifie en une roche ignée et que celle-ci est exposée à l’air et à l’érosion, le cycle recommence.
[…] Les roches ignées résultent de la solidification du magma. Expulsé par un volcan, le magma peut prendre plusieurs formes, de l’obsidienne vitreuse à la pierre ponce. Stagnant sous la croûte, il forme un pluton qui refroidit lentement en roche intrusive ou plutonique fortement cristallisée, le plus souvent un granite, composé de quartz, feldspath alcalin et plagioclase [mica].
Nouvel Atlas Universel. Reader’s Digest. 1998
Avec le basalte, le granite est la roche la plus répandue à la surface du globe : 43 % en basalte, qui tapisse plutôt le fond des océans et 22 % en granite, plutôt sur les continents. Les granites constituent les produits les plus évolués et les plus tardifs de la cristallisation des magmas silicatés. Cette cristallisation peut se former à des températures de l’ordre de 700 °C facilement atteintes dans la croûte, à condition que les teneurs en eau du milieu soient suffisantes. Certains granites apparaissent en milieu de plaque ou en zone de divergence de plaques, c’est-à-dire dans une région non soumise aux effets orogéniques : ils sont anorogéniques. Les autres, majoritaires, s’installent dans les chaînes de montagne au moment de leur formation et sont orogéniques.
Les granites participent à la croissance et au recyclage des océans. À l’échelle du globe, la production de magmas provenant du manteau est estimée à 30 km³ par an en moyenne.
Aujourd’hui, on établit trois grandes catégories de roches :
- Les roches magmatiques ou ignées ; venues d’un magma en profondeur, ce sont des roches plutoniques : granite, diorite, andésite ; venues d’une zone plus proche de la surface, ce sont des roches volcaniques : basaltes, laves.
- Les roches sédimentaire, formées sur le fond des océans par décomposition des coquillages : grès, calcaires, argiles, marnes.
- Les roches métamorphiques : préexistantes à grande profondeur et cuites à haute température : schistes, houille, serpentine.
800 m.a.
La température des océans est d’environ 20°.
750-700 m.a.
Glaciation dite de Ghaub [ou Varanger…selon le pays d’où l’on en parle] : on en trouve des traces en Namibie, alors dans l’hémisphère sud à des latitudes tropicales : les variations climatiques tenaient déjà dans ces temps lointains essentiellement aux variations de l’intensité de l’effet de serre. Les algues partent à la conquête des océans.
725 m.a.
Une chaîne de montagnes se forme à l’emplacement de l’actuel cañon du Colorado, suivie de phases d’érosion puis de submersions marines de 550 à 250 m.a.
ère géologique : Cryogénien : 720 à 635 millions d’années. La terre est quasiment entièrement recouverte de glace : on la nommera Terre boule de neige ou Terre boule de glace.
700 m.a.
Le bloc australien se soude au bloc antarctique.
ère géologique : Édiacarien : 635 millions d’années à 541 millions d’années
600 m.a
Premiers métazoaires, dont les fossiles seront découverts à Ediacara, en Australie : des disques dont les plus grands atteignent un mètre de diamètre, contre seulement 6 mm d’épaisseur : ainsi l’absorption de la lumière était maximale pour assurer la photosynthèse des algues qui leur étaient liées. D’autres pluricellulaires apparaissent : vers, coraux, éponges, méduses etc…
La terre connaît un épisode glaciaire global : on en retrouve des témoignages jusqu’en Afrique intertropicale.
580 m.a
Les conditions de l’explosion précambrienne se mettent en place, mais encore aujourd’hui, plusieurs hypothèses sont émises :
-
Un réchauffement important de l’atmosphère terrestre due à l’augmentation de teneur en dioxyde de carbone, CO² et donc de l’effet de serre, et ceci en une centaine d’années, faisant fondre une grande partie de la glace et libérant ainsi des formes de vie jusqu’alors emprisonnées. La prolifération des plantes aurait alors entraîné une augmentation de la teneur en oxygène, et donc du développement du vivant.
-
La chute de l’astéroïde Acraman en Australie, par 32°1’ S et 135°27’ E, qui se serait écrasé à une vitesse de 90 000 km/h (25 km/sec), creuse un cratère de 4 000 m de profondeur, engendre tremblements de terre et tsunamis de plus de 100 m de haut. On a retrouvé des éjecta, grains de quartz choqués à plus de 450 km du lac salé d’Acraman, de 20 km de diamètre. Les débris arrivant à la suite auraient mis le feu au méthane des marais, provoquant des incendies dont les fumées obscurcirent le ciel pour des années, faisant chuter la température et disparaître la plupart des organismes. Seuls les survivants les plus résistants, purent recoloniser la terre, une fois revenu le retour à la normale, sans concurrence aucune de qui que ce soit.
La grande aventure de la vie sur Terre
6. Il y a 575 millions d’années, des organismes aux formes étranges
À la sortie d’une longue période de glaciation, la faune marine se développe. Si des études repoussent l’apparition des premiers animaux quelques 300 millions d’années plus tôt, une explosion de biodiversité donna alors naissance à certains des plus anciens organismes complexes connus avec (presque) certitude. Dickinsonia foliacée, Chamia à l’allure de tube ou encore Tatena inflata en forme de disque… Ils présentent des formes étranges, ce qui rend leur classification délicate. S’ils semblent avoir prospéré pendant des dizaines de millions d’années, ils furent évincés lors d’une explosion de biodiversité plus foisonnante encore.
William Rowe-Pirra Sciences et Avenir n° 208 de janvier à mars 2022
558 m.a.
Le Dickinsonia vit au fond des océans : il est plat, ovale, et n’a aucun des organes des animaux évolués mais on le dit tout de même animal, principalement parce qu’on lui aurait trouvé du cholestérol ! [si ! si ! et on ne rit pas ! Mais depuis, il prend sa dose de statines tous les jours, et ça va nettement mieux, même s’il est guetté par la maladie d’Alzheimer !]


Reconstruction tardive de l’hémisphère sud au Protérozoïque Dans le dernier protérozoïque (550 Ma), Rodinia s’est fragmenté en formant Laurentia (Amérique du Nord), Baltica (Europe du Nord) et Gondwana (principalement nos continents de l’hémisphère Sud) avec l’ouverture de l’océan Iapetus. Les terranes péri-gondwanais d’Avalonia, d’Armorica et d’autres se sont rassemblés sur la marge nord du Gondwana, du craton de l’Amazonie à l’Afrique de l’Ouest. De nombreux aspects de ces reconstructions paléographiques font l’objet de débats intenses et d’investigations en cours.
550 m.a.
Les chinois nomment Yilingia spiciformis un ver trouvé dans le sud du pays qui rampait sur des terrains boueux. Nommée Yilingia spiciformis, elle mesure jusqu’à 27 centimètres et semble être un animal biologique constitué d’une tête et d’une queue. D’après les analyses, ce ver vivait pendant l’Ediacarien, soit entre -635 et -542 millions d’années. Nous avons trouvé une énorme empreinte, liée à ses déplacements mais également à de nombreuses autres activités, explique Shuhai Xiao, co-auteur de l’étude et chercheur à la Virginia Tech College of Science. Des observations qui démontrent que cette créature pouvait ramper dans les fonds marins comme un animal moderne. Mais on ignore à quelle lignée animale appartenait Yilingia spiciformis. Les chercheurs suggèrent que ce pouvait être un parent des insectes ou des crustacés tels que les crevettes et les homards, car elle semble avoir des structures en forme de pattes. Seconde théorie, elle serait un ancêtre des deux groupes.
Quoi qu’il en soit, le fossile confirme l’hypothèse d’un big bang zoologique : la vie animale serait arrivée sur Terre lors d’une explosion cambrienne, il y a environ 539 millions d’années. C’est à ce que moment, grâce à un accroissement du niveau d’oxygène et du réchauffement des océans, que les animaux à plusieurs cellules ainsi qu’une grande diversification des espèces animales, végétales et bactériennes seraient apparus. Avant cet événement, la plupart des organismes étaient composés simplement d’une seule cellule.
Gaëtan Lebrun Geo. 6septembre 2019

PHANÉROZOIQUE. De 541 m.a. à aujourd’hui.
Le Phanérozoïque couvre la période où sont apparues des organismes pluricellulaires (métazoaires) diversifiés, pouvant atteindre de grandes tailles.
C’est à ce moment que s’est amorcée la différenciation entre les plantes et les animaux. Les premiers organismes ont alors choisi entre deux parcours de vie distincts que l’on peut, quitte à risquer un certain simplisme, résumer en ces termes : les plantes ont opté pour la sédentarité ; les animaux, pour le nomadisme. Et soit dit en passant, il n’est pas inintéressant de rappeler à ce propos que l’adoption d’un mode d’existence sédentaire a donné naissance, dans l’histoire de l’humanité, aux premières grandes civilisations.
D’emblée, les plantes se sont donc retrouvées dans l’obligation de tirer de la terre, de l’air, et du soleil, tout ce dont elles ont besoin pour vivre. De leur côté, les animaux ont été contraints de se nourrir d’autres animaux ou de plantes, et de développer des formes multiples de mouvement (course, vol, natation…). Voilà pourquoi les plantes sont dites autotrophes (du grec autos, soi-même, et trophè, nourriture) et autosuffisantes ; leur survie ne dépend pas d’autres êtres vivants. Les animaux, en revanche, sont dits hétérotrophes (du grec hétéros, l’autre, et trophè, nourriture) ; ils ne sont pas autosuffisants.
Au fil des générations, ce choix originaire a eu pour conséquences d’autres différences fondamentales entre les règnes animal et végétal, à tel point qu’aujourd’hui, on peut y voir le yin et le yang, le noir et le blanc de l’écosystème. Les plantes sont sédentaires, passives, lentes ; les animaux sont mobiles, agressifs, rapides. On pourrait multiplier à l’envi ces attributs antinomiques, et le résultat ne changerait pas ; dans le monde végétal et le monde animal, depuis cinq cent millions d’années, la vie n’a pas évolué de la même manière.
Le choix primitif entre sédentarité et nomadisme a abouti à une différentiation considérable des corps et des modes d’existence. Les animaux ont décidé de se défendre, de se nourrir et de se reproduire au moyen du mouvement (y compris, au besoin, la fuite). Les plantes ayant, quant à elles, décidé d’obtenir le même résultat en demeurant immobiles, il leur a fallu pour cela chercher des solutions tout à fait originales, du moins de notre point de vue (qui, ne l’oublions pas, reste celui d’un animal).
Immobiles et donc sujettes à la prédation des animaux, les plantes ont commencé par développer une sorte de résistance passive aux attaques venues de l’extérieur. Leur corps est ainsi formé selon une structure modulaire où chaque partie est importante sans qu’aucune soit indispensable. Cette structure offre des avantages essentiels par rapport au monde animal, surtout si l’on tient compte du nombre d’herbivores présents sur terre et de l’impossibilité substantielle d’échapper à leur voracité. Le premier de ces avantages tient ainsi à la capacité des plantes d’être mangées sans pour autant subir des dommages trop graves. Or, aucun animal ne peut en dire autant.
La physiologie des végétaux repose en effet sur d’autres principes que celle des animaux. L’évolution de ces derniers les a conduits à concentrer la quasi-totalité de leurs fonctions vitales sur quelques organes tels que le cerveau, l’estomac ou les poumons. Les plantes, au contraire, ont tenu compte de leur vulnérabilité face à leurs prédateurs, et elles ont évité de regrouper leurs facultés sur quelques espaces névralgiques. Elles se sont comportées, en quelque sorte, à la manière de quelqu’un qui, face à une forte probabilité de vol, ne rassemble pas tout son argent en un seul lieu, mais le répartit entre plusieurs cachettes, afin de limiter les pertes en cas de larcin ; ou encore à la manière des épargnants qui diversifient leurs investissements pour mieux étaler les risques encourus. […]
Chez les plantes, les fonctions ne sont pas liées aux organes. En d’autres termes, elles respirent sans poumons, se nourrissent sans bouche et sans estomac, se tiennent debout sans squelette et sont en mesure de prendre des décisions même sans cerveau.
Et c’est grâce à cette physiologie tout à fait particulière qu’un arrachage même massif ne compromet pas nécessairement leur survie : certaines d’entre elles peuvent perdre jusqu’à 90 %, voire 95 % de leur organisme et repousser ensuite, en toute normalité, à partir du petit noyau ayant survécu à la prédation. Un pâturage peut-être brouté par tout un troupeau et se régénérer en quelques jours. […] Organismes sédentaires, les plantes ont adopté, au cours de leur évolution, une stratégie qui consiste à se composer de parties divisibles pour mieux résister à leurs prédateurs. Les animaux ayant, au contraire, fondés leurs stratégies défensives en premier lieu sur le mouvement, ils n’ont développé des capacités régénératrices que dans un très petit nombre de cas. Le lézard peut certes reconstituer sa queue, lorsqu’elle est coupée, mais il ne saurait en faire autant ni de ses pattes ni de sa tête. Lorsqu’une plante subit une mutilation, non contente de survivre, elle en tire même parfois, des avantages : il suffit, à ce propos, de penser aux effets revigorants des élagages. Cette caractéristique résulte d’une structure très différente de la nôtre et constituée de modules réitérés : les branches, les troncs, les feuilles ou les racines d’une plante correspondent à autant de modules plus simples accrochés les uns aux autres tout en restant indépendantes, un peu à la manière des éléments d’un jeu de construction.
Un géranium qui orne une terrasse ne donne certes pas cette impression, et il apparaît plutôt comme un être vivant unique. Mais si vous en coupez un morceau et que vous le replantez ailleurs – si vous le bouturez, dirait un jardinier -, ce morceau détaché s’enracinera et donnera naissance à une nouvelle plante [5]. En revanche, ni un bras d’homme ni une patte d’éléphant ne peuvent régénérer un organisme entier, ou continuer à vivre séparés du reste de leur corps.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si nous avons pris l’habitude de nous référer à nous-mêmes en parlant d’individus (du latin in, qui signifie non, et dividuus divisible. Notre corps, de fait, est indivisible : si l’on nous coupe en deux, nos deux moitiés seront incapables de vivre chacune de son côté et elles mourront. Si l’on coupe une plante en deux, en revanche, ses deux moitiés pourront continuer à vivre en parfaite indépendance, et ce pour une raison très simple : une plante n’est pas un individu. La manière la plus correcte de concevoir un arbre, un cactus ou un buisson, ne consiste pas à le comparer à un homme ou à un autre animal, mais de l’imaginer comme une colonie. Car il ressemble davantage à une colonie d’abeilles ou de fourmis qu’à un animal envisagé isolément.
De ce point de vue aussi, malgré l’extrême ancienneté de leur existence, les plantes témoignent d’une exceptionnelle modernité. L’un des concepts fondamentaux sur lesquels reposent les technologies rendues possibles par l’avènement d’Internet et fondées sur la connexion de groupes (par exemple les réseaux sociaux) est en effet celui des propriétés émergentes caractéristiques des super-organismes et des intelligences en essaim. On désigne par-là les propriétés que des entités individuelles ne développent qu’en vertu du fonctionnement unitaire de leur ensemble : aucun de ses composants n’est doté de manière autonome, de même justement que chez les abeilles ou les fourmis, dont les colonies développent une intelligence collective bien supérieure à celle de leurs membres pris un à un.
Stefano Mancuso, Alessandra Viola. L’intelligence des plantes. Albin Michel 2019
ERE PRIMAIRE, de 570 à 245 millions d’années. Paléozoïque
ère géologique : Cambrien 541 à 485.4 millions d’années.
La grande aventure de la vie sur Terre
7 Entre 541 et 530 millions d’années, l’explosion cambrienne
Cette nouvelle explosion va durablement marquer le monde du vivant. C’est la genèse de presque tous les embranchements majeurs d’animaux : arthropodes, mollusques, vers, éponges, échinodermes et chordés – ces organismes dotées d’une structure dorsale rigide et dont les vertébrés feront plus tard partie – y font leur apparition. Les océans fourmillent soudain d’une vie plus variée. D’une organisation simple (unicellulaires, petits organismes pluricellulaires, colonies de cellules), les êtres évoluent vers une structure beaucoup plus élaborée, avec des innovations essentielles : les intestins, la mâchoire, les yeux, ou encore un squelette interne minéralisé. Les changements sont de taille, littéralement, puisque les animaux gagnent aussi en envergure. Avec ses 80 centimètres, l’Anomalocaris était un véritable géant dans les mers cambriennes ! Mais explosion ne signifie pas chaos. L’écosystème marin, qui se complexifie conjointement, voit la mise en place d’une chaine alimentaire bien établie, enrichie de nouvelles relations de prédation.
William Rowe-Pirra. Sciences et Avenir n° 208 de janvier à mars 2022
540 m.a.
Les mers sont peu profondes et l’activité volcanique intense. Les algues vertes, sans racines, ni tiges, ni feuilles, quittent l’océan pour tenter – et réussir – la conquête des continents jusque là dénués de vie -. Ces organismes vont alors développer des racines et des tissus conducteurs de sève pour irriguer les parties aériennes. Occuper la terre ferme comportait plusieurs avantages, par exemple la possibilité de se disséminer plus facilement, puisqu’il n’existait aucune forme de concurrence. En dépit du danger de dessèchement, l’émersion permettait d’absorber plus facilement le gaz carbonique et de jouir d’un meilleur éclairage, car ces organismes avaient à leur disposition une lumière directe et non plus filtrée par l’eau. C’est ainsi que sont apparues les Bryophytes, c’est-à-dire les Mousses et les Hépatiques, toutes petites plantes primitives, encore liées au milieu aquatique, qui ne vivent actuellement que dans des milieux particulièrement humides. Des organes et des tissus se spécialisent. Les hépatiques tapissent le substrat humide pour maximiser l’absorption. Pour réduire les pertes d’eau, les épidermes sont recouverts de cutine. Les stomates – des petits trous – apparaissent pour régulariser le passage des molécules gazeuses à travers l’épiderme que la cutine a rendu étanche. Pollinisation et fécondation se font par le vent et plus tard par les insectes, mais encore – et ça, il faudra attendre 2022 pour que Myriam Valero, de la station biologique de Roscoff nous l’apprenne, en milieu marin, par l’idoté, un petit crustacé rouge de moins de 2 cm. qui assure la pollinisation des gracilaires, une algue rouge.
Apparition d’animaux complexes, à coquille rigide. On estime le nombre d’espèces animales à 160 000. Auparavant, de 3,5 milliards à 540 m.a, elles n’étaient que quelques centaines.
Le mot vie tient plus du besoin de classification de l’esprit humain qu’à une réalité physique précise : en fait, il tient à notre faculté de compréhension de la complexité des choses : tant que tout cela est à peu près compréhensible par un cerveau doté d’un QI moyen, on le nomme par le nom des principaux composants : bactéries etc… et dès que la complexification d’un organisme passe le seuil de compréhension rapide, on parle de vie.
La définition qu’en donne la NASA fait l’objet d’un relatif consensus : la vie est un système chimique capable de s’auto-entretenir et d’évoluer par sélection naturelle.
Ce qui caractérise le vivant, c’est peut-être la faculté de transmettre de l’information contenue dans l’ADN et colportée par l’ARN messager.
Didier Raoult, biologiste à Marseille.
On se retrouve donc aujourd’hui avec plusieurs scénarios, qui ne sont pas forcément incompatibles, concernant l’apparition de la vie : celui de la soupe primitive dans les océans ; celui des météorites ensemençant la Terre ; celui des sources hydrothermales dans les abysses où la pyrite de fer permet l’assemblage de molécules organiques complexes ; celui de mares de boues où l’argile, organisée en minces feuillets, facilite la production d’ARN et de petits peptides à l’abri de l’eau. Et donc celui des hydrogels d’argile, qui auraient rempli, dans les océans, cette même fonction.
Hervé Morin. Le Monde 12 novembre 2013
Et où se trouvent les frontières de la vie ? Quand on constate que des arbres sont à même de se transmettre des informations sur les prédateurs qui se nourrissent trop copieusement de leurs feuilles, ce qui leur permet d’émettre des toxines à même de détourner ces prédateurs, quand on voit la beauté ou la laideur des cristaux de glace selon l’environnement musical dans lequel ils se trouvent – voir les nombreux sites sur les expériences du Japonais Masaru Emoto -, etc… on se dit que les paramètres qui déterminent avec précision le contour du domaine de la vie demandent à être revus…
Explosion cambrienne : tous les grands embranchements animaux connus aujourd’hui sont apparus à cette occasion, apparemment sans ascendants. Les arthropodes (êtres articulés) se sont mis à proliférer : ancêtres des crustacés actuels, des araignées et des scorpions. Et aussi nombres de vers et mollusques. Tous ces animaux avaient besoin d’un taux d’oxygène plus important que les premières bactéries, car passant par l’intermédiaire de branchies ou de poumons.
À l’échelle géologique, cette explosion semble s’être déroulée en très peu de temps : tout au plus 40 m.a.
Il a fallu un coup de chance extraordinaire pour trouver les fossiles de cette époque – dans les monts Ediacara, en Australie et dans les schistes de Burgess, au Canada – : chance extraordinaire, car la plupart des fossiles sont généralement, pour les périodes les plus lointaines, des mollusques dotés d’une carapace ; or, au début du cambrien, les carapaces n’existaient pas encore. Cette faune du Burgess représente quelque chose de très spécifique dans le monde de la recherche, car elle fut décrite au début du XX° siècle comme étant bien celle de son époque et il fallut attendre les années 1970 pour réaliser qu’elle avait des caractères très novateurs par rapport aux autres faunes contemporaines. Ainsi, pour le Précambrien où la vie se limite aux bactéries, il y a 2 exceptions :
- La faune d’Ediacara constituée de métazoaires à corps mou, datée autour de 600 m.a. En 2013, des chercheurs ont trouvé dans ces schistes Spartobranchus tenuis, un ver à gland, connu sous le nom scientifique d’entéropneuste, une espèce qui prospère aujourd’hui dans le sable fin et la boue des eaux profondes et peu profondes. Selon Christofer Cameron, de l’Université de Montréal, sa description ajoute 200 millions d’années aux registres fossiles des entéropneustes, les faisant remonter jusqu’à la période cambrienne. Cela change notre compréhension de la biodiversité de cette période. Ces vers ont un corps mou, et il est extrêmement rare d’en trouver des fossiles. Les vers à gland font partie des hémichordés, avec les ptérobranches. Les Spartobranchus tenuis fossilisés sont similaires aux vers à gland d’aujourd’hui, à l’exception du fait qu’ils formaient aussi des tubes fibreux. Ils passaient ainsi au moins une partie de leur vie dans ces tubes, une habitude qui a disparu chez les vers à gland actuels, mais qui persiste chez leurs cousins les ptérobranches. Ces tubes constituent, selon les chercheurs, le chaînon manquant qui relie les deux principales familles d’hémichordés.
- La faune découverte par des géologues français [ci-dessus, à 2.1 milliard] dans le Francevillien (2 000 m.a.) du Gabon s’il est confirmé qu’il s’agit bien d’organismes pluricellulaires.
515 m.a.
On découvrira au XXI° siècle sous les cendres d’un volcan deux nouvelles espèces de trilobites, les mieux conservés jamais découverts. Ces arthropodes fossiles retrouvés pétrifiés dans leur dernière posture sont les représentants d’un écosystème vieux de 515 m.a. un Pompéi marin, découvert dans des niveaux de cendres volcaniques, à Aït Youb, dans la région du Souss-Massa au Maroc.
Avec plus de 22 000 espèces découvertes, les trilobites représentent sans doute les invertébrés fossiles les plus connus. Alors que leur exosquelette en calcite leur confère un fort potentiel de fossilisation (ce qui explique leur nombre important), leurs appendices non minéralisés et leurs organes internes ne sont connus qu’à travers un nombre limité de spécimens. Les trilobites sont éteints depuis la fin du Paléozoïque (-539 à -252 m.a.). Ce sont des arthropodes dont la taille varie d’un à quelques centimètres. Ils vivaient exclusivement dans le milieu marin. Ceux que nous avons découverts mesurent environ 2 centimètres. Aujourd’hui leurs plus proches descendances morphologiquement sont les limules. Ce sont également des arthropodes marins, mais ce sont de lointains cousins.

Vue d’artiste de l’explosion du volcan qui a enseveli les trilobites. Fourni par l’auteur

Vue ventrale d’une reconstitution microtomographique d’un trilobite Gigoutella mauretanica. A. Mazurier, Abderrazak El Albani, Fourni par l’auteur.
Grâce à une technique d’imagerie, la microtomographie de rayons X, nous avons pu étudier les fossiles en 3D sans les extraire de leur gangue. Cette technique se base sur la propriété des rayons X à traverser la matière et à être absorbés en fonction de la nature et de la densité des constituants qu’ils rencontrent. En remplissant numériquement leur moule, les corps disparus ont été reconstitués avec un niveau de détails saisissant.
Ce travail, réalisé par Arnaud Mazurier, Ingénieur de Recherche à l’Université de Poitiers, apporte un éclairage inédit sur l’organisation anatomique des trilobites. Les résultats ont notamment révélé dans les moindres détails un regroupement de paires de pattes spécialisées autour de la bouche, permettant de se faire une idée plus précise de la manière dont ils se nourrissaient. Ils révèlent également, pour la première fois pour ces fossiles, la présence d’un labrum, un lobe charnu faisant office de lèvre supérieure chez les arthropodes actuels.

Vue latérale d’une reconstitution microtomographique d’un trilobite Gigoutella mauretanica. A. Mazurier, Abderrazak El Albani, Fourni par l’auteur.
Cette découverte démontre le rôle essentiel des dépôts de cendres volcaniques pour la préservation des fossiles et l’importance cruciale de l’exploration des environnements sous-marins volcaniques.
Elle démontre aussi que la microtomographie de rayons X est un outil puissant permettant d’observer en 3D des objets fossilisés dans des roches très dures, sans risque de les altérer. Ainsi, les dépôts pyroclastiques (roches composées principalement ou uniquement de matériaux volcaniques) devraient devenir de nouvelles cibles d’études au vu de leur potentiel exceptionnel à piéger et conserver des restes biologiques, même mous, sans générer de dégradation. De nouvelles fenêtres devraient ainsi s’ouvrir sur le passé de notre planète.
Pour illustrer, l’impact de notre découverte, Greg Edgecombe, conservateur au Muséum national d’histoire naturelle de Londres, spécialiste des arthropodes et co-auteur de l’étude a déclaré : J’étudie les trilobites depuis près de 40 ans, mais je n’ai jamais eu l’impression de regarder des animaux vivants comme je l’ai fait avec ceux-ci. J’ai vu beaucoup d’anatomie molle de trilobites, mais c’est la préservation en 3D ici qui est vraiment stupéfiante.
Conversation
505 m.a.
Premiers poissons et proto-amphibiens.
En 2014, on pêchera dans les schistes de Burgess, les fossiles d’un banc de poissons Metaspriggina jusqu’alors seulement connu grâce à deux fossiles dégradés, quand c’est une centaine de spécimens qui ont été identifiés dans les rocheuses canadiennes. Cet ancêtre putatif des vertébrés actuels est long de six centimètres, doté de branchies et d’yeux-caméras ; il devait filtrer sa nourriture sur le fond et utiliser ses muscles striés pour fuir les ancêtres des insectes et des crustacés.
500 m.a.
La grande aventure de la vie sur Terre
8 Entre 500 et 430 millions d’années, les plantes, pionnières de la vie terrestre
Les plantes seront les premières à se risquer sur la terre ferme. Grâce à une série d’innovations physiologiques, elles deviennent capables de résister aux conditions jusqu’alors meurtrières de ce milieu : l’eau y est rare, les rayons ultra-violets plus dangereux que dans les océans. Leur arsenal s’enrichit de molécules essentielles, la lignine et la cellulose entre autres. Elles permettent à ces végétaux de s’imperméabiliser et donc de réduire leurs pertes en eau, mais aussi de rigidifier leurs parties aériennes afin de pouvoir pousser à l’air libre et résister à leur propre pression sans le soutien de l’eau, ainsi que de jouir d’une meilleure protection contre les radiations venues du ciel. Les pionnières de la vie terrestre sont probablement issues d’un groupe d’algues vertes capables de survivre à des émersions temporaires grâce à un mécanisme de symbiose avec des champignons. Avec le temps, la vascularisation des plantes provoque une augmentation de leur taille et une diversification.
William Rowe-Pirra. Sciences et Avenir n° 208 de janvier à mars 2022
Les poissons, puis les amphibiens et les reptiles se dotent d’un cerveau que l’on dira archaïque qui comprend le tronc cérébral et le cervelet. Il gère les fonctions primaires liées à la physiologie de base – respiration, rythme cardiaque, pression artérielle, sommeil, équilibre et les autres fonctions physiologiques essentielles -. Seconde fonction : déclencher, face au danger, des comportements instinctifs liées à la survie, des réflexes d’attaque ou de fuite.

Je me nomme Utaurora Comosa. Je suis long de 3 cm et j’habite dans la formation Wheeler, dans le futur Utah, aux États-Unis.
ère géologique : Ordovicien 485.5 à 443.4 millions d’années.
480 m.a.
Terranne (sous-ensemble) de la Laurasie (aujourd’hui Amérique du Nord, Europe du sud, Asie) l’Avalonia s’avance en subduction sous l’Armorica vers le sud en direction du Gondwana (aujourd’hui Amérique du Sud, Afrique, Inde/Madagascar, Arabie, Australie, Antarctique), et ce dernier s’avance au contraire vers le nord ; ils sont séparés par un océan, zone de fractures : le Paléo-Téthys. Entre la couche Avalonia s’enfonçant sous Armorica et ce dernier, une zone de fusion partielle du manteau qui va créer des volcans explosifs.

Collage européen de terranes amalgamées de type Avalonia et Cadomia, dérivées du Gondwana. Cette carte illustre l’histoire complexe de l’accrétion en Europe. Pour référence, Paris est au point rouge. Assemblage en Europe des masses continentales du Paléozoïque. La plate-forme cratonique européenne est composée d’un assemblage de terranes et de blocs de croûte continentale délimités par des failles, d’ascendance Avalonienne et Cadomienne – une Europe de croûte recyclée précambrienne et cambrienne dérivée du Gondwana. Les principaux pays qui forment l’Europe sont Avalonia, le terrane rhéno-hercynien, l’assemblage de terranes armoricains, Perunica, les Pouilles, Adria, le terrane hellénique et Moesia, tous des terranes péri-gondwanais, à l’exception de la Scandinavie dérivée de Baltica.
472 m.a.
Apparition des plantes terrestres : les premières spores fossiles sont retrouvées, en 2010, dans le nord-est de l’Argentine, alors côte nord-est du Gondwana : ces hépatiques sont de petits végétaux sans feuilles, ni tiges, ni racines, mais équipées, à l’instar des algues, d’un appareil végétatif sans cellules différenciées, ou thalle, plaqué sur le sol : c’est le premier organe de la photosynthèse. Leur ADN les relie à des petites algues d’eau douce que l’on rencontre aujourd’hui encore dans les mares temporaires, les charophytes. Des algues se seraient adaptées à l’assèchement des mares et auraient progressivement appris à vivre hors de l’eau. L’époque où elles apparaissent, l’ordovicien, coïncide avec le moment où l’oxygène s’est accumulé dans l’atmosphère pour former la couche d’ozone de haute altitude, écran indispensable à l’émergence de la vie terrestre. D’autres avaient déjà été trouvés, un peu plus jeunes, en Arabie Saoudite – 461 m.a. – et en République Tchèque – 463 m.a. -. Cinq variétés sont recensées. Il a fallu tout ce temps pour que l’évolution permette aux végétaux d’atteindre le niveau de complexité nécessaire à la colonisation des terres émergées. Ensuite, pendant à peu près 40 m.a., les plantes vont prendre de la hauteur, avec l’apparition du sporange, l’organe reproducteur de spores ; ainsi, spores et oosphères n’ont plus besoin d’eau pour se disperser : le vent peut y pouvoir ; la conquête des zones sèches peut commencer.
470 m.a.
Un fragment de météorite de 8 cm de long, baptisé Osterplana 65 et découvert en 2016 par Birger Schmitz, de l’université de Lund, vient s’incruster dans du calcaire dans ce qui est aujourd’hui la Suède à Thorsberg. Il aurait voyagé pendant un million d’années et sa datation correspondrait avec les chondrites L supposées appartenir à un astéroïde qui aurait explosé après avoir été percuté par un autre corps inconnu. Le bombardement de météorites déclenché par cette collision pourrait être responsable de l’explosion de la vie marine qui a marqué l’ordovicien.
450 m.a.
Premières plantes terrestres vasculaires, thalloïdes pour les plus simples, les autres, plus élaborées, de type Cooksonia.
445 m.a.
Des tout premiers animaux marins, combien sont parvenus jusqu’à nous, en évoluant certes, mais traversant bravement les ans par millions. Ils ne sont pas des milliers d’espèces, mais quelques unes tout de même, pour lesquelles les scientifiques ont préféré abandonner le terme fossile pour adopter celui de reliques. La plus illustre probablement : la limule.
Je pense que cela a commencé avec une pierre que j’ai trouvée dans ma maison en Pologne, où j’ai grandi. Un jour, alors que je traversais la rue en revenant de l’école, j’ai remarqué un beau coquillage parfaitement conservé, évoquant une coquille Saint Jacques, incrustée dans une grande pierre à demi-enterrée. Je n’avais qu’à la prendre et une nuit, je l’ai enterrée discrètement, une pierre énorme que je pouvais à peine soulever, et je l’ai trainée jusque chez moi. La première à remarquer ma nouvelle acquisition a été ma grand-mère. Quand je lui ai demandé ce qu’elle pensait du mystérieux coquillage, elle n’a hésité qu’une seconde avant de me répondre que c’était un vestige du Déluge, quand les animaux qui n’ont pas pu rejoindre l’arche de Noé sont morts noyés. En bon petit catholique, j’ai accepté son explication, mais en même temps, cela m’a paru paradoxal qu’un mollusque aquatique se noie dans une inondation. Je suis allé voir mon père pour clarifier la chose. En homme de science, il a sorti un livre et nous avons déterminé ensemble que la coquille appartenait vraisemblablement à un brachiopode éteint, un animal marin superficiellement semblable à un mollusque, et qu’elle devait être vieille de centaines de millions d’années. Un dessin d’une coquille remarquablement semblable à la mienne était décrite comme venant d’une période appelée Crétacé. Il y avait d’autres dessins, des libellules géantes apparemment grandes comme des oiseaux, une sorte d’immense salamandre avec la tête large et plate et des pattes courtes et trapues. J’ai trouvé cela fascinant, mais je n’arrivais pas à admettre que ces créatures merveilleuses avaient disparu et qu’on ne les reverrait jamais vivantes.
Peu après, j’ai commencé à lire des livres sur la paléontologie. La plupart étaient pleins d’informations qui passaient loin au-dessus de ma tête de huit ou neuf ans, mais les descriptions et les images de trilobites, d’ammonites, sans parler des dinosaures et des surréelles forêts de calamités, me gonflaient du désir irréalisable de remonter le temps. Puis je suis tombé sur une chose très intrigante. C’était la description d’un cœlacanthe vivant capturé au large de l’Afrique du sud – un fossile – vivant. Si ce contemporain des dinosaures avait survécu, peut-être n’était-il pas le seul. Peut-être existait-il d’autres lieux reculés – des poches de ce monde ancien – habités par des plantes et des animaux hâtivement déclarés éteints, mais toujours parmi nous.
Depuis, je suis fasciné par l’idée que certains organismes aient pu survivre plus longtemps que d’autres, et que leur apparence, et peut-être leur comportement, préserve des bribes anciennes de ce récit long et tortueux qu’est la vie sur Terre. Leur existence peut nous donner une idée des écosystèmes du passé et des interactions entre leurs habitants. Faute de machine à remonter le temps, ils sont peut-être notre meilleure chance d’appréhender les mondes fossiles disparus depuis longtemps. Beaucoup d’organismes ont reçu l’appellation excitante de fossiles vivants. Charles Darwin lui-même a été le premier à soutenir l’existence d’animaux et de plantes qui seraient restées pendant de longues périodes géologiques, conservant leur corps et faisant office d’archives du passé de la Terre.
Le concept de fossile vivant a séduit plus d’un scientifique et a nourri de nombreuses controverses dans lesquelles il est brandi comme preuve pour ou contre l’évolution de la vie.
Jeune étudiant en biologie, j’ai embrassé avec enthousiasme l’idée séduisante de créatures vivantes qui auraient résisté à la pression du changement provenant de leur environnement en perpétuelle transformation. C’étaient eux ma machine à remonter le temps, ces vestiges fossilisés rendus à la vie.
Mais en dépit de sa simplicité apparente et d’une longue liste d’animaux et de plantes qui semblent correspondre à cette définition, la validité du concept de fossile vivant n’a cessé de s’éroder et il a fini par tomber en disgrâce. D’une part, les biologistes ne s’entendent pas sur ce qu’est réellement un fossile vivant. Est-ce une même espèce qui n’a pas changé depuis sa première apparition dans les archives fossiles, ou est-ce le survivant d’une lignée autrefois florissante mais presque entièrement disparue depuis ? Un tel organisme doit-il être rare et peu répandu, ou peut-il être commun du moment que nous savons qu’il est issu d’une lignée ancienne ? Doit-il exister des vestiges fossiles ou suffit-il que son origine ancienne soit attestée par ses relations avec d’autres organismes ? Ou le fait de posséder des caractères primitifs (plésiomorphes) suffit-il à définir un fossile vivant ? Les séquences ADN présentes dans mes cellules, qui remontent au premier protiste unicellulaire respirant de l’oxygène, font-elles de moi un fossile vivant ?
Finalement, le concept s’est tellement dilué et a si souvent été appliqué de manière erronée qu’il a pratiquement perdu toute signification, tandis que les créationnistes, dans une manifestation typique de littéralisme infantile, se servent du terme comme preuve de l’absence d’évolution. La confusion est exacerbée par l’idée fausse que les organismes actuels ressemblant à des espèces éteintes sont les ancêtres encore vivants d’espèces modernes, ce qui n’est pas le cas. (Il existe bien des espèces résultant d’une hybridation et dont les deux espèces parentes vivent toujours mais c’est une autre histoire qui n’a rien à voir avec les fossiles vivants). On s’est également aperçu que certains fossiles vivants classiques (le tuatara de Nouvelle Zélande par exemple) évoluent au niveau moléculaire beaucoup plus vite que beaucoup d’organismes jeunes. Surtout, nous savons que tous les animaux et plantes considérées comme fossiles vivants sont des espèces modernes, récemment apparues en adaptation à l’environnement actuel, et non des survivants miraculeux génétiquement identiques aux vestiges pétrifiés, en dépit de ressemblances superficielles. Pour ces raisons, beaucoup de biologistes considèrent maintenant le terme de fossile vivant comme éteint.
Et pourtant, nous ne pouvons échapper au fait que certaines espèces actuelles ont une ascendance très ancienne, beaucoup plus vieille que les organismes modernes. Certaines sont les uniques survivants de lignées qui ont autrefois dominé les anciens écosystèmes, avant que ce fleuve d’espèces se réduise à un filet d’eau. Le cœlacanthe, représentant d’un groupe de poissons autrefois florissant, en est un. D’autres, comme les artémies, sont communs et appartiennent à des groupes encore riches d’espèces, – ici les crustacés – mais il en existe aussi des fossiles vieux d’un demi-milliard d’années. D’autres encore, comme les requins, au squelette cartilagineux, sont des organismes actuels présentant des caractères à la fois primitifs et modernes. Clairement, ces organismes doivent pouvoir nous apprendre des choses sur les mondes anciens.
Pour éviter ambiguïté du terme fossile vivant, les biologistes préfèrent appeler ces organismes reliques. Dès 1944, le paléontologue américain George G. Simpson a proposé un système de classification des espèces reliques reposant sur les circonstances ayant conduit à leur statut actuel. Certaines espèces sont devenues reliques à cause de la disparition de leur habitat, les confinant à de rares refuges écologiques, minuscules vestiges d’écosystèmes autrefois vastes (reliques écologiques). Mais la plupart des reliques sont issues de processus évolutifs, par exemple la concurrence d’une lignée apparentée plus efficace (reliques phylogénétiques), ou la fragmentation progressive et l’extinction subséquente à l’intérieur d’une grande partie de leur ancienne aire de distribution (reliques biogéographiques). Près de soixante-dix ans après son introduction, le système de Simpson n’a été que marginalement amélioré par les biologistes, preuve de sa validité.
Si les espèces reliques ne peuvent plus être considérées comme les répliques d’organismes vivant à des époques géologiques antérieures – ce sont en fait des organismes parfaitement adaptés aux conditions modernes – leurs morphologies et leurs comportements peuvent nous donner une idée de la vie au temps de leur gloire passée. Le comportement de ponte des limules en dit long sur les dangers de l’ère Mésozoïque qui les ont poussé à quitter l’eau pour la terre ferme, hostile, mais néanmoins préférable. La morphologie des ailes des Prophalangopsidés, parents de certains des premiers insectes chanteurs, nous donne un aperçu de l’origine de la production de sons chez ces animaux. La toxicité des cycas indique une pression adaptive forte de la part d’anciens herbivores, tandis que leur mode de pollinisation élucide les premiers chapitres de la longue relation entre les plantes et les insectes. L’aspect d’une touffe de prêles nous donne une idée des forêts du Crétacé, tandis que le dévouement maternel des blattes nous aide à comprendre l’évolution des sociétés complexes chez les insectes. Chacun de ces organismes reliques jette un modeste rayon de lumière sur un fragment de l’histoire de la vie et nous aide à mieux comprendre l’origine de la merveilleuse diversité des formes de vie, notre espèce comprise.
Les reliques peuvent aussi nous aider à comprendre pourquoi une espèce réussit mieux que les autres dans la quête sans fin pour transmette ses gênes. Il n’existe pas de caractère commun à tous les organismes reliques, mais des lignes directrices apparaissent. Certaines lignées ont survécu en s’adaptant aux conditions rudes de la haute montagne qui ont éliminé la plupart de leurs concurrents. D’autres doivent probablement leur longévité à des mécanismes de défense ingénieux et efficaces, tels que toxines puissantes ou substances chimiques indigestes. Certains groupes reliques ont su tirer parti d’autres organismes pour vivre. Parfois en les incorporant dans leurs propres tissus (les cycas et leurs symbiontes cyanobactériens en sont un bon exemple), parfois en profitant de nouvelles niches écologiques créées par des organismes plus récents et plus évolués comme les fougères qui ont occupé les nouveaux habitats créés par les plantes à fleur). Mais la stratégie la plus courante des reliques est simplement d’être des généralistes écologiques – le moyen le plus rapide de disparaître est d’être trop spécialisé. La constante des écosystèmes terrestres est d’évoluer en permanence ; si vous êtes trop dépendant d’un système précis de conditions, vous êtes en danger dès que l’inévitable changement survient.
[…] J’étais arrivé dans mon lieu de recueillement préféré, où s’ancre ma foi dans les forces physiques, indéniables et prouvées, qui ont donné naissance à notre univers. J’étais venu voir un spectacle, peut-être l’un des plus vieux de la planète, qui en est déjà à plus de cent millions de représentations.
Chaque année en mai et juin, pendant les quelques nuits qui coïncident avec la pleine et la nouvelle lune, les limules quittent les bancs de sable de l’océan Atlantique, et font irruption dans notre monde, sec et aussi étrange pour elles que leur domaine humide et sombre l’est pour nous. Luttant contre la traction des vagues refluantes, ces animaux extraordinaires marchaient lentement vers la plage. Les vagues s’écrasaient sur elles, les retournaient sur le dos et les ramenaient dans les eaux plus profondes, comme si l’océan ne voulait pas relâcher sa prise sur ses sujets. Et pourtant, elles persistaient. Lentement, mais sûrement, elles commençaient à émerger. Risquant leurs vies, elles abordaient un terrain étrange et inconnu où l’absence d’eau semblait démultiplier la force de la gravité. Dans l’eau, les limules sont étonnamment gracieuses, capables de courir sur le fond sableux et parfois même de nager maladroitement sur le dos. Mais ici, sur les plages de la baie du Delaware, elles se traînaient lentement. Les femelles étaient particulièrement désavantagées. Non seulement elles sont plus grandes et plus lourdes que les mâles, mais quand elles émergent sur le rivage, chacune a au moins un prétendant accroché à son dos. Parfois, elles traînent jusqu’à deux ou trois mâles soucieux de fertiliser les œufs qu’elles s’apprêtent à pondre.
Pendant que des centaines de mouches piqueuses faisaient tout leur possible pour nous vider de notre sang, mon ami et collègue Joe Warfel se tenait avec moi sur la plage en attendant que le spectacle commence. Le soleil s’obscurcissait et la marée haute s’approchait de son étale. Il y avait peu de gens sur la plage à notre arrivée, mais maintenant nous étions les seuls témoins de ce qui allait se passer.[…]
D’abord sont arrivées les grandes femelles. Presque toutes remorquaient des mâles. Dans la lumière déclinante, nous apercevions les queues épineuses de centaines de limules trébuchant dans les vagues pour gagner la terre ferme. Quand le soleil fut couché, la plage était recouverte de centaines d’énormes animaux luisants. Les femelles ont creusé le sable pour y déposer leurs œufs – près de 4 000 par nid -, tandis que les mâles se disputaient le privilège de les féconder. La fécondation étant externe, il arrive souvent que plusieurs mâles se partagent la paternité d’une même ponte. Dotés d’une paire de gros yeux composés (et huit autres plus petits) capables de voir la lumière ultraviolette, les mâles repèrent très bien les femelles dans le tourbillon des vagues de sable et de centaines d’autres mâles. Les scientifiques qui les étudient pensaient d’abord que les mâles étaient attirés par des phéromones femelles, mais il s’est avéré qu’ils se fient uniquement à leur excellente vue. Cela dit, ils font parfois des erreurs et il n’est pas rare de voir des chaînes de mâles qui se défont dès que les vraies femelles se montrent.
Assister au spectacle du frai massif des limules est pour moi ce qui se rapproche le plus d’une expérience religieuse. Mon cœur semble ralentir et un calme naturel m’aide momentanément à oublier les maux de ce monde. Aussi étranges et différentes de nous que les limules puissent paraître, ces créatures majestueuses me rappellent que nous partageons tous le même héritage évolutif. Bien que nos chemins aient divergé très tôt, les humains et les limules ont eu à un moment donné un ancêtre commun. C’était il y a très, très longtemps. Les limules sont sur Terre depuis plus longtemps que la plupart des lignées animales actuelles. Dans le dépôt fossile du Manitoba, au Canada, la découverte récente d’un petit animal nommé Lunataspis aurora prouve que des limules très semblables aux espèces modernes vivaient déjà à l’Ordovicien, il y a 445 millions d’années. Quand les dinosaures ont commencé à terroriser la terre au Trias, il y a 245 millions d’années, les limules étaient déjà des reliques d’ères géologiques passées. Et pourtant, elles ont survécu. Les dinosaures ont tiré leur révérence, la polarité et le climat de la Terre ont changé plusieurs fois, mais les limules ont poursuivi leur lent cheminement. Les espèces du Jurassique étaient si semblables aux actuelles que je doute que je remarquerais quoi que ce soit d’insolite si l’une d’elle rampait devant moi sur la plage du Delaware. Les limules paraissent avoir trouvé une morphologie et un mode de vie si réussis qu’elles ont survécu aux changements qui ont balayé des milliers de lignées en apparence plus imposantes (on pense aux dinosaures et aux trilobites). Contrairement à ce qu’affirment les créationnistes et autres lunatiques, elles ont continué d’évoluer. Les limules actuelles, qui se limitent à trois espèces en Asie du Sud-Est et une dans l’est de l’Amérique du Nord, diffèrent par bien des détails de leurs parents fossiles. Par exemple, nous savons que beaucoup et peut-être la plupart des limules fossiles vivaient en eau douce, souvent dans des marécages peu profonds surplombés par une végétation dense et certaines pourraient avoir été entièrement terrestres. Actuellement, seule la limule des mangroves (Carcinoscorpius rotundicauda) dans la péninsule malaise, fréquente régulièrement les rivières et pond en eau douce ou saumâtre.
Mais la morphologie des limules a changé très lentement. Une telle évolution morphologique très lente, appelée bradytélie, caractérise les organismes polyvalents. Être très spécialisé, par exemple se nourrir seulement d’herbes quand l’herbe est abondante, vous donne un grand avantage sur les organismes qui ne raffolent pas d’herbe. Mais que le climat change, remplaçant l’herbe par les cactus, et tous les herbivores exclusifs disparaissent alors que les généralistes s’en sortent. Les limules sont très tolérantes aux variations de l’environnement. L’espèce atlantique, Limulus Polyphemus, est présente dans les eaux glacées de la Nouvelle Ecosse, Canada, jusqu’aux littoraux tropicaux du Golfe du Mexique. Elle tolère de fortes variations de salinité, mange à peu près tout ce qui est organique (avec une préférence pour les moules et les coques) et peut survivre plusieurs jours hors de l’eau. C’est la signature d’un champion de la survie. La solide cuirasse des limules les met à l’abri de presque tout ennemi naturel (seuls les requins et les grandes tortues marines attaquent parfois les limules adultes). Mais la limule est une amoureuse, pas une guerrière. La longue pointe effrayante qui prolonge son corps n’est rien d’autre qu’un levier qui lui permet de se redresser lorsqu’une vague la retourne. Curieusement, cette queue appelée telson porte une rangée de cellules photosensibles, sortes d’yeux rudimentaires. Leur fonction probable est de les aider à s’orienter vers la plage au moment du frai.
Outre leur épais exosquelette, les limules asiatiques se défendent pendant la saison de reproduction à l’aide de toxines puissantes présentes dans les œufs et dans les parties molles du corps. La saxitoxine qu’elles contiennent est l’un des poisons organiques les plus puissants que l’on connaisse. Les premiers symptômes de défaillance musculaire apparaissent quelques minutes après l’injection. La mort par paralysie des muscles respiratoires intervient dans les 16 heures. Il n’existe pas d’antidote, seulement un traitement symptomatique qui peut laisser la victime avec des lésions cérébrales. Il est donc étrange de constater que ces limules figurent toujours au menu en Thaïlande et dans d’autres pays d’Asie. Il est connu qu’il ne faut pas manger ces animaux pendant la saison de reproduction, quand ils contiennent la toxine, mais une série de 280 empoisonnements par les limules dans un seul hôpital thaïlandais montre que le message n’est pas parvenu aux habitants de la ville de Chon Buri.
L’espèce américaine n’est pas toxique, mais les habitants doivent avoir un palais plus raffiné (ou moins ?) que les gourmets asiatiques, car manger les limules n’a jamais pris en Amérique du Nord. En 1588, un rapport de la première expédition en Virginie informait les Européens de l’existence de ces animaux et précisait que les indigènes en mangeaient, mais semble-t-il uniquement quand ils ne trouvaient rien de mieux. En Chine, la première mention écrite des limules date de 250 ap. J.C. Mais les auteurs ont dû seulement entendre parler du poisson hou et non le voir, car il était décrit comme une carpe à six pattes avec une grande nageoire dorsale. Il a fallu près de 1 400 ans pour avoir une description exacte. En 1666, l’auteur japonais Tekisai Nakamura a publié un dessin remarquablement précis de limule, le baptisant kabutogani (crabe cuirassé) – pas tout à fait juste, mais pas loin.
De son côté, le nom anglais de crabe fer-à-cheval jette la même confusion. Classés dans un groupe à part, les Xiphosures, les limules sont en effet plus proches des arachnides que des crabes et autres crustacés. Contrairement aux crabes, leur exosquelette ne contient pas beaucoup de calcium, et il est essentiellement fait de chitine, un polysaccharide. Solide, souple, biodégradable et non allergénique, la chitine de ces animaux est un matériau idéal pour les sutures chirurgicales, les implants et les lentilles de contact. Qui sait si vous ne regardez pas le monde à travers un morceau de limule ?
Le lendemain matin, Joe et moi avons trouvé la plage couverte d’œufs. Bien reposées et prêtes à commencer une nouvelle journée de festin, les mouches piqueuses nous ont attaqués avec un enthousiasme renouvelé. Tout en les écrasant par dizaines d’un coup, nous retournions les limules immobilisées sur le dos en recherchant des pontes particulièrement grosses. Bien que les femelles enfouissent leurs œufs dans le sable, la marée en découvre beaucoup. Les œufs tout juste pondus ne sont pas plus gros qu’un grain de riz. Étonnamment, ils sont deux fois plus gros à la fin de leur développement. Ce qui est bien sûr impossible. Leur croissance est une illusion qui résulte de la production d’une mince membrane externe par l’embryon. Un œuf pleinement développé, après deux semaines dans le sable, ressemble à un petit bocal renfermant une petite limule, impatiente de briser les murs de sa prison. Une fois libres, les larves (du moins les chanceuses) profitent d’une vague pour retourner à l’océan, où elles flotteront librement pendant une semaine avant de rejoindre le fond dans les eaux littorales peu profondes, pour commencer une vie identique à celle de leurs parents.
Mais une question demeure : pourquoi des animaux aquatiques quittent-ils leur milieu naturel pour exposer leurs petits aux dangers de la terre ferme, quand leur développement nécessite de l’eau ? Il serait tentant de comparer ce comportement à celui des tortues marines, qui passent aussi leur vie dans l’océan et ne le quittent que pour pondre dans le sable. Mais les raisons de ces comportements similaires ne pourraient pas être plus différentes. Descendant de reptiles terrestres, les tortues marines sont des nouvelles venues dans l’océan et doivent respirer à la surface. Elles ne peuvent pas rester sous l’eau plus de deux heures (au repos, moins si elles sont actives), et leurs œufs doivent être exposés à l’oxygène atmosphérique pour éviter l’asphyxie des embryons. Inversement, les limules respirent sous l’eau et leurs œufs doivent être submergés ou au moins fréquemment recouverts par les vagues pour se développer. La force qui les a poussées à une mesure aussi désespérée, ce sont les millions d’estomacs affamés qui attendaient dans l’océan la provende des œufs de limules. Lorsque les limules sont apparues sous leur forme actuelle, il y a 445 millions d’années, presque toute la vie animale – et quasiment tous les prédateurs – vivaient dans les mers et les lacs du globe. En osant sortir de leur domaine aquatique, les limules ont donné à leur progéniture un avantage considérable sur les autres organismes marins. Elles ont été parmi les premiers animaux, sinon les tout premiers, à adopter une stratégie d’exportation pour leur reproduction. Aucun animal terrestre actuel ne descend des limules, mais il est vraisemblable que certains des premiers invertébrés terrestres aient suivi une voie similaire, poussés par la pression sélective des prédateurs d’œufs.
Mais il y a une chose que les limules ne pouvaient pas prévoir. Les dinosaures, ces tétrapodes gigantesques qui ont foulé la terre pendant presque 170 millions d’années avant de sembler s’éteindre à la fin du Crétacé, n’ont pas complètement disparu. Certains ont évolué pour donner une des lignées les plus prospères du règne animal – les oiseaux -. Les oiseaux sont malins et ont une excellente vision. Ils ont aussi un métabolisme intense qui leur permet de maintenir une température corporelle constante, mais qui nécessite un apport continu d’aliments énergétiques. Les œufs de limule sont exactement ce qu’il leur faut.
Bourrés de lipides et de protéines, les œufs de limules atlantiques sont un carburant idéal pour de nombreux oiseaux du littoral. Avec la régularité d’un coucou suisse, les limules répandent un déjeuner d’œufs frais sur les rivages de la baie du Delaware aux pleines et nouvelles lunes de la fin du printemps. Un oiseau, le terne bécasseau maubèche (Calidris canutus rufa) doit même sa survie aux limules. Sa migration inclut un arrêt dans la baie du Delaware répit indispensable après un voyage non-stop depuis l’Amérique du Sud. Les nuages de bécasseau s’abattant sur les plages de la baie au printemps ont toujours stupéfié les hommes. Mais, il y a quelques années, quand la population de limules a chuté à une fraction de sa splendeur passée, le bécasseau s’est mis à disparaître à son tour.
Les ornithologues américains se sont émus. Des pétitions ont circulé, des études ont été réalisées et des lois protégeant ces oiseaux ont été votées. Quelqu’un a fini par comprendre que si les limules disparaissaient, le précieux oiseau suivrait ; il faudrait peut-être aussi sauver ce méprisable invertébré. Au New Jersey, un an avant d’écrire ces lignes, on pouvait sans problème remplir son pick-up de centaines de limules pour servir d’appât ou autre. Maintenant, il est illégal d’en ramasser une seule. J’ai été menacé d’une amende de 10 000 $ pour avoir ramassé une limule (dans l’intention de la relâcher aussitôt après avoir pris quelques photos) par un garde particulièrement zélé. Il m’a donné un avertissement sévère mais il m’a fait grâce. En repartant, il a marché sur une des dizaines de limules qui gisaient sur le dos. Il ne s’est pas arrêté.
Il y a un siècle environ, nous n’aurions probablement pas pu arpenter la plage sans marcher sur les limules. Elles étaient si nombreuses que les hommes ont cherché des moyens d’utiliser cette abondante ressource. L’idée a été vite trouvée. De 1880 à 1920, on a ramassé plus d’un million de limules par an pour les tuer et les broyer afin d’en faire de l’engrais ou de l’aliment pour cochons. Cette pratique a continué jusque dans les années 1970, lorsque la dernière usine a fermé, en grande partie à cause des plaintes motivées par l’odeur, mais aussi parce que la récolte était tombée à 100 000 par an. Mais une autre industrie l’a remplacée, tuant les limules pour appâter les anguilles et les bulots. Tout ceci a entraîné un déclin de la population de limules dont elle pourrait ne jamais se remettre complètement. Et bien sûr, il y a la question du sang de limule.
Au début des années 1950, le chercheur Frederik Bang a découvert que le sang de ces animaux était extrêmement sensible aux endotoxines produites par les bactéries Gramnégatives. Toute exposition du système immunitaire de la limule à ces bactéries provoque une coagulation généralisée et immédiate, isolant efficacement les microbes et les empêchant de nuire. Bang et son collaborateur Jack Levin ont rapidement réalisé les possibilités offertes par cette découverte. Après avoir isolé les éléments actifs du sang de limule, les amébocytes, ils ont mis au point un extrait appelé lysat d’amébocyte de limule (LAL). Celui-ci facilite la détection des endotoxines bactériennes dans l’urine, le liquide céphalo-rachidien et autres fluides corporels. Mais sa principale application est la détection des contaminations dans les médicaments intraveineux et sur les instruments médicaux. Si on vous a fait une injection intraveineuse ou si on vous a remplacé une valve cardiaque, leur stérilité a très probablement été testée avec du LAL. La récolte des limules pour produire du LAL est maintenant une industrie importante qui génère des centaines de millions de $ par an. Chaque année, on capture ces centaines de milliers de limules pour prélever 20 % de leur sang bleu (il contient de l’hémocyanine à base de cuivre au lieu d’hémoglobine à base de fer). Les animaux sont ensuite relâchés en mer. Bien que la mortalité des limules relâchées soit faible (plus de 85 % des animaux survivent à ce prélèvement de sang), l’industrie perturbe la structure de leurs populations en déplaçant ces animaux à des centaines de kilomètres des lieux de capture.
Ce qui me choque le plus, c’est qu’il a fallu un oiseau pour que l’on commence à s’inquiéter du déclin des limules. Celles-ci ont été systématiquement exterminées pendant plus d’un siècle dans ce que je ne peux qu’appeler un phylogénocide. Cela peut sembler sévère mais réfléchissez-y : la perte d’un bécasseau maubèche, aussi impardonnable qu’elle soit, ne signifie que la perte d’un dix millième du patrimoine génétique des oiseaux. La perte d’une espèce de limule signifie la perte d’un quart de l’héritage génétique des Xiphosures, l’une des lignées les plus anciennes de la planète. Et pourtant, nous nous préoccupons plus d’une adorable petite boule de plumes, dont notre bien-être dépend peu, que d’une bestiole répugnante qui a déjà sauvé des millions de vies humaines. Comme nous sommes superficiels…
L’extinction des limules est presque complète au Japon, où l’espèce locale (Tachypleus tridentatus) était aussi abondante que sa cousine atlantique. J’y suis allé à l’été 2008 pour l’observer sur la dernière plage japonaise où elles se montrent encore en grand nombre. Avec mon ami Kenji Nishida, entomologiste et grand photographe, je me suis rendu sur la plage d’Imari, sur l’île de Kyushu. C’était un jour avant le festival Kabotugani, une célébration annuelle des limules. On nous a raconté que c’était une bonne année : quatre couples de limules avaient été aperçus près de la plage ! Quatre couples. Huit individus. C’était tout. Dans les années 1980, il n’était pas rare de voir cinq cents limules au même endroit. Au Japon, où les limules sont presque révérées, l’Association Nippone pour la Protection des Limules se bat pour la survie de l’espèce. Pourtant, leur nombre continue à décroître. Il y a là une leçon à apprendre. Dans le destin d’une espèce, il existe un point de non-retour. Espérons que nous pourrons empêcher la limule atlantique de l’atteindre.
Chaque fois que je rentre de la baie du Delaware, je me demande ce que je trouverai l’année suivante. Est-ce mon imagination, ou y-a-t-il de moins en moins de limules chaque année ? Par chance, cela ne semble pas être le cas. Les efforts de protection ont des effets positifs qui, espérons-le, arrêteront le déclin de ces animaux magnifiques. Dans la baie, on a instauré une zone d’interdiction de ramassage, la réserve Carl N. Schuster, d’après l’un des plus éminents chercheurs et avocats des limules. La récolte des limules pour appâts est limitée et les gens s’intéressent de plus en plus au sort des limules. Les volontaires sont chaque année plus nombreux pour dénombrer les limules au moment du frai. Récemment, j’ai vu dans un magasin de jouets, à côté d’un panda et d’une orque, un limule en peluche. Cela signifie-t-il que maintenant les enfants trouvent les limules adorables ? Peut-être y-a-t-il de l’espoir finalement.
Piotr Naskrecki. Reliques. Ulmer 2012
ère géologique : Silurien : 443.4 à 419 millions d’années.
440 m.a.
Des explosions astrophysiques, appelées sursauts gamma, sous-produit soit de supernovae, soit de collisions entre étoiles ultradenses nommées neutroniques, pourraient avoir provoqué des extinctions d’espèces et un refroidissement du climat : destruction d’une bonne partie de la couche d’ozone, conversion de l’azote et de l’oxygène de l’air en dioxyde d’azote : il n’en faut pas plus pour perturber gravement la vie.
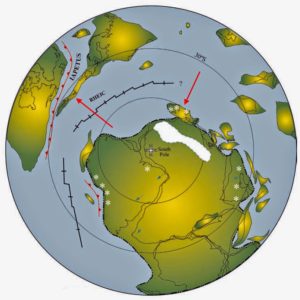
Dernière reconstruction de l’hémisphère sud à l’ordovicien. Dans le dernier silurien ordovicien-ancien (440 Ma), Avalonia (ouest et est situés à la flèche de gauche) s’était précédemment écartée de la marge nord du Gondwana, à la dérive de la fermeture d’Iapetus Ocean et se préparait bientôt à entrer en collision avec Baltica et Laurentia au cours de l’orogenèse Acadian-Caledonide. Le corps principal du Gondwana polaire sud est en train de traverser un océan Rheic en déclin. Les terranes de type Cadomian (flèche vers la droite) sont toujours amarrés en marge de Gondwana.
de 445.2 m.a. à 443.8 m.a.
Un astéroïde aurait percuté l’Australie, alors partie du Gondwana, créant un cratère de 520 km Ø : Deniliquin, le nom de la ville la plus proche, au sud-est de l’Australie, en Nouvelles Galles du Sud, au nord de Melbourne et à l’est de Victor Harbor, près d’Adélaïde. Ce sont des chercheurs de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, à Sydney, qui l’ont découvert en 2023… alors qu’ils cherchaient de l’or !
Les astéroïdes ont joué un rôle crucial dans la formation et l’évolution de la Terre. Durant des milliards d’années, leurs impacts ont façonné la géologie, influencé le climat et même provoqué des extinctions massives. Ces événements cataclysmiques ont laissé des empreintes indélébiles, mais souvent cachées sous des couches de roches ou des océans. De plus, ces dernières peuvent s’éroder, rendant difficile leur identification.
Au cœur de l’Australie du Sud-Est, une gigantesque structure enfouie vient d’être dévoilée. Son étude, menée par des experts de l’UNSW (Université de Nouvelle-Galles du Sud, à Sydney), met en lumière ce qui pourrait être la plus grande structure d’impact d’astéroïde jamais découverte. Au-delà de sa taille impressionnante, elle offre une perspective inédite sur les conséquences géologiques des impacts et leur rôle dans l’évolution de notre planète. L’étude est publiée dans la revue Tectonophysics.
En complément de ces motifs magnétiques, le cratère présente des motifs gravitaires circulaires de Bouguer. Ces motifs mettent en évidence des variations de la gravité à la surface de la Terre, souvent utilisées pour identifier des structures souterraines ou des variations de densité dans la croûte terrestre.
Les mesures magnétiques montrent également des preuves de failles radiales : des fractures qui rayonnent à partir du centre d’une grande structure d’impact. Cela s’accompagne en outre de petites anomalies magnétiques qui peuvent représenter des digues ignées, qui sont des feuilles de magma éjectées dans des fractures au sein d’un corps rocheux préexistant.
Les auteurs soulignent également dans un article qu’ils ont publié dans The Conversation que la taille de cette structure est tout simplement stupéfiante. Avec un rayon d’environ 260 km, elle s’étend sur une vaste zone, témoignant de l’ampleur de l’événement qui a pu la créer. Cette dimension la place parmi les plus grandes structures géophysiques de ce type découvertes à ce jour.
La caractéristique de Deniliquin, malgré sa position profondément enfouie sous la surface, révèle des indices intrigants d’un événement passé. Lorsque les chercheurs ont effectué des forages dans cette région, ils ont découvert des lamelles de Boehm. Ces formations, qui sont des minces couches ou inclusions dans des minéraux, peuvent être indicatives de processus géologiques spécifiques.
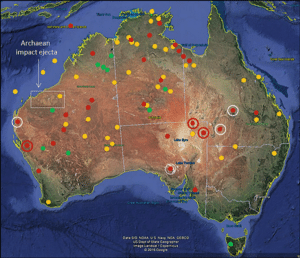
Cette carte montre la répartition des structures circulaires d’origine d’impact incertaine, possible ou probable sur le continent australien et au large. Les points verts représentent les cratères d’impact confirmés. Les points rouges représentent des structures d’impact confirmées de plus de 100 km de large, tandis que les points rouges à l’intérieur des cercles blancs font plus de 50 km de large. Les points jaunes représentent les structures d’impact probables. © Andrew Glikson et Franco Pirajno
De plus, cette découverte pourrait servir de point de départ pour de nouvelles recherches. Les scientifiques pourraient être en mesure d’étudier en détail les conséquences d’un tel impact sur l’environnement local et global. Cela inclut les changements climatiques potentiels, les perturbations de l’écosystème, et même les extinctions qui pourraient avoir été déclenchées par l’impact.
Selon les auteurs, celui-ci aurait pu se produire lors de l’événement d’extinction massive de l’Ordovicien supérieur. Ils précisent : Plus précisément, je pense que cela a peut-être déclenché ce qu’on appelle le stade de glaciation hirnantien, qui a duré entre 445,2 et 443,8 millions d’années, et est également défini comme l’événement d’extinction ordovicien-silurien. 85% des espèces de la planète ont disparu à cette époque, soit le double de l’impact de Chixculub, qui a tué les dinosaures.
Trust my science
430 m.a.
Jusqu’alors, l’alimentation en eau des plantes se faisaient par capillarité, chaque paroi cellulaire se gorgeant d’eau, mais le système n’est efficace que jusqu’à une hauteur de 2 cm, ce qui limite radicalement la croissance verticale ; vont apparaître des cellules lignifiées dont la mort programmée permet la transformation en canal de transport de l’eau : ces larges cellules mortes et vides étaient un million de fois plus efficaces que l’ancien mécanisme intercellulaire, permettant le transport sur de plus longues distances et un taux de diffusion du CO2 plus élevé. Cette tige unique est porteuse du sporange, l’organe reproducteur de spores : spores et oosphères n’ont dès lors plus besoin d’eau pour se disperser : le vent y pourvoie. En se verticalisant, la plante développe un système de vaisseaux pour diffuser, avec la sève, sucre et matière organique dans tout leur organisme.
Les plantes ayant acquis ce système de transport étaient devenues capables d’extraire de l’eau de leur environnement par des organes semblables à des racines, et cette dépendance moindre aux aléas climatiques leur permettait d’atteindre des tailles bien plus importantes. Mais, conséquence de cette relative indépendance vis-à-vis de l’environnement, elles perdirent leur capacité à survivre à la dessiccation, un trait trop coûteux à conserver.
ère géologique : Dévonien : 419 à 358.9 millions d’années
416 m.a.
La concentration atmosphérique en O2 dépasse 13 % : dès lors les incendies deviennent possibles : on en a les premières traces fossiles, enchâssés dans du charbon.
_______________________________________________________________________________________
[1] On peut en trouver dans des environnements tout à fait imprévus… jusqu’à 2 000 mètres sous terre…
[2] Être vivant en symbiose étroite avec un autre être
[3] Corpuscules des cellules végétales porteuses de chlorophylle et sièges de la photosynthèse
[4] Organites composant les cellules et productrices d’énergie
[5] Et que dire encore de ces poteaux d’enceinte de cases, voire de ces poteaux télégraphiques, qui repartent en végétation en Afrique tropicale et équatoriale, quelques semaines après avoir été posés … et des ces bambous coupés, posés sur leur longueur sur du sable où l’eau n’est pas loin et qui repartent eux aussi en végétation par des racines développées au niveau des nœuds.