| Publié par (l.peltier) le 13 octobre 2008 | En savoir plus |
12 01 1851
En ce temps-là, un voyage en Orient est encore beaucoup plus proche des conditions de l’antiquité que de celles des temps modernes ; vilain temps pour Gustave Flaubert sur les flancs du Cithéron.
La neige tombe, elle s’attache aux poils qui sont dans l’intérieur des oreilles de nos chevaux et les emplit ; ils ont l’air d’avoir du coton dans les oreilles.
L’Hélicon est sur notre droite, nous apercevons des sommets blancs dans les interstices des nuages et du crépuscule. Sur une éminence où l’œil est amené par une pente blanche et très douce, enfoui dans la neige comme un village de Russie, avec ses toits bas, Kokla.
Nous n’entendons plus nos chevaux marcher, tant la neige assourdit leurs pas, nous allons nous perdre pour passer le Cithéron, Giorgi demande un guide, personne ne veut venir.
Nous continuons ; ma gourde d’eau-de-vie, que j’avais précieusement gardée pendant tout le voyage, me devient utile, le froid de ma culotte de peau me remonte le long du dos dans l’épine dorsale ; s’il fallait me servir de mes mains, j’en serais incapable. Le moral est de plus en plus triomphant. Mes yeux se sont habitués à la neige, qui re-souffle de plus belle, Maxime en est ébloui. Nous allons sur la pente nord du Cithéron, nous rapprochant le plus que nous pouvons vers sa base, afin de trouver la route. Nous passons un torrent, que nous laissons à droite, et nous nous élevons rapidement. Des pierres sous la neige font trébucher nos chevaux ; nous sommes complètement perdus, le gendarme et Giorgi n’en sachant pas plus que nous sur la route. Pour continuer jusqu’à Casa il faudrait savoir le chemin ; quant à nous en retourner à Kokla, ce que nous allons pourtant essayer de faire, il est probable que nous allons nous perdre encore.
Nous entendons aboyer un chien, j’ordonne au gendarme de tirer des coups de fusil, il arme son pistolet qui rate ; enfin il parvient à tirer un coup, le chien aboie dans le lointain.
Décidément j’ai froid, ça commence à me prendre.
Nous redescendons, le gendarme tire encore deux ou trois fois des coups de pistolet, les aboiements se rapprochent, nous sommes dans la bonne direction, nous repassons le torrent à sec.
Bientôt nous apercevons quelques maisons ; les chiens, en nous sentant venir, font un vacarme d’enfer ; pas d’autre bruit dans le village, pas une lumière, tout dort sous la neige.
Le gendarme et Giorgi frappent à la porte d’une cabane, personne ne dit mot ; ils vont frapper à une autre, une voix d’homme épouvantée répond, on ne veut pas ouvrir. Le gendarme donne de grands coups de crosse dans la porte, Giorgi des coups de pied ; la voix, furieuse et tremblante, répond avec volubilité, une voix de femme s’y mêle ; Giorgi a beau répéter milordji, milordji, on nous prend pour des voleurs, et l’altercation mêlée de malédictions de part et d’autre continue. Je me range en dehors de la porte, près de la muraille dans la crainte d’un coup de fusil. Ô mœurs hospitalières des campagnards ! Pureté des temps antiques !
À une troisième porte, enfin, quelqu’un de moins craintif consent à nous ouvrir. Jamais je n’oublierai de ma vie la terreur mêlée de colère de cette voix d’homme. Quel propriétaire ! Était-il chez lui ! Avait-il peur de l’étranger ! Se moquait-il du prochain ! Et la voix claire de la femme piaillant par-dessus celles des hommes !
Celui-ci nous mène au khan, que l’on nous ouvre. Nous entrons dans une grande écurie pleine de fumée, où je vois du feu ! du feu ! Quelqu’un de là m’a détaché ma couverture, et je me suis approché de la flamme avec un sentiment de joie exquis. Souper avec une douzaine d’œufs à la coque, que nous fait cuire une bonne femme, la maîtresse du khan. J’ai bu du raki, j’ai fumé, je me suis chauffé, rôti, refait, dormi deux heures sur une natte et sous une couverture pleine de puces, prêtée par l’hôtesse du lieu ; le reste de la nuit se passe à faire sécher et à brûler nos affaires. Les chevaux mangent, le bois flambe et fume, de temps à autre je me lève et vais chercher le bois dont les épines m’entrent dans les mains, les autres voyageurs dorment couchés tout autour du feu. Quand arrive quelqu’un, on crie Khandji ! Nadji ! la porte s’ouvre, l’homme entre avec son cheval tout fumant, la porte se referme, le cheval va s’attabler à la mangeoire et l’homme s’accouve près du feu, puis tout rentre dans le calme. -Ronflements divers des dormeurs. – Je pense à l’âge de Saturne décrit par Hésiode ! Voilà comme on a voyagé pendant de longs siècles ; à peine sortons-nous de là, nous autres.
Mais quelques jours plus tard vient le bonheur après la peine : Dans les Propylées, adossé au mur de la tour vénitienne, un torse de femme. Deux seins pomme, le gauche couvert d’une draperie, le droit nu ! quel téton ! Comme c’est beau ! Que c’est beau ! Que c’est beau !
[…] En allant au Parthénon et en y revenant, j’ai longtemps regardé cette poitrine aux seins ronds qui est faite pour vous rendre fou d’amour.
Gustave Flaubert. D’Athènes à Delphes et aux Thermopyles. Arléa 2007
15 04 1851
1° pierre des Halles de Baltard.
Entre minuit et deux heures, les charrettes confluent des barrières de Paris vers son centre par les rues du faubourg Saint Denis, Saint Martin, d’Enfer, etc… Il entre ainsi chaque nuit dans Paris, vers 1840, plus de 6 000 voitures de maraîchers ou de laitières. Il faut se rappeler que la vie qui commerce à la halle diffère essentiellement de celle de tous les autres habitants ; la plupart font, comme dans quelques professions, de la nuit le jour : ils se lèvent quand les autres se couchent.
Louis Montigny. Les Halles Le provincial à Paris, esquisses des mœurs parisiennes Paris Ladvocat. 1825
Après une nuit passée dans les cloaques [entourant les Halles] au milieu de ces êtres immondes à qui l’ivresse arrache de temps en temps de sinistres confidences, on se sent heureux et soulagé de respirer cet air imprégné de senteurs balsamiques ; on contemple avec admiration la vigoureuse santé de ces vaillantes filles des campagnes.
Privat d’Anglemont. Paris anecdote 1854
Le désir que chacun puisse manger à sa faim n’est peut-être pas au premier rang des priorités de l’époque, néanmoins, le souci de ne pas gaspiller est-il bien présent partout : ainsi, vers 8 ou 9 h, s’installaient autour des Halles les vendeurs d’Arlequins, qui n’étaient autres que des plats proposées à la vente à bas prix, composés des restes des restaurants des alentours.
Coup de foudre pour Gustave Flaubert en ce mardi saint, à Rome, plus précisément à Saint Paul Hors les Murs
En tournant la tête à gauche, j’ai vu venir lentement une femme en corsage rouge, elle donnait le bras à une vieille femme qui l’aidait à marcher ; à quelque distance un vieux en redingote, et ayant autour du cou une cravate en laine tricotée, les suivait. J’ai pris mon lorgnon et je me suis avancé, quelque chose me tirait vers elle.
Quand elle a passé près de moi, j’ai vu une figure pâle, avec des sourcils noirs, et un large ruban rouge noué à son chignon et retombant sur ses épaules ; elle était bien pâle ! Elle avait des gants de peau verdâtres, sa taille courte et carrée se tordait un peu dans le mouvement qu’elle faisait en marchant, appuyée du bras droit sur le bras gauche de la vieille bonne.
Une rage subite m’est descendue, comme la foudre, dans le ventre, j’ai eu envie de me ruer dessus comme un tigre, j’étais ébloui !… Je me suis remis à regarder les fresques et le custode qui tenait des clefs à la main.
Elle s’était arrêtée et assise sur un banc, contre le grand carré d’échafaudage ; je l’ai regardée et j’ai cédé de suite à la douceur envahissante qui m’est survenue.
Elle avait un front blanc, d’un blanc de vieil ivoire ou de paros bien poli, front carré, rendu ovale par ses deux bandeaux noirs derrière lesquels fulgurait son ruban rouge (bordé de deux filets blancs) qui rehaussait la pâleur de sa figure. Le blanc de ses yeux était particulier. On eût dit qu’elle s’éveillait, qu’elle venait d’un autre monde, et pourtant c’était calme, calme ! Sa prunelle, d’un noir brillant, et presque en relief tant elle était nette, vous regardait avec sérénité. Quels sourcils ! Noirs, très minces et descendant doucement ! Il y avait une assez grande distance entre le sourcil et l’œil, ça grandissait ses paupières et embellissait ses sourcils que l’on pouvait voir séparément, indépendamment de l’œil. Un menton en pomme, les deux coins de la bouche un peu affaissés, un peu de moustache bleuâtre aux commissures, l’ensemble du visage, rond !
Elle s’est levée et s’est remise à marcher ; elle a une maladie de poitrine ? ou de reins ? à sa démarche, elle est peut-être convalescente ; elle avait l’air de jouir du beau temps ; c’est peut-être sa première sortie, elle avait fait toilette.
Le custode a passé devant elle et lui a ouvert la petite porte qui donne dans la basilique ; le vieux monsieur, que j’avais cessé de voir, lui a donné la main pour l’aider à descendre les trois marches qu’il y a ; j’étais resté béant sur la première, hésitant à la suivre.
Puis nous avons été voir le cloître, avec ses colonnes tordues, granulées de mosaïques vertes, or et rouges ; j’ai senti l’air chaud, il faisait beau soleil. Moins de roses que dans le cloître de Saint Jean de Latran, auquel il ressemble tout à fait. Monsieur Lacombe a demandé au custode s’il connaissait cette dame malade, le custode a répondu que non.
En sortant de l’église, je l’ai revue au loin, assise sur des pierres, à côté des maçons qui travaillaient.
Je ne la reverrai plus !
J’avais eu dans l’église envie de me jeter à ses pieds, de baiser le bas de sa robe ; j’ai eu envie, tout de suite, de la demander en mariage à son père (?) ! Dans la voiture, j’ai pensé à avoir son portrait et à faire venir pour cela de Paris Ingres ou Lehmann… Si j’étais riche ! J’ai pensé à aller me présenter à eux comme médecin pour la guérir !… et de la magnétiser ! Je ne doutais pas que je l’aurais magnétisée et que je l’aurais guérie peut-être !
Que ne donnerais-je pas pour tenir sa tête dans mes mains ! Pour l’embrasser au front, sur son front ! Si j’avais su l’italien, j’aurais été vers elle quand elle était sur ces pierres ; j’aurais bien su trouver moyen de lier la conversation.
Quel beau temps ! La campagne d’ici me semble bien belle, nous avons repassé par la porte près de la pyramide de Cestius.
Rencontré deux ecclésiastiques en grandes robes rouges et à chapeaux pointus.
Nous avons tourné le Palatin et nous sommes trouvés au bord du Tibre, devant la douane ; nous sommes descendus de voiture après le pont rompu, au bas de l’île du Tibre, délicieuse vue de chic, avec ses filets qui tournent dans l’eau.
Rentré à l’hôtel à quatre heures.
Déjà ses traits s’effacent dans ma mémoire.
Adieu ! adieu !
Gustave Flaubert. Rome. Arléa 2007
1 05 1851
À Londres, inauguration de la Great Exhibition of Works of Industry of All Nations, la première Exposition universelle. L’idée en était venue au Français Jacques Boucher de Crèvecœur de Perthes : Pourquoi donc ces expositions sont-elles restreintes à notre pays ? Pourquoi ne pas les ouvrir sur une échelle vraiment large et libérale ? Qu’elle serait belle et riche une exposition universelle ! Mais Chambres de Commerce et industriels français firent la moue : sur les 400 soyeux que comptait Lyon, seulement 37 jugèrent utile d’y aller : trop imbus d’eux-mêmes, ils estimaient n’avoir rien à apprendre des Anglais. Ils mettront des années à combler leur retard. Les Anglais, eux, ne firent pas la moue : Joseph Praxton, jardinier paysagiste autodidacte qui s’était spécialisé dans la construction de serres construisit pour l’événement le fameux Crystal Palace, – aujourd’hui détruit – : 563 mètres de long, 124 mètres de large, 34 mètres de haut, de quoi exposer 100 000 objets, sur 70 000 m². Il mit en œuvre les premières techniques de préfabriqué : éléments fabriqués en usine, techniques innovantes de montage, ce qui avait permis un assemblage en un temps record. Trois ans plus tard, on estimera que le bâtiment occupait trop de place à Hyde Park : ce n’est pas un problème… on va le déménager. Ce qui fut fait à Upper Norwood, où il restera jusqu’à sa destruction par un incendie en 1936.
Crystal Palace . Joseph Praxton
Le Corbusier en parlera comme du premier bâtiment d’architecture moderne.



Cachée sous les rues de Londres, la gare de Crystal Palace est un tunnel souterrain de l’époque victorienne, vestige d’une période révolue. Inauguré en 1865 à côté de la gare ferroviaire High Level, il se caractérise par une grande façade à l’italienne. Destiné à impressionner les visiteurs, il a perdu de son importance après son incendie en 1936, ce qui a entraîné sa fermeture en 1954. Des travaux de restauration sont actuellement en cours, sous la direction de l’architecte Thomas Ford & Partners, afin de faire revivre ce joyau caché.
Les exposants sont pour moitié britanniques, pour moitié étrangers. Sur fond musical de grandes orgues – le plus grand du monde, au centre du bâtiment – on y voit George Stephenson, l’inventeur de la première locomotive à vapeur, devenu héros national, donnant des explications techniques à la reine Victoria ; on y voit tant et tant de choses nouvelles, preuves de la suprématie anglaise. Mais les Américains sont déjà présents avec la moissonneuse McCormick par exemple, qui marque le début des transferts technologiques des États Unis vers la Grande Bretagne. En se référant à la surface occupée, la locomotive doit faire jeu égal avec la moissonneuse McCormick, mais dans l’imaginaire du visiteur Lambda, c’est certainement le corset qui s’ouvre automatiquement en cas d’urgence qui tient le haut du pavé. Il était un véritable instrument de torture :
Elle ne toucha que son corset, et le maudit. Il lui faisait une taille d’enfant, mais lui remontait l’estomac entre les seins et lui refoulait le ventre dans le derrière. Cet instrument de supplice n’avait qu’un avantage : c’était de faire du déshabillage un moment de bonheur fabuleux. Tout à coup délivrée, décompressée en quelques secondes, la chair tendre et rose s’épanouissait, reprenait toutes ses places, les organes fonctionnaient, le sang affluait vers la peau et les lieux secrets. Envahie de joie et de chaleur, la femme, en soupirant de gratitude, aspirait alors, comme une fleur qui s’ouvre, à la volupté.
René Barjavel Les Jours du monde. Omnibus 1995
Le succès fut total : plus de 6 millions de visiteurs : les bénéfices permirent de construire le Royal Albert Hall, le Victoria and Albert Museum et le musée de la Science. L’Angleterre recommencera trois fois : 1862, 1871 et 1885.
Cependant déjà Marx et Engels se faisaient détracteurs : Cette exposition est une preuve éclatante de la violence concentrée avec laquelle la grande industrie moderne renverse partout les barrières nationales, effaçant de plus en plus les particularités locales dans la production, les rapports sociaux et le caractère de chaque peuple […] Avec cette exposition dans la Rome moderne, la bourgeoisie mondiale édifie son Panthéon où elle montre, fièrement satisfaite d’elle-même, les dieux qu’elle s’est créée.
Ceci n’empêche nullement Marx d’être un fervent admirateur du progrès technique : chemin de fer, bateaux à vapeur etc… Et c’est bien cette fascination qui l’avait amené à visiter l’exposition.
22 08 1851
À l’occasion de l’Exposition universelle, le prince Albert et la reine Victoria ont décidé d’organiser une grande régate autour de l’île de Wight, loin d’imaginer que le seul navire étranger à avoir répondu à l’invitation ridiculiserait la flotte de Sa Très Gracieuse Majesté : c’est ainsi que la goélette America, armée par John Cox Stevens, le fondateur du New-York Yacht Club, remporte le prix de 500 guinées devant les meilleurs bâtiments britanniques : l’America cup est née : l’affreuse aiguière d’argent, née chez Robert Garrard, le joaillier de la Reine, restera en Amérique pendant des décennies avant de migrer en 1983 en Australie avec Australia II, skippé par John Bertrand, à nouveau en Amérique avec Dennis Conner, puis en 1995 en Nouvelle Zélande avec Time New Zealand, skippé par Peter Blake, et en 2004, en Suisse avec Alinghi, né des profits pharmaceutiques d’Ernesto Bertarelli : après 153 ans d’absence, la coupe revenait dans la vieille Europe, et, pour fêter cela Ernesto Bertarelli l’emmena au sommet d’une des plus belles montagnes d’Europe, le Cervin, lequel bien sûr, n’avait jamais vu pareille horreur : quand on a été conçue pour figurer dans le paysage d’un vaisselier victorien, difficile d’être en harmonie avec le paysage du Cervin. Les sommets supportent parfois des Vierges – au Grépon, aux Drus, et peut-être ailleurs – mais rien d’autre. L’Australie a apporté ce qu’elle a de plus grand, de plus beau : une planche d’eucalyptus de Tasmanie, de 47 mètres de long sur 3.5 mètres de large, dans un navire construit en … eucalyptus et calfaté à la résine… d’eucalyptus : les rues du Strand, au centre de Londres, seront pavées d’eucalyptus.
24 09 1851
Le colonel Donald D. Mitchell, surintendant fédéral pour les Affaires indiennes a lancé l’idée d’une conférence à Fort Laramie, dans le sud-est du Wyoming, en pays cheyenne, où seraient convoquées les représentants des principales tribus vivant à l’est des Rocheuses.
Il présente quatre propositions :
- Les Indiens reconnaissent aux États Unis le droit d’établir, sur leur territoire, des routes et des postes militaires.
- Ils s’engagent, pour le maintien de la paix, à réparer les pertes et dommages éprouvés, de leur fait, par les Blancs.
- Une indemnité de 50 000 $ or sera immédiatement payée aux Indiens pour les dégâts causés dans leurs terrains de chasse, leurs forêts, leurs prairies, par ceux qui traversent le pays.
- Il leur sera payé, chaque année, pendant 50 ans, 50 000 $ en nature d’après ce qui sera jugé le plus utile pour eux.
Pour ce faire, il avait mandé le Blanc connaissant alors le mieux les Indiens, Pierre Jean De Smet, jésuite belge vivant alors parmi les Têtes Plates et les Nez Percés dans les Rocheuses. Il mettra trois mois pour parvenir à Fort Laramie, un mois de bateau sur le Missouri, puis la Yellowstone, puis six semaines vers le sud le long des Monts Bighorn, sur les pistes où se bousculaient des chercheurs d’or illuminés : à Fort Laramie l’attendaient 10 000 Sioux et Cheyennes.
De Smet s’était fait l’avocat du plan Mitchell, qui est adopté après 12 jours de palabre, moyennant force cadeaux venus de Washington : Ce conseil est le commencement d’une nouvelle ère pour les Peaux-Rouges, d’une ère de paix. Désormais, les voyageurs pourront traverser le désert sans être molestés et les Indiens n’auront plus rien à craindre de la part des mauvais Blancs.
La renommée de Pierre Jean De Smet grandira d’année en année ; déjà établie auprès des Indiens depuis longtemps, elle prendra force aussi auprès des Blancs, ravis de trouver en ce missionnaire hors du commun l’interlocuteur idéal auprès des Indiens pour toute négociation. De Smet avait appris à bien connaître les Indiens. Il est moins sur qu’il en fit fait autant avec les Blancs, et qu’il ait réalisé combien ces derniers allaient l’utiliser, pour ensuite revenir à leurs jeux favoris, revenant sur leur parole, trompant les Indiens, encore et toujours. Difficile de savoir si les militaires présentaient un front commun, ou s’ils étaient eux-mêmes fort partagés sur la question indienne, encore plus difficile de savoir si le pouvoir fédéral de Washington manipulait aussi les militaires …
10 1851
À Marseille, une commission composée de deux médecins du conseil d’hygiène, d’un ingénieur des Mines et d’un ingénieur des Ponts et Chaussées, vient d’enquêter sur le condensateur de l’usine chimique de Figueroa, dont les rejets de plomb, d’antimoine et d’arsenic font l’objet de plaintes de la part des riverains. D’emblée, les choses sont mises au clair : En recherchant l’effet produit par cette usine sur la santé des hommes, il doit être bien entendu d’abord que l’on fait abstraction des ouvriers et des employés de l’établissement. On sait généralement que les ouvriers qui travaillent dans les fabriques de ce genre sont exposés à certaines maladies. Eux-mêmes ne l’ignorent point, et lorsqu’ils rentrent dans ces fabriques, ils connaissant parfaitement les dangers qu’ils courent et les précautions qu’ils doivent prendre pour les éviter autant que possible. Les certificats de médecin qui sont joints au dossier et qui attestent que des ouvriers de l’usine Figueroa ont été atteints de maladie saturnine ne peuvent donc avoir une grande importance aux yeux de la Commission.
La maladie saturnine, c’est l’intoxication au plomb qui provoque œdèmes, problèmes articulaires, troubles digestifs …. On pourrait mettre au compte du seul cynisme des membres de cette commission le ton de ce paragraphe, mais il n’en est rien : ils ne font que dire la loi ; le cynisme est d’État : ce que dit le droit, – c’est le décret impérial du 15 octobre 1810, qui sera en vigueur jusqu’en 1917 -, c’est que ne sont pris en considération parmi les effets des nuisances industrielles que ceux qui s’exercent sur les propriétaires des immeubles avoisinant les fabriques. Il coulera encore beaucoup d’eau sous les ponts avant que ne soient recevables les plaintes du personnel de la fabrique elle-même.
2 12 1851
Coup d’état du président Bonaparte, moyennant 250 morts sur les barricades, 337 fusillés au Champ de Mars, parce que capturés les armes à la main et 26 000 arrestations (chiffre minimum). Sur ces 26 000, un peu moins de la moitié des personnes incarcérées furent rapidement libérées, un peu plus de cinq mille simplement placés sous surveillance. Parmi les incarcérés, quelques illustres généraux : Cavaignac, Lamoricière, Changarnier, tous avec des états de service des plus élogieux… dont l’absence se fera très cruellement sentir lors de la guerre de 1870 contre la Prusse de Bismarck. Il y eut 9 530 déportations en Algérie et 2 800 internements. Victor Hugo passe toute la journée du 3 à aller d’une barricade à l’autre, avant que d’être du nombre des 26 000 arrêtés ; libéré, il quittera la France : La police est partout, la justice nulle part. La province résistera au coup d’État jusqu’à la mi-décembre.
Les républicains de Bédarieux s’insurgent le 4 décembre 1851 contre le coup d’État de Napoléon Bonaparte pour rétablir la République.
La Mairie est occupée par les insurgés, des incidents éclatent faisant un mort et un blessé parmi les Républicains. La gendarmerie est prise d’assaut : quatre gendarmes trouvent la mort.
L’armée appelée à la rescousse met six jours pour rétablir l’ordre. La répression est féroce : deux cent cinquante huit arrestations.
Dix-sept Républicains sont condamnés à mort (six contumax) dont onze sont commués à la déportation à vie.
Vingt sept déportations à Cayenne. Cent cinq en Algérie. Cent quarante sept mises en résidence surveillée hors département. Cinq bannis du territoire national.
Une amnistie générale est prononcée le 16 août 1859 mais quatorze déportés à Cayenne et cinq en Algérie sont morts.
La loi de Réparation de 1880 a réhabilité leur mémoire.
Passant souviens-toi.
Plaque inaugurée le 11 décembre 2002 par Antoine Martinez, Maire de Bédarieux et le Conseil municipal à l’occasion du 150° anniversaire des événements du 2 décembre 1851.
En Janvier 1853, l’empereur recevra George Sand, venue solliciter des mesures de clémence pour certains amis : Ah, c’est vrai, mais ce n’est pas moi […] Demandez tout ce que vous voudrez, pour qui vous voudrez ! Puis plus tard, devant Daru : Je ne pouvais agir autrement.
Avant d’instituer le suffrage universel, il aurait fallu trente ans d’instruction obligatoire…
Jean Macé, écrivain, journaliste et franc-maçon
Nos rouges ont reçu une raclée solide et les badauds quelques éclaboussures qui les obligeront à l’avenir à se tenir tranquilles chez eux […] il me semble que si on avait laissé grandir cet enfant, il en aurait fait de belles en 1852…
Prosper Mérimée
L’heureuse crise de décembre 1851 a irrévocablement fait passer la République française de la phase parlementaire de la révolution négative à la phase dictatoriale seule convenable à la révolution positive.
Auguste Comte, 1798 – 1857
11 12 1851
Victor Hugo s’exile à Bruxelles : J’aime la proscription, j’aime l’exil, j’aime mon galetas de la grande place, j’aime la pauvreté, j’aime l’adversité, j’aime tout ce que je souffre pour la liberté, pour la patrie et pour le droit ; j’ai la conscience joyeuse ; mais c’est toujours une chose douloureuse de marcher sur la terre étrangère. et, quelques années plus tard, installé à Guernesey, car fâché à jamais avec Napoléon le Petit, dans Océan : Je trouve de plus en plus que l’exil est bon. Il faut croire qu’à leur insu, les exilés sont près de quelque soleil, car ils mûrissent vite […] Je me sens sur le vrai sommet de la vie […] Je mourrai peut-être en exil, mais je mourrai accru. Tout est bien.
Eugène Sue avait été élu en 1849 à Paris, sous une étiquette républicain socialiste : emprisonné après ce coup d’état, il fut relaxé mais préféra s’exiler à Annecy le Vieux : n’ayant jamais obtenu la permission de rentrer en France, il y mourra en 1857.
21 12 1851
Ratification du coup d’état par plébiscite : Le Peuple français veut le maintien de l’autorité de Louis Napoléon Bonaparte, et lui délègue les pouvoirs nécessaires pour établir une constitution sur les bases proposées dans sa proclamation du 2 décembre 1851. Résultats : 7 481 231 oui (92,03 % des exprimés / 74,81 % des inscrits). 647 292 non (7,96 % des exprimés / 6,47 % des inscrits).
27 12 1851
Le remorqueur Blazzer pose le premier câble sous-marin entre Douvres et Calais.
12 1851
Manuela Saenz, veuve de Simon Bolivar, vit depuis près de 30 ans à Paita, petit port de la côte péruvienne, entre lettres du grand homme et pots de confiture. De temps à autre une visite… dix ans plus tôt, celle d’Hermann Melville, qui disait vouloir écrire sur les baleines, aujourd’hui celle de Garibaldi qui pleure Anita : Je l’ai quittée très ému ; nous nous sommes séparés les larmes aux yeux, pressentant que cet adieu était le dernier sur cette terre. Doña Manuela Sáenz était la dame la plus charmante et la plus noble que j’eusse vue.
Garibaldi
1851
François Coignet construit une maison en béton armé et coffré, à Saint Denis. Le train relie Saint Pétersbourg à Moscou. À Lyon, le docteur Devay effectue sur une accouchée la première transfusion sanguine. La découverte d’or à Bathurst, – ouest de Sydney – amène une seconde vague de colonisation en Australie : on y comptait alors 0,45 million d’habitants, [dont un tiers d’anciens forçats] : ils seront 3,2 millions en 1890. William Thomson, qui deviendra lord Kelvin, définit le zéro absolu de l’eau à -273° : toutes les molécules sont alors au repos.
La photographie sur verre au collodium, mise au point par l’américain Frédérick Scott Archer et le français Gustave Le Gray donne des clichés plus détaillés. En France Jean-Marie Taupenot améliore aussi considérablement la technique, permettant aux plaques d’être conservées 8 jours avant d’être développées, c’est à dire que la photo cessait d’exiger la logistique d’une expédition. Gustave Le Gray invente encore le négatif sur papier ciré sec. Il va devenir la coqueluche des amateurs, avec ses photos d’art, composées, faites de la superposition de plusieurs clichés pour que partout tout soit parfait. Plus artiste que gestionnaire, il fera faillite et prendra la fuite en juin 1860 en compagnie d’Alexandre Dumas, sur sa goélette, cap sur la Sicile de Garibaldi puis sur Malte où Alexandre Dumas le débarquera sans le premier sou après une dispute. Après un passage en Syrie pour suivre l’histoire des Maronites, il échoue en Egypte où il mourra en 1884 dans un total anonymat.
Victor Place est nommé consul à Mossoul avec mission de reprendre les fouilles de Paul Émile Botta à Khorsabad. Deux ans plus tard, s’étant lui-même lourdement endetté, il sera parvenu à dégager une centaine de salles, découvrant notamment les taureaux ailés à tête humaine. Mais il reçoit l’ordre d’arrêter les travaux et on le nomme en Roumanie ! En mai 1855, des bédouins attaqueront et couleront dans le Chatt al-Arab les radeaux sur lesquels ont été entreposés les œuvres dans l’attente d’un navire de France qui n’est jamais arrivé. Un sommet dans l’incurie gouvernementale et administrative !
Le révérend anglais Langstroth invente la ruche à casier mobile, ce qui évite de sacrifier les abeilles, ce qui se pratiquait jusqu’alors : le miel était une économie de prédation. Allégeant ainsi le travail des abeilles qui ne demandaient pas mieux que d’utiliser ces casiers, les rendements seront grandement améliorés : cette nouveauté sera surtout appliquée au Royaume Uni, aux États Unis et en France.
01 1852
Le gouvernement s’emploie avec succès à susciter des fusions au sein des compagnies ferroviaires pour qu’elles deviennent partie d’un ensemble cohérent, la cohérence étant alors, et encore pour nombre de décennies, celle d’une toile d’araignée dont le centre est bien évidemment Paris.
26 02 1852
Bretonne de Plouhinec, dans le Morbihan, Hélène Jégado est guillotinée à Paris sur le Champ de Mars. Elle a 49 ans. Son acte d’accusation : 5 empoisonnements, 5 tentatives d’empoisonnement et 11 vols domestiques. En réalité elle a un tableau de chasse beaucoup plus chargé, nombre de crimes ayant été couverts par la prescription, car commis plus de 10 ans avant le procès, déclenché par les soupçons de son dernier employeur, et là l’inconscience peut s’appeler bêtise, car il était professeur de droit et expert en affaires criminelles et avait déjà vu succomber deux de ses gouvernantes et une servante. Sa méthode : l’arsenic. Cuisinière dans des collectivités, des presbytères, ou dans des maisons bourgeoises, elle assaisonnait les plats principaux, et à la longue, cela faisait effet. Très pieuse au demeurant.
150 ans plus tard, on trouve encore en Bretagne des pâtisseries qui proposent des gâteaux d’Hélène Jégado, l’angélique et les amandes amères, non greffées [1] venant remplacer l’arsenic – promis, juré -. Jean Theulé écrira une biographie romancée en 2013, Fleur de Tonnerre, dont Stéphanie Pillonca-Kervern reprendra le titre pour un film en 2017.
24 09 1852
Henry Giffard effectue le premier vol d’un dirigeable – ballon mû par un moteur à vapeur – de Paris à Trappes.
11 1852
Les frères Pereire fondent le Crédit mobilier, première des grandes banques d’affaires en France. Le prince président ne pouvait partager les idées des Rothschild, trop fermés aux idées modernes. Le Crédit mobilier a pour objectif de drainer une épargne nouvelle grâce à des émissions d’obligations dont le produit servira à financer des prêts aux entreprises. Quinze ans plus tard, la rapidité de son succès le mettra au bord de l’effondrement. Mais le mouvement des banques d’affaires était lancé : en 1855 naîtra, fruit de la fusion de 3 banques foncières, à Paris, Marseille et Nevers, le Crédit Foncier, puis le CIC en 1859, le Crédit Lyonnais en 1863, la Société Générale en 1864, avec, au sommet la Banque de France qui absorbe les anciennes banques départementales.
Entre 1851 et 1870, la circulation fiduciaire aura triplé. La Bourse de Paris aura connu une expansion foudroyante et se sera imposée de surcroît comme le principal marché des grands emprunts d’État. Alors qu’en 1851, on y cotait 118 valeurs pour un montant global de 11 milliards, les chiffres seront passés en 1869 à 307 valeurs pour un total de 35 milliards de francs.
Philippe Seguin. Louis Napoléon le Grand. Grasset 1990
2 12 1852
Proclamation du second Empire.

Le rétablissement de l’empire inspire à Victor Hugo un Te Deum d’imprécations :
Prêtre, ta messe, écho des feux de peloton,
Est une chose impie.
Derrière toi, le bras ployé sous le menton,
Rit la mort accroupie.
Prêtre, on voit frissonner, aux cieux d’où nous venons,
Les anges et les vierges.
Quand un évêque prend la mèche des canons
Pour allumer les cierges.
Tu veux être au Sénat, voir ton siège élevé
Et ta fortune accrue ;
Soit ; mais pour bénir l’homme, attends qu’on ait lavé
Le pavé de la rue.
Peuples, gloire à Gessler ! meure Guillaume Tell !
Un râle sort de l’orgue.
Archevêque, on a pris, pour bâtir ton autel,
Les dalles de la morgue.
Quand tu dis: Te Deum ! nous vous louons,
Dieu fort ! Sabaoth des armées !
Il se mêle à l’encens une vapeur qui sort
Des fosses mal fermées.
On a tué, la nuit, on a tué, le jour,
L’homme, l’enfant, la femme !
Crime et deuil. Ce n’est plus l’aigle, c’est le vautour
Qui vole à Notre Dame.
Va, prodigue au bandit les adorations ;
Martyrs, vous l’entendîtes !
Dieu te voit, et là-haut tes bénédictions,
O prêtre, sont maudites !
Les proscrits sont partis au flanc du ponton noir,
Pour Alger, pour Cayenne ;
Ils ont vu Bonaparte à Paris, ils vont voir
En Afrique l’hyène.
Ouvriers, paysans qu’on arrache au labour,
Le sombre exil vous fauche !
Bien, regarde à ta droite, archevêque Sibour,
Et regarde à ta gauche.
Ton diacre est Trahison et ton sous diacre est Vol ;
Vends ton Dieu, vends ton âme,
Allons, coiffe ta mitre, allons, mets ton licol,
Chante, vieux prêtre infâme !
Le meurtre à tes côtés suit l’office divin,
Criant : Feu sur qui bouge !
Satan tient la burette, et ce n’est pas de vin
Que ton ciboire est rouge.
L’empereur lui fit alors une offre d’amnistie, qui lui valut en retour une volée de bois vert :
Si l’on n’est plus que mille, eh bien, j’en suis ! Si même,
Ils ne sont plus que cent, je brave encore Scylla ;
S’il en demeure dix, je serai le dixième ;
Et s’il n’en reste qu’un je serai celui-là !
*****
Pour les élites du pays […], le coup d’État fut un double scandale : moral, car son succès parut le triomphe de la force sur le droit, intellectuel, car l’intelligence méprisait le pouvoir personnel […] En France, l’échec de la révolution de Février n’était pour la jeunesse cultivée qu’un temps d’arrêt dans la marche victorieuse de la démocratie libérale. Une dictature conservatrice, au siècle de la liberté, tel apparaissait le second Empire : un anachronisme.
Adrien Dansette
Fermeture du bagne de Toulon : 14 ans plus tôt, il comptait 4 300 forçats ; mais, globalement, avec plus de 51 000 prisonniers, la France atteint son record du nombre d’incarcérations : 2 personnes pour 1 000 habitants.
21 12 1852
La restauration de l’Empire est plébiscitée : 7 824 189 oui, 253 145 non, plus de 2 000 000 d’abstentions et 60 000 bulletins nuls. L’Église donne sa bénédiction : Jamais le doigt de Dieu ne fût plus visible que dans les événements actuels.
Monseigneur Sibour, archevêque de Paris.
Le suffrage universel s’est bel et bien exprimé, librement, largement, en faveur de Louis Napoléon. Le seul crime de celui-ci est de l’avoir rétabli, fidèle dans cette démarche au principe de toute son existence.
On pourra trouver cela regrettable, incompréhensible, affligeant, fâcheux, incroyable, mais c’est ainsi : à l’époque, le corps électoral ne voulait pas donner la majorité aux républicains. Las de ses propres divisions, il réclamait Louis Napoléon.
Durant des décennies, en noircissant à plaisir l’acte, le dessein et la personne de Louis Napoléon, cette vérité, cette simple vérité aura été occultée.
Ce camouflage prendra dans l’Histoire d’autres formes que celle de cette réputation salie : il résulte de l’étonnant rapport que, depuis lors et jusqu’à une période toute récente, la gauche entretient avec le suffrage universel, rapport fait d’adulation apparente et de méfiance réelle, et qui inspirera encore sa conduite en 1958 et lors de sa campagne référendaire de 1962. Pour elle, le suffrage universel doit être médiatisé au sens littéral du terme. Il est hors de question de laisser le peuple en faire trop librement usage…
À plus de cent ans de distance, ceux qui croyaient avoir à défendre, une fois encore, la liberté… contre les aspirations du peuple, ne manquèrent pas d’établir un parallèle entre les 13 mai 1958 et le 2 décembre 1851.
En recourant à cette comparaison, ils entendaient jeter l’opprobre sur Charles de Gaulle et réaliser à son détriment l’opération si magnifiquement réussie par le prince président.
C’était évidemment se tromper du tout au tout, et prendre un fantasme pour la réalité. Mais, peut-être secrètement espérée pour justifier la légitimité du pronostic, l’atteinte aux libertés se fit attendre et ne vint jamais. D’ailleurs s’il y eut pronunciamento, on comprit vite que de Gaulle n’avait pas pris le pouvoir à sa faveur.
Il existe pourtant, prenons le risque de le dire, certaines analogies entre les deux événements, et au moins un point commun : le coup n’est pas le fait générateur de la crise. Il est sa sanction logique et inévitable. Surtout, le peuple a fait son choix.
En 1958, la IV° République est déjà morte. En 1851, il n’y a déjà plus de II° République. Le régime en place n’en a plus que le nom. François Mitterrand, évidement peu suspect de complaisance, s’exprime là-dessus mieux que d’autres : Réduire la rébellion de l’armée, la chute de la IV° République et l’avènement du général de Gaulle aux ambitions et aux intrigues du chef de la France libre serait donner d’aussi grands changements une explication mesquine et fausse. Un peuple tout entier ne bouge pas en ses profondeurs pour la chiquenaude d’un commando. Le murissement des révoltes a besoin d’autres soleils que la gloire en veilleuse d’un héros.
Marx, en des termes différents, n’avait pas dit autre chose au sujet de Louis Napoléon : Il ne suffit pas de la dire, comme le font les Français, que leur nation a été surprise. On ne pardonne pas plus à une nation qu’à une femme le moment de faiblesse qui permet au premier aventurier venu de la violer. Le problème ne se trouve pas résolu par de semblables détours, il n’est que formulé autrement. Il resterait comment expliquer qu’une nation de 36 millions d’habitants peut se laisser réduire par eux en servitude.
Ainsi, présenter le coup d’État comme procédant de la seule ambition de Louis Napoléon ou d’un complot contre les libertés relève de la malhonnêteté historique.
En fait, comme l’a si bien dit Émile Ollivier : Le coup d’État a réussi parce qu’il était dans la majorité des esprits avant d’être réalisé dans les faits. Et d’ailleurs, qu’avait fait le Président ? Détruisait-il la République ? Non. Attentait-il à la souveraineté nationale ? Non. Il maintenait la République, il ne faisait pas la moindre allusion à l’Empire, il rétablissait, dans son intégrité la souveraineté nationale ; il proposait une solution et ne l’imposait pas : il interrogeait le peuple.
Plus près de nous, enfin, Pierre Guiral a reconnu que le coup d’État, s’il était un acte de violence […] dénouait une situation sans issue.
Philippe Seguin. Louis Napoléon le Grand. Grasset 1990
1852
Aux États Unis, parution de La Case de l’oncle Tom, de Misses Beecher Stowe : le livre va cristalliser les antagonismes américains sur la question de l’esclavage.
De ces années 1850 – 1860 date l’apparition de certaines des données politiques qui de nos jours encore commandent la vie politique américaine : le parti républicain apparaît en 1854, et récemment encore le Solid South votait en bloc démocrate pour faire pièce aux abolitionnistes républicains. La persistance de ces souvenirs, près d’un siècle après la fin du conflit, montre l’importance qu’eut la lutte du Nord contre le Sud, comparable à celle de la coupure de 1789 dans notre histoire nationale.
René Rémond. Histoire Universelle. L’Amérique anglo-saxonne. La Pléiade 1986
À Bayreuth, Eduard Steingraeber crée sa fabrique de pianos droits alors qu’il n’a que 29 ans. Sa réputation grandit rapidement au point que Richard Wagner lui demandera en 1874 la construction d’un carillon pour la scène du Graal de son opéra Parsifal. Steingraeber emploie aujourd’hui une trentaine de personnes. Elle est très réputée auprès des spécialistes pour la qualité de ses pianos droits, considérés par certains comme les plus aboutis au monde. Ils rivalisent sans complexe avec les modèles de Bösendorfer, Steinway, Bechstein et Pleyel.
29 01 1853
Napoléon III épouse Eugénie de Montijo. Elle va importer de l’Espagne, sa terre natale, un spectacle nouveau pour la France : la corrida, qui va connaître un grand succès du nord au sud et de l’est à l’ouest. L’empereur officialisera une entorse à la loi Grammont du 2 janvier 1850 qui protégeait les animaux domestiques […le taureau en était]. Les oppositions se manifestèrent avec virulence dans la moitié nord de la France, non par compassion sur le sort des taureaux, mais sur celui des chevaux : un taureau pouvait tuer plusieurs chevaux en une seule corrida ; on était certes sensible à cela en France, mais en Espagne, les touristes anglais étaient horrifiés … tant et si bien, qu’une loi [très probablement anticonstitutionnelle, car enfreignant le principe d’égalité sur tout le territoire] décrétera en 1951 que la corrida était autorisé dans la moitié sud de la France, que, sur le sujet, la tradition ne se différenciait du nord que par les courses de taureaux, vachettes dans les villes. La corrida était devenue un loisir très populaire en Espagne depuis quelques dizaines d’années seulement, quand des employés des abattoirs s’étaient mis à faire évoluer leur travail d’abattage en jeu qui s’était peu à peu ritualisé, enjolivé et popularisé. Mais il y avait bien tout de même quelques chose dans la tradition puisque dès la seconde moitié du XIV° siècle, on mentionne l’existence d’une forme de tournoi qui mettait aux prises un cavalier aristocrate contre un taureau.
1 06 1853
Marguerite et Aristide Boucicaut, associés aux frères Videau depuis l’année précédente créent officiellement Le Bon Marché, à l’angle des rues de Sèvres et du Bac, avec le dessein de recréer le mode de fonctionnement des foires, où la clientèle peut déambuler librement, comparer, apprécier la diversité des articles, et, en fin de compte, achètent plus. Ils inventent le satisfait ou remboursé. Dix ans plus tard, les frères Videau commencent à s’inquiéter sérieusement de l’ambition de leurs associés, qui leur semble démesurée : ça tombe bien, un ami des Boucicaut, de retour des États Unis après fortune faite, peut leur prêter le million et demi de francs dont ils ont besoin pour racheter les parts de leurs associés : ayant désormais les coudées franches, ils rachètent nombre de boutiques des environs pour augmenter leur surface de vente, transforment leur bâtiment d’origine en faisant appel à des célébrités, l’architecte Alexandre Laplanche, Boileau et Fils, l’ingénieur Armand Moisan et même Gustave Eiffel.
Le client ne dépend pas de nous, c’est nous qui dépendons de lui. Le client n’interrompt pas notre travail, il est notre but. Salon de lecture pour que les hommes puissent patienter pendant que Madame chine, toilettes pour hommes et toilettes pour femme, des images pour les enfants, les soldes d’été, le mois du blanc, service de livraison à domicile… On n’arrête pas le progrès.
Tout n’est pas rose tous les jours : en septembre 1869, quelques salariés quittent la maison, refusant le travail du dimanche : Marguerite répond alors… par de très substantielles améliorations des conditions de travail : intéressement aux résultats, promotion professionnelle au sein des magasins, pourcentage sur les ventes – c’était l’actualisation de l’ancienne guelte -, cantine d’entreprise – menu identique pour tous, quel que soit sa fonction -, cours d’anglais…
En 1876, les Boucicaut créeront une Caisse de prévoyance alimentée par les bénéfices de l’entreprise permettant, au bout de dix à quinze ans de présence, et sans retenue sur salaire, de verser un petit capital aux membres du personnel :
Nous avons voulu assurer à chacun de nos employés la sécurité d’un petit capital qu’il puisse retrouver au jour de sa vieillesse, ou qui, en cas de décès, puisse profiter aux siens. Nous avons voulu en même temps leur montrer d’une manière affective quelle est l’étroite solidarité qui doit les unir à la maison. Ils comprendront mieux que l’activité du travail, le soin des intérêts de la Maison, l’économie du matériel mis à leur disposition sont autant de devoirs qui tournent au profit de chacun.
Aristide Boucicaut meurt le 26 décembre 1877 : Le Bon Marché réalise alors un chiffre d’affaires de l’ordre de 80 millions de francs, avec 1 700 employés. Marguerite lui survivra 10 ans : à la mort Le Bon Marché avait 3 773 employés. Son fils étant mort, elle se retrouve sans héritier, et fait un chèque de 250 000 francs à Louis Pasteur, ce qui lui permet de fonder son Institut.
Ses obsèques seront celle des grands : Qui, en sortant de la gare Montparnasse, à Paris, en ce 12 décembre 1887, pouvait imaginer, devant la magnificence du cortège funéraire, lui bloquant le passage, qu’il s’agissait de Madame Boucicaut, Bourguignonne illettrée et gardeuse d’oies ?
Lucienne Delille, journaliste
8 07 1853
Quatre cuirassés américains mouillent dans le port d’Uraga, dans la baie d’Edo, au Japon ; à leur tête le commodore Matthew Calbraith Perry, avec pour objectif la protection des marins en détresse, la possibilité de se ravitailler dans les ports japonais et enfin l’ouverture au commerce de ces ports. Il y a 212 ans que le pays est fermé sur lui-même, interdit aux étrangers.
Le développement de la pêche à la baleine est venu infléchir les relations entre les États Unis et le Japon. Traditionnellement, les Japonais pêchaient la baleine au filet. Les Américains avaient commencé par la pêcher en Atlantique nord, où la ressource s’était vite épuisée, surtout après l’emploi à la fin des années 1840 de la grenade. Les baleiniers américains s’étaient alors mis à fréquenter assidûment le Pacifique, dans des zones proches du Japon, lui livrant une féroce concurrence. Par ailleurs les lois shôgunales ne sont pas tendres aux marins : si un équipage naufragé est recueilli par un navire étranger, ce peut-être la mort qui l’attend une fois de retour à la maison ; il en va de même pour des équipages non-japonais s’ils viennent à naufrager sur les côtes japonaises : ce sont de longues années de détention qui les attendent. Comment maintenir cette politique d’isolement face à l’ultimatum d’une telle puissance ? Le shogun hésite, consulte les daimyos, puis décide de s’incliner : un traité signé l’année suivante ouvrira aux Américains les ports de Shimoda et de Hakodate, suivi par d’autres accords analogues avec la Russie, l’Angleterre, la France et les Pays-Bas : c’en était fait du splendide et volontaire isolement du Japon.
24 09 1853
La France s’approprie la Nouvelle Calédonie. Jusqu’en 1948, elle va avoir le statut de colonie pénitentiaire et les premiers colons seront bien des bagnards, auxquels se joindront plus tard des Réunionnais, des colons algériens après la révolte en Algérie de 1871. Pour s’assurer que cette population criminelle des bagnards ne revienne que le plus tard possible en métropole, on a instauré la peine dite du doublage, qui impose de rester sur le territoire après avoir purgé sa peine, pour la même durée que celle-ci. Ces peuplements vont provoquer une véritables spoliation des terres kanaks, ces derniers étant parqués – c’est le mot qui convient – dans des réserves tribales selon le mot d’un gouverneur de l’époque, quand il n’existait pas de tribus chez les Kanaks. Ces peuplements apportaient avec eux des maladies inconnues jusqu’alors de kanaks, qui vont faire des ravages dans leurs rangs.
09 1853
Le choléra sévit en France depuis juin. On compte alors à Paris 150 médecins qui pratiquent l’homéopathie, plusieurs dispensaires et deux pharmacies exclusivement homéopathiques.
L’homéopathie m’a sauvé (du choléra)
Proudhon
1 10 1853
Carl Bechstein fonde à Berlin l’entreprise C. Bechstein Pianoforte AG Berlin, fabricant des pianos droit et à queue. Ils vont devenir très vite le haut de gamme du piano.
11 1853
La Russie envahit les provinces danubiennes de l’empire ottoman en tablant sur l’alliance avec la Grande Bretagne et la neutralité des autres puissances européennes.
31 12 1853
On peut faire confiance aux Anglais pour trouver une idée originale pour le réveillon du nouvel an, à grand renfort d’egos boursoufflés : […] ainsi, au Crystal Palace de Londres, onze invités triés sur le volet, portant un frac rehaussé d’une cravate blanche, prennent place dans le ventre d’un iguanodon. L’événement est destiné à célébrer une science – la paléontologie – et son héraut, le Britannique Richard Owen, qui trône d’ailleurs en bout de table. À dessein, sa tête apparaît juste à l’emplacement du cerveau de l’animal préhistorique dont l’énorme carcasse de brique abrite les agapes. Soupe à la tortue, turbot à la hollandaise, tourte au pigeon, faisan et nougat à la chantilly figurent parmi les huit plats arrosés de sherry, de madère, de vins de Moselle et de Claret, servis à une brochette de scientifiques, d’artistes et de journalistes. Owen, le Cuvier anglais, l’inventeur des dinosaures, triomphe.
Un seul homme manque à l’appel, pour la bonne raison qu’il est mort, probablement suicidé, un an auparavant : Gideon Mantell, médecin passionné de géologie et véritable inventeur de l’iguanodon, dont la reconstitution sculptée a été choisie pour accueillir ce réveillon très spécial. L’homme dont Owen, maître de cérémonie, a passé une partie de sa vie à piller les recherches, à s’attribuer les travaux et à contester faussement les conclusions.
L’histoire avait débuté en 1822 au bord d’une route du Sussex (sud de l’Angleterre). Mary Ann Mantell accompagne son époux obstétricien en tournée chez ses patientes. Elle remarque un objet brillant dans un tas de gravats, fait stopper la calèche. Et découvre deux énormes dents enchâssées dans un bloc de roche. Gideon Mantell, passionné de paléontologie et amateur reconnu pour ses recherches, consulte des savants, à commencer par Cuvier et Owen eux-mêmes. Leur sentence est sans appel : il s’agit des restes d’un mammifère carnivore de type rhinocéros. Mais, contre leur avis, Mantell a l’intuition que les dents appartiennent à un reptile herbivore géant, une catégorie totalement inconnue. Il continue de collecter fossiles et ossements jusqu’à ce qu’en 1825 sa découverte soit validée. Owen, médecin anatomiste de formation devenu une sommité de la paléontologie, ne lui pardonnera pas. Gideon Mantell avait révélé l’existence d’un gigantesque animal disparu, inimaginable jusque-là. Il lui revenait de le nommer. Ayant observé la similarité de ses dents avec celles d’iguanes actuels, il baptisa la créature iguanodon.
[…] Mais, en 1842, Richard Owen a une autre intuition de génie : les différentes espèces d’animaux disparus identifiées grâce aux fossiles et aux os appartiennent à une catégorie unique. Il forge un nom pour la désigner, s’en arrogeant ainsi la paternité. Ce sera le dinosaure, dérivé du grec terrible lézard. Pour la postérité, Owen sera l’unique inventeur des dinosaures, au prix de la dissimulation des découvertes décisives de Gideon Mantell. Devant la Royal Society, Owen nie que ses travaux découlent de ceux de Mantell. Il se bat même – en vain – pour empêcher que la prestigieuse Royal Medal lui soit décernée.
Le temps a-t-il fait œuvre de vengeance ? Aujourd’hui, alors que la vogue des dino, portée par des films comme Jurassic World, ne faiblit pas, leur inventeur est totalement oublié. Sa statue, qui trônait depuis plus d’un siècle dans le hall du Natural History Museum (NHM) de Londres aux dimensions de cathédrale, a été remplacée en 2009 par celle de Darwin. Le bronze d’Owen, qui fut pourtant le premier directeur du musée, fondé en 1881, a été relégué dans un recoin, quasi invisible.
Richard Owen a disparu car il s’est opposé à Charles Darwin dont la théorie de l’évolution a triomphé, analyse Paul Barrett, paléontologue au NHM. L’Histoire a été réécrite par les vainqueurs mais elle ne peut se réduire à celle de l’horrible personnage souvent dépeint. Jeune, Owen a été soutenu par ses collègues. Mais plus il a pris de l’importance, plus il est devenu odieux envers ses rivaux, les évaluant sur le plan scientifique, leur refusant l’accès à des fossiles et leur déniant parfois la paternité de découvertes pour se les attribuer.
Retraçant l’histoire de cette folle rivalité, Paul Barrett refuse parallèlement de réduire Gideon Mantell à une simple victime. Aujourd’hui, on le qualifierait d’obsessionnel compulsif. Sa passion dévorante des fossiles a détruit sa vie. Sa femme l’a quitté, ce qui était rarissime à l’époque ; son fils Walter s’est engagé en Nouvelle-Zélande pour échapper à l’ambiance familiale. Il a sacrifié son cabinet médical pour investir dans un musée destiné à rassembler ses collections, mais qui a périclité parce qu’il ne faisait pas payer l’entrée. Au bord de la faillite, le médecin a dû vendre au British Museum ses collections qui sont tombées ensuite entre les mains de son bourreau.
Mantell, aussi désintéressé et ouvert qu’Owen était renfermé et orgueilleux, poussa l’ouverture d’esprit jusqu’à confier pour examen à son tyrannique adversaire des os envoyés de Nouvelle Zélande par son fils. Ils furent identifiés par le savant comme d’énormes oiseaux préhistoriques incapables de voler, et baptisés plus tard moas. Mantell était un formidable découvreur d’espèces nouvelles mais peu armé sur le plan théorique, précise Paul Barrett. Owen, au contraire, n’a jamais ramassé un fossile de sa vie, mais il avait une connaissance étendue du monde animal et de l’anatomie comparée. Tous deux d’origine modeste et passionnés, ils auraient pu devenir complémentaires et leur rivalité se révéler productive. Elle fut plutôt destructrice en termes de connaissance des dinosaures, estime encore le chercheur. Il s’agit d’une rivalité unilatérale : Owen bataillait contre tout le monde, à commencer par lui-même. […]
Philippe Bernard. Le Monde 20 08 2015
1853
George Eugène Haussmann est nommé préfet de la Seine : début des grands travaux. La règle générale va être dictée par deux dangers auxquels il fallait parer : le choléra et les barricades révolutionnaires. Le choléra avait réapparu dans le dernier trimestre 1853, fauchant près d’1.5 million de personnes jusqu’à fin 1854 : dans la prison d’Aniane dans l’Hérault, ce sont 250 détenus qui en meurent, le tiers de l’effectif. Les boulevards de Strasbourg et Saint Michel doublèrent, de la gare de l’Est à l’Observatoire, les rues Saint Denis et Saint Jacques tandis que la rue de Rivoli, prolongée depuis la place de la Concorde jusqu’à l’Hôtel de Ville, doublait la rue Saint Honoré, ceci pour le principal ; il développe les galeries souterraines du réseau d’eau, facilitant ainsi les interventions : si, en 2009, Paris, avec un rendement de 96.5 % est largement en tête des villes de France qui perdent le moins d’eau, c’est en grande partie à Haussmann qu’elle le doit. Il lui sera tout de même reproché par après d’avoir mis les Halles Centrales au cœur de Paris ; mais les transformations de Paris dépassèrent de beaucoup ces seuls travaux ; il fera école en province : Rouen, Toulouse, Montpellier, Lyon, Avignon, Marseille et même à l’étranger : Bruxelles et Rome notamment.
Un tel bouleversement ne pouvait que susciter les passions. Apologistes et détracteurs s’en donnèrent à cœur joie : Haussmann avait l’air impudent d’un laquais de bonne maison. Il étalait sa personnalité avec une exubérance parfois grotesque ; mais il possédait les qualités d’un administrateur de premier ordre.
Emile Ollivier, qui le fit remercier en 1870
Autour de la place du Châtelet s’écroulent les immondes sentines, égouts à ciel ouvert, qui descendaient vers la Seine. Le boulevard du centre, traversant la ville d’un bout à l’autre, vivace artère où circulera le riche sang du commerce, s’avance triomphalement à travers ces décombres. La rue de Rivoli, prolongée jusqu’à l’ancienne place de Grève, sera pour Paris ce que le Grand Canal est pour Venise.
Théophile Gautier
Regrette qui voudra l’ancien Paris ; mes facultés intellectuelles ne m’ont jamais permis d’en reconnaître les détours quoique, comme tant d’autres, j’y aie été nourrie. Aujourd’hui que de grandes percées, trop droites pour l’œil artiste, mais éminemment sûres, nous permettent d’aller longtemps, les mains dans les poches, sans nous égarer et sans être forcés de consulter à chaque instant le commissionnaire du coin ou l’affable épicier de la rue, c’est une bénédiction que de cheminer le long d’un large trottoir… Pour mon compte, j’aime à reconnaître qu’aucun véhicule, depuis le somptueux équipage jusqu’au modeste sapin, ne vaut, pour la rêverie douce et riante, le plaisir de se servir de deux bonnes jambes, obéissant sur l’asphalte ou la dalle, à la fantaisie de leur propriétaire…
George Sand
Chez les détracteurs, on entend :
l’Amphion de cette ville n’était qu’un caporal Louis Veuillot
à ce rythme là, il va bientôt rectifier le cours de la Seine Edmond About
…. percées de magnificence Louis Dimier
l’Architecture n’est elle autre chose que l’administration ?
George Pillement et Maurice Raval. Destruction de Paris Haussmann contre Paris
les boulevards rectilignes ne sentent plus le monde de Balzac Les Goncourt
Le vieux Paris n’est plus : la forme d’une ville change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel Charles Baudelaire
Et enfin, lui-même, qui ne manquait pas d’humour, quand il sera élu membre libre de l’Académie en 1867 : J’ai été choisi comme artiste démolisseur.
Il reste tout de même quelques îlots dans Paris auxquels il n’a pas touché : Dans le crépuscule grisâtre de mars, l’île Saint Louis paresse : chaland alourdi de vieux immeubles blasonnés. Devant elle, la cité semble un remorqueur en panne avec les grandes tours de Notre Dame pour cheminées : son capitaine est un empereur à cheval. L’île Saint Louis patiente dans le sillage de la Cité. Ainsi vont, immobiles, ces deux caillots de terre dans la grosse veine de la Seine. L’île Saint Louis n’a que d’étroites rues fuyant, telles des arêtes de poisson, de part et d’autre de sa longue rue droite. Elle n’a pas, comme la Cité orgueilleuse, une grande place qui est le centre d’un monde ; ni de larges avenues aspergées de vie à jet continu ; aucun monument massif et nul édifice prétentieux. Elle n’a, l’île Saint Louis, la provinciale, que calme, bon ton et discrétion. La vie qu’elle emprisonne semble être celle du Paris d’autrefois conservée là, intacte. C’est une petite ville noyautée dans la grande.
Claude Seignolle. La nuit des Halles. Phébus 1988
L’île Saint-Louis en ayant marre
D’être à côté de la Cité
Un jour a rompu ses amarres
Elle avait soif de liberté
Avec ses joies avec ses peines
Qui s’en allaient au fil de l’eau
On la vit descendre la Seine
Ell’ se prenait pour un bateau
Quand on est une île
On reste tranquille
Au cœur de la ville
C’est ce que l’on dit
Mais un jour arrive
On quitte la rive
En douce on s’esquive
Pour voir du pays
De la mer Noire à la Mer Rouge
Des îles blanches aux îles d’or
Vers l’horizon où rien ne bouge
Point n’a trouvé l’île au trésor
Mais tout au bout de son voyage
Dans un endroit peu fréquenté
On lui raconta le naufrage
L’île au trésor s’était noyée
Quand on est une île
On vogue tranquille
Trop loin de la ville
Malgré ce qu’on dit
Mais un jour arrive
Où l’âme en dérive
On songe à la rive
Du bon vieux Paris.
L’île Saint-Louis a de la peine
Du pôle Sud au pôle Nord
L’océan ne vaut pas la Seine
Le large ne vaut pas le port
Si l’on a trop de vague à l’âme
Mourir un peu n’est pas partir
Quand on est île à Notre Dame
On prend le temps de réfléchir
Quand on est une île
On reste tranquille
Au cœur de la ville
Moi je vous le dis
Pour les îles sages
Point de grands voyages
Les livres d’images
Se font à Paris
Paroles de Léo Ferré, Charles Saut, musique de Léo Ferré
Cinquante ans plus tard, Stefan Zweig dira tout le bonheur qu’il y connaîtra, essentiellement fruit d’une liberté comme nulle part ailleurs : Nulle part on n’a pu éprouver la naïve et pourtant très sage insouciance de l’existence plus heureusement qu’à Paris, où la confirmaient la beauté des formes, la douceur du climat, la richesse et la tradition. Chacun de nous autres, jeunes gens, s’incorporait une part de cette légèreté et y ajoutait ainsi sa propre part ; Chinois et Scandinaves, Espagnols et Grecs, Brésiliens et Canadiens, tous se sentaient chez eux sur les rives de la Seine. Point de contrainte : on pouvait parler, penser, rire, gronder comme on le voulait, chacun vivait comme il lui plaisait, sociable ou solitaire, prodigue ou économe, dans le luxe ou dans la bohème ; il y avait place pour toutes les originalités, toutes les possibilités s’offraient. Il y avait là les sublimes restaurants à deux cents ou trois cents francs, avec toutes les magies culinaires et les vins de toute sorte, avec des cognacs abominablement chers qui dataient des jours de Marengo ou de Waterloo ; mais on pouvait manger et boire presque aussi magnifiquement chez le marchand de vin du coin. Dans les restaurants du Quartier latin, où se pressaient les étudiants, on obtenait pour quelques sous les petits plats les plus friands avant ou après son succulent bifteck, avec en outre du vin rouge ou blanc et une miche de délicieux pain blanc longue d’une aune. On pouvait aller vêtu à son gré : les étudiants se promenaient en béret boulevard Saint Michel ; les rapins, les peintres, s’exhibaient en chapeaux à larges bords pareils à des champignons géants et en vestes romantiques de velours noir ; les ouvriers arpentaient sans gêne les boulevards les plus élégants dans leur bourgeron bleu ou en manches de chemise, les nourrices en coiffe bretonne largement plissée, les marchands de vin en tablier bleu. Il n’était pas indispensable que l’on fût le 14 juillet pour que quelques jeunes couples se missent à danser dans la rue après minuit, et le sergent de ville se contentait d’en rire : la rue n’était-elle pas à tout le monde ? Personne n’éprouvait de gêne devant qui que ce fût : les plus jolies filles ne rougissaient pas de se rendre dans le petit hôtel le plus proche au bras d’un nègre aussi noir que la poix ou d’un Chinois aux yeux bridés. Qui se souciait à Paris de ces épouvantails qui ne devinrent menaçants que plus tard, la race, la classe et l’origine ? On allait, on causait, on couchait avec celui ou celle qui vous plaisait, et l’on se souciait des autres comme d’une guigne. Ah ! il fallait avoir d’abord connu Berlin pour bien s’éprendre de Paris, il fallait avoir éprouvé la servilité volontaire de l’Allemagne, avec sa conscience hiérarchique accusée des rangs et des distances, aiguisée jusqu’à en être douloureuse, où la femme d’un officier ne fréquentait pas celle d’un professeur de lycée, ni celle-ci l’épouse d’un commerçant, ni surtout cette dernière une femme d’ouvrier. Mais à Paris l’héritage de la Révolution, bien vivant, circulait encore dans le sang. Le prolétaire se sentait un citoyen aussi libre et digne de considération que son employeur, le garçon de café serrait la main d’un général galonné comme à un collègue. De petites bourgeoises actives, sérieuses et propres ne faisaient pas la grimace en rencontrant la prostituée dans le corridor, elles causaient tous les jours avec elle dans l’escalier, et leurs enfants lui donnaient des fleurs. Un jour je vis entrer dans un restaurant élégant – Larue, près de la Madeleine – de riches paysans normands qui revenaient d’un baptême, ils portaient les costumes de leur village, leurs lourds souliers ferrés faisaient un vacarme de sabots de cheval, et ils avaient sur les cheveux une si belle couche de pommade qu’on en sentait l’odeur jusqu’à la cuisine. Ils parlaient fort et se faisaient de plus en plus bruyants à mesure que le vin coulait, ils bourraient les reins de leurs grosses femmes en riant sans aucune gêne. Cela ne les dérangeait pas le moins du monde de se trouver, eux, vrais paysans, parmi les fracs impeccables et les grandes toilettes, mais le garçon rasé de frais ne fronçait pas non plus le nez devant ces campagnards comme il l’eût fait en Allemagne ou en Angleterre, il les servait avec la même politesse et la même perfection que les ministres ou les excellences, et le maître d’hôtel prenait même plaisir à saluer avec une cordialité toute particulière ces hôtes un peu frustes. Paris n’offrait qu’une juxtaposition de contrastes, point de haut ni de bas ; aucune frontière invisible ne séparait les artères luxueuses des passages crasseux, et partout régnaient la même animation et la même gaieté. Les musiciens ambulants jouaient dans les cours des faubourgs ; par les fenêtres, on entendait chanter les midinettes à leur travail ; toujours retentissait quelque part dans les airs un éclat de rire ou un appel cordial ; quand par hasard deux cochers s’engueulaient, ils finissaient par se serrer la main, buvaient un verre ensemble et l’accompagnaient de quelques huîtres qu’ils payaient un prix dérisoire. Rien de pénible ou de guindé. Les relations avec les femmes se nouaient facilement et se rompaient de même, chacun trouvait chaussure à son pied, chaque jeune homme une amie pleine de gaieté et que n’inhibait pas la pruderie. Ah ! que la vie était dépourvue de pesanteur, à Paris, qu’elle était bonne, surtout si l’on était jeune ! La simple flânerie était déjà une joie en même temps qu’une perpétuelle instruction, car tout vous était ouvert – on pouvait entrer chez un bouquiniste et feuilleter les livres un quart d’heure sans que le marchand murmurât. On pouvait aller dans les petite galeries privées et tout examiner par le menu dans les magasins de bric-à-brac ; on pouvait assister en parasite aux ventes de l’Hôtel Drouot et bavarder dans les jardins publics avec les gouvernantes. Il n’était pas facile de s’arrêter une fois que l’on s’était mis à flâner, la rue exerçait une attraction magnétique et montrait sans cesse quelque chose de nouveau dans son kaléidoscope. Si l’on était fatigué, on pouvait s’asseoir à la terrasse d’un des dix mille cafés et écrire des lettres sur du papier qu’on vous fournissait gratuitement, tout en se faisant présenter par les marchands ambulants toute leur pacotille de frivolités et d’objets superflus. Il n’y avait qu’une chose difficile : c’était de rester au logis ou d’y retourner, surtout quand le printemps faisait irruption, que la lumière brillait, argentée et douce, par-dessus la Seine, que les arbres des boulevards commençaient à se couvrir de pousses vertes et que les jeunes filles portaient toutes un petit bouquet de violettes piqué à leur corsage ; mais l’arrivée du printemps n’était vraiment pas indispensable pour qu’on fût de bonne humeur à Paris.
Stefan Zweig. Le Monde d’hier. Souvenirs d’un Européen 1944. Pour la traduction française 1982 chez Belfond

Les Trois Frères Provençaux, restaurant du quartier de Palais-Royal, à Paris. Gravure d’Eugène Lami, 1842. Photographie de Dea. Album

L’actuel Grand Véfour, descendant du restaurant du même nom fondé par Jean Véfour en 1820. Photographie de Christian Sarramon, Gtres
Développement important de la Franc Maçonnerie. La production de fonte par coke dépasse celle obtenue par le bois. L’oïdium, un champignon dévastateur de la vigne qui saupoudre feuilles et grappes d’une poussière grisâtre, est apparu en 1845 en Angleterre, venant d’Amérique, et prolifère à des températures supérieures à 25°. Il arrive dans l’Hérault en 1851 et en 1853, les deux tiers des plantations sont détruites : le remède sera le soufre et on descendra les vignes dans la plaine, la quantité prenant alors le pas sur la qualité. L’arrivée du chemin de fer permettra de transporter au loin des vins qui jusqu’alors devaient être consommés à proximité du lieu de production, et donc contribua aussi au développement des surfaces cultivées : c’est dans ces années que le vignoble du Bas Languedoc devindra en superficie plus important que le vignoble atlantique, du Bordelais aux Charentes. Deux années de récolte suffisent à payer une vigne : on verra de petits industriels de la région abandonner leur usine pour devenir viticulteur rentier. Béziers devient capitale régionale, attirant peintres, poètes et chanteurs lyriques.
Garantie de la retraite des fonctionnaires qui, dans le même temps, sont les premiers à bénéficier d’un congé payé annuel. Création de la Compagnie générale des Eaux, sur des idéaux saint simoniens, qui va s’occuper uniquement pendant plus de 120 ans de réseau d’eau et de son traitement. Les trains sont autorisés par décret à faire du 100 km/h. En Inde, le gouverneur général, lord Dalhousie, entreprend la construction des premiers chemins de fer indiens qui en feront, à la fin du XIX° siècle, le réseau le plus dense de tout le continent asiatique.
Le chantier américain Mc Kay lance le plus grand bateau jamais construit en bois : le Great Republic : 99 mètres de long pour 16,20 m au maître-bau. Il en a fallu des arbres : 3 810 m³ de pin dur, 2 056 tonnes de chêne blanc, 336 tonnes de fer, 6 de cuivre et 64 668 mètres courants de toile pour sa voilure. La Maison de Savoie retire à Nice, qui lui avait été rattachée depuis le XIV° siècle, ses dernières franchises au profit de Gênes. Les Niçois n’apprécient pas cette mauvaise manière et lapident la statue de Charles Félix, en créant une expression bien locale pour envoyer balader les gens : Vaï ti faïre pagà da Carlo Felice – va donc te faire payer chez Charles Félix.
Le port d’arme est interdit en Corse : de 1818 à 1852 , on a compté 4 646 homicides, dont 190 en 1822, 203 en 1834 et 228 en 1848. La Compagnie des Guides construit le premier refuge : les Grands Mulets, alors la seule voie pour le Mont Blanc.
À Montpellier, Charles Frédérik Gerhardt parvient à synthétiser la molécule de l’aspirine : l’acide acétylsalicylique, extrait de l’acide salicylique, lui-même extrait de l’alcool salicylique, tiré du salicoside, contenu dans la feuille de saule : les légionnaires romains s’en faisaient des emplâtres sur les jambes pour calmer leurs douleurs ; l’aspirine ne sera expérimentée en thérapeutique qu’en 1889 par les Allemands Dreser et Hoffmann.
Il faut attendre le début du XIX° siècle pour que le principe actif soit isolé. Tout commence par un pharmacien italien qui, en 1825, isole la molécule active de l’écorce de saule blanc en la nommant salicine. Trois ans plus tard, un pharmacologue allemand obtient des cristaux jaunes à partir d’écorce de saule blanc. Enfin, en 1829, un pharmacien français nommé Pierre Joseph Ledoux améliore le procédé pour obtenir une poudre blanche qu’il nomme salicylique.
Il faut attendre 1897 pour que deux chimistes de la firme Bayer, Félix Hoffmann et Arthur Eichegrün, obtiennent de l’acide acétylsalicylique sous une forme stable et bien moins irritable pour l’estomac. L’aspirine était née.
Le brevet fut déposé en 1900 et la commercialisation débuta en 1901 par Bayer. Celle-ci attribua la paternité du médicament au seul Félix Hoffmann. Il y avait là quelque chose d’injuste puisque ce dernier, récemment engagé par la firme, n’avait fait que travailler sous les ordres d’Eichegrün. L’un était juif et l’autre pas.
Chacun peut donc l’utiliser. Aussitôt, la Société chimique des usines du Rhône rebaptise la Rhodine, Aspirine Usine du Rhône. Mais Bayer n’a pas dit son dernier mot. En juin 1940, quand l’armistice est signé, Bayer oblige Rhône Poulenc qui a absorbé les Usines du Rhône, à lui verser une redevance. Celle-ci le sera jusqu’à la défaite de l’Allemagne en 1945.
Aujourd’hui, l’aspirine s’est un peu effacée devant le paracétamol et l’ibuprofene plus efficaces et moins nocifs. Néanmoins, l’aspirine continue à être prescrite dans certains cas comme la thrombose cardiaque.
Frédéric Lowino Le Point 8 07 2024
L’histoire de la médecine, fleuve interminable d’idées et d’actes, est partie intégrante et utile de l’histoire générale. Comment les hommes étaient-ils soignés ? Comment les médecins abordaient-ils la connaissance des corps, des maladies, de la santé ? Comment les autorités, celles des villes notamment, concevaient-elles la protection, la surveillance et l’amélioration de la santé publique ? Tout cela a un prix inestimable pour l’histoire des sociétés.
En outre, ce long passé de la médecine, sans fin diffusé à travers l’histoire générale qui l’accompagne, n’est pas sans mettre en lumière certains traits et structures de sa nature, même actuelle. Qui lira les beaux livres de Georges Canguilhem, philosophe et historien des sciences, saura que la médecine d’aujourd’hui, qui se veut science et expérimentation, rien de plus, rien de moins, est encore traversée de concepts a priori, tout comme au temps du vitalisme de Marie François Xavier Bichat (1771 – 1802), pourrait-on dire de mythes, pour reprendre, une fois de plus, un mot du professeur Sournia. N’empêche que les mythes, si mythes il y a, se remplacent aujourd’hui à vive allure et que l’étude des mécanismes de la vie et de la cellule progresse de façon accélérée et révolutionnaire.
La cassure, la mutation fondamentale date du milieu du XIX° siècle. En quelques années s’accomplissait alors une révolution profonde. Comme le remarque le professeur Jean Bernard, le médecin n’a acquis l’efficacité rationnelle qu’au milieu du XIX° siècle, avec l’émergence, en seulement six ans (1859 – 1865), de découvertes aussi fondamentales que celles de Darwin, de Pasteur, de Mendel, de Claude Bernard, qui devaient donner naissance à la médecine moderne et à la révolution biologique qui s’opère sous nos yeux. Aux noms qu’énumère Jean Bernard, ajoutons au moins, en exergue, celui de François Magendie (1783 – 1855) qui fut le maître et le précurseur de Claude Bernard, au Collège de France. Au lendemain de la Révolution française qui avait entraîné dans ses ruines l’ancienne Faculté de Médecine, il s’abandonna à corps perdu à la passion absolue du nouveau et, de ce fait, à une polémique sans relâche et sans merci contre les uns et contre les autres. En fait, il aura ouvert la médecine et la physiologie sur ces sciences déjà formées qu’étaient alors la physique et la chimie. Acte salutaire : il a fondé, du coup, la médecine expérimentale. En raison d’un tel exploit, il s’affirme unique dans la chaîne des esprits novateurs, au même titre qu’Evariste Galois (1811 – 1832), plus jeune que lui, mathématicien génial tué en duel, à vingt ans, et qui eut seulement le temps de formuler, dans un ultime mémoire, la théorie moderne des fonctions algébriques.
Nul plus que Magendie – et, avec lui, Claude Bernard (1813 – 1878) – n’aura eu le sentiment de vivre une époque nouvelle, révolutionnaire de la médecine. De Magendie, Emile Littré (1801 – 1881) disait, au lendemain de sa mort : Il était étranger, hostile même à toute histoire… Les systèmes du passé, le mode de raisonner, le mode d’expérimenter, les tendances, tout lui semblait indigne de l’attention d’un homme sérieux. Pour lui, la science n’avait pas de racines dans les âges antérieurs. [Émile Littré était lexicologue en toute circonstance, de jour comme de nuit : découvert au lit avec la bonne, sa femme se dit surprise : erreur, Madame, vous êtes étonnée, c’est nous qui sommes surpris. ndlr]. Claude Bernard pensait à l’unisson, qui affirmait sans hésiter que la science du présent est nécessairement au-dessus de celle du passé et il n’y a aucune espèce de raison d’aller chercher un accroissement de la science moderne dans les connaissances des anciens. Leurs théories, nécessairement fausses puisqu’elles ne renferment pas les faits découverts depuis, ne sauraient avoir aucun profit réel pour les sciences actuelles.
Comprenons ces paroles injustes : Magendie et Bernard s’acharnent avec passion à construire une science médicale fille exclusive de l’expérience. Révolutionnaires au sens fort du terme, il leur faut lutter contre un Ancien Régime qui les entoure et colonise jusqu’à l’absurde les institutions, les hôpitaux, les chaires, les enseignements… D’ailleurs, après eux, leur révolution sera lente encore à se mettre vraiment en place, comme toute révolution en profondeur. D’autant que la physique, la chimie, la biologie – bases essentielles – sont elles-mêmes des sciences en train de se faire, avec leurs retards, leurs avances et leurs limites. La nouvelle médecine se fabriquera, s’imaginera au ralenti, grâce à la clinique hospitalière, ensuite grâce à la médecine de laboratoire. Et cette médecine ne sera efficace que reprise, épaulée par l’État et les institutions élargies de la Santé Publique.
Fernand Braudel. L’identité de la France. Arthaud Flammarion 1986
Les Hollandais font travailler des esclaves ghanéens dans leurs plantations de canne à sucre en Indonésie. Quand ils s’affranchissent, ils rentrent au Ghana, le balluchon empli de batiks industriels fabriqués par Vlisco : c’est le wax qui va séduire toute l’Afrique. D’origine javanaise, le batik, tissu teint selon un procédé basé sur l’application de cire, est entièrement fait main ; les dessins sont tracés à l’aide d’un canting, – une sorte de stylet en cuivre – en creusant la cire dont les cotons ou les soies sont enduits. Un seul beau sarong peut demander une année pour être fabriqué. En 1844, Peter Fentener Van Vlissingen avait repris la manufacture de coton de son père à Helmond, aux Pays Bas, qui deviendra Vlisco. Et tout va changer quand son oncle, propriétaire d’une plantation de canne à sucre en Indonésie lui envoie des batiks dont il va industrialiser la fabrication avec la Perrotine, une presse d’impression mise au point en 1834 par Perrot. La Gold Coast devient alors l’un des premiers clients de la manufacture néerlandaise, qui se répand dans tout l’Afrique par le dynamisme des Mamma Benz, dont l’opulente poitrine est en grande partie constituée des billets de banque qui leur restent une fois qu’elle ont acheté leur Mercedes Benz. Ils sont plutôt nombreux à s’arracher les cheveux les comptables qui se demandent comment font ces femmes pour gérer leurs affaires, sans jamais tenir un seul livre de comptes… elles ont tout ça en tête, bien rangé… et ça marche très bien ! Quand la mémoire naturelle fait la pige à l’I.A. ! Aujourd’hui Vlisco produit 70 millions de mètres de wax, dont 90 % partent en Afrique. Mais en France, le vrai wax ne représente que 4 % du marché, les 96 % restant étant de la contre-façon chinoise.


3 01 1854
Flaubert dit à Louise Collet sa répulsion pour les honneurs, les flonflons et les décorations : […] Pour ce qui est de moi, tu comprends que je n’écrirai pas plus dans ton journal que dans un autre. À quoi bon ? Et en quoi cela m’avancerait-il ? S’il faut, quand je serai à Paris t’expédier des articles pour t’obliger, de grand cœur. Mais quant à signer, non. Voilà vingt ans que je garde mon pucelage. Le public l’aura tout entier et d’un seul coup ou pas. D’ici là, je le soigne. Je suis bien décidé d’ailleurs à n’écrire par la suite dans aucun journal, fut-même la Revue des deux mondes, si on me le proposait. Je veux ne faire partie de rien, n’être membre d’aucune académie, d’aucune corporation, ni association quelconque. Je hais le troupeau, la règle et le niveau. Bédouin, tant qu’il vous plaira ; citoyen, jamais. J’aurai même grand soin, dût-il m’en coûter cher, de mettre à la première page de mes livres que la reproduction en est permise, afin qu’on voie que je ne suis pas de la Société des gens de lettres, car j’en renie le titre d’avance, et je prendrai vis-à-vis de mon concierge plutôt celui de négociant ou de chasublier. Ah ! Ah ! je n’aurai pas tourné dans ma cage pendant un quart de siècle, et avec plus d’aspirations à la liberté que les tigres du Jardin des Plantes, pour m’atteler ensuite à un omnibus et trottiner d’un pas tranquille sur le macadam commun. Non, non. Je crèverai dans mon coin, comme un ours galeux. Ou bien l’on se dérangera pour voir l’ours. […]
Il me reste à peine assez de place pour te dire que ton G. t’embrasse.
01 1854
Les Indiens Duwamish et Suquamish remettent leurs terres au gouvernement des États Unis, et c’est leur chef Lumi Seattle [ou Lumi Sealth] qui s’adresse à Isaac Stevens, commissaire des Affaires indiennes pour le nouveau territoire de Washington :
Comment pouvez-vous acheter ou vendre le ciel, la chaleur de la terre ?
L’idée nous paraît étrange. Si nous ne possédons pas la fraîcheur de l’air et le miroitement de l’eau, comment est-ce que vous pouvez les acheter ?
Chaque parcelle de cette terre est sacrée pour mon peuple.
Chaque aiguille de pin luisante, chaque rive sableuse, chaque lambeau de brume dans les bois sombres, chaque clairière et chaque bourdonnement d’insecte sont sacrés dans le souvenir et l’expérience de mon peuple.
La sève qui coule dans les arbres transporte les souvenirs de l’homme rouge.
Les morts des hommes blancs oublient le pays de leur naissance lorsqu’ils vont se promener parmi les étoiles. Nos morts n’oublient jamais cette terre magnifique, car elle est la mère de l’homme rouge. Nous sommes une partie de la terre, et elle fait partie de nous. Les fleurs parfumées sont nos sœurs ; le cerf, le cheval, le grand aigle, ce sont nos frères. Les crêtes rocheuses, les sucs dans les prés, la chaleur du poney, et l’homme, tous appartiennent à la même famille.
Aussi lorsque le Grand chef à Washington envoie dire qu’il veut acheter notre terre, demande-t-il beaucoup de nous. Le Grand chef envoie dire qu’il nous réservera un endroit de façon que nous puissions vivre confortablement entre nous. Il sera notre père et nous serons ses enfants. Nous considérons donc, votre offre d’acheter notre terre. Mais ce ne sera pas facile. Car cette terre nous est sacrée.
Cette eau scintillante qui coule dans les ruisseaux et les rivières, n’est pas seulement de l’eau mais le sang de nos ancêtres. Si nous vous vendons de la terre, vous devez vous rappeler qu’elle est sacrée et que chaque reflet spectral dans l’eau claire des lacs parle d’événements et de souvenirs de la vie de mon peuple. Le murmure de l’eau est la voix du père de mon père.
Les rivières sont nos frères, elles étanchent notre soif. Les rivières portent nos canoës, et nourrissent nos enfants. Si nous vous vendons notre terre, vous devez désormais vous rappeler, et l’enseigner à vos enfants, que les rivières sont nos frères et les vôtres, et vous devez désormais montrer pour les rivières la tendresse que vous montreriez pour un frère. Nous savons que l’homme blanc ne comprend pas nos mœurs. Une parcelle de terre ressemble pour lui à la suivante, car c’est un étranger qui arrive dans la nuit et prend à la terre ce dont il a besoin. La terre n’est pas son frère, mais son ennemi, et lorsqu’il l’a conquise, il va plus loin. Il abandonne la tombe de ses aïeux, et cela ne le tracasse pas. Il enlève la terre à ses enfants et cela ne le tracasse pas. La tombe de ses aïeux et le patrimoine de ses enfants tombent dans l’oubli. Il traite sa mère, la terre, et son frère, le ciel, comme des choses à acheter, piller, vendre comme les moutons ou les perles brillantes. Son appétit dévorera la terre et ne laissera derrière lui qu’un désert.
Il n’y a pas d’endroit paisible dans les villes de l’homme blanc. Pas d’endroit pour entendre les feuilles se dérouler au printemps, ou le froissement des ailes d’un insecte. Mais peut-être est-ce parce que je suis un sauvage et ne comprends pas. Le vacarme semble seulement insulter les oreilles. Et quel intérêt y a-t-il à vivre si l’homme ne peut entendre le cri solitaire de l’engoulevent ou les palabres des grenouilles autour d’un étang la nuit ? Je suis un homme rouge et ne comprends pas.
L’Indien préfère le son doux du vent s’élançant au-dessus de la face d’un étang, et l’odeur du vent lui-même, lavé par la pluie de midi, ou parfumé par le pin pignon. L’air est précieux à l’homme rouge, car toutes choses partagent le même souffle. La bête, l’arbre, l’homme. Ils partagent tous le même souffle. L’homme blanc ne semble pas remarquer l’air qu’il respire. Comme un homme qui met plusieurs jours à expirer, il est insensible à la puanteur.
Mais si nous vous vendons notre terre, vous devez vous rappeler que l’air nous est précieux, que l’air partage son esprit avec tout ce qu’il fait vivre. Le vent qui a donné à notre grand-père son premier souffle a aussi reçu son dernier soupir. Et si nous vous vendons notre terre, vous devez la garder à part et la tenir pour sacrée, comme un endroit où même l’homme blanc peut aller goûter le vent adouci par les fleurs des prés. Nous considérerons donc votre offre d’acheter notre terre.
Mais si nous décidons de l’accepter, j’y mettrai une condition : l’homme blanc devra traiter les bêtes de cette terre comme ses frères. Je suis un sauvage et je ne connais pas d’autre façon de vivre.
J’ai vu un millier de bisons pourrissant sur la prairie, abandonnés par l’homme blanc qui les avait abattus d’un train qui passait. Je suis un sauvage et ne comprends pas comment le cheval de fer fumant peut être plus important que le bison que nous ne tuons que pour subsister.
Qu’est-ce que l’homme sans les bêtes ? Si toutes les bêtes disparaissaient, l’homme mourrait d’une grande solitude de l’esprit. Car ce qui arrive aux bêtes, arrive bientôt à l’homme. Toutes choses se tiennent.
Vous devez apprendre à vos enfants que le sol qu’ils foulent est fait des cendres de nos aïeux. Pour qu’ils respectent la terre, dites à vos enfants qu’elle est enrichie par les vies de notre race. Enseignez à vos enfants ce que nous avons enseigné aux nôtres, que la terre est notre mère. Tout ce qui arrive à la terre, arrive aux fils de la terre. Si les hommes crachent sur le sol, ils crachent sur eux-mêmes.
Nous savons au moins ceci : la terre n’appartient pas à l’homme ; l’homme appartient à la terre. Cela, nous le savons. Toutes choses se tiennent comme le sang qui unit une même famille. Toutes choses se tiennent.
Tout ce qui arrive à la terre, arrive aux fils de la terre. Ce n’est pas l’homme qui a tissé la trame de la vie : il en est seulement un fil. Tout ce qu’il fait à la trame, il le fait à lui-même.
Même l’homme blanc, dont le dieu se promène et parle avec lui comme deux amis ensemble, ne peut être dispensé de la destinée commune. Après tout, nous sommes peut-être frères. Nous verrons bien. Il y a une chose que nous savons, et que l’homme blanc découvrira peut-être un jour, c’est que notre dieu est le même dieu. Il se peut que vous pensiez maintenant le posséder comme vous voulez posséder notre terre, mais vous ne pouvez pas. Il est le dieu de l’homme, et sa pitié est égale pour l’homme rouge et le blanc.
Cette terre lui est précieuse, et nuire à la terre, c’est accabler de mépris son créateur. Les Blancs aussi disparaîtront ; peut-être plus tôt que toutes les autres tribus. Contaminez votre lit, et vous suffoquerez une nuit dans vos propres détritus. Mais en mourant vous brillerez avec éclat, ardents de la force du dieu qui vous a amenés jusqu’à cette terre et qui pour quelque dessein particulier vous a fait dominer cette terre et l’homme rouge.
Cette destinée est un mystère pour nous, car nous ne comprenons pas lorsque les bisons sont tous massacrés, les chevaux sauvages domptés, les coins secrets de la forêt chargés du fumet de beaucoup d’hommes, et la vue des collines en pleines fleurs ternie par des fils qui parlent.
Où est le hallier ? Disparu. Où est l’aigle ? Disparu.
Le texte est très beau, il attire la sympathie, mais son authenticité a tout de même été bien mise à mal. Tout d’abord, il n’y a pas eu de retranscription écrite lors de la rencontre entre le chef amérindien et le chargé d’Affaires indiennes. Néanmoins, on trouve bien une trace écrite des paroles du chef Seattle, dans le journal Seattle Sunday Star, mais… 32 ans plus tard. Le journal a publié une retranscription du discours signée du Docteur Henry Smith, qui était physiquement présent lors de la rencontre. Mais elle n’est qu’une version inexacte et biaisée du discours du chef, basée sur des souvenirs subjectifs. Les archives nationales américaines reconnaissent elles-mêmes que le style du texte du Docteur Smith est très victorien et qu’il est peu probable qu’il concorde avec la manière dont le chef Seattle s’exprimait.
On peut aussi rappeler que le chef amérindien ne parlait pas l’anglais et discourait plutôt en lushootseed, dialecte qui était lui-même traduit en jargon chinook avant d’être traduit une nouvelle fois en anglais. La pertinence de la transcription des pensées du chef Seattle dépendait des compétences des traducteurs, qui pouvaient y ajouter aussi leur touche stylistique personnelle.
Le texte a refait surface à l’occasion du premier Jour de la Terre, en avril 1970 : William Arrowsmith, professeur de littérature à l’université du Texas, lit un texte, quelque peu arrangé par Henri Smith, journaliste au Seattle Sunday Star à partir de notes prises en 1854, et publiées dans le journal du 29 octobre 1887, soit 33 ans après les faits. Ces notes reprennent pour le fond le discours de Seattle (qui laissa son nom à la ville).
Dans la salle se trouve Ted Perry, scénariste d’un film sur l’environnement commandé par la Southern Baptist Television Commission. Il estime qu’il faut garder l’esprit du discours, mais qu’une réécriture est nécessaire et qu’en même temps il faut continuer à l’attribuer à Seattle. Cet arrangement sera cité par Al Gore dans son livre Sauver la planète Terre en 1992. En avril 1992, le New York Times révélera qu’il était bien éloigné de la réalité de 1854 : J’ai vu un millier de bisons pourrissant sur la prairie, abandonnés par l’homme blanc qui les avait abattus d’un train qui passait. C’est tout de même un peu embêtant car, à cette époque, il n’y avait pas de bisons dans cette région pas plus d’ailleurs que de train… qui est arrivé 16 ans plus tard, en 1870 ; la vue des collines en pleines fleurs ternie par des fils qui parlent ? C’est encore embêtant car le téléphone n’était pas inventé. Dommage que Ted Perry ait été aussi bidouilleur ; il a adapté, arrangé ce texte comme les réalisateurs d’Hollywood traficotaient la réalité historique pour faire des péplums dans les années 60. Dommage, car pour le fond, l’idée qu’un WASP ait pu écrire un si beau discours en le prêtant à l’Indien Seattle dit bien dans quelle estime il tient aujourd’hui l’Indien après des décennies de mépris. Le petit tour de passe-passe sera couronné de succès, au delà de toute espérance, puisque ces paroles deviendront pour tous les écologistes le legs de la sagesse écologiste indienne aux hommes blancs destructeurs… Se non e vero, e ben trovato….
On peut lire un recueil de textes indiens exprimant la même sensibilité dans le recueil Pieds nus sur la Terre sacrée, Denoël, 1971.

Seattle (1786 – 1866), chef de six tribus indiennes établies dans l’actuel État de Washington, dont les Dumawish et Suquamish, photographié en 1864. L.B. Franklin Sammis, Museum of History and Industry, Seattle

Le général Custer dicte ses conditions aux Indiens
21 05 1854
Réunis au château de Font Ségugne à Châteauneuf de Gadagne, près d’Avignon, Théodore Aubanel, Jean Brunet, Paul Giera, Anselme Mathieu, Joseph Roumanille, Alphonse Tavan et Frédéric Mistral, jurent d’assurer le renouveau provençal en sauvegardant et promouvant la langue et tout ço que counstituïs l’èime naciounau. Frédéric Mistral, jeune poète de 25 ans né à Maillanes, conforte ainsi sa volonté de raviver en Provence le sentiment d’appartenance, de restaurer la langue naturelle et historique du pays et de rendre la vogue au provençal par l’influx et la flamme de la divine poésie, [Jacques Mouttet]. C’est le Félibrige.
10 06 1854
Quarante mille personnes plus la reine Victoria se pressent dans les jardins du Crystal Palace pour s’extasier devant des dinosaures en ciment, brique et acier, grandeur nature, construits par Benjamin Waterhouse Hawkins, avec la complicité de Richard Owen, le Cuvier britannique : Il faut redonner vie au monde ancien, arracher aux profondeurs du temps et de la terre ces formes vastes et ces bêtes gigantesques que le Créateur a désignées pour nous précéder dans la possession de cette partie du monde que l’on appelle la Grande Bretagne.
17 09 1854
Le nombre des sergents de ville en charge de la surveillance des arrondissements de Paris, passe de 915, soit un pour 1 150 habitants à 2 876, soit un pour 365 habitants. À la veille de l’Exposition Universelle de 1867, cet effectif passera à 5 768 hommes, soit un pour 350 habitant, pour respecter au mieux l’agrandissement de la ville
27 09 1854
L’Artic, un navire en bois à roues à aubes de 87 m de long, non équipé de compartiments étanches, 2 850 tonnes, assure le transport de 250 à 300 passagers, dont au moins 100 femmes et enfants de l’Europe à l’Amérique pour la Collins, où il n’y avait pas de place pour des capitaines trop prudents. L’équipage compte 150 hommes. Et ce jour-là, comme souvent, il y avait du brouillard au large de Terre Neuve généré par le croisement du courant froid du Labrador et du Gulf Stream. Le radar n’existait pas encore. Le Vesta, un vapeur français à hélice et en fer, équipé de compartiments étanches, appartenant à une compagnie de pêche pour transporter son personnel, passait par là, et c’est la collision. L’Artic est touché sous la ligne de flottaison, ce que le commandant mit un moment à réaliser, car le choc n’avait pas fait grand bruit, à telle enseigne que, dans un premier temps il se porta au secours du Vesta apparemment plus atteint, mais apparemment seulement. L’Artic coula quatre heures et demi après la collision. La mise à l’eau des chaloupes se fit dans la confusion et, au final il n’y eut que 88 survivants, et entre 285 et 372 morts. Au départ un certain nombre de femmes montèrent dans les chaloupes, mais en fin de compte, elles ne contenaient plus que des hommes, essentiellement des hommes d’équipage. Deux chaloupes parvinrent le 29 septembre à Broad Cave, 80 kilomètres au sud de Saint Jean de Terre Neuve. Les autres furent perdues corps et biens. Le Vesta, grâce à ses compartiments étanches, resta à flots et parvint à regagner Saint Jean de Terre Neuve avec son équipage presque au complet le 30 septembre. Le comportement condamnable de l’équipage de l’Artic ne donna lieu à aucun procès, aucune inculpation.

09 1854
Louis Vuitton, fraîchement débarqué de son Jura natal pour être employé de l’emballeur de la cour impériale, fonde sa propre maison qui, au XXI° siècle, pourra s’enorgueillir de figurer régulièrement au hit-parade des produits de luxe dont la contrefaçon inonde le marché, fabriquée dans les pays à faible coût de main d’œuvre… cruelle rançon du succès.
16 10 1854
Lincoln se prononce sur l’esclavage : Il faut dépouiller l’esclavage de sa prétention au droit moral, et le faire reculer vers ses droits légaux, le replacer sur le terrain où nos pères l’avaient mis, et le laisser en paix.
Abraham Lincoln, discours à Peoria
25 10 1854
Guerre de Crimée. Le tzar Nicolas I° avait voulu tailler des croupières à l’empire turc et pour cela avait prétexté une nécessaire protection des orthodoxes. Plus précisément, la querelle sur les droits des catholiques et des orthodoxes sur l’église du Saint Sépulcre de Jérusalem avait contribué pour une large part à l’affaire. Il avait par ailleurs mésestimé gravement les volontés anglaise comme française de préserver l’intégrité de cet empire. L’Angleterre, la France et … le royaume de Sardaigne, lui déclarèrent la guerre en envoyant d’importants contingents pour aider les Turcs. Le gouvernement pour ce faire avait lancé un emprunt en mars 1854 pour un montant de 250 millions : et c’est 467 millions qui avaient été encaissés venant de 18 000 souscripteurs. À court de grands navires, la France avait affrété pour le transport de ses troupes (200 000 hommes) le plus grand navire du monde, l’américain Great Republic, un quatre mâts barque à même d’envoyer 5 800 m² de toile ! Elle avait tout de même quelques navires à la pointe du progrès, tels ce Napoléon, conçu par Dupuy de Lôme, premier navire de guerre encore en bois mais déjà à vapeur, muni d’une hélice venant avantageusement remplacer les roues à aube, sur lequel les voiles ne venaient qu’en appoint du moteur : 73 mètres de long, 17 mètres de large, 90 canons sur deux ponts, déplacement de 5 000 tonnes, vitesse maximum : 13.8 nœuds. Il s’avérera aussi très utile pour remorquer les autres navires français à voile à travers le Bosphore, suivant la ligne la plus courte, sans avoir à prendre en compte la direction des vents.

Le Napoléon, par Barthélemy Lauvergne



La volonté de s’assurer l’alliance anglaise, de la conforter et de la faire vivre est probablement l’un des motifs de la décision prise par Louis Napoléon de s’engager aux côtés des Anglais, dans la guerre de Crimée, contre les Russes. Décision paradoxale : Louis Napoléon, jeune homme, n’avait-il pas songé à s’engager dans les troupes russes contre les Turcs ? Le voici allié du sultan contre le tsar.
Guerre inattendue mais importante : il s’agit du premier conflit européen depuis 1815. Ainsi, la Crimée marque, non seulement, l’entrée en scène de Louis Napoléon sur le théâtre extérieur, mais aussi et surtout le grand retour de la France dans le concert international en même temps que le premier vacillement de l’Europe du congrès de Vienne. Guerre bizarre que personne ne semble avoir vraiment voulue et qu’on ne sait au juste comment mener, faute de frontières communes et de buts territoriaux précis.
Il n’empêche qu’à partir d’une dispute entre moines catholiques et orthodoxes pour le contrôle de quelques sanctuaires des Lieux saints, dispute arbitrée par le sultan dans un sens qui déplaît au tsar, les événements s’enchaînent, se précipitent et s’emballent.
Nicolas I° revendique le droit de protéger les chrétiens orthodoxes de l’Empire ottoman, donnant à croire qu’il se propose de dépecer l’homme malade de l’Europe, et d’en profiter pour accéder enfin – vieux rêve – à la Méditerranée par les Détroits. C’est plus que ne peuvent admettre les Anglais qui ne veulent pas de marine russe en Méditerranée et qui, comme les Autrichiens, ne souhaitent pas livrer les Balkans aux ambitions du tsar.
Bien qu’il n’ait pas été concerné directement par la première phase du conflit, Louis Napoléon n’en va pas moins s’associer à l’Angleterre pour déclarer la guerre à la Russie, en mars 1854. Sans doute y voit-il une bonne occasion de rompre le front européen de 1815 et d’indiquer par avance sa place dans la cause des nationalités. Il est vrai que, s’agissant des Balkans, ce n’est pas l’ouvrage qui manque… Devant les Chambres, il prend donc soin de préciser qu’il s’agit d’une guerre idéologique, et non de conquête : La France n’a aucune idée d’agrandissement, elle veut uniquement résister à des empiètements dangereux. Aussi, j’aime à le proclamer hautement, le temps des conquêtes est passé sans retour, car ce n’est pas en reculant les limites de son territoire qu’une nation peut désormais être honorée et puissante, c’est en se mettant à la tête des idées généreuses, en faisant prévaloir partout l’emprise du droit et de la justice.
Une chose est de déclarer la guerre, une autre de la faire. Là commencent les difficultés.
Aucun des belligérants n’avait rien envisagé d’autre que des opérations limitées, destinées à imposer la négociation et à en préparer les termes de manière avantageuse. C’est ce qui explique que Louis Napoléon, au départ, ne songe pas un instant à prendre le commandement des troupes françaises et délègue sur place Saint-Arnaud.
S’engage alors, au début tout au moins, une drôle de guerre. Les Russes, qui avaient occupé, en juillet 1853, les provinces danubiennes de Moldavie et de Valachie, les évacuent sans combat. De leur côté, les Autrichiens qui, en août 1854, avaient pris pied dans les provinces roumaines, sont contraints de s’en retirer à la suite des manœuvres que conduisent les Prussiens à la Diète de la Confédération, laquelle va refuser son consentement à la guerre. Berlin veut empêcher, en effet, les Habsbourg d’accroître leur influence sur l’Allemagne à la faveur d’un succès extérieur.
Un corps est bien envoyé en Dobroudja mais les Russes ne s’y trouvent déjà plus. La situation serait cocasse si le choléra ne s’était déclaré, qui fait des ravages : Saint-Arnaud, lui-même, est atteint. L’impasse est donc complète. On ne peut cependant décemment rebrousser chemin sans combattre et sans avoir, à tout le moins, enregistré des propositions de paix du tsar.
Alors, faute de mieux, Français et Anglais, sur la suggestion personnelle de Louis Napoléon, décident d’aller détruire le principal arsenal russe de la mer Noire, installé à Sébastopol. En septembre 1854, un débarquement a lieu sur la presqu’île de Crimée. Au cours de leur marche vers Sébastopol, les Franco-Anglais remportent une belle victoire sur l’Alma, grâce aux zouaves du général Bousquet, qui entreront ainsi dans la légende.
Première victoire, il est vrai, première grande victoire depuis si longtemps ! Le bulletin adressé après la bataille par Saint Arnaud fleure bon le style impérial de jadis : Sire, le canon de votre majesté a parlé. Nous avons remporté une victoire complète. Votre majesté peut être fière de ses soldats. Ils n’ont point dégénéré : ce sont ceux d’Austerlitz et d’Iéna. Jamais je n’ai vu d’enthousiasme pareil. Le cri de Vive l’Empereur a retenti toute la journée ; les blessés se soulevaient de terre pour crier […]. Les zouaves se sont fait admirer des deux Armées. Nos soldats sont les premiers du monde.
Malheureusement, cette victoire est mal exploitée. Saint Arnaud se meurt ; quant au prince Napoléon Jérôme, qui représentait la famille sur le champ de bataille, il décide tout bonnement de rentrer à la maison. [son surnom de Plon-Plon évoluera alors en Craint-Plomb. ndlr]
Du coup, la place qui paraissait s’offrir sans résistance va pouvoir renforcer ses fortifications et, au lieu du succès foudroyant qu’on attendait, c’est un long siège qui commence… Un siège, où, du fait de la configuration du terrain, l’on ne sait plus au juste qui est l’assiégeant et qui est l’assiégé. Malgré des renforts français, malgré l’arrivée d’un contingent de quinze mille Piémontais – que Louis Napoléon a persuadé de s’engager pour mieux asseoir les revendication italiennes -, malgré une opportune supériorité navale, le désastre n’est pas loin. Au moins autant que l’adversaire, l’inadaptation de leur équipement, le froid glacial, le scorbut usent les forces des Français, Anglais, et Piémontais.
C’est trop bête… Louis Napoléon manifeste la nervosité et l’impatience du néophyte. C’est la première guerre qu’il doit conduire, et le pire lui paraît à craindre. Il est vrai qu’il est loin du théâtre des opérations, que les nouvelles arrivent mal, et que, de surcroît, elles ne sont pas bonnes…
Peu confiant en Canrobert, qui a remplacé saint Arnaud, Louis Napoléon dépêche donc sur place Niel pour prendre la mesure de la situation. Il souhaiterait qu’on tente de détruire les armées russes de secours plutôt que de se confiner dans les tranchées. Bientôt, c’est bien dans sa manière, il envisage de se rendre lui-même sur place. Ce serait un bon moyen d’unifier le commandement, dont la dualité n’arrange évidemment rien. Il rêve d’attirer à lui l’empereur de Russie en personne qui ne pourrait faire moins que de l’imiter. Ainsi ferait-il coup double : il le battrait et le forcerait à négocier, là, sur le terrain. Un tel programme, pour hypothétique que soient ses chances de succès, n’a rien qui soit de nature à réjouir les Anglais. Un triomphe pour Louis Napoléon n’arrangerait pas leurs affaires.
Victoria elle-même va se charger de dissuader l’empereur, déjà en butte, on l’a vu, aux réactions affolées de son entourage : et s’il lui arrivait malheur ?
Il se contente donc, en juin 1855, de remplacer Canrobert par Pélissier, le fil télégraphe direct dont il dispose désormais lui permettant de harceler son nouveau commandant en chef. Pélissier, qui en a vu d’autres, n’en fait qu’à sa tête. Il n’a pas tort : le 8 septembre 1855, Mac Mahon prend enfin la tour de Malakoff, ce qui entraîne l’évacuation de Sébastopol par les Russes après trois cent cinquante jours de siège.
Militairement, l’objectif est atteint. Politiquement, l’effet produit est considérable. À l’extérieur, la France en tire un bénéfice qui est à la mesure de son engagement et que nul ne peut lui contester. À l’intérieur, le pays a le sentiment de renouer avec la gloire d’antan : le plus important des événements militaires depuis Waterloo se solde par une victoire [chèrement payée : 15 000 morts et blessés ! ndlr]. On se croirait revenu près de cinquante ans en arrière : même fournée de maréchaux ; même baptême de ponts et de boulevards sous l’invocation de ces sites lointains où viennent de s’illustrer nos armées.
En de tels instants, Louis Napoléon se prend probablement à rêver : il a d’excellents atouts entre les mains, face au tsar Alexandre qui a succédé à son père en pleine bataille. Si d’aventure on pouvait persuader l’Autriche d’entrer enfin dans la guerre, le moment serait peut-être venu de lancer un appel général aux nationalités, en commençant par la Pologne, de valeur hautement symbolique.
Et c’est pourquoi précisément l’Autriche, au lieu de se lancer dans la mêlée, va faire pression sur la Russie pour arrêter les frais. Qu’il faille payer la victoire des alliés par certains arrangements, passe encore, mais à condition de ne pas les pousser trop loin.
Tous rêves écartés, il reste que Louis Napoléon peut se considérer comme un vainqueur : le congrès va se tenir à Paris, sous la présidence d’un ministre français. Et, face à une Russie vaincue, qui songe à se réformer en se repliant sur elle-même, à un allié anglais que ses ennuis dans les Indes commencent à accaparer, à une Autriche affaiblie par l’ambiguïté de ses positions, à une Prusse demeurée simple spectatrice, c’est le message de la France qui va compter.
Les buts de guerre, évidemment, sont atteints : l’Empire ottoman voit son intégrité reconnue, avec en prime un rôle prépondérant accordé à la France dans la garantie de ce statut : les Détroits sont fermés, la mer Noire est neutralisée, la libre circulation sur le Danube garantie.
Cependant, chacun sent bien que, pour satisfaire Louis Napoléon, dans la position de force qui est la sienne, il faut aller au-delà, mais si possible sans excès.
On va donc sacrifier implicitement au principe des nationalités, en reconnaissant leur autonomie aux provinces serbe et roumaine. La Valachie et la Moldavie, tout en restant dans l’Empire ottoman, se voient accorder des libertés internes qui, avec le parrainage de Louis Napoléon, déboucheront en 1861 sur un État unifié, la toute nouvelle Roumanie.
S’agissant du Monténégro et de la Serbie les bases sont jetées pour l’indépendance de celui-là, en 1857, et pour une évolution décisive de celle-ci.
Louis Napoléon aurait sûrement souhaité davantage, mais doit se contenter, pour l’heure, des moyens d’une intervention directe et positive dans les Balkans. Au moins obtient-il le droit pour Cavour d’exprimer les aspirations piémontaises. Ainsi, date est prise pour la suite des événements.
Philippe Seguin. Louis Napoléon le Grand. Grasset 1990
Le major général James Thomas Brudenell, comte de Cardigan, commande les 4° et 13° régiments de dragons légers, le 17° régiment de lanciers et les 8° et 11° régiments de hussards : cela fait 673 cavaliers qui, à cause d’une erreur de transmission d’ordre, se lancent à l’assaut des lignes russes : c’est la fameuse charge de la brigade légère : un massacre surtout de chevaux mais aussi d’hommes.
Nous pouvions difficilement croire au témoignage de nos sens ! Forcément, cette poignée d’hommes n’allait pas charger des ennemis en position ? Hélas, ce n’est que trop vrai… Ils ont avancé sur deux lignes, accélérant le rythme au fur et à mesure qu’ils se rapprochaient de l’ennemi… À 400 mètres, toute la ligne ennemie vomissait, depuis trente bouches de fer, un nuage de fumée et de flammes dans lequel sifflaient les balles mortelles.
London Illustrated News
Lord Cardigan en réchappe et, de retour au camp, abandonne les survivants pour regagner son yacht, le Dryad, qu’il a fait venir d’Angleterre !
La guerre de Crimée précipite l’évolution technologique des marines de guerre. La vapeur impose d’abord son avantage sur la voile. À plusieurs reprises au cours du conflit, des bâtiments à vapeur remorquent des grands vaisseaux de ligne paralysés par des vents et des courants contraires. C’est également la flotte à vapeur qui assure le ravitaillement des troupes engagées en Crimée, avec une rapidité et une régularité que l’on n’aurait pas pu attendre des bateaux à voile.
Cette guerre démontre aussi la formidable supériorité de l’obus, projectile explosif, sur le boulet. Le 17 octobre 1854, la flotte franco-anglaise tente de réduire la forteresse de Sébastopol, ce port de guerre russe situé sur la mer Noire ; elle tire sans résultat 40 000 boulets contre les redoutables fortifications russes. En revanche, les vaisseaux franco-anglais sont soumis au feu dévastateur des obusiers des forts de Sébastopol : à bord de la Ville de Paris, l’explosion d’un obus sur le pont arrière entraîne la mort de tout l’état-major, à l’exception de l’amiral Bruat, chef de la flotte française en Crimée ; l’escadre se retire et plusieurs navires désemparés sont pris en remorque.
Pour répondre aux canons de Sébastopol, les alliés franco-anglais entreprennent très vite la construction de batteries flottantes blindées. Seules les batteries françaises Dévastation, Lave et Tonnante interviennent avant la fin de la guerre. Ancrée devant Kinbourn à l’embouchure du Dniepr, protégées par un blindage d’une épaisseur totale de 10 centimètres, elles font merveille : démantelée par le tir de ces batteries flottantes, la forteresse capitule.
Les grandes marines de guerre s’empressent de tirer les leçons de la guerre de Crimée. Désormais, la supériorité de la vapeur, comme la nécessité du blindage, seule défense possible contre les dégâts causés par les obus, ne se discutent plus. Ainsi, en France, la loi de finances de 1857 précise que tout navire non pourvu de machine à vapeur cessera d’être considéré come un bâtiment de guerre. L’année suivante, en 1858, sur des plans de Dupuy de Lôme, le père du Napoléon, la Gloire est mise sur cale. Il s’agit d’un bâtiment de 5 600 tonnes, construit en bois, doté d’une machine à vapeur de 900 chevaux. Mais la grande innovation n’est pas là. En réduisant l’artillerie à 36 canons, Dupuy de Lôme a obtenu un gain de poids qui lui permet de garnir les flancs de la Gloire d’une ceinture de fer forgé de 10 à 12 centimètres d’épaisseur, à 5.5 mètres au-dessus de la ligne de flottaison et à 2 mètres au-dessous. C’est la naissance du premier cuirassé.
Un an plus tard intervient la réplique britannique, avec le lancement du Warrior et du Black Prince. D’emblée, la Navy a voulu faire mieux, plus rapide et plus fort. Grâce à l’avance de la sidérurgie anglaise, ces deux bâtiments sont intégralement construits en fer et affichent des dimensions très supérieures à la Gloire : 117 mètres de long au lieu de 78, un déplacement (le volume d’eau occupé par le navire à flots) de 9 000 tonnes et une vitesse de 14.5 nœuds contre 13.
Philippe Masson. Des forteresses flottantes : les cuirassés. La Mer, 5 000 ans d’Histoire. Les Arènes – l’Histoire 2022
1854
La Corse ne connaît que 6 assassinats et n’aurait abrité que six bandits : il y en avait 20 fois plus avant l’interdiction du port d’arme. La dernière épidémie de choléra en France fera 143 000 morts. Prosper Mérimée, qui n’aime guère son siècle, déclare à sa maîtresse, Madame de Montijo, mère de l’impératrice Eugénie : Le choléra n’est plus épidémique, il est devenu constitutionnel.
Le pape proclame le dogme de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. Victor Hugo dit tout le mal qu’il en pense :
Une conception seule est immaculée
Tous les berceaux sont noirs, hors la crèche étoilée
Ce grand lit de l’abîme, hyménée est taché
Où l’homme dit Amour ! le ciel répond Péché
Tout est souillure et qui le nie est athée
Toute femme est la honte, une seule exceptée !
*****
Aussi le dogme de l’Immaculée Conception me semble un coup de génie politique de la part de l’Église. Elle a formulé et annulé à son profit toutes les aspirations féminines du temps. Il n’est pas un écrivain qui n’ait exalté la mère, l’épouse ou l’amante. La génération endolorie, larmoie sur les genoux des femmes, comme un enfant malade. On n’a pas idée de la lâcheté des hommes envers elles !
Gustave Flaubert. Lettre à Mademiselle Leroyer de Chantepie du 18 décembre 1859
Puisque cela est affaire de dogme, et qu’en matière de dogme, le pape est infaillible, on peut, sans craindre d’être contredit, affirmer que la Vierge Marie est la première mère porteuse de l’humanité.
Au château de Font Ségugne, dans la banlieue est d’Avignon, Frédéric Mistral fonde le Félibrige, qui marque la renaissance de la culture provençale : Mistral et les herauts de la Renaissance provençale, autour des années 1850, avaient trouvé cette langue habillée comme une paysanne et l’avaient vêtu en princesse.
Stephane Giocanti. 2006
Pasteur est professeur à l’université de Lille. Faidherbe, gouverneur du Sénégal pour les dix années qui viennent, entreprend de gagner le Haut Niger par la vallée du Sénégal : ce sont ses successeurs qui achèveront la reconnaissance ; mais les premiers éléments de la constitution de l’AOF – Afrique Occidentale Française – se mettent en place. En Afrique du sud, par la convention de Bloemfontein, les Anglais reconnaissent l’État d’Orange. Principe du téléphone par Ch. Bourseul. Sainte Claire Deville pose les bases de la fabrication de l’aluminium par électrolyse à partir de l’alumine extraite de la bauxite. C’était devenu un métal précieux – le tiers du prix de l’argent – à telle enseigne que la Maison Christofle offrira un service de table en aluminium moulé à Napoléon III, qui ne le remisera pas au grenier mais honorera ainsi ses hôtes de marque ; et, lorsque le nombre d’hôtes dépassait le nombre de couverts en aluminium, il servait aux derniers des couverts en or !
Le centre de Chamonix, qu’on appelle encore Prieuré car regroupé autour de ce dernier, brûle entièrement. On comprend mieux ainsi l’architecture très XIX° siècle du village actuel. L’étymologie, là encore est très discutée : la version la plus commune veut qu’il s’agisse du Champ du Meunier : Cham Mouny. Alexandre Dumas marque une préférence pour le terrain des chamois. Mais, selon Emmanuel Fraïsse, qui préface le livre de Dumas, ce dernier fait erreur, et il s’agirait de Campus Munitus, c’est à dire la plaine défendue par les remparts que sont les montagnes. Les amateurs de langues plus lointaines ou moins connues, font appel à une racine indo-européenne cam – (la hauteur arrondie), mariée au gaulois moniz qui veut dire, lui aussi, la montagne. L’étymologie n’étant pas une science exacte, il est permis à chacun de dire tout et n’importe quoi…
Gabriel Fauré a neuf ans… qu’il a passé essentiellement à Foix chez une nourrice ; fils de Toussaint Honoré Fauré, instituteur à Pamiers, puis directeur de l’école normale d’instituteurs de Foix à Montgauzy, et de Marie Antoinette Hélène Lalène Laprade. Ayant montré des dispositions pour la musique : ses parents n’hésitent pas à l’envoyer à Paris étudier à l’École Niedermayer : musique classique et religieuse, qui formait alors des organistes d’église, des chefs de chœur et des maîtres de chapelle. Il va y étudier onze années et y obtient un 1° grand prix de piano, un 1° grand prix de composition et un 2° grand prix d’harmonie.
On a un peu de mal aujourd’hui où les mères gardent souvent leurs enfants à la maison très longtemps, à saisir le mode de fonctionnement de parents qui d’une part n’hésitent pas à le mettre en nourrice et d’autre part n’hésitent pas non plus à l’envoyer dans l’inconnu à 9 ans ! Il y a dans tout cela une dureté dont on a perdu l’habitude depuis des décennies.
15 02 1855
En route pour la Crimée, La Sémillante se fracasse sur les brisants du détroit de Bonifacio, probablement rendue non manœuvrable par la perte de son gouvernail : personne n’en réchappera : 173 morts, marins et soldats.
Puisque le mistral de l’autre nuit nous a jetés sur la côte corse, laissez-moi vous raconter une terrible histoire de mer dont les pêcheurs de là-bas parlent souvent à la veillée, et sur laquelle le hasard m’a fourni des renseignements fort curieux.
[…] Il y a deux ou trois ans de cela. Je courais la mer de Sardaigne en compagnie de sept ou huit matelots douaniers. Rude voyage pour un novice ! De tout le mois de mars, nous n’eûmes pas un jour de bon. Le vent d’est s’était acharné après nous, et la mer ne décolérait pas.
Un soir que nous fuyions devant la tempête, notre bateau vint se réfugier à l’entrée du détroit de Bonifacio, au milieu d’un massif de petites îles… Leur aspect n’avait rien d’engageant : grands rocs pelés, couverts d’oiseaux, quelques touffes d’absinthe, des maquis de lentisques, et, çà et là, dans la vase, des pièces de bois en train de pourrir : mais, ma foi, pour passer la nuit, ces roches sinistres valaient encore mieux que le rouf d’une vieille barque à demi pontée, où la lame entrait comme chez elle, et nous nous en contentâmes.
À peine débarqués, tandis que les matelots allumaient du feu pour la bouillabaisse, le patron m’appela, et, me montrant un petit enclos de maçonnerie blanche perdu dans la brume au bout de l’île :
Venez-vous au cimetière ? me dit-il.
Un cimetière, patron Lionetti ! Où sommes-nous donc ?
Aux îles Lavezzi, monsieur. C’est ici que sont enterrés les six cents hommes de la Sémillante, à l’endroit même où leur frégate s’est perdue, il y a dix ans… Pauvres gens ! ils ne reçoivent pas beaucoup de visites ; c’est bien le moins que nous allions leur dire bonjour, puisque nous voilà…
De tout mon cœur, patron.
Qu’il était triste le cimetière de la Sémillante ! … Je le vois encore avec sa petite muraille basse, sa porte de fer, rouillée, dure à ouvrir, sa chapelle silencieuse, et des centaines de croix noires cachées par l’herbe… Pas une couronne d’immortelles, pas un souvenir ! rien… Ah ! les pauvres morts abandonnés, comme ils doivent avoir froid dans leur tombe de hasard !
Nous restâmes là un moment, agenouillés. Le patron priait à haute voix. D’énormes goélands, seuls gardiens du cimetière, tournoyaient sur nos têtes et mêlaient leurs cris rauques aux lamentations de la mer.
La prière finie, nous revînmes tristement vers le coin de l’île où la barque était amarrée. En notre absence, les matelots n’avaient pas perdu leur temps. Nous trouvâmes un grand feu flambant à l’abri d’une roche, et la marmite qui fumait. On s’assit en rond, les pieds à la flamme, et bientôt chacun eut sur ses genoux, dans une écuelle de terre rouge, deux tranches de pain noir arrosées largement. Le repas fut silencieux : nous étions mouillés, nous avions faim, et puis le voisinage du cimetière… Pourtant, quand les écuelles furent vidées, on alluma les pipes et on se mit à causer un peu. Naturellement, on parlait de la Sémillante.
Mais enfin, comment la chose s’est-elle passée ? demandai-je au patron, qui, la tête dans ses mains, regardait la flamme d’un air pensif.
Comment la chose s’est passée ? me répondit le bon Lionetti avec un gros soupir, hélas ! monsieur, personne au monde ne pourrait le dire. Tout ce que nous savons, c’est que la Sémillante chargée de troupes pour la Crimée, était partie de Toulon, la veille au soir, avec le mauvais temps. La nuit, ça se gâta encore. Du vent, de la pluie, la mer énorme comme on ne l’avait jamais vue… Le matin, le vent tomba un peu, mais la mer était toujours dans tous ses états, et avec cela une sacrée brume du diable à ne pas distinguer un fanal à quatre pas… Ces brumes-là, monsieur, on ne se doute pas comme c’est traître… Ça ne fait rien, j’ai idée que la Sémillante a dû perdre son gouvernail dans la matinée ; car, il n’y a pas de brume qui tienne, sans une avarie, jamais le capitaine ne serait venu s’aplatir ici contre. C’était un rude marin, que nous connaissions tous. Il avait commandé la station en Corse pendant trois ans, et savait sa côte aussi bien que moi, qui ne sais pas autre chose.
Et à quelle heure pense-t-on que la Sémillante a péri ?
Ce doit être à midi ; oui, monsieur, en plein midi… Mais dame ! avec la brume de mer, ce plein midi-là ne valait guère mieux qu’une nuit noire comme la gueule d’un loup… Un douanier de la côte m’a raconté que ce jour-là, vers onze heures et demie, étant sorti de sa maisonnette pour rattacher ses volets, il avait eu sa casquette emportée d’un coup de vent, et qu’au risque d’être enlevé lui-même par la lame, il s’était mis à courir après, le long du rivage, à quatre pattes. Vous comprenez ! les douaniers ne sont pas riches, et une casquette, ça coûte cher. Or il paraîtrait qu’à un moment notre homme, en relevant la tête, aurait aperçu tout près de lui, dans la brume, un gros navire à sec de toiles qui fuyait sous le vent du côté des îles Lavezzi. Ce navire allait si vite, si vite, que le douanier n’eut guère le temps de bien voir. Tout fait croire cependant que c’était la Sémillante, puisque une demi-heure après le berger des îles a entendu sur ces roches… Mais précisément voici le berger dont je vous parle, monsieur ; il va vous conter la chose lui-même… Bonjour, Palombo ! … viens te chauffer un peu ; n’aie pas peur.
Un homme encapuchonné, que je voyais rôder depuis un moment autour de notre feu et que j’avais pris pour quelqu’un de l’équipage, car j’ignorais qu’il y eût un berger dans l’île, s’approcha de nous craintivement.
C’était un vieux lépreux, aux trois quarts idiot, atteint de je ne sais quel mal scorbutique qui lui faisait de grosses lèvres lippues, horribles à voir. On lui expliqua à grand’peine de quoi il s’agissait. Alors, soulevant du doigt sa lèvre malade, le vieux nous raconta qu’en effet, le jour en question, vers midi, il entendit de sa cabane un craquement effroyable sur les roches. Comme l’île était toute couverte d’eau, il n’avait pas pu sortir, et ce fut le lendemain seulement qu’en ouvrant sa porte il avait vu le rivage encombré de débris et de cadavres laissés là par la mer. Épouvanté, il s’était enfui en courant vers sa barque, pour aller à Bonifacio chercher du monde.
Fatigué d’en avoir tant dit, le berger s’assit, et le patron reprit la parole :
Oui, monsieur, c’est ce pauvre vieux qui est venu nous prévenir. Il était presque fou de peur ; et, de l’affaire, sa cervelle en est restée détraquée. Le fait est qu’il y avait de quoi… Figurez-vous six cents cadavres, en tas sur le sable, pêle-mêle avec les éclats de bois et les lambeaux de toile… Pauvre Sémillante ! … la mer l’avait broyée du coup, et si bien mise en miettes que dans tous ses débris le berger Palombo n’a trouvé qu’à grand’peine de quoi faire une palissade autour de sa hutte… Quant aux hommes, presque tous défigurés, mutilés affreusement… c’était pitié de les voir accrochés les uns aux autres, par grappes… Nous trouvâmes le capitaine en grand costume, l’aumônier son étole au cou ; dans un coin, entre deux roches, un petit mousse, les yeux ouverts… on aurait cru qu’il vivait encore ; mais non ! Il était dit que pas un n’en réchapperait…
Ici le patron s’interrompit :
Attention, Nardi ! cria-t-il, le feu s’éteint.
Nardi jeta sur la braise deux ou trois morceaux de planches goudronnées qui s’enflammèrent, et Lionetti continua :
Ce qu’il y a de plus triste dans cette histoire, le voici… Trois semaines avant le sinistre, une petite corvette, qui allait en Crimée comme la Sémillante, avait fait naufrage de la même façon, presque au même endroit ; seulement, cette fois-là, nous étions parvenus à sauver l’équipage et vingt soldats du train qui se trouvaient à bord… Ces pauvres tringlos n’étaient pas à leur affaire, vous pensez ! On les emmena à Bonifacio et nous les gardâmes pendant deux jours avec nous, à la marine… Une fois bien secs et remis sur pied bonsoir ! bonne chance ! ils retournèrent à Toulon, où, quelque temps après, on les embarqua de nouveau pour la Crimée… Devinez sur quel navire ! … Sur la Sémillante, monsieur… Nous les avons retrouvés tous, tous les vingt, couchés parmi les morts, à la place où nous sommes… Je relevai moi-même un joli brigadier à fines moustaches, un blondin de Paris, que j’avais couché à la maison et qui nous avait fait rire tout le temps avec ses histoires… De le voir là, ça me creva le cœur… Ah ! Santa Madre ! …
Là-dessus, le brave Lionetti, tout ému, secoua les cendres de sa pipe et se roula dans son caban en me souhaitant la bonne nuit… Pendant quelque temps encore, les matelots causèrent entre eux à demi-voix… Puis, l’une après l’autre, les pipes s’éteignirent… On ne parla plus… Le vieux berger s’en alla… Et je restai seul à rêver au milieu de l’équipage endormi.
Encore sous l’impression du lugubre récit que je venais d’entendre, j’essayais de reconstruire dans ma pensée le pauvre navire défunt et l’histoire de cette agonie dont les goélands ont été seuls témoins. Quelques détails qui m’avaient frappé, le capitaine en grand costume, l’étole de l’aumônier, les vingt soldats du train, m’aidaient à deviner toutes les péripéties du drame… Je voyais la frégate partant de Toulon dans la nuit… Elle sort du port. La mer est mauvaise, le vent terrible ; mais on a pour capitaine un vaillant marin, et tout le monde est tranquille à bord…
Le matin, la brume de mer se lève. On commence à être inquiet. Tout l’équipage est en haut. Le capitaine ne quitte pas la dunette… Dans l’entre pont, où les soldats sont renfermés, il fait noir ; l’atmosphère est chaude. Quelques-uns sont malades, couchés sur leurs sacs. Le navire tangue horriblement ; impossible de se tenir debout. On cause assis à terre, par groupes, en se cramponnant aux bancs ; il faut crier pour s’entendre. Il y en a qui commencent à avoir peur… Écoutez donc ! les naufrages sont fréquents dans ces parages-ci ; les tringlos sont là pour le dire, et ce qu’ils racontent n’est pas rassurant. Leur brigadier surtout, un Parisien qui blague toujours, vous donne la chair de poule avec ses plaisanteries :
Un naufrage ! … mais c’est très amusant, un naufrage. Nous en serons quittes pour un bain à la glace, et puis on nous mènera à Bonifacio, histoire de manger des merles chez le patron Lionetti.
Et les tringlos de rire…
Tout à coup, un craquement… Qu’est-ce que c’est ? Qu’arrive-t-il ? …
Le gouvernail vient de partir, dit un matelot tout mouillé qui traverse l’entrepont en courant.
Bon voyage ! crie cet enragé de brigadier ; mais cela ne fait plus rire personne.
Grand tumulte sur le pont. La brume empêche de se voir. Les matelots vont et viennent, effrayés, à tâtons… Plus de gouvernail ! La manœuvre est impossible… La Sémillante, en dérive, file comme le vent… C’est à ce moment que le douanier la voit passer ; il est onze heures et demie. À l’avant de la frégate, on entend comme un coup de canon… Les brisants ! les brisants ! … C’est fini, il n’y a plus d’espoir, on va droit à la côte… Le capitaine descend dans sa cabine… Au bout d’un moment, il vient reprendre sa place sur la dunette, en grand costume… Il a voulu se faire beau pour mourir.
Dans l’entre pont, les soldats, anxieux, se regardent, sans rien dire… Les malades essayent de se redresser… le petit brigadier ne rit plus… C’est alors que la porte s’ouvre et que l’aumônier paraît sur le seuil avec son étole :
À genoux, mes enfants !
Tout le monde obéit. D’une voix retentissante, le prêtre commence la prière des agonisants.
Soudain un choc formidable, un cri, un seul cri, un cri immense, des bras tendus, des mains qui se cramponnent, des regards effarés où la vision de la mort passe comme un éclair…
Miséricorde ! …
C’est ainsi que je passai toute la nuit à rêver, évoquant, à dix ans de distance, l’âme du pauvre navire dont les débris m’entouraient… Au loin, dans le détroit, la tempête faisait rage ; la flamme du bivouac se courbait sous la rafale ; et j’entendais notre barque danser au pied des roches en faisant crier son amarre.
Alphonse Daudet. L’agonie de la Sémillante. Lettres de mon moulin.
À la même période, Jean-Marie Deguignet, paysan breton, s’est engagé pour partir pour la guerre en Crimée. De son village, proche de Quimper, il a rejoint Rennes où est basé son bataillon : et c’est à pied qu’il va rejoindre Lyon – un mois de marche -, où il prendra le train pour Marseille, et de là, un bateau pour la Crimée. En 1850, le soldat était encore beaucoup plus proche de celui de Napoléon I° que de celui de la Première guerre mondiale.
24 02 1855
Victor Hugo se fait visionnaire et le propos est plus que pertinent :
ÉTATS-UNIS D’EUROPE
Le continent serait un seul peuple ;
Les nationalités vivraient de leur vie propre dans la vie commune ;
L’Italie appartiendrait à l’Italie,
La Pologne appartiendrait à la Pologne,
La Hongrie appartiendrait à la Hongrie,
La France appartiendrait à l’Europe,
L’Europe appartiendrait à l’humanité.
Le groupe européen n’étant plus qu’une nation,
L’Allemagne serait à la France, la France serait à l’Italie
Ce qu’est aujourd’hui la Normandie à la Picardie
et la Picardie à la Lorraine ;
plus de guerre, par conséquent plus d’armée …
Une monnaie continentale ayant pour point d’appui
le capital Europe tout entier
et pour moteur l’activité libre de deux cent millions d’hommes ;
Cette monnaie, une, remplacerait et résorberait
toutes les absurdes variétés monétaires d’aujourd’hui,
effigies de princes, figures des misères.
D’autres que lui – Eugène de Mirecourt pour ne pas le nommer – en font de même, pour cent ans plus tard, soit le Paris de 1955 à 2 heures du matin, et ma foi, c’est pas mal du tout : Une multitude de soleils électriques jettent leurs rayons à la ville du haut de cent phares immenses. Ils remplacent le soleil de Dieu. La foule des passants se heurte sur les trottoirs, et, le long de la chaussée, courent d’étranges véhicules dont on n’a pas idée de nos jours. Paris ne dort plus.
20 05 1855
Elisha Kent Kane, médecin de l’Us Navy envoyé en mai 1853 pour retrouver l’expédition Franklin a hiverné sur l’Advance, dans la baie de Rensselaer, côte nord ouest du Groenland, alors le point le plus septentrional atteint par l’homme blanc. Durant cet hivernage, le Docteur Hayes, médecin, avait pris la tête d’un groupe qui avait faussé compagnie au reste de l’expédition le 28 août 1854. Début décembre, les esquimaux du groupe endormis à l’opium avaient été dépouillés de leurs chiens, de leurs vêtements. Mais ils s’étaient quand même réveillé, s’étaient vêtus tant bien que mal de couvertures, et ainsi protégés, avaient rejoint les Américains. Ceux-ci avaient des armes, les Esquimaux n’en avaient pas et sous leur menace, les derniers avaient guidé les premiers de Rensselaer jusqu’à Natsivilik, près du cap Parry où ils avaient rejoint Kane qui avait quitté l’Advance le 20 mai 1855 pour gagner Upernavik, au milieu de la cote ouest du Groenland en 24 jours de navigation, à bord des barques de l’Advance.
05 1855
Deuxième exposition universelle de Paris ; 20 000 exposants dont la moitié étaient français ; 5 millions de visiteurs. La pièce maîtresse est le Palais de l’Industrie, construit entre les Champs Élysées et le cours de la Reine, par Viel et Desjardins : la nef centrale est en verre et en fer : elle atteint 35 m. de haut. Mais les galeries latérales manquaient de lumière, la charpente de fer et de fonte était emprisonnée dans une enveloppe de maçonnerie… le tout était pesant et laid : Un bœuf foulant un parterre de roses selon Octave Mirbeau.

C’est à cette occasion qu’est crée le premier classement officiel de vin : pour les Bordeaux, 61 domaines de six appellations différentes du Médoc, plus un vin de Graves, en 5 catégories. Les 4 premiers crus classés sont le Haut Brion, Margaux, Lafite et Latour. Les blancs liquoreux de Sauternes et Barsac sont également classés en trois catégories, avec seul en tête, en premier cru supérieur le déjà fameux Yquem [2]. Alfred Chauchard et Auguste Hériot ouvrent Les Magasins du Louvre à Paris. Premières photos aériennes de Félix Tournachon, dit Nadar. Un réseau de télégraphe électrique relie Paris à tous les chef lieux de département : il couvre plus de 10 000 km.
13 08 1855
Les chevaux du carrosse de l’impératrice Eugénie s’emballent en passant rue de Rivoli : Xavier Ruel quincaillier lyonnais est dans les parages ; monté à Paris pour y faire fortune et installé depuis peu au croisement de la rue de Rivoli et de la rue des Archives – c’est l’endroit où, dans ses parapluies ouverts, ses camelots faisaient les meilleures affaires – il a créé le Bazar de l’Hôtel de Ville. Il se précipite sur les chevaux et parvient à les calmer : l’impératrice lui en saura gré en lui offrant une récompense consistante qui lui permettra de développer considérablement le BHV.

24 08 1855
Quatre mois plus tôt, l’Empereur et l’Impératrice se sont rendus en visite officielle à Londres, où ils ont reçu le meilleur accueil. À partir du 18 août, la Reine Victoria, le prince consort et leur fils aîné leur rendent leur visite et ce 24 août c’est la journée la plus sensible : les Invalides où se trouve le tombeau du grand ennemi de l’Angleterre : Napoléon I° : Nous avons roulé jusqu’aux Invalides, où Napoléon repose sous le dôme, malgré l’heure tardive, car nous craignions de manquer pareille occasion de le voir, sans doute l’acte le plus important de notre séjour, si intéressant et riche en événements. Il était presque sept heures quand nous y sommes arrivés. […]
Nous étions éclairés par la lumière de quatre torches, ce qui ajoutait à la solennité de cette scène frappante à tout point de vue. L’église est belle et haute, avec une grande coupole. Nous nous sommes avancés pour regarder de haut le caveau dont la forme ne plaît pas à l’Empereur qui a dit qu’il ressemblait à un grand bassin ; l’on arrive et l’on se demande où est donc le tombeau de l’Empereur ? L’on attend de voir de l’eau. […]. Le cercueil n’y est pas encore, mais il est déposé dans une petite chapelle latérale, Saint Jérôme. L’Empereur m’y a conduite, et je me suis recueillie, au bras de Napoléon III son neveu, devant le cercueil de notre plus âpre adversaire, moi, la petite-fille de ce roi qui le détestait et qui lutta avec vigueur contre lui, et son neveu qui porte son nom, devenu mon plus proche et plus cher allié !
L’orgue des Invalides a alors entonné God Save the Queen, et cette scène solennelle se déroulait à la lueur des torches. Étrange et merveilleux en vérité ! Comme si, dans cet hommage respectueux à un grand ennemi défunt, les vieilles rivalités et les haines étaient lavées et que le ciel scellait cette amitié maintenant heureusement établie entre deux grandes et puissantes nations ! Puisse le ciel la bénir et la faire prospérer ! Le cercueil est drapé de velours noir et or, et les ordres, le chapeau et le sabre de Napoléon sont posés au pied. […] Nous avons quitté les lieux pour rentrer aux Tuileries vers sept heures et demie.
Victoria, reine d’Angleterre.

L’impératrice Victoria aux Invalides. Edward Matthew Ward (Londres, 1816 – Windsor, 1879) vers 1856 – 1860
10 09 1855
Les Zouaves du général Mac Mahon – j’y suis, j’y reste – enlèvent la tour Malakoff de Sébastopol, qui tombe aux mains des Turcs, très aidés par les Français et les Anglais. Le siège durait depuis un an. Après une victoire sur les rives de l’Alma, en septembre 1854, dont les principaux artisans furent les zouaves du général Bousquet, il fallut supporter le froid, le choléra, la dysenterie, le scorbut, qui emportèrent 75 000 soldats français, 19 000 britanniques, 2 600 piémontais, se trouvant là en vertu de l’alliance avec la France. Les Russes ne donneront pas le nombre de leurs morts. Léon Tolstoï, alors sous-lieutenant de 27 ans, en rapportera Les Récits de Sébastopol.
Cette guerre marque le début de la météorologie : le 18 novembre 1854, le Henri IV, fleuron de la marine française, avait sombré dans une tempête en Mer Noire : la marine mit en place deux ans plus tard 24 stations météorologiques. Ce fût aussi le début des reportages photographiques de guerre, et Florence Nightingale, infirmière anglaise affectée à l’hôpital militaire de campagne de Scutari, y déploie un talent et une énergie extraordinaires ; elle y impose le lavage des mains, des draps, l’usage de l’eau chaude, la rédaction des rapports et la rationalisation de l’approvisionnement. Elle sera nommée un an plus tard inspectrice générale du corps d’infirmières affectées aux hôpitaux militaires et fondera en 1860 la première école d’infirmières au monde.
Et cette même guerre marque aussi l’invention de la cigarette : durant le siège, le soldat Corentin le Couedic, breton comme son nom l’indique, voit sa belle pipe réduite en miettes par une balle. Ce qui signifie qu’il peut arriver que, lorsque l’on casse sa pipe, on s’en sorte vivant. Il décide alors de rouler son tabac dans une lettre de sa fiancée. Rentré au pays, il alla raconter son affaire au Moulin OCB, sur les bords de l’Odet, en amont de Quimper, qui avec son papier à cigarette, se mettra à devenir une grande entreprise. Sa publicité fétiche viendra un peu plus tard : si vous les aimez bien roulées…
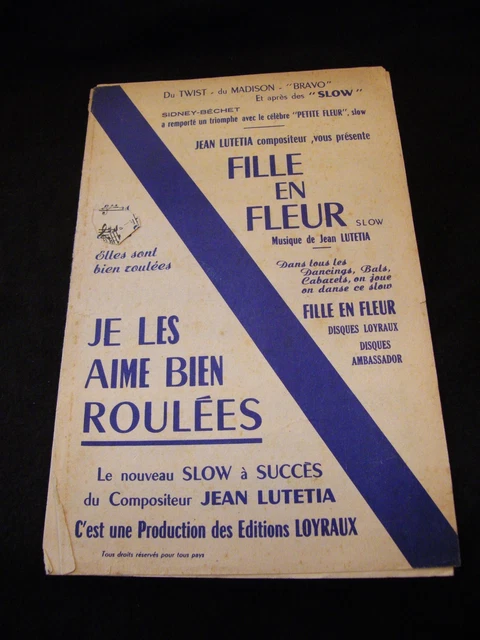


Avec le concours de Jules Cheret, la concurrence n’est pas en reste.
17 11 1855
David Livingstone découvre les chutes du Zambèze, qu’il nomme Victoria – 1 600 mètres de large, 139 mètres de haut – : Jamais les naturels ne se sont approchés de la cascade. Ils ne l’ont vue qu’à distance, et, frappés de la colonne qui s’en élève et du bruit qu’elle répand, ils se sont écriés : la fumée tonne là-bas.
Certain que cette cascade est inconnue en Europe, j’ai usé du droit de la baptiser, et je l’ai appelée : Chutes de Victoria. C’est la seule fois que j’ai pris la liberté d’appliquer un nom anglais aux lieux et aux choses que j’ai trouvé sur ma route.
Nous apercevons les colonnes de vapeur, très justement appelées fumées, et qui, à la distance où nous sommes, environ huit à dix kilomètres, feraient croire à l’un de ces incendies d’une vaste étendue de pâturages, que l’on voit souvent en Afrique. Ces colonnes sont au nombre de cinq et cèdent au souffle du vent. De l’endroit où nous nous trouvons, le faîte de ces colonnes va se perdre au milieu des nuages. Elles sont blanches à la base et s’assombrissent dans le haut, ce qui augmente leur ressemblance avec la fumée qui s’élève du sol. Tout le paysage est d’une beauté indicible. De grands arbres aux couleurs et aux formes variées garnissent les bords du fleuve et les îles dont il est parsemé. Chacun a sa physionomie particulière et plusieurs d’entre eux sont couverts de fleurs.
À huit cents pas environ de la cascade, je change de pirogue pour en prendre une plus légère, dont les rameurs habiles me font passer au milieu des tourbillons et des écueils, et me conduisent à une île située au bord de la rampe où les eaux viennent tomber. Je gravis avec émotion la rampe du précipice, je regarde au fond d’une déchirure qui traverse le Zambèze d’une rive à l’autre, et je vois un fleuve de mille mètres de large tombant tout à coup à plus de trente mètres de profondeur, où il se trouve comprimé dans un espace de quinze à vingt mètres de large.
À quels dieux furent consacrés ces bois obscurs et cet abîme terrifiant, sur lequel planent sans cesse ces colonnes de nuées ? Les anciens chefs Bakota avaient choisi, pour aller y rendre hommage à leurs divinité, les deux îles qui sont au bord du gouffre. Il n’est pas étonnant que, sous le dais nuageux de ces colonnes gigantesques, à la vue de ces brillants arcs-en-ciel, au roulement continu des eaux, au fracas de la cataracte, leur âme fût saisie d’un effroi religieux.
1855
L’Anglais Henry Bessemer invente le procédé pour convertir la fonte en acier, et monsieur Fritz la pomme de terre en frite : monsieur Fritz, comme son nom ne l’indique pas, est belge : donc la frite est belge, et elle ne fera son apparition en France que quatre ans plus tard. En 1843, Joseph Noilly avait confié la direction de son usine de fabrication de vermouth à Claudius Prat : ils déposent la marque Noilly Pratt. Ce vermouth, inventé en 1813, à Marseillan, dans l’Hérault, est né de deux cépages blancs, le Picpoul et la Clairette ; après un an de vieillissement en plein air au cours duquel 6 % s’évaporent – la part des anges -, on y ajoute alors des mistelles et des alcoolats de citrons et framboises ; commence ensuite, dans la Salle des secrets, la macération. Une vingtaine de plantes et d’herbes du monde entier sont utilisées selon un dosage gardé secret : camomille d’Italie, coriandre de Bulgarie, écorce d’orange amère d’Espagne, noix de muscade d’Indonésie, centaurée du Maroc etc… Longtemps populaire, au point d’être considéré comme le Martini français, le Noilly Prat est tombé en désuétude depuis la Seconde guerre mondiale et n’est quasiment plus utilisé que pour l’élaboration de sauces classiques déglacées et de cocktails (l’Adriana, le Cardinal, le Bronx).
Peste en Chine. La machine à coudre est produite en série par les anglais Elias Howe et Isaac Singer. Création à Salindres, près d’Alès, de la Société Henry Merle, pour exploiter le sel de Camargue : elle prendra le nom de Péchiney. Partant de Paris en train, on peut aller à Bayonne, Toulouse, Clermont-Ferrand, Marseille, Bâle, Dunkerque ; dix ans plus tard commencera le maillage du réseau avec les premières lignes transversales. Mise en service du chemin de fer de Panama, première ligne transcontinentale du Nouveau Monde, qui accélèrera de façon notable les voyage des côtes est aux côtes ouest des États Unis par transport des voyageurs et des marchandises à travers l’isthme de Panama. L’ingénieur anglais David Kirkaldy est aux premières loges pour le lancement de son navire, le Persia, un transatlantique tout en acier de 121 m. de long, munies de roues à aube actionnées par deux chaudières qui consomment 147 tonnes de charbon par jour. Il emmène 120 passagers en 1° classe et 50 en seconde. Il est muni de trois mâts : on supprimera celui de poupe un an plus tard. Il a le ruban bleu, de Liverpool à Sandy Hook avec 9 jours, 16 heures et 16 minutes.
Le 12 mai précédent, Charles Bourzillat, 10 ans, est mort en tombant sur le four de la forge d’Imphy, dans la Nièvre. Le 23 mai, c’est au tour de Jean Briffaud, 16 ans, de se faire écraser par une roue.
Le fait que cela arrive à des enfants n’était pas alors choquant en soi : on était encore dans un monde très largement agricole, et, à la ferme, tout le monde est habitué à ce que les enfants travaillent. Non, ce qui était choquant, c’était que ces accidents arrivent parce qu’on travaille trop, on ne se repose pas assez… c’est la fatigue qui était responsable. Le dimanche de l’Église avait été banni sous la Révolution, comme les corporations jugées entraver les libertés. Les révolutionnaires avaient même mis en place une semaine de dix jours pour s’assurer de sa disparition en 1793. Napoléon l’avait remis en service, mais seulement pour les fonctionnaires et ses successeurs avaient tenté, sans grand succès de l’imposer, au point que ces textes étaient finalement tombés en désuétude et finalement seront abolis en 1880. Dans ce contexte, et pour protester contre la mort de ces enfants, les ouvriers d’Imphy avaient décidé de bien s’habiller le dimanche et de se reposer. Et finalement, ils se feront entendre, en créant une caisse de secours et en obtenant deux jours de repos toutes les deux semaines ou une demi-journée le dimanche. Mais pour l’ensemble de la population, il faudra attendre la loi du 13 juillet 1906 pourque le dimanche devienne un jour férié pour tout le monde.
Résumé de François Baroin. Une histoire de France par les villes et les villages. Albin Michel 2017
Le lieutenant Windham introduit en France des skis de Norvège, suivi par Henri Duhamel à Chamrousse en 1889, le docteur Pilet à Colmar, le docteur Étienne Payot à Chamonix en 1897. En 1893, l’Illustration les nommait encore les souliers à neige.


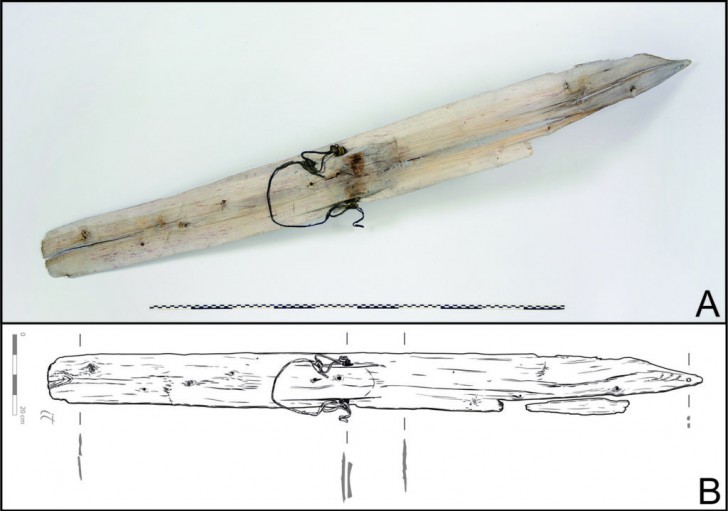
Un ski « préhistorique » découvert en Norvège : il a 1 300 ans.

Replica pair of the Digervarden ski. Reconstruction by Kjell Bengtsen. Photo: Espen Finstad, secretsoftheice.com.

Un sami à ski




Oslo, 1890

dessin exécuté avant 1890
Ouverture d’une voie pour le Mont-Blanc, passant par le col du Mont Lachat, Tête Rousse et l’Aiguille du Goûter. Elle va devenir la voie normale, dite encore à Saint Gervais voie royale car la plus facile, surtout lorsque le train à crémaillère construit à l’initiative de Duportal atteindra le Nid d’Aigle en 1913 ; la plus facile, donc la plus fréquentée : 150 ans plus tard, on comptera entre 20 000 et 30 000 personnes, qui laissent, bon an mal an, une trentaine de m³ de déchets que des bénévoles de la région ramassent chaque année. Le couloir du Goûter sera aussi nommé couloir de la mort, car, par temps doux, et de toutes façons presque chaque jour au-delà de quatorze heures, les pierres mitraillent d’un tir plus ou moins dense ceux qui le traversent.
01 1856
Quelques semaines plus tôt, le Sacramento Union a publié une annonce : People lost to the world Uncle Sam needs a mail carrier – Pour les gens perdus à l’autre bout du monde, Oncle Sam recherche un facteur. Et c’est Jon Torsteinsson Rue, devenu John Thompson qui a répondu. Enfant de Telemark, en Norvège il est arrivé en Californie quand il avait dix ans, il a fait venir de là-bas des skis, ici nommés snowshoes : en chêne, 12 kilos, plus de 3 mètres de long ! et une seul gros bâton. Il part de Placerville pour une tournée d’une moyenne de 150 km qui le mènera à travers la Sierra Nevada à Genoa, Lake Tahoe, Carson City. Deux à quatre liaisons par mois, avec un col à 2 300 mètres, et cela pendant vingt ans, jusqu’en 1876 !
Il vole littéralement à travers la montagne. Il ne monte pas à cheval sur son bâton pour se freiner ni ne s’appuie sur lui comme les autres snowshoers. Il descend ainsi gracieusement, en balançant sa perche d’un côté et de l’autre tel l’aigle qui déploie ses ailes.
Dan de Quille, plumitif local

ces skis pouvaient mesurer 3.5 m !
18 02 1856
Dans l’empire ottoman, le sultan Abdülmecit I° veut faire avancer les choses, en proclamant le rescrit impérial – Hatt i Humayoun – qui garantit l’égalité entre tous les citoyens ottomans sans distinction de religion, ce qui permettait dès lors aux non-musulmans d’entrer dans la fonction publique et de s’inscrire dans les écoles publiques tant militaires que civiles. Mais les résistances au changement finiront par l’emporter avec l’arrivée au pouvoir des Jeunes Turcs en 1908, qui prépareront méthodiquement le génocide des Arméniens en 1915.
fin mars 1856
À l’occasion du traité de Paris qui met fin à la guerre de Crimée, Napoléon III reçoit Dost Mohammad Khan, émir d’Afghanistan, qui se fait l’ambassadeur de la part de l’humanité qui, pour manger, se passe de couverts et mange à la main : Manger avec ses doigts, ignorer les intermédiaires que nous connaissons entre la nourriture et la bouche, c’est aussi jouir d’un contact sensuel plus direct avec l’aliment et les doigts, comme Mauss (1936) nous le laisse entendre par l’anecdote suivante : le shah invité de Napoléon III mangeait avec les doigts ; l’empereur insiste pour qu’il se serve d’une fourchette de vermeil : Vous ne savez pas de quel plaisir vous vous privez, lui répond le Shah en prenant sa fourchette.
Joëlle Plantier. Les dilemmes de la culture et de la pédagogie. L’Harmattan 1999.
30 03 1856
En Russie, au tout début de son règne, le tzar Alexandre II explique sa volonté de réforme aux représentants de la noblesse moscovite : Mieux vaut abolir le servage d’en haut que d’attendre le moment où il commencera à être détruit par en bas. Il mit fin à la toute puissance de l’autocratie, et peu à peu la société civile affirma son émancipation politique économique et culturelle. Dostoïevski, Tolstoï, Tchekhov, Tchaïkovski vont assurer le rayonnement de la culture russe à l’étranger.
printemps 1856
François Joseph comprend que l’ombrageuse nature de Sissi, son épouse, correspond à une sensibilité nouvelle, à un besoin d’émancipation avec lesquels il va falloir compter : il l’emmène à ses cotés à Venise, Milan où une amnistie générale lui attire la sympathie, et surtout en Hongrie où, – goût pour les grands espaces où les chevaux sont rois ? – Sissi triomphe : elle se trouve là chez elle ; l’amour que lui portent les Hongrois durera bien au-delà de sa mort.
Quand j’entends le nom de Hongrie,
Mon gilet allemand me semble trop étroit
Quand j’entends le nom de Hongrie,
C’est comme si une mer s’agitait en moi…
Heinrich Heine
Élisabeth, alias Sissi admire profondément le poète juif et allemand, à telle enseigne qu’elle projette de lui édifier une statue dans sa ville natale de Düsseldorf : elle se heurte à une bronca de tous les conservateurs, à la tête desquels on trouve Geor von Schönerer, que les nazis prendront pour théoricien de leur doctrine. L’antisémitisme est à l’œuvre. Le retentissement touche même l’étranger : en France, Edouard Drumont s’en prend directement à Élisabeth : elle recule et fera installer la statue dans son jardin de l’Achilleion à Corfou.
1 06 1856
Il a beaucoup plus toute la semaine sur la France. Les vitesses des eaux du Rhône et de la Loire ne sont pas les mêmes et les inondations touchent la vallée du Rhône avant celle de la Loire : Le Rhône a baissé de près de 2 m depuis minuit. Cette baisse est arrivée trop tard ; 4 digues étaient rompues en différents points. La Camargue est couverte de 2 ou 3 m d’eau. La plaine, depuis Tarascon jusqu’à la mer, est inondée ; 100 000 hectares environ, dont 60 000 en culture, sont sous l’eau. Toutes les récoltes sont perdues. Dans la ville de Tarascon, l’eau s’est élevée à 3 ou 4 m. Nous sommes obligés d’envoyer de Marseille le pain nécessaire aux habitants. Il est probable qu’en Camargue, la plus grande partie des bestiaux est noyée. En Avignon, le 3 juin 1856, l’inondation emporte une partie des remparts entre la porte Saint Roch et la porte Saint Dominique.
Dépêches télégraphiques des préfets.
4 06 1856
Le tocsin sonne à toute volée entre Saumur et Angers : la levée (digue) s’est brisée sur 200 mètres à La Chapelle sur Loire, en amont de Saumur. Port Boulet, le village voisin, est inondé. Le château de Flaire sera totalement détruit. Le 6 juin l’eau arrivera à Angers, s’engouffrant dans les ardoisières, faisant 30 morts. L’inondation recouvre près de 100 000 hectares, détruit 2 750 ha de terres de culture par ensablements et 400 ha par érosion. Elle détruit les ponts de Fourchambault, Sully sur Loire, endommage celui de Cosne sur Loire Le fleuve submerge 98 km de voies ferrées, détruit près de 23 km de levées. L’empereur arrivera en Anjou le 9 juin. Il y aura aussi des dégâts dans les vallées de la Garonne et de la Seine, mais de moindre importance.

Inondation des ardoisières de Trélazé en 1856
27 06 1856
Cavour a missionné depuis peu sa cousine Virginia Oldoini, comtesse de Castiglione à Paris, pour y séduire Napoléon III : Réussissez, ma cousine, par les moyens qu’il vous plaira, mais réussissez.
On peut céder une perle pour recevoir, en échange, des diamants. Les diamants, en l’occurrence, c’est l’alliance de la France et du royaume de Piémont Sardaigne pour chasser les Autrichiens de l’Italie du Nord et instaurer une confédération italienne sous la double autorité du pape et du roi de Piémont. Quant à la perle, on est en droit d’hésiter : soit il s’agit de la Savoie elle-même, soit de la comtesse de Castiglione, la divina contessa, cousine de Cavour qui après avoir illuminé la cour de Turin, sera priée d’en faire autant à Paris et d’étourdir de ses charmes Napoléon III… ainsi s’arrangeront les affaires italiennes… Italia fara da se, d’accord, mais avec une belle collectionneuse d’amants, cela va encore mieux. Le secret était devenu d’alcôve, et la divina contessa une sacrée diablesse.
Napoléon III a rapidement repéré la jeune beauté de 19 printemps et l’invite à une soirée dans le parc de Saint Cloud. Ingénieuse au suprême degré à attirer et à retenir l’attention sur elle, elle était, ce soir-là, tout en mousseline transparente, avec un chapeau garni d’une auréole de marabouts blancs, et sa chevelure avait l’air de ne pouvoir être comprimée, tant elle s’étalait sur ses épaules.
Comtesse Stéphanie de Tascher de La Pagerie
Le lendemain, elle pouvait envoyer un message à Cavour : mission accomplie.

Comtesse de Castiglione par Pierre Louis Pierson. Par grand vent, un rechange a été prévu, plus ajusté, plié entre les 3° et 4° jupons en partant de l’extérieur. Il faut évidemment faire vite, avant que d’être emporté au septième ciel… par la bourrasque. Il se dit même que Napoléon III fit creuser un tunnel du jardin des Tuileries passant sous la rue de Rivoli jusqu’à la place Vendôme, où la comtesse résidait à l’hôtel de Gramont, l’ancêtre du Ritz, pour l’y rencontrer en toute discrétion. C’est lui qui empruntait le tunnel… qui n’était pas assez large pour elle… avec tous ces jupons !
5 08 1856
Le Comte Ferdinand de Bouillé atteint le piton central de l’Aiguille du Midi, à 3 842 m. À force d’entendre répéter que cette ascension ne pourrait jamais avoir lieu, je résolus de faire, moi aussi, une tentative auprès de cette cruelle aiguille. Royaliste, il ne peut supporter Napoléon le petit… Badinguet… et rêve de planter le drapeau royaliste – fleurdelisé sur fond blanc – au sommet de l’Aiguille. Après trois échecs l’année précédente, il recommence en bivouaquant sous le col du Midi.
Nous piquâmes nos bâtons en rond et attachâmes tout autour un drap que nous avions emporté ainsi que mon plaid… Au milieu nous plaçâmes trois bûches comme foyer… Nous nous mîmes tous les onze autour du feu, un feu qu’il fallait déplacer sans cesse car il s’enfonçait dans la neige, prodiguant plus de fumée que de chaleur… Nous bûmes beaucoup et mangeâmes peu.
Le lendemain, à la vue du versant sud-ouest de l’Aiguille du Midi, les guides sont sceptiques : impossible de gravir cette montagne. Tenace, le comte décide pourtant de poursuivre jusqu’au pied de la face et se retrouve devant 300 m. de paroi. À 24 mètres du sommet, devant les difficultés techniques, Ferdinand de Bouillé laisse ses guides poursuivre seuls. Au bout d’une heure, Jean Alexandre Devouassoux, Ambroise et Jean Simond réapparaissent : Votre drapeau flotte là-haut, monsieur le comte, mais pour toute la fortune du monde, nous ne repasserons pas par l’arête que nous venons de traverser. Notre âme y passera peut-être après notre mort, mais notre corps, jamais.
Pascal Kober. La fabuleuse histoire de l’Aiguille du Midi. STMB Thétys. 1992

Isidore-Laurent Deroy. Chamouny. Première ascension de l’Aiguille du Midi par le comte Fernand de Bouillé. Nuit du 4 au 5 août 1856. 3 500 mètres au-dessus de la mer, 10 degrés de froid.

Isidore-Laurent Deroy. Chamouny. Première ascension de l’aiguille du midi par le comte Fernand de Bouillé. Escalade du dernier rocher le 5 Aout 1856, à 5 heures du matin.
2 09 1856
Robert Houdin (Robert est son nom, Houdin, celui de sa première femme), célèbre magicien qui pensait mener une retraite bien méritée dans son Abbaye de l’attrape, débarque à Alger où il va rester jusqu’en novembre à l’appel, deux ans plus tôt, du colonel de Neveu, chef du bureau politique à Alger, qui espère que ses tours pourront contribuer à déconsidérer les marabouts. Il est reçu comme un prince par le maréchal Randon, gouverneur général depuis 1851. Il va y devenir le grand marabout blanc.
09 1856
Henry Havershaw Godwin Austen, collègue de Sir Georges Everest au sein du Survey of India, identifie le deuxième sommet du monde – 8 611 m – avec pour nom de code K 2 – le deuxième sommet du Karakoram -. Ce code deviendra son nom, les autres greffes n’ayant pas pris.

K2 under the moonlight. Photo: Imagine Nepal. C’est tout de même autre chose qu’un clair de lune à Maubeuges.
8 10 1856
L’Arrow, un navire anglais enregistré à Hong Kong, est arraisonné par des officiers chinois qui soupçonnent son équipage de se livrer à la piraterie et au trafic d’opium. 12 hommes sont arrêtés : il n’en faut pas plus à l’Angleterre pour attaquer à nouveau la Chine, avec la France à ses cotés pour bombarder Canton en 1857. La deuxième guerre de l’opium va durer trois ans.
8 12 1856
Agesilao Milano, soldat calabrais, se jette sur Ferdinand II, roi des Deux Siciles, qui passe les troupes en revue sur le champ de Mars à Naples, après la grand messe de l’Immaculée Conception. Il le blesse à l’aine d’un coup de baïonnette ; mal soignée, la blessure ne cessera d’handicaper le roi jusqu’à devenir mortelle septicémie, trois ans plus tard. Les troubles des révolutions de 1848 avaient gravement perturbé la vie du royaume ; la répression des émeutes avait été dure, jusqu’à deux mille emprisonnements. Palerme était tombé un temps aux mains des libéraux, autant d’événements qui ternissaient l’image du souverain à l’étranger et qui l’éloignaient de la possibilité d’arriver à la tête d’un royaume d’Italie, ce, d’autant plus que sa foi catholique l’empêchait d’envisager de dépouiller le pape de ses États pontificaux.
1856
En remerciement de son aide à la Turquie lors de la guerre de Crimée, la France reçoit l’église Sainte Anne à Jérusalem du Sultan Abdulmecid I°, qui devient de ce fait partie du domaine national français en Terre Sainte, avec le statut de l’extra territorialité qui s’y rattache. Restaurée, l’État français la confiera en 1877 à Monseigneur Lavigerie et à sa Société des missionnaires d’Afrique. Entre 1882 et , le lieu abritera le grand séminaire pour la formation des prêtres grecs catholiques.
La même année, en voyage sur les Lieux saints, la princesse de la Tour d’Auvergne, veuve, dévote et riche, achète le sanctuaire de l’Éléona, au sommet du mont des Oliviers à Jérusalem Est, qui comprend une église, un cloître construits par Eugène Viollet le Duc, et, en sous-sol, la grotte du Pater, sur les murs de laquelle sont reproduits en plus de cent soixante-dix langues le Pater Noster. La princesse fera don d’une partie de son terrain à la France en 1868. Deux autres parties sont confiées à des sœurs carmélites et à des Pères blancs.
Selon la tradition chrétienne, Jésus se serait retiré fréquemment dans la grotte du Pater avec ses disciples. Sur le fronton de l’entrée est gravée l’inscription latine : Spelunga in qua docebat Dominus apostolos in Monte Oliveti qui signifie Grotte dans laquelle le Seigneur a enseigné à ses apôtres sur le mont des Oliviers.
Sur le site a d’abord été construite au IV° siècle une église pour commémorer l’Ascension du Christ, à la demande d’Hélène, mère de l’empereur Constantin. Elle est détruite par les Perses en 614. Au XII° siècle, des croisés construisent une nouvelle église partiellement financée par l’évêque du Danemark qui y est par la suite enterré avec son majordome. L’église des Croisés tombe peu à peu en ruines et à partir du XIV° siècle, ses pierres sont utilisées pour construire des tombes.
Les Israéliens auront régulièrement une réelle difficulté à admette le statut d’extra territorialité du domaine national français en Terre Sainte ; au XX° et XXI° siècle nombreux seront les incidents diplomatiques – sans gravité, certes – de Chirac à Emmanuel Macron, tous deux présidents de la République, la police israélienne se croyant en territoire israélien, quand ce n’est pas le cas.

Pierre Larousse, fils d’un charron forgeron et d’une aubergiste, a commencé par être instituteur : associé à Augustin Boyer, il fonde en 1852 la Librairie Larousse et Boyer, avec pour ambition d’instruire tout le monde et sur toute chose. En 1856, il édite le Nouveau Dictionnaire de la Langue Française. En 1863, il publiera le premier fascicule du Grand Dictionnaire Universel, qui comprendra au total 24 045 pages ; Le Petit Larousse illustré sera publié en 1905.
Je le (le Grand Larousse) déposais péniblement sur le sous-main de mon grand-père, je l’ouvrais, j’y dénichais les vrais oiseaux, j’y faisais la chasse aux vrais papillons posés sur de vraies fleurs. Hommes et bêtes étaient là, en personne : les gravures, c’étaient leurs corps, le texte, c’était leur âme, leur essence particulière ; hors les murs, on rencontrait de vagues ébauches qui s’approchaient plus ou moins des archétypes sans atteindre à leur perfection : au Jardin d’acclimatation, les singes étaient moins singes, au Jardin du Luxembourg, les hommes étaient moins hommes.
[…] Les grandes découvertes, c’était le monde pris dans un miroir : j’étais Lapérouse, Magellan, Vasco de Gama ; je découvrais des indigènes étranges.
[…] Platonicien par état, j’allais du savoir à son objet. Je trouvais à l’idée plus de réalité qu’à la chose. C’est dans les livres que j’ai rencontré l’univers : assimilé, classé, étiqueté, pensé, redoutable encore.
Jean Paul Sartre. Les Mots.
L’Albatros, barque ailée de 7,5 m de long, de Jean Marie Le Bris, tiré par un cheval, décolle à Tréfuntec, au fond de la baie de Douarnenez : l’engin s’élève de quelques dizaines de mètres, puis atterrit tant bien que mal. Ayant omis la dérive de queue, cela ne pouvait pas aller bien loin. Il voulut faire mieux dix ans plus tard avec un Albatros 2… qui s’écrasa au bout de quelques mètres en pleine rade de Brest : Dieu merci, il n’avait pas été autorisé à enfourcher la bête : il n’y eut donc ni mort ni blessé.
Cabirol met au point le premier scaphandre avec casque sphérique et semelles de plomb. Rouqueyrol et Denayrouze l’équiperont en 1864 d’un régulateur de pression. Paris est divisé en 20 arrondissements. Première ligne de tramway à Paris… tiré par des chevaux. Début du chauffage au gaz. Mise en service du train Paris Lyon Marseille. À Saint Nazaire, achèvement du premier bassin du port. À Saint Étienne, Pierre Pichon rachète un théâtre lyrique s’appelant Casino, et le transforme en épicerie. Geoffroy Guichard prendra la suite en 1892 et en 1898 sera crée Le Magasin du Casino. C’est aujourd’hui une cafétéria Casino. Casino deviendra une grande aventure commerciale qui se terminera en 2024, passant alors aux mains de Daniel Kretinsky, un milliardaire tchèque.
En Allemagne, découverte de l’homme de Neandertal : il a cent mille ans. Neander est une petite vallée proche de Düsseldorf.
À Londres, dans les locaux du Royal College de chimie, William Henry Perkin travaille sur la synthèse de la quinine : d’une expérience ratée, il tire un précipité rouge-brun qui le laisse perplexe, jusqu’à ce qu’il réalise qu’il vient d’obtenir un colorant – la mauvéine – qui peut présenter un intérêt commercial : il brevette la formule, quitte son emploi et construit une usine où il mettra en œuvre son invention : les colorants de synthèse étaient nés, tous à base d’aniline, qui vont entraîner le disparition progressive des colorants naturels : ils donnent aux tissus des couleurs beaucoup plus soutenues que les colorants naturels. En France, c’est en premier lieu la culture de la garance qui va être abandonnée en Provence. Les conséquences économiques seront plus graves avec l’abandon de la culture de l’indigo au Bengale, la cochenille et le bois de Campeche au Mexique. Les fabricants suisses et allemands – CIBA, Geigy, Sandoz, Basf, Kalle § C°, Leopold Cassella et Hoechst – distanceront dès 1860 leurs concurrents français et allemands.
Résumé de Bernard Kapp. La mondialisation des couleurs. Le Monde 11 01 2000
Auguste Guinnard, jeune Français de 23 ans part à l’aventure dans les immenses pampas d’Argentine, qui se nommait alors les Provinces unies de la Plata. Comme tant de milliers de Français que chaque année voit quitter le sol natal pour les rives de La Plata, j’étais venu en 1855 tenter la fortune à Montevideo et à Buenos Aires, et essayer d’acquérir, au prix des connaissances pratiques que j’avais acquises à Paris dans le commerce d’exportation, la certitude du pain quotidien pour moi et un peu d’aisance pour les vieux jours de ma mère.
Pour ce qui est de l’aventure, il ne va pas être déçu. Rapidement capturé par les Indiens Patagons, les Puelches, les Tehuelches, les Mamouelches, etc…, il va être leur esclave pendant trois ans, passant d’une tribu à une autre au gré des marchés entre tribus, soumis aux plus basses besognes ; puis son talent pour soigner et garder les chevaux lui attireront un peu plus de respect jusqu’à ce qu’il soit remarqué par Calfoucourah, le vieux sage dont l’autorité était reconnue de tous, car sa maîtrise de l’écrit représentait un atout important dans les négociations avec les autorités de Buenos Aires. Au retour d’une de ces négociations, le général Urquiza, chef de l’État, pour s’attirer les bonnes grâces des Indiens, avait pourvu leurs représentants du présent le plus apprécié, et en quantité : de l’alcool ; ce qui avait déclenché une fabuleuse cuite, qu’Auguste Guinnard mit à profit pour s’échapper, en volant trois chevaux et en étant suivi d’un chien qui rendra l’âme dans la traversée de la Cordillère des Andes. Les chevaux n’avaient pas attendu jusque là pour mourir. Il s’arrêtera assez longuement à Mendoza, sur les marches du versant est de la cordillère qu’il franchira à pied, le col est à 3 000 mètres d’altitude, pour en terminer avec ses aventures à Valparaiso, au Chili… good bye, farewell.
Il aura été sans doute un des derniers Français à avoir vu le Mendoza de la colonisation espagnole : la ville sera entièrement détruite par un tremblement de terre, deux ans plus tard, le 19 mars 1861, faisant plus de 4 000 morts. Reconstruite un peu plus loin par Ballofet, un urbaniste Français, dès 1863, c’est le paradis des espaces verts.
Les Indiens ne dispensent leurs femmes d’aucun travail, même pendant la dernière période de leur grossesse : on voit celles-ci sans cesse occupées d’une chose ou d’une autre jusqu’au moment de leur délivrance qui a lieu avec une facilité surprenante dont les a douées cette divine Providence qui n’abandonne aucun misérable. Lorsqu’elles sentent que leur enfant va venir au monde, elles se transportent au bord de l’eau et se baignent avec lui dès qu’il a vu le jour. Elles ne se font jamais aider dans ces circonstances si difficiles pour les femmes européennes ; puis sitôt qu’elles sont délivrées, elles reprennent le cours de leurs occupations journalières sans qu’aucune indisposition résulte jamais d’un semblable traitement.
Chez ces êtres presque primitifs les enfants ne sont pas à beaucoup près aussi nombreux qu’on serait porté à le croire ; car l’existence d’un nouveau-né est soumise à l’appréciation du père et de la mère qui décident de sa vie ou de sa mort.
Leur superstition leur fait regarder comme des divinités les enfants phénomènes principalement ceux qui naissent avec un plus grand nombre de doigts que celui voulu par la nature, soit aux pieds soit aux mains. Selon eux c’est un présage de grand bonheur pour leur famille. Quant à ceux qui sont tout-à-fait difformes (le cas est rare) ou dont la constitution ne leur paraît pas propre à résister à leur genre d’existence, ils s’en défont en leur brisant les membres ou en les étouffant, puis ils les portent à quelque distance où ils les abandonnent sans sépulture aux chiens sauvages et aux oiseaux de proie. Si l’innocent petit être est jugé digne de vivre, il devient dès l’instant l’objet de tout l’amour de ses parents qui au besoin se soumettraient aux plus grandes privations pour satisfaire à ses moindres besoins ou à ses moindres exigences. Ils étendent leur nouveau-né sur une petite échelle qui lui tient lieu de berceau. La partie supérieure de son petit corps repose sur des traverses ou échelons rapprochés les uns des autres et garnis d’un cuir de mouton, tandis que la partie postérieure s’emboîte dans une sorte de cavité que forme les autres échelons placés au-dessous des montants. L’enfant est maintenu dans cette position par des lanières fort souples enroulées en dessus des cuirs qui lui tiennent lieu de linge.
La longueur de ce berceau dépasse celle de l’enfant d’environ un pied à chaque extrémité. Aux quatre coins sont attachées d’autres lanières qui servent à le suspendre horizontalement durant la nuit au-dessus du père et de la mère auxquels un autre cordon de cuir permet de bercer cette petite créature sans se déranger. Tous les matins, ces petits êtres sont rendus à la liberté de mouvement pendant le temps nécessaire à l’entretien de leur propreté ; ou bien encore, lorsqu’il fait du soleil, leur mère les étend sur une peau de mouton pour qu’ils acquièrent la force et la vigueur que leur communique cet astre bienfaisant. Lorsqu’il pleut ou qu’il fait froid, ils restent emmaillotés et dans l’intérieur du rouleah ; ils sont placés verticalement, adossés à l’un des montants de la tente, de même qu’une échelle appuyée au long d’un mur. Leur mère se tient en face d’eux, les regardant sans cesse et leur donnant fréquemment le sein, ou bien encore des petits morceaux de viande sanglante qu’ils sucent.
Les femmes allaitent leurs enfants jusqu’à l’âge de trois ans ; si pendant ce temps elles en ont d’autres, elles n’en continuent pas moins de les nourrir avec le nouveau venu, sans qu’elle ni eux en souffrent aucunement. Les moindres caprices de ces petits êtres sont des lois pour les parents et pour leurs amis, qui à l’exemple des père et mère se soumettent à toutes leurs volontés. À peine ces enfants commencent-ils à se traîner sur les mains, qu’on laisse déjà à leur portée couteaux et autres armes, dont ils se servent indifféremment pour frapper ceux qui les contrarient, à la grande satisfaction des parents qui, dans ses colères enfantines, se plaisent à voir le germe précoce des qualités voulues pour faire un bon ennemi de la chrétienté.
Les seules indispositions communes aux enfants sont des douleurs dans les membres et une espèce de croup [une laryngite aigüe. ndlr]. Leurs douleurs sont traitées par le massage et les douches froides. Le remède qu’emploient les Indiens pour la guérison du croup est assez violent : il consiste en un mélange d’urine putréfiée au soleil, sorte d’alcali, et de poudre à tirer provenant de quelques pillages ; ou bien à défaut de poudre d’alcali seul. Il n’est jamais administré plus d’une cuillerée à l’enfant. L’effet de ce remède violent se traduit promptement sous forme de vomissements, et la guérison est généralement complète au bout de quelques heures. Parfois, j’ai vu les enfants tout à coup couverts de boutons d’une cuisson et d’une démangeaison insupportables qui leur faisaient pousser d’horribles cris et verser d’abondantes larmes ; alors, immédiatement leurs mères s’empressaient d’embraser quelques – mey veca – bouses de vaches sèches dont elles employaient la cendre brûlante à les frictionner en même temps qu’elles leur mouillaient le corps avec de l’eau renfermée dans leur bouche. À en juger par l’inquiet empressement que déploient les Indiennes à traiter ainsi leurs enfants, j’ai tout lieu de penser qu’elles redoutent beaucoup les suites de ces éruptions subites qui ont, du reste, toute l’apparence de la petite vérole.
À quatre ans, car les Indiens comptent par année d’un hiver ou d’un printemps à l’autre, ils soumettent leurs rejetons garçons et filles, à la cérémonie du percement d’oreilles, qui fait aussi époque dans leur vie que le baptême chez nous. Cette cérémonie a lieu comme il suit. Le père fait don à son enfant d’un cheval brun rouge, dont les allures plus ou moins douces sont en rapport avec son sexe. On le renverse sur le sol, les pieds fortement liés, au milieu de nombreux invités en costume de fête parmi lesquels figurent au premier rang tous les parents. L’enfant dont on a orné tout le corps de peintures bizarres est couché sur le cheval, la tête tournée vers l’Orient, soit par le chef de la famille soit par le cacique de la tribu quand il lui plaît d’honorer la fête de sa présence. Les femmes placées au second rang entonnent un chant criard et monotone, dont chaque strophe se termine en un ton grave et sourd ayant pour but d’implorer la protection de Dieu. Durant ce temps a lieu le percement des oreilles qui s’opère avec un os d’autruche bien effilé. Dans chaque trou le président de la fête passe un morceau de métal d’un poids suffisamment convenable pour agrandir ces trous et pour allonger les oreilles. Ensuite il s’arme du même os d’autruche et fait à chacun des assistants une incision dans la peau soit à la naissance de la première phalange de la main droite, soit au défaut du jarret droit. Le sang qui sort de cette blessure est offert à Houacouvou – Dieu directeur des esprits malfaisants – pour le conjurer d’accorder une heureuse et longue existence au nouvel élu. Après quoi, ainsi qu’il est d’usage dans toutes leurs fêtes, une jument grasse fait le menu d’un festin offert à la réunion. Les os des côtes sont de préférence donnés aux plus proches ou aux plus intimes qui, après les avoir convenablement rongés, les déposent aux pieds de l’enfant, s’engageant ainsi à lui faire un don quelconque dans le plus bref délai. Ces cadeaux consistent en chevaux, bœufs, éperons ou étriers d’argent qui lui constituent une dot.
L’éducation sérieuse des enfants commence sitôt après la cérémonie du percement d’oreilles. Lorsqu’ils atteignent leur cinquième année, ils montent à cheval en se saisissant à la crinière et en appuyant tour à tour leurs petits pieds sur les jointures de la jambe droite de leurs coursiers ; le plus souvent ceux-ci partent comme un trait emportant ainsi leurs cavaliers avant qu’ils n’aient pris le temps de s’installer complètement. À cet âge, les enfants se rendent déjà fort utiles et gardent le bétail. Ils deviennent bien vite experts dans l’art de jeter le lasso et de lancer la boléadora ; ensuite ils apprennent à manier la lance et la fronde ; en sorte qu’à dix ou douze ans, époque à laquelle ils ont certes plus d’apparence et de force qu’un Européen de vingt à vingt-cinq ans, leur éducation étant complète, ils prennent part aux excursions des tribus et participent aux razzias dans lesquelles ils se montrent généralement d’une témérité et d’une audace incroyable.
Quelques femmes suivent assez souvent leurs maris dans ces lointaines expéditions ; notamment celles des caciques. Leur rôle consiste à rassembler avec l’aide de leurs enfants tous les troupeaux épars et à les entraîner avec prestesse, tandis que la horde est aux prises avec les soldats ou avec les fermiers.
On ne saurait s’imaginer quelle adresse et quelle bravoure les Indiens déploient en ces circonstances, quoique munis seulement d’armes tout à fait primitives. Ils ne reculent jamais devant une armée de troupes régulières ; la fusillade, le canon même, ne suffisent pas toujours pour les repousser dans leurs agressions. Ils se meuvent en tous sens sur leurs chevaux avec une facilité et une promptitude telles, que maintes fois, lorsqu’on les croit atteints de blessures, on est tout étonné de les voir s’avancer de nouveau plus menaçant encore, faisant voltiger leurs lances avec une vélocité et une adresse diaboliques. Lorsqu’ils sont aux prises avec la cavalerie espagnole ils témoignent de leur joie en poussant des cris féroces et effrayants. Ils lancent souvent devant eux des chevaux indomptés à la queue desquels ils attachent des lambeaux de cuirs secs ou des herbes enflammées qui leur donnent un accès de folle frayeur bientôt communiquée à ceux des soldats sur lesquels ils vont fondre comme un terrible ouragan. Profitant de ce désordre, les Indiens se ruent spontanément sur les restes épars des escadrons et les achèvent dans un sanglant carnage. Quant à l’infanterie, dont ils font fort peu de cas, car les soldats argentins sont de si mauvais tireurs qu’ils semblent avoir peur de leurs armes à feu, ils ne l’attaquent qu’en dernier lieu et l’anéantissent promptement.
Lorsque quelques Indiens tombent dans la mêlée, ils sont relevés par leurs compagnons qui les ramènent chez eux et les soignent en chemin ; s’ils succombent pendant le trajet ils sont enterrés sans aucune cérémonie ; mais ceux qui meurent sous la tente, au sein de leurs foyers sont inhumés avec pompe.
Auguste Guinnard. Trois ans d’esclavage chez les Patagons 1856 – 1859. Aubier-Montaigne 1979
_____________________________________________________________________
[1] Lesquelles, à haute dose, sont aussi toxiques : c’est de l’amande amère que l’on extrait le cyanure.
[2] Une seule retouche du prestigieux classement a été effectué en 1973, hissant de second à premier cru le Mouton Rothschild.
Laisser un commentaire