| Publié par (l.peltier) le 10 octobre 2008 | En savoir plus |
12 04 1861
Aux États-Unis, Pierre Beauregard, général d’origine française, appliquant la décision des États Confédérés – le Sud -, qui estiment que Lincoln n’est pas un président légitime, que sa cause est indéfendable, donne l’ordre aux artilleurs de la milice de Caroline du Sud d’ouvrir le feu sur Fort Sumter, la forteresse fédérale qui garde l’entrée du port de Charleston : c’est le début de la guerre de Sécession [1]. Des Français prennent part aux combats, en général dans les rangs des États où ils se trouvent : le général comte Régis de Trobriand est aux cotés des soldats de l’Union à la tête du 55° corps de volontaires de New York ; le fils d’un ministre de Charles X, Camille de Polignac commande des troupes françaises aux cotés des sudistes ; on y voit aussi le comte de Paris (branche Orléans, les prétendants au trône de France) au total, environ 26 000 Français, dont 40 % aux cotés des Unionistes et 60 % aux cotés des Confédérés. À la fin de l’année, Napoléon III, soucieux de ne pas déplaire à l’Union pour pouvoir monter son expédition au Mexique, radiera les soldats français engagés aux cotés des sudistes. Pour ce qui est des principes, les choses étaient claires et les oppositions bien nettes ; sur le terrain, il n’en allait pas de même : on pourra voir aux cotés des sudistes un régiment issu de la communauté des Noirs libres : le Louisiana Native Guards ! L’armée de l’Union n’aborde pas le conflit sous les meilleurs auspices : 16 000 hommes dispersés en 79 garnisons dans l’ouest du pays. Des officiers qui s’ennuient au point de rejoindre les confédérés : ainsi du Virginien Robert Lee ; William Sherman lui, avait rejoint… la banque ; un armement périmé, désuet. Pas d’État Major interarmes, ce qui amènera Lincoln lui-même à assumer cette fonction : comme il n’y connaissait rien, il alla s’instruire à la bibliothèque du Congrès ! Les deux premières années furent nettement à l’avantage des sudistes : Bull Run, juillet 1861 et août 1862, bataille des Sept jours, juin-juillet 1862, Fredericksburg, décembre 1862 avec quelques victoires pour l’union : Antietam, septembre 1862, Chancellorsville, mai 1863, Shiloh, avril 1862 etc…
Dès lors que tant de choses, de si grands intérêts, des sentiments si forts étaient en jeu, la rupture était inévitable. Elle ne se produisit pas précisément sur le statut de l’esclavage, mais sur un point de droit constitutionnel : la faculté pour les États de faire sécession. À l’annonce du succès du candidat républicain à la présidence, Abraham Lincoln, la Caroline du Sud qui se retrouve à l’avant garde du séparatisme, qu’il s’agisse de la nullification ou de la sécession, prend l’initiative de sortir de l’Union ; d’autres États imitent son exemple et forment une nouvelle unité politique, les États confédérés. La sécession n’est pas encore la guerre : assurément Lincoln dénie aux sécessionnistes le droit de quitter l’Union et refuse de reconnaître le fait accompli, mais il se garde soigneusement de déclencher l’épreuve de force. C’est encore le Sud qui va prendre l’initiative des hostilités en attaquant à l’aube Fort Sumter, forteresse fédérale gardant l’entrée du port de Charleston.
[…] la guerre durera quatre années pleines (avril 1861-avril 1865) et sera une des plus effroyables guerres civiles dont l’histoire ait gardé le souvenir.
Dans les États du Sud le déclenchement des opérations pose un choix douloureux à la conscience de chaque citoyen : deux loyalismes se disputent sa fidélité, celui à son État et celui à l’Union. Ordinairement conciliés par la structure fédérale des États-Unis, ils reprennent leur autonomie et réclament part entière. Généralement le loyalisme l’emporte sur la Confédération érigée en rivale de l’Union. Deux groupes d’États sont en lutte que presque tout oppose : leurs économies, l’une industrielle, l’autre agricole, leurs sociétés marquées l’une par la croissance des villes et l’autre fondée sur la plantation, leurs modes de vie. Le rapport des forces ne parait pas égal entre eux et l’issue du combat semble inscrite par avance dans la disproportion des chiffres : vingt-trois États demeurent dans l’Union, onze ont fait sécession, vingt-deux millions d’hommes pour le Nord contre neuf pour le Sud et encore en y incluant trois millions et demi d’esclaves noirs. La comparaison des ressources ne corrige pas les désavantages du Sud : tous les centres industriels, les ports les plus actifs, les réseaux ferroviaires les plus serrés, les réserves financières sont au Nord. Et cependant la décision se fera attendre quatre années : c’est que le bilan statistique, démographique et économique ne rend pas compte de tous les éléments ; il laisse notamment échapper ce qui concerne l’aptitude au combat et la préparation psychologique. Habitués dès l’enfance à une vie de plein air, cavaliers entraînés, les propriétaires du Sud font rapidement de bons soldats, d’excellents officiers : ils bénéficient au départ de l’avantage commun à toutes les sociétés aristocratiques de pouvoir se muer sans délai en sociétés militaires. À l’inverse, le Nord doit surmonter le handicap de toutes les sociétés urbaines et démocratiques à qui une période d’adaptation est nécessaire. Au début les armées sudistes compensent heureusement l’infériorité du nombre par l’initiative, le mordant, l’habileté manœuvrière, mais peu à peu le rapport de forces se rétablit à l’avantage du Nord jusqu’à ce que la rupture d’équilibre entraîne la défaite irrémédiable de la Confédération.
La guerre de Sécession est peut-être la première guerre à annoncer par son style les grands conflits du XX° siècle : elle est bien plus moderne que la courte guerre franco prussienne de 1870-1871 ; il faudra attendre la guerre russo-japonaise pour revoir certaines des innovations introduites par le Nord et le Sud. D’une durée insolite, elle pose aux belligérants des problèmes inédits. Elle est aussi une des premières à mettre aux prises des effectifs qui dépassent le million d’hommes : Lincoln institue le service militaire obligatoire en mars 1863 ; à la fin des hostilités, le Sud avait en ligne huit cent mille hommes, le Nord deux ou trois fois autant. Les méthodes, la tactique révolutionnent les habitudes ; guerre de tranchées, intensité des bombardements, acharnement des combats, longueur des engagements pour se disputer une position, utilisation des navires cuirassés. C’est déjà une guerre d’usure et de matériel ; le Sud a succombé par épuisement sous le nombre et le matériel conjugués.
Guerre de type industriel, selon le caractère que les États-Unis imprimeront aux conflits auxquels ils participeront ultérieurement, elle pose des problèmes d’approvisionnement, d’armement et de financement dont les solutions annoncent déjà tous les expédients de l’économie de guerre.
[…] La défaite du Sud, l’occupation prolongée de son territoire par les troupes du Nord et l’abolition de l’esclavage proclamée dès 1863 entraînèrent la ruine de son aristocratie et l’écroulement de son économie : les grandes plantations morcelées, la main-d’œuvre affranchie, le mode de vie compromis, telles étaient les conséquences durables de la Civil War. Les États du Sud portaient encore récemment sur leur sol, dans leur économie, dans le niveau de vie médiocre de leur population les stigmates de leur défaite : ce sont l’exploitation des gisements pétrolifères et la rapide industrialisation provoquée par la deuxième guerre mondiale qui ont tiré le Sud de sa léthargie et commencé de l’arracher à sa dépendance à l’égard du Nord-Est. La victoire du Nord tranchait en effet la vieille rivalité entre les deux pôles de la société américaine : elle signifiait que la direction de l’Union revenait à la société urbaine du Nord, à son économie fondée conjointement sur le farmer et la manufacture. Politiquement il était maintenant décidé que l’évolution amorcée par Jefferson, continuée par Jackson, défendue par Lincoln se poursuivrait à l’avenir : non seulement l’Union était sauve, mais elle resterait démocratique.
René Rémond. Histoire Universelle. La Pléiade 1986
Dès le début de la guerre, Abraham Lincoln répond à un journaliste : Si je pouvais sauver l’Union sans libérer un seul esclave, je le ferais ; si je pouvais la sauver en libérant tous les esclaves, je le ferais ; et si je pouvais la sauver en libérant certains esclaves sans m’occuper des autres, je le ferais aussi.
[…] Il existe une répulsion compréhensible dans l’esprit de presque tous les Blancs à l’idée d’un amalgame indiscriminé des Blancs et des Noirs… Mais je proteste contre la fausse logique en vertu de laquelle, du moment que je ne veux pas prendre une femme pour esclave, je dois nécessairement la prendre pour épouse. Je puis me passer d’elle dans les deux cas. Je veux simplement la laisser tranquille. À certains égards, elle n’est certainement pas mon égale, mais dans son droit naturel à manger le pain qu’elle a gagné à la sueur de son front, elle est mon égal et l’égale de n’importe quel être humain.
Le moins que l’on puisse dire est que l’argument, pour l’instant, est plus proche de l’instauration d’une ségrégation que de la proclamation de l’égalité de chacun devant la loi.

Le général Lee au milieu de ses hommes

L’Union, en bleu : 22 millions d’habitants, dans 23 États. La Confédération des États du sud, en orange : 9 millions d’habitants, dont 3,7 millions d’esclaves

Abraham Lincoln sur le terrain

21 04 1861
Première coopérative de fromagerie à Valleiry, en Savoie
25 04 1861
La Nouvelle Orléans compte 3 000 citoyens français, qui se sont organisés pour la défense de la ville en 4 brigades. Menacées par les canons de la flotte de l’Union, les troupes confédérées quittent la ville, et ce sont les brigades françaises qui évitent à la ville le pillage généralisé.
26 04 1861
Première constitution tunisienne, suite du Pacte fondamental établi quatre ans plus tôt : 114 articles établissent un partage du pouvoir, entre un pouvoir exécutif composé du bey et d’un Premier ministre, un pouvoir législatif aux prérogatives importantes – détenu par un Conseil suprême de type oligarchique – et un pouvoir judiciaire indépendant. Gardien de la constitution, le législatif doté d’une autorité souveraine peut déposer le bey en cas d’actes anticonstitutionnels, favorisant ainsi la participation des élites à la gestion des affaires. De plus, le souverain n’est plus libre de disposer des ressources de l’État et doit recevoir une liste civile de 1 200 000 piastres alors que les princes de sa famille reçoivent des pensions prévues par le texte. Il reste que la liste des notables désignés membres du Conseil suprême est formée presque exclusivement de personnalités nées à l’étranger, consacrant ainsi le monopole des mamelouks sur la vie politique. Aussi cette constitution est mal accueillie par une partie de la population car, en plus de donner davantage de pouvoir aux mamelouks, elle entraîne d’autres mesures impopulaires comme la conscription générale, la création de nouveaux tribunaux et des concessions faites aux étrangers en matière de droit de la propriété. La hausse des dépenses publiques engendrées par les nouvelles institutions et de nombreux travaux publics conduit à une hausse de la mejba en septembre 1863 – l’étendant par ailleurs à plusieurs villes, aux fonctionnaires, aux militaires et aux oulémas auparavant exemptés – puis à une révolte en avril 1864 qui conduira à sa suspension.
Cette constitution gardera par la suite un pouvoir symbolique en devenant la référence du mouvement national tunisien, en lutte contre le protectorat français, au sein du Destour dont la première demande est son rétablissement avec toutefois certaines évolutions, la plus notable étant l’élection de 60 des 70 membres du Conseil suprême, et aussi au sein du Néo Destour.
19 05 1861
Le chirurgien américain I.I. Hayes découvre l’île d’Ellesmere, séparée de la côte nord-ouest du Groenland par le bassin de Kane, et atteint le cap Lieber, par 81°35 N et 64°30′ O.
06 1861
Le consul des États-Unis à Anvers, autorisé par son gouvernement, écrit à Garibaldi pour lui proposer un commandement dans l’armée des nordistes. Mais celui-ci fait de l’abolition de l’esclavage, sur l’ensemble du territoire un préalable non négociable ; Lincoln attendra encore 18 mois pour le faire. Et le 6 septembre, les contacts n’étant pas rompus, il ne demandait rien de moins que le commandement en chef de l’armée américaine ! Oh My God ! L’affaire en resta là.
27 07 1861
À l’issue d’un séjour à Vichy, recommandé par son médecin, le Dr Alquié qui pensait que les eaux de Vichy lui feraient plus de bien que celles de Plombières, ce qui était une ânerie, puisque, fortement minéralisées, elles n’auront que contribué à aggraver son mal – les calculs – plutôt que le guérir, Napoléon III dote la ville d’un plan d’urbanisme qui va en faire la capitale européenne du thermalisme pour un peu plus d’un siècle, avec notamment une nouvelle gare et surtout trois parcs magnifiques couvrant au total 143 hectares.
13 08 1861
Par décret impérial, en forêt de Fontainebleau, 542 hectares de vieilles futaies et 555 hectares de rochers à destination artistique se voient soustraits à tout aménagement. Et cela faisait suite à l’exemption de toute coupe réglementaire de 624 hectares de bois dès 1853. La réserve artistique de Fontainebleau devient ainsi le premier parc naturel au monde, bien avant celui de Yellowstone, aux États-Unis, en 1872.
Réserve artistique, parce que des artistes étaient à l’origine de l’affaire, et le premier d’entre eux, Théodore Rousseau, 1812-1867, amoureux de la forêt de Fontainebleau, qui boude Paris et son salon pour s’installer à Barbizon dès 1836, faisant de l’auberge du Père Ganne son QG d’artistes frondeurs – les peintres de Barbizon ont des barbes de bison. Du beau monde : Camille Corot, Jules Dupré, Charles Le Roux, Jean-François Millet … qui commenceront par s’opposer à l’inspection des forêts, on ne mangeait à l’auberge que si l’on y avait apporté deux plants de pin arrachés ! Les plaintes remonteront donc jusqu’à Napoléon III…qui saura les entendre.
Près de deux siècles avant le succès des livres sur le langage secret des arbres, Théodore Rousseau avait cette certitude intuitive qu’ils communiquaient entre eux. Et, au nom de l’art, il a contribué à envisager la nature comme un patrimoine à préserver, au même titre que les monuments historiques.
Virginie Félix. Télérama 3858 du 23 décembre 2023 au 5 janvier 2024
Un matin d’été en forêt de Fontainebleau par Théodore Rousseau.1861
Victor Hugo mêle sa voix : Un arbre est un édifice, une forêt est une cité, et entre toutes les forêts, la forêt de Fontainebleau est un monument. Ce que les siècles ont construit, les hommes ne doivent pas le détruire.
George Sand n’était pas en reste, écologiste avant l’heure :
Les grands végétaux sont des foyers de vie qui répandent au loin leurs bienfaits (…). Supprimer leurs émanations, c’est changer de manière funeste les conditions atmosphériques de la vie humaine.
[…] Partout le combustible renchérit et devient rare. La houille est chère aussi ; la nature s’épuise et l’industrie scientifique ne trouve pas de remède assez vite. […] Irons-nous chercher tous nos bois de travail en Amérique ? Mais la forêt vierge va vite aussi et s’épuisera à son tour. […] Si on n’y prend garde, l’arbre disparaitra et la fin de la planète viendra par dessèchement, sans catastrophe nécessaire, par la faute de l’homme.
[…] Il y a un grand péril en la demeure, c’est que les appétits de l’homme sont devenus des besoins impérieux que rien n’enchaine, et que si ces besoins ne s’imposent pas, dans un temps donné, une certaine limite, il n’y aura plus de proportion entre la demande de l’homme et la production de la planète. […] Nous tous, protestons aussi, au nom de notre propre droit et forts de notre propre valeur, contre des mesures d’abrutissement et d’insanité.
[…] Arrivera-t-on à prétendre que l’atmosphère doit être partagée, vendue, accaparée par ceux qui auront les moyens de l’acheter ? […] Voyez-vous d’ici chaque propriétaire balayant son coin de ciel, entassant les nuages chez son voisin, ou, selon son gout, les parquant chez lui […] ?
14 08 1861
La reddition de l’armée du roi de Naples à Gaète, a rendu leur liberté à nombre de soldats désormais désœuvrés… et du statut de soldat désœuvré et évidemment sans solde à celui de bandit de grand chemin, il n’y a qu’un pas que beaucoup d’entre eux avaient franchi : on donnera le nom de brigandage à ces troupes quelque peu hétéroclites : anciens soldats des Bourbons de Naples, repris de justice, évadés de prison, paysans réduits à la misère… Dans les jours précédents, un officier, quarante soldats et quatre policiers avaient été assassinés par 200 de ces brigands emmenés par Cosimo Giordano. Le village de Pontelandolfo subit alors la répression de 500 bersaglieri menés par le colonel Pier Eleonoro Negri, lui-même sous les ordres du général Enrico Cialdini : plus de 400 civils non armés sont massacrés, le village est incendié ; nombreuses sont les femmes violées avant d’être assassinées. Les villages voisins de Casladuni et de Campolattaro connurent le même sort.
Écrite par les vainqueurs, l’histoire pratique bien souvent le mensonge, au moins par omission, sans vergogne : la république française fille de la révolution a soigneusement masqué la violence des guerres de Vendée, la république italienne a elle aussi masqué la violence d’Enrico Cialdini à l’endroit de ceux qu’il traitait de cafoni, terroni – culs-terreux, paysans -.
Comment peut-on donc expliquer la si rapide décomposition de Naples, devenue symbole d’arriération et de dégradation, quand elle était jusqu’à cette première moitié du XIX° siècle un modèle d’évolution économique, politique, sociale, au point de représenter les deux tiers de la richesse italienne ? Construction navale, astronomie, architecture, santé publique, chemin de fer… il est peu de domaines dans lesquels Naples n’occupait pas une position de leader. Tout cela n’est pas le fait d’une évolution économique générale, mais bien celui d’un pillage généralisé, systématique de l’Italie du Sud par l’Italie du Nord, lors de la mise en place de l’unité italienne. L’Italie du nord n’est devenue riche que parce qu’elle a déshabillé l’Italie du sud. Un cannibalisme de cette envergure ne laisse que des charognes, terrain social déstructuré, décomposé sur lequel prospéreront les mafias. On n’est pas très loin de la situation d’Haïti dont la malédiction naquit d’avoir eu les plus grosses concentrations d’esclaves…
Qu’on en juge : la chronologie suivante couvre un peu plus d’un siècle. C’est éloquent :
| 1735 | Première chaire d’astronomie en Italie, confiée à Naples à Pietro di Martino |
| 1754 | Première chaire d’économie du monde, confiée à Naples à Antonio Genovesi |
| 1762 | Académie d’architecture, une des premières et des plus prestigieuses d’Europe |
| 1763 | Premier cimetière italien pour les pauvres, sur un dessin de Ferdinando Fuga |
| 1781 | Premier code de la mer du monde, œuvre de Michele Jorio |
| 1782 | Première intervention de prophylaxie antituberculeuse en Italie |
| 1783 | Premier cimetière d’Europe pour toutes les classes sociales, à Palerme |
| 1789 | Première affectation de maisons populaires en Italie, à San Leucio, près de Caserta Première institution d’assistance sanitaire gratuite, à San Leucio |
| 1792 | Premier atlas maritime du monde (G.A. Rizzi Zannone), Atlante maritimo delle due Sicilie, vol I, élaboré par la prestigieuse École de cartographie napolitaine. |
| 1801 | Premier musée minéralogique du monde |
| 1807 | Premier jardin botanique d’Italie, à Naples |
| 1812 | Première école de danse d’Italie, annexe du San Carlo. |
| 1813 | Premier hôpital psychiatrique italien, le Reale Morotrofio d’Aversa |
| 1818 | Premier bateau à vapeur de Méditerranée, le Ferdinando I |
| 1819 | Premier observatoire astronomique d’Italie à Capodimonte |
| 1832 | Premier pont suspendu en fer d’Europe continentale, sur le Carigliano |
| 1833 | Premier bateau de croisière en Europe, le Francesco I |
| 1835 | Premier institut italien pour les sourds-muets |
| 1836 | Première compagnie de navigation à vapeur en Méditerranée |
| 1839 | Premier chemin de fer italien, la ligne Naples-Portici Premier éclairage au gaz d’une ville italienne, la troisième en Europe après Londres et Paris |
| 1840 | Première usine métallugique et mécanique d’Italie, par le nombre de ses ouvriers – 1050 – à Pietrarsa |
| 1841 | Premier centre sismologique d’Italie, près du Vésuve Premier système de phares à lentille et à lumière constante en Italie |
| 1843 | Premier bateau de guerre à vapeur d’Italie, la frégate Ercole, lancée à Castellamare Premier périodique psychiatrique italien publié par le Reale Morotrofio d’Aversa par B. Miraglia |
| 1845 | Première locomotive à vapeur construite en Italie, à Pietrarsa Premier observatoire météorologique italien, au pied du Vésuve |
| 1852 | Premier télégraphe électrique d’Italie, inauguré le 31 juillet. Premier bassin de carénage en maçonnerie d’Italie, dans le port de Naples. Premiers essais d’éclairage électrique en Italie, à Capodimonte. |
| 1853 | Premier paquebot de la Méditerranée vers l’Amérique, le Sicilia. Première application des principes de la Scuola Positiva Penale pour le rachat des malfaiteurs |
| 1856 | Premier prix international pour la production de pâtes, à l’Exposition industrielle de Paris Premier sismographbe électromagnétique du monde construit par Luigi Calmieri |
| 1859 | Premier état d’Italie pour la production de gants en Europe, avec 700 000 douzaines de paires par an |
| 1860 | Première flotte marchande et première flotte militaire d’Italie, la deuxième du monde. Premier bateau à hélice d’Italie, la Monarca, lancé à Castellamare. Plus grande industrie navale d’Italie par le nombre d’ouviers, à Castellamare di Stabia, avec 2 000 ouvriers. Premier des états italiens pour le nombre d’orphelinats, hospices, pensionnats, conservatoires et structures d’assistance et de formation. Plus bas taux de mortalité infantile d’Italie. Plus grand pourcentage de médecins par habitants en Italie. Première ville d’Italie par le nombre de théâtres, par le nombre de conservatoires de musique : Naples. Premier plan régulateur en Italie, pour la ville de Naples. Première ville d’Italie pour le nombre de typographies, 113 à Naples. Première ville d’Italie par le nombre de journaux et de revues publiées. Plus haute cotation pour des rentes sur fonds d’État avec 120% à la Bourse de Paris. Impôts les plus faibles d’Europe Plus grande quantité de lires-or dans les banques nationales : sur les 668 millions de lires-or qui constituaient le patrimoine des états italiens dans leur ensemble, 443 millions appartenaient au royaume des Deux Siciles. |
Gennaro de Crescenzo. Industrie del Regno di Napoli, Grimaldi editore, Naples, 2003.
Gennaro de Grescenzo est président du mouvement royaliste Neoborbonico, fondé le 17 septembre 1993, qui milite pour la restauration du royaume de Naples. On est en droit de s’interroger sur l’exactitude de cette impressionnante liste de performances économiques, scientifiques, artistiques, médicales … que l’on a bien du mal à voir reproduite ailleurs. D’autre part, il serait probablement malhonnête de jeter le bébé avec l’eau du bain en mettant tout à la poubelle. Et il faut bien aussi donner le point de vue beaucoup plus classique de l’historien, même si c’est l’histoire des vainqueurs : Dès 1860, Cavour donnait à son représentant à Naples, Farini, les instructions les plus fermes pour mater, au besoin par la force, les résistances provenant des partisans des Bourbons, aussi bien que des radicaux, qui avaient appuyé le régime garibaldien. Son but est de rassurer l’Europe et d’encourager les investissements dans le Midi en montrant que le gouvernement tient la situation bien en main dans l’ex-royaume des Deux Siciles. Le Piémont y établit une rigoureuse centralisation administrative à l’aide de fonctionnaires venus du Nord, donne à des Piémontais les concessions de chemin de fer de l’ex-royaume et met le comble à l’impopularité du nouveau régime en prélevant de lourds impôts et en rétablissant la conscription. De surcroît, reprenant les traditions bourboniennes, il créé sous l’autorité d’un rescapé des geôles de l’Ancien Régime, Silvio Spaventa, une police omnipotente. La réaction de la population déçue par cette unité qui répond si peu à ses vœux, sera elle aussi dictée par la tradition, c’est le phénomène classique du brigandage.
[…] C’est à la fois pour se protéger contre cette insécurité et assurer sur place un ordre pour le maintien duquel on ne fait guère confiance aux fonctionnaires du Nord que se sont reconstituées des sociétés secrètes comme la Mafia en Sicile ou la Camorra à Naples. Ces organisations occultes sont dominées par les grands propriétaires, disposent de complicités dans l’administration et la justice et font figure de pouvoir parallèle rançonnant les paysans, imposant par la terreur dans le monde rural l’obéissance aux dirigeants traditionnels aux dépens des nouveaux gouvernants. Spaventa, puis La Marmora mèneront contre elles de véritables campagnes, sans parvenir, tant s’en faut, à les démanteler totalement.
[…] Les historiens se sont plu à noter que le développement économique était également générateur de disparités régionales et la thèse classique admet que le problème du Mezzogiorno est la conséquence de la faveur systématique donnée au Nord dans la politique économique des gouvernements italiens. On en veut pour preuve la faiblesse des implantations industrielles du Sud (en 1876 il n’a sur 41 % du territoire italien que 17 % des industries du royaume). On note aussi que, sauf dans le domaine agricole, la production est très inférieure à celle du Nord. On fait remarquer que de 1862 à 1896, l’État a dépensé en aménagements hydrauliques 270 millions de lires en Italie du Nord, 187 millions en Italie centrale, 3 millions dans les provinces méridionales. Pendant la même période, le Nord a reçu 142 millions de lires pour ses installations portuaires, le Sud 86 millions. Cette thèse du sous-développement du Sud résultant d’une politique de négligence qui aggrave les disparités régionales est aujourd’hui considérée comme simpliste. On note en particulier l’effort considérable consenti par le gouvernement dans les années qui suivent l’unité pour créer dans le Sud l’infrastructure industrielle, non sans succès d’ailleurs. Ainsi le Mezzogiorno qui ne possédait en 1861 que 7,2 % du réseau ferroviaire italien en a 32 % en 1875. De 1871 à 1880 alors que le Sud ne contribue que pour 30,4 % aux rentrées fiscales, il reçoit 45,6 % des dépenses de travaux publics (chemins de fer compris), etc. Dans ces conditions, l’explication du retard croissant du Mezzogiorno ne résiderait pas dans une politique délibérée d’avantages donnés au Nord, mais dans les conséquences naturelles du développement économique italien ; le Midi est, en 1861, déjà fort retardataire par rapport au Nord : structure latifundiaire de l’économie agraire qui bloque les investissements, absence de charbon et de possibilités hydroélectriques, cloisonnement du relief et difficulté des communications, éloignement des pays industriels de l’Europe du Nord-Ouest fournisseurs de techniques et de capitaux et, par conséquent, insuffisance du nombre des entreprises modernes capables d’assumer l’évolution, du capital nécessaire à l’expansion, du marché susceptible d’absorber la production. Et ce n’est que dans la mesure où il entend protéger les secteurs modernes de l’économie (par exemple par le tarif de 1887) que l’État défavorise un Sud qui est demeuré archaïque en dépit de ses efforts. Il n’en reste pas moins que celui-ci figure dès la fin du siècle parmi les victimes de l’évolution économique de l’Italie moderne.
Serge Berstein, Pierre Milza. L’Italie contemporaine, du Risorgimento à la chute du fascisme. Armand Colin 1995
Oui, je m’étais épris de tendresse, de sympathie et de pitié pour cette terre étrangère que Dieu, dans sa prédilection jalouse, a comblée de ses bienfaits et de ses richesses; pour cette oisive et nonchalante favorite dont la vie entière est une fête, dont la seule préoccupation est le bonheur.
Alexandre Dumas, 1802-1870
11 10 1861
Une inondation brutale des galeries la mine de charbon de Bessèges, au puits de Lalle, dans le nord du département du Gard, entraîne la mort de 101 mineurs. Les secours parviendront à trouver des survivants 13 jours plus tard !
11 12 1861
Charles Baudelaire, 40 ans, prend sa plus belle plume pour devenir immortel, c’est-à-dire être admis à l’Académie française : la soif de reconnaissance, de breloques et de sucreries aura été plus forte que toutes ses révoltes : et après tout, ne suis-je pas déjà l’auteur de six ouvrages de poésie et de critique, et le traducteur des œuvres d’Edgar Allan Poe ? J’ai également publié de nombreux poèmes, articles et critiques dans plusieurs revues. Il bénéficie de l’estime de plusieurs grands écrivains comme Victor Hugo, qui ignorait probablement ce qu’il avait écrit des Misérables à sa mère et Théophile Gautier, sensibles à sa poésie. Il s’adresse à Abel Villemain secrétaire perpétuel. J’ai l’honneur de vous instruire que je désire être inscrit parmi les candidats qui se présentent pour l’un des deux fauteuils vacants à l’Académie française [Eugène Scribe et Henri Lacordaire, décédés le premier en février, le second en novembre 1861], et je vous prie de vouloir faire part à vos collègues de mes intentions à cet égard.[…] Pour dire toute la vérité, la principale considération qui me pousse à solliciter déjà vos suffrages est que, si je me déterminais à ne les solliciter que quand je m’en sentirais digne, je ne les solliciterais jamais. Je me suis dit qu’après tout il valait peut-être mieux commencer tout de suite ; si mon nom est connu de quelques-uns parmi vous, peut-être mon audace sera-t-elle prise en bonne part, et quelques voix, miraculeusement obtenues, seront considérées par moi comme un généreux encouragement et un ordre de mieux faire.
Puis il entreprend de faire sa tournée : Charles de Montalembert, un écrivain lourd, incorrect et terreux selon Barbey d’Aurevilly, et d’autres épinglés par une presse peu portée sur la complaisance : Félix Dupanloup, un phraseur d’une médiocrité violente, Jules Sandeau, le premier amant de George Sand, [dont elle ne gardera que la moitié du nom] un petit conteur de contrebande, Philippe Paul de Ségur, une sorte de Xénophon pathétique, Émile Augier, le fruit le plus sec de la poésie contemporaine.
Mais l’Académie compte également quelques vraies gloires à qui Baudelaire rend visite avec émotion : Alfred de Vigny, 64 ans, contraint à garder la chambre le reçoit et lui écrira : Ce que vous ne saurez pas, c’est avec quel plaisir je lis à d’autres, à des poètes, les véritables beautés de vos vers, encore trop peu appréciés et trop légèrement jugés. Lamartine par contre lui conseille de renoncer. Prosper Mérimée, n’a pas dû l’encourager, qui avait écrit : Je ne connais pas l’auteur des Fleurs du mal, mais je parierais qu’il est niais et honnête. Sainte-Beuve le décourage de poursuivre plus avant tout en lui reconnaissant un étrange talent à l’extrémité d’une langue de terre réputée inhabitable et par-delà les confins du romantisme connu.
Il peut encore compter sur Gustave Flaubert et sur son futur biographe, Charles Asselineau. Mais que peuvent deux hommes pour s’opposer aux salves moqueuses envoyées par la majorité des journaux ? C’est Le Figaro, qui conseille de lire Les Fleurs du mal d’une main et de se boucher le nez de l’autre. C’est La Chronique parisienne, qui insinue qu’il faudrait placer Baudelaire dans la section des cadavres de l’Académie. C’est Le Tintamarre, qui dit que le poète a tiré le gros lot de sa loterie humoristique : un bon d’accès à l’Académie française.
Il jettera l’éponge le 10 février 1862. On est aujourd’hui un peu trop porté à opérer dans ses œuvres une sélection qui ne veut pas dire son nom, mais tout n’était pas du meilleur tonneau, comme en témoigne cette tirade contre le Belge, nauséeuse à souhait :
La Civilisation belge
Le Belge est très civilisé ;
Il est voleur, il est rusé ;
Il est parfois syphilisé ;
Il est donc très civilisé.
Il ne déchire pas sa proie
Avec ses ongles ; met sa joie
À montrer qu’il sait employer
À table fourchette et cuiller ;
Il néglige de s’essuyer,
Mais porte paletots, culottes,
Chapeau, chemise même et bottes ;
Fait de dégoûtantes ribottes ;
Dégueule aussi bien que l’Anglais ;
Met sur le trottoir des engrais ;
Rit du Ciel et croit au progrès
Tout comme un journaliste d’Outre-
Quiévrain ; — de plus, il peut foutre
Debout comme un singe avisé.Il est donc très civilisé.
Charles Baudelaire Amœnitates Belgicæ (Il était en Belgique de 1864 à 1866).

Charles Baudelaire par Gaspard Felix Tournachon Nadar

Charles Baudelaire – Portrait par Etienne Carjat, 1862 Fonds Geoffroy-Dechaume/Cité de l’architecture et du Patrimoine/MMF
1861
Julie Victoire Daubié est la première femme reçue au baccalauréat. Pierre et Ernest Michaux créent le pédalier : 2 ensembles manivelle/pédale sont fixées au moyeu de la roue avant : 2 vélocipèdes sont fabriqués en 1861, 142 en 1862 et 400 en 1865. Auguste Nefftzer fonde à Paris le journal Le Temps, qui sortira jusqu’en 1942. La 1° faucheuse inquiète le monde paysan. 1° guide touristique.
En Méditerranée, un câble télégraphique sous-marin s’est rompu l’année précédente entre la Sardaigne et l’Algérie : on l’a remonté pour le réparer, mais auparavant, il a été examiné par le zoologiste français Alphonse Milne Edwards qui a constaté la présence d’animaux vivants : Il m’a été donné de constater que certaines espèces zoologiques vivaient à des profondeurs où l’on croyait généralement qu’aucun animal ne pouvait habiter. Au fond d’une partie de la Méditerranée, où la profondeur de la mer varie entre 2 000 et 2 800 mètres, on trouve à l’état vivant un nombre assez considérable d’animaux.
Le Paraguay sous la bonne gouvernance de Carlos Antonio Lopez est devenu la deuxième puissance du Continent Américain, juste derrière les États-Unis. Dès 1848, il a saisi au nom de l’État paraguayen les dernières missions des indiens guaranis subsistant au nord du Parana. Il a fait appel à des ingénieurs anglais, il a envoyé des dizaines d’étudiants se former dans les universités européennes. On inaugure sa première ligne de chemin de fer. L’aciérie d’Ybicui est en service depuis 1854. L’arsenal d’Asuncion fournit canons et munitions à l’armée, mais aussi machines outils, tours, fraiseuses, perceuses ; un chantier naval peut construire des bateaux de 70 mètres de long ! Journalistes et diplomates qui visitent le pays en 1864 parlent avec admiration de sa jeune industrie, de ses caisses publiques bien remplies et de son impressionnante puissance militaire. En décembre 1864, Francisco Solano Lopez, président de la République, s’inquiétant de l’intervention du Brésil dans la vie politique de l’Uruguay et lui prêtant des intentions impérialistes dans le Rio de la Plata, envahit le Brésil et fait traverser à ses troupes une province d’Argentine. La guerre de la Triple Alliance – Brésil, Argentine, Uruguay, armés par l’Angleterre – contre le Paraguay, tuera de 1864 à 1870 80 % de la population et mettra donc à terre toute ce beau travail, modèle de gestion.
Les Paraguayens supportent l’héritage d’une guerre d’extermination qui constitue l’un des chapitres les plus abjects de l’histoire du continent. Elle s’appelle la guerre de la Triple Alliance. Le Brésil [2], l’Argentine et l’Uruguay furent responsables du génocide. Ils ne laissèrent pas une pierre debout, pas un habitant mâle parmi les décombres. Bien que l’Angleterre n’ait pas participé directement à l’horrible exploit, ce furent ses marchands, ses banquiers et ses industriels qui tirèrent les bénéfices de ce crime contre le Paraguay. L’invasion fut financée, du début à la fin, par la Banque de Londres, la firme Baring Brothers et la banque Rothschild, lesquelles consentirent des prêts léonins, pour les pays vainqueurs, hypothéquèrent leurs chances.
[…] Les gouvernements qui suivirent, celui de Carlos Antonio Lôpez et de son fils Francisco Solano, continuèrent l’œuvre et la consolidèrent. L’économie était en plein essor. Lorsque les envahisseurs parurent à l’horizon, en 1865, le Paraguay possédait une ligne de télégraphe, un chemin de fer et une bonne quantité de fabriques de matériaux de construction, de tissus, de toiles, de ponchos, de papier et d’encre, de vaisselle et de poudre à fusil. Deux cents techniciens étrangers, bien rémunérés par l’État, prêtaient une collaboration décisive. Dès 1850, la fonderie d’Ibycuï fabriquait des canons, des mortiers et des balles de tous calibres ; canons de bronze, obus et balles sortaient également de l’arsenal d’Asunciôn. La sidérurgie, comme toutes les autres activités économiques essentielles, était entre les mains de l’État. Le pays possédait une flotte marchande nationale et plusieurs bateaux qui battaient pavillon paraguayen au long du Paranâ ou à travers l’Atlantique et la Méditerranée avaient été construits dans les chantiers d’Asunciôn. Pratiquement l’État monopolisait le commerce extérieur : le maté et le tabac approvisionnaient la consommation du sud du continent ; les bois précieux étaient exportés en Europe. La balance commerciale accusait un fort excédent. Le Paraguay avait une monnaie forte et stable et des ressources qui lui permettaient de pratiquer une politique d’énormes investissements publics sans recourir au capital étranger. Le pays n’avait pas un centime de dettes à l’extérieur, bien qu’il se permît de maintenir la meilleure armée d’Amérique du Sud, d’engager des techniciens anglais qui se mettaient au service du pays au lieu de mettre le pays à leur service, et d’envoyer en Europe des universitaires pour y perfectionner leurs études. L’excédent économique engendré par la production agricole n’était pas dilapidé dans le luxe stérile de l’oligarchie – ici inexistante – ; il ne restait pas davantage dans les poches des intermédiaires ou entre les mains de sorciers des prêteurs ; il ne figurait pas non plus dans la rubrique des bénéfices que l’Empire britannique faisait avec les compagnies d’affrètement et d’assurances. L’éponge impérialiste n’absorbait pas la richesse que le pays produisait. 98 % du territoire paraguayen appartenait à la nation : l’État cédait aux paysans l’exploitation de parcelles de terre à condition d’y vivre, de les cultiver en permanence et de ne pas les vendre. Il y avait en outre soixante-quatre fermes de la patrie, propriétés que l’État administrait directement. Les ouvrages d’irrigation, barrages et canaux, et les nouveaux ponts et chemins contribuaient grandement à l’accroissement de la production agricole. On ressuscita la tradition indigène des deux récoltes annuelles, abandonnée par les conquistadores. Le souffle vivant des traditions jésuites facilitait sans doute tout ce processus d’entreprise.
L’État pratiquait un protectionnisme jaloux, qui fut renforcé en 1864, afin de défendre l’industrie nationale et le marché intérieur ; les fleuves étaient fermés aux navires britanniques, qui inondaient par ailleurs l’Amérique latine d’objets manufacturés de Manchester et de Liverpool. Le commerce anglais ne dissimulait pas son inquiétude, non seulement parce que ce dernier foyer de résistance nationale au cœur du continent s’avérait invulnérable, mais aussi, et surtout, parce que l’expérience paraguayenne irradiait dangereusement son exemple chez ses voisins. Le pays le plus progressiste d’Amérique latine construisait son avenir sans recourir aux investissements étrangers ni aux prêts de la banque anglaise, et sans la bénédiction du libre-échange.
Pourtant, à mesure que le Paraguay réussissait dans son entreprise, la nécessité de rompre son isolement se faisait plus urgente. Le développement industriel impliquait des contacts plus nombreux et plus directs avec le marché international et les sources de la technique de pointe. Le Paraguay était stratégiquement bloqué entre l’Argentine et le Brésil, et ces deux pays pouvaient l’étouffer en lui fermant l’embouchure des fleuves, comme le firent Rivadavia et Rosas, ou en fixant des impôts arbitraires au transit de ses marchandises. Pour ses voisins soucieux de consolider l’État oligarchique, en finir avec le scandale de ce pays détestable qui se suffisait à lui-même et ne voulait pas s’agenouiller devant les marchands britanniques devenait une condition indispensable.
Le ministre anglais à Buenos Aires, Edward Thornton, participa efficacement aux préparatifs de guerre. À la veille du conflit, il assistait comme conseiller du gouvernement aux réunions du cabinet argentin, assis au côté du président Bartolomé Mitre. La trame de provocations et de duperies dont le summum fut l’accord argentino-brésilien, qui décida du sort du Paraguay, fut ourdi sous son regard attentif. Venancio Flores envahit l’Uruguay porté en croupe par les deux grands voisins et, après la tuerie de Paysandû, établit à Montevideo son gouvernement fidèle à Rio de Janeiro et à Buenos Aires. La Triple Alliance entrait en fonction. Le président paraguayen Solano Lôpez avait menacé d’intervenir militairement si l’on attaquait l’Uruguay car il savait qu’alors la tenaille d’acier se refermerait sur la gorge de sa patrie encerclée par la géographie et les ennemis. Ce qui n’empêche pas l’historien libéral Efraïm Cardozo d’affirmer que Solano Lôpez affronta le Brésil simplement parce qu’il s’était senti offensé : l’empereur lui avait refusé la main d’une de ses filles. Le conflit était engagé. Mais c’était l’œuvre de Mercure et non de Cupidon.
La presse de Buenos Aires appelait le président Solano Lôpez l’Attila d’Amérique : Il faut le tuer comme un reptile, clamaient les éditoriaux. En septembre 1864, Thornton envoya à Londres un long rapport confidentiel, daté d’Asunciôn. Il y décrivait le Paraguay comme Dante l’Enfer, en insistant sur les éléments qui apportaient de l’eau à son moulin : Les droits d’importation sur presque tous les articles sont de 20 % à 25 % ad valorem ; mais, comme cette valeur est calculée sur le prix courant des articles, le droit versé atteint fréquemment 40 % ou 45 % du prix de la facturation. Les droits d’exportation sont de 10 % à 20 % de la valeur… En avril 1865, le Standard, journal anglais de Buenos Aires, célébrait déjà la déclaration de guerre de l’Argentine contre le Paraguay, dont le président a enfreint tous les usages des nations civilisées, et annonçait que l’épée du président argentin Mitre emporterait dans sa course victorieuse, outre le poids des gloires passées, l’élan irrésistible de l’opinion publique pour une juste cause. Le traité avec le Brésil et l’Uruguay fut signé le 1° mai 1865 ; ses clauses draconiennes furent rendues publiques un an plus tard, dans le Times de Londres, qui les avait obtenues des banquiers créanciers de l’Argentine et du Brésil. Les futurs vainqueurs se répartissaient d’avance les dépouilles du Paraguay vaincu. L’Argentine s’attribuait tout le territoire de Misiones et l’immense Chaco ; le Brésil dévorait une immense étendue à l’ouest de ses frontières. L’Uruguay, gouverné par une marionnette au service des deux autres puissances, n’obtenait rien. Mitre annonça qu’il prendrait Asunciôn en trois mois. En fait, la guerre dura cinq ans. Ce fut une boucherie tout au long des fortins qui jalonnaient et défendaient le fleuve Paraguay. L’ignominieux tyran Francisco Solano Lôpez incarna héroïquement la volonté nationale de survivre ; le peuple paraguayen, qui n’avait pas connu la guerre depuis un demi-siècle, s’immola à ses côtés. Hommes, femmes, enfants et vieillards, tous se battirent comme des lions. Les prisonniers blessés arrachaient leurs pansements pour qu’on ne les oblige pas à se battre contre leurs frères. En 1870, Lôpez, à la tête d’une armée de fantômes – des vieillards, et des enfants qui se mettaient de fausses barbes pour impressionner de loin l’adversaire -, s’enfonça dans la forêt. Les armées envahisseuses prirent d’assaut les ruines d’Asunciôn, le couteau entre les dents. Lorsque le président paraguayen fut finalement assassiné dans la végétation épaisse du Corâ, il réussit à dire : Je meurs avec ma patrie ! Et c’était vrai. Le Paraguay mourait avec lui. Auparavant, Lôpez avait fait fusiller son frère et un évêque qui l’accompagnaient dans cette caravane de la mort. Les envahisseurs venaient, prétendaient-ils, pour racheter le peuple paraguayen : ils l’exterminèrent. Le Paraguay, au commencement du conflit, n’était guère moins peuplé que l’Argentine. En 1870, seuls deux cent cinquante mille Paraguayens – le sixième à peine de la population – survivaient. C’était le triomphe de la civilisation. Les vainqueurs, ruinés par le coût exorbitant du crime, restèrent entre les mains des banquiers anglais qui avaient financé l’aventure. L’empire esclavagiste de Pedro II, dont les troupes se nourrissaient d’esclaves et de prisonniers, gagna cependant des territoires – plus de soixante mille kilomètres carrés – et de la main-d’œuvre, car de nombreux prisonniers paraguayens furent envoyés, marqués au fer de l’esclavage, dans les caféières de Sâo Paulo. L’Argentine du président Mitre, qui avait écrasé ses caudillos fédéraux, se retrouva avec quatre-vingt-quatorze mille kilomètres carrés de terre paraguayenne et autres fruits du butin, selon ce que Mitre lui-même avait annoncé en écrivant : Nous nous partagerons les prisonniers et autres prises de guerre de la manière convenue. L’Uruguay, dont les héritiers d’Artigas étaient déjà morts ou vaincus et où l’oligarchie commandait, participa à la guerre comme petit partenaire et sans récompense. Quelques-uns des soldats uruguayens envoyés dans cette campagne du Paraguay étaient montés à bord des bateaux les mains liées. Les trois pays subirent une banqueroute qui augmenta leur dépendance à l’égard de l’Angleterre. La tuerie du Paraguay les marqua à tout jamais.
Le Brésil avait empli le rôle que l’Empire britannique lui avait assigné depuis l’époque où les Anglais avaient transporté le trône portugais à Rio de Janeiro. Au début du XIX° siècle, les instructions de Canning à l’ambassadeur lord Strangford avaient été claires : Faire du Brésil un grand centre commercial pour les produits britanniques destinés à la consommation de toute l’Amérique du Sud. Peu avant de se lancer dans la guerre, le président argentin avait inauguré une nouvelle ligne de chemins de fer britanniques dans son pays et prononcé à cette occasion un discours enflammé : Quelle est la force qui donne l’impulsion à ce progrès ? Messieurs : c’est le capital anglais ! Du Paraguay vaincu disparurent non seulement les habitants mais aussi les tarifs douaniers, les fonderies, l’interdiction des fleuves au commerce étranger, l’indépendance économique et de vastes portions du territoire national. Les vainqueurs implantèrent à l’intérieur des frontières rétrécies par la spoliation le libre-échange et le latifondo. Tout fut pillé et vendu : les terres et les forêts, les mines, les plantations de maté, les écoles. Des gouvernements fantoches successifs furent installés à Asunciôn par les forces d’occupation. La guerre à peine terminée, sur les ruines encore fumantes du Paraguay s’abattit le premier emprunt étranger de toute son histoire. Il était anglais, naturellement. Sa valeur nominale atteignait le million de livres sterling, mais une moitié à peine arriva au Paraguay ; les années suivantes, des renflouements portèrent la dette à plus de trois millions. […] Après la défaite, la liberté de commerce fut garantie pour le Paraguay. On abandonna la culture du coton et Manchester ruina la production textile ; l’industrie nationale fut définitivement enterrée.
Eduardo Galeano. Les veines ouvertes de l’Amérique Latine. Terre humaine Plon
Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il est enragé : Francia figure parmi les monstres les plus horribles dans le bestiaire de l’histoire officielle. Les déformations optiques imposées par le libéralisme ne sont pas un privilège des classes dominantes en Amérique latine ; nombre d’intellectuels de gauche qui se penchent avec des lunettes étrangères sur l’histoire de nos pays partagent certains mythes, canonisations et excommunications de la droite. Le Chant général de Pablo Neruda, magnifique hommage poétique aux peuples latino-américains, montre clairement cette déformation. Neruda ignore Artigas, Carlos Antonio et Francisco Solano Lopez ; mais il s’identifie à Sarmiento. Il qualifie Francia de roi lépreux, entouré par les grands espaces du maté, qui clôtura le Paraguay comme un nid de sa majesté et lia torture et boue aux frontières. Envers Rosas, il ne se montre guère plus aimable : il fustige les poignards, éclats de rire des limiers sur le martyre d’une Argentine volée à coups de crosse dans la vapeur du petit jour, châtiée jusqu’au sang, jusqu’à la folie, vide, montée par d’âpres contremaîtres !
[…] Le souvenir de Solano Lopez brûle encore dans les mémoires. Lorsque le Musée historique national de Rio de Janeiro annonça en septembre 1969 qu’il allait inaugurer une vitrine consacrée au président paraguayen, les militaires réagirent violemment. Le général Mourão Filho, qui avait déclenché le coup d’état de 1964, déclara à la presse : Un vent de folie souffle sur le pays… La figure de Solano Lopez doit être gommée à tout jamais de notre histoire, car il est l’exemple même du dictateur sud-américain en uniforme. Ce fut un sanguinaire qui détruisit le Paraguay en l’entraînant dans une guerre sans merci.
Eduardo Galeano. Les veines ouvertes de l’Amérique Latine. Terre humaine Plon
On est tenté de paraphraser les mots de Victor Hugo, dans sa lettre à Adèle en date du 5 septembre 1837 sur Waterloo en remplaçant Europe, France par Angleterre, Paraguay, et ce, d’autant que le médiocre, dans le fond de l’affaire, est toujours l’Angleterre : Ce n’est pas seulement la victoire de ses voisins et de l’Angleterre sur le Paraguay, c’est le triomphe complet, absolu, éclatant, incontestable, définitif, souverain, de la médiocrité sur le génie.
Un tremblement de terre de magnitude 8.5 ravage l’île de Sumatra et les îles de Nias, Siberut et quelques autres.
Le Mexique, indépendant depuis 40 ans n’a connu qu’une instabilité politique quasi permanente : 31 présidents en 33 ans, les pronunciamiento devenant quasi annuels. Vient d’arriver au pouvoir un Indien, Benito Juarez, du parti libéral, qui parvient à mater une révolte mais a hérité de ses prédécesseurs une dette monumentale : 70 millions de pesos dus à l’Angleterre, 9 à l’Espagne et 3 à la France : il décide du report de 2 ans du remboursement de cette dette.
De son coté, Napoléon III nourrit le rêve de création d’une terre d’émigration chrétienne, à même d’accueillir les immigrants européens en provenance de pays à forte majorité catholique et ainsi faire contrepoids à la puissance naissante des États-Unis en majorité protestante. Les Américains venant de s’installer dans une très prenante guerre civile, ils ne pouvaient jouer de rôle sur des théâtres extérieurs, Napoléon III prend prétexte du report du remboursement de cette dette pour convaincre Angleterre et Espagne de se joindre à la France pour mettre en ordre les affaires du Mexique et les trois pays y envoient un corps expéditionnaire. Mais l’Angleterre et l’Espagne vont se retirer en avril 1862, et la France se retrouve seule au Mexique avec un corps expéditionnaire de 12 000 hommes. La plus belle pensée du règne, s’exclamèrent tous les flagorneurs, députés et sénateurs ; l’avenir allait se charger de montrer que ce n’était pas la plus belle, mais la plus bête.
Et les légionnaires chantaient – bien sûr c’était avant Camerone -.
Eugénie les larmes aux yeux,
Nous venons te dire adieu,
Nous partons de bon matin,
Par un ciel des plus sereins,
Nous partons pour le Mexique,
Nous partons la voile au vent,
Adieu donc belle Eugénie,
Nous reviendrons dans un an.
À Boston, William Barton Rogers crée le MIT : Massachusetts Institute of Technology.
Dès sa création, on savait clairement ce que le MIT ne serait pas : un établissement comme les autres de la région. Tandis que Harvard s’accrochait au modèle britannique d’Oxbridge [en référence aux deux universités les plus prestigieuses du Royaume Uni, Oxford et Cambridge] et à son éducation classique – en insistant sur le latin et le grec, ainsi qu’il sied à toute aristocratie terrienne -, le MIT s’inspirerait du modèle allemand. Il fonderait ses enseignements sur la recherche et l’expérimentation ; il récompenserait le mérite et le travail là où Harvard pliait devant les privilèges de la naissance. Le savoir avait un prix, certes, mais il devait être utile.
Cette approche concrète et réaliste correspondait parfaitement à l’industrialisation galopante de cette époque. Et elle inspira la devise de l’école – mens et manus – [l’esprit et la main] – ainsi que son emblème qui met côte à côte un savant en robe et un forgeron avec marteau et enclume.
[…] Nombreux sont les diplômés du MIT qui finissent par faire faillite. Mais nombreux aussi sont ceux qui connaissent un succès spectaculaire. Un étude portant sur l’ensemble des anciens élèves du MIT montre qu’ils ont crée 25 800 sociétés et emploient plus de trois millions de personnes, dont un quart de la population active dans la Silicon Valley. Leurs entreprises génèrent près de 1 900 milliards $ de chiffre d’affaires chaque année.
[…] Je demande à Tim Berners-Lee de me raconter comment il a atterri ici. Ce Britannique, père du World Wide Web est l’un des nombreux cerveaux étrangers attirés par le MIT. C’est lui qui a crée le web, en 1989, en associant le lien hypertexte au réseau Internet. À l’époque, il travaillait au CERN, à Genève, mais il a eu le sentiment qu’il devait traverser l’Atlantique. Il y a eu plusieurs raisons à mon départ, l’une d’elle était que le web connaissait un développement bien plus rapide aux États-Unis qu’en Europe, une autre était qu’il n’y avait pas de MIT là-bas.
Qu’a-t-il donc trouvé au MIT que l’Europe ne pouvait lui offrir ? C’est plus qu’une université. Sa réputation est telle que cela tourne à la prophétie autoréalisatrice : dès qu’un endroit est considéré comme celui où il faut être en matière de recherche technologique, les gens accourent comme je l’ai fait. Même si je passe mon temps dans les méandres de la technologie Internet ou à voyager autour du monde, j’aime bien me promener dans les couloirs et tomber sur des gens qui travaillent dans d’autres domaines fascinants. Cela maintient mon esprit en éveil.
Un ancien directeur affirme sur le mode humoristique que faire des études au MIT, c’est comme si on voulait prendre un verre d’eau à une bouche d’incendie.
Ed Pilkington. The Guardian Londres Courrier International 1077. 23 au 29 juin 2011
16 01 1862
Alphonse Eugène Beau dit Beau de Rochas, dans un mémoire à l’Académie des Sciences définit le cycle à quatre temps d’un moteur à explosion, dont on peut voir le déroulement sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_Beau_de_Rochas
22 02 1862
Ernest Renan, passé par le grand séminaire, a 39 ans. Il vient d’obtenir la chaire d’Hébreu au Collège de France. Il donne sa première leçon en parlant de Jésus, cet homme incomparable. Le propos fait scandale… il n’y aura pas de seconde leçon car il est renvoyé dans un premier temps et révoqué en 1864. Il n’est pas inutile de préciser que, dans l’affaire, ce n’est pas l’adjectif incomparable qui était en question : on aurait pu croire ainsi que le tollé venait des rangs de farouches athées, laïcs impénitents qui estimaient ce qualificatif comme étant de trop. Non, l’indignation venait des catholiques qui ne purent tolérer que le mot homme fut employé pour désigner le Christ dans le cadre d’une leçon donnée au Collège de France. Il faut encore noter que cela ne l’empêchera pas de connaître un retentissant succès avec La vie de Jésus un an plus tard ni de finir sa carrière à l’Académie Française.
30 03 1862
Parution – retardée, paraît-il, par les larmes des typographes – de la première partie des Misérables, une fraternisation menaçante de tous les débris, selon les mots d’Hugo lui-même. Il recevra à ce titre 300 000 francs.
Victor Hugo. Hauteville House 1862 : Tant qu’il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et compliquant d’une fatalité humaine la destinée, qui est divine, tant que les trois problèmes du siècle : la dégradation de l’homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l’atrophie de l’enfant par la nuit, se seront pas résolus ; tant que, dans de certaines régions, l’asphyxie sociale sera possible ; en d’autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu’il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles.
Le succès sera immense auprès des lecteurs, beaucoup moins chez ses pairs : Les Goncourt trouvent piquante cette fortune gagnée à la sueur de la misère d’autrui : Titre injustifié : point de misère, pas d’hôpital, prostituée effleurée. Rien de vivant : les personnages sont en bronze, en albâtre, en tout, sauf en chair et en os. Le manque d’observation éclate et blesse partout. Situation et caractères, Hugo a bâti son livre avec du vraisemblable et non avec du vrai, avec ce vrai qui achève toute chose et tout homme dans un roman par l’imprévu qui les complète.(avril 1862)
Lamartine parlera d’épopée de la canaille, qui provoquera le persiflage d’Hugo : un essai de morsure par un cygne.
Barbey d’Aurevilly, dans Le pays, 1862 : Le destin du livre de Monsieur Victor Hugo, c’est de faire sauter toutes les institutions sociales, les unes après les autres, avec une chose plus forte que la poudre à canon, avec les larmes et de la pitié. Conception méprisable mais rendue formidable par l’exécution. Chez Monsieur Victor Hugo, le talent, et surtout le style, c’est l’expression, c’est l’invention dans le verbe, c’est enfin toute cette matérialité enflammée de mots et d’images dont on ressent la puissance. Eh bien, c’est par là qu’il échappe au triste destin de n’être plus que l’imitateur d’Eugène Sue. Les Misérables, le livre le plus dangereux de notre temps.
George Sand : un peu trop de christianisme
Michelet : Comment ! il fait un évêque estimable et un couvent intéressant !
Flaubert : ni vérité, ni grandeur dans le fond, intentionnellement incorrect et bas dans la forme.
Baudelaire, dans L’art romantique 1863 : Ce livre est immonde et inepte. Il est bien évident que l’auteur a voulu dans Les Misérables créer des abstractions vivantes, des figures idéales, dont chacune, représentant un des types principaux nécessaires au développement de sa thèse, fut élevée jusqu’à une hauteur épique. C’est un roman construit en manière de poème et où chaque personnage n’est exception que par la manière hyperbolique dont il représente une généralité.
Mais peut-être y a t il incompatibilité entre Hugo et le haschisch. La même année, Baudelaire en chantait les plaisirs : Voici la drogue sous vos yeux : un peu de confiture verte, gros comme une noix, singulièrement odorante, à ce point qu’elle soulève une certaine répulsion et des velléités de nausée… Voilà donc le bonheur ! il remplit la capacité d’une petite cuiller ! le bonheur avec toutes ses ivresses, toutes ses folies, tous ses enfantillages ! Vous pouvez avaler sans crainte ; on n’en meurt pas. Vos organes physiques n’en recevront aucune atteinte. Plus tard peut-être un trop fréquent appel au sortilège diminuera-t-il la force de votre volonté, peut-être serez-vous moins homme que vous ne l’êtes aujourd’hui ; mais le châtiment est si lointain, et le désastre futur d’une nature si difficile à définir ! Que risquerez-vous ? demain un peu de fatigue nerveuse. Ne risquez-vous pas tous les jours de plus grands châtiments pour de moindres récompenses ?
Charles Baudelaire. Le poème du haschisch. Les Paradis artificiels
La postérité se gardera bien d’être aussi sévère à l’endroit des Misérables, en lui consacrant – cinéma et séries de télévision – pas moins de 160 adaptations.
Garibaldi est élu Grand Maître du Suprême Conseil écossais de Palerme. Il a été initié dès 1844 à Montevideo.
Illustres Frères,
J’assume de grand cœur la suprême charge à la tête de la Maçonnerie Italienne constituée selon le rite écossais réformé et accepté. Je l’assume parce qu’elle ma été conférée par le libre vote d’hommes libres, auxquels je dois ma gratitude non seulement pour l’expression de leur confiance à mon égard en m’ayant élevé à un si haut poste, mais aussi pour l’appui qu’ils m’ont donné, de Marsala au Volturno, dans la grande œuvre de l’affranchissement des provinces méridionales.
Cette nomination de grand Maître est la plus solennelle interprétation des tendances de mon âme, de mes vœux, du but que j’ai visé toute ma vie. Et je vous donne l’assurance que grâce à vous et avec la collaboration de tous nos frères, le drapeau d’Italie, qui est celui de l’humanité, sera le phare d’où rayonnera à travers le monde entier la lumière du véritable progrès.
Que le Grand Architecte de l’Univers répande sa bénédiction sur toutes les Loges et qu’il nous regarde toujours avec des yeux propices et que notre divin protecteur Saint Jean d’Ecosse [la loge de Palerme dépend de la Loge Saint Jean d’Ecosse de Marseille] nous gratifie de ses grâces.
7 04 1862
Henry Stanley, de nationalité anglaise né John Rowlands, qui n’aura jamais connu son père, abandonné à sa naissance par sa mère, est arrivé cahin-caha à l’âge adulte en étant parvenu à faire des études correctes ; un an plus tôt, à vingt ans, il s’est engagé dans la guerre de Sécession aux cotés des Confédérés et il est fait prisonnier lors de la bataille de Shiloh, dans le Tennessee. Dans le camp près de Chicago, sévit le typhus et les Yankees proposent aux prisonniers : si vous acceptez de combattre à nos cotés, venez et vous êtes libérés… ce que s’empressa de faire Stanley. Mais la maladie le tint à l’écart du front pour le reste de la guerre. Il devint navigateur, sur des bateaux de la marine marchande et dans la marine militaire de l’Union. Sa belle écriture lui donna la tenue du livre de bord du Minnesota. Il déserte juste avant la fin de la guerre, se rend à Saint Louis, où il est engagé comme correspondant indépendant d’un journal local. Auprès de l’état-major yankee, il participe aux guerres indiennes, envoie des papiers pleins de furieuses batailles, ce qui était rarement le cas sur le terrain, mais… ça plaisait, et pas seulement aux lecteurs mais aussi à des grands patrons tels James Cordon Bennet, patron du New-York Herald, un journal à sensation. En 1867, il deviendra correspondant pour ce quotidien et couvrira notamment une affaire en Abyssinie [Éthiopie].

5 05 1862
Les opérations militaires contre le Mexique commencent mal pour la France : le siège de Puebla ne parvient pas à faire tomber la ville et coûte 1 000 morts au corps expéditionnaire français. L’affaire fait mauvaise impression à Paris et 4 mois plus tard, Napoléon III envoie 26 000 hommes en renfort. Parmi eux, Henri Rousseau qui deviendra le douanier Rousseau : Dans cette confusion tropicale, ma mémoire, à défaut de mon œil, cherche à pénétrer. Où ai-je déjà vu cette nature mexicaine, ces larges langues de zinc tordu, ces fougères traitées feuille à feuille, avec une minutie de primitif ? Ces symphonies de verts, depuis le vert jaune jusqu’au vert de gris ? Cela me revient d’un coup : chez le douanier Rousseau, qui, avant d’être douanier, fit l’expédition du Mexique en qualité de voltigeur et qui rapporta de ce paysage confus ces claires visions qui plurent aux concierges de Montrouge, avant de séduire les marchands de la rue La Boétie.
Paul Morand. Hiver Caraïbe 1929
La guerre va envoyer à la mort nombre de ces soldats, mais pas autant que les épidémies, particulièrement virulentes à Veracruz, port de débarquement des troupes : sur 90 000 soldats hospitalisés pour maladies, 6 000 environ vont mourir de dysenterie, paludisme, typhus, fièvre jaune.
20 05 1862
Abraham Lincoln signe Le Homestead Act – littéralement Loi de propriété fermière – Il permet à chaque famille pouvant justifier qu’elle occupe un terrain depuis 5 ans d’en devenir propriétaire et ce dans la limite de 160 acres – 65 hectares -. Si la famille y vit depuis au moins 6 mois, elle peut aussi sans attendre acheter le terrain à un prix relativement faible de 1,25 $ par acre, soit 308 $ pour 1 km², c’est-à-dire 100 hectares.
Cette loi va jouer un rôle important dans la conquête de l’ouest. Elle pèsera son poids dans l’immigration européenne, et dans la notion de propriété privée. L’injonction d’un éditorialiste en 1850 va devenir le drapeau de cette envie des pionniers : Go west young man, and grow up with the country – Cap à l’ouest, jeune, et grandis avec ce pays -.
Malgré tout, il y aura à peu près la moitié de chute : l’acquisition d’un terrain ne donne pas la compétence pour le gérer, et nombreux encore sont les autres facteurs pour expliquer les échecs : climat ingrat, manque de moyens etc…
Cette loi sera abrogée en 1976, sauf en Alaska, qui pourra concéder des terres gratuitement à des particuliers jusqu’en 1986.

Il y a, en deçà de cultures différentes, de législation différentes une idée commune : la terre appartient autant à celui qui la cultive qu’à celui qui la possède ; ainsi ce droit français datant de Louis XV qui veut qu’une personne pouvant attester qu’elle a remis en valeur une terre abandonnée depuis plusieurs décennies peut en devenir propriétaire.
29 08 1862
Garibaldi, infatigable et incorrigible, s’est mis en tête de prendre Rome pour l’offrir à Victor Emmanuel II : il a débarqué à nouveau en Sicile avec ses volontaires, a passé le détroit de Messine mais est arrêté par le général Enrico Cialdini dans l’Aspromonte ; gravement blessé à la cheville, il sera évacué sur un navire du royaume de Sardaigne pour aller en prison dans la forteresse du Varignano, près de La Spezia, d’où il sortira le 22 octobre, à la faveur d’une amnistie générale accordée le 5 octobre. Il ne fallait pas faire du rebelle un martyr.
22 09 1862
Estimant que désormais, la mesure présente plus d’avantages que d’inconvénients, Abraham Lincoln proclame pour le 1° janvier 1863 l’émancipation de tous les esclaves des États et des régions encore en rébellion contre les États-Unis. Ils seront alors, désormais et pour toujours, libres. La guerre a dès lors changé de sens ; ses buts sont désormais hautement moraux et défendables. Lincoln, sans l’avoir totalement voulu devient le Grand Émancipateur.
30 09 1862
Le roi de Prusse, en conflit avec le Parlement sur le montant des crédits militaires, a demandé à Bismarck de quitter son poste d’ambassadeur à Paris pour le nommer à Berlin ministre d’État et ministre-président par intérim. Bismarck ne traîne pas pour faire part de sa fermeté face au Parlement : L’Allemagne ne s’intéresse pas au libéralisme de la Prusse, mais à sa force […]. Ce n’est pas par des discours et des votes à la majorité [au Parlement] que les grandes questions de notre époque seront résolues, comme on le croyait en 1848, mis par le fer et par le sang ! Scandale… dont Bismarck sortira avec… des pouvoirs plus étendus.
09 1862
Pour forcer le blocus qui leur est imposé par l’Union, les États confédérés ont obtenu de l’Angleterre, qu’elle effectue l’entretien de leurs navires, dont l’Alabama, qui va mener la vie bien rude aux Unionistes pendant 2 ans, en capturant 65 navires ; au bout d’une longue course, il sera coulé au large de Cherbourg le 19 juin 1864. Dans le cadre du traité de Washington du 8 mai 1871, et forts de la neutralité à laquelle aurait dû se tenir l’Angleterre dans ce conflit, les Unionistes lui intenteront un procès qu’ils gagneront en septembre 1872 : les 5 arbitres obtiendront 15.5 millions $ de dommages et intérêts.
William Tecumseh Sherman, général s’étant révélé le meilleur lieutenant de Grant, le chef de l’armée unioniste, fait part de ses états d’âme : Nous ne pouvons pas changer les cœurs de ces habitants du Sud, mais nous pouvons rendre la guerre si épouvantable et les en dégoûter à tel point que des générations entières naîtront et mourront avant qu’ils ne soient prêts à y avoir une nouvelle fois recours.
La guerre, c’est aussi l’installation du désordre dans la vie civile : jusqu’alors les forces de l’Union étaient parvenu à limiter au mieux les raids indiens : une fois parties pour le front, ces raids avaient repris de plus belle : La guerre toucha très peu la frontière de l’Ouest. Tous les affrontements les plus importants eurent lieu à l’est du Mississippi, et les combats qui furent livrés au Texas, au Kansas, au Nouveau Mexique et sur le Territoire Indien n’impliquèrent pas les tribus de cavaliers encore libres. Toutefois la guerre mit cette frontière en pièces. Pas à cause des cohortes de soldats et des convois de munitions, mais par simple négligence. Préoccupés par la guerre et manquant d’argent pour combattre les Indiens, les gouvernements de l’Union et les États confédérés n’eurent d’autre choix que de laisser l’Ouest à son sort. La plupart des hommes chargés de défendre les zones frontalières dans les années 1840 et 1850, des Rangers au 2° de cavalerie en passant par différentes milices, disparurent donc subitement.
Les hommes qui avaient remporté des victoires avec Ford aux Antelope Hills, Van Dorn au Village Wichita ou Ross à la Pease River prirent tous la direction des champs de bataille de l’Est. Et ils emportèrent avec eux les connaissances et la détermination qui leur avaient permis de poursuivre les Comanches au cœur même de leur territoire.
Ils furent remplacés par des milices relevant des Territoires ou des États, des soldats incompétents commandés par de médiocres officiers qui voulaient échapper à la guerre. Ils étaient également sous-équipés. Leurs armes, qu’ils devaient se procurer eux-mêmes, étaient souvent très médiocres. Ils avaient peu de plomb et leur poudre était parfois de si mauvaise qualité qu’elle n’aurait pas tué un homme à dix pas du canon, dixit Ernest Wallace. Ils souffraient de malnutrition, d’alcoolisme, de la rougeole et de problèmes intestinaux, et n’étaient pas assez courageux ou intelligents pour l’emporter contre des Comanches, des Cheyennes ou des Kiowas. (L’un des régiments, censé poursuivre des Indiens, préféra rejoindre un autre fort pour jouer au poker.)
De toute façon, ils avaient d’autres préoccupations, dont leur propre version miniature de la guerre civile qui ravageait le pays. En 1861, la milice du Texas pénétra dans le Territoire Indien, occupa des forts fédéraux et repoussa les troupes de l’Union au nord, dans l’État nouvellement créé du Kansas. Tout au long du conflit, les deux camps se disputeraient des territoires à l’occasion de petits affrontements périodiques, qui culmineraient en 1863 avec la bataille de Honey Springs, où trois milles soldats de l’Union venus du Kansas vainquirent six mille Texans et Indiens. Mais ces événements se produisirent bien à l’est de la Frontière, qui resta négligée et sans défense.
Ce manque d’intérêt subit changea tout. Même si les politiques fédérales étrangement passives des années 1850 avaient ouvert la voie à des centaines d’attaques indiennes, la décennie s’était en réalité achevée sur un éclair de volonté et de détermination. L’expédition de Rip Ford en 1858 fut un événement décisif qui n’avait que quelques précédents (y compris la traque de Cuerno Verde jusque dans les plaines de l’est du Colorado en 1779 par le brillant don Juan Bautista de Anza, le seul gouverneur espagnol qui parvint à freiner la terreur comanche). Et même si la victoire de Sul Ross à la Pease River en 1860 fut peut-être moins glorieuse que ne le suggèrent la plupart des récits, elle incarnait également le désir manifeste des taibos de se défendre. En effet, à la fin des années 1850, comme dix ou vingt ans plus tôt, on aurait pu croire que la puissance comanche déclinait rapidement, que la fin de leurs raids implacables était proche et qu’il leur restait très peu de temps à vivre en dehors des réserves. Pourtant, ce n’était qu’une illusion. L’histoire des Comanches se définit ainsi, par des gains et des pertes de puissance. À la fin des années 1850, l’État du Texas et la Fédération étaient redoutablement forts. Les Comanches couraient se réfugier dans le Llano Estacado. Ils étaient sur le point de s’effondrer. Ils n’étaient plus suffisamment nombreux pour qu’il en fût autrement.
Puis vint la guerre de Sécession. Les Texans partirent au combat, on leur creusa des tombes de fortune à travers tout le Sud et les enseignements furent une nouvelle fois oubliés. Avec le recul, on s’étonne du temps qu’il fallut aux Comanches pour comprendre que les défenses frontalières étaient tombées, que le rapport de force était bouleversé. Il faut dire que l’Union comme les États confédérés, affaiblis à l’Ouest, se mirent rapidement à leur proposer de généreux traités. Les mêmes promesses usées, peu sincères et en définitive inutiles furent réitérées. Mais elles permirent de retarder l’inévitable instant de vérité. Les Confédérés promirent des présents et des marchandises. En contrepartie, les Indiens s’empressèrent d’accepter de rejoindre leur réserve, d’apprendre à cultiver la terre et de cesser leurs attaques contre les Blancs et les autres tribus, des engagements qu’ils n’avaient aucunement l’intention de tenir. Le traité fut ratifié par les Comanches déjà installés sur la réserve, essentiellement des Penatekas, mais également par les chefs des bandes sauvages, dont les Nokonis, les Yamparikas, les Kotsotekas et les derniers Tennawishes. Les Kwahadis, superbement distants, refusèrent comme toujours de signer quoi que ce soit. Le gouvernement fédéral négocia également son propre accord, qui réaffirmait simplement celui de 1853, promettant les éternelles annuités et provisions en échange de concessions non moins absurdes.
Le premier désastre engendré par le démon de la négligence fut en grande partie indépendant de l’homme blanc. Il s’agit des guerres intertribales dans le Territoire Indien, la région située au nord de la Red River et au sud du Kansas destinée à devenir l’Oklahoma. C’est là qu’avait été installé l’essentiel des tribus vaincues et déplacées de l’Est, du Sud et du Midwest – un processus entamé au début du XIX° siècle. En 1830, en vertu de l’Indian Removal Act, la plupart des Indiens durent renoncer à l’ensemble de leurs terres dans l’Est et le Midwest en échange d’une concession prétendument éternelle dans le Territoire Indien. Dans les années 1860, le territoire était devenu un patchwork complexe de cultures indigènes, chacune disposant de sa propre réserve. Les plus vastes avaient été attribuées aux Cinq Tribus Civilisées (Creeks, Choctaws, Cherokees, Chickasaws et Séminoles) ainsi qu’à l’ensemble des bandes comanches, kiowas et apaches, aux Cheyennes, Arapahos, Wichitas et à leurs tribus affiliées (Caddos, Anadarkos, Tonkawas, Tawakonis, Keechis et Delawares). Des zones plus réduites avaient été accordées aux Kickapoos, Sauks et Fox, Osages, Pawnees, Pottawatomis et Shawnees, Iowas, Peorias, Quapaws, Modocs, Ottawas, Wyandots, Senecas, Ponças, Otos et Missouris. Un mélange détonnant d’affinités et d’antagonismes avait vu le jour par décret du Congrès dans les plaines onduleuses et les zones boisées du nord de la Red River.
Pour un grand nombre de ces tribus, la guerre de Sécession eut des conséquences aussi désastreuses que pour les fermiers blancs de l’est de la Géorgie. Les problèmes commencèrent en 1861, peu après le début des hostilités, lorsque les États-Unis retirèrent leurs troupes du Territoire Indien. Bien qu’il y eût quelques Confédérés éparpillés dans la région, les Indiens agriculteurs se retrouvèrent surtout à la merci des tribus de cavaliers, qui les avaient toujours détestés parce qu’ils empiétaient sur leurs territoires de chasse et qu’ils affichaient une complaisance servile vis-à-vis de l’homme blanc. Privés de toute protection, ils subirent les assauts violents des Comanches. (Essentiellement les bandes sauvages, parfois accompagnées de Penatekas de la réserve.) Les Chickasaws furent plus particulièrement visés, mais les autres ne furent pas épargnés. Les Comanches razzièrent leurs fermes et leurs villages comme s’ils étaient sur la frontière du Texas. Ils s’abattaient sur leurs victimes, qui circulaient à pied, habitaient des maisons et labouraient des champs. De nombreux Chickasaws furent repoussés hors du Territoire Indien, jusqu’au Kansas. Les Choctaws et les Creeks subirent également les attaques comanches, tout comme les Indiens de la réserve wichita, qui avaient parfois adopté avec beaucoup de succès les usages sédentaires et agraires des tribus civilisées. Les Comanches fondaient sur leurs fermes, leur bétail et leurs cultures. Des colonies entières furent massacrées, des hommes et des femmes enlevés. Il faut noter que les Indiens civilisés n’étaient pas toujours des proies faciles : c’étaient souvent d’habiles combattants qui triomphaient parfois de leurs persécuteurs.
Mais les raids comanches ne représentaient qu’une part de la tragédie. Il y avait également des guerres partisanes entre les tribus retranchées. Certains Indiens étaient favorables aux Confédérés et d’autres à l’Union. Chez les Cinq Tribus Civilisées, beaucoup possédaient des esclaves, ce qui irritait les Indiens unionistes et provoquaient de profondes dissensions dans leurs rangs. Il en résulta une série de massacres et de représailles dont l’Histoire n’a gardé que peu de traces. On sait simplement qu’ils furent sans doute cruels et répandus. Les territoires des Cherokees, des Creeks et des Séminoles devinrent le théâtre de luttes entre loyalistes des deux camps. Des maisons et des fermes furent incendiées, des semences et des outils détruits. Une grande partie de ces tribus sortit de la guerre affamée et démunie, donc une fois de plus dépendante du gouvernement. En 1862, cent Tonkawas furent tués en une seule attaque, et la multiplication d’incidents similaires faillit aboutir à leur extermination. Officiellement, c’est leur cannibalisme qui était en cause, mais il est plus probable que ce soit le fait qu’ils aient longtemps servi d’éclaireurs aux Texans lors d’expéditions contre les Indiens. La guerre de Sécession offrit de nombreuses occasions de régler des comptes.
Les déplacements de population furent considérables. À la fin de l’année 1861, un vaste groupe de Creeks et d’autres Indiens loyaux menés par le chef Opothle Yahola subirent les attaques répétées d’une force combinée de tribus confédérées et de soldats de la cavalerie texans. Terrifiés, les Indiens unionistes abandonnèrent tout et s’enfuirent vers le nord. Beaucoup moururent de froid et furent ensuite dévorés par les loups. Des bébés vinrent au monde dans la neige et ne survécurent pas longtemps. Selon un expert, 700 Indiens périrent au cours des attaques ou à cause du froid. Une fois au Kansas, ils se rassemblèrent dans un camp de réfugiés où les conditions n’étaient guère meilleures. Des familles dormaient sur le sol gelé, étendant des étoffes – mouchoirs, tabliers, etc. – sur des arbrisseaux pour se protéger des blizzards des Plaines. La composition initiale du camp est révélatrice des conséquences de la guerre civile sur le Territoire Indien. Il comptait 3 168 Creeks, 53 esclaves creeks, 38 nègres libres creeks, 777 Séminoles, 136 Quapaws, 50 Cherokees, 31 Chickasaws et quelques Kickapoos. En avril, le nombre de réfugiés s’élevait à 7 600, dont des Kichais, des Hainais, des Biloxis et des Caddos, tous complètement démunis.
Tandis que la guerre faisait rage dans l’Est, la frontière blanche connaissait également une redoutable explosion de violence. Tout commença en 1862 dans le Nord par une révolte indienne dans les plaines du Minnesota. Cette année-là, les Sioux Santees (les Sioux de l’Est, également appelés Dakotas) se soulevèrent dans leur réserve des bords de la Minnesota River. Ils tuèrent au moins huit cents colons, le bilan civil le plus lourd de l’histoire américaine en temps de guerre avant le 11 Septembre. Quarante mille personnes complètement affolées fuirent également vers l’est. La violence, déclenchée par l’incapacité de l’État fédéral à fournir les annuités et les vivres promis et par l’absence de troupes sur place, fut extrême, presque insensée. Contrairement aux Texans, issus pour la plupart de familles de pionniers et donc habitués aux atrocités des Indiens et en particulier aux mœurs belliqueuses des Comanches, les victimes du Minnesota n’étaient que de simples fermiers. La plupart venaient d’Europe. Ils furent pris d’une peur panique, qui ne fit que s’aggraver lorsqu’ils découvrirent ce que les colons du Nord ne connaissaient pas encore : le viol et la torture délibérée des captives.
Quand des soldats volontaires écrasèrent la rébellion Santee, des foules en colère tonnèrent contre les Indiens en cage, émasculèrent ceux qu’ils purent attraper et exigèrent qu’ils soient exécutés. Si le président Lincoln n’était pas intervenu, des centaines d’entre eux auraient subi le même sort. En l’occurrence, trente-huit rebelles furent pendus au cours de l’exécution la plus importante de l’histoire américaine. L’année suivante, la tribu fut expulsée du Minnesota et ses réserves dissoutes. Les Sioux, la grande puissance du Nord, avaient fini par se heurter à l’avancée des colons, un phénomène qui s’était produit dès les années 1820 au Texas.
À la fin 1863, la plupart des tribus de cavaliers encore libres des Plaines du Sud avaient compris qu’il n’y avait plus de soldats pour les arrêter. À l’été 1864, ils s’abattirent sur les colonies éparpillées entre le Colorado et le sud du Texas, attaquant pionniers et soldats sans s’encombrer de précautions ni craindre de représailles. D’immenses étendues colonisées depuis les années 1850 se dépeuplèrent entièrement. Les attaques comanches entraînèrent la quasi-fermeture de la piste de Santa Fé. Les entreprises de courrier terrestre abandonnèrent leurs relais sur six cent cinquante kilomètres. L’émigration fut stoppée. Les raids cheyennes bloquèrent l’approvisionnement des camps de mineurs du Colorado, où l’on mourut de faim. Le prix d’un sac de farine dans la ville de Denver atteignit 45 $. Une fois de plus, la Frontière reculait, de cent cinquante à trois cents kilomètres dans certains endroits, réduisant à néant deux décennies de progression. L’espace d’un instant, les raids semblèrent avoir sapé le fondement même de l’expansion de l’Amérique vers l’ouest. Après tout, la Destinée Manifeste n’avait de sens que si l’on parvenait à conquérir et soumettre le centre du continent.
S.C. Gwynne. L’empire de la lune d’été. Terre indienne. Albin Michel 2012
1862
Manifeste des peintres français contre la photographie. La France s’installe en Cochinchine. 29 % des conscrits sont illettrés. Première pierre de l’Opéra, 13° salle d’Opéra à Paris depuis la fondation de cette institution par Louis XIV en 1669 : elle prendra le nom de son jeune architecte – 35 ans – jusque là inconnu : Charles Garnier, gagnant d’un concours fort de 170 concurrents dont le très connu Eugène Viollet le Duc…
Le vainqueur, Charles Garnier-1825-1898-, artiste de trente-cinq ans, grand prix de Rome en 1848, manifesta d’emblée ce génie précoce et romantique qui devait enthousiasmer son ami Théophile Gautier. Inauguré en 1875 seulement, l’Opéra de Garnier fut un chantier colossal, inlassablement conduit par l’architecte, qui entendait bien en faire une œuvre personnelle, jusque dans les plus infimes détails. Les meilleurs artistes de l’époque interprétèrent ses dessins en peinture, mosaïque, bronze, marbre, stuc… Jamais le génie créateur d’un architecte ne s’était imposé avec autant d’autorité, d’audace (notamment dans le rapport entre la structure métallique de l’ensemble et la pompe des espaces, paradoxalement lourds et lumineux à la fois), mais aussi de minutie. L’unité absolue de l’architecture et du décor, pensée par le maître d’œuvre, force l’admiration ; la qualité de l’exécution témoigne du talent des artisans et des artistes de ce dernier tiers du XIX° siècle.
Daniel Rabreau. Le Grand atlas de l’architecture mondiale. Encyclopædia Universalis1988
Angelo, vite mon coup de peigne,
Je vais être en retard à l’opéra,
Je vais entendre La Callas ce soir,
Oh ! Je déteste l’opéra, mais que voulez-vous,
Les places sont si chères,
On ne peut pas ne pas y aller…
Michèle Arnaud 1919-1998 [3]
Les frères Péreire, banquiers saint-simoniens, demandent à l’Écossais John Scott de créer un chantier naval à Saint Nazaire pour construire les paquebots de la Compagnie Générale Transatlantique. En 1836, Saint Nazaire comptait 635 habitants ; on y construisit un avant-port pour Nantes en 1847. Le premier paquebot sera lancé en 1864 : Impératrice Eugénie. La machine à glace de Ferdinand Carré est le clou de l’exposition universelle de Londres. Le suédois Johann Peter Johansson invente la clef à molette. Dans le port de Barcelone, Narcis Monturiol I Estarriol fait plonger un sous-marin en bois de 17 m de long.


Ictineo II, 17 m de long.
Puceron d’origine américaine, le phylloxéra commence à ravager les vignes du Portugal en se fixant sur les racines pour en pomper la sève, laissant des plaies infectées qui mènent à la mort du plant : il gagnera, lentement mais sûrement – en 2 ans -, la France ; il détruira ainsi la moitié du vignoble représentant les deux tiers de la production de vin. Au début, ne connaissant pas la cause de la maladie, on faisait ce qui semblait devoir être bon : planter des vignes dans le sable – ça, ça restera pour donner le vin de Listel, – se promener dans les vignes au roulement de tambour censé effrayer l’insecte, fumiger à la corne de sabot, et ça, ça ne restera pas. Parfois le remède sera aussi nocif que le mal : traitées au naphtalène – une huile de houille – et au sulfure de carbone, les vignes brûleront et ne s’en relèveront pas. L’inondation ne noiera pas les sales bestioles. Un riche propriétaire de Roquemaure acheta en 1868 à Rome les reliques de Saint Valentin, lequel se révélera totalement inefficace et sera reconverti dans des valeurs plus incontrôlables. Le vin était alors une affaire très juteuse : de 9 francs au milieu du siècle, le prix de l’hectolitre était monté à 42 francs entre 1856 et 1880 !
Le vin des honnêtes gens
Le soir, l’âme du vin chante dans les bouteilles :
Homme, je pousserai vers toi, mon bien-aimé
Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles
Un chant plein de lumière et de fraternité
Je sais combien il faut, sur la colline en flamme,
De peine, de sueur et de soleil cuisant
Pour engendrer ma vie et me donner l’âme :
Mais je ne serai pas ingrat, ni malfaisant.
Car j’éprouve une joie extrême quand je tombe
Dans le gosier d’un homme usé par les travaux
Et sa poitrine honnête est une chaude tombe
Où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux
Entends-tu retentir les refrains des dimanches
Et l’espoir qui gazouille en mon sein palpitant ?
Les coudes sur la table et retroussant tes manches
Tu me glorifieras et tu seras content.
J’allumerai les yeux de ta femme attendrie,
À ton fils je rendrai sa force et ses couleurs
Et serai pour ce fidèle athlète de la vie
L’huile qui raffermit les muscles des lutteurs.
En toi je tomberai, végétale ambroisie,
Comme le grain fécond tombe dans le sillon
Et de notre union naîtra la poésie
Qui montera vers Dieu comme un grand papillon !
Charles Baudelaire. Juin 1850
2 ans après l’annexion, le désenchantement gagne la Savoie : Partout la tristesse et la méfiance se font remarquer, partout on trouve pour les Français, en tant que représentants de la France annexionniste, une froideur, une méfiance aussi grandes sinon plus que celle que l’on avait pour les Piémontais… Artisans ou cultivateurs, nobles ou bourgeois font preuve de la même antipathie. Les riches costumes des officiers, les habits brodés et galonnés des employés français n’y peuvent rien, nos salons restent obstinément fermés devant eux. Cela a été pour nos nouveaux maîtres une déception complète, aussi en retour de notre froideur, ils nous donnent l’injure : nous ne sommes plus, comme au moment de l’annexion, les bons Savoisiens, le peuple loyal, aux mœurs douces et affables, nous sommes redevenus les Savoyards, les montreurs de marmottes, le pékin vil et pauvre.
E. Lombard, Le Statut et la Savoie, journal chambérien.
Les vertus, le niveau élevé d’alphabétisation du Queyras sont choses connues : Aux cantons qui ont le goût des procès et où les fermiers se ruinent en papier timbré, il (l’évêque de Digne) disait : Voyez ces bons paysans de la vallée du Queyras. Ils sont là trois mille âmes. Mon Dieu ! C’est comme une petite république. On n’y connaît ni le juge ni l’huissier. Le maire fait tout. Il répartit l’impôt, taxe chacun en conscience, juge les querelles gratis, partage les patrimoines sans honoraires, rend les sentences sans frais ; et on lui obéit, parce que c’est un homme juste parmi des hommes simples.
Aux villages où il ne trouvait pas de maître d’école, il citait encore ceux de Queyras : Savez-vous comment ils font ? disait-il. Comme un petit pays de douze ou quinze feux ne peut pas toujours nourrir un magister, ils ont des maîtres d’école payés par toute la vallée, qui parcourent les villages, passant huit jours dans celui-ci, dix dans celui-là et enseignant. Ces magisters vont aux foires où je les ai vus. On les reconnaît à des plumes à écrire qu’ils portent dans la ganse de leur chapeau. Ceux qui n’enseignent qu’à lire ont une plume ; ceux qui enseignent la lecture et le calcul ont deux plumes ; ceux qui enseignent la lecture, le calcul et le latin ont trois plumes. Ceux-là sont de grands savants. Mais quelle honte d’être ignorants ! Faites comme les gens du Queyras.
Victor Hugo. Les Misérables. Chapitre III . À bon évêque, dur évêché.
Jules Verne a 34 ans et l’éditeur Pierre-Jules Hetzel édite ses Cinq semaines en ballon. C’est le début d’une longue carrière dont le succès ne se démentira pas. Le contrat qui les lie ne manque pas d’ambition : … résumer toutes les connaissances géographiques, géologiques, physiques, astronomiques, amassées par la science moderne, et refaire sous la forme attrayante et pittoresque qui lui est propre, l’histoire de l’univers…
*****
L’art de Jules Verne est d’avoir su donner une forme littéraire, neuve et passionnante à toutes ces idées de progrès, à toutes ces découvertes, de la vapeur à l’électricité, qui étaient dans l’air depuis le début du siècle. Il les a rassemblées, rendus vraisemblables, leur a donné un but, en général désintéressé, une âme, celle de ses héros, bref, il a fait de la science ce qu’Alexandre Dumas a fait de l’histoire de France : une matière vivante à laquelle les lecteurs s’initient sans effort parce qu’elle leur est enseignée à travers une fiction romanesque.
Ghislain de Diesbach Figaro Hors Série Février 2005
Tout ce qui s’est fait dans le monde s’est fait au nom d’espérances exagérées.
Jules Verne
Les succès de Jules Verne font de lui un homme riche, qui peut ainsi s’offrir de bien beaux bateaux, mais aussi la fréquentation assidue de la morphine, à laquelle il dédiera un sonnet :
À la morphine
Prends, s’il le faut, docteur, les ailes de Mercure
Pour m’apporter plus tôt ton baume précieux !
Le moment est venu de faire la piqûre
Qui, de ce lit d’enfer, m’enlève vers les cieux.
Merci, docteur, merci ! qu’importe que la cure
Maintenant se prolonge en des jours ennuyeux !
Le divin baume est là, si divin qu’Épicure
Aurait dû l’inventer pour l’usage des Dieux !
Je le sens qui circule, qui me pénètre !
De l’esprit et du corps ineffable bien-être,
c’est le calme absolu dans la sérénité.
Ah ! perce-moi cent fois de ton aiguille fine
Et je te bénirai cent fois, Sainte Morphine,
Dont Esculape eût fait une Divinité.
Jules Verne, À la morphine, (Poésies inédites) 1866
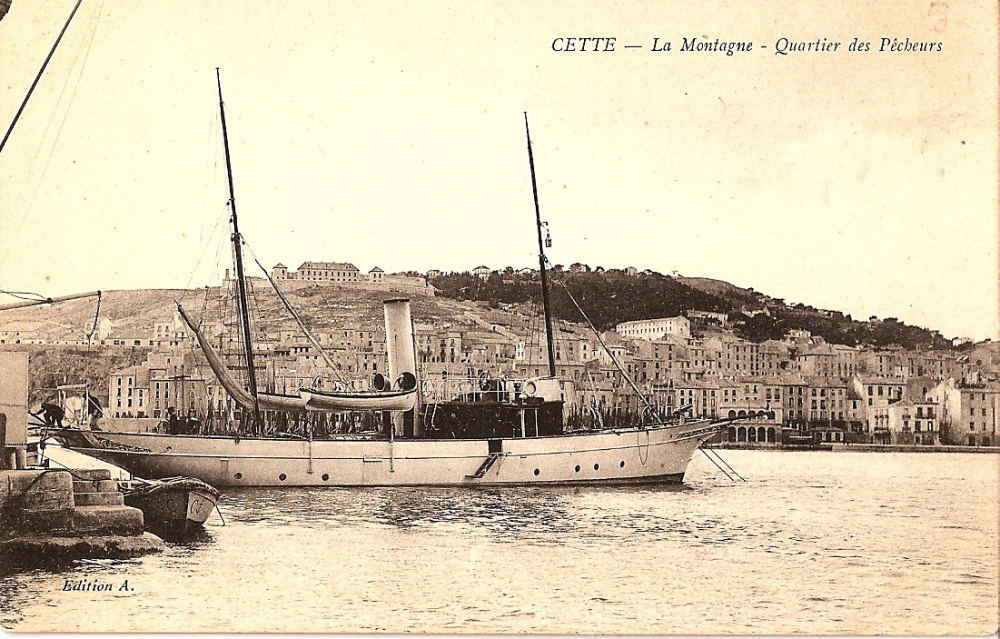
Le Saint Michel III, un des bateaux de Jules Verne. Le Cette de la carte est bien le Sète d’aujourd’hui.
1 01 1863
Abraham Lincoln proclame l’abolition de l’esclavage ; c’est le tournant abolitionniste de la guerre. On comptait alors 3.5 millions d’esclaves dans les États du Sud, sur une population totale de 9 millions d’habitants. Les esclaves des États restés fidèles à l’Union ne sont pas concernés ; Lincoln ne libérait donc que les esclaves des États qui étaient en guerre contre l’Union : libérés, ils furent nombreux à rejoindre l’Union où souvent ils grossirent les rangs de l’armée. Le calcul habile, pour ne pas dire cynique, venait faire contrepoids à la probité.
Le 13° amendement de la Constitution fédérale qui abolissait l’esclavage laissait tout une série de questions non résolues : les anciens esclaves étaient-ils des citoyens ? Avaient-ils des droits politiques ? Pouvaient-ils voter ? Devenir des agents de l’État ? Avaient-ils des droits civiques, pouvaient-ils témoigner en justice, siéger dans un jury ? Et quels étaient leurs droits fonciers ? Des expériences eurent lieu à la fin de la guerre pour distribuer aux anciens esclaves des lopins sur les terres confisquées aux planteurs. Les Blancs se demandaient encore si un esclave était capable de devenir productif en bénéficiant lui-même de son travail, en vendant sa récolte, ou en touchant un salaire… On a critiqué la période en ironisant sur le slogan 40 acres et un mulet, suggérant que les Noirs n’avaient guère bénéficié de l’abolition. Il y eut pourtant au départ une brève période d’espoir, celle des années dites de la reconstruction. Plus de 2 000 Noirs occupèrent des fonctions publiques. Un enseignement public fut prévu pour eux dans le Sud, qui existait déjà dans le Nord. Des institutions crées à cette époque, des églises, des collèges réservés aux Noirs subsistent aujourd’hui. La reconstruction fut riche d’expériences et d’espoirs qui échouèrent sous le coup de la violence, du refus de vote au hommes noirs et de la ségrégation. C’est alors que les lois dites Jim Crow engendrèrent la longue histoire du racisme anti-Noirs du XX° siècle.
Catherine Coquery-Vidrovitch. Les routes de l’esclavage. Histoire des traites africaines, VI°-XX° siècle. Espace libre. Albin Michel 2018
6 02 1863
Lettre de Napoléon III au Gouverneur de l’Algérie [le maréchal Pélisssier, qui mourra un an plus tard].
Monsieur le Maréchal,
Le Sénat doit être saisi bientôt de l’examen des bases générales de la constitution de l’Algérie ; mais, sans attendre sa délibération, je crois de la plus haute importance de mettre un terme aux inquiétudes excitées par tant de discussions sur la propriété arabe. La bonne foi comme notre intérêt bien compris nous en font un devoir.
Lorsque la Restauration fit la conquête d’Alger, elle promit aux Arabes de respecter leur religion et leurs propriétés.
Cet engagement solennel existe toujours pour nous, et je tiens à honneur d’exécuter, comme je l’ai fait pour Abd-el-Kader, ce qu’il y avait de grand et de noble dans les promesses des gouvernements qui m’ont précédé.
D’un autre côté, quand même la justice ne le commanderait pas, il me semble indispensable, pour le repos et la prospérité de l’Algérie, de consolider la propriété entre les mains de ceux qui la détiennent. Comment, en effet, compter sur la pacification d’un pays lorsque la presque totalité de la population est sans cesse inquiétée sur ce qu’elle possède ? Comment développer sa prospérité lorsque la plus grande partie de son territoire est frappée de discrédit par l’impossibilité de vendre et d’emprunter? Comment enfin augmenter les revenus de l’État lorsqu’on diminue sans cesse la valeur du fonds arabe qui seul paye l’impôt ?
Établissons les faits : On compte en Algérie trois millions d’Arabes et deux cent mille Européens, dont cent vingt mille Français. Sur une superficie d’environ quatorze millions d’hectares dont se compose le Tell, deux millions sont cultivés par les indigènes. Le domaine exploitable de l’État est de deux millions six cent quatre-vingt-dix mille hectares, dont huit cent quatre-vingt-dix mille de terres propres à la culture, et un million huit cent mille de forêts ; enfin, quatre cent vingt mille hectares ont été livrés à la colonisation européenne ; le reste consiste en marais, lacs, rivières, terres de parcours et landes. Sur les quatre cent vingt mille hectares concédés aux colons, une grande partie a été soit revendue, soit louée aux Arabes par les concessionnaires, et le reste est loin d’être entièrement mis en rapport. Quoique ces chiffres ne soient qu’approximatifs, il faut reconnaître que, malgré la louable énergie des colons et les progrès accomplis, le travail des Européens s’exerce encore sur une faible étendue, et que ce n’est certes pas le terrain qui manquera de longtemps à leur activité.
En présence de ces résultats, on ne peut admettre qu’il y ait utilité à cantonner les indigènes, c’est-à-dire prendre une certaine portion de leurs terres pour accroître la part de la colonisation.
Aussi est-ce d’un consentement unanime que le projet de cantonnement soumis au conseil d’État a été retiré. Aujourd’hui il faut faire davantage : convaincre les Arabes que nous ne sommes pas venus en Algérie pour les opprimer et les spolier, mais pour leur apporter les bienfaits de la civilisation.
Or, la première condition d’une société civilisée, c’est le respect du droit de chacun.
Le droit, m’objectera-t-on, n’est pas du côté des Arabes ; le sultan était autrefois propriétaire de tout le territoire, et la conquête nous l’aurait transmis au même titre ! Eh quoi ! l’État s’armerait des principes surannés du mahométisme pour dépouiller les anciens possesseurs du sol, et sur une terre devenue française il invoquerait les droits despotiques du Grand Turc ! Pareille prétention est exorbitante, et voulût-on s’en prévaloir, il faudrait refouler toute la population arabe dans le désert et lui infliger le sort des Indiens de l’Amérique du Nord, chose impossible et inhumaine.
Cherchons donc par tous les moyens à nous concilier cette race intelligente, fière, guerrière et agricole. La loi de 1851 avait consacré les droits de propriété et de jouissance existant au temps de la conquête ; mais la jouissance, mal définie, était demeurée incertaine. Le moment est venu de sortir de cette situation précaire. Le territoire des tribus une fois reconnu, on le divisera par douars, ce qui permettra plus tard à l’initiative
prudente de l’administration d’arriver à la propriété individuelle.
Maîtres incommutables de leur sol, les indigènes pourront en disposer à leur gré, et de la multiplicité des transactions naîtront entre eux et les colons des rapports journaliers, plus efficaces pour les amener à notre civilisation que toutes les mesures coercitives.
La terre d’Afrique est assez vaste, les ressources à y développer sont assez nombreuses pour que chacun puisse y trouver place et donner un libre essor à son activité, suivant sa nature, ses mœurs et ses besoins.
Aux indigènes, l’élevage des chevaux et du bétail, les cultures naturelles au sol.
À l’activité et à l’intelligence européennes, l’exploitation des forêts et des plaines, les desséchements, les irrigations, l’introduction des cultures perfectionnées, l’importation de ces industries qui précèdent ou accompagnent toujours les progrès de l’agriculture.
Au gouvernement local, le soin des intérêts généraux, le développement du bien-être moral par l’éducation, du bien-être matériel par les travaux publics. À lui le devoir de supprimer les réglementations inutiles et de laisser aux transactions la plus entière liberté. En outre, il favorisera les
grandes associations de capitaux européens, en évitant désormais de se faire entrepreneur d’émigration et de colonisation, comme de soutenir péniblement des individus sans ressources attirés par des concessions gratuites.
Voilà, Monsieur le Maréchal, la voie à suivre résolument ; car, je le répète, l’Algérie n’est pas une colonie proprement dite, mais un royaume arabe. Les indigènes ont, comme les colons, un droit égal à ma protection, et je suis aussi bien l’Empereur des Arabes que l’Empereur des Français.
Ces idées sont les vôtres ; elles sont aussi celles du ministre de la guerre et de tous ceux qui, après avoir combattu dans ce pays, allient à une pleine confiance dans son avenir une vive sympathie pour les Arabes. J’ai chargé le maréchal Randon de préparer un projet de sénatus-consulte dont l’article principal sera de rendre les tribus, ou fractions de tribu, propriétaires incommutables des territoires qu’elles occupent à
demeure fixe et dont elles ont la jouissance traditionnelle, à quelque titre que ce soit.
Cette mesure, qui n’aura aucun effet rétroactif, n’empêchera aucun des travaux d’intérêt général, puisqu’elle n’infirmera en rien l’application de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Je vous prie donc de m’envoyer tous les documents statistiques qui peuvent éclairer la
discussion du Sénat.
Sur ce, Monsieur le Maréchal, je prie Dieu qu’il vous ait en sa sainte garde.
Napoléon.
15 04 1863
À la suite de la guerre de Crimée, Napoléon III avait mis en place dans les Balkans et sur le littoral de la Mer Noire de nombreux consulats et vice consulats : Charles Champoiseau, 27 ans, avait été en poste dès 1857 à Plovdiv – aujourd’hui en Bulgarie – puis à partir de mars 1862, gérant par intérim du consulat d’Andrinople – aujourd’hui Edirne, en Turquie d’Europe -. Il ne possédait pas de formation d’archéologue mais savait l’empereur friand d’antiquités. En séjour à Aïnos pour y installer une agence consulaire, il entend vanter par tout le monde les antiquités de Samothrace, une île à l’ouest du détroit des Dardanelles. Il obtient une maigre allocation pour entreprendre des fouilles et c’est la découverte de la merveille dont il relate les circonstances à son supérieur hiérarchique, le marquis de Moustier, ambassadeur de France à Constantinople.
Samotraki, 15 avril 1863
Monsieur le Marquis,
Aujourd’hui même, je viens de trouver en fouillant, une statue de la Victoire ailée (selon toute apparence) en marbre et de proportions colossales. Par malheur, je n’ai ni la tête ni les bras à moins que je ne trouve des morceaux en fouillant aux alentours. Le reste, c’est-à-dire toute la partie comprise entre le bas des seins et les pieds [2.10 m] est presque intact et traité avec un art que je n’ai jamais vu dépassé dans aucune des belles œuvres grecques que je connais ; même pas les bas-reliefs de la Victoire aptère ou les Caryatides de l’Erechthéion du Parthénon [sic]. Les draperies sont tout ce que l’on peut rêver de plus ravissant : c’est de la mousseline de marbre collées par le vent sur des chairs vivantes ; le tout sans l’ombre d’une hyperbole.
Le mauvais coté de la découverte, c’est que la statue, même mutilée, pèse 1 200 à 1 500 kilogrammes et que je ne pourrai la porter au rivage des hauteurs escarpées où elle se trouve qu’avec des peines excessives et d’énormes dépenses. L’embarquement à bord d’un bateau du pays présente encore plus de difficultés sinon d’impossibilités.
L’ambassadeur dépêchera l’Ajaccio, navire stationnaire de l’ambassade pour prendre en charge la logistique. La Victoire de Samothrace mettra du temps pour arriver au Louvre mais elle y parviendra, sauvée d’une destruction certaine si on l’avait laissé en place, [ainsi se justifiaient les grands musées européens de leurs pillages des sites archéologiques.]
Dans un rapport ultérieur, Charles Champoiseau décrit l’environnement immédiat de la découverte :
Édifice où a été trouvé la statue de la Victoire
En allant un jour surveiller les fouilles du grand temple, je remarquai un marbre à demi-enfoui et présentant l’aspect d’un débris de statue. Je le dégageai et reconnus une épaule de femme avec le haut du sein et la base du cou. Les ouvriers amenés immédiatement déterrèrent des marbres dont les angles dépassaient à peine le sol de quelques millimètres et bientôt mirent au jour une plateforme AA auprès de laquelle était couchée EE la statue que j’ai nommée à tort ou à raison statue de la Victoire. Désireux de trouver la tête, les bras qui manquaient à ce magnifique corps, je fis fouiller tout à l’entour mais sans résultat autre que de me donner les fragments des ailes, des draperies, des jambes ; fragments contenus dans un tonneau qui arrivera à Paris avec la statue. Les déblais poussés à plusieurs mètres de l’endroit où se trouvait [sic] la statue et l’épaule [cette dernière à fleur de terre, comme je l’ai dit] dégagèrent la totalité du monument composé d’un mur CC en tuf calcaire, de la plateforme AA, de degrés en tuf calcaire BB et enfin d’une vingtaine de morceaux énormes en marbre gris-blanc uni, et taillés de façon à les faire regarder comme des espèces de pylônes de genre égyptien. Sur la plateforme même et renversés sans dessus dessous, gisait un sarcophage plein, également en marbre gris, composé de trois morceaux. Un tremblement de terre, quelque que violent qu’il soit, me semble impuissant à produire le désordre qui régnait parmi ces débris, complets du reste, remarquables par leurs proportions et bizarres par leur forme. On eut dit que sarcophages et pylônes dressés sur la partie sud du mur D ou appuyés contre lui étaient tombés sur la statue et l’avaient renversé en la brisant. S’il est permis de se livrer à des conjectures lorsque l’on n’a devant les yeux ni une inscription ni un objet quelconque propre à vous éclairer, je penche vers cette opinion que nous sommes en présence d’un monument funéraire élevé soit à l’un des Ptolémée soit à un des généraux d’Alexandre qui régnèrent à la fois sur la Thrace et sur l’Égypte, Séleucus, Lysimaque ou tout autre.
Les analyses postérieures d’archéologues infirmeront les interprétations de Champoiseau : en fait la Victoire de Samothrace reposait sur des blocs de marbre représentant la proue d’une galère. Elle remonte aux alentours de ~200 av. J.C. On n’a aucune certitude quant à l’identité du sculpteur qui pourrait être Eutychides de Sycione ou un brillant élève de Scopas de Paros.
Elle sera restaurée en 2014 :
Cette déesse ailée, messagère de la Victoire, ou Niké en grec, se tient en équilibre à la proue d’un vaisseau sculpté dans un marbre gris bleu provenant de Lartos, sur l’île de Rhodes, dans le sud de la mer Egée. À peine le pied posé, la Niké vient répandre la bonne nouvelle. Serait-ce celle d’une bataille navale victorieuse, comme le laisse supposer l’embarcation qui a la silhouette des navires de guerre de l’époque hellénistique (III°-II° av. J.C.), armés de deux éperons, dans la quille et l’étrave, et d’une double rangée de sabords de nage pour les rameurs ? Rien ne l’affirme. Les textes littéraires anciens n’en disent mot.
Sa robe, ou chitôn, en léger tissu resserré par une cordelette sous les seins, plaquée par le vent, dévoile une anatomie parfaite, nombril, seins, jambe dénudée dans un tourbillon. Sensualité à fleur de peau prise sur le vif. Son lourd manteau drapé glisse sur les hanches. Il est bordé d’un galon bleu invisible à l’œil nu, mais révélé par l’infrarouge. Preuve d’une polychromie jusque-là inconnue. Ses ailes, en porte-à-faux, sont un défi aux lois de la pesanteur.
Nœud papillon en bataille, cheveux à la Chateaubriand, Ludovic Laugier, copilote de la restauration, salue la fougue du mouvement, l’instantanéité, la sensation du vent, le bouillonnement de l’étoffe, la transparence sur les chairs. Le sculpteur a su saisir dans la pierre le bref moment où la draperie tient par le seul effet du vent.
[…] L’œuvre réalisée entre 180 et 160 av. J.C. pourrait commémorer la grande bataille navale de Cyrène (Libye), tout en s’inspirant des draperies du fronton du Parthénon, réalisées deux siècles auparavant. Tout cela n’est qu’hypothèses, insiste le scientifique.
[…] La déesse a été trouvée dans un sanctuaire dédié aux grands dieux où se pratiquait le culte des mystères, protégeant les initiés des dangers de la mer. Un petit sanctuaire, très dense, riche, plein de chapelles votives, coincé entre deux torrents au sommet du mont de la Lune, avec la mer bleu marine en contrebas. On y accède par un sentier qui grimpe entre les lauriers roses et les platanes géants.
Huit nouveaux fragments du vaisseau ont été identifiés sur place. Le Louvre a retrouvé aussi dans ses réserves neuf blocs de la même origine arrivés en caisses en 1864 à Paris. Le vilain socle du XIX° a été supprimé, rendant sa grâce tout en mouvement à la composition.
Une opération d’un coût de 4 millions € avec la restauration de l’escalier, dont le quart a été financé par un mécénat populaire.
Florence Evin. Le Monde Juillet 2014
Avril 1863. Le voyage de la belle Niké, victoire en grec, débute, disposée façon puzzle dans des caisses de bois garnies de paille descendues à dos de mulet jusqu’au port. Cent-vingt pièces en marbre blanc de Paros partent : bouts de jambes, de torse, parties d’ailes, plus une multitude de fragments. Mais ni tête, ni bras. Champoiseau a laissé sur place de gros blocs de marbre gris, non identifiés et trop lourds. [Ils seront récupérés ultérieurement]. La cargaison prend le large en avril 1863. Direction Constantinople, puis le port du Pirée, où les caisses sont transférées sur un navire militaire de la flotte de Napoléon III qui les convoie jusqu’à l’arsenal de Toulon. Elles y croupissent six mois et arrivent finalement au Louvre en mai 1864. À leur ouverture, c’est un chef d’œuvre exceptionnel qui apparaît, mais en miettes, à tel point qu’on fait appel à un restaurateur de vases antiques pou reconstituer l’ensemble. […] D’abord exposé sans buste, il faudra plus de vingt ans pour arriver à l’aspect qu’on lui connait, avec des ajouts modernes en plâtre, notamment une bonne partie du torse, dont le sein gauche, le dos et l’aile droite tout entière.
Sophie Cachon Télérama n° 3886 du 6 au 12 juillet 2024
Pour autant, la Victoire n’en aura pas fini avec les voyages : en 1939, elle partira dans une caisse à claire-voie sur une sorte de piste en bois descendant l’escalier Daru pour le château de Valençay, dans l’Indre où elle restera jusqu’en juillet 1945, regagnant alors ses pénates.

30 04 1863
Pour permettre le passage d’un convoi de ravitaillement, les 65 légionnaires du capitaine Danjou tiennent en respect pendant 9 heures 1 200 fantassins et 600 cavaliers mexicains à Camerone, au nord-est de Puebla, au Mexique. Lorsqu’il n’y eut plus que 9 hommes valides, et 25 blessés, le caporal Maine, répondit à la demande de reddition du colonel Cambas : Nous nous rendrons si vous nous faites la promesse la plus formelle de relever et de soigner notre sous-lieutenant et tous nos camarades atteints, comme lui, de blessures ; si vous nous promettez de nous laisser notre fourniment et nos armes. Enfin, nous nous rendrons si vous vous engagez à dire à qui voudra l’entendre que, jusqu’au bout, nous avons fait notre devoir.
Réponse devenue le serment de Camerone.
On ne refuse rien à des hommes comme vous, répondit le colonel mexicain.
La Légion fera de ce jour sa fête traditionnelle.
Ils furent ici moins de soixante
opposés à toute une armée.
Sa masse les écrasa.
La vie plutôt que le courage
abandonna ces soldats français
à Camerone le 30 avril 1863



05 1863
Puebla supporte un deuxième siège et tombe aux mains des Français.
8 06 1863
Quinze jours plus tôt, Ferdinand Lassalle a fondé l’Association des Travailleurs Allemands, forte de 600 membres, venus de toutes les régions d’Allemagne, demandant la république et le suffrage universel. Il est encore très proche de Karl Marx. Son activisme fait peur à Bismarck : ils se rencontrent secrètement et s’ensuit cette lettre très troublante de Lassalle à Bismarck par laquelle il lui dit approuver sa dictature à condition qu’elle prenne la forme d’une dictature sociale : La classe ouvrière se sent instinctivement encline à la dictature si elle peut être légitimement convaincue que celle-ci sera exercée dans ses intérêts et donc […] elle serait encline, comme je vous l’ai dit récemment – en dépit de tous ses sentiments républicains, ou peut-être pour cette même raison -, à voir dans la Couronne le soutien naturel de la dictature sociale, par opposition à l’égoïsme de la société bourgeoise.
*****
Fidèle aux idées qu’il a déjà exprimées, Lassalle propose ainsi à Bismarck de sceller une alliance entre le prolétariat, la paysannerie, l’aristocratie et l’armée contre la bourgeoisie. Naturellement intéressé, le chancelier entame à cette fin une correspondance secrète avec Lassalle, et les deux hommes se rencontrent même à plusieurs reprises au cours des semaines suivantes. Bismarck y trouve du plaisir. Cette idée de dictature sociale leur va bien à tous les deux. Elle est d’ailleurs presque consubstantielle à la société prussienne depuis que Hegel y a fait l’apologie de l’État comme lieu de vérité absolue. On la verra resurgir tout au long de l’histoire allemande et il n’est pas excessif de la considérer comme un jalon sur la voie qui mène de Hegel au national-socialisme en passant par cette dictature sociale imaginée par Lassalle.
Jacques Attali. Karl Marx, ou l’Esprit du monde. Fayard 2005
3 07 1863
Les Unionistes, au terme de 3 jours de combat, gagnent la bataille de Gettysburg à l’ouest de Philadelphie (c’est le point du front le plus au nord de toute la guerre) sur les Confédérés : ces derniers auront perdu 28 000 hommes, les unionistes, 23 000. Mais Lee parvient à faire traverser le Potomac au reste de ses troupes, se mettant ainsi à l’abri des poursuites : Lincoln aura du mal à l’accepter : Notre armée tenait l’issue de la guerre dans le creux de sa main et elle n’a pas voulu le refermer. L’avantage change de camp et l’Union, de plus en plus supérieure en nombre, de mieux en mieux armée par la puissance de l’industrie du nord, se met à engranger les succès jusqu’à la capitulation des confédérés.
5 07 1863
Ernest Doudart de Lagrée, parti pour la Cochinchine en 1862, signe à Saïgon le traité qui attribue à la France un protectorat sur le Cambodge. La configuration physique de la péninsule indochinoise explique sa grande complexité linguistique et ethnographique Aux zones montagneuses où sont établies les ethnies minoritaires montagnardes s’opposent les deltas des grands fleuves, les plaines et les vallées. La Birmanie, le Laos et le Vietnam sont les pays qui comptent le plus grand nombre de minorités par rapport à la Thaïlande et au Cambodge couverts de plaines et de plateaux. Il existe officiellement 48 groupes ethniques au Laos.
On peut identifier quatre grands groupes correspondant à des phases de peuplement différentes du Laos :
- les Austro-asiatiques ou Môn-Khmers, présents sur tout le territoire avant l’arrivée des autres populations. Ils sont nombreux au nord comme au sud. Les explorateurs et administrateurs coloniaux leur ont donné les noms de Moï, au Vietnam, Kha, au Laos et Phnong, au Cambodge. Ces termes signifient sauvages.
- Les Taï-Lao : ils proviennent du sud de la Chine et sont arrivés à partir du 7-9° siècle. Ce sont essentiellement les Lao et les Taï, installés principalement dans les plaines ou les vallées.
- Les Hmong-Mien (Miao-Yao) viennent du sud de la Chine et sont arrivés à la fin du 19e siècle. On les trouve depuis le nord du Laos jusqu’à Vientiane.
- Les Tibéto-Birmans sont descendus essentiellement du Yunnan et sont arrivés au cours du 19° siècle. Ils sont dans le nord du Laos.
Les premières cartes ethnolinguistiques datent de la colonisation. Il était en effet important pour l’administration d’identifier ses interlocuteurs. Mais la seule véritable distinction était entre les populations de langues taï d’un côté et les Khas de l’autre.
13 07 1863
La guerre de Sécession dure, et l’enrôlement devient obligatoire… sauf pour ceux qui peuvent débourser 300 $. New York est aux mains de plusieurs bandes organisées qui n’ont que la misère en commun. Faute d’avoir réalisé que les enfants du Bon Dieu étaient en fait des canards sauvages, les distingués nordistes de Washington et leurs tuniques bleues durent faire face à une révolte à l’annonce de cette mesure : l’affrontement durera plusieurs jours. La marine donnera du canon : on comptera 2 000 morts, plus de 10 000 blessés. Les Américains, peu fiers de l’épisode, l’oublièrent jusqu’à ce que Martin Scorcèse découvre en 1970 le livre Gangs of New York de Herbert J. Asbury (avec lexique d’argot criminel), et que l’idée d’en faire un film ne le lâche plus : il sortira en 2003.
Les chefs de bande étaient des voleurs, des joueurs, des receleurs et des assassins, à la tête d’une importante et dévouée clientèle ; payés par les politiciens municipaux pour donner quand il le fallait un coup de pouce aux urnes, ils se savaient, le reste du temps, sûrs de l’impunité. Ils travaillaient en bandes (gangs), surtout pendant les émeutes et les incendies, et occupaient leurs loisirs à danser et à boire dans des caveaux (dives), ou à parier aux combats de coqs. Certains vauriens, dits rats de quai, avaient pour spécialité d’éventrer les marchandises fraîchement débarquées et de dévaliser les marins dans les mauvais lieux de South Street. Leurs méfaits atteignirent leur apogée pendant et au lendemain de la guerre civile où, sous l’œil d’une police médiocre et d’une municipalité complaisante, ils détroussaient après les avoir endormis, – déjà – au chloral et à la morphine, les danseurs des Mabille (célèbre bal parisien) voisins ; ils n’hésitaient pas à profaner les cimetières. Cela dura jusque vers 1910, alors la police, avec la brutalité qui lui est habituelle, procéda soudain à un nettoyage à coups de mitrailleuse, comme on le fait à Chicago, – ville qui ressemble encore beaucoup au New York de ces temps héroïques.
Paul Morand. New-York. 1929
07 1863
Les troupes françaises maîtrisent les principaux centres du Mexique, dont la couronne est offerte à l’archiduc Maximilien de Habsbourg, frère de François Joseph, empereur d’Autriche ; il importe un gouvernement de ses proches.
19 09 1863
Quatorze ans après la mort de Chopin, des soldats russes, occupant Varsovie, jettent son piano par une fenêtre du 4° étage.
14 08 1863
Train Béziers-Lodève. Henri Germain fonde le Crédit Lyonnais.
21 08 1863
Montalembert prend la parole au congrès des catholiques belges, à Malines, devant une assistance essentiellement composée de cardinaux, évêques, prêtres et religieux : Dans une moitié de l’Europe, la démocratie est déjà souveraine ; elle le sera demain dans l’autre. […] L’Italie, l’Espagne, le Portugal sont là pour prouver l’impuissance radicale du système oppressif de l’ancienne alliance de l’autel et du trône pour la défense du catholicisme. […] L’inquisiteur espagnol disant à l’hérétique : la vérité ou la mort ! m’est aussi odieux que le terroriste français disant à mon grand’père : La liberté, la fraternité ou la mort ! La conscience humaine a le droit d’exiger qu’on ne lui pose plus jamais ces hideuses alternatives.
Il a droit à une standing ovation [le signifiant n’existait pas, mais le signifié oui].
26 10 1863
Au Freemason’s Tavern – la Taverne des Francs-Maçons – de Londres, quelques gentlemen, en fondant la FA : Football Association, inventent les règles de ce jeu, presque toutes encore en vigueur aujourd’hui.
13 11 1863
Abraham Lincoln inaugure le cimetière de Gettysburg : Il y a quatre vingt sept années que nos pères ont fondé sur le sol de ce continent, une nation, conçue dans la liberté et construite sur l’idée de l’égalité entre les hommes.
Maintenant, nous sommes engagés dans une grande guerre civile, épreuve qui décidera si cette nation, ou tout autre nation, ainsi conçue et vouée au même idéal, peut résister au temps. Nous sommes réunis sur un des grands champs de bataille de cette guerre. Nous sommes venus consacrer un coin de cette terre qui deviendra le dernier champ de repos de tous ceux qui sont morts pour que vive notre pays. Il est à la fois juste et digne de le faire.
Pourtant, en voyant plus loin, nous ne pouvons ni dédier ni consacrer, ni sanctifier ce coin de terre. Les braves, vivants et morts, qui se sont battus ici, l’ont déjà consacré bien au-delà de notre faible pouvoir de magnifier ou de minimiser. Le monde ne sera guère attentif à nos paroles, il ne s’en souviendra pas longtemps, mais il ne pourra jamais oublier ce que les hommes ont fait. C’est à nous les vivants de nous vouer à l’œuvre inachevée que d’autres ont si noblement entreprise. C’est à nous de nous consacrer plus encore à la cause pour laquelle ils ont offert le suprême sacrifice ; c’est à nous de faire en sorte que ces morts ne soient pas morts en vain ; à nous de vouloir qu’avec l’aide de Dieu notre pays renaisse dans la liberté ; à nous de décider que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ne disparaîtra jamais de la face du monde.
Ce texte est gravé à l’intérieur du mémorial de Lincoln à Washington.
8 12 1863
À Santiago du Chili, Don Juan Ugarte, curé de l’église de la Compagnie de Jésus, a voulu bien faire les choses pour la fête de l’Immaculée Conception, et les cierges et bougies se comptent par centaines. Bien sûr, il y a foule, peut-être 3 000 fidèles : il a fallu fermer les portes pour empêcher de rentrer ceux qui de toutes façons n’auraient pu trouver place. Un cierge laisse échapper sa cire fondue sur un tissu qui prend feu, et propage ainsi le feu en hauteur, faisant chuter les lampes : c’est l’embrasement. Les fidèles se précipitent vers la sortie, mais les portes s’ouvrant vers l’intérieur, la pression de la foule empêche leur ouverture. On comptera environ 2 500 morts, mais pas un seul prêtre. Le bon père Don Juan Ugarte ne connaîtra aucun ennui particulier.
1863
Premières caravanes scolaires dans les Alpes, organisées par des collèges libres. À Londres, mise en service de la première ligne de métro : 6,4 km de long, exploitée en traction à vapeur : c’est le Metropolitan Railway. Il faudra attendre 1891 pour que électricité remplace la vapeur. Le Belge Ernest Solvay et ses frères créent Solvay Cie pour exploiter un brevet de fabrication de soude à l’ammoniaque : en 1870, elle sera la seule multinationale à produire en Europe, en Russie et aux États-Unis. Les Arméniens de l’Empire Ottoman obtiennent le droit de se doter d’une assemblée régie par une constitution nationale : mais les nombreuses révoltes durement réprimées vont étouffer dans l’œuf le projet prometteur d’autonomie.
Arminius Vanbéry, hongrois déguisé en derviche, visite les grandes villes d’Asie Centrale, la plupart au sud, sud-est de la mer d’Aral, l’actuel Kazahkstan. Le récit qui suit se passe à Khiva, essentiellement peuplée d’Euzbeg.
[…] Je trouvai, dans la dernière cour, environ trois cents prisonniers Tchaoudor (une tribu turkmène) absolument déguenillés ; ces malheureux, dominés par la crainte de leur prochain supplice et livrés de plus à toutes les angoisses de la faim, semblaient littéralement sortir du tombeau. On en avait formé deux sections : dans la première étaient ceux qui, n’ayant pas atteint leur quarantième année, devaient être vendus comme esclaves ou gratuitement distribués par le khan à ses créatures : la seconde comprenait ceux que leur rang ou leur âge avait classé parmi les parmi les aksakals – les Anciens de la tribu tartare -, et qui restaient soumis au châtiment infligé par le prince. Les premiers, réunis l’un à l’autre au moyen de colliers de fer, par files de dix à quinze, furent successivement emmenés ; les autres attendaient, avec une résignation parfaite, qu’on exécutât l’arrêt porté contre eux. On eût dit autant de moutons sous le couteau du boucher. Pendant que plusieurs d’entre eux marchaient soit à la potence, soit au bloc sanglant sur lequel plusieurs têtes étaient déjà tombées, je vis, à un signe du bourreau, huit des plus âgés, s’étendre à la renverse sur le sol. On vint ensuite leur garrotter les pieds et les mains, puis l’exécuteur, s’agenouillant sur leur poitrine, plongeait son pouce sous l’orbite de leurs yeux dont il détachait au couteau les prunelles ainsi mises en saillie. Après chaque opération, il essuyait sa lame ruisselante sur la barbe blanche du malheureux supplicié.
Spectacle atroce, je puis le dire ! L’exécution aussitôt terminée, la victime, délivrée de ses liens et jetant de tous côtés les mains autour d’elle, cherchait à se relever. Parfois, trébuchant au hasard, leurs têtes s’entrechoquaient ; parfois, trop faibles pour se tenir debout, ils se laissaient retomber à terre avec un sourd gémissement qui, lorsque j’y pense, me donne encore le frisson.
Si abominables que ces détails puissent paraître au lecteur, il me faut bien ajouter que ces cruautés se justifiaient par la loi des représailles et que les Tchaoudor étaient ainsi punis pour avoir traité avec les mêmes raffinements de barbarie les membres d’une caravane euzbeg surprise par eux, dans le cours de l’hiver précédent, sur la route d’Orenbourg à Khiva. Elle comptait, dit-on, jusqu’à deux mille chameaux, et les Turkomans, – qui après avoir pris possession d’une immense quantité de marchandises russes, auraient dû se contenter d’un si riche butin, – n’en dépouillèrent pas moins, de tout ce qu’ils possédaient en fait de vêtements et de denrées alimentaires, les Euzbegs Khivites dont elle se composait en grande partie. Ils périrent à peu près tous au milieu du Désert, quelques-uns de faim, les autres de froid. Huit à peine sur soixante parvinrent à se sauver.
Il ne faudrait pas regarder comme un cas exceptionnel l’horrible scène que je viens de décrire. À Khiva comme dans toute l’Asie centrale, on n’est sans doute pas cruel pour le plaisir de l’être, mais on trouve de tels procédés parfaitement naturels, et la coutume, les lois, la religion s’accordent à les sanctionner. Le souverain actuel de Khiva voulait tout simplement, se signaler comme protecteur de la religion et croyait y réussir en châtiant, avec une extrême rigueur, toute violation des préceptes sacrés. Il suffisait de jeter un regard sur une femme enveloppée de son voile pour être livré au redjm, conformément aux clauses pénales édictées dans les saints livres. En pareil cas, l’hommes est pendu, et la femme, enterrée jusqu’au buste dans le voisinage de la potence, est lapidée jusqu’à ce que mort s’en suive. Le sol de Khiva ne fournit pas de cailloux, mais on les remplace par des kesek (boule de terre cuite). À la troisième décharge, une enveloppe de poussière a rendu méconnaissable cette victime infortunée dont le cadavre déchiré n’a déjà plus forme humaine, et on l’abandonne alors aux longues angoisses de l’agonie. Ce n’est pas seulement contre l’adultère, mais contre beaucoup d’autres offenses à la religion que le khan a voulu promulguer la peine de mort, si bien que, dans les premières années de son règne, les Oulémas eux-mêmes se virent obligés de réprimer les entraînements de sa piété trop zélée. Malgré leur intervention, il ne se passe guère de jours sans que l’une ou l’autre des personnes admises à l’audience du prince, ne soit emmenée hors du palais, après avoir entendu l’arrêt sommaire qui dispose définitivement de sa destinée : Alib barin ! (Emmenez-le)
Le yasoul me conduisit ensuite – j’allais oublier ce détail -, chez le trésorier, qui me compta sans difficulté la somme à laquelle j’avais droit. Cette transaction, par elle-même, n’avait rien de fort intéressant, mais je trouvais ce personnage occupé d’un travail trop curieux pour que je le passe sous silence. Il assortissait des khilat (robes d’honneur) qu’on devait envoyer au khan pour récompenser les services hors-ligne. Ces vêtements en soie, de couleur voyante et décorés de grandes fleurs en fils d’or, étaient de quatre espèces ou catégories différentes. On les désignait sous le nom de robes à quatre, à douze, à vingt, à quarante têtes. Comme, dans les dessins ou les broderies dont elles étaient couvertes, je ne voyais rien qui légitimât une pareille appellation, je voulus savoir à quoi elle s’appliquait : on me répondit que les plus simples se donnaient au soldat qui rapportait quatre têtes ennemies, et les plus belles à celui qui en fournissait quarante. Quelqu’un ajouta que si tel n’était pas l’usage du pays de Roum, je ferais bien de me rendre le lendemain matin sur la principale place, où j’assisterais à la distribution de ces glorieux emblèmes. Je n’eus garde, on le devine, de manquer à cette assignation, et je vis, en effet, arriver du camps à peu près cent cavaliers dont les vêtements poudreux avaient un air tout à fait martial. Chacun d’eux amenait au moins un prisonnier, et parmi ceux-ci, des femmes, des enfants, attachés soit à la queue du cheval, soit au pommeau de la selle ; il portait de plus, sanglé derrière lui, un grand sac où se trouvaient les têtes enlevées à l’ennemi, témoignage irréfragable des hauts faits accomplis sur le champ de bataille. Son tour venu, il offrait les prisonniers soit au Khan, soit à quelque notable personnage, et, débouclant ensuite son sac qu’il saisissait par les deux angles inférieurs, il vidait aux pieds de l’agent comptable, – celui-ci les repoussant du pied comme s’il se fut agi de pommes de terre, – le monceau de têtes, barbues ou imberbes, en échange duquel il allait lui être octroyé des insignes plus ou moins honorifiques. Suivant l’importance de la livraison, il était porté sur les registres pour tel ou tel nombre de têtes, et la rétribution ne se faisait pas attendre au-delà de quelques jours.
Arminius Vambery. Voyages d’un faux derviche dans l’Asie Centrale : de Téhéran à Khiva, Bokhara et Samarcand par le grand désert turkoman (1873), traduit de l’anglais par E.D. Forgues, éd. You-Feng, 1987
En ce temps-là, les glaciers de Chamonix venaient encore lécher le fond de la vallée

Mont Blanc et glacier des Bossons : photographie des frères Bisson, 1863. Au dernier plan, à droite, l’Aiguille du Goûter, au centre le Dôme du Goûter et au fond à gauche le Mont-Blanc, tout en neige. Au premier plan à gauche, en amont du glacier des Bossons, les contreforts rocheux du Mont Blanc du Tacul et du Mont Maudit.
3 01 1864
Le Grafton, une goélette de 56 tonneaux, a quitté Sydney le 12 novembre 1863 pour découvrir, selon les informations reçues, une mine d’étain argentifère sur l’île Campbell, au sud de la Nouvelle Zélande. Le chef d’expédition, le français François Édouard Raynal, 33 ans, non seulement ne découvre aucune mine sur l’île Campbell, mais en plus y tombe gravement malade. Les quatre autres membres de l’équipage sont Henry dit Harry Forges, portugais, cuisinier, George Harris, matelot anglais, Alexander, dit Alick Mc Larren, norvégien de 28 ans matelot taciturne, et Thomas Musgrave, le commandant, américain de 30 ans. Ces cinq hommes ne se connaissaient pas avant d’embarquer sur le Grafton. Pour ne pas rentrer bredouille à Sydney, ils décident d’aller dans les eaux de l’île Auckland voir s’ils trouvent des éléphants de mer, alors très recherchés. Cette île est sur leur chemin de retour à Sydney. Le 2 janvier, le temps se gâte, qui devient tempête et les pousse vers la côte. Ils mouillent les deux ancres mais la tempête casse les chaînes et ils se mettent à talonner puis se plantent sur un caillou. Ils mettent à l’eau le canot de secours et débarquent sur terre, sans penser un instant qu’ils allaient être là pour 20 mois : ce sont les îles Auckland, un archipel de 510 km², 42 km de long, avec une côte très découpée qui ressemble à des fjords.
Une fois la tempête calmée, ils vont chercher sur l’épave tout ce dont ils peuvent avoir besoin : 100 livres de biscuit, 50 de farine, du sel, de la viande, une bouilloire, des allumettes, un fusil, etc.. un peu d’outillage et d’instruments de navigation. Pour la nourriture, cela se compte en jours… donc il va falloir rapidement exploiter les ressources locales, essentiellement l’éléphant de mer, aujourd’hui nommé lion de mer. Ils parviendront à se construire une cabane, à utiliser le sel récupéré pour conserver la viande etc … mais surtout, même avec ce petit nombre, François Édouard Raynal saura créer les conditions de vie pour que la zizanie ne prenne pas le dessus ; il considère que ces cinq hommes forment une famille et procède donc à l’élection d’un chef de famille : c’est Thomas Musgrave qui va être élu. Raynal s’aperçoit-il que le jeu de cartes le met dans tous ses états, qu’il triche ? … on ne va pas faire jouer les sanctions prévues par le règlement pour de pareilles bricoles… c’est le jeu de cartes qui part au feu. De même qu’on abandonnera un projet de fabrication de bière, techniquement réalisable. On s’occupe du mieux possible : cours de langues, lectures des rares livres sauvés du naufrage etc… A-t-on oublié de se signaler ? On répare cela en dressant mât et drapeau sur un cap le 7 février… qui ne fait venir personne. On décide alors de la construction d’un navire pour rejoindre la Nouvelle-Zélande, avec les restes du Grafton mais la chose s’avère rapidement impossible, faute d’outils appropriés. On se rabat sur une autre solution : transformer le canot en navire propre à naviguer – un semblant de quille, un pont, un mât et une voile, un gouvernail – , avec un inconvénient majeur : il ne pourra emmener que trois hommes. En mai, la neige fait son apparition… le feu est entretenu constamment… le tannage des peaux se révèle efficace après cinq mois de traitement. Les coquillages passés au feu permettent d’obtenir de la chaux qui permet de construire en dur.
Le 19 juillet 1865, le canot peut appareiller : ce sont Henry Forges et Georges Harris qui restent à terre. Les trois autres arrivent à Port Adventure sur l’île Stewart, à 27 km au sud de l’île du Sud, en Nouvelle Zélande, le 24 juillet, après cinq jours de mauvais temps. Le capitaine Cross du Flying Scud les a recueillis, puis les a emmenés à Invercargill, la ville la plus méridionale de l’île du Sud de la Nouvelle Zélande, le lendemain. Personne n’acceptant d’aller chercher Henry et George, il fallut faire une collecte de fonds à Invercargill pour que le capitaine Cross accepte le voyage aux îles Auckland pour ramener les deux membres d’équipage restants, qui avaient commencé à se disputer. Donc, happy end pour ces cinq naufragés qui ont fait ce qu’il fallait pour survivre avec leurs tripes et avec leur cœur. Mais ce n’est pas vrai de tout le monde : près de deux mois après l’échouage du Grafton, un autre navire, l’Invercauld, navire de 1 100 tonneaux, fera aussi naufrage sur l’île Auckland, mais sur une rive opposée à celle du Grafton, si bien que les deux groupes ne se rencontreront pas, laissant 19 survivants qui ne seront plus que trois quand ils seront secourus.

50° 40′ Sud. Janvier, c’est l’été austral. Le point culminant est à 659 m
Les paysages du naufrage du Grafton : Carnley Harbour et l’île Adams en 2007



François Edouard Raynal

Les naufragés : Henry Forges, portugais, George Harris, anglais, Alexander McLaren, norvégien, Thomas Musgrave, américain et François Edouard Raynal, français. © Getty – Dessin d’Alphonse de Neuville
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/naufrages-une-histoire-vraie/20-mois-seuls-sur-les-auckland-3498096
12 02 1864
El Hadji Omar Tall meurt dans l’explosion de sa maison à Déguembéré, près des falaises de Bandiagara, au Mali : elle était devenu une poudrière. Originaire du Fouta Toro, au Sénégal, il avait prêché pendant treize ans l’islam sunnite dans le Fouta Djalon, puis était devenu guerrier, et s’était construit un empire en partant vers l’est, Mali et Côte d’Ivoire : l’empire Toucouleur. Ses successeurs tiendront l’empire jusqu’à la conquête française en 1893. Son ami Mohamadou Alou Tyam écrira sa biographie – La Kacida – en ‘ajami, [ou poular], langue peul écrite en caractères arabes, traduite en français en 1935 par Henri Gaden.
14 03 1864
Sir Samuel Baker, très connu en Angleterre pour ses chasses à Ceylan, a remonté le Nil en compagnie de son intrépide épouse, à laquelle il a demandé de se faire la plus discrète possible… de peur qu’on ne découvre qu’il l’avait tout bonnement achetée deux ans plus tôt sur un marché d’esclaves à Vidin, au nord-ouest de l’actuelle Bulgarie ; Florence Barbara Maria Finnian von Saas était une Hongroise de Transylvanie dont la famille avait été massacrée en 1848. Il croise Speke, qui lui parle d’un autre lac que le Victoria : c’est le lac Albert, dont il voulut faire une seconde source du Nil, alors qu’il n’en est qu’une très grosse hernie, à 620 mètres d’altitude quand le lac Victoria est à 1 133 mètres. Cela ne relève que de la fantaisie, mais, comme cela avait représenté pour lui-même et son épouse un voyage plein de risques et d’épreuves, là encore il fallait que son nom s’inscrivit dans l’histoire : autant de sources du Nil que d’explorateurs, et comme les explorateurs sont nombreux… ; telle fût finalement la règle prise en compte pour satisfaire la vanité de ces messieurs. Il n’y a pas de problème de source du Nil [4], mais il y a un problème de ses découvreurs, et de la rivalité des territoires qui se la disputent, précurseurs de la civilisation du tout à l’Ego. C’est, avant toute autre chose, question de cohérence intellectuelle : comment pourrait-on voir dans un lac la source d’une rivière : un lac n’est que l’extension du lit d’une rivière : s’il reste à niveau constant en ayant un émissaire, c’est qu’il y a un affluent, en amont qui apporte au lac un volume d’eau égal à celui qui en part avec l’émissaire. Il est donc parfaitement incohérent de dire qu’un fleuve prend sa source dans un lac : sa source se trouve sur l’affluent qui, en amont, lui apporte de l’eau. Jamais personne n’a osé dire que le Rhône prenait sa source dans le lac Léman !
La vanité est un trait commun et personne n’est est peut-être entièrement exempt. Dans les milieux scientifiques et universitaires elle est même une sorte de maladie professionnelle.
Max Weber. Le savant et le politique, 1919
Le 14 mars 1864, le lac si longtemps cherché s’offrit enfin à nos yeux. Aussi loin que la vue pouvait porter vers l’ouest et le sud-ouest, une étendue d’eau sans limites brillait comme un miroir. Partout où la terre était en vue, le lac était encaissé par des montagnes. J’allai immédiatement au bord de l’eau, j’en bus à longs traits (c’était une coutume des anciens explorateurs), remerciant Dieu de m’avoir guidé jusqu’à cette heureuse fin quand tout espoir était perdu. Je baptisai le lac Albert Nyanza comme étant une seconde source du Nil.
Sir Samuel Baker
29 03 1864
Alexine Tinne, très riche héritière d’un Hollandais, magnat du sucre, s’est mise à voyager en compagnie de sa mère Harriet depuis la mort de son père, en 1845. Cette fois-ci, elle est de retour à Khartoum où elle retrouve sa sœur, Adriana Van Capellen, après une expédition dramatique pour atteindre l’équateur via le Nil et le Bahr al-Ghazal. L’incroyable taille de l’expédition – jusqu’à 450 personnes ! – n’en assura cependant pas le succès : elles sont parvenue un peu au sud de Waw, près de la frontière du Soudan avec la Centrafrique et le Congo. Mais sa mère, sa tante, et leurs deux bonnes hollandaises étaient mortes.
11 04 1864
Garibaldi, immensément populaire en Angleterre, a fini par répondre aux nombreuses invitations. Il est arrivé le 3 à Southampton. Il est maintenant à Londres où la police a prévu que 100 000 personnes viendraient l’acclamer. Il en vient 500 000. L’interminable cortège des députations venues lui rendre hommage met 6 heures pour parcourir les 5 kilomètres qui séparent la gare du palais du duc de Sutherland, où il est logé. Déjeuner d’honneur invité par le premier ministre, citoyenneté d’honneur de la ville de Londres, réceptions ininterrompues, députations d’exilés polonais, hongrois, allemands qui lui rendent hommage… c’est un triomphe. C’est au citoyen du monde que l’Angleterre cosmopolite rendait hommage. Seule la reine Victoria ne le reçoit pas : elle notait dans son journal : Honnête, désintéressé et courageux, Garibaldi l’est certainement, mais c’est un chef révolutionnaire. Tout ce tohue bohue autour d’un homme finit par inquiéter et le 17 avril, le médecin de la reine diagnostique un surmenage dangereux : il lui conseille d’annuler la tournée prévue en province. Le gêneur rentre chez lui.
14 05 1864
Une météorite tombe sur la commune d’Orgueil, au sud de Montauban, dans le Tarn et Garonne – elle prendra son nom.
C’est une chondrite carbonée de type CI, une espèce très rare. Orgueil contient entre autres du xénon HL (132Xe) et des poussières de diamant. C’est la première météorite dans laquelle on a retrouvé des acides aminés extraterrestres, donnant crédit à la théorie de la panspermie. Une masse totale de 14 kg a été collectée, ce qui fait d’Orgueil la plus massive des neuf chondrites CI connues en 2021. Un morceau de la météorite d’Orgueil est exposé au muséum d’histoire naturelle Victor Brun à Montauban. D’autres sont exposés au musée d’histoire naturelle de Londres, le muséum américain d’histoire naturelle de New-York ou le muséum d’histoire naturelle à Paris, qui en possède un fragment de plus de 10 kg.
Wikipedia
Elle est encore étudiée aujourd’hui.
25 05 1864
La loi Emile Ollivier abolit le délit de coalition institué par la loi Le Chapelier en 1791 et autorise, sous conditions, la cessation concertée du travail – le droit de grève -.
L’empereur avait écouté les conseils de son demi-frère, le duc de Morny, [fils de Hortense de Beauharnais et de Charles de Flahaut] qui lui répétait : Il est temps de donner de la liberté pour qu’on ne nous l’arrache pas, et du prince Jérôme, son oncle qui avait proposé d’envoyer une délégation d’ouvriers à l’Exposition universelle de Londres en 1862. L’empereur avait acquiescé et, forte de 200 travailleurs, une délégation emmenée par Henri Tolain, ouvrier ciseleur, avait fait la découverte au Royaume-Uni d’une condition ouvrière mieux lotie qu’en France, d’un pays où depuis 1824 les syndicats avaient une existence légale.
Nous qui n’avons d’autre propriété que nos bras, nous qui subissons tous les jours les conditions légitimes ou arbitraires du capital, nous demandons le droit pour les ouvriers de présenter des candidatures aux élections, la création de chambres syndicales et le droit de grève, la liberté d’association qui permettra de résister par la liberté et la solidarité à des exigences égoïstes et oppressives.
Henri Tolain
Cette pression ouvrière encouragea Napoléon III à donner un signal social fort, en libéralisant dans un même mouvement le statut des coalitions et celui des grèves. C’est à un jeune avocat de 39 ans, Emile Ollivier (1825-1913), qui s’était fait remarquer en étant nommé, en 1848, à 22 ans, commissaire du gouvernement provisoire, dans les Bouches-du-Rhône, qu’il revint d’être rapporteur de la loi devant le Corps législatif.
La loi Ollivier abolit le délit de coalition – sans autoriser les réunions publiques, qui ne seront licites qu’en 1868 à condition qu’on n’y parle que de questions sociales ou scientifiques et pas de politique – […].
Le nouvel article 414 dispose : Sera puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans et d’une amende de 16 francs à 3 000 francs, ou de l’une de ces deux peines, quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir une cessation concertée du travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.
Avec la loi Ollivier, la France donne le ton en Europe. Plusieurs pays vont adopter des législations similaires : la Belgique (1866), la Prusse (1869), les Pays-Bas (1872) et le Luxembourg (1879). Mais il s’agit au mieux d’une tolérance vis-à-vis d’actions de plus en plus répandues dans ces sociétés en pleine industrialisation, et non d’une reconnaissance pleine et entière de la grève. L’exercice de celle-ci entraînait toujours une rupture automatique du contrat de louage ou de travail, et donc justifiait un licenciement de l’ouvrier gréviste ou une intervention des forces de l’ordre en cas de violence.
Le 15 juillet 1864, Emile Ollivier publie un commentaire de sa loi, intitulé Les coalitions, dans lequel il en revendique hautement la paternité : J’ai voulu simplement, écrit-il, résumer dans quelques formules claires et sommaires les principales conditions auxquelles est désormais soumise la faculté de se coaliser, afin que les patrons et les ouvriers puissent, sans le conseil de personne, juger eux-mêmes de l’étendue de leurs droits et les exercer sans péril.
Et celui qui deviendra premier chef du cabinet de Napoléon III de janvier à août 1870 –[…] juge que sa loi, si les coalitions futures conservent le caractère de calme et de dignité, n’en est pas moins une des meilleures qui aient été faites par le gouvernement actuel, une de celles dont doivent le plus se réjouir ceux qui considèrent l’amélioration du sort des travailleurs comme constituant le but supérieur de la politique.
Et Emile Ollivier conclut : La conquête politique, c’est le suffrage universel ; la conquête sociale, c’est le droit de se coaliser. Je considère comme un bonheur d’avoir contribué pour ma part au second de ces actes d’émancipation populaire. Quelques injures ou quelques froissements inattendus du cœur ne me semblent pas une rançon trop chère de cette bonne fortune.
Mais avant d’être vraiment reconnu par la Constitution de 1946, le droit de grève empruntera un chemin semé de déconvenues. En défendant la coalition, M. Ollivier se dit convaincu qu’il n’est pas vrai qu’il n’y ait que des individus, grains de poussière sans cohésion, et la puissance collective de la nation, mais qu’entre les deux il existe le groupe formé par les libres rapprochements et les accords volontaires.
Entre 1864 et 1884, 2 700 condamnations sont prononcées pour faits de grève, dont 61 à plus d’un an d’emprisonnement. En 1870, Emile Ollivier n’hésite pas à envoyer la troupe contre des grévistes au Creusot. Jules Simon avait lancé, à propos de sa loi : Elle commence par une promesse ; elle continue par une menace.
Michel Noblecourt. Le Monde du 24 mai 2014
Avoir poursuivi d’une haine féroce jusqu’à la tentative d’assassinat le seul Souverain dont la préoccupation principale ait été d’améliorer la situation matérielle et morale des masses et de les affranchir de leurs servitudes traditionnelles, le seul qui, malgré les terreurs de ses conseillers ait accordé aux travailleurs des droits refusés par la Révolution elle-même et relevé leur dignité en donnant à leur parole une autorité égale à celle des patrons ; avoir méconnu le créateur des sociétés de secours mutuel ; le protecteur du droit de coalition, le restaurateur du suffrage universel mutilé ; avoir préféré à l’ami couronné qui servait le peuple de tout cœur les bourgeois opportunistes qui s’en servaient sans cesse, cela restera, à l’heure de la véritable histoire une des pages les plus laides des annales de la démocratie française. Ce jugement sera rendu plus sévère encore par la longanimité avec laquelle l’empereur, méconnu, menacé dans son trône et dans sa vie par la plus noire ingratitude, continua son dévouement à ceux qui le déchiraient. Que de fois ne m’a -t-il pas dit dans nos conversations intimes: Tâchez donc de me proposer quelques chose dans l’intérêt du peuple.
Émile Ollivier L’empire libéral. 17 volumes. [mort à Saint Gervais les Bains en 1913, enterré à Saint Tropez, au Château de la Moutte, légué au Conservatoire du Littoral, géré par la commune]
En toute circonstance, qu’on lui parlât du passé ou du présent, de ce qu’on faisait ou de ce qu’on pourrait faire, la même question revenait sur les lèvres de M. Émile Ollivier : Où est le droit ? Où est le devoir ? Qu’exige, qu’eût exigé la justice ? […]
À aucun prix il n’eût utilisé, même pour des fins pratiques les plus hautes, les parties basses de la nature humaine, la cupidité, l’égoïsme, l’envie. Il était l’artiste qui veut tout droit sculpter son idéal dans le marbre, sans passer par l’intermédiaire de la terre glaise où l’on se salit les mains… […] Par-delà les partis, sa pensée allait à la France.
Henri Bergson, qui lui succédera à l’Académie Française le 12 février 1914
9 06 1864
Pierre Jean De Smet, une fois de plus mandaté pour parlementer avec les Indiens, débarque à Fort Berthold, près de l’embouchure du Petit Missouri, où vivent les Aricaras et les Mandans : il s’est embarqué sur le Missouri le 20 avril pour gagner les grandes plaines septentrionales, muni des plus chaudes recommandations : Nul homme de ce pays n’a rendu de plus importants services, par la dignité de son caractère et la finesse de son intelligence, par rapport aux tribus indiennes, de ce coté des Montagnes rocheuses ou au-delà…
Général Pleasanton
Le Révérend Père De Smet se rend en mission de paix et de pardon auprès des Sioux combattants. Toute assistance doit être donnée à cet illustre missionnaire.
Genéral Rosecrans
Mais il va se heurter au général Sully qui s’enferme dans un pas de pourparlers avant qu’un châtiment exemplaire n’ait été donné aux rebelles. Un tel blocage rend sa mission caduque : il rentre à Saint Louis non sans avoir adressé un rapport circonstancié à Washington.
5 10 1864
Un cyclone ravage Calcutta : on comptera près de 60 000 morts ; 40 000 maisons détruites, 90 % des navires coulés ou fracassés.
16 11 1864
Le général Sherman, (nordiste), entreprend sa marche vers la mer : d’Atlanta à Savannah, dévastant tout, menant une politique de la terre brûlée : le sort le plus enviable était alors celui des esclaves, qu’il libère. À raison de 20 km par jour, il arrivera à Savannah à 500 km d’Atlanta le 21 décembre. Il se montre plus près d’Attila que d’un général respectueux d’un code de guerre.
Nous avons détruit tout ce que nous ne pouvions pas manger, volé leurs Nègres, brûlé leur coton [5] et leurs égreneuses, déversé partout leur sorgho, incendié et tordu leurs voies ferrées et, d’une façon générale, mis le pays à feu et à sang.
Un soldat de Sherman
Brûlez tout ! Brûlez tout ! … D’abord les soldats hésitent. Ils se regardent les uns les autres comme pour voir qui est prêt à obéir, mais Sherman exulte. Il montre la ferme devant laquelle ils viennent de s’arrêter, dans cette vallée de Shenandoah, et il hurle : Brûlez ! Alors ils se décident, finissent par le faire, un peu honteux. Ils s’habitueront vite et bientôt n’y penseront même plus. Toutes les fermes qu’ils trouveront sur leur route connaîtront le même sort et ils le feront sans même s’en apercevoir. The Burning. C’est cela que Grant a demandé à Sherman : la guerre totale, qui fait pleurer les villages. Bientôt ils n’auront plus ce geste un peu gauche d’hésitation, bientôt ils ne descendront même plus de leurs chevaux. Ils n’hésiteront pas non plus à tirer dans le ventre des fermiers qui ont saisi une fourche pour protéger leur récolte, ou à passer par le fil de la lame les femmes qui essaieront de s’interposer. Bientôt, ils brûleront tout, systématiquement. Pendant des mois. Et Sherman n’aura plus à le dire, à le hurler en se dressant sur ses étriers : Brûlez tout ! ils auront appris à le faire. Grant pense souvent qu’il aura à demander pardon pour ces ordres donnés car il sait quelle réalité se cache derrière ce qu’il exige. Et quand il ordonne the Burning il voit, lui, les fermes brûlées et les enfants en pleurs. Alors il s’adresse à Julia en son esprit, lorsqu’il boit sans trouver le sommeil, pardonne-moi, Julia, car j’ai ordonné de tuer, pardonne-moi, Julia, des femmes et des enfants ont été piétinés, il voudrait le dire, le hurler : ce qu’il exige de ses hommes est folie. Lorsque j’en aurai terminé, lui écrit Sherman, la vallée sera impropre à la vie des hommes et des bêtes, et c’est ce qu’il a fait : le bétail est éventré ou, pour aller plus vite, brûlé vif dans les étables, avec les fermiers parfois, pardonne-moi, Julia, et ne me regarde plus jamais avec amour. La victoire approche et la guerre devient plus sale, plus pénétrante. Cela fait longtemps que les hommes n’ont plus de rêve de noblesse. Ils savent que la guerre se fait en grimaçant et qu’ils se sont perdus. C’est cela qu’on leur a demandé : accepter de se dire adieu et aller au plus ignoble. Ils le font. Sherman écrit à Grant que la vallée de Shenandoah n’est plus que cendres et Grant, en le lisant, n’éprouve aucun dégoût. Il n’a pas le droit. C’est lui qui a exigé cela de ses hommes. S’il doit ressentir le dégoût, qu’il le ressente pour lui-même et c’est ce qu’il fait, mais qui peut l’entendre. Julia continue à l’aimer alors que lui est hanté par les cris de Sherman : Brûlez…! Brûlez tout… ! et il n’a pas le droit de trouver cela répugnant car c’est lui qui l’exige alors il y répond en ordonnant qu’on tire une salve de mille coups de fusil contre Petersburgh en l’honneur de ceux qui ont fait saigner la terre de Shenandoah, Brûlez… Brûlez et lorsqu’il referme son courrier et relève la tête, il sait qu’une nouvelle façon de faire la guerre est née.
[…] À quel moment ont-ils commencé à vaincre ? Le capitaine le salue avec fierté en ordonnant à son cheval, par une légère pression des cuisses à peine perceptible, de se mettre à l’arrêt : Les voilà, mon général … Il est fier de sa prise, cela se voit, Il sourit et ne peut s’empêcher d’ajouter : On en trouve partout sur les routes… Lee ne tient plus ses hommes… Et son cheval s’écarte pour laisser passer la colonne de fuyards et de déserteurs. Ce ne sont plus des hommes. Ils avancent d’un pas lent, le corps rachitique, ne pesant plus que la moitié de leur poids, les yeux hagards. Grant repense alors aux corps dans les tranchées de Petersburg, lorsque la ville a fini par céder après neuf mois de siège. Il y avait des gamins de treize ans, pieds nus, qui gisaient là, dans la boue… Honte aux confédérés qui les avaient armés et honte à ceux qui les avaient tués. Ce ne sont plus des hommes. Ni ceux qui titubent devant lui, qui n’ont rien mangé depuis des jours – que des pousses d’herbe et des racines -, ni lui, là, qui se tient droit, ému par tant de misères alors que c’est lui qui a décidé d’axer la guerre sur le ravitaillement pour affamer les soldats. Il voit le jeune capitaine qui sourit à ses côtés, heureux de la prise du jour, qui ne trouve pas révoltant qu’un homme ait pu devenir un sac d’os aux gencives qui saignent. War is hell, dit son ami Sherman. Il faut châtier les civils et couper l’ennemi de ses bases. Je peux faire brûler de douleur la Géorgie, lui a-t-il écrit, et il l’a fait, détruisant tout sur son passage. Les voilà, devant ses yeux, les vaincus aux corps creusés, aux lèvres blanches, hallucinant de faim. Faut-il se réjouir ? oui, car ils sont le signe de la victoire. L’armée de Lee fond à vue d’œil. Ils ne doivent même plus être trente mille et ils sont tous affamés. La guerre est cruelle. Il repense toujours à Sherman parce qu’il n’y a que lui qui soit lucide, et dise les choses avec la brutalité qu’elles contiennent. Plus elle sera cruelle, plus vite elle sera terminée. Les villages brûlent. Les hommes meurent de faim le long de la route. Rien n’empêche Sherman d’avancer. Il traverse la boue, les forêts. Il saccage tout et le Sud hurle de douleur. Faut-il se réjouir ? Grant songe à cet instant que la victoire est une épreuve. Il laisse les confédérées en haillons passer et il lui semble que c’est lui qui est humilié, pire, il sent que cette humiliation ne le quittera plus, qu’il va devoir apprendre à la porter en lui, même lorsque les cris de victoire retentiront – car ils retentiront -, même là, elle sera en lui, sourde, pénétrante, il ne pourra pas la fuir, et jusqu’à sa mort, il y aura cela en partage entre lui et les troupes ennemies : cet instant-là, tète basse, où l’homme est allé si loin qu’il n’en était plus un.
Laurent Gaudé. Écoutez nos défaites. Actes Sud 2016
29 11 1864
Aux États-Unis, le 3° régiment de volontaires de la cavalerie du Colorado se livre à un massacre sur les Cheyennes de Sand Creek : ils en tuent 200.
Rivière Sand Creek
|
Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura
sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura fu un generale di vent’anni occhi turchini e giacca uguale fu un generale di vent’anni figlio d’un temporale. C’è un dollaro d’argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte e quella musica distante diventò sempre più forte chiusi gli occhi per tre volte mi ritrovai ancora lì chiesi a mio nonno è solo un sogno mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Sand Creek. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso il lampo in un orecchio nell’altro il paradiso le lacrime più piccole le lacrime più grosse quando l’albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del Sand Creek. Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte c’erano solo cani e fumo e tende capovolte tirai una freccia in cielo per farlo respirare tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura fu un generale di vent’anni occhi turchini e giacca uguale fu un generale di vent’anni figlio d’un temporale. Ora i bambini dormono sul fondo del Sand Creek. Auteurs-compositeurs : Fabrizio De André 1940-1999, Massimo Bubola.
|
Ils ont pris nos cœurs sous une sombre couverture
sous une lune morte petite nous dormions sans peur
ce fut un général de vingt ans
aux yeux aussi bleus que sa veste
ce fut un général de vingt ans
fils d’un orage
il y a un dollar en argent au fond du Sand Creek
Nos guerriers trop éloignés sur la piste des bisons
et cette musique distante se fit de plus en plus forte
je fermai les yeux trois fois
je me retrouvai toujours là
je demandai à mon grand-père n’est-ce qu’un rêve
mon grand-père répondit que oui
les poissons chantent parfois au fond du Sand Creek
Je rêvai si fort que le sang coula de mon nez
l’éclair dans une oreille, dans l’autre le paradis
les plus petites larmes
les plus grosses larmes
lorsque sur l’arbre à neige
fleurirent des étoiles rouges
maintenant les enfants dorment dans le lit du Sand Creek
Lorsque le soleil leva la tête entre les épaules de la nuit
il n’y avait plus que des chiens de la fumée et des tentes renversées
je décochai une flèche au ciel
pour qu’il puisse respirer
je décochai une flèche au vent
pour qu’il puisse saigner
la troisième flèche, cherche-la au fond du Sand Creek
Ils ont pris nos cœurs sous une sombre couverture
sous une lune morte petite nous dormions sans peur
ce fut un général de vingt ans
aux yeux aussi bleus que sa veste
ce fut un général de vingt ans
fils d’un orage
maintenant les enfants dorment au fond du Sand Creek
Auteurs-compositeurs : Fabrizio De André 1940-1999, Massimo Bubola.
|
8 12 1864
Pie IX publie l’encyclique Quanta Cura qui contient notamment le Syllabus : complectens præciuos nostræ ætatis errores – Recueil renfermant les principales erreurs de notre temps qui sont signalées dans les allocutions consistoriales, encycliques et autres lettres apostoliques de Notre Très Saint-Père le pape Pie IX -.
Le Syllabus est l’un des textes qui ont été portés au pinacle par quelques-uns, montrés du doigt avec horreur par beaucoup d’autres. Il est probable qu’il n’a pas été réellement lu. Les encycliques provoquent souvent des tempêtes alors que très peu de gens en prennent vraiment connaissance.
Le Syllabus n’échappe pas à la règle. Pendant près d’un siècle, il sera un signe de contradiction ; on y verra la preuve que l’Église ne comprend rien à son siècle, qu’elle est bel et bien la dernière citadelle d’un monde définitivement mort à la Révolution française.
Or, contrairement à la rumeur, le Syllabus comportait bon nombre de vérités. Étaient dénoncés, tout à la fois, le rationalisme, parce qu’il allait jusqu’à nier la divinité du Christ ; le gallicanisme, dans la mesure où il donnait au pouvoir civil le droit de mettre en question les autorités religieuses ; l’étatisme, parce qu’il exigeait le monopole de l’enseignement à son profit et l’abolition des ordres religieux ; le socialisme, parce qu’il veut tout soumettre à l’État (la famille, la propriété, les libertés d’opinion) ; l’économisme, qui estime que l’acquisition des richesses est le but de l’organisation sociale. Plus grave encore, aux yeux des rédacteurs : le naturalisme, qui prétend que la société humaine doit être gouvernée sans tenir compte de la religion ; ce qui suppose la laïcisation des institutions, la séparation de l’Église et de l’État, la liberté de la presse, l’égalité des cultes devant la loi, l’équivalence des religions.
Si les derniers points que nous venons d’énumérer comportent bon nombre de contre-vérités – la séparation de l’Église et de l’État existe déjà aux États-Unis, elle sera établie en France dans moins d’un demi-siècle et les catholiques y gagneront une indépendance qu’ils n’ont jamais connue -, les autres considérants contiennent des intuitions qui se révélèrent profondes cent cinquante ans plus tard (l’économisme réducteur ; le socialisme et le communisme, sources possibles d’une soumission de l’individu à l’État, etc.).
Peu de gens comprendront les ambiguïtés du Syllabus. Encore une fois, parce qu’ils ne le lurent pas. Ensuite, parce que les mots utilisés, le style du document, exhalaient un parfum d’autrefois. On avait le sentiment qu’un siècle de rancœurs, fondées ou pas, s’exprimait dans cet étrange manifeste. Et cette analyse, elle aussi, était en partie exacte.
Conséquence du Syllabus : un vacarme européen qui contribue à obscurcir le débat. Ultramontains et intégristes clament leur satisfaction ; leurs cris de victoire enveniment le climat. Quant aux éternels anticléricaux, ils en appellent au bon peuple, affirment que le Syllabus démontre une fois pour toutes que l’Église est opposée au progrès. Un journal piémontais – n’oublions pas que le Piémont mène, depuis dix ans, la guerre contre les idées et les institutions romaines – soutient que le pape va supprimer dans ses États les trains, les machines à vapeur, le télégraphe et l’éclairage au gaz. À Paris, Napoléon III estime (à juste titre) que le Syllabus est, en partie, une machine de guerre contre lui. Sans façon, il interdit aux évêques la publication du document. Quant aux catholiques libéraux, les grands vaincus, on les considère désormais comme des hérétiques.
C’est, encore une fois, Mgr Dupanloup qui évite la catastrophe. Il publie fin janvier un petit livre d’interprétation à propos de l’encyclique et du Syllabus. En quinze jours, il s’en vend cent mille exemplaires en France. On traduit l’ouvrage en dix langues. Six cent trente évêques lui écrivent du monde entier pour le féliciter d’avoir si bien exprimé leur pensée. Enfin, le pape lui-même déclare à ses amis : Il a expliqué et fait comprendre l’encyclique comme il faut qu’on la comprenne.
Comment Mgr Dupanloup a-t-il réussi cette métamorphose ? En utilisant un vieux procédé, cent fois utilisé durant l’histoire de l’Église : il a simplement distingué la thèse et l’hypothèse. D’après lui, le pape n’avait pas à se réconcilier avec la civilisation moderne, puisqu’il n’a jamais cessé de l’encourager. Il devait simplement indiquer ce qui lui semblait dangereux dans son évolution. Voilà le Syllabus transformé en un document dont on a limé les principales aspérités. Mais les ponts étaient coupés entre le Saint-Siège et les catholiques libéraux.
Georges Suffert. Tu es Pierre. Éditions de Fallois 2000
Ce temps fut, selon l’archevêque de Reims, celui de l’idolâtrie de la papauté. De Veuillot à Mgr Berthaud, évêque de Tulle, on multipliait les outrances et les provocations quasi blasphématoires : l’un saluait en Pie IX le vice-Dieu de l’humanité ; l’autre le Verbe incarné qui se continue. L’évêque de Genève, Mermillod, parlait des trois incarnations du fils de Dieu : dans le sein de la Vierge, dans l’Eucharistie et dans le vieillard du Vatican. La très jésuite Civitta cattolica osait écrire que lorsque le pape médite, c’est Dieu qui pense en lui. Et l’on entendit des prêtres attribuer en chaire au pape les vertus par lesquelles les cantiques saluent le Christ pontifex sanctus, impollutus, segregatus a peccatoribus et excelsior coelis factus. Cinq siècles plus tôt, au temps auquel ces gens rêvaient de revenir, on montait sur le bûcher pour moins que cela. Adorer un homme …
À cet Être suprême, il manquait un attribut – ou plutôt, que cet attribut fut sacralisé, incorporé à la doctrine catholique : l’infaillibilité. À partir de 1865 commença à circuler la rumeur de la convocation d’un concile à cet effet – le premier concile depuis celui de Trente, trois siècles auparavant… On entendait dire en même temps que Pie IX s’apprêtait à canoniser un inquisiteur, Arbues. Où allait-on ? Jusqu’où ces gens de Rome pousseraient-ils leur offensive intégriste et passéiste ?
Jean Lacouture. Jésuites. Les Conquérants. Seuil 1991
1864
En Russie, création des zemstvos, assemblée territoriale élue tous les 3 ans par région – il y en avait 34 dans la Russie d’Europe – ; élection au suffrage indirect, par trois collèges – propriétaires fonciers ruraux, propriétaires urbains et paysans -. Elle a en charge tous les domaines civils de l’administration : entretien des routes, ouverture d’écoles, d’hôpitaux, d’hospices, organisation des réserves de grains, diffusion de connaissances agronomiques, collecte de statistiques. L’assemblée se réunit une fois par an et élit un bureau exécutif, dont les pouvoirs resteront cependant restreints face à ceux du gouverneur provincial. C’est sur cette base que naîtra l’idée d’une fédération de ces assemblées pour donner une assemblée nationale, chère aux révolutionnaires de 1905.
Maxwell établit les relations entre magnétisme et électricité ; un an plus tard, il montrera que la lumière est un phénomène électro-magnétique.
Le Norvégien Svend Foyn embarque sur le Spes et Fides premier baleinier à vapeur, apportant avec lui sept canon-harpons de son invention : c’en est fini de la pêche artisanale au harpon lancé par l’homme ; les massacres vont commencer, détruisant en quelques décennies un capital considérable de cétacés, les prélèvements l’emportant toujours sur le renouvellement de l’espèce : Américains et Japonais sont au premier rang des prédateurs.
La Compagnie Générale Transatlantique ouvre une ligne régulière le Havre-New York avec un paquebot à roues.
Découverte d’un gisement de nickel, en Nouvelle Calédonie, française depuis 1853.
Pasteurisation : les producteurs de lait, de vin ou de bière peuvent expédier leurs marchandises à distance sans craindre qu’elles ne se gâtent. Pour protéger le marché français, Napoléon III interdit l’exportation vers l’Italie de métiers à tisser la soie et le coton. Le four du Français Pierre Martin permet les premiers aciers spéciaux. Création du Comité des Forges, le patronat de la sidérurgie. Évian devient Évian les Bains : le thermalisme s’y développe et la haute aristocratie vient y chercher santé et mondanité : golf, concerts plusieurs fois par semaine, théâtre, feux d’artifice et spectacles sur le lac… on construit plusieurs palaces, dont l’Hôtel du Parc, qui hébergera 100 ans plus tard les négociateurs des accords d’Évian qui mettront fin à la guerre d’Algérie. Travaux d’endiguement de la Camargue, qui vont permettre le développement de la culture du riz.
Publication en fascicules du Grand Dictionnaire Universel du XX° siècle, de Pierre Larousse. À l’article Paris, on peut lire : Paris, la France, tous les peuples obéissent à des lois bien autrement fortes que les lois fabriquées par les hommes ; nous voulons parler des lois qui régissent l’univers et qui, comparativement aux êtres, sont immuables et éternelles. Les qualités et les défauts physiques et intellectuels, en un mot l’ensemble des qualités ethniques des habitants d’une contrée dépendent :
- de la nature du sol ou élément géologique ;
- des conditions atmosphériques ;
- de la situation géographique (…)
Pour qu’une réunion de citoyens (ville ou peuple) puisse être supérieure comme intelligence, il faut que le territoire qu’elle occupe soit insuffisant à la nourrir. […]
Tout arrive à Paris des points les plus divers et les plus éloignés des territoires français : vins, viandes, fruits, légumes, blés, poissons, volailles, gibiers, etc, apportant, condensés en eux, les essences des sols multiples. Les eaux aussi sont ses tributaires. Une foule de ruisseaux et de rivières, qui rejoignent la Marne et la Seine au-dessus de Paris, y apportent leurs aliments en bloc… Les eaux minérales de la France et de l’étranger y trouvent un vaste débouché. Les cafés, thés, poivres, sucres, les denrées coloniales en un mot, y arrivent de tous les points du globe. Chacun de ces produits si divers agissant sur l’homme suivant la loi des principes nutritifs ou excitants qu’ils contiennent, il en résulte de cette universalité, cette suprématie, cette prépondérance qui constitue le caractère des Parisiens pris collectivement.
De ces données, nous ne prétendons pas conclure que le plus ou moins d’intelligence d’une population soit le résultat exclusif, absolu de son alimentation, plus étendu dans la capitale que dans les autres villes ; que les bibliothèques, les musées, les expositions, les spectacles, beaucoup plus nombreux et plus fréquentés ; les journaux surtout beaucoup plus répandus, et principalement aussi les étalages des boutiques si artistement ordonnés et où chacun peut venir puiser des idées ; nous croyons que tout cela contribue pour une large part au développement de l’intelligence parisienne ; mais nous sommes convaincus que cette diversité de nourriture, que nous venons d’indiquer, prépare admirablement, par ses influences occultes mais fécondes, notre suprématie.
Les provinces qui ne se nourrissent que de leurs propres produits, comme la Bretagne, les peuples qui ne sortent pas de chez eux, qui gardent leurs frontières contre l’importation, qui se suffisent à eux-mêmes, seront toujours des Barbares, relativement.
La supériorité de l’Angleterre, des États-Unis, de la France sur toutes les autres nations, la supériorité de Paris sur toutes les autres villes n’ont pas d’autres causes que leurs relations extérieures.
Voilà pourquoi Paris est indécapitalisable.
L’article n’a pas été rédigé par Stendhal, tout à l’opposé de ces éloges dithyrambiques, plein de très grasse fatuité : En Angleterre, l’aristocratie méprise les lettres. À Paris, c’est une chose trop importante. Il est impossible pour des Français habitant Paris de dire la vérité sur des ouvrages d’autres Français habitant Paris.
[…] Tôt ou tard, les provinciaux et les étrangers s’apercevront que tous les articles des journaux français sont dictés par la camaraderie.
[…] En revanche, rendre compte d’une relation de voyage ou d’un bon livre d’histoire qui vient de paraître à Paris ou à Londres, c’est ce qui leur est absolument impossible par la grande raison qu’avant tout il faudrait le lire et ensuite se donner le temps de le comprendre.
En France, les journaux auront crée la liberté et perdu la littérature.
[…] La critique française manque à ce point de probité qu’il est très courant de laisser un auteur écrire pour son propre ouvrage un compte rendu qui est inséré dans les journaux des factions rivales, suivant qu’il est partisan de l’une ou de l’autre ; et cet esprit de coterie est si répandu et si bien admis que notre affirmation serait sans doute confirmée par les cercles littéraires de Paris, sans qu’elle les fasse rougir. Les journaux ainsi contrôlés par les auteurs et leurs amis sont souverains en matière de critique, car le public juge invariablement d’après les oracles.
[…] À Paris, la vie est fatiguée. Il n’y a plus de naturel ni de laisser-aller.
[…] La société de Paris déclare de mauvais goût tout ce qui est contre ses intérêts. Or, décrire d’autres manières sans les blâmer peut faire douter de la perfection des siennes
[…] Il me semble qu’il faut du courage à l’écrivain presque autant qu’au guerrier ; l’un ne doit pas plus songer aux journalistes que l’autre à l’hôpital.
Stendhal. Chroniques envoyées à des revues anglaises de 1822 à 1830
Pour pertinentes qu’elles soient, les prises de position de Stendhal ne viendront pas mettre Paris à bas du trône qu’elle s’était construite : 100 ans plus tard, le nombrilisme pathologique sévissait encore, confondant allègrement mondanités et pensée : Paris… les quelques hectares du monde où il a été le plus pensé, le plus parlé, le plus écrit, le carrefour de la planète qui a été le plus libre.
Jean Giraudoux, vers 1930
Le Vatican met à l’index Les Misérables, Mme Bovary, Balzac et Stendhal. Réunis en congrès à Londres, les ouvriers français et anglais créent l’Association Internationale des Travailleurs, en soutien au peuple polonais.
Le capitaine Thomas George Montgomerie du Survey of India – Service cartographique de l’Inde – se sent frustré de ce que le Tibet reste zone blanche en cartographie, puisqu’interdit aux cartographes : plutôt que de faire faire le travail illégalement par un blanc, trop facilement repérable, il en confie le soin à des autochtones, triés sur le volet : il se nommeront Mohammed Hamid, un jeune employé musulman du Service, Nain Singh et Mani Singh, tous deux guides de montagne et instruits. Ils seront munis d’équipements plutôt sophistiqués, sextants, boussoles, altimètres ou équivalents, chapelet pour mesurer des distances parcourues… le tout dissimulé dans des poches cachées, des doubles fonds de valise : cela soutenait la comparaison avec James Bond ! Le premier parti du Ladakh pour Yarkand, au cœur du Turkestan chinois : il mourut probablement de maladie, mais on retrouva son journal de bord qui contenait toutes les mesures qu’il avait pu effectuer : positions, altitude, distances. Des deux seconds, seul Nain Singh poursuivit sa mission, parvenant à passer plusieurs mois à Lhassa, effectuant clandestinement un remarquable travail de cartographie. De retour à Dehra Dûn, en Inde, il se verra confier une autre mission : l’exploration de la région de Thok Jalung et de ses légendaires mines d’or, dans l’ouest du Tibet. Remarquable encore, Kishen Singh, qui, à 21 ans avec déjà deux missions à son actif, fut missionné pour une expédition de 4 800 km : l’exploration du nord-est du pays, autour du lac Koko-nor, aux confins du Tibet et de la Mongolie, qui l’emmènera jusqu’aux grottes de Dunhuang, qu’Aurel Stein découvrira 25 ans plus tard… [voir l’an 336]. Attaque de bandits, assauts constants du froid, réduction en esclavage pour survivre… il lui en aura fallu de la niaque pour survivre ! Quatre ans plus tard, il revenait à Darjeeling, accompagné de son fidèle serviteur Chumbel : Ils arrivèrent dans un état de quasi déchéance physique, bourse épuisée, vêtements en lambeaux, émaciés par les conditions du voyage et les privations endurées… Mais tout épuisés qu’ils fussent, ils étaient aussi triomphants…
Général Walker, message à la RGS – Royal Geographic Society –
Le moins que l’on puisse dire est que la reconnaissance fut loin d’être à la hauteur des services rendus : Un explorateur britannique qui aurait fait le tiers de ce que Nain Singh, Kishen Singh et tant d’autres… ont accompli, aurait vu tomber dans son escarcelle médailles et décorations, promotions flatteuses et fonctions luvcratives ; il aurait été fait citoyen d’honneur de mainte ville, bref, il serait devenu une célébrité. Ces explorateurs indigènes ne pouvaient attendre qu’une petite récompense pécuniaire, et l’obscurité.
William Rockhill, Américain. Terre des Lamas 1891.
Ceci dit, les choix de Montgomerie étaient les bons, car par la suite, nombre d’occidentaux s’essaieront à gagner Lhassa, et aucun n’y parviendra et ce jusqu’en 1901 : Prjevalski, Sven Hedin, Rockhill, Lansdell, Bonvalot, Bower, Annie Taylor, Dutreuil de Rhins, les époux St George Littledale, Henry Savage Landor… quels que fussent leurs choix, leur logistique, leur fortune, tous se heurtèrent sur le refus catégorique des autorités de Lhassa à laisser pénétrer leur ville par un occidental : ils parvinrent parfois à dix jours de marche, certains à seulement un jour, mais ils trouvèrent toujours pour les arrêter des émissaires incorruptibles, car punis de mort s’ils contrevenaient aux ordres : à quoi bon amasser monnaie si on doit mourir le lendemain ! Certains, que les aventures avaient dépouillé, rincé, obtinrent des montures et de l’équipement pour s’en retourner, d’autres périrent en se heurtant à l’hostilité de villageois…
20 01 1865
Abraham Lincoln inaugure son second mandat après sa réélection le 8 novembre : Si l’esclavage [6] , en Amérique, fut un de ces maux nécessaires selon les décrets de la providence divine, mais qui doit maintenant, au terme du temps fixé par Dieu, prendre fin, et s’il a donné une fois au Nord et au Sud cette guerre terrible comme le malheur dû à ceux par qui le mal est venu, allons-nous voir là une discordance d’avec ces divins attributs que les croyants et un Dieu vivant lui ont toujours reconnus ? Et pourtant, si Dieu veut que l’horrible fléau de la guerre dure jusqu’au naufrage de toute la richesse entassée par deux cent cinquante ans de travail forcé et jusqu’à ce que chaque goutte de sang jaillie sous le fouet soit payée par une autre jaillie sous l’épée, alors, ainsi qu’il fut dit voici trois mille ans, qu’il soit dit encore : Les jugements du Seigneur sont justes et vrais.
2 02 1865
Menton et Roquebrune deviennent français.
02 1865
Oaxaca, ville mexicaine qui avait jusque là rassemblé l’opposition au pouvoir de Maximilien est prise.
03 1865
Grégor Mendel, fils d’agriculteur, moine augustinien à Brno, au sud de la Tchéquie, expose à la Société de Sciences Naturelles les règles de reproduction des végétaux hybrides, qu’il avait établi à partir de ses travaux sur le pois Pisum. Il fonde ainsi la botanique et la génétique modernes, même si l’extension de ses découvertes à tout le règne végétal ne sera reconnue que beaucoup plus tard.
Gregor Mendel (1822-1884) était un moine originaire de Moravie qui, dans les années 1850 à 1860, effectua à Brno une série d’expériences sur l’hérédité des végétaux. Ses résultats étaient intrigants. En croisant un plant de pois de grande taille avec un autre plant de grande taille, il obtenait des pois de grande taille et le croisement de pois petits avec des petits donnait des plants de pois petits ; mais le croisement de pois grands et petits engendrait une série de conséquences inattendues. Les produits issus du premier croisement étaient tous grands, mais le croisement entre eux donnait en deuxième génération un rapport de trois grands pour un petit. Ces derniers engendraient des pois petits si on les croisait avec d’autres plants de pois petits. Ainsi, le caractère petite taille, bien qu’il disparût à la première génération derrière le caractère grande taille, reparaissait inchangé à la génération suivante. Pour expliquer ces résultats, Mendel suggéra que chaque génération contenait deux facteurs pour chaque caractère héréditaire, l’un provenant du parent mâle, l’autre du parent femelle [En fait, ce sont les auteurs du XX° siècle qui attribuent cette suggestion à Mendel. Le moine morave ne l’a, quant à lui, jamais explicitement avancée, s’étant borné à formuler sous forme mathématique les lois de l’hérédité, dites lois de Mendel cf. M. Blanc, La légende du génie méconnu, la Recherche, n° 151, janvier 1984, p. 46. N.d.T.] Étant donné que certains facteurs empêchaient l’apparition des autres, il qualifia les premiers de dominants et les autres de récessifs. Puis il énonça deux lois générales : la loi de la ségrégation établissait que, dans la formation des cellules germinales, les deux facteurs pour chaque caractère (par exemple la taille) sont toujours séparés l’un de l’autre, un ovule ou un spermatozoïde ne contenant que l’un ou l’autre; la loi de l’assortiment indépendant établissait que les facteurs maternels et paternels pour tout ensemble de caractères ségrèguent indépendamment de ceux de tous les autres ensembles, si bien que chaque cellule germinale contient un ensemble aléatoire de facteurs provenant des deux parents.
Mendel publia ses résultats, assortis d’une analyse mathématique détaillée, dans le journal de la Société d’histoire naturelle de Brno, où ils demeurèrent oubliés pendant plus de 35 ans.
Colin Ronan. Histoire mondiale des sciences. Seuil. 1988
_____________________________________________________________________________
[1] La guerre de Sécession est le terme adopté en Europe. Les Américains garderont toujours le terme de Civil War, qui rend mieux compte de ses caractères les plus importants, car c’est bien l’aspect de guerre civile qui fut prédominant.
[2] Les grands propriétaires terriens et les capitaines d’industrie brésiliens enverront souvent à la guerre à leur place leurs esclaves contre une promesse d’affranchissement à leur retour… s’ils revenaient.
[3] Femme aux talents multiples : Serge Gainsbourg lui devra sa carrière… et il ne l’oubliera pas,
[4] De tous temps, la localisation précise de la source d’une rivière a été l’objet de controverses : soit, parvenu aux abords de la source, dès lors qu’il a plusieurs cours d’eau, on choisit celui qui est le plus long, ou bien celui qui a le plus gros débit, sans être pour autant le plus long. Les Suisses ont eu ce problème avec le Rhin, mais en refusant systématiquement de s’étriper sur ce sujet qu’avec leur bon sens, ils ne considéraient pas comme majeur ; aussi, contrairement au reste de l’Europe, ils déclarèrent qu’il y aurait désormais 2 cours supérieurs du Rhin : le Rhin inférieur et le Rhin supérieur. Point. La querelle est close !
[5] L’étendard du Sud était cotton is king : 75 % du coton importé par les usines européennes venait des États-Unis. Le Sud était convaincu que leur système esclavagiste était à la base de la richesse américaine et ce fut vrai tant que le pays resta majoritairement agraire.
[6] Il promettait aux esclaves une mule et 40 acres de terre [environ 16 ha], promesse jamais tenue, qui deviendra le symbole de l’hypocrisie et de la tromperie des Nordistes.
Laisser un commentaire