| Publié par (l.peltier) le 31 décembre 2008 | En savoir plus |
ère géologique : fin Dévonien 410 à 358.9 millions d’années.
410 m.a.
Premières feuilles sur les plantes ; elles ont commencé par avoir une seule nervure centrale, puis des nervures ramifiées dont la forme se complexifie de plus en plus.
400 m.a.
Les terres émergées gagnent sur la mer. Notre planète se présente avec un continent principal, le Gondwana avec pour cœur l’actuelle Afrique, bordée à l’ouest de la future Amérique du sud, à l’est, des actuelles Arabie, Inde/Madagascar, Antarctique, et Australie. Au nord de ce Gondwana, une succession d’océans, dans un axe nord-est, sud-ouest, l’océan Rhéique, le Lapetus et le Paléo-Téthys. Au nord-ouest et au cœur de ces océans, un ensemble de plus petits continents, le Laurentia, future Amérique du Nord, le Baltica, future Europe de l’ouest, puis la Sibérie, le Kazakhstan, la Chine du Nord, la Chine du sud. Pendant ces 50 m.a. du Dévonien, le Laurentia et le Baltica vont fusionner pour former le continent des Vieux Grès Rouges, et à la fin du Dévonien les trois océans vont se refermer, laissant ainsi se former une pré-Pangée.
Il y a environ 500 m.a. au début du paléozoïque, le Gondwana constituait sur la sphère terrestre la masse continentale principale localisée dans l’hémisphère Sud. Il réunissait cinq continents : l’Afrique, l’Amérique du Sud, l’Antarctique, l’Australie et l’Inde plus la péninsule Arabique et de grandes îles comme Madagascar, la Tasmanie et Ceylan. Dans l’hémisphère Nord, deux autres continents, l’Amérique du Nord et l’Eurasie ne se réuniront que plus tard, à la fin du Paléozoïque autour de 250 m.a, pour constituer un second supercontinent, le ou la Laurasia. Lui-même s’unira rapidement au Gondwana pour former un unique supercontinent, la Pangéa (c’est-à-dire toutes les terres réunies) et, corrélativement, un unique océan, la Panthalassa (tous les océans réunis).
Le Gondwana s’est constitué dans l’intervalle 600 – 500 m.a. suite à la fermeture des océans panafricains, encore dénommés cadomiens en France, ouverts autour de 800 m.a. Les chaines de montagne panafricaines nées des multiples collisions, induites par la disparition de ces océans, souderont en un super mégacontinent les diverses masses continentales dérivantes. Après environ 300 m.a. de relative stabilité, le supercontinent du Gondwana se fragmentera au Jurassique autour de 200 m.a., engendrant quelques uns de nos continents mais aussi nos océans actuels comme l’Atlantique Sud et les océans péri-antarctiques.
La chaleur interne produite par la désintégration des minéraux radioactifs s’accumule sous la croûte continentale de composition moyenne granitique, épaisse et peu conductrice. Elle provoque le soulèvement du supercontinent, refoulant les mers à ses marges et favorisant le dépôt de faciès continentaux et marins peu profonds. Des gonflements locaux engendrent des voussures, lieux de bris de la croûte continentale. De jeunes océans s’ouvrent, à l’instar de l’actuelle Mer Rouge témoin d’une cassure entre la plaque africaine et celle de la péninsule Arabique qui s’éloigne à la vitesse de quelques centimètres par an.
Le Gondwana n’est pas le premier supercontinent de l’histoire géologique. Plusieurs l’ont précédé, le dernier étant Rodinia, constitué autour de 1 200 – 1 000 m.a. Les continents participent d’un cycle ou grand balai où se succèdent les phases suivantes :
- Formation d’un supercontinent.
- Fragmentation de celui-ci et création de nouveaux continents.
- Dérive de ceux-ci suite à l’ouverture puis la fermeture d’océans (les océans ne peuvent pas grandir indéfiniment : la croûte océanique mince s’enfonce, se fragilise et finit par casser localement et l’océan se résorbe).
- Collision et création d’un nouveau supercontinent différent du précédent. La durée de ce cycle des supercontinents est de l’ordre de 600 – 700 m.a : 300 m.a. de stabilité auxquels s’ajoutent 350 m.a. de dérive aller-retour.
Roland Trompette, Daniel Nahon. Science de la Terre, Science de l’Univers. Odile Jacob 2011
Ce très gros morceau de grès, se trouve en Arabie saoudite : Cette formation est à une cinquantaine de kilomètres au sud de l’oasis de Tayma, non loin du sanctuaire de la faune d’Al Knanafah. Deux rochers d’environ six mètres de haut y reposent sur deux petits socles en parfait équilibre. Les deux structures sont couvertes sur leur face sud-est de nombreux pétroglyphes de chevaux arabes, de bouquetins et d’humains, réalisées vers ~3 000. Il y a encore quelques milliers d’années, ces deux pierres ne faisaient qu’une. La coupe est aujourd’hui tellement nette qu’il peut paraître difficile d’imaginer que la formation rocheuse d’Al Naslaa soit née par accident, mais on ne trouve aucune explication vraiment satisfaisante pour dire l’origine de ce trait de scie parfaitement net
Brice Louvet Sciencepost 28 mars 2022

Apparition des ammonites. Les poissons se multiplient. On connaît un rescapé de cette époque qui est parvenu à survivre, non sans s’adapter, à ces millions d’années : le cœlacanthe, poisson des eaux profondes de l’hémisphère sud : il se fera discret, au moins à la vue des humains, pendant des millions d’années, jusqu’en 1938, quand Majorie Latimer, conservatrice d’un musée de la mer en Afrique du Sud, remarque sur l’étal d’un marché un poisson qu’elle ne connaissait pas : elle s’en ouvre à un scientifique, James Leonard Brierley Smith, qui parvient à situer l’animal, dont tout le monde dit qu’il a disparu il y a plus de 60 millions d’années. On le prend pour un fada, mais celui-ci se met à offrir une prime à qui lui en apportera un vivant, … et quelques mois plus tard, on lui apprend que les habitants de l’île d’Anjouan, dans les Comores vénèrent un étrange poisson bleu : c’est lui. Il faudra attendre les années 1990 pour qu’un sous-marin scientifique rapporte des images du poisson vivant : on lui donnera le nom de la femme qui le découvrit : Latimeria.

Latimeria chalumnae, plus simplement cœlacanthe

Galitheutis phyllura. Calamar cacatoès. Peut mesurer jusqu’à 3 m.

Kiwa hirsuta. Galathée yéti. 20 cm, au sud de l’île de Pâques en 2005 par -2 300 mètres

Vulcanolepas Lau A.sp, crustacés sessiles, nommés pouce-pieds

Crosotta milsae. Méduse d’environ 3 cm. – 1 000 m. à – 3 800 m.

Alvinella pompejana, ver de Pompéi, car à même de vivre sur des parois à plus de 80°C !
Photos [sauf Latimeria] extraites d’Abysses, de Claire Nouvian. Fayard 2007

Sur les pentes du mont de Gorringe, au large du Portugal, en Atlantique
et encore, publiées par GEO du 9 mai 2024, et du 20 février 2025 :





Anémone de mer dans le golfe du Mexique

Méduse rouge de l’Arctique, dite Crossota

Pieuvre dumbo dans le golfe du Mexique

Cténophore de l’Arctique

Poisson-coffre de la mer de Célèbes

Ange de mer de l’Arctique

Méduse Narcomedusae de l’océan Arctique

Chimère d’Indonésie

Le calmar récifal à grandes nageoires, qui vit dans les récifs des eaux côtières, les herbiers marins, les fonds océaniques sablonneux ou le littoral rocheux, peut changer la couleur de son corps et ses motifs en un clin d’œil.
:max_bytes(150000):strip_icc()/horned-or-opalescent-nudibranch-56a5f8ea5f9b58b7d0df532c.jpg)
Les nudibranches utilisent leurs couleurs brillantes (tirées de leur nourriture) pour faire fuir les prédateurs et sécrètent de l’acide pour détourner l’attention malvenue.
Ce poisson-scorpion solitaire trône au sommet de l’épave du Salvatierra, dans la mer de Cortez, au Mexique. Ce poisson des profondeurs est très doué pour se camoufler, ce qui en fait un excellent prédateur qui chasse en embuscade. Cette rascasse est aussi une des créatures les plus venimeuses du monde océanique.

Ce calmar vampire, céphalopode des profondeurs, a des bras palmés, des yeux d’un rouge intense et une cape bioluminescente, d’où son nom baroque. Malgré cela, il ne représente aucune menace pour la plupart des humains, car il passe ses journées à utiliser ses organes bioluminescents et son métabolisme d’oxygène unique pour prospérer dans les parties de l’océan où les concentrations d’oxygène sont les plus faibles. Autre fait étrange ? Il peut se retourner pour éviter les prédateurs.

Le poisson-pêcheur attire ses proies à l’aide d’un appendice lumineux qui lui sert d’appât – d’où son nom. Certains se distinguent par des différences extrêmes entre le mâle et la femelle, cette dernière étant parfois même beaucoup plus grande que son compagnon.

L’anoplogaster – poisson-ogre – est l’une des espèces de poissons qui vit le plus profond. Connu pour ses grandes dents en forme de crocs et pour son corps sombre et robuste, il s’est adapté aux pressions extrêmes des grands fonds marins. Malgré son apparence féroce, il ne mesure que 15 centimètres de long environ et s’avère inoffensif pour l’humain. Ce poisson des abysses craint la lumière, profitant de la nuit pour se rapprocher de la surface. Le poisson-ogre possèderait les plus grandes dents au monde, proportionnellement à sa taille. Si bien qu’il lui est impossible de fermer sa mâchoire en totalité.
et, par Chloé Gurdjian GEO du 23 août 2024 :

Le dragon de mer feuillu, ou hippocampe-feuille (Phycodurus eques), est un poisson de la famille des hippocampes. On l’aperçoit au large de la côte ouest de l’Australie.

Les protubérances du dragon de mer feuillu permettent à cet étrange poisson de se camoufler parmi les algues, se dissimulant ainsi vis-à-vis de ses prédateurs.

Les poissons de la famille des Brachionichthyidae sont surnommés en anglais handfish (littéralement, poissons à mains). Si certaines espèces ont déjà disparu à cause de l’impact humain, d’autres bénéficient d’efforts de protection, notamment en Tasmanie (Australie) où l’on trouve la majorité de ces poissons.

Parmi les poissons à mains, l’espèce Thymichthys politus ne semblait compter qu’une vingtaine d’individus, jusqu’à la découverte d’une nouvelle population en 2019, doublant l’effectif total.

Le poisson chauve-souris des Galapagos, surnommé poisson chauve-souris aux lèvres rouges, semble porter du rouge à lèvres. Un maquillage qui servirait aux individus à se reconnaître entre eux pour la reproduction.

Endémique des îles Galapagos, le poisson chauve-souris aux lèvres rouges se déplace sur le sol à l’aide de ses nageoires pectorales et pelviennes. Au sommet de sa tête, une protubérance appelée illicium lui permet d’attirer ses proies (mollusques et petits crustacés), de même qu’un petit appendice sous son nez agissant comme un leurre.

Prionotus carolinus, un poisson de l’océan Atlantique, connu pour posséder des nageoires ventrales transformées en pseudo-jambes. Famille des Triglidae, autour de -300 mètres.

Les poissons perroquets (Scaridae), incroyablement colorés et dotés d’une étonnante sorte de bec, dorment la nuit dans un cocon de mucus – masquant ainsi leur odeur corporelle vis-à-vis de leurs prédateurs.

Il existe environ 80 espèces de poissons perroquets dans le monde. Leur bouche en forme de bec leur permet de croquer le corail dont ils se nourrissent au sein des récifs. Les particules qu’ils rejettent contribuent à former les plages de sable blanc si prisées des touristes dans les régions tropicales.

Le poisson-grenouille strié, surnommé poisson chevelu (Antennarius striatus) est connu pour son apparence incroyable, évoquant des poils hirsutes ou des cheveux. Ce poisson étrange se démarque également par son mode d’alimentation : il s’avère en effet capable de capturer ses proies à une vitesse record d’environ six millièmes de seconde.

Lorsque le poisson-grenouille strié se sent menacé, il avale de l’eau pour gonfler son corps et ainsi paraître plus gros qu’il ne l’est en réalité.

En anglais, on l’appelle communément Whitemargin Stargazer, stargazer signifiant celui qui regarde les étoiles. En effet, les yeux d’Uranoscopus sulphureus sont situés, comme sa bouche, au-dessus de son corps. De telle sorte que ce poisson étrange peut continuer à voir tout en restant caché dans le sable.

Doté d’un organe électrique, Uranoscopus sulphureus – le poisson qui regarde les étoiles – est capable de générer des décharges à plus de 50 volts, sous certaines conditions de température.

Les Opistognathidae sont une famille de poissons qui regroupe une soixantaine d’espèces. Egalement appelés tout-en-gueule, ces poissons étranges présentent la particularité de conserver leurs œufs dans la bouche.

Une fois que le mâle tout-en-gueule a fécondé les œufs pondus par la femelle, il les place dans sa bouche pour la phase d’incubation, où ceux-ci demeureront pendant une à deux semaines avant d’éclore.

Le poisson pierre (Synanceia verrucosa) compte parmi les poissons les plus dangereux pour l’humain, en raison de son venin mortel et de son camouflage quasi-parfait dans le sable ou parmi les rochers.

Chaque année, 10 à 15 personnes sont hospitalisées en Polynésie après avoir été piquées par un poisson pierre. Le premier geste en cas de piqûre est d’approcher celle-ci d’une source de chaleur (eau chaude entre 45 et 50°C, flamme de briquet ou cigarette) – en prenant toutefois garde à ne pas brûler la victime. Ensuite, une visite aux urgences s’impose.

Les poissons de la famille des Tetraodontidae sont appelés poissons globes (environ 120 espèces au total). Plutôt que de s’échapper face à leurs prédateurs, ils avalent de grandes quantités d’eau afin de gonfler, devenant ainsi plus difficiles à manger.

Les poissons globes contiennent de la tétrodotoxine, un poison létal pour leurs prédateurs potentiels mais aussi pour l’humain. Un seul poisson globe contient assez de toxine pour tuer 30 personnes, et il n’existe aucun antidote connu à ce jour.
En 2001, grâce à un film d’une beauté époustouflante projeté à l’Aquarium de Monterey en Californie, j’ai plongé dans les Abysses. D’une minute à l’autre et sans crier gare, ma vie a changé de direction.
Les images, diffusées en boucle, montraient des animaux qui avaient été filmés par l’Institut MBARI [Monterey Bay Aquarium Research Institute] dans les profondeurs du canyon de Monterey. On y découvrait des créatures fabuleuses, aux formes surprenantes, aux couleurs insensées, crachant des éclairs menaçants de lumière bleue ou ondulant au contraire avec une grâce infinie en produisant des scintillements irisés. Des êtres étranges, sans queue ni tête, s’entortillaient et se déroulaient comme des rubans fluides exécutant une danse magique. Une créature me marqua plus que les autres : une sorte de pieuvre transformiste rouge foncé, munie de deux grandes oreilles comiques qui la rendaient attachante. Elle semblait flotter dans l’espace, parmi les étoiles… Avec une immense élégance, une extrême lenteur, elle gonflait sa robe en ballon ou l’aplatissait en disque : d’autres fois encore, elle la relevait au-dessus de sa tête et se métamorphosait en citrouille abyssale, puis elle ressurgissait soudainement, cette fois vrillée dans la longueur, semblable à une fleur de liseron repliée pour la nuit. Tranquillement enfin, elle s’éloignait dans la noirceur de son univers…
Quel univers ! Je restai quatre fois d’affilée à scruter l’écran, incrédule, guettant l’indice qui, infailliblement, trahirait même le meilleur des truquistes. Mes pensées opéraient la même boucle que le film : Ce n’est pas possible… Ces animaux ne sont pas réels… Ces effets spéciaux sont magnifiquement exécutés, du jamais vu ! Tim Burton est derrière tout ça ! Et au fur et à mesure que mon œil décelait non la marque d’images de synthèse, mais la texture inimitable de la réalité, mes pensées changeaient de nature. Comment est-il possible que la Terre comporte des telles merveilles sans que nous soyons même au courant ? Pourquoi n’a t-on pas suspendu la marche du monde, ne serait-ce qu’une minute, une seconde, pour nous annoncer que ces créatures existaient, ici-bas, au sein même de notre planète ? Je ressentais la même émotion, le même choc, que si je venais d’apprendre que les premiers extraterrestres avaient été découverts… et filmés !
J’était éblouie… sans voix… émerveillée…
Je ne sus analyser que plus tard l’état dans lequel je me trouvais. Aussi stupide que cela puisse paraître, j’avais eu un coup de foudre. Telle une adolescente surprise par la puissance de l’amour, je trouvais que la vie prenait subitement de nouvelles dimensions, comme si un voile s’était déchiré, révélant un voile des perspectives inattendues, plus vastes et plus prometteuses. Dans l’avion qui me ramenait à Paris, toute mon énergie était canalisée par une pensée unique : les abysses. Je me figurais ce volume d’eau colossal, baigné dans l’obscurité permanente, et j’imaginais les créatures fantastiques qui y évoluaient, loin de nos regards, surréalistes résultats d’une nature ô combien inventive.
Bientôt les images qui m’avaient frappé s’estompèrent et je ressentis péniblement la pénurie de documents sur le sujet. Les animaux en mouvement étaient magnifiques, ils étaient la vie, mais la fugacité des images animées ne satisfaisait pas ma curiosité : il me fallait d’abord un livre qui me permettrait de détailler, à ma guise et des heure durant ces bêtes incroyables recluses dans les ténèbres de l’océan. J’avais besoin de recul et de liberté pour entamer mon propre voyage intérieur et rejoindre par l’esprit ces intraterrestres puisant au cœur d’un ciel liquide. Je voulais tout savoir d’eux : à quelle profondeur ils vivaient, comment ils se reproduisaient, leur taille, leur nom… Je rêvais d’un livre qui réunirait les plus belles images ramenées de cette frontière, inaccessible pour la plupart d’entre nous, un livre qui donnerait la parole à ceux qui détenaient les informations précieuses sur cet environnement singulier, un livre qui irait à la rencontre du plus grand nombre : en somme, je rêvais d’un livre qui ferait sortir les abysses de l’ombre.
Cet ouvrage, je le désirais si ardemment, j’avais une vision si précise de la mission qu’il devait remplir que je décidai de le réaliser. J’appelai les chercheurs de par le monde, les grands noms de l’océanographie actuelle, et, l’un après l’autre, tous acceptèrent spontanément de collaborer à mon projet.
Tel qu’il se présente, le livre correspond exactement au désir que j’en avais : un ouvrage qui nourrit notre sens esthétique comme notre curiosité intellectuelle. Un ouvrage qui, je l’espère, saura créer une émotion assez forte pour nous saisir et nous interpeller dans ce qu’il y a de plus profond, de plus intime en nous : notre appartenance à une vaste chaîne vivante incroyablement belle, terriblement fragile, et jusqu’à preuve du contraire, miraculeusement unique sans l’univers.
Claire Nouvian Paris, 2 mai 2006 Avant-propos de Abysses Fayard 2007
Le coup de foudre ne sera pas un feu de paille : en 2014, elle fondera l’association écologiste Bloom obtenant que l’Europe mette fin à la pêche électrique, très prisée des Hollandais, et encore au chalutage en eau profonde qui laboure les fonds marins, y détruisant la flore et parfois la faune … etc
| www.bloomassociation.org |
Apparition des insectes et des graines ; les insectes sont issus des premiers animaux terrestres, les arthropodes – il y a entre 407 et 410 m.a. ; c’est l’embranchement des invertébrés auquel appartiennent également les mille-pattes, les trilobites, les arachnides, les crustacés et les scorpions -. Aujourd’hui, ils représentent 70 % des animaux vivants et jouent, par l’intermédiaire des pollinisateurs, des ravageurs et des recycleurs, un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes actuels.
Et apparition aussi … des sols :
Le sol est bel et bien à l’origine du monde actuel. Il influence le climat tantôt négativement, quand il est source de gaz à effet de serre, tantôt positivement, quand il stocke de la matière organique. Par ailleurs, les eaux des rivières et des fleuves sortent des sols où elles se sont chargées en nutriments et sels minéraux. Les sols pleurent ainsi dans les océans, alimentant leur fertilité. Voilà pourquoi la plupart des poissons sont pêchés le long des continents, là où les algues se développent – et pourquoi les pêcheurs bretons veulent pêcher au large de la Grande-Bretagne… Et puis, le sol joue un rôle central dans le cycle de l’eau. Il la retient comme une éponge et va écrêter les crues, soutenir les étiages et créer des réserves d’eau dans lesquelles puisent les humains et, surtout, les plantes.
Elle présentait une dynamique d’oued, entre inondations brusques et sécheresses totales. Il n’y avait pas de plantes, mais juste de petites croûtes de microbes, un peu comme celles qui ornent les façades de nos immeubles. Et les océans, près des côtes, étaient moins fertiles.
Un sol, pour faire simple, c’est de la matière organique morte en devenir, sous l’effet du vivant qui recycle ainsi des sels minéraux. Ce sont également des fragments minéraux colonisés par des microbes qui les dissolvent, notamment par des processus d’acidification locale. La fertilité ainsi libérée sert à nourrir les plantes. Et le sol contient des gaz qui y pénètrent, eux aussi en devenir sous l’effet du vivant. L’oxygène est ainsi consommé pour la respiration. Ici et là, dans des sols sans oxygène (anoxiques), des bactéries fabriquent du méthane. Ailleurs encore, certaines bactéries utilisent l’azote atmosphérique pour produire des protéines : c’est la source du stock d’azote du sol.
Les sols hébergent plus du quart de l’ensemble des espèces connues – encore ne connaissons-nous qu’à peine 1 % des microbes -. Entre 50 % et 75 % de la masse vivante des écosystèmes se trouvent sous terre. Dans nos régions, un gramme de sol forestier contient des millions de bactéries, appartenant à plusieurs milliers d’espèces, des milliers d’espèces de champignons, un millier d’amibes et des milliards de virus, d’un nombre inconnu d’espèces. La biodiversité, on en parle autant qu’on la foule aux pieds…
C’est très variable. Les sols agricoles de nos régions sont très pauvres en matière organique parce qu’on les laboure, ce qui les aère et favorise la respiration de microbes qui la consomment. Cet appauvrissement les déstructure et les rend plus vulnérables à l’érosion et à la sécheresse, car ils retiennent moins bien l’eau, et cette sécheresse est elle-même très défavorable à la vie microbienne. Dans la Corn Belt du Middle West américain, par exemple, le maïs pousse – mal – sur un sol qui ne contient plus que quelques pour cent de matière organique.
À l’autre bout du spectre, on trouve les sols des tourbières, dans les zones humides du Canada, de Russie, et ponctuellement de France. Elles représentent 3 % de la surface du globe, mais concentrent les trois quarts de la matière organique stockée dans les sols du monde entier ! Dans la lande bretonne, vous trouvez de la matière organique pratiquement pure en surface. Ces tourbières sont aujourd’hui menacées par des feux zombies qui brûlent en été et couvent l’hiver sous la neige, pour repartir à l’été suivant. L’an dernier, les feux zombies russes ont émis autant de CO2 que toute la Belgique.
Autre curiosité : les sols des paramos, dans les montagnes andines, contiennent plus de 20 % de matière organique. Ils ont, de plus, une microporosité qui leur permet de retenir énormément d’eau (deux fois et demie leur poids sec). Ce sont, de fait, les châteaux d’eau de toutes les grandes villes des Andes !
Par un processus en miroir de celui qui opère en surface, à mesure que la végétation se complexifie. Cela commence avec les croûtes microbiennes qui patinent les roches nues ; puis se développent des croûtes de lichen et de mousses puis des herbes, et enfin des fourrés et des forêts. Sous cette succession végétale, le sol mélangeant de la roche altérée et de la matière organique s’épaissit progressivement et finit par former un sol mature – d’une épaisseur de 2 mètres dans les régions tempérées, de 10 mètres à 100 mètres sous les tropiques -, qui va ensuite évoluer très lentement. L’ensemble de ce processus prend un millénaire, au moins : les sols sont un héritage qui ne se reconstitue pas du jour au lendemain. C’est un patrimoine dont nous avons le droit d’encaisser les intérêts, mais notre devoir est de le transmettre.
Pourtant, un sol agricole ne pèse pas très lourd aujourd’hui. La construction de l’université Paris-Saclay, sur le plateau de Saclay, a allègrement détruit un des sols les plus productifs d’Ile-de-France, et nul n’a bronché.
Quand les plantes terrestres sont apparues, c’est-à-dire quand des algues se sont associées à des champignons pour exploiter un sol encore très rudimentaire. Cette symbiose a commencé il y a au moins 400 millions d’années, d’après les fossiles disponibles.
Les premières plantes terrestres n’étaient pas dotées de véritables racines mais de tiges rampantes. les racines sont apparues plus tard, comme un moyen d’accueillir davantage de champignons. Cette association symbiotique perdure, car les deux partenaires y trouvent un bénéfice. Les racines, en effet, n’exploitent pas directement le sol. Elles accueillent des champignons qui puisent dans le sol les sels minéraux qu’ils redistribuent ensuite à la plante, en échange des sucres – fabriqués par photosynthèse – que celle-ci leur fournit.
Parce que les plantes, grâce aux champignons, ont acquis une capacité accrue d’exploiter le sol et donc de faire de la photosynthèse. Elles ont pu nourrir encore plus les champignons, qui sont devenus encore plus capables d’exploiter le sol. Un cercle vertueux s’est installé. Les deux partenaires ont commencé à altérer la roche et à déposer des déchets qui formeront la matière organique du sol. Par ailleurs, les filaments du champignon et les parties racinaires des plantes ont créé un maillage qui a structuré et retenu le sol.
Cette coopération a fait chuter le CO2 de l’atmosphère. D’une part, le gaz carbonique a été massivement transformé – par photosynthèse – en plantes vivantes ou mortes (dans les sols). D’autre part, les roches se sont altérées plus vite dans les sols qu’en surface. Résultat, elles ont injecté du calcium et du magnésium, par les cours d’eau, dans les océans. Là, ces éléments ont précipité sous forme de calcaire en pompant le CO2 atmosphérique. Résultat, le climat s’est massivement refroidi.
En effet, un des sous-produits de la photosynthèse est l’oxygène, dont le taux atmosphérique s’est mis à augmenter. Première conséquence, les incendies sont apparus et ont commencé à se propager (avant, il n’y avait pas grand-chose à brûler, et les feux ne s’entretiennent pas dans une atmosphère contenant moins de 15 % d’oxygène). Résultat, les premiers charbons se sont formés il y a environ 400 millions d’années. Mais, en plus, comme il y avait plus d’oxygène dans l’air, de plus gros animaux ont pu se développer car ils pouvaient plus facilement respirer. Des poissons – nos ancêtres – se sont hissés sur terre, capables de respirer assez pour porter leur propre poids hors de l’eau.
La façon dont nous les traitons n’est pas durable. L’excès de labour, par exemple, augmente d’un facteur 10 à 100 leur érosion. Résultat, nos sols labourés sont en train de fondre, trop lentement pour qu’on s’en rende compte, et pourtant la dégradation des sols affecte déjà la vie de 3 milliards et demi d’individus dans le monde. D’ici trente ans, leur épuisement provoquera la migration de 50 millions à 700 millions de personnes.
Quand on exporte les pratiques agricoles européennes dans d’autres écosystèmes, notamment dans les tropiques, où les sols n’ont pas le même fonctionnement, les dégâts sont parfois pires.
Aux États Unis aussi des erreurs ont été commises, entraînant une prise de conscience plus précoce que la nôtre. Les pratiques de labour et de pulvérisation de la surface du sol (dry farming) ont entraîné, dans les années 1920-1930, des érosions éoliennes catastrophiques. La région touchée a été nommée Dust Bowl (bassin de poussière). Certains sols ont été décapés, ruinant des dizaines de milliers de personnes et provoquant leur exode. Ce malheur a inspiré à John Steinbeck Les Raisins de la colère (1939). Et au président Franklin D. Roosevelt cette phrase, en 1937 : Une nation qui détruit ses sols se détruit elle-même.
De nombreuses civilisations amérindiennes n’ont jamais utilisé de charrues : elles plantaient dans un trou… et c’est tout ; la main d’œuvre pour désherber, par ailleurs, ne manquait pas. On peut donc nourrir de vastes civilisations sans labour. La charrue augmente certes les rendements à court terme, ce qui a conduit à son adoption en Europe. Mais, aujourd’hui, la permaculture, qui évite le labour, obtient des rendements réduits de seulement 10 % au plus. Ce type d’agriculture maintient un couvert végétal entre deux cultures, c’est-à-dire durant les intercultures (entre la récolte d’une culture et le semis de la suivante). Ces méthodes conservent la fertilité naturelle. Mais il faut poursuivre les recherches pour les généraliser (pour la pomme de terre, par exemple, la permaculture reste difficile).
L’inondation des sols cultivés avec des engrais crée une double dépendance des plantes, vis-à-vis des engrais et vis-à-vis des pesticides. Abreuvées d’azote et de phosphate sous forme d’engrais, les plantes vont cesser d’alimenter leur partenaire fongique en sucres. On entre dans un cercle vicieux : en l’absence du champignon, les plantes auront besoin de plus d’engrais pour être nourries. Elles perdront aussi la protection que leur fournissait le champignon vis-à-vis des microbes pathogènes (il émet, en effet, des toxines, et sa présence stimule le système immunitaire de la plante). Pour autant, il faut reconnaître une vertu à cette agriculture conventionnelle : elle a, quantitativement, nourri l’humanité. Mais avec des effets de bord sur la qualité des sols, sur la qualité des eaux de surface et sur la qualité des aliments.
Observons le fonctionnement spontané des sols, qui peut nous inspirer des alternatives à nos pratiques agricoles actuelles. Il en existe déjà, comme l’agriculture biologique, mais il faut aller plus loin. Le bio améliore grandement la qualité alimentaire, et aussi un peu la qualité des sols, en interdisant les engrais et les pesticides d’origine chimique. Mais le labour reste pratiqué, qui tue la vie du sol.
La permaculture, une forme d’agroécologie, commence à être développée pour limiter le labour. Et le sol reprend vite des couleurs ! Autre atout, elle utilise des intercultures, on l’a vu, qui limitent l’érosion et réinjectent de la matière organique dans le sol. Quand, de surcroît, ces intercultures sont des plantes associées à des bactéries capables de transformer l’azote atmosphérique en protéines, comme les légumineuses (lentilles, pois, haricots, fèves, etc.) qualifiées d’engrais verts, c’est une élégante façon de réintroduire de l’azote dans le sol.
Les consommateurs ont pris conscience de l’importance de manger sainement, ce qui justifie l’agriculture biologique, mais ils méconnaissent la nécessité d’entretenir les sols. Or, un sol, on l’a vu, met un millénaire à se construire ! J’appelle de mes vœux une convergence de l’agriculture biologique et de la permaculture, pour respecter à la fois la santé des consommateurs et celle des sols.
Les agroécologistes n’ont jamais cru que la nature était bonne en soi : ils proposent de gérer et d’exploiter les synergies existant dans la nature. Par exemple, quand vous plantez des arbres au-dessus de cultures céréalières, vous gérez de façon vertueuse des problèmes microclimatiques et des problèmes d’érosion. Finalement, vous réduisez peu les rendements des céréales, mais vous pouvez compter sur le bois produit. Autre exemple : en misant sur les synergies des champignons associés aux racines des plantes, vous pouvez nourrir les plantes dans des sols moins fertilisés.
J’entends dire que ça ne peut pas fonctionner avec les variétés végétales actuelles. Mais la sélection variétale n’est pas un processus achevé ! Il y a dix ans, on disait que les semoirs n’étaient pas adaptés à la permaculture. Or, aujourd’hui, ces semoirs sont produits industriellement. Il y a des solutions à développer. Qu’on ne me dise pas que c’est infaisable : ce serait faire insulte à l’intelligence humaine et à la force du biomimétisme.
Cette odeur de terre mouillée a un nom : c’est le pétrichor. Cette senteur fraîche et musquée émanant du sol, après une averse, provient de la géosmine, une molécule sécrétée par un groupe de bactéries du sol, les actinobactéries. Dissous dans les gouttes de pluie, ces composés volatils sont libérés sous forme d’aérosols. Finalement, le pétrichor raconte que le sol est riche en actinobactéries. Celles-ci sont aussi la source de nombreux antibiotiques, comme la streptomycine, produite par le genre Streptomyces. Cela montre, au passage, que la biodiversité du sol sert à autre chose qu’à l’agriculture. Tous nos antibiotiques sortent du sol ! Ce sont des moyens de lutte des microbes qui se castagnent entre eux, et que l’homme a réutilisés contre ses propres ennemis pathogènes…
Marc André Selosse. Le Monde du 1 décembre 2021
Trois catégories de vers se partagent le travail : les épigées restent en surface pur brasser et déchiqueter la litière ; les anéciques creusent des galeries verticales et entraînent la matière organique vers le fond (jusqu’à 100 % de la matière organique déposée en surface par endroits) tout en remontant la terre vers la surface par leurs turricules ; enfin, les endogées creusent des galeries horizontales en profondeur et stimulent l’activité microbienne qui parachève le recyclage des nutriments, les rendant à nouveau disponibles aux plantes, Les différentes strates du sol sont constamment mélangées. Les tunnels permettent d’aérer et d’humidifier le sol ; ils canalisent la progression des racines et sont un véritable paradis pour la communauté microbienne qui s’y développe, Les vers représentent la plus grande biomasse de la plupart des sols forestiers européens : on y trouve 100 à 200 gr de vers par m². Si l’action d’un seul ver de terre peut paraître négligeable, leur force vient de leur nombre. Tous ensemble, ils transforment le sol en une véritable éponge qui peut stocker d’énormes quantités d’eau lors de fortes pluies, augmentant la capacité d’infiltration et évitant ainsi les phénomènes d’érosion et de glissement de terrain. Cette eau percolera ensuite doucement vers la nappe phréatique et les rivières, De même, en déposant chaque nuit leur turricules à la surface, les vers ramènent des profondeurs environ 40 tonnes/ha/an, soit une épaisseur de 4 mm/an, 40 cm/siècle, 4 mètres/millénaire. Un rôle qui a particulièrement fasciné Darwin qui décrétait le ver de terre meilleur ami de l’archéologue et du paléontologue. En recouvrant patiemment de turricules tout objet déposé sur le sol, ils le protègent des injures du temps pour des durée indéfinies. Darwin avait même cherché à élaborer une échelle temporelle ; basée sur la vitesse d’enfouissement qui aurait permis de dater les découvertes archéologiques à une époque où l’on avait aucun moyen de datation. Ainsi, toute cette partie du sol placée sous l’influence des vers de terre est appelée drilosphère. Mais il existe également la myrmécosphère tout aussi importante et marquée, elle, par l’influence des fourmis. Il existe plus de 400 espèces de fourmis en Europe et leur rôle est tout aussi capital que celui des vers de terre dans le fonctionnement de la forêt, Les fourmis construisent leurs fourmilières en rassemblant de grandes quantités de débris végétaux et en aménageant tout un réseau de galeries souterraines. Le sol est plus chaud, plus sec, plus aéré et plus riche en nutriments, Les arbres voisins ne s’y trompent pas : ils envoient leurs racines vers les fourmilières et poussent bien plus vite que les autres, Les fourmis collectionnent toutes sortes de choses et notamment des graines dont elles assurent la dispersion (myrmécochorie), Elles peuvent également chasser et une seule colonie peut consommer en une saison des centaines de milliers d’insectes et des dizaines de litres de miellat produits par les pucerons, Chaque fourmilière possède son cimetière et son dépotoir où les fourmis accumulent leurs déchets et cadavres, un endroit particulièrement riche en éléments nutritifs et qui fait la joie de nombreux organismes, Mais, mieux qu’une fourmilière active, il y a la fourmilière abandonnée. Sa couche superficielle étanche n’étant plus entretenue, la fourmilière prend l’eau, ce qui accélère d’autant plus sa décomposition, donc le recyclage des nutriments, par ailleurs, les fourmis n’étant plus là pour faire le ménage, chaque graine déposée sur la fourmilière y trouve les conditions parfaites pour germer sans craindre leurs mandibules, La fourmilière abandonnée devient ainsi un véritable pépinière.
Stéphane Durand 20 000 ans ou la grande histoire de la nature, Actes Sud 2018
390 m.a.
Les arbres commencent à développer le cambium, la cellule reproductrice qui se trouve entre l’écorce et l’aubier : on a donc un bois de cœur, composé de cellulose et de lignine. Les archéoptéryx qui pouvaient déjà atteindre 30 mètres de haut vont céder la place aux lycopodes, qui vont atteindre jusqu’à 50 mètres, avec un Ø de base de 2 m.
La grande aventure de la vie sur Terre
9 Entre 380 et 358 m.a. les tétrapodes se risquent hors de l’eau
Les animaux, eux aussi, vont parvenir à se hisser sur les territoires émergés. En tête de file, les tétrapodes – dotés de deux paires de membres locomoteurs – qui sont apparus en milieu aquatique. L’un des plus vieux proto-tétrapodes dont on ait retrouvé des fossiles, Tiktaalik roseae pouvait se servir de ses articulations flexibles afin de se hisser sur les berges humides et de s’y déplacer brièvement. Vers – 365 m.a., Ichttyostega est le premier animal connu à pouvoir entreprendre une locomotion purement terrestre. Il possède des côtes allongées et un sternum primitif qui protègent ses poumons contre la pression exercée à l’air libre par le poids de son propre corps. Mais ces animaux ne sont pas encore totalement terrestres ! Il faudra pour cela une autre innovation, vers – 340 m.a., qui rompra pour de bon leur dépendance au milieu aquatique : l’œuf amniotique. Celui-ci, doté d’une membrane, isole l’embryon du milieu aérien et le protège ainsi de la dessication, lui offrant un environnement aqueux propice à son développement.
William Rowe-Pirra Sciences et Avenir n° 208 Janvier à Mars 2022
380 m.a.
Dans le parc national de Miguasha au Québec, on découvre un poisson fossile appartenant à un groupe éteint qui annonce les tétrapodes – vertébrés à quatre membres, dont font partie les humains – Elpystostège Watsoni -. Intégrés aux nageoires, des petits os font penser à des proto-doigts, ce qui leur permet peut-être de s’aventurer en eaux peu profondes, voire sur la terre ferme.
Il y a 370 à 320 m.a. ! Ou plutôt, bienvenue dans les eaux de la Planète bleue, à l’heure où d’intrépides créatures s’apprêtaient à en sortir. En ces temps reculés, des pionniers aquatiques se sont lancés à l’assaut d’un nouvel eldorado : les terres émergées. Beaucoup y laissèrent des écailles. Quelques élus en réchappèrent ; certains ont prospéré. De leur audace est née l’aventure évolutive des vertébrés terrestres à quatre pattes. Ces poissons ont donné naissance aux tétrapodes terrestres qui, à leur tour, ont évolué pour former les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères que nous connaissons aujourd’hui. Une fabuleuse success story, donc – du moins, jusqu’à sa récente mise en péril. Quelles ont été les innovations génétiques, physiologiques et mécaniques qui ont permis cette colonisation du milieu terrestre ? Une série d’études récentes révèlent quelques surprises. Leur principe : les chercheurs tentent de remonter le temps en déchiffrant les génomes d’espèces actuelles de poissons, mais qui semblent avoir très peu évolué depuis leur apparition – des espèces qualifiées un peu abusivement de fossiles vivants ou d’espèces reliques, comme le fameux cœlacanthe. Puis ils comparent ces génomes anciens avec ceux d’espèces modernes de poissons ou de vertébrés terrestres. Les régions du génome qui présentent de plus grandes différences sont celles qui sont susceptibles d’avoir joué un rôle évolutif majeur. Au-delà de la seule lecture du génome, les chercheurs s’intéressent aussi aux gènes dans les différents organes corporels : ils en déduisent leur importance dans la fonction de ces organes. Que montrent ces études ? Contre toute attente, les bases de ces innovations existaient déjà chez l’ancêtre commun de tous les poissons dits osseux – pas seulement chez l’ancêtre de la lignée qui s’est hasardée sur la terre ferme, donc. Quand l’ère de la sortie des eaux est venue, il a suffi de quelques adaptations pour que ces risquetout puissent respirer, voir et se mouvoir sur la terre ferme. Une série de petits pas génétiques, donc. Mais un pas de géant pour la future humanité. À quoi ressemblait la Terre, en ces temps immémoriaux ? Nous sommes à la fin du dévonien. Les plantes ont colonisé la terre ferme depuis plus de 50 m.a. : leur arrivée sur les continents date de – 500 à – 475 m.a. De gigantesques forêts se développent alors – des forêts de pro gymnospermes, des plantes fossiles cousines de nos plantes à graines. Et le climat ? Dans l’atmosphère, le taux de gaz carbonique [CO2] a chuté, raconte Chris Bowler, titulaire de la chaire biodiversité et écosystèmes au Collège de France, et chercheur CNRS à l’École normale supérieure. Comme ce taux était faible, la planète était froide. Il y avait des glaciers aux latitudes élevées, et le niveau des mers était bas. Pourquoi une telle chute des taux de CO2 – passant de 4 000 parties par million (ppm) à environ 300 ppm, un taux similaire à celui des derniers millions d’années ? Parce que ce gaz a été consommé par des plantes terrestres récemment évoluées. Grâce à la photosynthèse, elles ont transformé le CO2 en matière organique et produit de grandes quantités d’oxygène, explique Chris Bowler. Cela a stimulé l’évolution d’insectes géants. Mais le dévonien n’est-il pas surnommé l’âge des poissons ? Non sans raison : à cette époque, ces vertébrés aquatiques se sont alors énormément diversifiés. Des poissons ont évolué vers des formes tétrapodomorphes, qui conduiront aux premiers tétrapodes à gagner la terre ferme.
Mais quelle terre ? Des fossiles de tétrapodes datant de la fin du dévonien ont été trouvés sous toutes les latitudes, des tropiques aux régions polaires. L’un d’eux, par exemple, baptisé Tutusius umlambo, a été découvert en 2018 en Afrique du Sud, près des latitudes australes. Il faut savoir qu’à la fin du dévonien la configuration des continents différait radicalement de celle des continents actuels. Le supercontinent Pangée ne commencera à se former que plus tard, il y a 335 m.a. à partir de la coalescence de sept ou huit grands continents, indique Chris Bowler. Revenons à notre fossile : longue de 1 mètre, la créature est une mosaïque à gueule de crocodile, à pattes trapues et à queue en forme de nageoire. En réalité, ce n’était probablement pas le premier vertébré à mettre un pied sur la terre ferme. Il n’empêche : Nous savons désormais que les tétrapodes, à la fin du dévonien, vivaient dans le monde entier, des tropiques au cercle antarctique. Il se peut donc (…) qu’ils aient commencé à se déplacer sur la terre ferme n’importe où sur la planète, observe Robert Gess, paléontologue au Muséum Albany, en Afrique du Sud. Mais, avant de plonger dans le grand bain de cette odyssée, grimpons brièvement sur les branches de l’arbre évolutif des poissons. Quelle formidable diversité ! Les poissons regroupent près la moitié des espèces de vertébrés actuels, relève Alain Chédotal, directeur de recherche à l’Institut de la vision (Inserm, CNRS, Sorbonne Université) à Paris. On en connaît plus de 28 000 espèces, qui vivent dans tous les environnements aquatiques possibles. Intéressons-nous aux poissons à mâchoires. Parmi eux, il y a les placodermes : ces poissons cuirassés se sont éteints il y a 440 m.a. Il y a les poissons cartilagineux, comme les requins et les raies. Et il y a les poissons osseux : tous les autres, soit l’écrasante majorité. Eux seuls nous intéressent ici. Ils se divisent en deux branches : les poissons à nageoires rayonnées (actinoptérygiens) et les poissons à nageoires charnues (sarcoptérygiens). Les premiers comptent quelques espèces très anciennes mais encore actuelles, comme le bichir. Surtout, ils rassemblent les poissons dits téléostéens, soit 99,8 % des espèces actuelles ! Carpes, brochets, sardines, anguilles, truites, thons, morues, soles, épinoches… tous sont des téléostéens. Une vraie pêche miraculeuse. Quant à la seconde branche, celle des poissons à nageoires charnues, elle donnera naissance aux tétrapodes. Mais elle porte aussi une sous-branche de poissons anciens : le cœlacanthe et les dipneustes figurent parmi ces fossiles vivants. Revenons à l’ère de la sortie des eaux. Deux capacités sont indispensables à la conquête du milieu terrestre : la respiration à l’air libre et la locomotion, rappelle le professeur Jean Nicolas Volff, responsable de l’équipe génomique évolutive des poissons à l’École normale supérieure de Lyon. Ces capacités, se dit-on, ont dû apparaître lors de la sortie des eaux. Selon le scénario évolutif cher à Darwin, des variations (mutations) sont alors survenues par hasard, puis elles ont été retenues par la sélection naturelle. Sauf qu’il y a une erreur de date. L’ancêtre commun à tous les poissons osseux, en effet, était déjà équipé des outils génétiques pour faire des membres articulés et pour faire des poumons. Pour survivre à la sortie de l’eau, nos héros n’ont eu qu’à améliorer ces prototypes, révèle une série de travaux récents. Mais alors, quid des poissons restés dans l’eau ? Les chemins évolutifs sont décidément tortueux : ils ont dû, à rebours, transformer les bases innovantes qui abritaient en germe la possibilité d’envahir la terre ferme, dans le génome de leurs ancêtres… pour les réadapter au milieu aqueux. Examinons la première adaptation indispensable à la survie en milieu terrestre : la respiration à l’air libre. L’étude des dipneustes est ici précieuse. Première surprise : ces poissons d’eau douce, d’apparition très ancienne, sont pourtant les poissons actuels les plus proches des vertébrés terrestres, indique Jean Nicolas Volff. Ils sont dotés, en plus de leurs branchies, d’un poumon fonctionnel qui les rend capables de respirer à l’air libre. Chez le dipneuste australien, ce poumon est sollicité quand l’eau s’appauvrit en oxygène, en complément de la respiration branchiale. Quant au dipneuste africain, il peut survivre des mois hors de l’eau, durant la saison sèche, grâce à cet unique poumon ! Des équipes ont séquencé les génomes du dipneuste australien et de son cousin africain. Verdict : Les génomes de ces deux poissons recèlent une grande diversité de gènes codant les protéines du surfactant pulmonaire, indique Jean Nicolas Volff, qui cosigne l’étude dans Nature. Ce surfactant est un matériau complexe, associant lipides, phospholipides et protéines ; il est sécrété en continu dans la lumière des alvéoles. Son rôle est essentiel : grâce à ses propriétés tensioactives, il facilite l’expansion des alvéoles lors de l’inspiration et les maintient ouvertes lors de l’expiration. Sans surfactant, pas de respiration aérienne : les alvéoles s’effondreraient sur elles-mêmes. Autre évolution observée chez ces poissons : il y a eu une expansion des gènes des récepteurs olfactifs. Des outils indispensables à la vie en milieu aérien, pour détecter les odeurs et les phéromones qui aident à la reproduction. Examinons maintenant quatre autres poissons, plus anciens encore que les dipneustes. Ces poissons d’eau douce peuvent atteindre 2 ou 3 mètres de long. Ils portent des noms baroques : le bichir du Sénégal, le poisson castor, le poisson spatule, le garpique alligator. Soit quatre espèces à nageoires rayonnées, qui ont divergé très tôt de la lignée des téléostéens. Prenons le bichir du Sénégal, ou poisson-dragon. Lui aussi est doté d’un poumon fonctionnel. Eh bien, les chercheurs ont découvert, dans son poumon, des gènes actifs semblables à ceux qui sont actifs dans les poumons des tétrapodes. Prenons maintenant le garpique alligator, qui vit dans la basse vallée du Mississippi : lui n’a pas de poumon fonctionnel, mais il est muni d’une vessie natatoire. Cet organe, également présent chez la plupart des téléostéens (truite, etc.), sert à contrôler la flottaison : il se remplit ou se vide de gaz. Plus étonnant encore : la vessie natatoire du garpique alligator lui sert parfois de poumon. Or, dans cet organe du garpique, les chercheurs ont trouvé les mêmes gènes activés que dans le poumon du bichir. Tous les indices concordent : en clair, l’ancêtre commun de tous les poissons osseux avait déjà un poumon fonctionnel, mais pas de vessie natatoire. Ensuite, ce poumon primitif est devenu inutile chez la plupart des poissons osseux, qui respirent grâce à leurs branchies. Recyclage évolutif, il a été transformé en vessie natatoire, commente Jean Nicolas Volff. Voyons désormais la seconde adaptation nécessaire à l’évolution sur la terre ferme : la locomotion. Nouvelle surprise : les dipneustes sont déjà prééquipés pour des déplacements terrestres. Par exemple, des gènes clés du développement, comme HOXC13, sont hyperactifs dans leurs nageoires. Mieux : ces gènes ressemblent à ceux qui sont actifs dans les membres à cinq doigts des tétrapodes. Voyons maintenant ce qui se passe chez nos quatre poissons très anciens : bichir du Sénégal, poisson-castor, poisson-spatule et garpique alligator. Dans leur génome, les chercheurs ont trouvé des éléments régulateurs qui augmentent la flexibilité des nageoires. Mais qui dit locomotion terrestre dit, le plus souvent, articulations sophistiquées. Une équipe de Harvard s’est interrogée : avant leur sortie de l’eau, les poissons étaient-ils déjà outillés pour bricoler des membres aptes à se déplacer sur le sol ? Les chercheurs ont examiné un de leurs modèles favoris : le poisson-zèbre, un téléostéen qui n’a jamais mis un pied sur la terre ferme. Par mutagenèse, ils ont produit une myriade de mutations touchant au hasard le génome de ce poisson. Parmi les mutants obtenus, ils sont tombés sur un os… salutaire. Un os à effet Eurêka !. Une mutation ponctuelle, sur une seule lettre de l’ADN, suffit pour produire un spectaculaire effet : dans la nageoire, deux os se divisent en deux. Mieux : une véritable articulation se crée entre les os divisés ; des muscles et des neurones moteurs s’y connectent. Cette mutation touche une région du génome (VAV2) qui contrôle l’activité de gènes clés dans la formation des membres. Pour vérifier son importance, les chercheurs ont créé des souris portant des mutations dans cette même région. Résultat, ils ont induit des déficits dans les articulations du rongeur. Ce travail montre que les téléostéens n’ont pas de membres parce qu’ils ont perdu la capacité à exprimer ce gène. Le reste du programme génétique pour bâtir un membre est présent, mais à l’état dormant, relève Alain Chédotal. Mais à quoi a pu servir, chez ces anciens poissons, un tel pré-équipement à la locomotion terrestre ? Dans l’imaginaire collectif, le poisson évoque un animal évoluant en pleine mer. Mais le niveau des mers étant plus bas, en ces temps reculés, ces membres primitifs ont peut-être servi à des vertébrés aquatiques, dans un premier temps, à se déplacer sur les basfonds des marécages et des mangroves… Une première étape, ou plutôt une première marche avant la véritable sortie des eaux. Voilà donc nos ancêtres poissons équipés pour se mouvoir sur le sol. Leur longue marche, cependant, a été pavée d’embûches. Mieux valait qu’ils soient résilients face à ces multiples stress ! C’est ce que suggère, là encore, l’étude des dipneustes. Deux gènes, dont l’action anxiolytique était connue chez les tétrapodes modernes, ont été identifiés chez ces poissons : NPS et NPSR1. Ils renforcent la résistance au stress en codant un neuropeptide (le neuropeptide S) et son récepteur. Ce faisant, ils inhibent la transmission de l’influx nerveux dans l’amygdale, cette région du cerveau impliquée dans la détection de la peur, de l’anxiété et de la douleur – mais aussi du plaisir. Nos téméraires poissons ont été ainsi armés contre les méfaits du stress, lors de cette épreuve du feu – ou plutôt, des terres émergées. Si le scénario se dessine, ses acteurs vedettes restent anonymes. On ignore l’identité des premiers vertébrés aquatiques qui sont sortis de l’eau, admet Jean Nicolas Volff. Sans doute étaient-ils assez proches du cœlacanthe et des dipneustes actuels. Leurs nageoires articulées ont évolué en pattes munies de doigts, qui leur ont d’abord permis de ramper sur les fonds marins. Certains ont aussi exploité leur poumon primitif pour respirer à l’air libre. Cette transition aurait eu lieu dans les eaux stagnantes des marais du dévonien, pauvres en oxygène. Pour se hisser hors de l’eau, ces poissons ont d’abord utilisé leurs puissantes nageoires osseuses. Puis celles-ci ont poursuivi leur évolution en pattes semblables à celles qui équiperont les tétrapodes. Toutes ces innovations n’ont pas été inventées d’un seul coup de baguette magique. Un constat conforme aux lois de l’évolution. Il n’empêche : les bases génétiques ayant permis ce saut magistral étaient bien plus ancestrales qu’on ne l’imaginait. L’essentiel du matériel génétique était déjà là, il y a 450 m.a. au nœud évolutif entre les deux branches des poissons osseux. Moyennant quelques adaptations, ce même matériel permettra ensuite la respiration pulmonaire et la locomotion terrestre, résume Jean Nicolas Volff. Reste une énigme. Pourquoi, voici 450 m.a. un poisson qui avait des branchies a-t-il développé un poumon primitif ? Peut-être parce qu’à un moment l’oxygène est devenu plus rare dans l’eau, avance le généticien. Ce poumon primitif aurait été utile pour capter l’oxygène de l’air, en surface. Ensuite, les poissons qui ont colonisé la Terre ont perdu leurs branchies : ils n’en avaient plus besoin. De leur côté, la plupart des poissons à nageoires rayonnées ont perdu leur poumon primitif, qu’ils ont transformé en vessie natatoire. Peut-être le taux d’oxygène dans l’eau a-t-il réaugmenté. Ce poumon serait alors devenu superflu. Et puis venir respirer en surface n’était pas dénué de risque : bien plus tard, quand les oiseaux prédateurs sont apparus, ils ont guetté ces nouvelles proies pour n’en faire qu’une becquée. La pression de sélection, sauf exception (dipneustes, cœlacanthe, bichir), n’a donc pas retenu ce double mode de respiration. Ultime exploit, ces poissons feront mentir, bien plus tard, un géant de la littérature. Pour vivre, le poisson ne doit pas sortir de l’eau, notait Hugo dans une œuvre de jeunesse (Han d’Islande, 1823). Vertigineux aveuglement, en vérité. Car si un poisson plein d’audace, jadis, n’avait osé s’échapper du milieu aqueux, vaste mer amniotique qui l’abritait, nous ne serions pas là pour en disserter.
[…] Les poissons sont de drôles de zèbres… Le plus grand génome connu de vertébré appartient au dipneuste éthiopien. Il compte 133 gigabases, soit 42 fois la taille du génome humain ! S’il est si long, c’est qu’il est truffé de parasites : de courtes séquences d’ADN très mobiles, ou éléments transposables, se multiplient au sein des génomes. Ces parasites créent un sacré bazar. En même temps, ils favorisent l’évolution en produisant de la diversité, explique le biologiste Jean-Nicolas Volff. Quant au plus petit génome de vertébré, c’est celui du fugu, ce fameux poisson japonais prisé des gastronomes téméraires – on peut mourir en quelques heures si l’on ingère son poison. Pourquoi ce génome est-il si petit, alors qu’il abrite autant de gènes que celui des dipneustes ? C’est parce que le fugu s’est débarrassé de ces éléments transposables, indique Jean-Nicolas Volff. Autre étrangeté : on sait que le génome des vertébrés a subi deux événements de duplication, il y a 500 à 550 m.a. à la base du tronc de leur arbre évolutif. Le génome des poissons téléostéens, lui, en a subi une duplication, il y a 350 m.a. Ce qui rend leur génome particulièrement plastique, apte à muter pour créer plus de diversité encore.
florence rosier. Le Monde du 21 avril 2021
de 375 m.a. à 360 m.a.
Disparition d’au moins 70 % des espèces, suite de plusieurs événements successifs qui se seraient déroulés sur une période de 15 à 20 m.a. dite du Dévonien tardif.
360 m.a.
La plaque Avalonia poursuit sa subduction sous Armorica, et à l’opposé, Gondwana en fait de même, mais en sens inverse.
Apparition des premiers tétrapodes vertébrés avec pattes. Premiers amphibiens : petit poisson en a marre de se faire croquer par les gros : il a bien envie d’aller voir sur terre si l’herbe y est plus verte – en fait le garde-manger y est surtout constitué de nuées d’insectes – et pour cela il lui faut des pattes : il va laisser tomber ses nageoires arrières qui vont devenir pattes, il va se doter d’un système respiratoire passant par des poumons pour respirer de l’air ; il va encore supporter longtemps l’eau de mer dans son organisme.
LE POISSON À POUMONS
Les dipneustes cumulent les originalités. Pourvus de branchies et de poumons, nos plus proches cousins poissons résistent à l’assèchement saisonnier grâce à un cocon aux étonnantes qualités immunitaires. L’histoire paraît familière, naturelle aux deux sens du terme. Elle tient en quelques mots : il y a 360 millions d’années, pour sortir de l’eau et gagner la terre, les animaux marins ont développé des poumons. Eh bien, non ! Tout est faux dans cette phrase, fautif même. D’abord, il n’y a pas de pour. C’est la base de la théorie de l’évolution. Les êtres vivants n’évoluent pas pour profiter du milieu. C’est l’environnement, dans toutes ses dimensions, et les différentes pressions qu’il impose, qui sélectionnent parmi la multitude de mutations incessantes celles qui sont favorables à une espèce. Ce préalable darwinien posé, notre histoire reste toujours aussi fausse. Car dans l’arbre de la vie, les poumons sont apparus sur des espèces marines il y a au moins 420 millions d’années.
Pendant 60 millions d’années, les poumons sont restés dans l’eau, avec une fonction d’adaptation aux milieux manquant d’oxygène, souligne Gaël Clément, paléontologue et professeur au Muséum national d’histoire naturelle. Les poissons qui en étaient pourvus respiraient essentiellement avec leurs branchies mais remontaient prendre une goulée d’air à la surface quand cela devenait nécessaire. Dans un second temps seulement, ils ont permis à certaines espèces de sortir de l’eau. Ce comportement initial, les dipneustes l’ont conservé. On connaît mal ces poissons à poumons, d’une longueur allant jusqu’à un mètre et vivant plusieurs dizaines d’années.
Présents il y a bien longtemps dans toutes les eaux du globe, douces comme salées, ils ont peu à peu disparu. Ne restent aujourd’hui que six espèces dites reliques, concentrées chacune dans quelques lacs d’Afrique subsaharienne, d’Amérique du Sud ou d’Australie. Dans les fonds saumâtres de ces régions subtropicales, leur double respiration fait merveille.

À lui seul, ce comportement mériterait un peu plus de renommée. Mais cinq des six espèces en question font encore mieux : elles ont développé une technique unique qui leur permet de survivre à l’assèchement saisonnier de ces climats arides.
Les dipneustes creusent un trou dans la vase, produisent du mucus, dont ils font un cocon, enterré à 50 centimètres de la surface. Sec à l’extérieur, constamment humide à l’intérieur, il évite le dessèchement. Seul un petit canal vertical relie l’abri à l’air libre. Plongé dans une torpeur estivale de plusieurs mois, le poisson attend ainsi des jours meilleurs.
Tout cela était connu, rappelle Gaël Clément, ce que personne ne savait, c’est que cette barrière physique cachait aussi une barrière immunitaire. Une équipe de l’université du Nouveau-Mexique vient de le révéler, dans un article paru le 17 novembre dans la revue Science Advances. Le cocon est en réalité un tissu vivant avec des propriétés antimicrobiennes, résume Irene Salinas, coordinatrice de cette recherche, spécialiste de l’immunologie évolutive.
La chercheuse a repris un travail de 1931 qui décrivait les cellules sanguines chez les protoptères, l’autre nom des dipneustes africains. Elle a profité des technologies modernes pour aller beaucoup plus loin avec l’un d’eux, Protopterus annectens. Elle a d’abord observé l’abondance de granulocytes, des globules blancs également présents chez les humains, et leur migration vers la peau à la saison sèche. On a alors décidé d’analyser le cocon, explique simplement la chercheuse. Et là, bingo ! Elle y a trouvé non seulement les granulocytes mais des pièges extracellulaires, des sortes de filets à bactéries façon Spider-Man, décrit-elle. Pour bien s’en convaincre, les chercheurs ont éteint chimiquement cette action immunitaire. Dans leur cocon, les poissons ont développé œdèmes, hémorragies et autres septicémies.

Pendant la saison sèche, il creuse un trou dans la vase, s’y recroqueville et sécrète du mucus par ses ouïes, qui durcit pour former un cocon de protection.
Des globules blancs appelés granulocytes migrent de la paroi intestinale et des reins vers la peau, puis dans le cocon. Ce gilet immunitaire protège le poisson des infections pendant ce long sommeil estival.
Lorsque l’eau revient avec les pluies, le poisson sort de son cocon et reprend une activité aquatique.
Un système immunitaire externalisé : jamais pareille chose n’avait été observée dans la nature. L’équipe prévoit d’aller l’étudier sur site, en Tanzanie, l’an prochain. Pourrions-nous nous en inspirer, à l’heure des grandes pandémies ? Irene Salinas évite de plonger dans la science-fiction. En revanche, certaines molécules aux propriétés antibactériennes retrouvées dans ces pièges sont déjà en cours d’étude.
Nathaniel Herzberg. Le Monde du 15 décembre 2021
Les feuilles composées modernes deviennent majoritaires dans le monde végétal : une diminution de concentration du CO2 atmosphérique, associée à une augmentation de la densité des stomates à la surface des feuilles, assurait une meilleure évapotranspiration, et des échanges gazeux accrus. Un meilleur refroidissement des feuilles leur permettait ainsi d’acquérir une plus grande surface. Les systèmes de racine se développent très souvent en symbiose avec des champignons, qui se nourrissent d’elles mais qui leur apportent aussi des nutriments, notamment des phosphates, permettant une croissance accrue des plantes. Dans les sous-bois ombragés du dévonien supérieur apparaissent les premières plantes à graines.
ère géologique : Carbonifère 358.9 à 298.9 millions d’années.
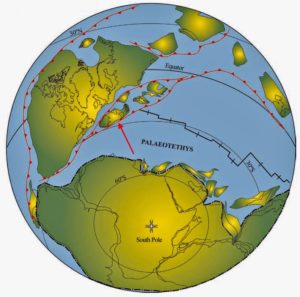
Dans cette vue Mississippienne (340 Ma), les terranes de type cadomien (flèche) se sont détachés du corps principal du Gondwana et entreront en collision avec Laurussia lors de l’orogenèse Ouachita-Alleghenian-Variscan. La collision de Gondwana a entraîné Pangea aux dépens de l’océan Rhé. Les terranes de sous-sol de l’Europe se sont maintenant formés – une Europe de Gondwana. Il ne reste plus qu’à les obtenir de l’océan Atlantique, qui se formera bientôt.
Arte a réalisé une série tout à fait remarquable sur la question : La Valse des Continents, par Christopher Hooke. Disponible en DVD.
La grande aventure de la vie sur Terre
10. vers 350 millions d’années, des graines, des racines et … des ailes
Arrimées à la terre ferme, les premières plantes terrestres dépendaient encore largement de l’humidité pour se reproduire. Leurs spores germaient et produisaient des gamètes mâles qui nageaient dans les sols très humides de leurs habitats à la recherche d’un gamète femelle. À l’instar de l’œuf amniotique pour les tétrapodes, le développement de la graine, un ovule contenu dans une enveloppe appelé tégument, rompt la dépendance des plantes aux milieux aqueux. Les gymnospermes ou plantes à graines nues – tels nos sapins contemporains -, développent alors des cônes, dans lequel ils stockent leurs graines ; encore un moyen de résister à la dessication et de survivre plusieurs années en milieu sec avant de germer. Cette innovation est une arme décisive dans l’arsenal des végétaux pour la conquête complète du milieu terrestre. C’est aussi de cette époque que date le plus vieux fossile d’insecte connu, mais ses caractéristiques laissent entendre que les premiers insectes sont apparus quelques dizaines de millions d’années plus tôt, pendant le silurien.
William Rowe-Pirra. Sciences et Avenir n° 208 Janvier à Mars 2022
vers 330 m.a.
L’ensemble Euramérique, Amérique du Nord et Europe, se rapproche du Gondwana, l’ensemble prenant le nom de Pangée, bordée à l’ouest par l’océan Panthalassique et à l’est par le Paléo-Tethys. Ce mouvement provoque la formation de la chaîne des Appalaches et de la chaîne Hercynienne [1], gigantesque chaîne de montagnes, à l’étendue comparable à l’actuelle Himalaya, de 1 000 à 1 500 km de large. Les sommets peuvent atteindre 5 à 6 000 m. Aujourd’hui, en France, les roches anciennes du Massif Central, de la Montagne Noire, mais aussi de la Bretagne – les granites de Pont l’Abbé – et du Mont Saint Michel, des Ardennes, des Vosges, appartenaient à cette chaîne, ainsi que des parties importantes de chaînes plus jeunes comme les Pyrénées et les Alpes. La Bretagne se trouvait à la latitude… de l’équateur. Son climat était tropical, ses reliefs couverts de forêts luxuriantes d’où émergeaient des fougères géantes, l’océan bordant ses côtes était peuplé de trilobites (les ancêtres des crustacés), dont de nombreux fossiles ont été retrouvés dans le schiste breton. On retrouve aussi des restes de cette chaîne hercynienne en Angleterre, en Belgique, en Bohème, Calabre, Sardaigne, Espagne, Afrique du Nord, Mauritanie, et encore dans l’Est des États-Unis (la création de l’Atlantique est postérieure). C’est dans ces couches que l’on trouvera plomb, zinc, argent, fer, uranium…
Les océans disparaissent peu à peu tandis que les montagnes continentales se rapprochent et entrent en collision, ce qui provoque la formation d’une chaîne d’importance mondiale : la chaîne hercynienne. Les sédiments marins sont alors plissés. Quand ils sont entraînés en profondeur, sous l’effet de l’augmentation de la pression et de la température, ils sont d’abord transformés en schistes, quartzites et marbres alors que, dans les parties les plus profondes de cette chaîne, la fusion de ces roches donne naissance à des granites. Puis toutes ces roches sont revenues en surface, car, à peine dressées, les montagnes de la chaîne hercynienne sont soumises à l’érosion, qui va durer au moins cinquante millions d’années, à la fin du carbonifère puis au Permien.
Histoire des dinosaures dans le Languedoc méditerranéen

Les arbres sont surtout des conifères à feuillage persistant, de 10 à 30 m. de haut, qui se reproduisent avec des spores, comme les fougères : les Archéoptéris – des gymnospermes -. Ils dispersent dans l’air, en grande quantité, des grains de pollen contenant le matériel génétique mâle. Transportés jusqu’aux ovules, protégés par des feuilles rigidifiées en écailles, organisées pour former des cônes – à l’image de nos actuelles pommes de pin – c’est là que se forme la matrice où sont fécondées les graines : succès immédiat : les arbres vont dépasser les 30 mètres. Un écosystème se forme avec des libellules de 70 cm d’envergure et des amphibiens de 3 mètres de long. La biomasse végétale pompe tellement de dioxyde de carbone que les périodes glaciaires se reproduisent à intervalles réguliers par manque de gaz à effet de serre.
L’hémisphère sud est en grande partie sous les glaces et de vastes zones marécageuses se développent à l’équateur.
vers 304 m.a.
Érosion de la chaîne Hercynienne : sables et argiles s’entassent, parfois colorés en rouge par des oxydes de fer. Les hauts reliefs vont disparaître en 50 m.a. Apparition des reptiles. Un peu à l’est de l’actuelle ville de Castres, dans le Sidobre, une intrusion hercynienne sous forme de lentille épaisse en forme d’amande amène du granite en surface, qui se solidifie sur une épaisseur allant de 7.5 km à 20 km. La grande diversité des formes actuelle des blocs est l’œuvre d’une érosion ultérieure, sous climat tropical. C’est aujourd’hui le bassin granitique le plus important de France, exploité essentiellement pour les monuments funéraires.
Peyro Clabado, 708 tonnes. Les rochers gris du Sidobre émergent des fougères comme les baleines des vagues. Certains rochers fameux, Pero-Clabado par exemple, semblent posés par un génie farceur qui s’amuse à nier les lois de l’équilibre. Le Sidobre a son mystère, ses bois et ses lacs, son grand jeu de granit. Lorsque les experts régionaux affirment qu’il est actuellement le dernier refuge des druides et des fées, on est tenté de les croire. Ces forêts sortent évidemment des contes. Oui, c’est bien ainsi que nous avons toujours imaginé les bois où les enfants se perdent et devinent que l’on peut aimer. Kleber Haedens. L’air du pays.

Le troisième jour de la Genèse, Dieu sépara la terre des eaux et la nomma continent. Ce continent était d’une pièce, plat, et les quatre fleuves qui sortaient du jardin d’Eden devaient multiplier leurs méandres pour rejoindre la mer qui les entourait.
Les crimes, trahisons et forfaitures de l’humanité contre son Créateur sont tous commis en pays plat. Caïn ne pousse pas Abel dans le vide, il l’assomme dans un champ où la vue se perdait. C’est au moment où Jéhovah, dépité de l’échec de sa première esquisse, décide de revoir sa copie et noie toute la planète, que les montagnes sont mentionnées pour la première fois : Noé échoue son arche-ménagerie sur le sommet encore boueux et glissant du Mont Ararat. Après la décrue, la planète met encore quarante jours pour sécher. On la découvre alors ridée comme une patate, couverte de sommets enneigés, de pics sourcilleux, de vallées, de précipices. De ses cinq mille mètres retrouvés, l’Ararat qu’on peut bien appeler la mère des montagnes domine l’immense espace biblique – de l’Arménie à l’Égypte – où notre histoire va prendre forme.
Première victoire du roc sur l’eau, du solide sur le liquide, et début d’une guerre interminable dont nous ne connaîtrons pas l’issue avant des millions d’années. Combat où, comme dans celui des gladiateurs, chaque élément dispose d’armes différentes, de tactiques opposées, et affronte l’autre dans un temps dont l’aune n’est pas la même. L’eau peut attendre : elle attaque et ronge les côtes, les berges, les îles, déracine les arbres par milliers pour les jeter sur les rivages solitaires où ils deviennent ossuaires d’immenses troncs écorcés et blanchis par les vagues et les récifs. La montagne, moins ancienne, moins avisée et patiente est, à sa façon, auto-suicidaire : elle arrête les nuages qu’elle transforme en pluie, grêle, neige, glaciers, moraines, cascades, gorges de plus en plus profondes dans lesquelles elle finit par s’effondrer et se refermer sur elle-même, à moins que, minée par les pluies et la sape de l’humide elle ne s’éboule dans le lac qui la reflétait, créant un raz-de-marée qui emporte les villages riverains.
Ainsi en 1806, le Rossberg (canton de Schwytz) s’effondre dans le lac de Lauerz et la vague qu’il provoque détruit le bourg de Goldau et fait près de cinq cents morts : la plus grande catastrophe naturelle de notre petit pays, mais sans doute pas la dernière. Ici l’eau a vaincu la montagne et accroît la mauvaise humeur de cette dernière. Match nul. Mais, pendant qu’au fil des millénaires, certains reliefs s’érodent sous l’effet de la pluie qui vient à bout de molasse et calcaire, d’autres font face avec leurs défenses granitiques et se montrent intraitables. Je ne pense pas que le Cervin ait perdu beaucoup de sa hauteur et de sa morgue depuis les Magdaléniens. La terre reprend aussi parfois les territoires que l’eau lui vole par le surprenant et imprévisible biais des volcans. Soudain elle en a marre de sa couverture aquatique, elle se rebiffe, surgit d’une mer qui se met à siffler comme bouilloire et crée une île volcanique parfois d’une taille considérable que les hommes ne tardent pas à occuper et cultiver malgré les dangers d’une nouvelle éruption et que les géographes doivent placer sur leurs cartes. La légende veut que l’île de Cheju, entre la Corée du Sud et la côte chinoise, soit sortie de la mer dans un immense bruit de pet. Pet élevé à la dignité de dieu et figuré par d’innombrables effigies taillées dans la lave qui jalonnent le sentier – horriblement éprouvant – qui conduit au cratère. Cheju, c’est quatre-vingts kilomètres de tour et un cône de prés somptueux, de plateaux de rhododendrons où courent des chevaux sauvages, de névés qui bordent le cratère. Ces révoltes sporadiques, Krakatoa ou volcans des îles alaskiennes, ne se produisent qu’aux fissures des plaques sismiques et nous sont épargnées. Dans les Alpes, le combat est beaucoup plus serein et plus lent, et la conscience occidentale a, elle aussi, été très lente à mesurer ses enjeux.
Alors qu’en Chine, les montagnes médiatrices se couvrent de monastères taoïstes, de bonzeries bouddhiques et que leur ascension assure dix ans de longévité, l’Occident reste plus circonspect. Ou bien la montagne est sacrée – donc interdite – parce que séjour des Immortels (quel disciple de Platon aurait osé gravir l’Olympe ?) ou bien elle l’est parce que séjour des sorcières et des démons. Au XVII°, seul un géologue fou serait allé planter sa tente sur le Mont Chauve (Kahlenberg) en Bohème.
À son égard, les Saintes Écritures restent d’ailleurs ambiguës : elles l’ont sanctifiée au Mont Sinaï, puis crucifiée au Golgotha. La Tour de Babel, montagne artificielle, est ridiculisée par le Créateur et réduite, par la confusion qu’elle suscite, à l’état d’un chantier en faillite. Beaucoup de théologiens la considéreront d’un mauvais œil : c’est une paille dans la Création, une incongruité commise au seul instant où Jéhovah avait le dos tourné et peut-être pendant son jour de repos. Même Buffon et ses collègues tiennent ces pics érectiles et inaccessibles pour une erreur de la nature, et leurs abords inhospitaliers comme le repaire de contrebandiers, déserteurs, proscrits louches et bandits de petits chemins.
Revenons à l’eau qui, dans son combat contre (ou avec) le roc, produit un phénomène stupéfiant qui de l’Extrême-Orient à l’Amérique fait l’unanimité : c’est, vous l’aviez deviné, la cascade. La cascade qui remplit à la fois de joie, de curiosité et de terreur respectueuse devant les Œuvres du Créateur – n’oublions jamais que la plupart de ces naturalistes sont des chrétiens convaincus qui voient dans la nature le grand laboratoire du Ciel.
Bien plus que les pâmoisons de Haller et de Rousseau, ce sont les cascades qui vont séduire l’imagination populaire et gagner la montagne à sa cause. Sans parois escarpées, sans à-pics et sans glaciers, pas de cascade. Mille ans de peinture extrême-orientale et toute notre iconographie alpestre témoignent de cet engouement. En outre, la cascade use la montagne, transforme les éclats coupants d’éboulis en galets, alimente les rivières et irrigue nos champs. Elle fait un trait d’union arqué, gracieux, éblouissant entre stérilité et fertilité, entre sérac et avoine. De l’eau ou du rocher, qui va gagner cette bataille ? Je suis prêt à risquer un pari à très long terme : un magnum de champagne Krug millésimé 1982. C’est l’eau qui gagnera donc. À moins d’être un nouveau Noé, ce qui est improbable, je ne boirai jamais de cette bouteille qui aura quelques millions d’années lorsque cette vieille affaire aura été tranchée, et que les canards feront coin-coin sur les cimetières sous-marins d’une humanité disparue.
Nicolas Bouvier. Entre errance et éternité. Éditions Zoé.1998
À l’ouest de l’actuel aéroport de la Grand’Combe, dans les Cévennes, la forêt de Champclauson connaît une inondation subite qui fossilise nombre de ses végétaux : on y trouve aujourd’hui des troncs de palmiers, des systèmes racinaires pétrifiés : c’est grâce à l’abandon dans les années 1960 d’une ancienne mine de charbon que ce site a pu être protégé.
De ces immenses forêts tropicales qui, au Carbonifère, s’étendaient jusqu’à la pointe nord du Spitzberg, nous ne saurions rien si les vestiges n’avaient été remis au jour lors du forage des mines de charbon. Les marécages dans lesquelles elles croissaient furent envahis par la mer qui, tous les mille ans environ, y faisaient mourir les arbres et ensevelissaient leurs restes à demi-décomposés sous une couche d’eau salée et de boue. Sous cette carapace qui se durcissait, ils se transformaient en carbone. Il s’est agit là d’un phénomène répétitif, extrêmement lent, où intervenaient plusieurs facteurs, et qui s’est déroulé pendant de nombreux millions d’années. Le gisement d’Essen, en Rhénanie, par exemple, a révélé, grâce à une coupe géologique, l’existence de cent quarante-cinq forêts superposées.
Jacques Brosse. L’aventure des forêts en Occident. De la préhistoire à nos jours. J.C. Lattès 2000
ère géologique : Permien 298.9 à 245 millions d’années.
290 m.a.
Les premiers reptiles sophistiqués et les premières plantes modernes [conifères] se sont développés. Certains tétrapodes comme Sclerocephalus sont capables de régénérer leurs membres en entier ; aujourd’hui la salamandre, qui apparaîtra 80 m.a. plus tard, est le seul tétrapode qui ait gardé cette caractéristique. La capacité de régénération se serait donc perdue puis retrouvée sur le chemin de l’évolution.
270 m.a.
Amorcée au carbonifère supérieur, la constitution de la Pangée, supercontinent rassemblant la quasi totalité des terres émergées, se termine au début du Permien. Une grande partie de l’hémisphère sud est sous la glace et une calotte glaciaire recouvre le pôle nord. Puis le climat va se réchauffer, les forêts équatoriales faisant place à de grands déserts. Grands dépôts de potasse et de sel gemme.
Formation aussi du charbon, qui provient de la maturation en profondeur de matières organiques végétales continentales quand le pétrole et le gaz sont le plus souvent issus de la transformation de matières organiques marines (le plus souvent des algues) ou plus rarement lacustres (plancton, bactéries).
Le taux d’accumulation de carbone organique est, durant ce laps de temps, le plus important de l’histoire de la terre. Les végétaux colonisent les zones côtières marécageuses, mal drainées, périodiquement envahies par des entrées maritimes mais aussi des bassins intérieurs sans liaison avec la mer. Les charbons s’accumulent majoritairement à de hautes latitudes sous des climats froids à tempérés, humides. Dans l’hémisphère Nord, les charbons de la Laurasia se forment à basses latitudes entre l’équateur et le tropique du Cancer.
Pour accumuler du charbon, il faut non seulement disposer d’une forte productivité de carbone organique mais il faut aussi le soustraire à l’oxydation. C’est-à-dire qu’il faut après son dépôt l’enfouir rapidement. Cela est réalisé par des sédiments déposés par des transgressions marines (bassins côtiers) induites par les fontes glaciaires ou/et par des apports fluviatiles issus de la rapide érosion des reliefs avoisinants.
Roland Trompette, Daniel Nahon. Science de la Terre, Science de l’Univers. Odile Jacob 2011
Comme ce charbon est curieux ! comme cette roche combustible, merveilleuse, peut-être riche de suggestions ! La combustion génère la chaleur. Cette pierre brûle. Ce qui se consume est essentiellement du carbone, c’est un hydrocarbure. Il en va avec le pétrole, avec le gaz aussi, comme avec le charbon. L’origine du carbone pur se trouve dans la végétation. Nos carbonates, comme le calcaire, contiennent du carbone, mais combiné à de l’oxygène ; il est donc déjà captif, il n’est plus libre – il n’est donc plus en condition de brûler.
Le charbon doit se composer de carbone libre, dans une large mesure – mélangé, probablement avec des hydrocarbures. Le carbone, comme nous le voyons avec le charbon de bois, brûle sans flamme brillante et sans fumée. L’hydrocarbure, comme un peut le constater avec le kérosène ou le gaz d’éclairage, brûle avec une flamme vive. Il s’agit alors d’une masse de carbone saturée d’hydrocarbures liquides ou gazeux, ou peut-être bitumineux. En tous cas, nous sommes toujours conduits à trouver au carbone une origine végétale.
Alors, si nous examinons un tas de charbon, nous découvrirons sans doute des signes de tissus végétaux. Dans le schiste argileux collé aux morceaux de charbon ou mélangé au charbon lui-même, on trouve des empreintes qui ressemblent à des feuilles de fougères. Si on descend dans les mines, on trouvera même des troncs d’arbres de taille modérée, sertis dans les couches de schiste argileux qui se trouvent au-dessus du charbon, ou parfois aussi dans le charbon lui-même. Toutes ces observations conduisent à nous convaincre que le charbon est d’origine végétale. Si nous cherchions plus loin, nous trouverions des traces de végétation qui ressemblent à nos prêles et à nos pins nains. On peut donc conclure que le charbon qui brille joyeusement dans le foyer, se trouva un jour sous la forme d’un arbre sans fleur, enraciné dans un sol séculaire, étalant ses vertes frondaisons sous le soleil, décomposant ainsi l’acide carbonique contenu dans l’atmosphère et fixant le carbone dans ses propres tissus tout en libérant l’oxygène.
Ce qui veut dire que le soleil brillait déjà dans le ciel il y a bien longtemps. Les schémas des structures végétales existaient déjà, ainsi que les forces de la croissance végétale. Combien de temps ces schémas n’ont-ils pas perduré ! Comme les pensées qui se sont incarnées dans ces schémas sont impérissables ! L’arbre se tenait droit dans le sol, il buvait de l’eau par ses racines et baignait son feuillage dans l’air primordial. Il a bâti son tronc et ses branches avec des fibres et des cellules, tout comme les fougères modernes. Le soleil a stimulé ce schéma qui est devenu action. La chaleur du soleil lui a donné la force de remplir ses fonctions. Les émanations de lumière et de chaleur solaire se transformèrent en tronc, en feuillage et en tissus variés.
Quelles que soient les vicissitudes que cette croissance ait pu ensuite subir, le même charbon éliminé est toujours là ; c’est la même lumière transformée qu’il y a des millions d’années. C’est une ancienne lumière solaire qui a été enfermée comme un trésor et enfouie sous la terre pendant des siècles.
Alexander Winchell 1824-1891 Walks and Talks in the geological field 1886

Le Gorgonopsien vit à Majorque Avec ses 90 cm. de long, il ressemble à un chien sans oreilles ni fourrure, mais ses dents de sabre en font un redoutable chasseur. Dinosaur Era via YouTube
260 m.a.
Eunotosaurus (du grec lézard, et eunotos, à dos robuste) creuse son abri sommaire dans ce qui deviendra l’Afrique du Sud, non loin d’une mer intérieure superficielle. Grâce à des robustes pattes avant et des côtes courtes, larges et épaisses, il est adapté à un mode de vie terrestre et fouisseur. Première étape menant à la carapace, ces côtes confèrent un double avantage : protection face au broyage de la cage thoracique en cas d’ensevelissement, et surtout meilleure capacité à creuser le sol en rigidifiant le tronc. Ces innovations arrivent à point nommé : il y a 250 m.a. lors de l’extinction de masse permien-trias, les ancêtres des tortues survivent probablement aux températures infernales régnant au cœur de la Pangée (jusqu’à 50 à 60°) grâce à leur capacité à s’enfouir. Quelques m.a. plus tard, vertèbres et côtes se souderont, devenant carapace : plastron au niveau du ventre et dossière sur le dessus, reliés par deux ponts sur les côtés du corps.

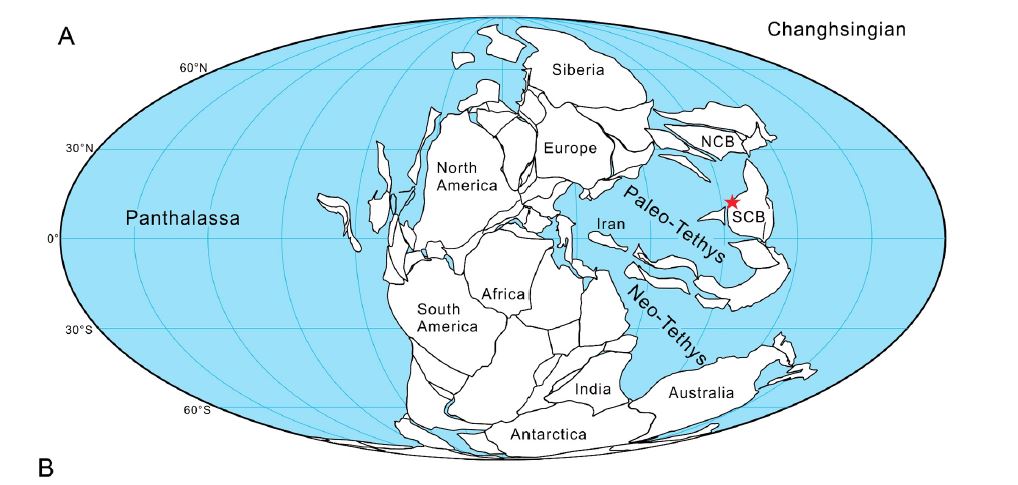
Paléographie du Changhsinien – 254,14 m.a. à 251,90 m.a. Le supercontinent Pangée s’est formé mais le bloc de Chine du Sud SCB reste à part. L’océan Paléo-Téthys se ferme tandis que la Néo-Téthys s’ouvre. La Pangée est entourée par l’océan Panthalassa. Selon Wang Wenqian et al., 2020…
252 m.a.
La plus grave crise que la vie a connue depuis le début du Cambrien s’est produite à la fin du Permien il y a environ 252 m.a. provoquée par les trapps de Sibérie, de grandes éruptions volcaniques qui ont eu lieu au nord de ce qui était la Pangée, et qui ont duré 300 000 ans ! Elles y ont laissé de grandes coulées de laves, mais aussi des dépôts de coulées pyroclastiques. La vie dans les mers a été considérablement affectée. Des animaux emblématiques du Paléozoïque, comme les trilobites et les coraux rugueux et tabulés, ont disparu. Les brachiopodes, des animaux à coquilles semblables aux bivalves mais constituant un embranchement à part, ont beaucoup régressé. Sur Terre, mêmes les insectes ont été affectés.
Les trapps de Sibérie n’ont pas été les seuls phénomènes volcaniques de grande ampleur de la fin du Permien. Les trapps d’Emeishan (le mont Emei), dans l’actuelle Chine du Sud, ont également perturbé le système climatique de cette époque. Les coulées basaltiques recouvrent une surface de 250 000 km² sur un à deux kilomètres d’épaisseur. Les phénomènes volcaniques de grande ampleur – formation de trapps sur les continents et de plateaux océaniques – sont des causes d’extinction.
En 2020, des scientifiques travaillant en Chine, sous la direction de Wang Wenqian, ont déterminé l’évolution des températures des eaux superficielles jusqu’à la fin du Permien en utilisant des fossiles de brachiopodes. Les isotopes de l’oxygène des cristaux de calcite de leurs coquilles fournissent des indications sur les températures des mers. Elles ont augmenté à la fin du Capitanien et sont restées élevées au tout début du Lopingien. Les températures maximales de l’eau ont alors tourné autour de 31°. Une extinction des coraux rugueux s’est produite à ce moment, parce qu’ils étaient les animaux benthiques les plus sensibles aux températures. Les fusulines (des foraminifères géants) et les bivalves, plus résistants, ont périclité plus tard.
Le premier étage du Lopingien, le Wuchiapingien, va de 259,1 à 254,14 m.a. (soit un laps de temps de 5 m.a.), la fin étant définie avec une meilleure précision que le début. Elle correspond dans les anciennes mers de Chine du Sud à une période froide, probablement due à l’altération des basaltes des trapps d’Emeishan. Ce processus est un puits de CO2 atmosphérique, alors que les éruptions volcaniques en sont une source. Le refroidissement s’est poursuivi jusqu’à la fin du Wuchiapingien. Le deuxième étage du Lopingien, le Changhsingien, va de 254,14 à 251,90 m.a. D’une durée d’environ 2,2 m.a., il est marqué par un réchauffement, enregistré par les brachiopodes, qui coïncide avec les premières éruptions pyroclastiques en Sibérie. Il est plus court mais plus ample que celui de la fin du Capitanien. Les plus hautes valeurs sont atteintes il y a 251,90 m.a. à la limite Permien-Trias, ce qui coïncide avec l’extinction de masse. Elle a été datée entre 251,94 et 251,88 m.a. Elle aurait donc duré dans les 60 000 ans, en tout cas moins de 100 000 ans.
La deuxième phase a eu lieu entre 251,91 et 251,43 m.a. à peu près durant cinquante mille ans. Ne pouvant plus gagner la surface, le magma s’est propagé dans des sills (des intrusions parallèles aux strates), où se trouvaient des strates d’évaporites et de carbonates du bassin sédimentaire de la Toungouska qu’il a métamorphisée. Il en a résulté une forte émission de gaz à effet de serre, dont du méthane et du dioxyde de carbone. Cette phase appartient au tout premier étage du Trias, l’Indusien, qui dure seulement 700 000 ans. Sa fin est située à 251,2 m.a. Durant une troisième phase, jusqu’il y a 251,35 m.a. le magma a continué à se propager dans des sills mais il a de nouveau atteint la surface, provoquant de nouvelles éruptions volcaniques. À cela, il faut ajouter que le bassin de la Toungouska comporte aussi beaucoup de matière organique, dont des hydrocarbures et du charbon, qui a été brulé lors des éruptions.
D’après l’ensemble des données disponibles, avant l’excursion isotopique, environ 9 600 Gt (gigatonnes) de carbone ont été injectées sous forme de CO2 dans l’atmosphère durant une période de 35 000 ans. Le taux d’émission moyen était par conséquent de 0,27 Gt de carbone par an. La composition isotopique du CO2 émis montre qu’il provenait du manteau terrestre.
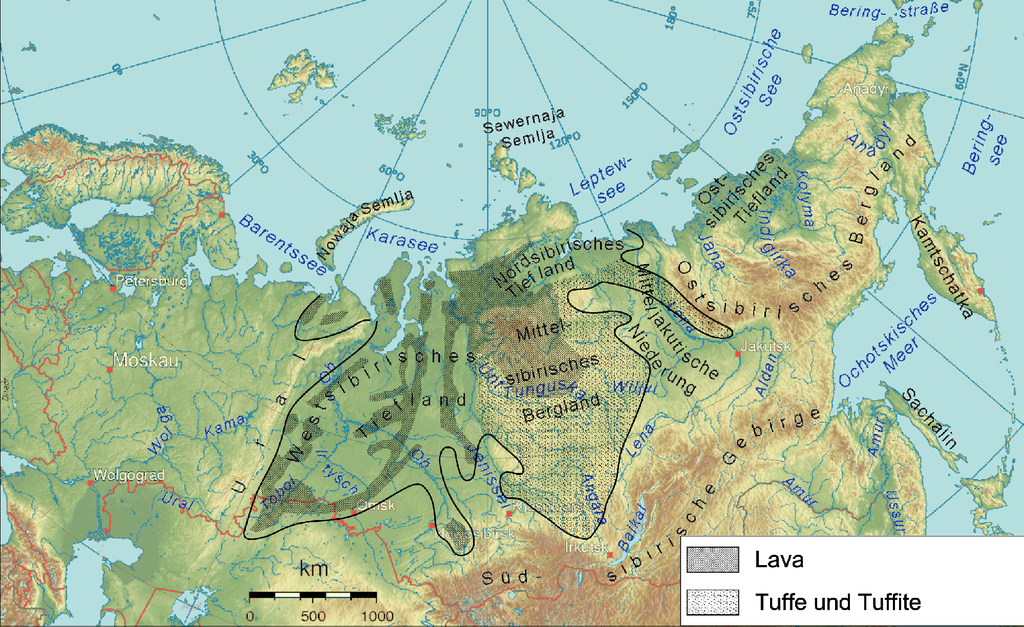
Les trapps de Sibérie. Les affleurements de basalte et de tuf volcanique sont en gris foncé. Les sills (intrusions) sont indiqués en gris clair.
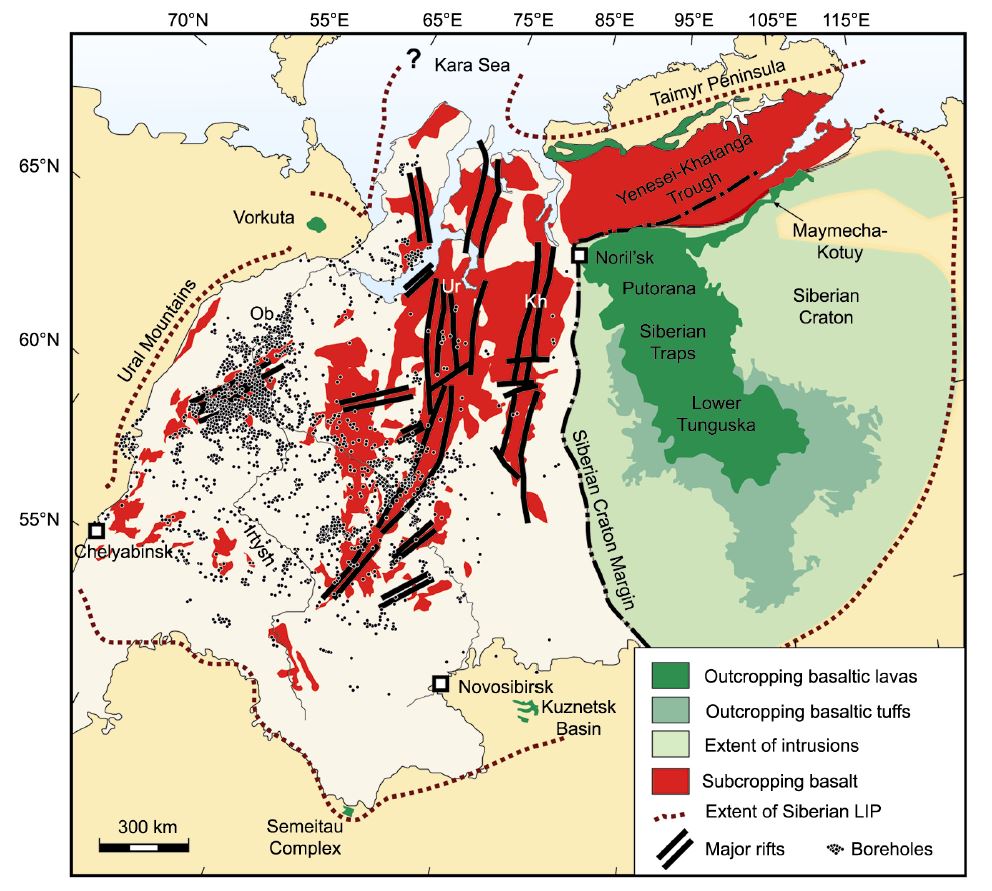
Carte des trapps de Sibérie selon Andy Saunders & Marc Reichow, 2009. Les affleurements de basalte et de tuf volcanique sont en vert. Les sills (intrusions) sont indiqués en vert clair. A l’ouest du craton sibérien, du basalte est recouvert par les sédiments.
Au bout de 44 000 ans, la quantité de carbone allégé émise dans l’atmosphère a atteint les 48 000 Gt. C’est beaucoup, sachant qu’au début de l’ère industrielle, il y avait 589 Gt de carbone. Mais bien entendu, toute cette quantité ne s’est pas accumulée dans l’atmosphère. Au fur et à mesure de son émission, le dioxyde de carbone s’est dissous dans l’océan superficiel, puis le carbone a été transféré dans les profondeurs grâce à l’activité biologique. L’altération des roches silicatées (granites et basalte) et du calcaire, consommatrice de CO2, a agi durant toute la formation des trapps de Sibérie. Elle a été amplifiée par l’élévation de la concentration en CO2 atmosphérique.
Les forêts australiennes ont été dévastée par des incendies, bien avant le début de l’extinction marine. L’acidification et les températures de l’océan superficiel ont atteint leur niveau le plus élevé à la fin de cette période de forte émission de CO2. Ces pics correspondent à la limite Permien-Trias. Dans la Téthys, la température initiale était de 22 °C. Elle était à 24 °C au début de l’excursion isotopique et elle est montée jusqu’à 31 °C avant de décroître. Au début du Trias, les volcans de Sibérie ont continué à émettre du CO2 provenant de la combustion de matière organique, mais moins que durant le paroxysme de la crise. La concentration en CO2 atmosphérique est restée au niveau assez élevé de 1 500 ppm.
Après le début de l’excursion isotopique, l’acidification des eaux superficielles et leur réchauffement ont décimé les constructeurs de récifs, qui étaient probablement plus sensibles que les coraux modernes à ce genre de perturbation. Au début du Trias, les eaux profondes sont devenues anoxiques. Elles le sont restées jusqu’à la fin de la crise, 500 000 ans après l’excursion isotopique. Une brève période d’euxinie a également pu se produire comme c’est actuellement le cas dans la Mer Noire, dont les eaux profondes sont anoxiques et empoisonnées par du sulfure d’hydrogène. Les eaux superficielles n’ont subi qu’une légère anoxie au plus fort de la crise. Cependant, les plateaux continentaux de la Téthys et les zones d’upwelling (de remontée d’eaux profondes) de l’océan Panthalassa ont pu être empoisonnées par du sulfure d’hydrogène, à cause de la faible teneur en oxygène des eaux profondes ascendantes et de leur teneur élevée en nutriments. Avec un manque de disponibilité des nitrates, cette situation a conduit à un anéantissement des espèces vivant fixées sur le plancher marin, nombreuses durant le Paléozoïque. Les animaux marins ne pouvaient plus vivre qu’à la surface des eaux.
L’Univers de la géologie. Octobre 2020
Une grande injection de carbone dans l’eau produit une augmentation de la température de 3 à 5 degrés sur 10 000 ans. Le pH a baissé de 0,5, et on estime que 86 % des espèces marines ont disparu et presque autant sur la Terre : la mère des catastrophes, la plus grande extinction biologique de l’histoire de la terre : 70 % des espèces marines comme les trilobites, les tétracoralliaires, les fusulines disparaissent ; les brachiopodes, les bryozoaires et les crinoïdes sont décimés : ce sont les groupes fixés sur les fonds marins, qui filtrent la matière organique contenue dans l’eau. Les escargots, les bivalves et les nautiloïdes s’en sortent mieux. Sur terre, les insectes et les vertébrés subirent de lourdes pertes, notamment les reptiles et les amphibiens. De nombreuses plantes ont aussi disparu. Le volcanisme recouvre 2 millions de km² d’une couche de basalte de 2 à 3 km d’épaisseur. À une poignée de millions d’années, baisse importante du niveau marin – au moins 200 mètres – et variations rapides des températures. Avant cette découverte par des chercheurs de l’Ohio en 2006, on émettait l’hypothèse suivante : le CO² libéré par les très importantes éruptions volcaniques, notamment au sud-ouest de la Chine et en Sibérie, aurait fait monter les températures au point de déstabiliser le méthane souterrain, transformant ainsi les océans en un gigantesque cimetière. Encore aujourd’hui, les sous-sols sous-marins contiennent d’énormes réserves de méthane, maintenu à l’état solide par les basses températures et la pression de l’eau et des sédiments… mais si cela venait à se réchauffer… bigre
250 m.a
Une comète géante s’écrase sur l’Antarctique, provoquant un cratère [2], de 250 km de Ø – la découverte a été établie par les données du satellite Grace (Gravity Recovery and Climate Experiment) : dissimulé sous des centaines de mètres de glace, il ne pouvait être décelé autrement ; autre cratère, cette fois-ci sous l’eau proche de l’Antarctique – que l’on nommera Bedout, de 173 km de Ø diamètre.
On admet aujourd’hui que cette crise est un fusil à deux coups, chacun de 1 m.a., séparés de 8 m.a. C’est leur succession en peu de temps qui a conduit à l’importance de cette extinction.
Patrick de Wever, géologue au Museum d’Histoire naturelle de Paris

Le cratère de l’est de l’Antarctique (région de Wilkes Land), env. 480 km ∅. Situé à plus de 2 km sous la glace. Détecté comme anomalie dans l’épaisseur de la croûte terrestre.
Dans les vallées montagneuses de Chine, le Ginko biloba, un arbre qui aujourd’hui peut atteindre 30 m de haut, s’enracine durablement en terre ; grâce aux moines bouddhistes du XII° siècle, il évite l’extinction. Sa robuste nature lui permettra de traverser des millions et des millions d’années d’accidents, d’explosions, de refroidissement, de réchauffements pour arriver jusqu’à nous ; introduit au XVIII° siècle en Europe, il ne se laisse pas intimider par nos pollutions urbaines auxquelles il résiste magnifiquement bien. L’arbre aux quarante écus – du nom de la couleur de ses feuilles à l’automne -, est un fossile vivant.
Dépôts de marnes, grès et calcaires : ce dernier est constitué de carbonates crée par les organismes à coquille qui ont fixé le carbone du CO². Le climat est subtropical, à longue saison sèche. Amphibiens et reptiles envahissent les terres.
Du plus haut que l’on regarde ou du plus loin que l’on vienne, ce sont elles que l’on voit d’abord, filons d’ivoire sous les toits sombres, ces pierres dont Sacy, mon village, est fait. Extraites d’une carrière toute proche, aujourd’hui abandonnée aux ronces, elles sont l’ossature du village et bien que certaines façades soient recouvertes de crépi beige ou bistre, elles donnent toujours aux maisons une note claire et chaude, comme si les pierres elles-mêmes retenaient le soleil. C’est un calcaire tendre, argileux que les maçons d’ici nomment de la marne. Il se taille facilement mais gèle aussi facilement, en raison de l’eau qu’il contient. Aussi voit-on souvent à terre de multiples éclats venus de pierres délitées, pierres gélives, dit-on, faites pour la chaleur et non pour le gel. On le sait bien que le calcaire est souvent friable, taillable et trouble à merci, qu’il aime surtout se mesurer à la patience et au silence de l’eau, lui résister, lui céder tour à tour jusqu’à édifier des reliefs karstiques et fantasques ou au contraire des sédiments aussi sages et stables qu’une longue mémoire assoupie. Ici, dans les carrières à ciel ouvert entourant le village, on voit nettement les strates des dépôts secondaires, disposés en couches très régulières. À croire qu’il n’y eut jamais de tempêtes en ces océans du Trias et que les particules limoneuses qui peu à peu se déposèrent au fond des eaux entreprenaient déjà les assises, les fondations des temps futurs.
Je longe ces blocs jonchant le sol de la carrière, certains équarris, d’autres encore prisonniers de leur gangue sédimentaire. Je passe mon doigt sur la face lisse, glissante de l’un d’entre eux, sur ce limon coagulé aussi compact et net que la surface polie d’une pierre lithographique. Peut-être, avec un microscope, y verrait-on les fantômes figés d’un peuple de fossiles mais à l’œil nu, rien n’apparaît, rien d’autre que ce miroir lisse et vierge, assez tendre pour que l’ongle le raye. Plus loin, d’autres blocs portent, eux, des traces de vie fossilisées, chemins de vers, alvéoles de brachiopodes, rostres de bélemnites et, plus rarement, empreintes d’ammonites. Parfois aussi, la présence de filons ferreux crée des figures arborescentes, des oxydations dendritiques dessinant des forêts miniaturisées, toute une jungle lilliputienne éclairée par un crépuscule triasique. C’est là surtout, en ces lieux oubliés, en ces carrières abandonnées, c’est là que j’aime découvrir les pierres entre leur gangue originelle et le premier travail des hommes, erratiques ou encore alignées en leurs strates immenses, comme les fondations d’une demeure de géant.
Au village, les maçons les montent et les jointoyent, ces pierres, avec un mortier discret, fait de sable, de gravier et de terre d’arène – une terre argileuse dont un gisement existe encore à proximité de Sacy. Certaines, plus grosses, disposées en linteaux ou montants, portent des inscriptions indiquant la date de la construction. J’aime vraiment le calcaire car – comme la lune – il renvoie jusqu’à nous la lumière du soleil. Et aussi, parce qu’au cœur des continents, il dit l’histoire des mers originelles, mémoire fidèle, plus encore que les roches éruptives ou métamorphiques. Tôt ou tard le choix s’impose à notre vie, entre la sédimentation et la métamorphose. Vivre de lents dépôts, d’accumulation de savoir, de progressives initiatives ou au contraire, d’éruptions brutales, de soudaines intuitions, de fusions, d’effusions.
Être calcaire ou être lave. Porter la mémoire de l’eau ou celle du feu. J’ai choisi le calcaire. J’ai choisi la roche claire, friable et fragile. Eus-je vécu différemment dans une maison de lave ou de granit, quand je regarde les pierres de mon village, j’ai parfois l’impression de regarder le lieu de notre naissance, l’ossature du grand bassin où la vie se forma. J’aime rêver au lent dépôt des limons et des songes de la terre, à ces milliards de particules qui édifièrent les soubassements des continents. J’aime les pierres venues du fond des mers, j’aime leur mémoire friable mais fidèle. J’aime que sur elles la nature ait gravé sous forme de fossiles, les mille lithographies de nos genèses. J’aime les pierres encore vivantes de mon village.
Jacques Laccarière. Le géographe des brindilles. Hozhoni 2018
ÈRE SECONDAIRE : 245 à 65 millions d’années
ère géologique : Trias 245 à 201 millions d’années.
240 m.a.
Dragon trouvé en Chine en 2024 : Dinocephalosaurus orientalis. Un cou composé de 32 vertèbres distinctes, une longueur totale d’environ 5 mètres, des membres en forme de nageoires, une dentition acérée. On peut noter la présence de poissons dans son estomac.
La grande aventure de la vie sur Terre
11 Entre 234 et 210 millions d’années, l’avènement des dinosaures
Avant de devenir de fascinants géants, les dinosaures sont apparus sous la forme de petits bipèdes carnivores, généralement longs d’un à deux mètres. L’extinction du Permien-Trias, la plus grosse crise écologique de l’histoire terrestre, assurera leur succès, créant dans le vivant un vide qu’ils combleront. Ils domineront ainsi la planète pendant près de 175 millions d’années sous des formes – et des tailles – diverses. Le plus grand d’entre eux, le Titan de Patagonie (Patagotitan mayorum), mesurait 37 mètres et pesait 69 tonnes. C’est dans ce monde de colosses que se sont développés les tout premiers mammaliaformes – les précurseurs des mammifères -,vraisemblablement déjà dotés de fourrure et de la capacité d’allaiter. On attribue généralement leur survie à la diversité de leurs régimes alimentaires et de leurs modes de vie, certains étaient nocturnes, fouisseurs, insectivores ; d’autres arboricoles et fructivores… Déjà des animaux pleins de ressources !
William Rowe-Pirra. Sciences et Avenir n° 208 Janvier à Mars 2022
~ 232 m.a.
Il pleut, il pleut, il pleut… et cela va durer 2 m.a. C’est l’épisode pluvial du Carnien qui va voir l’apparition des dinosaures.
Cette augmentation des précipitations pourrait être le résultat d’une importante hausse de l’humidité, elle-même résultant probablement d’une énorme éruption volcanique dans l’actuel centre-sud de l’Alaska. Les éruptions ont atteint leur apogée pendant le Carnien, déclarait Jacopo Dal Corso, impliqué dans la recherche sur ces éruptions. En étudiant la signature géochimique des éruptions il y a quelques années, j’ai observé des impacts massifs sur l’atmosphère mondiale. Ces éruptions étaient d’une telle ampleur qu’elles ont libéré d’énormes quantités de gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone, entraînant des pics de réchauffement climatique.
Morgan Fromentin 24matins.fr
230 m.a.
Les dinosaures – du grec deinos : terrible, et saura : lézard – apparaissent sur la Pangée, à l’emplacement de l’actuelle Amérique du Sud ; ils vont se diviser en trois groupes : théropodes, saurischiens, avec un bassin de type lézard, et ornithischiens – avec un bassin de type oiseau, c’est la branche qui finalement donnera les oiseaux -, qui se disperseront sur toute la Pangée avant sa dislocation en plusieurs continents. Ils se plairont beaucoup dans l’actuel désert de Gobi, alors pays luxuriant. C’est une très très grande famille qui regroupe des milliers d’espèces : aujourd’hui, les chercheurs du monde entier en découvrent une nouvelle espèce chaque mois ! Le Chirotherium, un reptile, laisse ses empreintes sur des dalles de grès, qui se forme à cette période, près de Lodève, Hérault, à Fozières. Ces empreintes de reptiles y sont fréquemment voisines de celles de petits cynocéphales. Tout près de là se forment aussi les ruffs, ces terres le plus souvent rouges quand elles résultent d’une oxydation du fer en climat sec et parfois grises, sous climat humide. Beaucoup plus tard, il y a 1.5 m.a., elle seront parfois recouvertes de laves volcaniques.
Nous regardons ce territoire, récemment recouvert de la luxuriante végétation qui allait donner naissance à la houille, dont les Cycas et les Voltzias ont maintenant pris possession. Les Cycas ont une forme de palmier, leur feuillage rappelle celui de la fougère et leur mode de vie évoque celui des pins ; quant aux Voltzias, ils semblent être les ancêtres du cyprès. Aucun Lepidodendron, aucune Sigillaire ne viennent pointer leur couronne verte dans ce paysage boisé. Le marécage fétide a disparu, une étendue de terre ondulée occupe le continent.
Jetons un coup d’œil à cette vaste étendue. De sombres chaînes de montagnes couvertes d’arbres nous regardent de haut. Nous cherchons des yeux l’ancienne grève, qui marquait les limites de l’empire de la mer et constatons que cet empire a maintenant disparu. Il est bien loin, au sud, à moins de trois cents kilomètres de la limite formée par le Golfe à l’époque humaine – le domaine océanique a été dépossédé de tant de choses…
[…] Toutes les anciennes formes paléozoïques de vie animale ont été déplacées ailleurs. D’étranges occupants sont arrivés. Au lieu des faibles amphibiens aux corps de lézards qui s’abritaient dans les souches creuses, nous trouvons maintenant de grands labyrinthodontes quadrupèdes qui rampent comme d’énormes crapauds, cachés sous une frange forestière. Leur lourde masse imprime de profondes empreintes dans le sable de la plage – une forme de main à quatre doigts -, des empreintes destinées à durer et à devenir un sujet d’émerveillement pour l’espèce humaine.
Mais les amphibiens ont cédé l’empire à une autre dynastie. L’Archégosaure était certes grand, mais le Dinosaure fut encore plus grand. Une silhouette extraordinaire et étonnante qui se profile sur la plage qu’elle arpente. De toute évidence, ce monstre, énorme, couvert d’écailles, très droit, avec une toute petite tête, avec un abdomen gonflé et cette queue massive qui traîne, est représentatif de la famille régnante. Il est massif, sans aucune élégance ; fort, sans aucune grâce. Cette créature marche sur deux pattes et laisse une empreinte à trois doigts, comme celle d’un oiseau. Ses mâchoires sont équipées de longues dents aiguisées et pointues. Ses os longs sont creux comme ceux des oiseaux ; son bassin, comme ses pattes, ressemblent à ceux des oiseaux ; sa mâchoire inférieure peut se mouvoir latéralement pour triturer la nourriture, comme les bovins. Sa forme est celle des batraciens ; sa tête, sa queue et ses écailles sont celles du lézard ; ses pattes, celle de l’oiseau, son sacrum, celui des mammifères – mais comment appeler cette créature ?
Nous l’observons faire sa promenade au bord de l’eau et le suivons jusque dans la jungle humide et pousseuse dans laquelle il a élu domicile. Nous le voyons fouiner dans les touffes de feuillage les plus basses, dévorer les brindilles fibreuses avec les mouvements de mâchoires d’un herbivore, usant et émoussant ainsi les couronnes de ses dents. Mais voilà qu’il rencontre son ennemi – un autre dinosaure au tempérament féroce, un mangeur de chair, armé de dents aiguës et coupantes.
Un farouche différent les oppose et ils ont, en ces temps plus anciens, combattu pour la gloire. L’herbivore reconnaît la supériorité de l’autre, mais il ne se soumet qu’avec réticence, une féroce colère brille dans son œil sombre et, avec un infernal grognement de défi, il laisse passer le carnivore méprisant, assoiffé de sang comme un loup.
Nous nous tenons sur le versant occidental de la côte et regardons cette étendue brillante. La mer s’est retirée, la douce plage de sable fin est à nu. À la surface, se tortillent, rampent et se rétrécissent sous le soleil les différentes formes de vie marine apportées par la dernière marée. Une bonne occasion pour les maraudeurs terrestres. Les voici qui se précipitent à la recherche d’un repas. C’est là que, le plus ouvertement du monde arrive le grand Brontozoum mal dégrossi, un Dinosaure à trois doigts qui mesure bien quatre mètres de haut. Son pied fait soixante-dix centimètres de long. Par moments, il se met à quatre pattes pour attraper un petit morceau de crabe délicat, ce qui fait qu’il laisse, pour un temps, des empreintes de quadrupède. Mais ses pieds antérieurs sont petits, en comparaison des pieds postérieurs. Au loin, l’Otozoum arpente la plage – c’est un autre dinosaure bipède, mais qui a quatre orteils à l’arrière. Avec des pieds de cinquante centimètres de long, il fait des pas de un mètre, quand il avance tranquillement : quand il cherche son repas. De temps à autre, il ramasse un poisson échoué. On peut voir, parmi ces silhouettes gigantesques, celles de Dinosaure plus modestes. L’un d’eux ne laisse des empreintes qui ne font que sept centimètres de long ; on peut également remarquer un petit reptile tout mignon dont les empreintes ne font que six millimètres de longueur. Ils sont trop occupés à se rafraîchir. C’est le banquet ordinaire des reptiles.
Attendons ici que la marée remonte. Elle arrive et s’annonce par son grondement. La marée venant du large est accentuée du fait des limites étroites de la baie, et elle gonfle en un mascaret terrifiant. Les Dinosaures et les Labyrinthodontes en entendent le bruit, ils relèvent la tête dans l’attitude de la créature qui écoute, avant de se précipiter vers leurs retraites. La marée s’attarde un peu, elle lambine sur les bancs de sable, tout en avançant vers la grève. Mais, à l’heure prévue, elle donne un dernier baiser mouillé à la plage qu’elle a câlinée pendant une heure, avant de se retirer.
Où sont donc, maintenant, les empreintes, les traces de ces gigantesques sauriens ? La marée, qui traînait là, les a-t-elle donc effacées ? Non, elle les a recouvertes d’une fine pellicule de sable fin. Elles ne sont pas détruites, mais au contraire préservées. La table est de nouveau dressée, pleine de chair qui s’agite, et les sauriens entendent une nouvelle invitation à se sustenter. Ils arrivent de nouveau sur la grève et impriment leurs traces sur la surface molle. Sans le savoir, ces créatures inscrivent leurs autographes sur les pages du livre de l’histoire du monde. Petit à petit, les marées cesseront. Cette baie se soulèvera hors de leur portée ; ce sable deviendra un grès brun très dur. Des cantonniers exerceront leur métier le long des parois montagneuses et déchiffreront les anciens textes avec leurs mains, comme des aveugles.
Les étoiles tombent du ciel, les comètes tournoient. Des oiseaux au sang chaud se développent – contemplez, enfin, au cours de cette merveilleuse période Mésozoïque, un vrai oiseau avec de vraies ailes. Recouvert de vraies plumes, […] c’est pourtant encore un reptile. Sa longue queue ressemble à celle d’un lézard, elle est munie jusqu’au bout de vertèbres et possède des plumes, mais l’animal ne peut cacher sa parenté avec l’ordre des reptiles. Cette créature vient de l’empire des reptiles et elle apporte avec elle des traces de reptiles.
Un type supérieur est maintenant sur le point d’exister. Le glas sonne déjà la fin de la dynastie reptilienne. Les hordes sauriennes reculent devant l’approche de cette créature supérieure. Après un règne splendide, la dynastie des reptiles s’effondre et on ne le sait que grâce à l’histoire écrite dans les ruines.
Alexander Winchell 1824-1891 Walks and Talks in the geological field 1886
225 m.a.
Plusieurs dorsales sous-marines entrent en activité, ouvrant l’Atlantique central, qui va mettre à peu près 150 m.a. pour trouver sa configuration actuelle. Le mouvement vers le nord-est de l’Afrique, et de l’Europe vers l’ouest, selon une dorsale nord-ouest, sud-est, crée l’océan ligure.
220 m.a.
Une intense activité volcanique aurait réchauffé les fonds marins, créant ainsi les conditions pour un dégazage massif des clarathes de méthane dans les fonds marins : et ce sont plus de 12 000 milliards de tonnes de carbone qui auraient été libérés sous forme de CH4 – le méthane, a très grand effet de serre, provoquant la disparition de plus de 50 % des espèces marines.
Cette activité volcanique sous-marine génère elle-même entre la plaque de l’océan Atlantique et celle du Pacifique une nouvelle plaque, Farallon, – son nom vient des îles Farallon, au large de la baie de San Francisco – qui va disparaître en subduction, créant vers 150 m.a. la plaque volcanique des Caraïbes.

Création des plaques Juan de Fuca (dont Explorer et Gorda) et de Cocos (dont Rivera) et de la faille de San Andreas à partir de la plaque Farallon.
201 m.a.
Une grosse météorite [1.5 km ∅, cratère de 21 km ∅, chondrite ordinaire] – encore nommée astroblème – termine sa vie près de l’actuel Rochechouart, à l’ouest de Limoges, à la limite de la Haute-Vienne et de la Charente : des roches fortement choquées et des brèches en seront les témoins, et encore une autre à Manicouagan, au Québec, et encore à Obolon, en Ukraine. On en compte ainsi cinq, qui pourraient provenir de la fracture préalable d’un astéroïde dont les débris auraient provoqué une hécatombe. À Rochechouart, c’est l’Allemand François Kraut qui déterminera l’origine de ces brèches, dont on avait pensé longtemps qu’elles étaient d’origine volcaniques. Les sédimentations à venir n’auront eu aucun mal à effacer toutes les témoins morphologiques de ce gigantesque coup de marteau. En 2017, commencera une campagne de carottage – l’impact de l’astroblème atteint 700 mètres de profondeur – pour aller jusqu’à 150 mètres : pourquoi si tard, serait-on tenté de penser ? Probablement parce ce n’est qu’aujourd’hui que l’on dispose des techniques d’analyse de ces brèches : nous avons les moyens de vous faire parler !
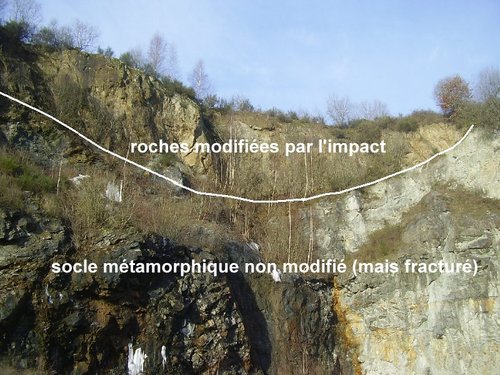
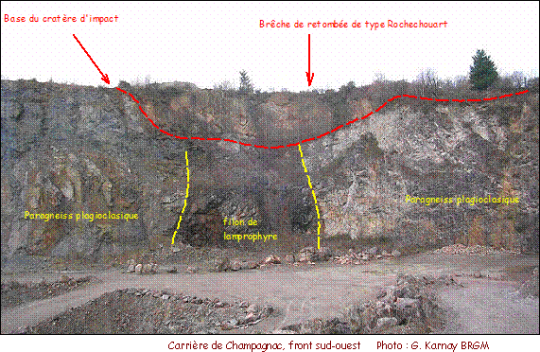
Suite au choc, les roches originelles ont été complètement transformées. Impactées, elles ont été projetées et certains éléments ont fondu. Ces débris sont ensuite retombés au fond du cratère qui venait de se former. Là, ils se sont soudés entre eux. De nos jours, l’érosion a totalement détruit le cratère et l’a même sur-creusé de façon telle que Rochechouart est actuellement perchée sur un plateau.

Carte de l’Europe au Norien – 220 m.a. –
Jurassique 201 à 145 million d’années.
200 m.a.
Apparition des mammifères, tous ovipares. Les plantes à fleurs se développent et vont beaucoup se diversifier au crétacé et au tertiaire.
La mer recouvre la région de Digne ; y vivent des nautiles, de nombreux lamellibranches et surtout, en grand nombre des ammonites – Coroniceras multicostatum, une espèce du Sinémurien – qui meurent, et abandonnent alors leur coquille qui va se déposer sur les argiles de sédimentation du fond marin. Les plus grosses atteignent 70 cm Ø ; elles sont accompagnées de pectènes, bivalves et pentacrines, nommées aussi étoiles de Saint Vincent et qui permettent de déterminer la hauteur d’eau : environ 250 mètres. On estime à peu près à 100 000 ans la durée pendant laquelle il n’y eut qu’une faible sédimentation, ce qui permit à ces coquilles d’ammonites de se retrouver en grand nombre. Bien plus tard, la surrection des Alpes soulèvera tout cela, mais, dans cet endroit, avec, semble-t-il, une délicatesse certaine puisqu’au milieu du XX° siècle sera découverte une partie de cette dalle aux ammonites qui sera mise à nu en 1994 : 350 m² sur lesquelles on compte plus de 1 500 fossiles d’ammonites. C’est à la sortie de Digne, direction Barle.

75 % des espèces de la faune et de la flore disparaissent, et on ne sait pas bien pourquoi : le phénomène est plus grave que l’extinction à venir, celle de 65 m.a, à la frontière du crétacé et du tertiaire. La rupture de la région centre-atlantique sous l’effet de la tectonique des plaques aurait-elle provoqué un volcanisme gigantesque ?
Au jurassique inférieur, l’Asie du Sud est formée. Thétys sépare le nord du Gondwana, principalement l’actuelle Sibérie, du reste du continent. Tout au long de ces dorsales, les coulées de lave s’empilaient sous la forme de coussins ou d’oreillers, de 1 à 2 mètres de long et de 0,30 à 1 mètre d’épaisseur, les pillow-lavas (de l’anglais pillow : oreiller). Surgi à une température voisine de 1 100° et brutalement trempé au contact de l’eau de mer, le basalte refroidissait très rapidement. Cette trempe donnait naissance, en bordure des pillows-lavas, à de petites sphères de quelques millimètres Ø constituées essentiellement de minéraux silicatés blanchâtres, des plagioclases, ou vert pâle, des chlorites et des actinotes : Alexandre Brongniart (1770-1847), géologue, minéralogiste et directeur de la Manufacture de Sèvres, donnait à cette roche, dont le cortex avait une allure si particulière, le nom de variolite.
Pendant près de 90 m.a. les basaltes ont surgi tout le long de cette zone volcanique, les coulées s’étalant sur le fond de l’océan en s’éloignant peu à peu de la dorsale. À une vitesse de quelques cm/an, la Téthys s’élargissait, pour atteindre finalement une largeur de l’ordre de 1 000 km. À ces basaltes étaient associés des roches caractéristiques de la fusion, puis de la cristallisation du manteau supérieur, des gabbros et des péridotites altérées et transformées en serpentinite : cette trilogie serpentinites, gabbros et basaltes est appelé le cortège ophiolitique. Accompagnant et recouvrant ces roches, des sédiments déposés en mer profonde s’accumulaient, en particulier des boues à radiolaires, les radiolarites, constituées d’argiles et de squelettes de minuscules organismes monocellulaires.
175 à 135 m.a.
Thétys accumule les sédiments qui vont former les grandes couches de calcaire et dolomie [au Ph neutre] des côtes méditerranéennes, l’omniprésent calcaire jurassique, dont sont formés par exemple, le Grésivaudan, les Causses du sud du Massif Central, les Monts de St Guilhem le Désert, etc… Tout cela prend du temps : il faut à peu près 500 ans pour avoir un dépôt de sédiments de un cm !
Au Jurassique moyen, la Pangée commence à se disloquer.
168 m.a.
Des sauropodes marchent sur une plage située sur l’actuelle commune lozérienne de Sainte Énimie. Les changements géologiques à venir font que ce qui était plancher va devenir plafond, par un effondrement souterrain qui va donner lieu à la création de cette grotte de Castelbouc.
La grotte de Castelbouc s’est constituée sous une plage, sur laquelle les dinosaures ont laissé leurs empreintes. C’est le dessous de cette plage, qui constitue désormais le plafond de la grotte, et donc l’envers des empreintes, que l’on peut admirer. Il n’y a pas eu de bouleversement des couches géologiques. Les traces que l’on observe sont en réalité des contre-empreintes, qui correspondent au dessous des pieds des sauropodes (l’espèce de dinosaures qui a laissé ces traces, ndlr). C’est comme si on regardait la piste laissée par les dinosaures par en dessous, l’eau s’étant infiltrée et ayant creusé le sol sous la couche géologique où se trouvent les empreintes. Certaines traces de pas font jusqu’à 1,25 mètre de circonférence. Laissées par plusieurs dinosaures quadrupèdes comme le Titanosauriforme (qui mesurait jusqu’à 50 mètre de haut), elles datent du Jurassique moyen et sont donc vieilles de plus de 168 m.a. Leur morphologie, avec notamment des traces de doigts, de coussinets et de griffes n’avait jamais été observée jusqu’à présent. Le travail des paléontologues a permis de décrire un nouveau type de trace qu’ils ont nommé Occitanopodus, en référence à l’Occitanie !
Jean-David Moreau

Titanosauriforme


Occitanopodus, un nouveau type de trace de dinosaures en Lozère • © Photo Rémi Flament
166 m.a.
Première grande diversification des mammifères. Au Jurassique supérieur, la partie nord de l’océan atlantique commence à s’ouvrir, et l’Amérique du sud commence à se détacher de l’Afrique : le Gondwana se coupe en deux.
150 m.a.
Les premiers mammifères se dotent d’une nouvelle partie du cerveau dit émotionnel, ou encore système limbique, qui regroupe l’amygdale, l’hippocampe, l’hypothalamus, le cortex cingulaire et le cortex préfrontal, l’insula, le noyau accumbens, le septum, les ganglions de la base. Tout cela permet les sensations agréables, les désagréables et toute la gamme très étendue des émotions, qui sont tempérées par le néocortex pour ne pas occuper tout l’espace. Il joue également un rôle de régulateur des instincts primitifs de survie venant du cerveau archaïque ; il aide à contrôler les réactions d’attaque ou de fuite. Il est encore impliqué dans l’olfaction, l’apprentissage et la mémoire
Apparition des oiseaux : le premier sera nommé archaeopteryx. On sait depuis 1860 que c’est un enfant des dinosaures carnivores : les arthosaures. Le premier fossile sera trouvé en Bavière, à Solenhofen, en 1859. La dispute – les oiseaux sont-ils oui ou non des dinosaures ? – naîtra avec la découverte de ce premier oiseau : elle est en train de se clore, tant les arguments en faveur d’une filiation directe deviennent probants :
- Longtemps l’argument des contre tint à l’existence chez l’oiseau d’une clavicule, laquelle n’existait pas croyait-on, chez les dinosaures… jusqu’à ce que Ostrom en découvre une chez le Deinocytus en 1969.
- La très probable existence d’un système respiratoire commun – la pneumatisation – existence de poches emmagasinant de l’air, hors des poumons, de sorte que ceux-ci ne sont jamais vidés d’air au cours de la phase d’expiration.
- La ponte de deux œufs est commune aux oiseaux et aux dinosaures.
- Certains dinosaures avaient eux aussi des plumes : ainsi était le sinosauropteryx découvert en 1996 dans le nord-est de la Chine. Elles ne servaient probablement pas pour voler, et elles n’avaient sans doute qu’une fonction d’isolant thermique et surtout devenaient opérationnelles pour les parades nuptiales.
Dans l’actuel Arizona, sur le territoire des Navajos, à l’est de Page, le vent dépose du sable en provenance des montagnes environnantes, formant un désert qui va s’étendre jusqu’au Pacifique. Ce sable va se transformer en grès. Plus près, sur le site de l’actuel Plagne, un village proche d’Oyonnax, – le sud de notre actuel Jura – le climat est particulièrement plaisant et attire quantité d’animaux de variétés très différentes qui se régalent dans cette lagune proche d’une mer peu profonde. On y trouve une trace – une succession d’empreintes de pas – de 155 mètres de long d’un sauropode, le plus important des dinosaures : l’animal devait faire entre 30 et 40 mètres de long, peser 40 tonnes : les empreintes font de 96 à 112 cm !


à Plagne, près d’Oyonnax, dans le Jura.
ère géologique : Crétacé 145 à 66 m.a.
140 m.a.
Au pied de la falaise de Kaouar, à proximité de l’actuelle oasis de Bilma, en Algérie, s’étend un lac de plus de 100 km de long ; il va s’assécher, donnant un sel de grande qualité, qui donnera naissance aux caravanes de sel : la taghlamt, qui va d’Agadez à Bilma : 575 km avec deux points d’eau : aller-retour en quatre mois… à l’allure du dromadaire. L’autre légendaire caravane de sel, l’azalay, de Tombouctou à Taoudenni, 650 km, fera commerce de sel gemme.
Il y a deux milliards d’années, les algues bleu-vert et les bactéries ont libéré dans l’atmosphère suffisamment d’oxygène pour assurer la formation de la couche d’ozone et protéger la vie sur terre des rayons ultra-violets meurtriers. Puis le vent ordovicien a semé sur les terres vides et stériles les premiers spores, donnant naissance à une incroyable diversité végétale et aux premières plantes à fleur il y a environ 140 millions d’années, et à plus de 400 000 espèces, à ce jour.
Annie Proulx Bird Cloud Grasset 2012
136 m.a.
Les premières plantes à fleur connues – les botanistes les appellent Angiospermes (angion – récipient ; sperma – graine) – apparaissent dans les archives fossiles au début du Crétacé, il y a 136 m.a. [3]. Elles diffèrent des autres plantes de la même période par des structures entièrement nouvelles : leurs organes reproducteurs associant souvent les éléments mâles et femelles dans un même emballage commode. Mais encore plus important, contrairement à leurs ancêtres les gymnospermes aux graines exposées à peu près à l’air libre (gymno – nu), les graines des angiospermes se développent à l’abri de l’ovaire, l’embryon étant entouré d’un tissu nutritif appelé endosperme. Souvent la paroi de l’ovaire devient épaisse et charnue, devenant ces objets savoureux que nous nommons fruits.
Ce qui s’est passé ensuite a profondément bouleversé le monde végétal. Dix millions d’années après l’apparition des fleurs, la plupart des lignées de plantes modernes étaient présentes et, au milieu du Crétacé, les angiospermes étaient devenues le groupe végétal dominant. De nos jours, 300 000 à 350 000 espèces d’angiospermes, dont la quasi-totalité sont des plantes dont dépend la survie de l’humanité, occupent tous les écosystèmes terrestres et aquatiques de la planète. En comparaison, il ne reste plus que de 800 à 1 000 espèces de gymnospermes, les ancêtres des plantes à fleur, incluant tous les conifères – pins, épicéas etc.
C’est cette rapide explosion des angiospermes qui intriguait Darwin, dont la conception de l’évolution supposait l’accumulation lente mais régulière des variations dans les organismes. Maintenant, nous savons que l’évolution peut avancer très rapidement (encore une fois, à l’échelle géologique), et qu’un bouleversement de la composition de la flore de toute la planète en une seule période géologique n’est pas un événement si exceptionnel. Mais quelle est la raison de ce succès soudain ?
Darwin supposait que le processus devait être lié à la diversification pratiquement simultanée des insectes au Crétacé, mais à son époque on manquait de preuves solides. Maintenant, disposant d’abondantes archives fossiles et d’une corrélation entre la phylogénétique moléculaire et la biologie du développement (éco-dévo), les biologistes sont certains que c’est bien la relation mutuelles bénéfique complexe entre les insectes et les angiospermes qui a entrainé la spécialisation et la diversification rapides de ces deux lignées. On voit très bien aujourd’hui le résultat de ce processus – les insectes sont dominants dans le règne animal et les angiospermes dans le règne végétal. Grâce à leur relation symbiotique, chaque groupe a acquis un avantage qui a augmenté considérablement ses chances de survivre et de prendre le dessus sur ses concurrents. En utilisant les insectes pour transporter leurs cellules reproductrices, les plantes à fleur ont accru l’efficacité et la distance de dispersion de leurs gènes. Elles ne dépendent plus de vents imprévisibles pour propager leurs pollens, et la quantité d’énergie dépensée pour produite de très grandes quantités de gamètes peut être employée ailleurs. L’envoi du pollen loin de la plante-mère grâce aux insectes et la protection des ovules à l’intérieur des ovaires a aussi réduit les risques d’autofécondation, ce qui s’est traduit par une plus grande diversité génétique et l’émergence plus rapide de nouvelles formes. Quant aux insectes, butiner les fleurs leur a apporté toutes sortes d’avantages, notamment nourriture (nectar, pollen), sites de rencontre commodes et chauffage gratuit (certaines fleurs produisent de la chaleur que les insectes mettent à profit pour se réchauffer). Les angiospermes n’ont pas été les premières plantes à impliquer les insectes dans leur reproduction – certaines des premières gymnospermes étaient pollinisées par les insectes – mais elles ont perfectionné la relation. Au fil des millions d’années, ces interactions plantes-insectes sont devenues toujours plus spécialisées et efficaces, et maintenant, la majorité des plantes ne peut pas vivre sans les insectes et vice versa. Certaines fleurs ne peuvent être pollinisées que par quelques insectes précis, leur morphologie empêchant les autres d’accéder à leur nectar. De leur côté, les insectes ont mis au point des organes et des comportements dont le seul but est d’accéder aux fleurs. Les pièces buccales très longues et modifiées en trompe des papillons qui s’adaptent parfaitement aux corolles profondes des fleurs est un bon exemple de ces changements évolutifs réciproques, ou coévolution.
Piotr Naskrecki. Reliques. Ulmer 2012
La grande aventure de la vie sur Terre
11 Il y a environ 135 millions d’années, les fleurs dominent le paysage
La présence des plantes à fleurs ou angiospermes est avérée dès le Crétacé. Elles se distinguent de leur groupe frère, les gymnospermes, par une innovation remarquable : elles protègent leur ovule, la future graine, dans un ovaire qui deviendra, après maturation, un fruit. Un atout majeur puisqu’elles vont connaître une diversification rapide, notamment grâce à la pression de sélection exercée par les animaux avec lesquelles elles co-évoluent, – en particulier les insectes. Jusqu’ici majoritairement phytophages, ils transportent le pollen en volant de fleur en fleur. Les animaux frugivores, comme l’était peut-être le vilevolodon- semblable à l’écureuil volant -, favorisent quant à eux la dispersion des graines contenues dans les fruits dont ils se délectent.
William Rowe-Pirra. Sciences et Avenir n° 208 Janvier à Mars 2022
135 m.a.
Le sauropode, un grand dinosaure herbivore dont la taille dépasse vingt mètres prend sa retraite à Angeac, en Charente. Il n’est pas seul, il y a aussi des dinosaures carnivores, des crocodiles, des tortues. En France, jusqu’en 2010, seul le site d’Espéraza, dans l’Aude, présentait une importance comparable, car :
Angeac-Charente est devenu l’un des plus grands gisements de dinosaures en Europe. Certes, des formations géologiques comme celles de Morrison aux États-Unis ou de Liaoning en Chine ont livré beaucoup plus de squelettes. Mais elles recouvrent de grandes périodes, de l’ordre de plusieurs millions, voire de dizaines de millions, d’années. Résultat : les spécimens que l’on y met au jour appartiennent souvent à des animaux qui ont vécu à des époques différentes et n’ont pas toujours de rapport entre eux. Tel n’est pas le cas du site charentais. Repéré en 2008 et sondé une première fois en février 2010 par des carriers de l’entreprise Audoin et par Jean-François Tournepiche, paléontologue et conservateur au Musée d’Angoulême, celui-ci renferme des restes d’organismes qui ont vécu à quelques centaines d’années d’écart seulement. Au maximum, deux millénaires !
[…] En tout, 8 000 fossiles, 65 000 fragments, 3 000 coprolithes et d’innombrables microfossiles ont déjà été extraits avant d’être nettoyés en vue d’identification dans les réserves du Musée d’Angoulême, où ils sont conservés. Ils témoignent de la présence de quelque 46 familles de vertébrés à Angeac-Charente. Une manne pour les paléontologues qui peuvent, à partir de ce matériel, espérer établir des liens entre ces espèces et aboutir à une description de cet écosystème du passé.
Un passé qui se révèle particulièrement lointain. L’étude de microscopiques algues vertes, appelées charophytes, découvertes sur le site, a démontré qu’il correspond à l’étage géologique du berriasien : entre 145 et 139 m.a. À cette époque, le supercontinent, la Pangée, est déjà morcelé. À l’ouest, l’Atlantique continue à s’ouvrir. Et vers l’Orient, un gigantesque océan, le Téthys, dresse une succession de vagues jusqu’à l’horizon. L’Europe n’est alors qu’un chapelet d’îles, dont l’une, la Terre armorico-centrale, occupe une partie de la France actuelle. Le bassin Aquitain étant encore sous les eaux, Angeac-Charente est situé non loin de la côte. Les fossiles qu’on retrouve vont y être déposés au cours de cette période. Avant que, le niveau des mers augmentant, la zone soit immergée, voici 100 m.a. puis de nouveau découverte, il y a 65 m.a. Par la suite, des mouvements tectoniques ont fait remonter ces couches de dinosaures, de 80 cm à deux mètres d’épaisseur, à la surface. Et voici 100 000 ans, un paléo-fleuve Charente y a creusé son lit et y a déposé ses sédiments. Ce sont ces derniers qui sont exploités de nos jours par des carriers, formant dans cette vallée gorgée d’eau un paysage d’étangs entouré de vignes.
Comme l’a confirmé l’analyse isotopique de l’oxygène des dents récupérées sur le site, la région connaît alors un climat tropical humide et chaud – la température du globe est alors 5° ou 6° supérieure à ce qu’elle est actuellement. Ce climat était marqué par des épisodes de précipitations violentes et de longues phases d’évaporation, un peu à l’image de ce que l’on peut observer, aujourd’hui, dans les marécages des Everglades, en Floride, explique Jean Gœdert, post-doctorant au laboratoire Pacea, à Bordeaux, et dont les études ont aussi pu établir que ces étendues liquides étaient faites d’eau douce.
Les plantes à fleurs et l’herbe sont absentes de ce milieu dont la végétation est constituée, pour l’essentiel, de fougères arborescentes et de grands conifères aux branches hautes de la famille des cheirolépidiacées, dont la morphologie rappelle celle des cyprès chauves actuels. Bois, pommes de pin, cuticules, frondes, graines… cette flore a laissé de nombreuses traces à Angeac-Charente. Parmi lesquelles un gigantesque tronc de dix mètres de long mis au jour en 2012. Trop fragile pour être extrait, ce dernier gît toujours enterré, sous le piquet qui marque l’emplacement où il fut découvert. Son moulage est exposé au Musée d’Angoulême.
Une faune abondante et diversifiée occupe cette zone humide. Notamment de petits mammifères et des tortues dont des microfossiles, ainsi que des restes de carapace et de plastron ont été récupérés. On y trouve aussi plusieurs genres de crocodiles : Goniopholis, Pholidosaure ou Bernissartia. Ces prédateurs aquatiques typiques du continent européen avaient des régimes alimentaires différents. Et témoignent, par leur seule présence, de la richesse de cet écosystème : si certains, longs de cinq mètres, étaient de taille à s’attaquer à des animaux terrestres, les autres se nourrissaient exclusivement de poissons ou de mollusques tels que les moules et les gastéropodes d’eau douce dont on retrouve les traces à Angeac-Charente.
Des dinosaures, herbivores et carnivores, fréquentent également ces marais. Même si ces derniers, Eotyrannus (du même groupe que le T. rex) ou Carchadontosaurus (proche de l’Allosaurus), n‘y ont laissé que des indices de leur passage : une griffe et quelques-unes des dents qu’ils perdaient au cours de leur existence.
Ont ainsi été extraits du sol charentais des ossements de plusieurs grands, voire titanesques animaux. Pour commencer, des phalanges, des vertèbres et des côtes de l’un des derniers représentants du genre des stégosaures, ces dinosaures au dos cuirassé de plaques osseuses qui disparurent au cours du crétacé. Cet individu de 7 ou 8 mètres de long n’était probablement pas isolé. En effet, les paléontologues ont récupéré sur le site quantité de boules de grès qui se sont avérées correspondre à des restes de remplissage d’empreintes par du sable. Au moins une centaine de tailles différentes, dont la présence constituerait, selon eux, une preuve qu’un troupeau ou une famille de ces grosses bêtes placides avait l’habitude de se promener à cet endroit.
À cela s’ajoutent des éléments de squelettes de trois ou quatre énormes turiasaures d’une nouvelle espèce. Ce groupe de sauropodes à long cou et à longue queue, décrit en 2008 à partir de spécimens trouvés dans la province d’Aragon en Espagne, réunit quelques-uns des plus grands quadrupèdes qui aient foulé le sol terrestre. En 2010, à la suite de la découverte d’un fémur de 2,20 mètres de long (dont une copie est actuellement [2018] exposée dans le parc du Jardin des plantes à Paris), l’équipe d’Angeac a calculé qu’ils pouvaient mesurer 35 m. et peser 50 tonnes ! Depuis, en 2014, des chercheurs argentins ont, avec un os de titanosaure de 2,40 m, provisoirement battu ce record du monde. Avant que les Français réoccupent la première place en annonçant la récupération d’un fragment osseux correspondant à l’extrémité distale d’un fémur de… 2,50 m. !
Bref, ces herbivores aux dents spatulées en forme de cœur qui leur servaient à arracher les végétaux sans les broyer ni les couper avant de les avaler, étaient proprement colossaux. Il est facile de s’en rendre compte en observant, sur le lieu même des fouilles, le gigantisme de leurs contre-empreintes d’un mètre de long aux traces d’écailles de pied toujours visibles. Ou encore en allant constater, sous une tente installée un peu à l’écart, la taille du grand sacrum qu’est occupé à nettoyer Yohan Desprès, l’un des préparateurs du MNHN…
Toutefois, l’animal emblématique du gisement d’Angeac-Charente demeure l’ornithomimosaure. Ce petit théropode de 5 mètres de long au maximum était équipé de pattes arrière ressemblant à celles des actuelles autruches. Elles lui permettaient d’atteindre une vitesse de 60 km/h. Il était, sans doute, doté de plumes et était probablement omnivore. À Angeac-Charente, on le trouve sous la forme de 49 spécimens juvéniles dont les ossements, brisés et mélangés, sont dispersés sur une surface de 150 m². La raison de la présence d’un aussi grand nombre d’individus à cet endroit a été l’objet de l’étude, digne d’une enquête policière, conduite par Lee Rozada dans le cadre de la préparation de sa thèse en taphonomie et paléoécologie.
L’explication qu’elle propose en dit long sur le comportement de ce dinosaure et sur les rapports qu’il entretenait avec les autres représentants de la faune de ces marais. Mais elle ne recouvre qu’un des aspects de la découverte. En effet, avec leur absence de dents et leurs membres antérieurs atrophiés, ces animaux se sont aussi révélés appartenir à une nouvelle espèce d’ornithomimosaure. Et même à l’une des plus anciennes jamais décrites dans le monde. L’existence de ce groupe de dinosaures étant attestée à la même époque en Afrique du Sud et pour des périodes ultérieures en Asie, les squelettes quasi complets d’Angeac-Charente pourraient livrer des informations précieuses sur les déplacements de la faune entre les divers continents à un moment où ces derniers n’étaient pas encore totalement formés.
Au total, les restes de treize types de dinosaures ont été mis au jour à Angeac-Charente, dépassant, de loin, les espérances initiales des paléontologues. […]
Vahé Ter Minassian Le Monde du 27 08 2018
Un turiasaure, un sauropode au long cou et à la longue queue, qui compte parmi les plus gros animaux à avoir jamais foulé la surface terrestre – ce spécimen devait peser plus de 30 tonnes et dépasser les 20 mètres -, passera aux rayons X du synchrotron de Grenoble en 2023. De son crâne, il ne subsiste que la partie arrière, posée sur une table. Notre objectif est de sonder le fossile par une technique de tomographie aux rayons X en vue de récolter des images permettant de produire un modèle 3D de son endocaste. En comparant cette reconstitution à celles disponibles pour d’autres espèces, nous espérons accéder à des informations sur les capacités, la physiologie et le comportement de cet herbivore. Par exemple, savoir si l’inclinaison de sa tête le rendait plus apte à manger des feuillages placés en hauteur que des fougères situées près du sol. C’est-à-dire apprendre s’il était spécialisé.
Ronan Alain, chercheur au synchrotron de Grenoble.

Depuis 2010, le dessinateur Mazan suit les fouilles sur le site d’Angeac-Charente.
Crétacé moyen : 130 à 90 m.a. C’est durant cette période que le climat a été le plus chaud que la terre ait connu : les eaux de surface des océans sont de 15 à 20° plus élevées que les températures actuelles : les coraux édifiaient des édifices au large de New-York ! et de l’est de l’actuel Mexique au nord du Canada s’étendait un vaste océan, peuplé de requins géants et de grands reptiles marins.
127 m.a.
Dans nos cieux règne l’ornithocheirus, le plus grand, le plus lourd (100 kg), le plus beau de tous les ptérosaures – ils sont une centaine d’espèces, de l’envergure de 12 mètres de l’ornithocheirus à la taille d’un moineau – ; avec cette majestueuse envergure, les gorges trop étroites ne sont pas fréquentables et le terrain d’atterrissage doit être plutôt spacieux, – surtout pour le décollage – !
Les chinois feront une découverte étonnante fin 2017 concernant l’un d’eux, l’Hamipterus tianshanensis, une espèce datant du crétacé inférieur (entre 140 et 100 m.a.), de la taille d’un grand goéland. Peuplant ce qui est aujourd’hui la province du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, l’animal avait été décrit en 2014 par l’équipe de Zhonghe Zhou (Académie des sciences de Chine, Pékin). Surprise : un ensemble de cinq œufs accompagnait ces fossiles. Un seul œuf de ptérosaure, découvert en 2004 en Argentine, était jusqu’alors connu.
L’équipe de Zhonghe Zhou a poursuivi ses investigations et est revenue avec une moisson pléthorique. Dans le Science du jeudi 30 novembre, elle révèle la découverte d’un gisement contenant des centaines de fossiles d’Hamipterus, mais aussi 215 œufs – mais il pourrait y en avoir 300 -, car plusieurs apparaissent enterrés sous ceux qui ont été exhumés, rapporte l’équipe. La découverte confirme que les ptérosaures pondaient des œufs souples, recouverts d’une fine pellicule parcheminée, comme les lézards actuels. Alors que les ptérosaures étaient plus proches des dinosaures et des crocodiles, aux œufs à coquille rigide, leur ponte ressemble plus à celle des lézards, plus éloignés sur le plan évolutif, nous dit Jean-Michel Mazin, responsable d’un site de fouilles à Crayssac (Lot) où de multiples traces de ptérosaures ont été mises au jour.
Cette structure implique que la ponte devait être enfouie, pour la protéger de la dessiccation, comme aujourd’hui chez les tortues marines. Cela écarte toute forme d’incubation par contact, comme celle observée chez les oiseaux modernes, commente Charles Deeming, de l’université de Lincoln au Royaume-Uni. Cependant, des adultes devaient s’occuper des nids ou les protéger, ce qui expliquerait la présence sur le site de nombreux ossements de ptérosaures adultes.
Il faut donc imaginer une colonie, un site de ponte collectif, qui aurait été touché par un glissement de terrain ayant facilité la fossilisation de l’ensemble. Une grande partie des œufs décrits sont racornis, chiffonnés, ce qui suggère un incident survenu au moment de la ponte, avance M. Mazin. À moins que la compétition pour trouver un lieu de ponte meuble n’ait entraîné la destruction accidentelle d’autres nids, comme on l’observe parfois chez les tortues marines qui déterrent par mégarde la descendance de leurs voisines.
L’équipe chinoise a une autre explication : l’étude des strates géologiques laisse penser que le lieu de ponte, situé dans un environnement lacustre, aurait pu être déterré par un puissant orage. Les œufs auraient été entraînés dans le lac, flottant à sa surface, se concentrant avant d’être enfouis avec les squelettes désarticulés des adultes, écrivent-ils.
Ce mode d’incubation enterrée fait naître d’autres hypothèses : elle devait durer longtemps, en raison d’une température moins élevée que chez les animaux couveurs. Cela signifie-t-il également que les petits sortaient de leur coquille tout armés pour la vie et le vol ?
C’est là que la découverte de seize embryons fossilisés dans ces œufs embrouillés prend tout son intérêt. À de rares exceptions près, leurs os ont tendance à être désarticulés et déplacés par rapport à leur position naturelle, explique l’équipe chinoise. Aucune dent n’a été observée, alors que les embryons de lézard et de crocodile en sont dotés. Il y a donc deux possibilités : soit les embryons de ptérosaures ont été pétrifiés alors que leur développement n’était pas achevé, soit l’éruption des dents intervient plus tard chez cette espèce.
Et les ailes ? Leurs articulations ne sont pas non plus formées, alors que les fémurs sont bien développés. Cela implique que les nouveau-nés devaient pouvoir se déplacer, mais qu’ils n’étaient pas capables de voler, écrivent Zhonghe Zhou et ses collègues. Ce qui conduit à l’hypothèse qu’Hamipterus aurait pu être moins précoce que ce qu’on pensait généralement des reptiles volants, et que les petits nécessitaient probablement une forme de soin parental.
Cette conclusion dépend du niveau de maturité des embryons étudiés, note cependant Jean-Michel Mazin. On ignore s’ils étaient arrivés à terme. De futures fouilles permettront peut-être de le savoir…
Hervé Morin. Le Monde du 2 12 2017
Eussent-ils été mieux inspirés en ne mettant pas tous leurs œufs dans le même panier ? Rien n’est moins sûr.
125 m.a.
Eomaia scansoria, un petit mammifère bien adapté à son environnement, vraisemblablement bon grimpeur, est découvert par des Chinois dans la province de Liaoning : c’est le plus ancien euthérien : il ressemble à une petite musaraigne aux longs doigts et aux mœurs arboricoles. C’est un ancêtre de la lignée humaine : les lémuriens et les hominoïdes [4] appartiennent tous deux à la classification des primates, qui partagent certains caractères tels que le pouce opposable, les grandes orbites profondes, les ongles plats.
Il y aura toujours en nous un Tarsier ou un Lémurien qui sommeille. Ne le répudions pas. Il est le plus discret, le plus fiable des compagnons, et son départ laisserait en nous ce vide inexplicable, ce sentiment d’abandon, d’exil au cœur d’un monde inhabité, le froid d’un désert intime et glacé. Il est l’indispensable intercesseur entre nous et l’antique Bête, le chaînon qui manquait à notre généalogie secrète, il est la Belle dormant en notre bois sacré. Si leur figure ne nous est pas toujours familière, c’est que nous avons désappris le secret de notre naissance. Pourtant, Tarsier ou Lémurien, il est plus beau et bien plus vrai que toutes les fables inventées par les religions et les mythologies. Il est plus beau et bien plus vrai que tous les contes de notre enfance. Il n’y a jamais eu de paradis, d’ange à l’épée de flamme, de pommier, de serpent, d’arbre du Bien et du Mal. Mais il y a eu la longue chaîne de nos naissances successives, la longue chaîne de nageoires, de moignons, de pattes et de jambes, de mufles, de groins, de museaux et de faces, d’opercules, d’évents, de narines et de nez, enfin d’ocelles et d’yeux qui ont fait de chacun de nous cette parfaite mosaïque de gènes, cette anthologie de cellules, cette alchimie de sèves, de sang sélectionnés. Nous ne serons jamais seuls au monde tant que le monde entier sommeillera en nous.
Jacques Lacarrière. Un Jardin pour mémoire. Nil 1999
Montsechia vidalii est la plus ancienne plante à fleurs, ancêtre des actuelles Ceratophyllae, plantes aquatiques comme la cornifle nageante. Elle est en concurrence au titre de plus ancien angiosperme (plante à fleurs) avec sa cousine chinoise Archaefructus. Ces fossiles ont en fait été découverts il y a plus d’un siècle dans les Pyrénées espagnoles dans des couches calcaires, mais ils avaient jusqu’alors été mal interprétés.
120 m.a.
Apparition des mammifères vivipares : l’embryon se développe, avec son aide, dans le ventre de la mère.
115 m.a.
L’analyse d’un morceau d’ambre sous-marin près de l’île de Hokkaïdo au Japon, datant du crétacé, révèle l’existence d’un tsunami de très grande ampleur.
110 m.a.
L’Ibérie, jusqu’alors jointive avec la France – Galice et Bretagne appartiennent toutes deux à la chaîne hercynienne -, se met à migrer vers l’est, ce qui va ouvrir le golfe de Gascogne et amorcer la fermeture de l’océan.
Des scientifiques français et espagnols découvrent dans des dépôts du crétacé inférieur au nord de l’Espagne des spécimens fossilisés de thysanopterans, communément appelé thrips ; le spécimen étudié appartient au genre Gymnospollisthrips : c’est le plus ancien insecte pollinisateur, long d’à peine 2 mm, couvert de centaines de grains de pollen attaché à son corps au moyen de poils en forme d’anneaux, comparables à ceux qui équipent les abeilles aujourd’hui. Ils sont des pollinisateurs aussi efficaces que les papillons, les bourdons et les très nombreuses espèces de mouches et de coléoptères. On en compte aujourd’hui pas moins de 5 000 espèces. Ils pourraient être les premiers pollinisateurs.
100 m.a.
L’ouverture de l’océan Atlantique commence à séparer l’Amérique du Sud de l’Afrique. L’Antarctique, l’Australie, l’Inde et Madagascar amorcent leur séparation de l’Afrique pour émigrer, qui vers le sud et l’est, qui vers le nord-est. L’Inde, va se séparer de Madagascar à l’étonnante vitesse de 170 km par m.a. La Nouvelle Calédonie va rester isolée pendant 80 m.a., sauvegardant ainsi l’exceptionnelle richesse de sa faune et de sa flore : plus de 3 000 espèces endogènes sur un peu moins de 20 000 km² ! Mais dans les années 2010, on cessera de parler de la Nouvelle Calédonie, pour parler d’un continent qui l’englobe, ainsi que la Nouvelle Zélande : le Zealandia, continent essentiellement sous-marin avec ces deux grandes îles comme parties émergées, avec une dimension de 4.9 millions de km² et une altitude moyenne de 1 100 mètres sous le niveau de la mer : on le dit continent, car ceux-ci, contrairement aux fonds sous-marins, ont une croûte essentiellement granitique de 10 à 25 km d’épaisseur [30 à 45 km pour les autres continents], quand celle des fonds sous-marins est au maximum de 10 km d’épaisseur et composé surtout de basaltes. On parle aussi d’un continent Icelandia, dont l’Islande serait la partie émergée pour le Nord et les Îles Féroé pour le Sud, au nord-ouest de l’Iralande, sur une surface d’environ 1 million km².
Lorsque l’on veut reconstituer le puzzle de l’état antérieur, l’opération est beaucoup plus précise quand l’on rapproche le bord des plateaux continentaux actuels, plutôt que les côtes elles-mêmes.
L’archipel européen d’il y a 100 m.a. occupe l’emplacement de l’Europe actuelle, à l’est du Groenland, à l’ouest de l’Asie ; au centre d’une région située entre les 30° et 50° parallèle nord. L’île de Bal, qui fait aujourd’hui partie de la région baltique, pourrait sembler de prime abord une destination idéale pour notre machine à remonter le temps. C’est de loin la plus ancienne et la plus grande île de l’archipel européen, et elle a probablement joué un rôle fondamental dans la constitution de la faune et de la flore primitives en Europe. Mais de façon très frustrante, pas un seul fossile datent de la dernière partie de l’époque des dinosaures n’a été retrouvée sur ce territoire. Tout ce que nous savons de la vie sur Bal provient de quelques restes de plantes et d’animaux : emportés par les eaux, ils ont été conservés dans des sédiments marins qui affleurent aujourd’hui en Suède et au sud-est de la Russie. Atterrir dans un tel désert n’aurait aucun intérêt.
[…] La faune des dinosaures de Hateg est la plus caractéristique que nous connaissions, sans toutefois être représentative de l’ensemble de l’Europe. Pour avoir une vision plus complète, nous devons élargir notre rayon d’action. Depuis le rivage de l’île décollons vers le sud et traversons la vaste étendue tropicale de la Téthys. Dans ses eaux peu profondes, des bivalves aujourd’hui disparus, les rudistes, tapissent les fonds marins. On y trouve aussi de nombreux escargots de mer en for d’obus, les Actanonellidae, dont les plus gros remplissent une main. Les coquilles de ces escargots prédateurs sont exceptionnellement épaisses. Ils prospèrent sur les lits de rudistes et s’enfouissent lorsque les sédiments le permettent. Ils sont si nombreux qu’en Roumanie, aujourd’hui encore, des collines entières, qu’on appelle les collines des escargots, sont faites de leurs fossiles. Outre les ammonites et les grands reptiles marins comme le plésiosaure, tortues de mer et requins parcourent la Thétys.
Un océan tout à fait différent s’étend au nord de l’archipel. Aucune espèce qui l’habite ne se retrouve dans les eaux tièdes de la Thétys. Ses ammonites, par exemple, sont de type très différents. La mer Boréale n’est pas tropicale, et ses eaux sont loin d’être claires et invitantes. Elles sont pleines d’algues planctoniques d’un brun doré, des cocolithophoridés, dont les squelettes formeront les couches de craie situées aujourd’hui en Grande Bretagne, en Belgique et en France. La plupart des restes de cocolithophoridées qui constituent ces couches ont été broyés. Ils pont dû être mangés et excrétés par un prédateur encore non identifié.
Si les cocolithophoridés qui abondaient dans l’océan Boréal ressemblaient à Emiliania huxleyi (Ehux), l’espèce la plus abondante qui vit aujourd’hui dans nos mers, nous pouvons en déduire beaucoup de choses sur l’aspect de cet océan. Là où des remontées d’eau ou d’autres sources de nutriment favorisent la prolifération d’Ehux, cette algue peut se multiplier sous la forme de fleurs, à tel point que les eaux en deviennent laiteuses. Ehux réfléchit aussi la lumière et concentre la chaleur dans la couche supérieure de l’océan, tout en produisant du sulfure de diméthyle, un composé qui facilite la formation de nuages. L’océan Boréal devait être un endroit grouillant de vie, ses eaux laiteuses remplies d’organismes qui se nourrissaient de plancton, protégés de la chaleur et des rayonnements ultra-violets nocifs par un ciel nuageux.
On ne saura jamais trop souligner à quel point la situation de l’Europe à la fin de l’époque des dinosaures est singulière. C’est un arc insulaire géologiquement complexe et dynamique, dont les masses individuelles sont constituées d’anciens fragments de continents et de croûte océanique émergés et de terres nouvellement créées par l’activité volcanique. Même à ce stade précoce, l’Europe exerce une influence disproportionnée sur le reste du monde, en partie à cause de l’amincissement de la croûte qui la porte. La chaleur augmente vers la surface, ce qui provoque un soulèvement du fonds marin qui crée des dorsales entre les îles. Cette diminution de la profondeur des eaux, renforcé par la création des dorsales médio-océaniques au moment de la séparation des supercontinents, fait déborder les océans, modifiant les contours des continents et engloutissant certaines iles européennes. La tendance à long terme favorise toutefois la création de nouvelles terres dans ce qui va devenir l’Europe.
Comme la Gaule de César l’archipel européen de la fin de l’âge des dinosaures peut-être divisé en trois parties. La principale est constituée de la grande terre septentrionale de Bal et de sa voisine méridionale, la Modac. Au sud de ce premier territoire se trouve une région extrêmement variée et en rapide évolution qui nous appellerons les îles de la mer : elle englobe les archipels isolés des Pontides, de la Pélagonie et de Tau. Dans 50 m.a., ils s’uniront aux terres qui bordent aujourd’hui la Méditerranées orientale.
La troisième partie est située à l’ouest de ces deux grandes divisions. Des masses terrestres complexes se répartissent en longueur entre le Groenland et Bal. En l’absence de dénomination largement acceptée, nous l’appellerons la Gaelia (des îles gaéliques et d’Iberia). Formée des îles gaéliques (proto-Irlande, Écosse, Cornouailles et Pays de Galles) et vers la partie africaine du Gondwana, des îles gallo-ibériques (qui se répartiront entre la France, l’Espagne et le Portugal), c’est une région hétérogène.
Tim Flannery. Le super continent. Une histoire naturelle de l’Europe. Flammarion 2018

L’Europe du Crétacé, il y a 80 m.a. En blanc, les terres émergées, en grisé, clair et sombre, les mers. GAELIA à l’ouest, et, encore plus à l’ouest : l’Amérique du Nord et l’Afrique, BAL au nord-est, NODA an centre. Au centre sud Téthys. Au sud-est, Pélagonie et Tau, et au-dessus, Hateg et les Pontides.
Au sud de l’Europe, dans l’actuel Sahara, le Spinosaurus prend ses quartiers :

Formation de la structure De Richat, dans l’actuelle Mauritanie, par 21°07’26 » N, 11°24’07 » O, résultat de l’érosion d’un volcan géant effondré.

Diamètre d’environ 50 kilomètres
98 m.a.
Un titanosaure se pique d’être le plus grand découvert à ce jour : il habite la vallée de la Neuquén, dans l’actuelle Patagonie. L’Argentine compte de très nombreux fossiles issus des trois périodes de l’ère mésozoïque (secondaire) – le trias, le jurassique et le crétacé -. Ils appartiennent à des animaux différents de ceux rencontrés dans l’hémisphère Nord.
93 m.a.
Les océans se mettent à manquer d’oxygène : Un événement anoxique, qui marque la limite entre le Cénomanien et le Turonien, se caractérise par une extinction de masse particulièrement sévère dans le milieu marin. Les ichtyosaures et presque tous les pliosaures disparaissent à ce moment-là. Si le rôle des volcans dans l’origine de cet événement dramatique est depuis longtemps suggéré, la source exacte restait débattue. Jusqu’à présent, deux suspects potentiels étaient proposés : le LIP (Large Igneous Province) des Caraïbes et le LIP de l’Extrême-Arctique. Une nouvelle étude, publiée dans la revue Nature communications pointe cependant du doigt un autre coupable.
Crâne du plus grand spécimen d’Ichtyosaure, issu de la collection de Lus Ebbo, conservé à la paléo galerie de Salignac, Alpes de Haute Provence. Pascal Goetgheluck Biosphoto via AFP
L’analyse géochimique et isotopique de sédiments élevés dans le bassin de Mentelle au large de l’Australie révèle en effet que l’Événement anoxique océanique 2 (OAE 2), survenu il y a 94 m.a. serait lié à l’activité éruptive du plateau océanique de Kerguelen, qui serait arrivé à l’émersion à ce moment-là.
Futura
95 m.a.

Spinosaurus mirabilis : 14 mètres de long, une dentition parfaitement ajustée qui ne laisse échapper aucune proie. Chasse en eaux peu profondes . Vue d’artiste de Dani Navatro, Université de Chicago
86 m.a.
Effectués sur des sites où la sédimentation était particulièrement lente – 1 millimètre par millénaire – des forages révèlent des traces d’oxygène dans des argiles rouges se trouvant à 30 mètres de profondeur sous le sol marin du Pacifique nord, permettant une activité microbienne réduite.
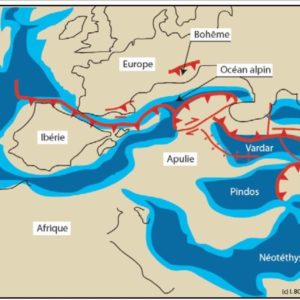
L’Europe au Santonien [85.8 à 83.7 m.a.]. La plaque ibérique ferme l’océan alpin et une tectonique compressive se met en place dans le sud-est de la France
83 m.a.
La plaque de l’île sud de la Nouvelle Zélande se détache du Gondwana, et va rester sous-marine pendant quelques 60 m.a. À 23 m.a. émergera l’île, dont le plateau continental reste considérable : à peu près la moitié de l’Australie voisine. La plaque Pacifique passe en subduction sous cette île sud de la Nouvelle Zélande, provoquant l’orogénèse des Alpes du Sud, à raison de 15 cm/an.
80 à 35 m.a.
L’orogénie laramienne met en place les Montagnes rocheuses.
Par un curieux hasard, le morceau de terre qui s’est détaché de la partie orientale du Gondwana à la fin du Crétacé, il y a 80 m.a. pour devenir l’actuelle Nouvelle Zélande, n’a pas convié de mammifères terrestres dans son odyssée océanique. Les seuls habitants à fourrure natifs du pays sont une poignée de chauve-souris et de phoques. Un grand nombre de niches écologiques potentielles se sont retrouvées vacantes – niches rapidement remplies par d’autres groupes animaux plutôt inattendus -. Les oiseaux ont endossé le rôle de grands herbivores (les moas maintenant éteints), d’insectivores aptères mais alertes (les troglodytes pratiquement éteints) ou de prédateurs nocturnes d’invertébrés doués d’un odorat sensible (les kiwis gravement menacés). En l’absence de prédateurs mammaliens, plusieurs lignées d’oiseaux sont devenues inaptes au vol, car il n’existait plus de menace devant laquelle s’envoler à tire d’aile. Le rôle des souris et autres rongeurs était rempli par les wetas, des insectes granivores ressemblant à des grillons. Peu d’oiseaux s’intéressant à eux, les wetas sont devenus grands et lents. Quand l’invasion mamalienne a commencé avec l’arrivée des premiers navigateurs polynésiens il y a 2 000 ans, cette faune insulaire vulnérable n’a pas fait le poids. Les premiers à disparaître ont été les moas, énormes oiseaux deux fois plus gros que les autruches, victimes du pire des prédateurs, l’homme. Avec les premiers humains sont arrivés d’autres mammifères, principalement les cochons, le chien et le rat du Pacifique (Rattus exulans). Ce dernier a bien sur été introduit accidentellement, mais cela n’a diminué en rien le carnage qu’il a provoqué. Les rats sont probablement la cause principale de l’extinction de nombreux oiseaux, du déclin sévère des populations de wetas et de la disparition des tuataras des deux grandes îles. Pour ne pas être en reste, les colons anglais ont retroussé les manches et se sont mis en tête de transformer ce pays singulièrement exotique. Ils y ont introduit renards et cerfs pour les plaisirs de la chasse, puis hérissons, chats et de nombreuses autres espèces à poil. En l’absence de concurrents, les rats et les souris, apportés par les Maoris et les Européens, se sont mis à prospérer et à dévaster les cultures, s’attirant finalement l’attention des colons. Dans ce qui est resté l’une des décisions les plus désastreuses de l’histoire de la Nouvelle Zélande, des hermines ont été rapportées d’Europe pour juguler leur prolifération. Mais pourquoi les hermines se seraient-elles tuées à chasser ces rongeurs rapides et rusés qui, en quelques m.a. de coévolution avec des mammifères prédateurs avaient développé une grande habileté à les fuir, alors que les îles regorgeaient d’oiseaux naïfs, lents ou inaptes au vol ? Sans surprise, un carnage d’oiseaux s’en est suivi.
Piotr Naskrecki. Reliques. Ulmer 2012
75 m.a.
Mise en place de tous les grands ordres de mammifères.
L’évolution suit toujours les mêmes tendances : les organismes dérivent vers plus d’ordre, plus de complexité, plus d’efficacité, plus d’indépendance vis-à-vis de l’environnement. L’évolution est progressive, elle s’accompagne de l’augmentation de la taille et se traduit par une complexification des structures. Le processus évolutif traverse deux étapes : d’abord apparaissent des répétitions d’organes ou de molécules homologues, résultat de la duplication d’un gène majeur. Chaque copie est soumise à des mutations aléatoires et diversifiantes, et la fonction s’améliore petit à petit en devenant plus complexe. Dans un second temps, la spécialisation et la sélection opèrent sur des individus déjà diversifiés. Une formule différenciée est sélectionnée et devient invariable car mieux adaptée. Ainsi, tous les insectes ont trois paires de pièces buccales, tous se déplacent à l’aide de pattes insérées sur les trois segments thoraciques. De même, il est remarquable de constater que les mammifères ont tous sept vertèbres cervicales, du dauphin sans cou à la girafe qui en a un fort long.
La sélection naturelle choisit des caractères adaptés au milieu. Des isolements géographiques font apparaître plusieurs populations distinctes, soumises à des conditions de vie différentes, qui vont évoluer de façon divergente jusqu’à donner des espèces différentes ; on parle alors de phénomène de spéciation par isolement géographique.
Si l’on prend l’exemple du renard, il a largement débordé son aire géographique habituelle et cette extension lui a permis de coloniser des territoires nouveaux. On constate que la taille des renards de régions froides est plus grande, avec des extrémités réduites. Un renard polaire est trapu aux pattes courtes et petites oreilles alors que le fennec est menu, perché sur de longues pattes fines. Une des adaptations au froid des homéothermes est l’augmentation de taille, car ils perdent moins de chaleur à cause de la surface relativement petite par rapport au volume ; quand le rapport entre la surface et le volume se réduit, le pelage s’épaissit et la conductance diminue : l’isolement s’améliore. Dans un climat chaud, ils doivent évacuer la chaleur, et la tendance est à la petite taille qui crée une grande surface de déperdition de chaleur par rapport au volume.
Au fur et à mesure que l’évolution progresse, la différenciation s’accompagne du développement des systèmes de régulation (nerveux, endocrinien, immunitaire), conférant à l’organisme une unité de plus en plus parfaite et une indépendance de plus en plus grande vis-à-vis du monde extérieur.
L’évolution est le plus souvent progressive mais il lui arrive aussi d’être régressive en faisant disparaître des organes. Selon la loi de Dollo, l’évolution régressive est irréversible. Si l’organe perdu exerçait une fonction indispensable, un autre analogue le remplace pour perpétuer la fonction. Des organes peuvent en outre être reconvertis et détournés de leur rôle dans l’optique d’une amélioration qui apparaît dans la lignée évolutive. Prenons l’exemple de deux petits os : l’articulaire et le carré des reptiles reconvertis en osselets de l’oreille moyenne chez les mammifères. Autre exemple : l’hormone de l’osmorégulation des poissons se retrouve chez les mammifères, sécrétée par la thyroïde, après avoir obtenu une promotion puisqu’elle gère la thermorégulation. François Jacob a même dit à ce sujet que la nature se content[e] de bricoler au lieu de créer vraiment.
L’indépendance vis-à-vis de l’environnement est à coup sûr un atout majeur dans un milieu qui s’assèche en devenant de plus en plus défavorable à la vie.
Les vertébrés, après avoir réussi leur adaptation terrestre grâce à l’émergence des reptiles capables de ramper pour coloniser les continents, ont poursuivi leur évolution en se libérant des contraintes de leur environnement.
Au cours des temps géologiques, plusieurs formules évolutives sont apparues :
- La rapidité de déplacement pour améliorer l’ordinaire alimentaire sur un plus grand territoire.
- La thermorégulation chez les oiseaux et les mammifères pour résister aux fluctuations climatiques ; ils assurent alors une activité permanente sans période de vie ralentie sauf chez les hibernants.
- La viviparité ou l’oviparité qui leur permet de s’affranchir du milieu originel aquatique en protégeant l’embryon dans des poches liquides riches en éléments nutritifs (poche amniotique ou œuf).
Si le milieu change dans le sens d’une plus grande désertification, les animaux vont devoir poursuivre leur effort d’adaptation s’ils ne veulent pas disparaître.
L’accroissement de l’indépendance à l’égard du milieu constitue une des orientations de l’évolution animale. Cette dernière découle de remaniements génétiques entraînant des modifications organiques. On peut imaginer une augmentation de la mobilité chez les mollusques, les insectes et les vertébrés pour pouvoir échapper aux zones arides et exploiter des biotopes plus variés. Ils mettront à profit ces nouveaux perfectionnements pour découvrir des territoires plus favorables.
Quelles sont les espèces récentes qui font partie des plus évoluées ? Les insectes se trouvent en bonne position, ils ont acquis une prédominance dans ce domaine, à en juger par leur omniprésence dans tous les milieux et le nombre des espèces qui avoisine le million. Ils représentent plus d’un tiers de toutes les espèces. Cette réussite est incontestablement à attribuer aux facteurs d’indépendance qu’ils ont développés à l’égard du milieu. Par exemple, le squelette externe de chitine imperméable les préserve de la déshydratation, l’aptitude au vol les rend plus mobiles, la coque protectrice des œufs préserve la descendance. Elle tient aussi à la brièveté de leur cycle de maturité conditionnant leur énorme potentiel reproductif et favorisant la sélection des mutations avantageuses ou de nouvelles combinaisons géniques. Ces variations héréditaires conduisent à une diversification des espèces.
Parmi les espèces récemment apparues, certaines montrent une vitalité accrue et bénéficient d’adaptations leur permettant de conquérir des milieux nouveaux.
Le moteur de l’évolution agit-il de nos jours ? L’évolution actuelle se résume à la spéciation et, d’après Pierre-Paul Grassé, subirait un amortissement. La marge de manœuvre de l’évolution n’a cessé de s’amenuiser, dit-il : à l’Ordovicien, la genèse des embranchements s’arrête, au Jurassique celle des classes, au Paléocène celle des ordres. Une évolution directionnelle intervenant maintenant ferait sortir des individus du cadre de l’espèce avec beaucoup de difficulté. On peut aussi penser qu’un nouveau venu, l’homme, est capable par sa technique de diriger cette évolution […] Cette dangereuse liberté exige que l’homme agisse dans un total respect du vivant. L’ontogenèse évolutive repose sur une exploitation des potentialités de l’œuf mais l’homme par sa technique peut à chaque étape intervenir et modifier le génome et le déroulement du développement autonome, donc multiplier les possibles.
[…] Des paléontologues ont évalué approximativement la durée moyenne d’existence d’une espèce de mammifère à dix m.a. en théorie. L’homme existe depuis quatre m.a. il lui reste donc du temps devant lui.
Catherine Boudier. Le Livre des Déserts. Bouquins Robert Laffont 2005
En 2020, des chercheurs canadiens rapporteront le premier cas confirmé de tumeur maligne osseuse chez un dinosaure, en l’occurrence chez un Centrosaurus apertus adulte, un herbivore à corne appartenant au groupe des cératopsiens. Découvert au Canada, il y a vécu entre 75 et 77 m.a. il était porteur d’une tumeur osseuse agressive : un ostéosarcome du péroné (fibula).

Geological sketch map of the Anglo-Paris Basin showing the main structural features. The study area (rectangular box) is located in the central part of the basin. The seismic surveys and the location of the wells mentioned in this study are indicated, and they are shown in greater detail in Fig. 5. The location of the seismic lines shown in Figs. 3, 4, 6-8 is also shown.
70 m.a.
Les Montagnes Rocheuses naissent du début de la collision entre la plaque Faramon, océanique et la plaque nord-américaine. Cependant, certains secteurs méridionaux datent du Précambrien – entre −4,5 milliards d’années et – 542 m.a -. La chaîne des Rocheuses est un complexe de roches métamorphiques et magmatiques comportant quelques dépôts sédimentaires (karst de Grand Teton, Monts Big Horn, Bighorn Basin). L’érosion intense, des glaciations pour le principal, a arasé des bassins situés au centre de la chaîne, tel que le bassin du Wyoming et également formé des vallées profondes et encaissées, résultat de compressions intenses : c’est une chaîne de collision active. La partie sud-ouest a été disloquée dans les horsts avec les bassins (grabens) au milieu. Cette zone est nommée bassin et étendue provinciale – Basin and Range.
Ce n’est pas vraiment un oiseau, mais un reptile qui parvient tout de même à s’envoler à deux mètres de haut : c’est le Quetzalcoaltus, dont l’envergure peut dépasser dix mètres !



et lui, c’est un titanosaure qui peur mesurer 5 mètres de haut, et 30 mètres de long
________________________________________________________________________________
[1] terme aujourd’hui abandonné par les scientifiques qui lui préfèrent celui de varisque, plus approprié. Ce texte étant destiné au grand public, on conservera le terme hercynien beaucoup plus répandu, encore pour quelques bonnes dizaines d’années, de même que l’on a avalisé des erreurs, en conservant les termes d’Indien pour parler des peuples autochtones d’Amériques du nord comme du sud, de même qu’on parle de remède de bonne femme, en lieu et place de remède de bonne réputation (fame), etc, etc …
[2] lequel cratère d’astéroïde peut porter le nom plus savant d’astroblème
[3] En 2018, selon l’équipe de Jérôme Salce, les premières angiospermes seraient apparues beaucoup plus tôt – il y a 214 m.a. – que ce que l’on croyait jusqu’alors.
[4] Les hominoïdes regroupent les gibbons, les orangs outangs, les gorilles, les chimpanzés et les hommes ainsi que nombre d’espèces aujourd’hui disparues.






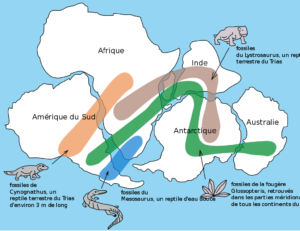

Laisser un commentaire