| Publié par (l.peltier) le 4 décembre 2008 | En savoir plus |
4 12 1259
Le traité de Paris met fin à des décennies de guerre avec l’Angleterre. Le roi de France Louis IX rend au roi d’Angleterre tout ce qu’il détient dans les diocèses de Limoges, Cahors et Périgueux. De plus tout ce que son frère Alphonse de France possédait en Agenais et en Saintonge, au sud de la Charente, serait rendu au roi d’Angleterre si Alphonse mourait sans héritier. En revanche, Henri III validait les conquêtes de Philippe Auguste : Normandie, Maine, Anjou, Touraine, Poitou et l’Anglais rendait hommage au roi de France pour son duché d’Aquitaine.
À l’instar des contemporains stupéfaits d’une générosité estimée excessive, Joinville rapporta la controverse entre le roi et nombre de membres du conseil royal : Sire, nous nous émerveillons fort que votre volonté soit telle que vous voulez donner au roi d’Angleterre une si grande partie de votre terre que vous et vos devanciers avez conquise sur lui par sa défaite…. Si vous entendez que vous n’y avez pas droit, vous ne faites pas bien de les rendre au roi d’Angleterre, ou alors rendez-lui toute la conquête que vous et vos devanciers avez faite ; et si vous entendez que vous y avez droit, il me semble que vous perdez ce que vous lui rendez.
À cela, répondit le saint roi de telle manière : Seigneurs, je suis certain que les devanciers du roi d’Angleterre ont perdu à bon droit la conquête que je tiens ; et la terre que je lui donne, je ne la lui donne pas pour quoi que ce soit dont je sois tenu envers lui ou ses héritiers, mais pour mettre amour entre mes enfants et les siens qui sont cousins germains, et il semble qu’en la lui donnant je l’emploie bien, car il n’était pas mon homme et désormais entre en mon hommage.
1259
Qoubilaï, autre petit fils de Gengis Khan, monte sur le trône mongol, à la tête du plus grand empire qui ait jamais existé : 33 millions de km². De la Corée, conquise l’année précédente au Danube et de la Sibérie au Golfe Persique ; le tout fédéré en quatre Ulus : Ulus des Ilkhans [actuels Turquie, Iran, Afghanistan, Pakistan] Ulus de la Horde d’Or [de l’actuelle Bulgarie à l’est de l’Oural, Ulus du Diaghataï, [Sibérie Centrale du nord au sud, jusqu’à Samarkand], Ulus du Grand Khan, à peu près l’actuelle Chine. Il mourra à Pékin en 1294.
Le refroidissement qui va s’installer durablement dans ces steppes du nord – le petit âge glaciaire – est une des causes de cette migration des Mongols vers le sud. Ils vont s’avérer de puissants alliés contre les musulmans et les Turcs qui interdisaient la route de l’Orient ; les deux routes de la soie existaient certes depuis longtemps, mais les marchands francs et vénitiens s’arrêtaient aux ports de la méditerranée orientale, ou, tout au plus Alep ou Damas et Alexandrie, passant alors le relais aux marchands arabes et ottomans. La route s’ouvrit alors au voyageur européen ; le premier d’entre eux sera Marco Polo. Le commerce des Indes va se déplacer plus au nord, avec pour principale plaque tournante Trébizonde, port de la rive sud de la Mer Noire.
Le Thibet, le Turkestan, la Moscovie, le Siam, la Cochinchine, le Tonking, et la Corée reconnaissaient la suzeraineté du grand Khan des Tartares, et lui payaient fidèlement le tribut. Les nations européennes furent même, à plusieurs reprises, insolemment sommées de reconnaître la domination mongole. Des lettres orgueilleuses et menaçantes furent envoyées au Pape, au Roi de France, à l’Empereur, pour leur enjoindre d’apporter en tribut les revenus de leurs États jusqu’au fond de la Tartarie. Les princes issus de la famille de Tchinggiskhan, qui régnaient en Moscovie, en Perse, dans la Bactriane et dans la Sogdiane, recevaient l’investiture de l’empereur de Péking, et n’entreprenaient rien d’important, sans lui en avoir donné avis par avance. Les pièces diplomatiques que le roi de Perse envoyait au treizième siècle à Philippe le Bel, sont une preuve de cette subordination. Sur ces monuments précieux, qui se sont conservés jusqu’à nos jours aux Archives de France, on voit des sceaux en caractères chinois, et qui constatent la suprématie du grand Khan de Péking sur les souverains de la Perse.
Les conquêtes de Tchinggiskhan et de ses successeurs, plus tard celles de Tamerlan ou Timour, qui transporta le siège de l’empire Mongol à Samarcande, contribuèrent, autant et peut-être plus que les croisades, à renouer les relations de l’Europe avec les États les plus reculés de l’orient, et favorisèrent les découvertes qui ont été si utiles au progrès des arts, des sciences et de la navigation.
M Huc. Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine pendant les années 1844, 1845 et 1846. Librairie d’Adrien Le Clerc 1853
Les marchands ne sont pas les seuls témoins (de la Chine). D’autres ont parlé à travers toute l’Europe, comme ce moine chinois, Rabban Çauma, un moine chrétien de rite nestorien. Car il est au cœur de l’Asie une église chrétienne, ou plutôt des communautés chrétiennes généralement issues, entre le VI° et le VII° siècle, de l’Église nestorienne organisée en Perse après la condamnation de l’hérésie de Nestorius – le Christ-homme entièrement distinct du Christ-Dieu – par le concile de Chalcédoine en 451. Le monachisme nestorien est au XIII° siècle bien vivant en Arabie, en Inde, en Chine. Lui aussi se pose la question d’Innocent IV, mais en sens inverse : qu’en est-il de l’Occident ? Le moine Rabban Çauma vient donc en Europe. Il visite Rome et Paris. Il voit Nicolas IV, Philippe le Bel, Edouard I°. Il s’entretient avec les maîtres des universités. Il écoute, et nous ne savons ce qu’il racontera plus tard en Asie. Mais il parle, et l’Occident entend des choses étonnantes.
À tous, le propos que tient Rabban Çauma paraît engageant, même pour qui ne sait pas bien si le moine se contente de prolonger en Europe un voyage dont l’objet premier était un pèlerinage à Jérusalem, ou s’il est vraiment chargé d’une mission diplomatique par le Khan.
Jean Favier. Les Grandes découvertes. Livre de poche Fayard 1991
En fait, on sait assez bien ce que racontera Rabban Çauma une fois de retour en Chine ; ainsi de cette visite de Paris que lui fit découvrir Philippe le Bel en 1287, auprès duquel il était venu demander secours pour sa grande Église d’Orient dont les chrétiens syriaques étaient de plus en plus menacés par l’essor d l’Islam : Ils s’en allèrent ensuite dans la région de Pariz, près du roi de Phransis. Ce roi envoya au-devant d’eux une escorte nombreuse qui les conduisit dans la ville avec honneur et en grande pompe. Son pays a l’étendue de plus d’un mois de marche. On leur assigna une demeure et, après trois jours, le roi de France envoya un de ses émirs appeler Raban Sauma. Lorsque celui-ci arriva, le roi se leva devant lui et le traita avec honneur.
[…] Rabban Sauma dit au roi : Maintenant que nous avons vu la gloire de votre royauté et que nous avons considéré de nos yeux la merveille de votre puissance, nous vous prions d’ordonner aux habitants de la ville de nous faire voir les églises, les châsses et les reliques des saints, et tout ce qu’il y a chez vous et qui ne se trouve point ailleurs afin que, quand nous retournerons, nous puissions raconter et faire connaître dans notre pays ce que nous aurons vu chez vous. Le roi ordonna à ses émirs : Allez, faites-leur voir tout ce qu’il y a de remarquable chez nous ; ensuite je leur montrerai moi-même ce que j’ai près de moi.
Les émirs sortirent donc avec eux. Ils restèrent un mois et quelques jours dans cette grande ville de Paris et virent tout ce qu’elle renfermait. Il y a là trente mille écoliers qui étudiaient les sciences ecclésiastiques et profanes, c’est à dire l’interprétation et l’explication de tous les livres saints : la sagesse, c’est-à-dire la philosophie et la rhétorique avec la médecine, la géométrie, l’arithmétique et la science des planètes et des étoiles : ils sont constamment occupés à écrire, et tous reçoivent du roi la nourriture.
Ils virent aussi dans une grande église [Saint Denis] qui se trouve là les cercueils des rois défunts et leurs images en or et en argent placés sur leurs tombeaux. Il y a pour le service funèbre de ces rois cinq cent moines qui mangent et boivent aux frais du roi. Ils persévèrent dans le jeûne et la prière sur les tombeaux de ces rois. Les couronnes de ces princes, les armes et leurs vêtements sont placés sur leurs tombeaux. En un mot, tout ce qu’il y a de grandiose et de remarquable, ils le virent.
Après cela, le roi lui-même les fit appeler. Ils se rendirent donc près de lui, à l’église. Ils le virent qui se tenait du côté de l’Orient et ils le saluèrent. Le Roi demanda à Rabban Sauma : Avez-vous vu tout ce qu’il y a chez nous ? Ne vous reste-t-il plus rien à voir ? Rabban Sauma rendit grâces. Et aussitôt, il monta avec le Roi vers un tabernacle d’or que le roi ouvrit. Il en tira un reliquaire de cristal dans lequel se trouvait la Couronne d’épines que les Juifs placèrent sur la tête de Notre Seigneur lorsqu’ils le crucifièrent. La couronne se voit à l’intérieur du reliquaire, sans que celui-ci soit ouvert, grâce à la transparence du cristal. Il y avait aussi dedans une partie du bois de la Croix. Le roi leur dit : Quand nos ancêtres ont pris Constantinople et ont pillé Jérusalem, ils en ont rapporté ces objets de bénédiction.


1259
Les lieutenants de Tchinggiskhan et de ses premiers successeurs, en arrivant dans l’Asie occidentale, ne cherchèrent d’abord à y contracter aucune alliance. Les princes dans les États desquels ils entraient se laissèrent imposer un tribut ; les autres reçurent ordre de se soumettre. Les Géorgiens et les Arméniens furent du nombre des premiers. Les Francs de Syrie, les rois de Hongrie, l’Empereur lui-même, eurent à repousser d’insolentes sommations ; le Pape n’en fut pas garanti par la suprématie qu’on lui reconnaissait à l’égard des autres souverains chrétiens, ni le roi de France par la haute renommée dont il jouissait dans tout l’Orient.
La terreur qu’inspiraient les Tartares ne permit pas de faire à leurs provocations la réponse qu’elles méritaient. On essaya de les fléchir, on brigua leur alliance, on s’efforça de les exciter contre les Musulmans. On eût difficilement pu y réussir, si les Chrétiens orientaux qui, en se faisant leurs vassaux, avaient obtenu du crédit à la cour de leurs généraux et de leurs princes, ne s’y fussent employés avec ardeur ; les Mongols se laissèrent engager à faire la guerre au sultan d’Égypte.
Tel fut l’état des rapports qu’on eut avec eux pendant la première période, qui a duré depuis 1224 jusqu’en 1262.
Dans la seconde période, le khalifat fut détruit ; une principauté mongole se trouva fondée dans la Perse elle confinait aux États du sultan d’Égypte. Une rivalité sanglante s’éleva entre les deux pays : les Chrétiens orientaux s’attachèrent à l’aigrir. L’empire des Mongols était divisé ; ceux de Perse eurent besoin d’auxiliaires, leurs vassaux d’Arménie leur en procurèrent ; ces auxiliaires furent les Francs. Leur puissance déclinait alors de plus en plus ; elle ne tarda pas à être détruite. De nouvelles croisades pouvaient la relever. Les Mongols sollicitèrent en occident ; ils joignirent leurs exhortations à celles des Géorgiens, des Arméniens, des débris des croisés réfugiés en Chypre, et à celles des souverains pontifes. Les premiers Tartares avaient débuté par des menaces et des injures ; les derniers en vinrent aux offres, et descendirent jusqu’aux aux prières. Vingt ambassadeurs furent envoyés par eux en Italie, en Espagne, en France, en Angleterre ; et il ne tint pas à eux que le feu des guerres saintes ne se rallumât et ne s’étendît encore sur l’Europe et sur l’Asie.
Ces tentatives diplomatiques dont le récit forme, pour ainsi dire, un épilogue des expéditions d’outre-mer, à même de la plupart d’entre eux, méritaient peut-être de fixer notre attention. Il fallait rassembler les faits, résoudre les difficultés, mettre en lumière le système politique auquel se lient les négociations avec les Tartares. Les particularités de ce genre ne pouvaient être appréciées tant qu’on les considérait isolément, et sans les examiner dans leur ensemble. On pouvait mettre en doute, comme Voltaire et De Guignes, qu’un roi des Tartares eût prévenu saint Louis par des offres de service. Ce fait ne paraissait tenir à rien, et le récit en devait sembler paradoxal. Le même scepticisme serait déraisonnable, quand on voit que les Mongols n’ont fait autre chose pendant cinquante années et quand on est assuré, par la lecture des écrits des contemporains, et par l’inspection des monuments originaux, que cette conduite était naturelle de leur part, qu’elle entrait dans leurs vues, qu’elle était conforme à leurs intérêts, et qu’elle s’explique enfin par les règles communes de la raison et de la politique.
La série des événements qui se rattachent à ces négociations sert à compléter l’histoire des croisades ; mais la part qu’elles ont pu avoir dans la grande révolution morale qui ne tarda pas à s’opérer, les rapports qu’elles firent naître entre des peuples jusqu’alors inconnus les uns aux autres, sont des faits d’une importance plus générale et plus digne encore de fixer notre attention. Deux systèmes de civilisation s’étaient établis, étendus, perfectionnés, aux deux extrémités de l’ancien continent, par l’effet de causes indépendantes, sans communication, par conséquent sans influence mutuelle. Tout à coup les événements de la guerre et les combinaisons de la politique, mettent en contact ces deux grands corps, si longtemps étrangers l’un à l’autre. Les entrevues solennelles des ambassadeurs ne sont pas les seules occasions où il y eut entre eux des rapprochements ; d’autres plus obscures, mais encore plus efficaces, s’établirent par des ramifications inaperçues, mais innombrables, par les voyages d’une foule de particuliers, entraînés aux deux bouts du monde, dans des vues commerciales, à la suite des envoyés ou des armées. L’irruption des Mongols, en bouleversant tout, franchit toutes les distances, combla tous les intervalles, et rapprocha tous les peuples ; les événements de la guerre transportèrent des milliers d’individus à d’immenses distances des lieux où ils étaient nés. L’histoire a conservé le souvenir des voyages des rois, des ambassadeurs, de quelques Missionnaires. Sempad l’Orbélien, Hayton, roi d’Arménie, les deux David, rois de Géorgie, et plusieurs autres, furent conduits par des motifs politiques dans le fond de l’Asie. Yeroslaf, grand duc de Sousdal et vassal des Mongols, comme les autres princes russes, vint à Kara-Koroum, où il mourut empoisonné, dit-on, par la main même de l’impératrice, mère de l’empereur Gayouk. Beaucoup de religieux italiens, français, flamands, furent chargés de missions diplomatiques auprès du Grand-Khan. Des Mongols de distinction vinrent à Rome, à Barcelone, à Valence, à Lyon, à Paris, à Londres, à Northampton ; et un Franciscain du royaume de Naples fut archevêque de Péking. Son successeur fut un professeur de théologie de la Faculté de Paris. Mais combien d’autres personnages moins connus furent entraînés à la suite de ceux-là, ou comme esclaves, ou attirés par l’appât du gain, ou guidés par la curiosité, dans des contrées jusqu’alors inconnues ! Le hasard a conservé le nom de quelques-uns. Le premier envoyé qui vint trouver le roi de Hongrie de la part des Tartares, était un Anglais banni de son pays pour certains crimes, et qui, après avoir erré dans toute l’Asie, avait fini par prendre du service chez les Mongols. Un cordelier flamand rencontra dans le fond de la Tartarie une femme de Metz, nommée Paquette, qui avait été enlevée en Hongrie, un orfèvre parisien, dont le frère était établi à Paris sur le grand Pont, et un jeune homme des environs de Rouen, qui s’était trouvé à la prise de Belgrade ; il y vit aussi des Russes, des Hongrois et des Flamands. Un chantre, nommé Robert, après avoir parcouru l’Asie orientale, revint mourir dans la cathédrale de Chartres ; un Tartare était fournisseur de casques dans les armées de Philippe le Bel ; Jean de Plan Carpin trouva, près de Gayouk, un gentilhomme russe, qu’il nomme Temer, qui servait d’interprète ; plusieurs marchands de Breslaw, de Pologne, d’Autriche, l’accompagnèrent dans son voyage en Tartarie ; d’autres revinrent avec lui par la Russie ; c’étaient des Génois, des Pisans, des Vénitiens. Deux marchands de Venise, que le hasard avait conduits à Bokhara se laissèrent aller à suivre un ambassadeur mongol que Houlagou envoyait à Khoubilai ; ils séjournèrent plusieurs années tant en Chine qu’en Tartarie, revinrent avec des lettres du Grand-Khan pour le Pape, retournèrent auprès du Grand-Khan, emmenant avec eux le fils de l’un d’eux, le célèbre Marc Pol, et quittèrent encore une fois la cour de Khoubilai pour s’en revenir à Venise. Des voyages de ce genre ne furent pas moins fréquents dans le siècle suivant. De ce nombre sont ceux de Jean de Mandeville, médecin anglais, d’Oderic de Frioul, de Pegoletti, de Guillaume de Bouldeselle et de plusieurs autres. On peut bien croire que ceux dont la mémoire s’est conservée, ne sont que la moindre partie de ceux qui furent entrepris, et qu’il y eut, dans ce temps, plus de gens en état d’exécuter des courses lointaines que d’en écrire la relation. Beaucoup de ces aventuriers durent se fixer et mourir dans les contrées qu’ils étaient allés visiter. D’autres revinrent dans leur patrie, aussi obscurs qu’auparavant, mais l’imagination remplie de ce qu’ils avaient vu, le racontant à leur famille, l’exagérant sans doute, mais laissant autour d’eux, au milieu de fables ridicules, des souvenirs utiles et des traditions capables de fructifier. Ainsi furent déposées en Allemagne, en Italie, en France, dans les monastères, chez les seigneurs, et jusque dans les derniers rangs de la société, des semences précieuses destinées à germer un peu plus tard. Tous ces voyageurs ignorés, portant les arts de leur patrie dans les contrées lointaines, en rapportaient d’autres connaissances non moins précieuses, et faisaient, sans s’en apercevoir, des échanges plus avantageux que tous ceux du commerce. Par là, non seulement le trafic des soieries, des porcelaines, des denrées de l’Hindoustan, s’étendait et devenait plus praticable ; il s’ouvrait de nouvelles routes à l’industrie et à l’activité commerciale ; mais, ce qui valait mieux encore, des mœurs étrangères, des nations inconnues, des productions extraordinaires, venaient s’offrir en foule à l’esprit des Européens resserrés, depuis la chute de l’empire romain, dans un cercle trop étroit. On commença à compter pour quelque chose la plus belle, la plus peuplée, et la plus anciennement civilisée des quatre parties du monde. On songea à étudier les arts, les croyances, les idiomes des peuples qui l’habitaient ; et il fut même question d’établir une chaire de langue tartare dans l’Université de Paris. Des relations romanesques, bientôt discutées et approfondies, répandirent de toute part des notions plus justes et plus variées ; le monde sembla s’ouvrir du coté de l’Orient ; la géographie fit un pas immense ; l’ardeur pour les découvertes devint la forme nouvelle que revêtit l’esprit aventureux des Européens. L’idée d’un autre hémisphère cessa, quand le nôtre fut mieux connu, de se présenter à l’esprit comme un paradoxe dépourvu de toute vraisemblance ; et ce fut en allant à la recherche du Zipangri de Marc Pol, que Christophe Colomb découvrit le Nouveau-Monde.
Je m’écarterais trop de mon sujet, en recherchant quels furent, dans l’Orient, les effets de l’irruption des Mongols. La destruction du Khalifat, l’extermination des Bulgares, des Komans, et d’autres peuples septentrionaux. L’épuisement de la population de la haute Asie, si favorable à la réaction par laquelle les Russes, jadis vassaux des Tartares, ont à leur tour subjugué tous les nomades du Nord ; la soumission de la Chine à une domination étrangère, l’établissement définitif de la religion indienne au Thibet et dans la Tartarie : tous ces événements seraient dignes d’être étudiés en détail. Je ne m’arrêterai pas même à examiner quels peuvent avoir été, pour les nations de l’Asie orientale, les résultats des communications qu’elles eurent avec l’Occident. L’introduction des chiffres indiens à la Chine, la connaissance des méthodes astronomiques des Musulmans, la traduction du nouveau Testament et des Psaumes en langue mongole, faite par l’Archevêque latin de Khan-Balik (Péking), la fondation de la hiérarchie lamaïque, formée à l’imitation de la cour pontificale, et produite par la fusion qui s’opéra entre les débris du nestorianisme établi dans la Tartarie et les dogmes des Bouddhistes : voilà toutes les innovations dont il a pu rester quelques traces dans l’Asie orientale et, comme on voit, le commerce des Francs n’y entre que pour peu de chose. Les Asiatiques sont toujours punis du dédain qu’ils ont pour les connaissances des Européens, par le peu de fruit que ce dédain même leur permet d’en tirer. Pour me borner donc à ce qui concerne les occidentaux, et pour achever de justifier ce que j’ai dit en commençant ces Mémoires, que les effets des rapports qu’ils avaient eus dans le treizième siècle avec les peuples de la haute Asie, avaient contribué indirectement aux progrès de la civilisation européenne, je terminerai par une réflexion que je présenterai avec d’autant plus de confiance, qu’elle n’est pas entièrement nouvelle, et que cependant les faits que nous venons d’étudier semblent propres à lui prêter un appui qu’elle n’avait pas auparavant.
Avant l’établissement des rapports que les croisades d’abord, et plus encore l’irruption des Mongols, firent naître entre les nations de l’Orient et de l’Occident, la plupart de ces inventions qui ont signalé la fin du moyen âge, étaient depuis des siècles connues des Asiatiques. La polarité de l’aimant avait été observée et mis en œuvre à la Chine, dès les époques les plus reculées. Les poudres explosives ont été de tout temps connues des Hindous et des Chinois. Ces derniers avaient, au dixième siècle, des chars à foudre qui paraissent avoir été des canons. Il est difficile de voir autre chose dans les pierriers à feu, dont il est si souvent parlé dans l’histoire des Mongols. Houlagou, partant pour la Perse, avait dans son armée un corps d’artilleurs chinois. D’un autre coté, l’édition princeps des livres classiques, gravée en planches de bois, est de l’an 952. L’établissement du papier-monnaie et des comptoirs pour le change, eut lieu chez les Jou-Tchen l’an 1154 ; l’usage de la monnaie de papier fut adopté par les Mongols établis à la Chine ; elle a été connue des Persans sous le nom même que les Chinois lui donnent, et Josaphat Barbaro apprit en 1450 d’un Tartare intelligent, qu’il rencontra à Asof et qui avait été en ambassade à la Chine, que cette sorte de monnaie y était imprimée chaque année con nuova stampa ; et l’expression est assez remarquable pour l’époque où Barbaro fit cette observation. Enfin les cartes à jouer, dont tant de savants ne se seraient pas occupés de rechercher l’origine, si elle ne marquait l’une des premières applications de l’art de graver en bois, furent imaginées à la Chine l’an 1120.
Il y a d’ailleurs, dans les commencements de chacune de ces inventions, des traits particuliers qui semblent propres à en faire découvrir l’origine. Je ne parlerai point de la boussole, dont Hager me paraît avoir soutenu victorieusement l’antiquité à la Chine, mais qui a dû passer en Europe par l’effet des croisades, antérieurement à l’irruption des Mongols, comme le prouvent le fameux passage de Jacques de Vitry et quelques autres. Mais les plus anciennes cartes à jouer, celles du jeu de tarots, ont une analogie marquée par leur forme, les dessins qu’elles offrent, leur grandeur, leur nombre, avec les cartes dont se servent les Chinois. Les canons furent les premières armes à feu dont on fit usage en Europe ; ce sont aussi, à ce qu’il paraît, les seules que les Chinois connussent à cette époque. La question relative au papier-monnaie, parait avoir été envisagée sous son véritable jour par M. Langlés, et après lui par Rager. Les premières planches dont on s’est servi pour imprimer étaient de bois et stéréotypées, comme celles des Chinois ; et rien n’est plus naturel que de supposer que quelque livre venu de la Chine a pu en donner l’idée : cela ne serait pas plus étonnant que le fragment de Bible en lettres gothiques, que le Père Martini trouva chez un Chinois de Tchang- Tcheou Fou. Nous avons l’exemple d’un autre usage, qui a manifestement suivi la même route ; c’est celui du Souan Pan ou de la machine arithmétique des Chinois, qui a été sans aucun doute apportée en Europe par les Tartares de l’armée de Batou, et qui s’est tellement répandue en Russie et en Pologne, que les femmes du peuple qui ne savent pas lire, ne se servent pas d’autre chose pour les comptes de leur ménage et les opérations du petit commerce. La conjecture qui donne une origine chinoise à l’idée primitive de la typographie européenne, est si naturelle, qu’elle a été proposée avant même qu’on eût pu recueillir toutes les circonstances qui la rendent si probable : c’est l’idée de Paul Jove et de Mendoça, qui pensent qu’un livre chinois put être apporté, avant l’arrivée des Portugais aux Indes, par l’entremise des Scythes et des Moscovites. Elle a été développée par un Anglais anonyme ; et si l’on a soin de mettre de côté l’impression en caractères mobiles, qui est bien certainement une invention particulière aux Européens, on ne voit pas ce qu’on pourrait opposer à une hypothèse qui offre une si grande vraisemblance.
Mais cette supposition acquiert un bien plus haut degré de probabilité, si on l’applique à l’ensemble des découvertes dont il est question. Toutes avaient été faites dans l’Asie orientale, toutes étaient ignorées dans l’occident.
La communication a lieu ; elle se prolonge pendant un siècle et demi ; et un autre siècle à peine écoulé toutes se trouvent connues en Europe. Leur source est enveloppée de nuages ; le pays où elles se montrent, les hommes qui les ont produites, sont également un sujet de doute ; ce ne sont pas les contrées éclairées qui en sont le théâtre ; ce ne sont point des savants qui en sont les auteurs : des gens du peuple, des artisans obscurs font coup sur coup briller ces lumières inattendues. Rien ne semble mieux montrer les effets d’une communication ; rien n’est mieux d’accord avec ce que nous avons dit plus haut, de ces canaux invisibles, de ces ramifications inaperçues, par où les connaissances des peuples orientaux avaient pu pénétrer dans notre Europe. La plupart de ces inventions se présentent d’abord dans l’état d’enfance où les ont laissées les Asiatiques, et cette circonstance nous permet à peine de conserver quelques doutes sur leur origine.
Les unes sont immédiatement mises en pratique ; d’autres demeurent quelque temps enveloppées dans une obscurité qui nous dérobe leur marche, et sont prises, à leur apparition, pour des découvertes nouvelles ; toutes bientôt perfectionnées, et comme fécondées par le génie des Européens, agissent ensemble, et communiquent à l’intelligence humaine le plus grand mouvement dont on ait conservé le souvenir. Ainsi, par ce choc des peuples, se dissipèrent les ténèbres du moyen âge. Des catastrophes, dont l’espèce humaine semblait n’avoir qu’à s’affliger, servirent à la réveiller de la léthargie où elle était depuis des siècles ; et la destruction de vingt empires fut le prix auquel la Providence accorda à l’Europe les lumières de la civilisation actuelle.
Abel Rémusat. Mémoires. 1824
3 09 1260
En Galilée, dans la vallée de Jezreel, aux environs du village d’Aïn Jalout, l’armée de Kitbouka, lieutenant de Houlagou reparti contrer d’autres dangers à l’est, se heurte à celle de Al Muzaffar Qutuz, sultan du Caire et son brillant chef de guerre Baibars : la cavalerie mongole est exterminée, Kitbouka décapité. Cinq jours plus tard, les cavaliers mamelouks entrent en libérateurs dans Damas en liesse.
23 10 1260
Baïbars tue Al Muzaffar Qutuz d’un coup d’épée, et de ce fait devient sultan.
1260
Blazena Vilemina, – alias Guillemette de Bohême – arrive à Milan, repaire d’hérétiques de tous poils : elle a cinquante ans, est fille de Constance de Hongrie et de Premislas I°, roi de Bohême. Elle y mourra vingt et un ans plus tard, considérée comme sainte, enterrée en grande pompe dans l’abbaye de Chiaravalle.
1261
Michel VIII, fondateur de la dynastie byzantine des Paléologues, reprend Constantinople aux Latins. Mais Byzance est amputée de la plus grande partie du Péloponnèse, des îles grecques et Constantinople, la ville la plus riche du Moyen Age, compte encore 150 000 habitants mais est ruinée. Les Mamelouks du Caire prennent le contrôle de Jérusalem ; ils vont le garder pendant 250 ans.
1264
Le revers des armes a poussé Brunetto Latini, florentin, guelfe et diplomate, à se réfugier en France. Il y écrit Le livre du Trésor, en picard, assise de la langue d’oïl, en se justifiant de ce choix : Et si certains se demandaient pourquoi ce livre est écrit en roman selon le langage des Français puisque nous sommes Italien, je dirai que c’est pour deux raisons : l’une c’est car nous sommes en France, et l’autre parce que la parlure de France est plus délectable et plus commune à toute gens.
18 05 1265
Baibars reprend Antioche à Bohémond et rase la ville, massacre la population, réduisant en esclavage les survivants.
1267
Le français s’impose aux classes cultivées de l’Europe : l’Italien Brunetto Latini écrit en français son encyclopédie, le Livre dou Trésor. Moshé Rambam établit la première communauté juive à Jérusalem depuis leur dispersion en 70. Les pairs de France, les vassaux les plus proches du roi, sont au nombre de douze : les ducs de Bourgogne, Aquitaine, Normandie, les comtes de Flandre, Saint Gilles, Champagne, les évêques de Langres, Laon, Châlons, Beauvais, Noyon, et l’archevêque de Reims.
1269
On compte environ 100 000 lépreux, rassemblés dans 2 000 léproseries, ou ladreries. Au XVIII° siècle, on ne comptera plus que quelques foyers, les malades seront alors envoyés à Belle Île. Pierre Le Pèlerin de Maricourt publie Epistola de magnete où il tente d’expliquer le magnétisme. Il y fait mention aussi d’un miroir en verre.
25 08 1270
Saint Louis mène la huitième croisade contre Tunis, où il meurt de dysenterie, ou du typhus. Il laisse des Enseignements à son successeur : Cher fils, s’il advient que tu deviennes roi, prends soin d’avoir des qualités qui appartiennent aux rois, c’est-à-dire que, quoi qu’il arrive, tu ne t’écartes pas de la justice. Et s’il advient qu’il y ait une querelle entre un pauvre et un riche, soutiens de préférence le pauvre contre le riche jusqu’à ce que tu saches la vérité, et, quand tu la connaîtras, fais justice. Et, s’il advient que tu aies querelle contre quelqu’un d’autre, soutiens la querelle de l’adversaire devant ton conseil...
*****
Pourquoi Louis IX prend-il à nouveau la croix en 1267 ? Et pourquoi viser Carthage, cible restée secrète jusqu’au dernier moment ? Les historiens en discutent encore, avec toutefois la sourde conviction que la géopolitique cède le pas à un projet idéologique nouveau porté par les ordres mendiants depuis un demi-siècle : chercher la conversion de l’émir hafside al-Mustancir, qui venait de se proclamer calife à la faveur de la chute des Abbassides, terrassés par les Mongols à Bagdad en 1258, est comme l’adoption de l’ambition missionnaire de François d’Assise, allant au-devant du sultan al-Kamil en 1219. Au minimum, il s’agissait d’appuyer la prédication locale des dominicains qui avaient fondé un studium arabicum en 1250 à Tunis, brutalement fermé en 1267 précisément. Le roi se sait par ailleurs malade et il lui faut racheter son échec en Égypte : mourir en terre infidèle ouvrirait la voie au martyr.
La mort du roi est d’abord une nouvelle naissance, d’autant plus troublante qu’elle coïncide avec le jour où, vingt-deux ans plus tôt, Louis IX quittait Aigues-Mortes et la France pour une première croisade achevée le 24 avril 1254, le jour anniversaire de sa naissance. Transfigurée en une croisade perpétuelle, la mort en terre non chrétienne est rigoureusement mise en scène par des gestes (lit de cendres) et des paroles d’imitation christique. Jacques le Goff a souligné combien la dernière parole du roi – Père, je remets mon âme entre tes mains – rapportées dès 1272 par le confesseur Geoffroy de Beaulieu, achevait le programme d’identification messianique du souverain français, amorcé en 1238 par l’acquisition de la couronne d’épines du Christ et la construction consécutive de la Sainte Chapelle. En 1239, le pape désigne Louis IX comme Dei filius, alors qu’il condamne à la déposition l’empereur Frédéric II, assimilé à l’Antéchrist. En marge du Saint Empire, la royauté française élabore sa propre mission universelle : transposée dans un projet dynastique, et bientôt national, la royauté de Jérusalem est désormais réalisable ici et maintenant dans un morceau d’Extrême-Occident ouvert sur les mers. Le passage de 1270 voit d’ailleurs la mise en œuvre d’une première flotte autonome, avec la construction de vaisseaux permanents et la création d’une charge d’amiral de France, bel exemple de transfert linguistique de l’émir arabe dans la langue française. Fondation mythique, cartes, mais qui sera remobilisée lors de la mise en œuvre d’une véritable Marine royale – tous les ports français se couvriront d’églises Saint Louis, de Rochefort (1686) à Toulon (1707), de Brest (1702) à La Rochelle (1741), avant la création d’un Port Saint Louis du Rhône (1737) ou d’une église Saint Louis à la Roche-sur-Yon napoléonienne (1808).
Yann Potin. Histoire Mondiale de la France, sous la direction de Patrick Boucheron et 132 auteurs encadrés par Nicolas Delalande, Florian Mazel, Yann Potin, Pierre Singaravélou. Seuil 2018
Toutes ces croisades avaient coûté cher : Saint Louis fut le premier à avoir endetté lourdement l’État. Commence alors l’histoire de sa dépouille, longue histoire dont le principal rebondissement sera la sanctification de la personne du roi en 1297, provoquant une montée en flèche de la cote des reliques …
Jamais dans l’histoire le corps d’un roi de France n’a été autant déchiqueté, éparpillé, disséminé que celui de saint Louis. Le cœur est à un endroit, les entrailles à un autre, tandis que les os de son squelette, devenus des reliques, sont conservés dans des dizaines de cathédrales, de monastères et de musées en Europe, et même en Amérique du Nord. Ici un humérus, là une dent, et encore là une côte. Si, aujourd’hui, Louis IX voulait ressusciter avec un corps présentable, il lui faudrait accomplir un marathon de plusieurs milliers de kilomètres pour reconstituer intégralement son squelette.
Le 22 mai 1271, les restes de Louis IX, mort devant Carthage, arrivent en grande pompe à la basilique de Saint-Denis pour y être inhumés. Le cercueil est porté par le nouveau roi de France, Philippe III le Hardi, et ses frères. Tous les plus hauts dignitaires civils et religieux sont présents dans le cortège, tous les corps de métier sont représentés. L’émotion est énorme et la foule, immense. C’est alors que se produit un contretemps incroyable : le cortège se heurte à la porte close de l’abbaye. L’abbé de Saint-Denis refuse d’ouvrir tant que l’archevêque de Sens et l’évêque de Paris portent leurs ornements sacerdotaux, ce qu’il interprète comme une atteinte à ses privilèges ! Ici, il est chez lui, et ces curés n’ont pas à arborer leurs vêtements liturgiques. On parlemente de part et d’autre, Philippe III le Hardi laisse les hommes d’Église s’étriper entre eux. Finalement, les deux prêtres acceptent d’abandonner leurs chasubles pour que la cérémonie puisse se dérouler. Mais l’autre ne l’emportera pas au paradis… Après une longue et émouvante cérémonie, la dépouille de Louis IX est finalement inhumée sous une simple dalle de pierre.
La dépouille ? C’est un bien grand mot. En réalité, c’est un sac d’os qui a été rapporté d’Afrique du Nord. En effet, à la mort du roi, le 25 août 1270, personne dans son entourage ne connaît les secrets de la momification. Or, avec la chaleur qu’il fait, il ne peut être question de la glisser telle quelle dans un cercueil. L’enterrer en terre musulmane ? Hors de question ! Charles d’Anjou, frère de Louis IX, n’a pas vraiment le choix : faire un pot-au-feu avec le corps pour en récupérer le squelette. [ce qui était pratique courante : tous les croisés morts en Terre sainte étaient ainsi rapatriés. ndlr] Les chirurgiens entrent en cuisine : ils commencent par prélever le cœur et les entrailles pour les serrer dans deux pots séparés. Ils jettent ensuite le reste du corps dans un grand chaudron contenant du vin et de l’eau salée. Pas d’oignons ni de carottes, apparemment… Après plusieurs heures de cuisson, la chair se détache toute seule des os comme sur un gigot de sept heures. Les ossements sont mis à sécher au soleil avant d’être pieusement enfermés dans un sac en cuir. Quant à la chair, elle est déposée dans une urne close. Voilà Louis IX paré pour un long voyage vers la basilique de Saint-Denis.
Malheureusement il n’y arrivera pas en entier, car on se dispute déjà ses bons morceaux. Les chairs sont inhumées à proximité de Palerme, dans la cathédrale de Monreale consacrée quatre ans plus tôt. Seuls les ossements et le cœur prennent donc la route de Paris, atteint le 21 mai 1271 après plusieurs mois de trajet. Le lendemain, c’est donc l’inhumation à l’abbaye de Saint-Denis, mais le repos éternel n’est pas encore promis à celui qui sera canonisé en 1297.
Car, en devenant saint, Louis IX acquiert une valeur marchande. Au Moyen Âge, le trafic des reliques est un commerce en plein expansion. Philippe le Bel fait exhumer les ossement de son grand-père le 25 août 1298 afin de les déposer dans une superbe châsse digne de sa promotion papale. La grande distribution des reliques peut alors commencer. Mais, avant cela, Philippe le Bel désire rapatrier saint Louis dans son palais de la Cité qu’il a agrandi et embelli. Le pape donne son accord à la condition qu’un bras ou un tibia soit laissé à l’abbaye de Saint-Denis. Mais l’abbé refuse le deal. Pas question de se laisser dépouiller. En 1305, le roi de France revient à la charge auprès du nouveau pape, Clément V. Celui-ci coupe la poire en deux : il lui accorde le crâne, mais demande que le menton, la mâchoire inférieure et les dents restent à Saint-Denis. Le transfert a lieu le 17 mai 1306. On en profite pour abandonner une côte à l’évêque de Paris pour l’exposer à Notre-Dame. Il se dit que le cœur royal aurait également fait partie du transfert vers la Sainte-Chapelle.
Au cours du siècle qui suit, c’est la grande distribution : des phalanges pour le roi de Norvège, des fragments de côte pour les dominicains de Paris et de Reims, les abbayes de Pontoise et de Royaumont. Des fragments divers sont remis à la reine Blanche de Suède et à l’empereur Charles IV, lors de leur passage à Paris. Lorsqu’en 1392 les ossements restant à Saint-Denis sont déposés dans une nouvelle châsse, on en profite pour distribuer trois côtes : une pour le pape, une pour le duc de Berry, et la dernière pour le duc de Bourgogne. Les prélats présents à la cérémonie reçoivent pour leur peine un morceau d’os, à charge de se le partager entre eux. Plus tard encore, des éclats sont remis à Louis VII de Bavière. Quelques mois après l’assassinat d’Henri IV, son épouse, Marie de Médicis, reçoit à son tour un os, mais le restitue lors du sacre de son fils Louis XIII. Six ans plus tard, sa belle-fille, Anne d’Autriche, 15 ans, est furieuse de ne recevoir qu’un morceau de côte, aussi l’année d’après a-t-elle droit à sa côte entière. Et elle fait obtenir à ses amis jésuites encore une côte et même un os du bras.
Lorsqu’en 1793 les sans-culottes viennent vider les tombeaux de l’abbaye de Saint-Denis, les reliquaires contenant les ossements de saint Louis sont emportés pour être fondus. Seule la mâchoire est sauvée et se trouve aujourd’hui encore dans le trésor de Notre-Dame. Tout le reste, y compris le crâne que Louis XVI avait restitué à Saint-Denis, a disparu. Où ? Dieu seul le sait et il n’est pas près de parler. Mais il est tout à fait possible que quelques-uns des révolutionnaires qui ont participé au sac de l’abbaye aient emporté en douce quelques morceaux d’os. Fouillez vos greniers !
Frédéric Lewino, Gwendoline dos Santos. Le Point 21 mai 2012
1270
La dynastie Zagoué est renversée en Éthiopie, et c’est Yikunno Amlak, du pays Choa, qui monte sur le trône : il se prétend alors descendant de Salomon et de la Reine de Saba : vrai, faux ? peu importe, l’essentiel, c’est qu’on le croie, et on le croie. Ainsi commence l’histoire de la communauté Beta Israël, les Falacha. Son petit-fils, Amda Seyon sera le plus grand roi guerrier de l’Éthiopie, qui agrandira son pays de tous côtés. Les chroniques royales et les documents ecclésiastiques nous ont bien renseignés sur la vie éthiopienne d’alors. Le paysan entourait sa maison d’anneaux concentriques de cultures de moins en moins intensives et au-delà se défendait comme il pouvait des forces naturelles. Mais Saint Takla Haymanot, abbé du Choa leur conseillaient la patience en cas de pillage des récoltes par les animaux : Laissez-les tranquilles, car c’est nous qui avons envahi leur habitat, et non eux le nôtre ; cependant, comme il y a des limites à tout, quand un gros singe dépouille une pauvre veuve, cela devient : Par la parole du Dieu que je sers, que tu sois retenu prisonnier, toi parmi toutes les bêtes du désert, car tu as dépassé les limites qui t’ont été fixées.
vers 1270
Des poèmes qui nous sont parvenus, cette complainte est sans doute la plus ancienne.
Que sont mes amis devenus
Que j’avais de si près tenus
Et tant aimés
Ils ont été trop clairsemés
Je crois le vent les a ôtés
L’amour est morte
Ce sont amis que vent emporte
Et il ventait devant ma porte
Les emporta
Avec le temps qu’arbre défeuille
Quand il ne reste en branche feuille
Que n’aille à terre
Avec pauvreté qui m’atterre
Qui de partout me fait la guerre
L’amour est morte
Ne convient pas que vous raconte
Comment je me suis mis à honte
En quelle manière
Que sont mes amis devenus
Que j’avais de si près tenus
Et tant aimés
Ils ont été trop clairsemés
Je crois le vent les a ôtés
L’amour est morte
Ce sont amis que vent emporte
Et il ventait devant ma porte
Les emporta
Pauvre sens et pauvre mémoire
M’a Dieu donné le Roi de gloire
Et pauvre rente
Et froid au cul quand bise vente
Le vent me vient le vent m’évente
L’amour est morte
Le mal ne sait pas seul venir
Tout ce qui m’était à venir
M’est avenu
Rutebeuf vers 1225 – 1285
S’il se posait des questions sur le devenir de ses amis, il avait des réponses sur celui des Dominicains – nommés aussi Jacobins – comme sur celui des Franciscains :
Les Dominicains
Les Jacobins sont si prudhommes
Qu’ils ont Paris et qu’ils ont Rome
Ils sont à la fois rois et papes,
Et de biens ils ont grand somme.
Celui qui meurt et ne les nomme
Ses exécuteurs perd son âme.
Ils sont apôtres par parole :
Bien profitèrent de leur école
Les Franciscains
Humilité était petite
Que pour eux ils avaient choisie.
Humilité a bien grandi,
Car les frères sont les seigneurs
Des rois, des prélats et des comtes.
Humilité chasse l’orgueil,
C’est bien le droit et la raison
Que si grande dame ait grands maisons
Et beaux parloirs et belles salles
Il n’est pas non plus chaud partisan de la croisade : On peut bien gagner Dieu sans bouger de son pays, en vivant de son héritage. Je ne fais de tort à personne. Si je pars, que deviendront ma femme et mes enfants ? Il sera temps de se battre quand le soudan viendra ici.
Jean d’Avesne 1248 – 1304, un autre poète, reste plus attaché à la simple joie de vivre qui, faute de télévision, a tout loisir pour s’exprimer à la veillée :
| Et pour vous faire entendre que ma parole soit veritable, | Et pour vous prouver que je dis la vérité, | |
| je vous declaire qu’en ce tampz cy l’en y fait la sairie à laquelle femmez, fillez, jonez, viellez, marieez et à marier, viennent. | je vous affirme que, en cette saison de l’année, on s’y réunit à la veillée : les femmes et les filles, jeunes et vieilles, mariées ou à marier, y viennent ; | |
| Desquellez là l’une pigne, l’autre fille, l’aultre garde, l’aultre desvuide | l’une peigne la laine, l’autre file, une autre carde, une autre dévide sa quenouille | |
| et, en faisant sa besognette, ellez chantent, rient, | et, tout en travaillant – chacune étant occupée à sa besogne – toutes ensemble, elles chantent et rient ; | |
| puis parlent de leurs amours avec bouviers, parquiers, vacquiers | ensuite, elles racontent leurs amours avec les bouviers, les porchers, les vachers | |
| et avec moy quy suy le mieux amé des aultrez. | et surtout avec moi qu’elles aiment bien plus que tous les autres. | |
| Et à brief dire quant nous sommes tous assemblez, | Et pour dire les choses en peu de mots, quand nous sommes tous réunis, | |
| il n’est point de tel soulas que de ouir nos bons motz. | je ne connais pas de plus grand bonheur que d’entendre les plaisanteries qui se disent à cette veillée. |
Le beau langage est bien celui de Paris, et d’aucuns éprouvent le besoin de s’excuser de ne pas le parler : ainsi de Jean de Meun, dans son prologue de la traduction de la Consolation de Philosophie de Boèce :
| Si m’escuse de mon langage | Je m’excuse de mon langage, |
| Rude, malostru et sauvage, | rustre, grossier et sauvage, |
| Car nés ne suis pas de Paris, | mais je ne suis pas né à Paris |
| Ne se cointes con fut Paris ; | et ne suis pas aussi sage que le fut Pâris ; |
| Mais me rapporte et me compère | je reproduis et reprend |
| Au parler que m’aprist ma mere | le parler que ma mère m’a appris |
| A Meün quand je l’alaitoie, | à Meun [proche d’Orléans], quand elle m’allaitait ; |
| Dont mes parlers ne s’en desvoie. | mon parler ne s’en écarte pas. |
Le royaume de Grenade s’est constitué en 1232, lors de la dislocation de l’empire des Almohades : il contrôlait alors Cordoue, Séville et Jaén. Depuis 1270, Grenade – Al Andalus – était la dernière place musulmane d’Espagne.
Le pluralisme religieux y anime la vie sociale comme dans toute l’Espagne musulmane, mais sur une base inégalitaire ; si les chrétiens soumis – les dhimmis – ne s’acquittent pas de l’impôt, ils risquent l’esclavage ou la mort. Ils sont obligés de porter des vêtements distinctifs qui ne soit ni rouge ni vert, leurs savates doivent être plus courtes que le pied ; fils n’ont droit qu’à une bougie pour sortir la nuit. Posséder des armes ou monter à cheval leur est interdit. Ils doivent l’hospitalité gratuite à tout musulman qui l’exige. Sur la voie publique, ils doivent céder le pas aux musulmans et baiser la main du cadi, le juge sous la régence ottomane. Leurs maisons doivent être plus basses que celle des musulmans. Leur culte est autorisé, mais ils ne peuvent ni bâtir une nouvelle église, ni sonner les cloches, ni effectuer de processions, ni exposer une croix ou du vin. Tout prosélytisme est réprimé. Le musulman qui se convertit en secret au christianisme encourt la peine de mort. Il n’y a pas tolérance mais coexistence.
En dépit et au-dessus de tout cela, pour le Roi de Castille et Leon, astronome-poète, Alphonse X [1254 – 1284] l’Espagne, possède tout ce qu’il faut pour que ce soit le Paradis :
Et chaque pays du monde et chaque province fut honoré par Dieu à sa façon et reçut ses dons de Lui ; mais parmi tous les pays, celui qu’il honora le plus fut l’Espagne de l’Occident ; car Il la combla de tout ce que l’homme convoite. Car depuis que les Goths erraient par tous les pays, les mettant à l’épreuve des guerres et des batailles, conquérant de nombreuses provinces en Asie et en Europe, essayant mainte demeure en chacune et considérant bien et choisissant parmi toutes la plus avantageuse, ils trouvèrent que l’Espagne était la meilleure de toutes et l’estimèrent plus que les autres, car, plus que toutes, l’Espagne est une terre d’abondance et de richesses. En outre, elle est fermée sur tout son pourtour. Oui, cette Espagne que nous disons est semblable au paradis de Dieu, car elle est arrosée de cinq grands fleuves. L’Espagne a des moissons abondantes, des fruits délicieux, des poissons variés, des laits et des fromages savoureux, elle regorge de gibier et de bétail ; heureuse dans ses maisons, bien assise sur ses mulets, à l’abri dans ses nombreux châteaux, animée par ses bons vins, bien nourrie grâce au pain abondant, elle est riche en métaux : plomb, étain, vif argent, fer, cuivre, argent, or, et en pierres précieuses ; elle a des carrières de marbre, les sels de la mer et de ses mines et les autres ressources de son sol : pierre bleue, ocre, argile, alun, et bien d’autres encore ; elle s’enorgueillit de sa soie et de ses soieries, s’égaye de son safran, s’éclaire de sa cire ; elle a le miel et le sucre, et l’huile en abondance. L’Espagne est ingénieuse entre toutes, hardie et forte à la lutte, légère au travail, loyale envers le Seigneur, persévérante à l’étude, courtoise en son parler, riche de qualités ; il n’est pas de pays au monde qui rivalise avec elle pour l’abondance ou l’égale pour le nombre des forteresses ; il en est peu qui soient aussi grands qu’elle. L’Espagne les dépasse tous par sa grandeur et, de tous, c’est elle la plus prisée pour sa loyauté. Ah ! Espagne ! Il n’est pas de langue ni d’esprit pour dire tes mérites.
Et c’est ce royaume si noble, si riche, si puissant, si plein d’honneur qui d’un seul coup fut dévasté par la discorde de ses fils qui prirent les armes les uns contre les autres, comme s’ils n’avaient pas eu d’ennemis ; et c’est ainsi qu’ils perdirent tout, car toutes les cités de l’Espagne tombèrent aux mains des Maures, et furent détruites par eux.
Alphonse X Éloge de l’Espagne et comment elle regorge de tous les biens.
03 1271
Baibars reprend Hosn-al-akrad, autrement dit le Krak des Chevaliers.


1271
Marco Polo, fils de Niccolo, marchand de Venise, a 17 ans. Lui-même serait né sur l’île dalmate de Korçula, (aujourd’hui croate) ; son oncle vit à Constantinople où il possède une maison de commerce ; il a ouvert une succursale en Crimée, à Soudak que son père et un troisième oncle décident de gérer. Tous deux rentrent d’un voyage en orient et y repartent en l’emmenant. Ils passent par Bagdad, Ormuz à l’entrée du Golfe persique et de là, partent par voie de terre au nord-est.
Les frères Nicolo et Marfeo se rendent une première fois à la cour du souverain de la Horde d’Or, par le même itinéraire que les Franciscains qui les ont précédés (Guillaume de Rubrouck). De là, ils gagnent Boukhara où ils séjournent trois ans. Ne pouvant revenir sur Constantinople (d’où ils sont partis en 1260) en raison des guerres entre tribus mongoles, ils se joignent à une ambassade envoyée par le souverain mongol de Perse auprès de Kubilay, à Pékin. Ils empruntent un itinéraire passant par le Syr-Daria, la vallée de l’Ili, longent les Tian-Shan, et rejoignent le Gansu. Ayant quitté la Chine en 1266, ils arrivèrent à Saint Jean d’Acre en 1269. C’est grâce au récit du fils de Nicolo, Marco, que nous connaissons cet itinéraire. Il est vraisemblable que bien d’autres voyageurs de cette époque ont réalisé ces mêmes traversées continentales, mais sans en laisser de traces.
Quand les deux hommes repartent d’Acre à la fin de 1271, Marco Polo accompagne son père et son oncle. Ils devaient à l’origine passer par la mer jusqu’aux ports de mer de Chine du Sud. Mais, avertis des difficultés qu’ils auraient dans ces régions où s’affrontaient les Mongols et les dernières armées de la dynastie de Song, ils préférèrent rejoindre l’Asie centrale à partir d’Ormuz. C’est cet itinéraire que Marco Polo décrit, passant par le Wakhan, Kachgar et la ligne sud des oasis du Takla-Makan, Yarkand (Yarcan), Khotan (Cotan), Keriya (Pem), Qarqan (Ciarcan), pour arriver ensuite au sud du Lob Nor, et, après avoir traversé une zone désertique, Saciu, l’actuel Dunhuang. Plus de six siècles après leur passage, les grands voyageurs, parmi lesquels Sven Hedin ou Aurel Stein, ne manqueront pas d’évoquer les récits du Vénitien.
Michel Jan. Le voyage en Asie Centrale et au Tibet. Anthologie des voyageurs occidentaux du Moyen-Âge à la première moitié du XX° siècle. Bouquins Robert Laffont 1992
Il ne dit pas grand bien des navires arabes cousus et non cloués : Leurs bateaux sont très mauvais et un grand nombre d’entre eux chavirent, parce qu’ils ne sont pas assemblés avec des clous de fer mais cousus avec de la ficelle d’écorce de noix de coco. Ils détrempent la bourre jusqu’à ce qu’elle prenne la texture du crin de cheval, puis ils en font des cordes et ils cousent leurs bateaux […], c’est la raison pour laquelle faire voile dans ces embarcations est une entreprise aussi périlleuse. Et vous pouvez me croire : il y en a beaucoup qui coulent, car l’océan indien est souvent sujet aux tempêtes.
Marco Polo ne pouvait savoir que les Arabes, en l’absence de bois propres à la construction navale chez eux, se fournissaient en Inde où ils utilisaient un bois très fendif : l’aïni, d’où le développement d’une technique qui permette de se passer de clou. Il est le premier européen à repérer un gisement de pétrole – en latin, petroleum : l’huile de pierre – :
Aux abords de la Caspienne, il y a une fontaine d’où sourd une liqueur telle qu’huile… elle est bonne à brûler et pour oindre les hommes et animaux galeux. Ils traverseront le Pamir où je vous dis qu’à cause du grand froid, le feu n’est pas aussi clair et brûlant, ni de la même couleur que dans les autres lieux, et les aliments cuisent mal. […] Là, ne sont aucuns oiseaux, à raison de la hauteur et du froid intense et pour ce qu’ils n’y pourraient rien trouver à manger.
Après le Pamir, ils rejoignirent la route des caravanes par le nord du Cachemire, pour arriver au désert de Gobi. Dans le désert de Lop (méridien de Dacca, parallèle de Pékin), il entend chanter le sable qui descend les dunes : des hommes oient ces voix d’esprit, et il vous semble maintes fois que vous oyez résonner dans l’air maints instruments de musique et notamment des tambours, et le choc des armes. Ils traversèrent encore les steppes de Mongolie, et parvinrent après trois ans et demi de voyages, à la cour de Koubilaï, le Grand Khan. Ce dernier, grand admirateur de la civilisation chinoise, ne cherchait en rien à la détruire : il conservait l’administration, organisait la lutte contre la famine, remettait en état le Grand Canal ; il abandonne la capitale ancestrale de Karakorum pour construire Khanbalik, à partir de 1260, l’actuelle Pékin. Il décela rapidement chez le jeune Marco des talents aptes à satisfaire son insatiable curiosité et l’engagea pour l’envoyer en mission et lui rendre compte de tout ce qu’il avait découvert de nouveau. Son odyssée durera vingt quatre ans et le mènera dans tout l’empire.
La très nobilissime et magnifique cité qui, pour son excellence, importance et beauté, est nommé Kinsaï [aujourd’hui Hangzhou, en Chine du Nord] […] Kinsaï a cent milles de tour ou à peu près, parce que ses rues et ses canaux sont très larges. Il y a des places carrées où l’on tient des marchés et qui, vu la multitude des gens qui s’y rencontrent, sont nécessairement très vastes et spacieuses. […] Sur chacune de ces places, trois fois la semaine, se réunissent quarante à cinquante mille personnes qui viennent au marché et apportent tout ce que vous pouvez désirer en fait de victuailles parce qu’il y en a toujours une grande abondance ; du gibier, chevreuil, cerf, daim, lièvre, lapin ; et des oiseaux : perdrix, faisans, francolins, cailles, volailles, chapons, et tant d’oies, et tant de canards, qu’on ne saurait dire davantage. Ils en attrapent tant dans ce lac que, pour un gros d’argent de Venise, vous pourriez acheter un couple d’oies ou deux paires de canard.
[…] Les courtisanes de Kinsaï sont extrêmement compétentes et accomplies dans l’usage des charmes et des caresses, et savent les mots qui répondent convenablement à chaque sorte de personne ; en sorte que les étrangers qui en ont une fois joui ne se possèdent plus du tout, et sont à ce point captivés par leur douceur et leur charme qu’en rentrant chez eux, ils disent qu’ils ont été au Kinsaï, c’est-à-dire dans la cité céleste, et c’est sans patience qu’ils attendent le moment où il leur sera donné d’y retourner.
[…] Les grandes dames et nobles de ce pays portent braies jusqu’aux pieds comme les hommes ainsi que vais vous dire, et les font de coton et de soie très fine, avec du musc dedans. Et elles bourrent beaucoup d’effets à l’intérieur de leurs braies. Il y a des dames qui, dans leurs braies, c’est-à-dire le vêtement des jambes, mettent bien cent brasses de très fins tissus de lin et de coton enroulés autour du corps comme langes, et certaines en mettent quatre-vingts, certaines soixante, selon leurs moyens, et elles les font bouffer tout autour. Ainsi font pour montrer qu’elles ont de grosses fesses et devenir belles, car leurs hommes se délectent de femmes rebondies, et celle qui paraît la plus renflée au-dessous de la ceinture leur semble plus belle que les autres. Et voilà racontées toutes les affaires de ce royaume ; nous allons le quitter et vous parler d’un autre peuple qui habite le Midi, à dix journées de voyage de cette province…
[…] Et encore vous dirai un autre merveilleux usage qu’ils ont et que j’avais oublié d’écrire. Sachez très véritablement que, quand ils sont deux hommes dont l’un ait eu un garçon, qui est mort – et il peut être mort à quatre ans, ou quand on veut avant l’âge du mariage – et un autre homme qui ait eu une fille, morte aussi avant l’âge nubile, ils font mariage des deux trépassés quand le garçon aurait eu l’âge de prendre femme. Ils donnent pour femme au garçon mort la fille morte, et en font dresser acte. Puis un nécromancien jette l’acte au feu, et le brûle; et voyant monter la fumée, disent qu’elle va à leurs enfants en l’autre monde et leur annonce leur mariage ; et que dorénavant le garçon mort et la fille morte en l’autre monde le savent et se tiennent pour mari et femme. Alors ils font une grande noce, et des viandes répandent quelque peu çà et là, disant qu’elles vont à leurs enfants en l’autre monde, et que la jeune épouse et le jeune mari ont reçu leur part de festin. Et ayant dressé deux images, l’une en forme de fille, l’autre en forme de garçon, les mettent sur une voiture aussi bellement adornée que possible. Tirée par des chevaux, elle promène ces deux images avec grande réjouissance et liesse à travers tous les environs ; puis ils la conduisent au feu et font brûler les deux images ; avec de grandes prières, ils supplient leurs dieux de faire que ce mariage soit réputé heureux en l’autre monde. Mais ils font aussi une autre chose : ils font des peintures et portraits sur papier à la semblance de cerfs et chevaux, d’autres animaux, d’habits de toute espèce, de besants, de meubles et d’ustensiles, et de tout ce que les parents conviennent de donner en dot, sans le faire en effet; puis font brûler ces images, et disent que leurs enfants auront toutes ces choses en l’autre monde. Cela fait, tous les parents de chacun des deux morts se tiennent pour alliés et maintiennent leur alliance aussi longtemps qu’ils vivent, tout comme si vivaient leurs enfants trépassés.
Le Devisement du monde.
Le Devisement du monde [1] et Le Livre des merveilles, seront écrits vers 1298 en français par un compagnon de cellule, Rusticien de Pise, Rustichello, prisonnier comme lui des Génois à la suite d’une bataille perdue au large de l’île de Korçula, en Dalmatie, entre Génois et Vénitiens [2]. Ces derniers, sceptiques et plutôt ingrats, se moqueront de lui, l’affublant du surnom de il millione – celui qui raconte qu’il a gagné des millions… à moins qu’il ne s’agisse du million de mensonges que contient son récit – ; et pendant bien longtemps, il n’y aura qu’une place portant ce nom pour qu’on se souvienne de lui : il fallut attendre l’avion pour que Venise donne son nom à l’aéroport. Ses détracteurs laisseront à la postérité le si juste se non e vero, e ben trovato .

Marco Polo, mosaïque du Palazzo Tursi, Gênes, 1867. La liberté ignore les serrures du temps et de l’espace.
Si l’Italie ne devait retenir qu’une chose de cette odyssée, ce serait l’adoption ad vitam aeternam, des nouilles que Marco Polo rapporta de Chine. Mais il avait rapporté aussi la poudre à canon, la porcelaine, – en italien, porcellana est un coquillage nacré – [en France de même : ils servaient de crachoir aux pestiférés de Marseille, pour être ensuite jetés en mer : les plongeurs en retrouvent souvent] – et bien d’autres choses que les Chinois connaissaient avant nous.
L’ouverture de la route du Cathay (la Chine, pour les chroniqueurs du Moyen Age) qui se fit en 1259 avec l’apogée de l’empire mongol prit fin avec la dislocation de ce dernier, amorcée par la prise du pouvoir en Chine par Tchou Yuan-tchang, fondateur de la dynastie des Ming, en 1368.
Le pape Clément IV est mort depuis trois ans, et les cardinaux, réunis à Viterbe, au N-O de Rome, n’en finissent plus de se mettre d’accord pour élire un nouveau pape : la population enferme les électeurs dans le palais épiscopal, en mure tous les accès et réduit les cardinaux au pain et à l’eau : le véritable conclave – cum clave : enfermé à clef – était né. Le pape élu, Grégoire X, légalisera trois ans plus tard les principes mis en œuvre par la population de Viterbe. Jusqu’au XI° siècle, c’est le clergé et les fidèles du diocèse de Rome qui choisissaient le pape. Ce n’est qu’à partir du XII° que l’élection fut réservée aux seuls cardinaux, qui se virent alors, par deux fois avant ce scandale de Viterbe, enfermés par la population pour accélérer l’élection, en 1216 et 1241.
vers 1272
La vigne est déjà très répandue : les vins d’Anjou s’exportent depuis longtemps en Angleterre, et du haut de Montmartre
La rivière de Saine vit qui molt estoit lée
Et d’une part et d’autre mainte vigne plantée
Adenet Le Roi.
laquelle vigne ne donnait pas vraiment un grand cru, mais la bonne ville de Paris, au vu de la couleur de ce petit blanc l’avait, nommé la Goutte d’or.
La population de la France poursuit sa croissance, et l’augmentation du rendement des céréales en est sans doute la principale explication : Pour un grain semé, les céréales rendaient en France 3 grains à la récolte, avant 1200 ; 4,3 entre 1300 et 1500 ; 6,3 entre 1500 et 1820.
Fernand Braudel. L’identité de la France. Arthaud Flammarion 1986
Certes, toujours à cause d’un cheptel peu développé, le fumier faisait souvent défaut, mais le marnage et le chaulage tendaient à se généraliser. Aussi les rendements, déjà en progression au XI° siècle, grimpèrent dans certaines régions, et, sur quelques domaines, jusqu’à sept à huit pour un en froment et neuf à dix pour un en avoine ! Pour l’époque, c’était énorme, et, il faut le dire, exceptionnel.
Claude Michelet. Histoire des paysans de France. Robert Laffont 1996
Tout l’élan qui fait progresser, aux dépens des friches, les prés, les champs et les vignobles, qui étend les faubourgs des villes, qui pousse les négociants aux foires, les chevaliers au combat et les Franciscains à la conquête des âmes, toute l’allégresse active qui anime l’âge nouveau, la théologie des cathédrales l’accompagne et la traduit. La création n’est pas achevée. Par ses œuvres, l’homme y coopère. Ainsi se trouve réhabilité, en même temps que la matière, le travail manuel. La pensée des maîtres de Paris et d’Oxford condamne le mépris du labeur que professaient les aristocraties aux époques de stagnation, et que Cluny, que Cîteaux même, en fin de compte, professaient encore. Alors que les parfaits cathares refusaient de mettre l’effort de leur corps au service de la matière, les humiliés de Lombardie, les petits frères de Saint François ont tous travaillé de leurs mains. Ils ont transformé le monde et contribué selon leur pouvoir à la création continue de l’univers – tout comme les défricheurs obscurs qui, en ce temps même, corrigeaient le cours des eaux et substituaient aux fourrés d’épines l’ordonnance des champs labourés. Dans les nouveaux manuels de confesseurs, toute profession est justifiée, qui se fonde sur le travail, et les moralistes se mettent à chercher des raisons pour justifier le profit. Aux portes des églises urbaines, les images des travaux manuels qui figurent chacune des saisons prennent tout leur sens dans la croissance économique du XIII° siècle. Et lorsque les maitres des corporations offrent une verrière, ils veulent y voir représentées par le menu les techniques de leur métier. Éloge, dans la cathédrale même, du travailleur conquérant.
Georges Duby. Le temps des cathédrales. Gallimard 1976
1273
Les Pyrénées séparent l’Espagne de la France et vérité en deçà, erreur au-delà. Les seigneurs, les grandes fortunes tiennent leur pouvoir beaucoup plus de l’élevage que de l’agriculture. En Castille, ils s’organisent pour réglementer la transhumance : interdiction est faite aux troupeaux de traverser les propriétés des nobles, des villes et des ordres monastiques, établissement de contrôle vétérinaire et de taxes : ce sont les Mestas, que l’on retrouvera aussi en Aragon. Elles resteront en vigueur jusqu’en 1839.
Le commerce lainier du Moyen Age en Espagne mérite une attention spéciale dans la mesure où il se fondait sur l’exploitation d’une race unique et particulièrement appréciée, le mouton mérinos, à laine blanche bouclée, introduit d’Afrique en Espagne par les musulmans (sa découverte tardive fut peut-être due à la médiocre qualité de sa viande). Mais les migrations semi-annuelles des moutons, la transhumance le long d’itinéraires fixes qui caractérisèrent l’histoire de la laine espagnole étaient déjà connues sous les Goths, probablement même sous les Ibères. En réalité, l’élevage du mouton dans le bassin méditerranéen se déroula pendant des centaines d’années selon le même schéma, provoquant presque toujours des querelles entre pasteurs et cultivateurs. Rome avait un préteur spécial chargé de la surveillance des routes de transhumance. Ces pratiques ne furent pas interrompues par la chute de l’Empire romain. Les monarques médiévaux en Italie comme en Espagne ne cherchèrent qu’à codifier des règles anciennes. L’Espagne du Moyen Age avait l’économie la plus pastorale d’Europe. Sur ses vastes prairies ne paissaient pas seulement des troupeaux de moutons, mais aussi des cochons et du bétail sauvage. Cette géographie correspondait mieux que l’exploitation aratoire au contexte d’une croisade perpétuelle, comme Macaulay devait qualifier le Moyen Age espagnol, et de frontières mouvantes. Le cycle migratoire de la transhumance des moutons passant l’hiver dans l’Estrémadure et le sud de la Castille, l’été dans les montagnes septentrionales, coïncidait avec l’alternance de la trêve hivernale et du combat estival. Ainsi, les pasteurs passèrent-ils toujours de la chrétienté en terre islamique. Vers 1400, l’Espagne exportait la laine crue dans toute l’Europe, notamment vers la Toscane, où les importations anglaises avaient au contraire diminué. Pour l’Espagne, la laine était devenue la source indispensable du revenu royal. L’État espagnol, selon les termes de l’historien du commerce lainier ibérique, Julius Klein, visait à une politique soigneusement conçue ayant pour objectif persistant, pour but unique, l’exportation des matières premières en échange desquelles pouvaient être obtenues les plus grandes quantités d’or et de marchandises étrangères.
Le commerce lainier espagnol était donc une affaire d’exportation, mais la péninsule n’avait pas d’industrie drapière propre. Le roi Ferdinand essaya d’en créer une en introduisant des réglementations détaillées concernant les guildes, allant même jusqu’à prescrire un système de production à l’anglaise, avec des qualités standard, des poids imposés et ainsi de suite, mais ces incitations restèrent sans effet. Les marchands étrangers parvinrent même à s’emparer de la vente de la laine avec permission royale et, au milieu de ce qu’il est convenu d’appeler le siècle d’or espagnol, les Génois obtinrent le monopole de l’exportation de la laine (comme celui de la vente d’esclaves à l’Empire espagnol). De grandes quantités furent ainsi vendues à l’Empire espagnol, tandis que la couverture de laine, ou serape, remplaçait la vieille monta de coton ou de fibre végétale de l’Amérique précolombienne.
L’échec des Espagnols à exploiter une aussi importante ressource naturelle doit être attribué à une célèbre institution espagnole qui, comme tant d’autres, devait se révéler une arme à double tranchant : la Mesta. Son histoire n’est pas seulement révélatrice de certaines causes de l’échec économique de l’Espagne du XVI° siècle, mais explique peut-être également pourquoi les peuples d’Amérique latine n’ont pu pleinement tirer profit de leur longue appartenance à la communauté européenne des grandes nations commerçantes.
La Mesta (le mot dérive soit de mezclado, – mélangé –, c’est-à-dire mélange de troupeaux différents ; soit de mecht, terme désignant les campements d’hiver en Afrique du Nord) était une guilde de propriétaires de moutons qui organisait les mouvements des troupeaux de leurs quartiers d’été à leurs quartiers d’hiver, du nord au sud et vice versa, le long de pâturages bien définis. La Mesta protégeait les éleveurs d’ovins contre les propriétaires terriens qui entreprenaient de clôturer des servitudes. Elle s’occupait du marquage des bêtes, déterminait le service des bergers, et fixait les étapes pour 2 600 000 moutons en 1479 (3 400 000 en 1526) qui remontaient ou redescendaient le pays sur quelque 300 à 500 kilomètres. La Mesta obtint sa première lettre de privilège en 1273 et survécut, quoique très affaiblie, jusqu’en 1839. Le parcours quotidien était parfois de vingt-cinq kilomètres, la moyenne de huit kilomètres, et la transhumance prenait habituellement un mois. La progression vers le sud était organisée de façon à coïncider avec les fiestas des villes intéressées et avec le temps des moissons.
Toute personne qui acquittait les droits de passage des moutons pouvait faire partie de la Mesta, quelle que soit l’importance de son troupeau. En fait, la majeure partie des ovins de la Mesta appartenaient à des éleveurs qui conduisaient eux-mêmes quelques centaines de bêtes le long de l’itinéraire de la transhumance, mais il y avait aussi des grands d’Espagne qui employaient des régisseurs chargés de conduire pour eux des troupeaux pouvant compter jusqu’à 30 000 têtes. Les assemblées de la Mesta étaient tenues régulièrement, et de façon démocratique, l’assistance comprenant plusieurs centaines de personnes (soit un dixième des adhérents), bien qu’à la fin l’organisation fût passée entre les mains des riches propriétaires fonciers. Les femmes propriétaires de moutons avaient exactement les mêmes droits que les hommes.
La Mesta était un organisme éminemment protégé, qui reçut de la couronne tous les subsides et avantages politiques qu’elle pouvait désirer. La couronne déployait ses efforts pour encourager la vente de laine à l’étranger, mais cette direction centralisée freina considérablement la naissance en Espagne de la libre entreprise. Par son insistance sur un contrôle gouvernemental de l’organisation du marché, l’Espagne ressemblait beaucoup plus à ces despotes islamiques vaincus par les chrétiens qu’à une société européenne moderne, comme la Toscane à laquelle elle vendait sa laine. La couronne fit tout ce qui était en son pouvoir pour étendre le pâturage au détriment des cultures. Les initiatives des propriétaires terriens en vue d’améliorer l’agriculture, même dans les vegas de Grenade et Murcie, furent ou bien interdites ou bien étouffées sous les taxes. Rarement, peut-être même jamais, la vie agraire d’une nation avait été maintenue dans un carcan si rigide, ni contrainte à se plier aussi strictement au dessein étroit d’une administration déterminée, devait conclure Julius Klein, ajoutant qu’il n’était pas du tout exclu que la Mesta ait poussé les rois à expulser aussi bien les Maures que les Juifs, qui s’intéressaient alors beaucoup plus aux cultures qu’au cheptel. L’histoire de la Mesta apparaît donc comme celle d’un organisme gouvernemental qui domina la principale matière première de l’habillement espagnol au cours des dernières phases de l’âge de l’agriculture. Son caractère statique permet d’expliquer pourquoi la laine, en définitive, ne fut pas la matière qui détermina l’âge industriel dans ses phases primitives – ni en Espagne, ni ailleurs en Europe. Ce rôle revint au coton. L’exemple de la Mesta est aussi révélateur de la façon dont les Espagnols conçurent leur commerce avec le Nouveau Monde après 1492.
Hugh Thomas. Histoire inachevée du monde. Robert Laffont 1986
1274
Le grand Khan Qoubilaï attaque le Japon : 20 000 archers, embarqués sur des centaines de navires, se font contenir par les forces japonaises qui restent victorieuses après le passage d’une tempête qui envoie la flotte chinoise par le fond. Cette défaite ne l’empêchera pas de fonder 5 ans plus tard la dynastie des Yuan, avec Pékin pour capitale.
Début de l’élevage du ver à soie dans le comtat Venaissin [3] : …Oui, mon enfant, des moines voyageurs, en grand secret, ont rapporté le ver à soie de Chine en Europe. Comme les Chinois voulaient garder pour eux cette industrie précieuse, ils défendaient sous des peines sévères de la faire connaître aux étrangers ; mais les moines cachèrent des œufs de ver à soie dans des cannes creuses, et ils les emportèrent en Europe avec des plants de mûrier. Plus tard, ce fut un pape qui dota la France de l’industrie des vers à soie.
Et comment cela, demanda Julien ?
Vous connaissez bien le Comtat d’Avignon, qui est tout près d’ici ? À cette époque, le comtat appartenait aux papes. Grégoire X y fit planter des mûriers et éleva des vers à soie. Bientôt, on imita dans toute la vallée du Rhône les gens d’Avignon, et à présent on élève des milliards de vers chaque année.
G Bruno. Le Tour de la France par deux enfants. 1877
Le travail des autres textiles évolue lui aussi : à partir du XIII° siècle en Europe, le cardage de la laine s’effectue au moyen d’un paire de brosses à dents métalliques et non plus à l’aide de la cardère (chardon à foulon), plante de la famille du chardon (cardus). Au lieu du cardage, on pouvait procéder au peignage : le peigne, avec ses dents métalliques montées sur de la corne et un manche en bois, glissait plus facilement dans la laine. Vint ensuite le rouet. Comme la plupart des grandes innovations du Moyen-âge, il fut inventé en Chine et expérimenté en Europe pour la première fois à Speyer, en Allemagne, en 1280. Il multiplia la productivité par deux, bien que le filage continua à être pratiqué le plus souvent à la maison… quand les femmes n’étaient pas aux champs. Plus tard apparût le métier à tisser à cadre horizontal, extrêmement précieux pour les tisserands. Enfin fut inventé le moulin à foulon [4], avec des maillets actionnés par des roues hydrauliques. Ces dernières innovations semblent avoir vu le jour en Italie.
Hugh Thomas. Histoire inachevée du monde. Robert Laffont 1986
Le concile de Lyon interdit toutes les communautés fondées après 1215 et n’ayant pas été expressément reconnues ; l’Église tentait ainsi de mettre un terme à la création fréquente de communautés qui avaient quasiment toutes en commun pour idéal une ardente pauvreté, et étaient donc radicalement opposées aux richesses en général, et à celles de l’Église en particulier.
En prenant le parti de l’Église, on pourrait facilement se faire accuser de jouer les avocats du Diable. Mais il faut bien reconnaître que cet idéal de pauvreté brandi en étendard pouvait recouvrir pas mal d’ambiguïté. Ils avaient bien dû faire leurs premiers pas en faisant montre d’une certaine rigueur, mais les dérives s’étaient probablement développées au fil du temps. Par définition, ils n’avaient rien d’institutionnel, et s’ils voulaient obtenir quelques succès, il fallait bien, par certains côtés, chercher à plaire, c’est-à-dire se laisser aller à la démagogie, pour avoir des adhérents. Tous ces refus d’une hiérarchie, cette liberté sexuelle [revendiquée par exemple par les Frères apostoliques], parfois même cette justification du vol, cette interdiction de travailler… tout cela avait un parfum très prononcé de peace and love où l’esprit de responsabilité n’avait pas le dessus, étouffé qu’il était sous une démagogie sans limite : on prend l’argent là où il est, on le distribue à tout le monde, et le tour est joué !
1275
Sous Édouard III, 280 juifs, accusés d’avoir altéré les monnaies, sont pendus à Londres. Il fixe à la première année du règne de Richard Cœur de Lion – 1189 – la date à partir de laquelle un document écrit pourra être exigé dans une affaire judiciaire, ce que Michael T. Clanchy nommera la limite légale de la mémoire. Ce nouveau référent sera renouvelé en 1293.
Dante Alighieri a le coup de foudre pour Beatrix Portinari 9 ans ; certains voudront alors faire de lui le chef de file des prédateurs de petites filles, oubliant tout simplement au passage son âge à lui : 10 ans. Béatrice mourra dans la fleur de l’âge à 24 ans et Dante ne s’en remettra pas : Florence a perdu sa Béatrice. Elle restera la Dame de ses pensées et de son cœur omniprésente dans Vie nouvelle et La divine Comédie.

Béatrice (1895), par Marie Spartali Stillman
1276
Pierre III, roi d’Aragon, est le premier à aller au sommet du Canigou, 2 874 m, le premier… des personnes connues, bien entendu.
Ambrogiotto di Bondone, dit Giotto, né dix ans plus tôt à Colle, sur la commune de Vespignano, dans le Mugello, à une trentaine de kilomètres au nord-est de Florence, se fait remarquer par Cimabue, auteurs de Crucifix byzantins et peintre déjà réputé, en route pour Bologne :
Un enfant merveilleusement doué était né à Vespignano, non loin de Florence. Il était capable de dessiner une brebis d’après nature. Un jour, le peintre Cimabue, en route pour Bologne, passa par ce hameau. Il vit l’enfant par terre en train de dessiner une brebis sur une ardoise. Il fut rempli d’admiration en voyant un enfant d’un âge aussi tendre dessiner aussi bien. Cimabie reconnût que l’habileté de cet enfant était un don naturel et il lui demanda son nom. Je m’appelle Giotto. Mon père se nomme Bondone. Il habite dans la première maison. Cimabue, homme de grand renom, alla avec l’enfant voir le père de celui-ci, un homme très pauvre. Il lui demanda de lui confier l’enfant, ce que le père accepta. Cimabue emmena Giotto avec lui, c’est ainsi qu’il devint élève de Cimabue.
Lorenzo Ghiberti 1378 – 1445. Commentaires
Giotto se mit à l’école mais sans rien perdre de sa spontanéité. La nature restait son modèle. Sur le nez d’une figure de moine commencée par Cimabue, il fit un jour une mouche. Si ressemblante, si vraie, que le peintre, quand il reprit son travail, essaya plusieurs fois de la chasser avant de découvrir sa méprise.
Dominique Fernandez. La course à l’abîme Grasset 2002
24 04 1277
Philippe le Hardi, soucieux de prouver son alignement sur les positions de l’Église en matière d’usure, s’en prend aux prêteurs italiens exerçant en son royaume : L’an du Christ 1277, le 24 avril, en un seul jour, le roi Philippe de France fit arrêter tous les prêteurs italiens de son royaume, et même des marchands, sous prétexte que l’usure ne se pratiquait pas dans son pays, les chassant du royaume à cause de l’interdiction qu’avait faite le pape Grégoire au concile de Lyon, mais ce qui montre qu’il faisait plus cela par convoitise d’argent que pour des raisons honnêtes, c’est qu’il les tint quittes pour soixante mille livres de parisis, de dix sous le florin d’or. Après quoi la plus grande partie demeura dans le pays comme avant, en faisant le prêt.
Giovanni Villani. Histoire fiorentine. Florence Magheri, 8vol., 1823 VII-53
1278
La principauté d’Andorre passe sous la suzeraineté commune de l’évêque d’Urgel et du comte de Foix, ce dernier passant ses droits à la France.
09 1279
Charles II d’Anjou dit avoir découvert à Saint Maximin la Sainte Baume, en Provence, la véritable sépulture de Marie Madeleine. Pour comprendre l’importance de l’affaire, il faut revenir à la légende fondatrice qui veut que Marie Madeleine, Marie Jacobe, Marie Salomé, Lazare et Marthe soient parvenus sur une barque depuis la Palestine, aux Saintes Maries de la Mer, et de là aient été emmenés au sommet du massif de la Sainte Baume où ils auraient vécu dans une grotte. De là étaient nés nombre de lieux de dévotion à Marie Madeleine, de par toute la France, Verdun étant probablement le plus important. En 1037, Geoffroy, abbé bénédictin de Vézelay avait sorti des placards une déjà vieille tradition remontant au IX° siècle selon laquelle l’abbaye de Vézelay était dépositaire de la sépulture de Marie Madeleine, initiative à succès qui lui avait valu nombre de privilèges. Il avait bénéficié de plus du soutien des puissants ducs de Bourgogne. En Provence, ce sont les Dominicains qui géraient le sanctuaire de la Sainte Baume, soutenus par les comtes de Provence qui avaient fait de Marie Madeleine la garantie de leurs états. Rome était de leur bord dans cette affaire. Marie Madeleine est donc l’une des pièces maîtresses dans cette rivalité religieuse, politique et commerciale – les lieux de culte étaient source de richesse – qui n’est pas petite.
Il faudra attendre le milieu du XVII° siècle pour que Jean de Launoy ose remettre en question cette légende.




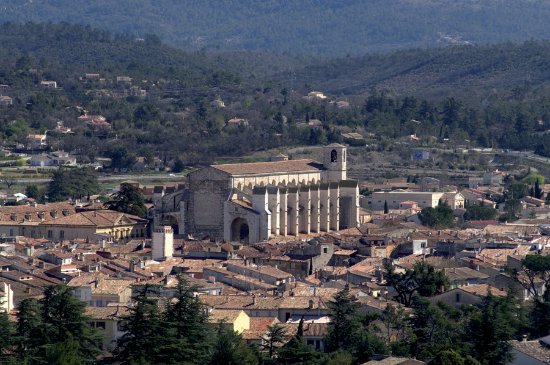
Basilique Sainte-Marie-Madeleine (Saint-Maximin-la-Sainte-Baume)

Crypte Saint Maximin la Sainte Baume
Le décentrement occidental est une posture d’humilité biblique, qui reconnait la centralité de Dieu et son propre éloignement géographique et historique, loin des sources de sa culture savante et religieuse. De cette culture décentrée, le plus beau vestige monumental se trouve à Vézelay. On entre dans la grande basilique romane par un vaste narthex. Sur le tympan sculpté vers l’an 1130, le Christ ne trône pas comme un juge : il répand l’esprit saint sur les apôtres, fondant ainsi l’Église. Autour de cette scène de la Pentecôte prend place un catalogue de peuples tel qu’on l’enseignait dans les écoles. Certains peuples sont historiques, bien connus de la géographie classique, les autres sont des monstres cités par Pline l’Ancien au I° siècle : on reconnaît les Pygmées nains et des géants, des cynocéphales et des Panotii à grandes oreilles. Les monstres, représentant l’universalité d’un monde en partie inconnu, ne sont pas rejetés, mais célébrés puisque appelés à la connaissance de Dieu. Sur cette pointe occidentale du monde souffle alors l’appel missionnaire. De sa marginalité, l’Europe reçoit un dynamisme paradoxal qui trouve son sens dans la Bible elle-même : c’est de la marge que Dieu tire ses instruments et ses renouvellements sont des renversements. Le Messie vient de Nazareth, comme plus tard, la Pucelle Jeanne viendra des marches de Lorraine, à la cour du Dauphin. En 1147, c’est à Vézelay qu’est prêchée la deuxième croisade.
Léonard Dauphant. Géographies. Ce qu’ils savaient de la France (1100 – 1600). Époques Champ Vallon 2018
vers 1280
L’Anglais Walter de Henley publie un Traité agricole où l’on peut apprendre qu’une graine a tendance à s’affaiblir lorsqu’on la sème plusieurs années de suite en un même lieu, et qu’il vaut donc mieux acheter tous les ans des semences et non puiser dans les récoltes de l’année. On y lit aussi la mise au point de l’assolement triennal, améliorés par les amendements et le fumier. Les labours ne doivent être faits qu’à la charrue.
25 08 1281
Le grand Khan Qoubilaï repart en guerre contre le Japon, cette fois avec 150 000 hommes, mongols, chinois et coréens ; mais les Japonais ont eu le temps de construire une muraille ininterrompue sur la côte ouest du Kyushu – l’île méridionale du Japon – : la bataille dure trois semaines, mais les 150 000 hommes débarqués se heurtent à l’efficacité des fortifications japonaises, quand survient un typhon salvateur qu’ils nommeront Kamikaze – Vent Dieu, qui survient quand tout est perdu – qui fait riper les ancres de l’armada chinoise, et ainsi l’envoie à la casse sur les rochers ; les Japonais se lancent à l’abordage des navires encore accessibles et se livrent à un massacre. Seuls 200 navires échappent au désastre sur les 2 400 que comptait la flotte ; des 150 000 marins et soldats ne restent que 30 000 survivants.
3 03 1282
Insurrection des Vêpres Siciliennes. Charles, comte d’Anjou, frère de Louis IX, s’est vu chargé en 1266 par la papauté de mettre un terme au pouvoir des Hohenstaufen en Italie et de conquérir Naples et la Sicile, ce à quoi il parvient en battant Manfred, le bâtard à qui Frédéric II avait légué ses terres italiennes, et Conradin, le dernier Hohenstaufen. Mais Charles d’Anjou va s’aliéner le soutien de la population qui se soulève. Le massacre va durer plus d’un mois.
Attribuée, au siècle dernier, par le nationaliste italien Michelo Amari à l’inimitié de ses compatriotes contre l’occupant étranger, préfiguration des Bourbons de Naples, elle l’est surtout par les historiens d’aujourd’hui (comme elle l’était par les récits contemporains) à la rencontre d’un grand conspirateur, créature et fidèle des Hohenstaufen, le médecin Jean de Procida, et d’un prince ambitieux, Pierre III d’Aragon. Une longue préparation diplomatique, auprès des gibelins siciliens, italiens et étrangers, auprès de la cour de Constantinople, auprès de certains milieux du Saint-Siège, mit au point une action qui visait à l’entière dépossession de l’Angevin au profit de l’Aragonais. Les inimitiés locales aidant, elle débuta à Palerme, par une rixe entre peuple et police, qui, peut-être spontanée, fut aussitôt exploitée dans un massacre général, et certainement préparé, de tous les Français de la ville puis d’une grande partie de la Sicile : la localité de Sperlinga, dans la région de Catane, devait plus tard se faire gloire de s’y être, seule, refusée. En un mois, toute l’île fut perdue pour la Cour de Naples, la dernière de ses places, Messine, étant passée à la révolte le 28 avril. Une telle unanimité et une telle promptitude ne sont pas nécessairement la marque d’un profond patriotisme dans la population sicilienne : du moins prouvent-elles que le pays était ulcéré d’une exploitation sans mesure et sans égards par le régime de Charles d’Anjou.
Emile G Léonard. L’Italie médiévale.1986
L’impitoyable Charles ne sut pas régner comme il avait su vaincre ; il lâcha la bride à toutes les passions de ses Provençaix, malgré les remontrances des papes qui prévoyaient une révolution dans ses États, et apercevoient déjà le feu destructeur qui couvait dans le calme perfide d’une soumission apparente. Un gentilhomme sicilien, Jean de Procida, actif, discret, souple, éloquent, fier, blessé vivement d’être négligé par le vainqueur, alla lui susciter des ennemis en Aragon, dans Constantinople, et reçut de puissans secours de l’empereur grec, ennemi déclaré de Charles d’Anjou. Tout à coup, le nouveau Protée se rendit invisible, et, caché sous l’habit de cordelier, soufflant dans tous les cœurs la haine contre les Français, souleva toute la Sicile contre eux : c’était une révolte générale que ce chef habile avait médité, et non un massacre. Les historiens les plus judicieux conviennent que l’on doit attribuer à un effet du hasard la boucherie nommée Vêpres siciliennes. Ce ne fut point la cloche qui sonna le massacre, le lundi de Pâques 1282 ; un Français lui-même donna le véritable signal, et les cris de la pudeur brutalement outragée par lui, en pleine rue, dans une jeune personne qui allait à vêpres, furent le véritable tocsin qui rassembla le peuple, et lui inspira cette rage meurtrière qui coûta la vie à vingt huit mille Français : la preuve que ce massacre ne fut point prémédité, c’est qu’il ne fut pas simultané dans l’île.
Si les historiens se disputent sur les causes des Vêpres siciliennes, tous s’accordent pour en vouer les auteurs à l’exécration des siècles. Un grand nombre de Provençaux, déguisés en paysans, essayèrent de quitter la Sicile ; mais aucun d’eux ne se sauva, parce que les Siciliens, doués d’un esprit infernal, s’avisèrent d’attaquer grammaticalement les fugitifs, et ciceri fut le mot que les insulaires choisirent pour reconnoître leurs victimes. Ce mot si cruellement immortalisé, et dont la prononciation est très difficile, servit d’arrêt de mort aux étrangers qui ne purent venir à bout de le répéter avec la même délicatesse et le même accent que les naturels. La populace de Palerme poussa la fureur au point d’éventrer les Siciliennes enceintes des Français, afin d’exterminer leurs ennemis jusque dans les entrailles de ces infortunées. Il nous répugne de représenter toutes les horreurs dont la Sicile devint le théâtre : on sait assez que la multitude est capable des plus violens excès, et que, dans tous les âges, chez tous les peuples, elle jouerait souvent de sanglantes tragédies, si elle n’était contenue par un gouvernement sage et vigoureux.
Charles d’Anjou roulait dans sa tête les projets les plus ambitieux, entre autres, celui de détrôner l’empereur grec, lorsque cette nouvelle vint l’écraser et l’anéantir en quelque sorte. Il tenta vainement les plus grands efforts pour recouvrer la Sicile sur dom Pedro, roi d’Aragon, qui étoit venu régner, non sans quelque crainte et sans hésiter, sur ce théâtre de carnage et parmi tant d’assassins. Au bout de trois ans, le Frère de Saint Louis, dévoré par le chagrin, rendit le dernier soupir, maudissant trop tard sa cruelle ambition : il eut pour successeur son fils, Charles II, le boiteux, qui, fait prisonnier par dom Pedro, recouvra la liberté en renonçant au royaume de Sicile.
M.E. Jondot. Tableau historique des nations. 1808.
1282
Début de la construction de la cathédrale Sainte Cécile d’Albi. Elle sera terminée en 1480. L’hérésie cathare commence à n’être plus qu’un souvenir, mais il vaut mieux avoir en vue des monuments qui disent la puissance et la gloire de l’Église catholique. On a parlé de croisade contre les Albigeois, car c’est à Albi que s’était tenu en 1167 le concile de Lombers visant à la réconciliation. Elle se pose en lieu et place de plusieurs édifices antérieurs, détruits par le feu ou plus simplement le temps. Ce premier édifice, en pierre, sera détruit par la querelle entre deux évêques, l’un nommé par le pape, l’autre par le collège des chanoines de 1435 à 1462. Mais la pierre coute plus cher que la brique. On choisira la brique pour édifier, rapidement, le second édifice, le plus grand bâtiment du monde en brique rouge. Et puis la brique, c’est le matériau que le pauvre utilise pour sa maison et, pour montrer aux sympathisants cathares que l’Église peut faire preuve de pauvreté, ce choix est préférable. La suite de la construction, avec l’appel à des artistes renommés, surtout italiens, pour les aménagements intérieurs – chœur, jugement dernier, voûtes de la nef – viendra infirmer cette orientation première en en faisant une cathédrale qui en met plein la vue, bien loin de la pauvreté évangélique. Chassez le naturel, il revient au galop. Indécente richesse de ces prélats, qui n’oublieront pas de se bâtir aussi un palais épiscopal – la Berbie – devenu aujourd’hui après une magnifique restauration, le musée Toulouse-Lautrec. Aujourd’hui, Albi est une des villes de France où il fait vraiment bon vivre, fruit d’une gentillesse qui est dans l’ADN de chacun.


26 06 1284
Légende ? Histoire vraie ? Légende ? Histoire vraie ?
- La légende, par les frères Grimm en leur temps (fin XVIII° début XIX°).
Alors que la ville de Hamelin [en Basse Saxe, Allemagne] est prise d’assaut par les rats, les habitants désespéraient de voir leur fléau disparaître. Les rats vont et viennent toujours plus nombreux. Un beau jour, un inconnu arrive aux portes de la ville. Ce dernier prétend pouvoir dératiser tout le village si toutefois il reçoit une rémunération. Les habitants et le maire n’hésitent pas une seconde et acceptant l’offre de l’homme aux habits multicolores. Marché conclu, l’inconnu sort de sa poche une petite flûte et commence à en jouer.
À peine les premières notes jouées qu’une bonne partie des rats accourent hors des maisons. Bientôt tous les rats qui infestent le village se regroupent autour du joueur de flûte, qui les emmène hors de la ville, jusqu’au Weser où ils se noient. À son retour dans Hamelin, l’étranger demande son dû. Pas de chance, la ville lui refuse ! Vexé et furieux l’étranger quitte la ville mais ce n’est que quelques jours, le temps de préparer sa vengeance !
On prétend qu’il revient le 26 juin 1284 à Hamelin, sous des allures assez effrayantes et portent un étrange chapeau rouge. Alors que tous les habitants sont à l’église, l’homme se met à jouer de la flûte dans toutes les ruelles de la ville. Étrange pouvoir, la musique attire non plus des rats mais les enfants !
Les petits, complètement ensorcelés suivent sans se poser de questions le joueur de flûte qui les conduit jusque dans la montagne Koppelberg où ils disparaissent à jamais. L’histoire raconte que sur les 130 enfants emmenés par l’homme aux habits colorés, seuls 2 sont revenues de ce terrible périple.
Mais le premier étant devenu aveugle, il ne pouvait indiquer l’endroit où étaient piégés ses compagnons, tandis que le second, muet et ne sachant écrire, ne pu, lui non plus, donner cette information.
Bien sur, on excuse les crédules de croire que cette histoire est vrai. Mais quelque part, ils n’ont pas totalement tort. Certains indices poussent à croire que la légende part d’une véritable disparition d’enfants.
Maurice Shadbolt, de passage à Hamelin, en Basse-Saxe, décide de vérifier s’il reste quelques détails de la légende dans le village même. Il découvre alors une plaque de bois où il peut lire l’inscription suivante : en l’an 1284, le jour de la Saint-Jean et Saint-Paul, le 26 juin, 130 enfants nés dans la ville de Hamelin suivent un joueur de flûte en habit aux couleurs vives, et disparaissent. Bien que l’inscription date du début du XVII° siècle, elle semble rappeler la réalité d’un drame réellement vécu en 1284. Le chercheur découvre plus de 350 volumes au Musée municipal du village, se rapportant à la légende et tentant d’en percer le mystère. Un fragment de manuscrit du XV° siècle confirme que le joueur de flûte a fort probablement existé. Vers l’an 1300, un vitrail est installé à l’église affirmant que les enfants auraient survécu à maints dangers jusqu’à Koppen où ils disparaissent. Sur ce vitrail cependant ce n’est pas un jeune joueur de flûte qui entraîne les enfants mais un vieillard habillé de couleurs vives. Une aquarelle datant de 1592 représente le joueur de flûte comme un homme relativement âgé, portant moustache, à l’air aimable. Il mène alors les enfants vers une colline révélant une caverne et joue de la flûte pour entraîner les rats dans la rivière.
Au Moyen-Âge, il y a de nombreuses invasions de rats et on a retrouvé entre autre des sifflets de cette époque qui peuvent éventuellement appeler les rongeurs et les précipiter dans des pièges. Il est possible que l’inventeur d’un tel sifflet, après son exploit accompli, a pu être pris pour un sorcier ou un envoyé du diable et ainsi se voir refuser la prime consentie pour l’extermination des rongeurs. Il n’est donc pas impossible que cet événement se soit produit à Hamelin. Outre l’existence du joueur de flûte, le drame entourant la disparition des enfants est à étudier… Un instituteur, Hans Dobbertin, s’y est attardé, croit que le drame a bien eu lieu mais pas à Hamelin même, pour lui, les enfants seraient partis vers le nord-est pour s’embarquer à bord d’un navire qui aurait fait naufrage près de la ville de Kopahn, en Pologne. C’est pourquoi on a amené dans la légende le fait que les enfants soient disparus près de la colline de Koppen. Les indices de ce fait ont été découverts dans des archives relatant les événements de la vie d’un certain comte Nikolaus von Spiegelberg, qui est un colonisateur allemand. Il est connu que cet homme a des rapports avec les habitants de Hamelin et est aperçu pour la dernière fois dans le port allemand de Stettin, le 8 juillet 1284, soit 12 jours après la disparition présumée des enfants. Précisons que Stettin se trouve à 12 jours de marche de Hamelin… Selon l’hypothèse de l’instituteur c’est ce comte Spiegelberg qui aurait amené avec lui les enfants du village vers l’Ouest, soit vers l’Allemagne, d’où il est originaire. À cette époque, l’Allemagne est comme une terre promise pour les populations de l’Est, car le surpeuplement rend la vie difficile. Les seigneurs Slaves et Hongrois accueillent avec enthousiasme les nouveaux venus d’abord pour la main d’œuvre que cela amène, ensuite pour les aider à repousser les attaques des pilleurs Tartares venant de Russie. Sur le plan commercial également l’installation de colons le long des villes frontières est un atout, il y a donc à l’époque beaucoup de recruteurs officiant pour le compte des nobles Allemands.
Bien que plusieurs érudits ne soient pas en accord avec les conclusions de Hans Dobbertin, son hypothèse est attrayante et explique beaucoup de choses concernant cette légende. Résumons ; l’homme plus âgé que l’on voit sur les premiers tableaux serait le comte von Spiegelberg, qui habillé de l’habit des nobles Allemands de l’époque, offre une image très colorée. Il est fort possible qu’afin d’entraîner avec lui plusieurs habitants, surtout des jeunes, à venir coloniser l’Allemagne, il ait fait appel à plusieurs musiciens pour mieux les charmer. Le joueur de flûte serait donc un recruteur du XIII° siècle qui aurait emmené un grand nombre de jeunes aux confins orientaux de l’empire germanique pour créer de nouvelles cités. Il a donc ainsi réussi à faire monter à bord du bateau prévu, la plupart des jeunes du village de Hamelin, mais le navire sombre par la suite les entraînant tous dans la mort. C’est donc ce drame que les habitants du village auraient conservé en mémoire, la légende par la suite a repris les événements mais avec le temps y a greffé ou modifié divers facteurs. l’histoire reconstituée est plausible et répond à diverses questions sur lesquelles se sont penchés de chercheurs de partout. Cette recherche démontre surtout qu’à l’origine d’une légende bien connue, il est fort possible de découvrir un événement bien réel !…
Cette légende naît en 1284, en Allemagne, alors que la petite ville de Hamelin (Allemagne) est infestée de rats, au grand désespoir de ses habitants et de son maire. Un jour, un joueur de flûte Rattenfänger se présente comme étant un exterminateur de rats. Habillé d’un long manteau multicolore, il propose de débarrasser la ville des rats, moyennant finances. Le maire et les habitants de la ville acceptent sa proposition avec joie.
La légende du joueur de flûte de Hamelin, histoire enfantine bien connue, a été immortalisée par le poète Anglais Robert Browling. Il faut pardonner aux touristes qui visitent Hameln (son véritable nom en Allemand) de croire que ce récit est une réalité historique. En effet, deux maisons du XVI° siècle portent des inscriptions rappelant l’enlèvement des enfants du 26 juin 1284, et la légende est régulièrement présentée dans la ville. Dans une certaine rue, même, la Bungenstrasse (qui serait le chemin emprunté par les petits ensorcelés), aucune musique n’est autorisée de peur de courroucer à nouveau le joueur de flûte. Et, jusqu’au XIX° siècle, deux croix se dressaient sur la montagne pour marquer l’endroit où les enfants ont disparu.
Cependant, selon les témoignages écrits, il y aurait là une certaine confusion. Le plus ancien témoignage, remontant à 1450, ne relate que la disparition de 130 enfants. Ce n’est qu’au XVI° siècle que la chronique mentionne le joueur de flûte comme charmeur de rats. Selon des récits plus tardifs du XVII° la date fatidique serait le 22 juillet 1376. Bien que la différence jette le doute sur l’authenticité de l’histoire, le fait même qu’elle soit rapportée avec une telle précision porte à croire que la légende a un fond de vérité, (comme toute les légendes). Ce n’est certes, ni la première ni la seule de son genre. Des récits remarquablement similaires se retrouvent dans le folklore de toute l’Europe et du Moyen-Orient. Mais contrairement aux autres contes similaires, celui de Hamelin donne des dates précises, quoique contradictoires…
De nos jours, nombreux sont ceux pour qui la date de 1284 évoque la croisade des enfants. En 1212, lors d’une tentative pour libérer la Terre Sainte de l’emprise musulmane, cette croisade passe par Hamelin et fait très probablement des recrues… D’innombrables enfants meurent au cour du long et difficile voyage. Une autre théorie rattache cette même date à la mort d’un grand nombre de jeune Hamelinois à la bataille de Sedemunde, à la suite d’une querelle locale en 1260. L’un ou l’autre de ces événements est peut-être à l’origine de la première version du récit…
Au XIV° siècle, un désastre bien pire va s’abattre sur Hamelin. La Mort Noire (la peste bubonique) fait rage en Europe dès 1345 et jusqu’à la fin des années 1360. Elle est apportée par des rats infestés de puces qui meurent par la maladie. Les puces passent alors aux humains, qui meurent à leur tour. C’est un enchaînement semblable à celui de la légende. Les souvenirs confus de la Mort Noire explique peut-être la date la plus tardive de certains témoignages écrits…
Des souvenirs d’une autre maladie sont peut-être enfouis dans ce récit. L’on rapporte que les enfants s’en vont vers la mort en dansant… Il s’agit là, peut-être d’une description symbolique des pitoyables bandes de victimes de la Danse de Saint-Gui ( peut-être la Chorée de Sydenham) qui parcourent les campagnes au Moyen Âge. La musique des flûtes doit, croit-on, calmer les spasmes musculaires incontrôlables dont les victimes sont affligées…
Qu’est-ce qui nous pousse à douter de l’authenticité de cette légende?
Et bien, ce n’est qu’au XVI° siècle que les rats font leur apparition dans l’histoire, alors que l’enlèvement des enfants semble être déjà connu et reconnu depuis 1450. Ce qui fait douter les spécialistes est la mention de dates très précises. La légende serait donc bel et bien un fait quelque peu modifié et embellie pour détourner la vérité qui doit choquer ou attrister les gens (qui ne veulent pas graver ces affreux faits dans leur mémoire).
Decan Lude, originaire de Hamelin, déclare en 1384 avoir en sa possession un livre de chants contenant un vers en latin donnant le récit d’un témoin oculaire de l’événement. Ce vers aurait été écrit par sa grand-mère. Ce livre de chants est réputé avoir été perdu à la fin du XVII° siècle.
Une version Allemande de ces vers semble cependant être parvenue jusqu’à nos jours, par une inscription de 1602/1603 trouvée à Hamelin :
Anno 1284 am dage Johannis et Pauli war der 26. junii Dorch einen piper mit allerlei farve bekledet gewesen CXXX kinder verledet binnen Hamelen gebo[re]n to calvarie bi den koppen verloren
ce qui peut être traduit en Français par : En l’année 1284, le jour de Jean et Paul Soit le 26 juin. Par un flûtiste tout de couleurs vêtu, 130 enfants nés à Hamelin furent séduits Et perdus au lieu du calvaire près de Koppen.
Koppen (Allemand : collines) semble être une référence aux collines entourant la ville. Le vers ne permet pas de savoir laquelle de ces collines serait celle désignée.
Chantal. Le Figaro 6 novembre 2013
Chanson de Hugues Aufray :
Un étranger est arrivé un beau soir
De son pipeau il tirait des sons bizarres
Ses cheveux longs
Lui donnaient l’air
D’un vagabond
En ce temps-là
La ville était envahie
Par tous les rats
Venant du fond du pays
Privés de pain
Les habitants
Mouraient de faim
Le musicien leur dit
Si vous le voulez,
Je peux sur l’heure
Du fléau vous délivrer
Pour mille écus
Le marché fût
Bientôt conclu
Devant l’église
Il joua de son pipeau
Comme le berger
Pour assembler le troupeau
Et de partout
Les rats sortirent de leur trou
Et tous ces rats
Qui le suivaient dans les rues,
Chemin faisant
Ils étaient cent mille et plus
Ils arrivèrent
À la rivière
Et s’y noyèrent
(parlé 🙂
C’est un sorcier !
S’écrièrent les bourgeois
tout le village déjà
Le désignait du doigt
(chanté)
À coups de pierres
Et sans parjures
Ils le chassèrent
Tout le village
Dormait paisiblement
Lorsque soudain
On entendit dans le vent
Un doux refrain
Que les enfants
Connaissaient bien..
Les p’tits enfants
En chemise de nuit
Cherchaient le vent
Et le pipeau dans la nuit
Ils arrivèrent
À la rivière
Et s’y noyèrent.
6 08 1284
Gênes a déjà les dents longues et parvient à se défaire de sa rivale en Méditerranée : Pise, lors de la bataille navale de Meloria, au large de Livourne. Ainsi fait-elle tomber dans son giron la Sicile [5] et la Corse. Cent dix ans plus tôt, elle avait passé un accord avec le comte de Toulouse pour s’emparer de la Provence et en garder les principales villes côtières, dont évidemment la première d’entre elles, Marseille, mais ça n’avait pas marché.
28 12 1284
La voûte du chœur de la cathédrale de Beauvais s’effondre ; commencée en 1225, elle avait été terminée en 1272. On reconstruira, mais ce ne sera terminé qu’en 1500, avec, au-dessus de la croisée des transepts, une énorme tour haute de cent cinquante mètres En 1304, les bourgeois se soulèveront contre le coût insupportable de la construction.
Dans ces années-là, Villard de Honnecourt, commis voyageur du gothique, – selon Roland Bechmann -, parcourait l’Europe des cathédrales, le carnet à la main, aujourd’hui précieusement conservé à la Bibliothèque Nationale. Honnecourt est une petite ville de Picardie, proche d’Amiens et de Saint Quentin. On ne sait quasiment rien de cet homme sinon le contenu extraordinaire de ces carnets, foisonnant de détails d’architecture, de procédés de construction… Cela n’est pas sans rappeler les Croquis d’Albert Laprade, dans l’entre deux guerres, et plus récemment, les illustrations de Lizzi Napoli, en Provence, point de départ d’une vogue certaine des croquis, aquarelles, dessins de voyage. Ce monsieur ne faisait pas que dessiner : muni sans doute d’une solide formation, il créait lui-même des automates pour en équiper le clocher des églises qu’il faisait construire.
1286
Création de la gabelle, l’impôt sur le sel [en fait, il avait déjà existé de 1140 à 1150, sous le nom de saunerie] : il lui faudra pratiquement cent ans pour s’imposer. À la veille de la Révolution, il représentera pour le Trésor Royal le tiers des impôts indirects. Le mot vient de l’arabe Kabala : impôt. Il ne faut pas perdre de vue que le pays était encore avant tout marqué par le poids des régions …. Et l’impôt se calait sur cette réalité : ainsi seule la France née de l’Île de France était pays de Grande gabelle. Le sud-ouest était pays du Quart-bouillon – le quart de la récolte allait dans les caisses royales -. Les pays francs ne payent pas de gabelle : Bretagne, pays Basque et Flandre. Les pays de petite gabelle – moitié est du pays d’Oc – les habitants peuvent acheter la quantité qu’ils veulent dans les greniers. Les pays de gabelle de salines : Franche comté et Provence.
Mais le principe de la taxe n’était pas nouveau : l’un des impôts les plus courants avait été jusqu’alors le péage… il en existait de toutes sortes :
Déjà, à l’époque de Charlemagne, on ne relève pas moins de six taxes différentes affectant le trafic routier dans un diplôme délivré à l’abbaye d’Aniane :
- En tête, le téloneum, le droit de douane des Grecs, adopté par les Romains, et qui, en France, deviendra le tonlieu.
- Le pontaticum, perçu au passage des ponts.
- Le capitacum, taxe destinée, en principe, à compenser les dégâts causés aux champs et aux prés des riverains.
- Le rotaticum, frappant les chariots et les charrettes
- Le travaticum, encaissé aux portes des villes.
Au XII° siècle, cette liste s’était allongée avec :
- Le pedaticus, qui a donné les français péage, perçu pour le passage sur route.
- Le transitus, dû pour les déplacements en bateau sur les fleuves et les rivières.
- Le ripaticum, dû pour les transports par eau.
Le droit de relève dont bénéficiaient les propriétaires riverains des voies antiques.
Pierre A Clément. Les chemins à travers les âges. Les presses du Languedoc 1983.
1287
Béatrix, duchesse de Savoie, sans doute bien intentionnée, sème la zizanie dans le pays de Megève en octroyant à Saint Nicolas de Véroce et Saint Gervais des pâturages sur une étendue considérable autour des actuels chalets d’Hermance, c’est à dire versant Megève. Mais en même temps elle donnait tort à des Beaufortins envahissants qui n’avaient pas hésité à occuper les terres autour du Mont de Vorès, versant Val d’Arly, en les renvoyant au-delà de la ligne de crête Mont de Vorès – Col des Saisies ; toujours est-il qu’en 1789, le procès entre Megève et Saint Nicolas de Véroce, Saint Gervais, n’était toujours pas terminé.
Olaf et Karl, chanoines d’Uppsala, capitale de la Suède, sont aussi étudiants à Paris : l’époque est à la fin des grands chantiers de cathédrale et les bâtisseurs se trouvent disponibles : il est va ainsi de Pierre Bonneuil, tailleur de pierre, qui est engagé par les deux chanoines pour construire à Uppsala une cathédrale aussi belle que Notre Dame de Paris. Et il en sera fait ainsi. Il est aujourd’hui difficile de savoir si elle était vraiment aussi belle car elle brûlera et 1572 et 1702 et ne sera pas restaurée à l’identique.
1288
Ibn al-Nafis, disciple d’Avicenne, premier médecin au Caire, tire sa révérence. Il a écrit un traité de médecine Al-Mudjiz al Qanum dans lequel il décrit sans erreur majeure la petite circulation sanguine, entre cœur et poumons. Mais son œuvre restera longtemps inédite en Europe ; il est vrai qu’en dénonçant avec vigueur l’erreur de Galien assurant que le sang passait d’un coté du cœur à l’autre, il se mettait à dos tous ceux dont le mode de fonctionnement est le principe d’autorité : c’est quelqu’un de reconnu qui dit cela, donc c’est la vérité. Il faudra attendre Servet en 1553 et Colombo en 1559 pour que sa découverte soit reconnue.
27 04 1289
Après un mois de siège, Tripoli tombe aux mains de Qalaoun, le sultan mamelouk, qui ne fait pas de quartier : ville pillée puis rasée, population massacrée ou déportée.
1289
Giovanni da Monte Corvino, frère franciscain, ancien soldat, ancien juge et ancien médecin, donc, homme d’expérience, quitte Venise pour la Chine : il porte au khan mongol de Perse un message du pape Nicolas IV, séjourne treize mois en Inde, s’arrêtant sur le soi-disant tombeau de Saint Thomas, à Melaiapour (aujourd’hui faubourg de Madras) ; il va être archevêque de Khambaluk, l’actuelle Pékin.
1290
Amédée V, † 1323, prend la Bresse, le Bugey et Genève, où il nomme un vidomne, chargé de contrôler l’évêque dans ses décisions politiques. En Angleterre, 15 000 juifs sont dépouillés de leurs biens et bannis.
A Quiquengrogne, dans l’Aisne, première fabrique française de verre à bouteille.
________________________________________________________________________________
[1] L’homme aura ses détracteurs, qui prétendent qu’il n’aurait pas effectué ces voyages, mais n’aurait fait que collecter des témoignages de sources multiples… on pourrait ne les prendre que pour des jaloux, malheureusement, ils ont quelques solides arguments dans leur besace : Marco Polo ne mentionne jamais la muraille de Chine, pas plus que le thé, pas plus que les pieds des jeunes chinoises comprimés dans des bandelettes… Il ne parle pas chinois, mais turc et mongol. Ses partisans répondent que la muraille de Chine était à l’époque dans un état si lamentable qu’elle n’attirait pas du tout l’attention, que le thé ne paraissait pas particulièrement remarquable puisqu’on buvait en Europe beaucoup de tisanes, que Marco Polo ne vivait pas chez les Chinois, mais chez les Mandchous, dont les femmes ne comprimaient pas leurs pieds dans des bandelettes…
[2] Dans les Grandes découvertes Jean Favier, de l’Institut, ne le veut pas imposteur, mais seulement vantard : La rencontre qu’il fait du notaire Rusticello de Pise, compagnon de cellule dans une prison génoise où l’un et l’autre purgent une condamnation pour escroquerie, l’incite à mettre au net ce qu’il a pris l’habitude de raconter et d’enjoliver. Et le marchand de laisser broder l’écrivain professionnel qu’est le notaire. L’un et l’autre font l’intéressant. Ils grossissent les chiffres, ce qui est d’ailleurs en leur temps l’habitude de bien des chroniqueurs… les historiens auront quelque peine à dégager le vrai du faux.
[3] dont Avignon ne fait pas partie, contrairement à ce que semble croire G. Bruno.
[4] Rien ne fut plus rudimentaire que ce foulon. Un arbre, muni de cames qui soulevaient et laissaient retomber tour à tour des pilons verticaux, des auges destinées à recevoir la laine, à l’intérieur desquelles retombaient ces pilons, un fort bâti en charpente contenant et reliant tout le système : telle fut la machine en question.
Jules Verne L’île mystérieuse
[5] Les changements dans une île sont moins rapides qu’ailleurs, le temps n’y est pas le même : ces quelques lignes d’Andrea Camilleri, parlant des années 1990, donc 700 ans plus tard, le disent bien : C’était là la Sicile qui plaisait au commissaire, âpre, où le vert était rare, sur laquelle il était impossible de vivre et où il y avait encore des hommes, mais de moins en moins, avec les guêtres, la casquette et le fusil à l’épaule qui le saluaient depuis le dos de leur mule en se portant deux doigts à la visière [La voix du violon, 1997]
Laisser un commentaire