| Publié par (l.peltier) le 19 novembre 2008 | En savoir plus |
début 1533
C’est l’année probable de la conversion de Calvin, il a 24 ans : Et puis premièrement, comme ainsi soit que je fusse si obstinément adonné aux superstitions de la papauté, qu’il était bien malaisé qu’on me pût tirer de ce bourbier si profond, par une conversion subite, Dieu dompta et rangea à docilité mon cœur, lequel, eu égard à l’âge, était par trop endurci en telles choses. Ayant donc reçu quelque goût et connaissance de la vraie piété, je fus incontinent enflammé d’un si grand désir de profiter, qu’encore que je ne quittasse pas du tout les autres études, je m’y employais toutefois plus lâchement. Or je fus tout ébahi que devant que l’on passât, tous ceux qui avaient quelques désir de la pure doctrine se rangeaient à moi pour apprendre, combien que je ne fisse que commencer moi-même.
15 07 1533
François I° a demandé à Dominique de Cortonne, dit le Boccador de construire le premier édifice de style italien : l’Hôtel de Ville de Paris [1]

12 10 1533
Catherine de Médicis est arrivée la veille à Marseille pour y épouser Henri second fils de François I° ; tous deux ont 14 ans ; pour l’instant, c’est l’aîné, François qui est le Dauphin, mais sa mort deux ans plus tard fera de Henri le futur roi Henri II. Le mariage officiel est fixé au 28 octobre, et Marseille va être à la fête pendant quinze jours.
Pour mémoire rappelons la généalogie de ces Médicis qui vont tant marquer la Renaissance en France : Catherine est l’arrière petite fille de Laurent le Magnifique, petite fille de Pierre II l’Infortuné, aîné de Laurent, et fille de Laurent II, duc d’Urbino. Sa mère était Madeleine de la Tour d’Auvergne, cousine de François I°, morte dans les jours qui suivront la naissance de Catherine. Honoré de Balzac ira traquer les parentés : C’est par sa mère que Catherine était si riche et alliée à tant de familles ; car, chose étrange ! Diane de Poitiers, sa rivale, était aussi sa cousine. Jean de Poitiers, père de Diane, avait pour mère Jeanne de la Tour-de-Boulogne, tante de la duchesse d’Urbin Furne. Orpheline presque de naissance, Catherine a passé l’essentiel de son enfance dans un couvent de bénédictines. Son premier, et peut-être seul amour, Hippolyte, est un petit fils de Laurent, et fils de Julien, le 3° fils de Laurent.
Léon X, pape de 1513 à 1521, est Jean, le second fils de Laurent le Magnifique.
Clément VII, pape de 1523 à 1534, est probablement un fils illégitime de Julien, frère de Laurent, assassiné dans le Duomo de Florence par les Pazzi, le 26 avril 1478.
Quant à Marie de Médicis, future seconde épouse d’Henri IV, il faut remonter à l’arrière grand père de Laurent le Magnifique pour trouver un ancêtre commun : Jean di Bicci 1360 – 1429.
Sonnent les cloches, tonne le canon, le Saint père fait une entrée triomphale précédé par un cheval blanc aux rênes immaculées, qui porte le Saint Sacrement. Le lendemain, autre cortège féerique, les chars du roi et de la reine de France, entourés de trente chevaux montés par les plus belles et nobles filles de la cour, traversent Marseille en délire ; derrière eux, Catherine, à cheval – c’est une écuyère magnifique – est vêtue de brocart d’or et sa monture est carapaçonnée d’or et de cramoisi. Pour finir, le cortège ; les douze dames d’honneur de la duchessina dans des carrosses garnis de velours noir dont les chevaux portent deux pages chacun.
Quand Catherine de Médicis, impassible, passe devant la tribune richement décorée où sont rassemblées les grandes dames du royaume, elle ne remarque la plus belle de toutes qui, pourtant, n’a d’yeux que pour elle, Diane de Poitiers.
Janine Lambotte. À l’ombre des Médicis. Londreys 1988
L’Italie est coutumière des morts violentes, et elles le sont souvent par empoisonnement : aussi, prudente, sa famille la fit accompagner des meilleurs cuisiniers et pâtissiers de Florence. Lorsqu’elle embarqua à Portovenere sur le navire qui allait la mener en France pour aller célébrer son union avec Henri II en septembre 1533, Catherine de Médicis emportait avec elle bien plus qu’un simple bagage à main. Outre ses malles à vêtements et ses coffres à bijoux elle emportait un véritable garde-manger. En plus des empoisonneurs dont on n’a pourtant jamais pu prouver l’existence, sa suite princière comptait des marmitons, un échanson, des boulangers, des pâtissiers et quelques uns des plus fins cuisiniers.
Le scepticisme de Catherine à l’égard de la cuisine française était véritablement fondé car, en ce début du XVI° siècle, la gastronomie des bords de Seine faisait bien piètre figure.
La cour française de l’époque était toujours attachée aux principes de l’abondance issus du Moyen Age. Un repas composé selon les règles se devait de refléter la richesse de la maison – un ingrédient exotique et onéreux important plus alors qu’un bon produit du terroir -. La confection d’un plat nécessitait de multiples étapes plus complexes les unes que les autres et l’assaisonnement dégénérait le plus souvent en orgie d’épices. À la fin du repas, les convives avaient coutume de se livrer à un petit jeu qui les amusait beaucoup : reconstituer par devinette la liste des ingrédients nécessaires à la confection des plats dégustés ! La France ne semblait pas réceptive au vent nouveau qui soufflait depuis la traduction par Maestro Martino du plus grand ouvrage italien consacré à la gastronomie et aux arts de la table, Liber de Arte coquinaria de Bartolomeo Sacchis. De même, le traité De Honesta voluptate et valitudine de l’humaniste, également connu sous le nom de Platina, dans lequel il s’efforce d’établir les règles de la cuisine raffinée, restait lettre morte.
L’entrée sur la scène politique et culinaire de Catherine provoqua une véritable révolution de palais. Son mariage, habilement organisé par le pape Clément VII, tira les cuisiniers de leur léthargie. À la fois gourmande et fin gourmet, Catherine interdit que l’on servit en même temps les plats sucrés, aigres, piquants et salés, et ordonna que l’on présente des mets dont la composition s’harmonisait agréablement. La débauche de plats n’était plus à l’ordre du jour. Les banquets déstructurés firent place à une véritable cérémonie de la table, où l’on servait les plats les plus fins et où l’élégance et les conversations de bon ton étaient de mise. Les coupes grossières devaient bientôt laisser place aux élégants verres de Venise. De Faenza on fit venir de la vaisselle en terre vernissée, la faïence. C’est Catherine qui introduisit en France l’usage de la fourchette [2] […]
Elle ne s’en tint pas là. Elle redora le blason des produits de base tels que l’huile et les haricots. Elle encouragea la confection de spécialités comme la pintade aux marrons, la fricassée, la daube, les pâtés, les sorbets. L’un de ses pâtissiers, Jean Pastilla, nous laissa la pastille. Elle fit mettre en œuvre la distillation d’une liqueur élaborée selon la recette du monastère de Murate. Elle lança la mode des épinards à la florentine, faisait préparer les artichauts pour son époux, et on lui devrait encore d’avoir introduit le cépage trebbianno en France. Selon d’autres sources, elle aurait fait connaître aux Italiens le cépage cabernet.
En quelques mots, il était de bon ton à Paris de dîner à la mode de la reine Catherine. Des siècles plus tard, on honorait encore sa mémoire pour le coup de fouet qu’elle avait donné à la gastronomie française. Le grand Antoine Carême [1784 – 1833], le cuisiner favori de Napoléon et de Talleyrand, aimait affirmer que les grandes toques devaient étudier l’art des cuisiniers italiens de Catherine de Médicis avant de se lancer dans la grande cuisine française.
Anne Vanderloeve. La cuisine italienne. Fayard 1986
28 10 1533
Mariage de Catherine de Médicis et de Henri de Valois, duc d’Orléans à Marseille. Les rues de Marseille sont parsemées de fleurs de lys et de pétales de roses. Dans une galerie construite tout exprès dans la rue principale, les deux fiancés sont conduits devant le pape qui reçoit leurs serments […]
Le lendemain, après la messe de mariage où Catherine semble perdue dans sa riche toilette brodée d’or et son manteau garni d’hermine, une lourde couronne d’or sur la tête, les fêtes les plus éblouissantes se succèdent à nouveau, dont les héros ne sont pas les mariés mais le roi de France et Hippolyte de Médicis qui veut oublier ses amours malheureuses tandis que sa Catherine chérie est au lit avec son nouvel époux, ce que constate la cour tout entière, comme le veut la coutume.
Janine Lambotte. À l’ombre des Médicis. Londreys 1989
Sa façon de monter à cheval mena à la création d’un nouveau sous-vêtement féminin : Jusqu’alors les femmes s’asseyaient de coté sur leur cheval, les pieds reposant sur une planchette ; la Médicis montait le pied gauche à l’étrier et la jambe droite fixée sur la corne de l’arçon. Comme cette nouvelle mode de monte faisait parfois flotter haut la jupe, les grandes Dames de la Cour qui voulurent imiter l’Italienne furent bientôt dans l’obligation d’adjoindre à leur trousseau une pièce de lingerie qu’elles ne possédaient point jusqu’alors parce qu’elles n’en avaient pas encore éprouvé le besoin : un caleçon [que l’on nommera plus tard culotte].
Un chroniqueur
Marseille, toute honorée d’avoir ainsi l’honneur d’un mariage princier, se fendit d’une allée triomphale donnant sur le port : première mouture de ce qui deviendra la Canebière, prenant ce nom en 1672, qui lui viendra des nombreux champs environnants de chanvre – le cannabis – dont on fabriquait les cordages de marine.
La Canebière (autrefois la Cannebis) vient du provençal canebe, qui provient lui-même du latin cannabis, cannabis, m, signifiant le chanvre. En effet Marseille était l’un des plus grands comptoirs de chanvre au monde pour la fabrication et le commerce des élingues et cordages. En provençal, une canebiera est une plantation de chanvre, ou chènevière, en français. Ce chanvre est le Cannabis sativa, qui a un taux de THC – tétrahydrocannabinol – beaucoup trop faible pour engendrer quelqu’effet que ce soit.
Wikipédia
La vie s’est chargée de lui apprendre ce qu’aucune éducation n’enseigne jamais. À l’âge où l’on s’efforce d’inculquer aux enfants une morale claire, elle a découvert que le bien et le mal s’interpénètrent et qu’il est peu d’actions humaines qui ne participent à la fois de l’un et de l’autre. Des illusions, elle n’en a plus guère. Elle observe, enregistre, se tait. Elle a pris conscience de sa faiblesse, mais s’est aperçue qu’on pouvait en faire un atout. Elle sait à merveille se maîtriser. Son orgueil, elle le cache ; son intelligence, elle la masque ; sa violence, elle la réprime, sous les apparences de la plus séduisante douceur. De son enfance ballottée entre Rome et Florence, otage que se disputent les partis, à moins qu’ils ne la sacrifient, victime de marchandages matrimoniaux et politiques dans une Italie déchirée, elle se méfie de tout et de tous, elle est habitée par une crainte, une peur diffuses, d’autant plus inquiétantes qu’elles n’ont pas d’objet défini. En elle s’insinue un désir obscur, mal formulé peut-être, mais aigu : acquérir son indépendance, la maîtrise de son propre sort, et peut-être devenir celle qui mène les autres, au lieu d’être mené par eux.
[…] La France rêve d’Italie. Elle s’est mise à son école. Elle imite ses architectes, ses peintres, ses sculpteurs, ses poètes, ou les invite à venir en personne construire et décorer de merveilleux châteaux. La Renaissance y bat son plein. Catherine s’acclimate donc aisément. Pas de fautes de goût, pas de fausses notes : elle est, d’emblée à l’unisson.
Simone Bertière. Les Reines de France au temps des Valois. France Loisirs 1994
On peut à peu près deviner dans quelles dispositions se trouvaient ces deux enfants ; bien évidemment la décision de cette union avait été prise hors de leur consentement : il n’était pas question qu’il en soit autrement à cette époque et on faisait avec. Les aléas d’une enfance plutôt mouvementée avaient sans doute laissé chez Catherine un penchant sérieux pour la méfiance, d’autre part, – on était amoureux très tôt à cette époque – elle s’était éprise de son cousin et cardinal Hippolyte, et cela n’arrangeait pas du tout, mais alors pas du tout, les affaires de Clément VII, le marieur, lui-même un Médicis : si ces deux derniers descendants directes de Laurent le Magnifique se marient, la légitimité de la branche aînée des Médicis va s’imposer aux dépens d’Alexandre, mon fils [grand duc de Toscane de 1531 à 1537] Et cela ne se peut. Donc, Clément VII va éloigner Hippolyte en le nommant légat du pape en Hongrie, sans hésiter à lui demander à revenir pour participer aux joyeuses fêtes de mariage de Catherine, qui pourra apercevoir ainsi son amoureux au milieu des très nombreux invités.
Il en allait à peu près de même pour Henri : dans son malheur d’enfant privé de mère à 5 ans, remis comme otage à une nation ennemie à 7 ans, il avait trouvé sa force, son ancrage, son équilibre : tout cela dans un baiser, celui de la plus belle femme du royaume, qui allait se charger de son éducation sitôt veuve : Diane de Poitiers. C’est elle qu’il avait choisie et non Catherine. Sitôt libéré des geôles de Charles Quint, ils ne vécurent plus jamais séparés. Il n’aimera qu’elle. On ne peut dire qu’Henri ait trompé son épouse Catherine de Médicis avec Diane de Poitiers, car c’est bien la machine à broyer les individus qui a imposé à Henri une épouse alors que celui-ci avait déjà rencontré 7 ans plus tôt son grand amour. En mariant Catherine de Médicis à Henri, la famille de ce dernier le contraignait à assumer sa fonction de prince, puis de roi. Et on ne lui demandait rien d’autre que de se taire.
Tout alla bien les premières années ; Henri n’avait pas encore soufflé sur les braises du feu allumé 7 ans plus tôt, mais… mais, en dépit de louables efforts, le ciel s’assombrit car l’Italienne ne donnait pas d’enfants à la France, pas plus fille que garçon et que cela dura dix ans, dix longues années pendant lesquelles elle garda un statut bien fragile face à la toute puissance de la femme aimée du roi, celle qu’il avait choisie. L’affaire était sans conséquence tant qu’elle n’était que duchesse d’Orléans, mais la mort du Dauphin François en 1536, fit d’elle l’épouse du futur roi. Allait-elle connaître le sort des reines stériles ? Être obligée de retourner en sa Florence natale ? François I° s’était attachée à elle et lui dit clairement qu’il n’en était pas question.
Catherine étudiait toutes les pratiques suggérées par les magiciens et les sorciers. Selon Albert le Grand, l’herbe appelée verger du pasteur et la pervenche réduites en poudre et mêlées à des vers de terre donnaient aux femmes le désir de concevoir. Les cendres d’une grenouille, les génitoires d’un sanglier produisaient les mêmes effets. Selon Photius, un verre d’urine de mule bu chaque mois par une femme stérile la rendait féconde. Le doigt majeur et la chair d’un fœtus venu deux mois avant terme constituaient d’excellentes amulettes. Un autre auteur affirmait que le sang du lièvre et la patte arrière gauche d’une belette infusée dans du vinaigre étaient fort efficaces. Enfin, une ceinture faite de poils de chèvre, trempée dans du lait d’ânesse et portée au-dessus du nombril par la femme qui voulait engendrer, la rendrait mère d’un enfant mâle.
Ivan Cloulas. Diane de Poitiers. Fayard 1997
À cause, – ou malgré ? – tout cela elle fut finalement enceinte en avril 1543 : le garçon naquit en janvier 1544. La malédiction s’en était allée, le dysfonctionnement avait cessé : la belle mécanique se mit à tourner à plein régime : dix enfants en douze ans ! [3] et tout cela sans fatigue, dans une forme éblouissante qui lui permettait de suivre la cour dans ses déplacements permanents ; ces dix ans de stérilité lui avaient permis de n’avoir son premier enfant qu’à 24 ans : elle avait alors un physique d’adulte déjà solide ; on est ainsi plus à même de connaître des grossesses à répétition, surtout si, en plus on est doté d’une santé de fer. Dommage qu’elle n’ait pas testé finement les prises de ses potions : on aurait pu connaître la nature de celle qui avait marché, mais il est vrai qu’une stérilité qui cesse pour faire place à la fécondité est très souvent affaire que ne parviennent pas à expliquer même les gynécologues les plus avertis et la plupart de temps les potions n’y ont aucune place.
Ces usages de sorcellerie bien évidemment ne se limitaient pas aux seuls cas de stérilité féminine, mais englobaient bien tout le quotidien, avec, au premier rang, – à tout seigneur tout honneur – le nœud de l’aiguillette, sortilège jeté aux jeunes mariés pour qu’ils n’aient point d’enfant.
On distingue trois catégories de maléfices : le somnifique, l’amoureux, et l’ennemi. Le premier maléfice, le somnifique se fait par le moyen de certains breuvages, de certaines herbes, de certaines drogues, de certains charmes, et de certaines pratiques dont les sorciers se servent pour endormir les hommes et les bêtes, afin de pouvoir ensuite plus facilement empoisonner, tuer, voler, commettre des impuretés, ou enlever des enfants pour faire des sortilèges.
Le maléfice ennemi est tout ce qui cause, tout ce qui peut causer, et tout ce qui est employé pour causer quelque dommage aux biens de l’esprit, à ceux du corps, et à ceux de la fortune, lorsque cela se fait en vertu d’un pacte avec le démon.
[…] C’est un maléfice que d’empêcher l’effet du sacrement de mariage par le nouement de l’aiguillette, ou par quelqu’autre pratique superstitieuse. Que d’envoyer des loups dans les troupeaux de moutons et dans les bergeries ; des rats, des souris, des charansons ou calendres, et des vers dans les greniers ; des chenilles, des sauterelles, et d’autres insectes dans les champs pour gâter les grains ; des taupes et des mulots dans les jardins pour perdre les arbres, les légumes et les fruits. Que d’empêcher les gens de manger, en mettant à table sous leur assiette une aiguille qui a servi à ensevelir un mort. Que d’envoyer des maladies de langueur et de longue durée aux hommes et aux bêtes, en sorte que les uns ou les autres affoiblissent visiblement, sans qu’on les puisse secourir par les remèdes ordinaires. Que de faire mourir les hommes, les bêtes, et les fruits de la terre, par le moyen de certaines poudres, de certaines eaux, et de certaines autres drogues magiques… Que de faire sécher une certaine herbe à la cheminée afin de tarir le lait aux vaches… Que de tremper un balay dans l’eau, afin de faire pleuvoir, et de causer quelque dommage à son prochain… Que de briser les coques des œufs mollets, après en avoir avalé le dedans, afin que nos ennemis soient ainsi brisés… Que de se servir de l’os d’un mort pour faire mourir quelqu’un, en faisant certaines actions et en récitant certaines paroles… Que de faire mourir les bêtes en les frappant d’une baguette, et en disant : Je te touche pour te faire mourir… Que de faire des figures de cire, de boue, ou de quelqu’autre matière, de les piquer, de les approcher du feu, ou de les déchirer, afin que les originaux vivans et animés ressentent les mêmes outrages et les mêmes blessures dans leurs corps et dans leurs personnes… Que d’attacher à une cheminée, ou faire griller sur un gril, certaines parties d’un cheval, ou de quelqu’autre animal mort par maléfice, et de les piquer avec des épingles, des aiguilles, ou d’autres pointes, afin que le sorcier qui a jeté le maléfice sèche peu-à-peu, et meure enfin misérablement… Que d’exciter des tempêtes, des grêles, des orages, des foudres, des tonnerres, des ouragans, afin de venger quelque injure reçue… Que d’empêcher les personnes de dormir, en mettant dans leur lit un œil d’hirondelle. Que de procurer la stérilité aux femmes, aux cavales, aux vaches, aux brebis, aux chèvres, etc, afin de causer du dommage à ses ennemis. Que de faire ce qu’on appelle cheviller (par ce sortilège, on empêche les personnes de faire leur eau…). Par le même maléfice, les sorciers enclouent aussi et font clocher les chevaux ; ils empêchent les vaisseaux pleins de vin, d’eau, ou autre liqueur, de pouvoir être tirés, encore qu’on y fasse une infinité de pertuis. Que de troubler les esprits des hommes, en sorte qu’ils perdent l’usage de la raison, ou de remplir leur imagination de vains phantômes, qui les fassent tomber en phrénésie, afin de tirer avantage de leur malheur, ou de les exposer au mépris des autres. Que de donner la male-nuit aux hommes et aux femmes (en brûlant un fagot, des chandelles ou en invoquant une étoile)… Que de faire des imprécations contre quelqu’un en étaignant toutes les lumières du logis, en tournant le dos aux voisines, en se roulant par terre, et en récitant le psaume CVIII (CIX aujourd’hui). Que de faire mourir les poux et les autres vermines qui attaquent l’homme, en se frottant d’eau de puits ou de fontaines sous les aisselles, et en récitant certaines paroles.
Il existe encore une infinité d’autres maléfices que les sorciers et les empoisonneurs employent tous les Jours.
Jean Baptiste Thiers, curé du Perche, 1777
1 11 1533
Pour la rentrée universitaire de Paris, le Bâlois et recteur Nicolas Cop, lit un discours rédigé par Calvin qui y avait mêlé les idées d’Érasme, de Lefèvre et de Luther, mais avait surtout prôné la paix religieuse et dénoncé la persécution de ceux qui, purement et simplement, s’efforcent d’insinuer l’Évangile dans l’âme des fidèles. Il remettait ainsi en question le pouvoir absolu des institutions ecclésiastiques auxquelles il refusait toute dimension divine, mettant en avant la nécessité pour l’Église catholique de se réformer. L’affaire fera scandale. Nicolas Cop doit quitter Paris pour se réfugier à Bâle. Et Calvin s’échappe de sa chambre du collège Fortet et utilisant ses draps comme corde. Il va à Angoulême chez Louis du Tillet, un ami proche, curé de Claix en Poitou, chanoine et archidiacre d’Angoulême, ancien greffier du parlement de Paris, où il prend le pseudonyme Charles d’Espeville. Le curé a une maison plus que confortable, dotée d’une impressionnante bibliothèque de plus de 4 000 volumes. Et c’est là que, pendant un peu plus d’un an, avec quelques séjours à Tours, Orléans, il va rédiger le début de son œuvre majeure : Institution de la Religion Chrétienne. Il y rencontrera pas mal de monde, Rabelais inclus, mais celui-ci avait la vocation de mécréant : Les autres, comme Rabelais […] après avoir goûté l’Évangile, ont été frappés d’un même aveuglement. En octobre 1534, l’affaire des placards le contraindra à quitter Angoulême accompagné de son très cher hôte et ami Louis du Tillet pour retrouver à Bâle Nicolas Cop.
1533
Henri VIII d’Angleterre répudie sa femme Catherine d’Aragon pour épouser Anne Boleyn, mariage que l’archevêque de Canterbury déclare nul : le Parlement, fortement orienté par le tout puissant Thomas Cromwell, qui est un peu à Henri VIII ce que sera Richelieu à Louis XIII, vote alors l’Acte de Suprématie qui enlève tout pouvoir au pape en Angleterre ; le roi devient le chef de l’Église d’Angleterre. La réforme sera imposée au prix de centaines de victimes pendues ou éventrées : cardinaux, archevêques, évêques, abbés, moines prêtres et laïcs, dont Thomas More, chancelier du royaume, un des plus éminents penseurs anglais, qui s’était rangé à jamais dans le camp des fidèles au pape. Henri VIII se lassera de Thomas Cromwell, et rappellera de l’étranger Gardiner, qui n’aura de cesse de le torpiller… jusqu’à sa décapitation le 28 juillet 1540
En 2025, Arte donnera Wolf Hall, série toute de splendeur de Peter Straughan d’après le roman de Hilary Mantel, réalisée par Peter Kosminsky (RU, 2024, 6 × 55 min). Un voyage dans une Angleterre où la paranoïa croit avec l’étendue des pouvoirs de chacun et donc, au sommet, devient irrespirable.
Le parlement de Pau refuse de recevoir les lettres de créance de son président désigné par le roi de France, l’évêque de Rodez, parce qu’elles sont rédigées en français.
02 1534
À Münster, des anabaptistes (qui refusent le baptême pour les nouveaux nés, demandant à attendre l’âge de raison) guidés par deux Néerlandais, Jean Matthys et Jan Beukels – Jean de Leydes – s’emparent de l’hôtel de ville et de la direction de la cité : le délire prophétique va être pendant plus d’un an réalité quotidienne. Catholiques et Luthériens sont chassés comme impies au milieu d’une tempête de neige. Le reste de la population se fait rebaptiser. Tous les contrats, toutes les reconnaissances de dettes vont être brulées. On constitua des dépôts de vêtements, literie, mobilier, quincaillerie et nourriture gérés par sept diacres. La propriété privée de l’argent fut abolie. Des logements furent réquisitionnés pour de nombreux immigrants. Tous les livres furent proscrits, sauf la Bible, et on en fit un feu de joie devant la cathédrale. Aussitôt l’évêque de Münster avait commencé les hostilités contre la ville rebelle et réuni des troupes pour un siège. Celui-ci ne fit que renforcer l’exaltation et la tension dans la cité et la terreur que ses nouveaux chefs y firent régner. Jean Matthys ayant été tué au cours d’une sortie, Jean de Leyde, un enfant naturel qui avait d’abord été apprenti tailleur, puis marchand sans clientèle, devint le chef de la nouvelle Jérusalem. La législation sur le travail transforma les artisans en employés publics ; la polygamie publique fût instaurée (au seul bénéfice des hommes) et, tandis que la ville repoussait les troupes de l’évêque, Jean de Leyde se fit proclamer roi. Il s’habilla de robes somptueuses, s’entoura d’une cour, tout en imposant à la masse une austérité rigoureuse. Sa garde était composée d’immigrés. Toute opposition était sanctionnée par la mort. Inlassablement on disait à la population que le temps des tribulations touchait à son terme. Le Christ allait revenir, établir son royaume à Münster. De ce royaume, le peuple élu partirait, armé du glaive de justice, pour étendre l’empire de Dieu jusqu’aux extrémités de la terre.
Jean Delumeau. La peur en Occident. Arthème Fayard 1978
Mais dans la nuit du 24 juin 1535, les troupes s’emparèrent de la ville épuisée : le délire avait tout de même duré 15 mois ! Trois des quatre chefs anabaptistes furent pendus vivants dans des cages de fer, en haut du clocher de l’Église Saint Lambert : ils y restèrent non point six semaines, comme dans Perrine était servante, mais quatre siècles ! aujourd’hui, il n’y a plus trace de squelette, mais les cages sont toujours là !
15 08 1534
Iñigo de Loyola, treizième et dernier enfant, d’une famille basque très catholique a vu sa destinée prendre un cours nouveau au siège de Pampelune en 1521, quand un boulet lui frappa la jambe droite et lui fractura la gauche : il en eut une jambe plus courte que l’autre et les genoux raides. Mal rafistolé par les Français, il sera opéré à nouveau une fois rentré chez lui, puis encore une fois en espérant retrouver ses jambes d’avant : il s’attira alors un : eh bien toi, heureusement que tu n’es pas un mille pattes ! Il finira par avoir recours à une semelle compensée. Les très longues périodes d’alitement furent propice à sa conversion, et Iñigo commença par un pèlerinage à Jérusalem, et poursuivit par des études à Barcelone d’abord, puis à Paris à Montaigu, où il devint Ignace, et au collège Sainte Barbe. Deux collèges… deux pédagogies bien différentes : à Montaigu, la chicotte régnait encore en maître : meurtrir la chair pour mieux graver les choses dans l’esprit et dans le cœur, disait Du Boulay. Érasme parle de collège vinaigre, Rabelais, de collège de pouillerie. À Sainte Barbe, l’humanisme était déjà à l’honneur.
Ce jour-là, réuni avec ses compagnons [4], en une chapelle de Montmartre [le mont des martyrs], ils forment le vœu d’une croisade spirituelle en Terre Sainte, prenant le parti de l’honneur et de la gloire de Dieu, avec le souci très net d’arracher l’homme à l’obsession luthérienne du péché. Ils jettent ainsi les bases de la Compagnie de Jésus : les Jésuites.

18 10 1534
Des placards contre la messe sont affichés à Amboise, – où se trouve alors François I°, jusque sur la porte de sa chambre -, Blois, Orléans et Paris. Une provocation d’un tel niveau, c’est une déclaration de guerre et c’est bien ainsi que l’entendit François I°. Le Parlement fait arrêter 200 personnes, dont 6 sont immédiatement brûlées. Loin de clore l’affaire, les bûchers parisiens vont se banaliser. En janvier 1535, 73 personnes, parmi lesquelles Clément Marot, suspectes d’adhérer à la Réforme et donc d’avoir trempé dans le complot d’Amboise, sont assignés à comparaître. Marot parvient à s’échapper et à se réfugier à Ferrare auprès de Renée de France [5]. Il abjurera en décembre 1536 à Lyon pour profiter des lettres d’absolution du Roi en date du 31 mai 1536.
1534
Soliman le Magnifique a fait depuis longtemps d’Anastasia Lisovska, esclave ruthène – région d’Ukraine d’obédience polonaise – et chrétienne la favorite de son harem de 200 femmes. Mon amour aux cheveux noirs et aux beaux sourcils, aux yeux langoureux et perfides, je chanterai toujours tes louanges. On la nommera Roxelane, qui se fait affranchir et fait la grève du lit tant que le sultan ne l’épouse pas : ce qu’il fait.
Conseillère officieuse mais influente, Roxelane participe à la planification des grands travaux lancés à La Mecque et à Jérusalem. Elle fait aussi construire un hôpital pour femmes, près du marché aux femmes esclaves d’Istanbul. La sultane consort se voit confier des missions diplomatiques auprès d’ambassadeurs des pays chrétiens. Allié de François I° contre Charles Quint, Soliman veut en effet assurer ses arrières. Sans que son époux s’y oppose, La rieuse s’immisce sans complexe dans les affaires intérieures. Elle obtient l’exécution de l’héritier présumé, fils né du premier mariage du sultan, puis celle du grand vizir Ibrahim Pacha, ami d’enfance de Soliman. Inspiratrice de fantasmes exotiques sur fond de querelles byzantines, la sultane Roxelane – qui repose dans un mausolée de la mosquée Süleymaniye d’Istanbul – a généré une riche littérature, plusieurs œuvres théâtrales, des films, des bandes dessinées et un opéra de Haydn.
jean-michel normand le Monde du 26 juillet 2020
Une épidémie de peste a ravagé la région du Bugey. Le destin d’Oncieu, à mi-chemin entre Lyon et Genève se joue autour du pré du seigneur du lieu, car en fait, auparavant, le village était à 300 mètres en contrebas. Ici, il y avait la demeure féodale, avec ce grand pré, qui était alors un verger d’au moins 80 pommiers. Les murs qui ceinturaient ce verger servaient aussi à protéger le bétail des serfs du village en cas d’invasions. Souvent à l’époque, pour éloigner la maladie après la mort, on brûle malades et maisons. Mais le maître des lieux, qui avait évidemment besoin de ses serfs, décide d’autoriser les survivants à reconstruire le village autour de son verger à condition qu’il n’y ait aucune ouverture donnant sur mon château et mes pièces de vie ! D’où la construction circulaire autour de ce pré et le peu de fenêtres ayant une vue vers l’intérieur du cercle, les quelques ouvertures visibles étant bien plus tardives.

19 05 1535
Un an plus tôt, le malouin Jacques Cartier s’est vu confier par le roi une somme de 6 000 livres et 3 navires pour faire le voyage de ce royaume en Terres Neuves […] où l’on dit qu’il doit se trouver grande quantité d’or et d’autres riches choses. Il a accosté au cap Boavista (côte de Terre-Neuve), découvert par Verrazano, et a longé les côtes du golfe Saint Laurent.
Pour son deuxième voyage, il appareille de Saint Malo avec 100 hommes répartis sur 3 navires, La Grande Hermine, la Petite Hermine et l’Émerillon – l’hermine est l’emblème des ducs de Bretagne et la Reine Claude de France la dernière duchesse de Bretagne. Il explore plus en profondeur ces nouvelles terres en remontant le Saint Laurent – il a commencé cette remontée le 10 août, jour de la Saint Laurent – sur environ 1000 kilomètres Au bout de son périple, il nomme Mont-Réal le village indien Hochelaga et retournant sur ces pas, il hiverne à Stadacone (l’actuelle ville de Québec). D’après ses conversations avec les Indiens, il apprend que des hommes viennent de l’ouest pour échanger et marchander de l’or ainsi que des pierres précieuses : il est à son tour convaincu que l’Asie est proche. Mais ce chemin de Canada [qui signifie amas de cabanes en Iroquois] [6], n’est bien qu’un fleuve : ce n’est donc pas le fameux passage du nord-ouest.
Ces mêmes Indiens lui font découvrir le maïs qu’il nomme gros mil, le tabac et sauvent ses hommes du scorbut – sur 110 hommes, 25 en étaient déjà morts, et 40 étaient gravement atteints – grâce à l’Annedda, une tisane à base d’écorce et de feuilles du sapin baumier, qui préserve et si besoin reconstitue le collagène ; celui- ci imperméabilise la paroi interne des plus fins vaisseaux sanguins, évitant ainsi les hémorragies. Le 3 mai 1536, il dresse à Stadacone une croix de 35 pieds – 9 mètres – de haut, ornée d’un écusson fleurdelisé portant l’inscription : Franciscus primus Dei gratia Francorum Rex regnat : Le roi de France François premier règne par la grâce de Dieu. Pour les Hurons, cela ne faisait qu’un totem de plus et ils s’en réjouirent.
En 1541, il organisera son troisième voyage pour fonder une colonie. De retour en France, il apprendra que les minerais rapportés des précédentes expéditions ne sont que du cuivre, du quartz et du mica, sans valeur aucune. Nous en restera le faux comme diamants du Canada. Un jour, de méchante humeur, il lâchera à propos du Canada… cette terre que Dieu donna à Caïn.

Dessin (colorisé) de Pierre Gandon (1899-1990)
16 07 1535
Estimant éloigné le danger de l’hérésie, François I° promulgue un édit de tolérance à Coucy.
1535
Genève se sépare du duché et de son évêque. Charles Quint lance une grande opération de représailles – 600 navires à Tunis – contre les corsaires qui infestent les côtes d’Afrique du Nord. Tunis et La Goulette vont rester espagnols jusqu’en 1574 : elles seront alors reprises par les Turcs.
Cortés, depuis 1529, a reçu licence de découvrir, conquérir et peupler lesdites îles, terres et provinces, c’est à dire les côtes ouest du Pacifique : Philippines, Moluques etc … s’est attaché au développement de la côte pacifique du Mexique : un chantier naval est crée à Tehuantepec, Huatulco devient le port qui assure les liaisons avec le Pérou, les ports de Santiago (Manzanillo), Zacatula, Chametla, Acapulco, sont crées. Il reconnaît et baptise les terres de la Sainte Croix, qui va devenir la Californie.
Il envoie deux bateaux et des secours à son cousin Francisco Pizzaro au Pérou : un des deux navires se perdra au retour, atteignant les Moluques avec un équipage décimé : le Portugais Antonio Galvão qui y était en poste découvrit à cette occasion l’ampleur des ambitions espagnoles sur ces rivages où le Portugal était jusqu’à présent le seul colonisateur. Mais, s’il n’est pas trop difficile de faire voile du Mexique vers l’ouest, le retour, lui, est beaucoup plus délicat : dans les zones tropicales, vents et courants s’y opposent et il faut aller bien au nord, ou au sud, pour trouver des courants vers l’est. Il faudra encore attendre pour que soient trouvées les routes praticables pour des navires de commerce.
Plus au sud encore, dans les immenses pampas qui deviendront l’Argentine l’Espagnol Pedro de Mendoza introduit le bovin et le cheval : ce dernier se multiplia si bien qu’au XIX° siècle, il aura perdu toute valeur marchande : Les chevaux appartenaient à qui voulait bien les dresser. Le prix d’une monture était si bas qu’à Montevideo ou à Buenos Aires même les mendiants allaient à cheval.
Jean-Paul Duviols. Introduction à Trois ans d’esclavage chez les Patagons 1856 – 1859, d’Auguste Guinnard. Aubier-Montaigne 1979
19 05 1536
Anne Boleyn, deuxième femme d’Henri VIII d’Angleterre, est décapitée : elle avait eu l’impardonnable tort de ne pas lui donner d’héritier mâle, seulement une fille : Élisabeth, qui sera reine, et des plus grandes, puisque la loi salique n’est pas appliquée en Angleterre. Pour contourner cet argument qui ne peut donc avoir valeur légale, on lui mettra sur le dos un adultère monté de toutes pièces. Henri VIII n’avait pas de maîtresses, il n’avait que des femmes : il en consomma tout de même six ! Ce bluff King Hall a vraiment la bosse du mariage, dira Paul Morand. Sa première épouse, Catherine d’Aragon, elle aussi, ne lui avait donné qu’une fille : Marie Tudor que ses penchants sanguinaires affubleront du surnom Bloody Mary.
10 08 1536
Le Dauphin François a disputé 8 jours plus tôt une partie de jeu de paume dans les prairies d’Ainay, près de Tournon. Le temps était à l’orage, lourd : Sebastiano de Montecucculi, l’un de ses gentilshommes, lui apporte de l’eau glacée. La fièvre le gagne et l’emmène à la mort. François I° ne peut croire à une mort naturelle, et accuse le gentilhomme italien, venu à la Cour avec Marie de Médicis, mais ayant autrefois servi Charles Quint, d’avoir empoisonné le Dauphin. Sous la torture, on parvient à lui arracher des aveux ; il se rétractera, mais rien n’y fera : il sera écartelé Place Grenette à Lyon, en présence de toute la famille royale.
1536
François I°, prend les terres de sa mère, Louise de Savoie. Megève devient française jusqu’en 1559. Et comme en Savoie, on connaît les vertus du lait, cela permit de le guérir d’une intoxication intestinale… à grands renforts de yaourt. Christian III, roi de Danemark, oblige tous les habitants de son royaume à se convertir au luthéranisme : il confisque les biens d’Église, emprisonne prêtres et évêques.
Niñez Cabeza de Vaca, parti à pied huit ans plus tôt du Texas, arrive à Mexico : on ne sait pas vraiment s’il était sage au départ, mais à l’arrivée il l’était, ça, c’est sûr : Le plus difficile fut de se séparer peu à peu des pensées dont se pare l’âme d’un Européen, et surtout de l’idée que la force de l’homme réside dans son poignard et sa dague qu’il met au service de Sa Majesté. Nous dûmes renoncer à de telles chimères jusqu’à ce que notre nudité intérieure fût celle d’un bébé à naître, commençant une nouvelle vie dans un univers de sensations qui nourrissent mystérieusement.
11 1537
Henri, fils de François I° guerroie au Piémont : À Fossan, proche de Moncalieri, le repos du guerrier se nomme Filippa Duci, union qui donnera naissance le 25 juillet 1538 à une petite Diane de France dont l’éducation sera supervisée par Diane de Poitiers. On enverra la maman d’abord au couvent, puis dans un manoir près de Civray. La fille, Mademoiselle la Bâtarde, épousera François de Montmorency, le fils d’Anne, connétable de France. La liaison de Henri et Diane de Poitiers suivra de peu l’escapade : elle avait jadis épousé son père, il mourait constamment de l’envie d’aimer sa mère.
Michel de Decker. Diane de Poitiers, Reine d’amour et de beauté. Flammarion 2007
8 12 1537
À Genève, Calvin met en place une véritable police des mœurs, contrôlant à domicile la foi et la vie privée des habitants. Les hérétiques sont passibles de la peine de mort.
L’ordonnance de Montpellier crée le dépôt légal des livres imprimés pour tenter d’empêcher la publication d’ouvrages hérétiques : chaque éditeur est tenu à déposer un exemplaire de chaque livre à la Bibliothèque royale de France. On a choisi cette date comme celle de naissance de la Bnf : Bibliothèque nationale de France.
La Bibliothèque nationale de France tire son origine de la bibliothèque (librairie) du roi, installée en 1368 au Louvre par Charles V (1364 – 1380), dans la tour de la Fauconnerie, et dont l’inventaire, dressé par Gilles Mallet en 1373, premier libraire du roi, comprenait 917 manuscrits. Conçue pour la première fois comme une véritable institution transmissible à son successeur, elle est privée de quelques belles pièces par les oncles de Charles VI (1380 – 1422) profitant de sa folie, puis disparaît sous l’occupation anglaise, après la mort du roi. Alors que Charles VII (1422 – 1461) est réfugié à Bourges, ce qu’il en reste est en effet prisé en bloc en 1424 pour 1 220 livres par le duc de Bedford, régent du royaume, qui l’emporte ensuite en Angleterre, où elle est dispersée à sa mort en 1435. Sur les 120 volumes retrouvés, 69 sont conservés au département des manuscrits.
C’est donc seulement à partir du règne de Louis XI (1461 – 1483) que la bibliothèque du roi connaît une certaine continuité, sans dispersion des collections. La bibliothèque, un temps transférée à Amboise par Charles VIII (1483 – 1498), puis à Blois par Louis XII (1498 – 1515), qui lui donne une véritable importance, est respectivement augmentée par ces derniers d’une partie de la bibliothèque des rois d’Aragon, rapportée de Naples, puis de manuscrits de la bibliothèque milanaise des Visconti et des Sforza. En 1544, elle est réunie à celle de Fontainebleau, fondée en 1522 par François I° (1515 – 1547), qui en confie la garde à Guillaume Budé et qui institue le dépôt légal en 1537. En 1568, elle est de nouveau installée à Paris par Charles IX (1560 – 1574), créateur de l’office de garde du Cabinet des Médailles, où elle subit les vicissitudes des guerres de religion. Après plusieurs déménagements sous le règne d’Henri IV (1589 – 1610) dans le quartier de l’Université, du collège de Clermont en 1595 au couvent des Cordeliers en 1604, puis, en 1622 sous Louis XIII (1610 – 1643), au collège Saint Côme, elle est confiée par Colbert à son bibliothécaire Pierre de Carcavy et installée en 1666 rue Vivienne, dans deux maisons voisines de l’hôtel du ministre. Sous la protection de ce dernier, elle connaît pendant le règne de Louis XIV (1643 – 1715) un important développement et est ouverte au public en 1692. Une fois nommé garde de la Bibliothèque du roi, l’abbé Bignon obtient en 1720 du Régent (1715 – 1722), son déplacement à proximité, dans la partie du palais Mazarin de la rue de Richelieu devenue l’hôtel de Nevers, où il l’organise en cinq départements, ce qui correspond au site Richelieu actuel. En 1733, sous Louis XV (1715 – 1774), Robert de Cotte et son fils, puis Jacques V Gabriel, entreprennent la fermeture par deux ailes de la cour d’honneur.
Avec la Révolution française, la Bibliothèque devient Bibliothèque nationale puis impériale ou royale au fil des changements de régime que connaît la France jusqu’à la stabilisation en 1870. Malgré une interruption du dépôt légal de 1790 à 1793, la Bibliothèque nationale s’enrichit fortement par l’entrée de fonds entiers, en provenance surtout d’abbayes, de collèges et d’universités supprimés, notamment parisiens, mais aussi de province. Elle a aussi reçu des documents confisqués à des notables émigrés ou des documents provenant de pays voisins occupés par les troupes de la République puis de l’Empire. En 1833, elle réunit à nouveau l’hôtel Tubeuf, bâti en 1635, au palais Mazarin. Puis en 1868, elle s’agrandit dans les bâtiments reconstruits par Henri Labrouste, comprenant la salle de lecture, avant d’occuper la totalité de l’îlot, après l’inauguration, en 1936, de la salle ovale conçue par Jean-Louis Pascal et achevée par Alfred Lecoura. Les redéploiements et rattachements de sites effectués à Paris en dehors du quadrilatère Richelieu, à l’Arsenal en 1934, à l’Opéra en 1935 et dans le bâtiment Louvois édifié à proximité en 1964, n’empêchent pas la saturation du site historique. En 1979, les collections se déploient en province avec la maison Jean Vilar ouverte en Avignon.
[…] À partir de 1988, la Bibliothèque nationale entre dans une phase d’importantes mutations, lorsque le , François Mitterrand, conseillé notamment par Jacques Attali, annonce la construction et l’aménagement de l’une ou de la plus grande et la plus moderne bibliothèque du monde… qui devra couvrir tous les champs de la connaissance, être à la disposition de tous, utiliser les technologies les plus modernes de transmission de données, pouvoir être consultée à distance et entrer en relation avec d’autres bibliothèques européennes.
La coordination de ce projet, qui est inclus dans les Grands Travaux de François Mitterrand, est confiée au journaliste et écrivain Dominique Jamet, qui devient président de l’établissement public de la Bibliothèque de France. Le site choisi se situe dans le nouveau quartier de Tolbiac, 75013, à l’emplacement d’une ancienne verrerie, au cœur de la ZAC Rive-Gauche, alors le principal secteur de renouvellement urbain de la ville. Le projet architectural de Dominique Perrault est retenu par le concours international d’idées de la bibliothèque avec un jury d’architectes et de personnalités culturelles. La nouvelle Bibliothèque nationale de France, achevée en 1995, ouvre au public le et, après le déménagement de la majeure partie des collections de la rue Richelieu, accueille les chercheurs au Rez-de-jardin le .
Wikipedia
Toute bibliothèque qui se respecte a son enfer :
Peut-on se rendre en Enfer ? Assurément, et ce, grâce à la Bibliothèque nationale de France. Au sein des livres rares de la BnF, une section méconnue du grand public est dédiée à la conservation des livres érotiques ayant un intérêt artistique et littéraire. Le Figaro vous retrace l’histoire de l’Enfer de la BnF ainsi que les nouveaux livres récemment acquis avec Jean-Marc Chatelain, le directeur de la Réserve des livres rares et l’actuel passeur de l’Enfer, à l’instar de Charon dans la mythologie grecque.
En 1750, avant que le nom d’Enfer apparaisse, la BnF publie un catalogue des livres imprimés avec une section à part, celle des ouvrages licencieux. Les livres concernés, une trentaine, sont alors tous à caractère érotique. Dès le départ, ça n’est ni un enfer politique, ni un enfer idéologique ou même religieux mais bien un enfer érotique, explique Jean-Marc Chatelain. Ce n’est pas une licence de pensée, mais de mœurs.
À partir du XIX° siècle, les questions de moralité se posent avec une acuité plus grande. Ce qui était alors simplement reconnu comme un sous-domaine de la littérature est désormais considéré comme une atteinte à l’esprit public. On passe du livre licencieux au livre dangereux, raconte le directeur. Certains écrits sont jugés si pernicieux qu’ils sont détruits et ironiquement, brûlés hors de l’Enfer. Cela s’est notamment fait à l’époque napoléonienne, en amont de la bibliothèque, par des décisions de police. Je le regrette parce qu’on a perdu une partie de cette littérature, bien qu’elle ne soit pas totalement inoubliable, assure Jean-Marc Chatelain.
L’occurrence du terme enfer pour désigner les ouvrages contraires aux bonnes mœurs est finalement attestée pour la première fois en 1844, bien qu’une telle désignation préexistait certainement dans les années 1830. Ces livres ne suivaient pas les chemins traditionnels d’édition, mais étaient alors publiés dans la clandestinité, sous le manteau. Selon Chatelain, les auteurs du XVIII° siècle risquent la Bastille, et le Marquis de Sade en est l’exemple le plus célèbre.
Ironie du sort : avec le mouvement de libération des mœurs des années 1960, la bibliothèque décide de clore la cote Enfer… en 1969. À ce moment-là, on a donc envoyé les livres érotiques dans les autres classes de la bibliothèque : si c’était de la poésie érotique, l’ouvrage allait dans les livres de poésie, si c’était des romans érotiques, dans les romans etc , détaille Jean-Marc Chatelain. Les portes de l’Enfer seront finalement rouvertes en 1983, pour des questions pratiques, la littérature libertine correspondant à un domaine de création littéraire ayant sa personnalité propre. Cependant, les bases étaient tout à fait nouvelles. Pendant longtemps, l’Enfer était simplement juxtaposé aux livres rares car il répondait aux mêmes conditions de communication, mais à partir de 1983, on l’a complètement intégré à la Réserve des livres rares analyse le directeur. L’Enfer n’a eu que 14 ans de purgatoire, finit-il par plaisanter.
Aujourd’hui, l’Enfer de la BnF continue d’être enrichi, même s’il ne correspond plus qu’à une manière de rangement. Jean-Marc Chatelain et son équipe continuent d’acquérir des livres de la section de la même manière que pour les livres rares. L’Enfer est le regroupement des livres rares dans le domaine de la littérature érotique, résume-t-il. Pour les sélectionner, l’équipe achète les livres soit auprès de libraires spécialisées, soit dans des ventes publiques. Nous portons un jugement de rareté, et nous nous basons sur le marché du livre rare, ajoute-t-il. En définitive, une forme de jugement dernier ?
Récemment, la collection de l’Enfer s’est agrandie avec trois nouvelles acquisitions. Une édition revue et corrigée de 1791 d’un roman paru en 1770 – 1771 intitulé Vénus en rut ou vie d’une célèbre libertine, une édition originale de La Cauchoise ou Mémoires d’une courtisane célèbre, et enfin un poème érotique de l’auteur surréaliste George Hugnet, Jeune maman, publié en 1964 et tiré à seulement 10 exemplaires. Notre idée était de compléter notre fonds de grands classiques de la littérature libertine, comme Le portier des Chartreux ou l’histoire de Dom Bougre, Margot la ravaudeuse, Thérèse philosophe etc… On essaye de compléter avec certains textes manquants, ou avec les différentes éditions qui permettent de voir si le texte a évolué d’une édition à une autre, explique-t-il.
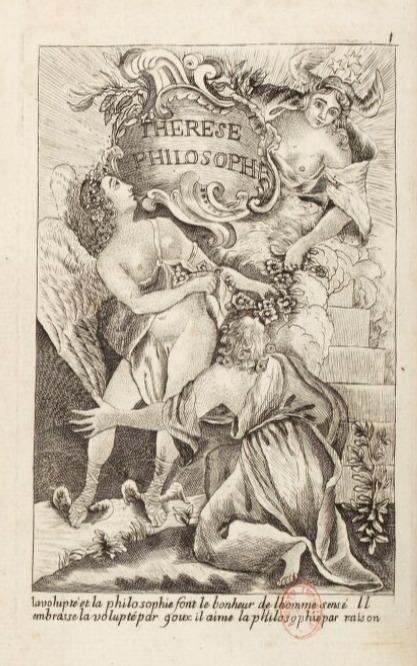
Frontispice de Thérèse philosophe. Bibliothèque nationale de France.
Par leur publication clandestine, ces livres qu’on ne lit que d’une main sont imprimés avec de faux noms pour la ville et l’éditeur, en conservant un aspect explicitement grivois. Ainsi, Vénus en rut, aurait été imprimé à Luxurville, chez Hercule Tapefort, imprimeur des Dames, et La Cauchoise à Libidinus, Chez Sensualité, à la Délicatesse, rue du Tempérament. Cette dernière acquisition a la particularité d’avoir un chapitre dans lequel est décrite une bibliothèque érotique, qui énumère d’autres titres libertins. C’est en quelque sorte une manière de faire entrer l’Enfer dans l’Enfer, souligne le directeur, comme une mise en abyme de la collection de la BnF.
Ces ouvrages, nouvelles acquisitions comme anciennes, peuvent être consultés par tout lecteur justifiant d’une recherche, qu’elle soit universitaire ou de curiosité personnelle. Cependant, ils ne peuvent être consultés que dans la salle de lecture des livres rares, et aucun des livres ne peut être sorti, à l’image d’Eurydice. L’Enfer, c’est pour l’éternité, conclut facétieusement Jean-Marc Chatelain.
Romain Ferrier. Le Figaro du 26 07 2024

Pandemonium est la capitale de l’Enfer dans le poème épique Paradise Lost du poète John Milton.
1537
André Vésale, né à Bruxelles, se rend à Padoue, la plus prestigieuse des écoles de médecine, muni d’une licence obtenue à Louvain, pour s’y inscrire pour une maîtrise : après deux jours d’examen, l’étendue de ses connaissances se révèle tel qu’on lui accorde son doctorat avec mention et que le lendemain, il acceptait un poste de lecteur en chirurgie et en anatomie. Son De humani corporis fabrica libri septem compte au nombre des plus grands ouvrages scientifiques jamais écrits, et il sonne le glas du règne de Galien sur les esprits. Deux ans après son arrivée à Padoue, il jouissait déjà d’une réputation qui lui permettait quelques petits arrangements avec le juge au tribunal criminel de Padoue, qui se débrouillait, à l’occasion pour différer ou accélérer des exécutions en fonction des besoins de cadavres à disséquer de l’anatomiste. Il était alors déjà en mesure de prouver que les descriptions anatomiques de Galien correspondaient au corps d’un singe et non à celui d’un homme. Une ou deux décennies plus tard, Gabriele Fallope redécouvrait, après des siècles d’oubli les trompes de Fallope, minces conduits qui relient les ovaires féminins à l’utérus et Bartomoléo Eustacchi, les trompes d’Eustache qui assurent la communication entre l’oreille moyenne et le haut du pharynx.
Avec la bulle Sublimis Deus, le pape Paul III condamne l’esclavage des Indiens : c’est bien, se dirent les personnes concernées, ainsi nous pourrons continuer nos opérations de traite avec les Noirs, puisqu’ils ne sont pas Indiens.
Domenico Bolani est ambassadeur de la Sérénissime à la cour d’Angleterre. Il a prêté sa maison de Venise à Pietro Bacci, dit l’Arétin (car né à Arezzo) pamphlétaire déjà connu, et ayant donc déjà eu des ennuis avec les grands. Il remercie le propriétaire de cette maison :
J’aurais l’impression, noble sire, de pécher par ingratitude si je ne payais en éloge une partie de ma dette pour la divine beauté du site où est bâtie votre maison. L’habiter est le plus grand plaisir de ma vie car d’en bas, d’en haut et de droite à gauche, sa position est sans défaut. Ainsi, j’hésite à analyser les mérites comme on le fait pour ceux de l’empereur. Son bâtisseur a choisi le plus beau côté du Grand Canal. Celui-ci est le patriarche de tous les autres canaux, Venise papesse de toutes les autres villes, je peux donc vraiment dire que je jouis de la plus belle vue et de la rue la plus animée du monde. Je ne peux me mettre à la fenêtre sans voir des milliers de gens et autant de gondoles à l’heure du marché. À droite, la vue découvre le campo delle Beccarie et la Pescheria, le champ gauche embrasse le pont et le Fondacco dei Tedeschi ; à la croisée des deux, le Rialto où se pressent les marchands. Il y a pour moi des vignes sur les chalands, le gibier à poils et à plumes dans les boutiques, le potager sur le sol. Peu m’importent les ruisseaux arrosant les prés quand à l’aube je regarde l’eau couverte de toutes sortes de produits de saison. Quel joli passe-temps, le manège des convoyeurs distribuant des tas de fruits et de légumes aux porteurs qui les acheminent !
Mais chansons que tout cela à côté du spectacle des vingt ou vingt-cinq bateaux à voile chargées de melons, serrés les uns contre les autres, qui forment une sorte d’île où la foule se presse pour en apprécier la qualité à l’odeur et au poids. Des belles épouses étincelantes de soie, d’or, de bijoux, magnifiquement installée dans leurs gondoles, je ne parlerai pas pour éviter de jeter un discrédit sur le renom de la fête. Mais je veux dire que je ris à m’en décrocher la mâchoire quand éclatent les cris, les sifflements, le tapage des gondoliers derrière celles qui se font conduire par des serviteurs sans chausse écarlates. Et qui pourrait se retenir de pisser sous lui en voyant chavirer, au cœur de l’hiver, une barque chargée d’Allemands tout juste échappés de la taverne comme nous l’avons vu, l’illustre Giulio Camillo et moi ? Sa plaisanterie habituelle est de me dire que à l’entrée de ma maison du côté terre, sombre, tordue, avec son escalier atroce, lui paraît assortie à la renommé de terreur que je me suis acquise en étalant la vérité au grand jour ; mais il ajoute : à me fréquenter, mon amitié pure, sincère et naturelle apporte la joie tranquille qu’on éprouve en passant ma porte pour se mettre à mon balcon. Pour que rien ne manque au délices des yeux, on a à accommoder d’un côté les orangers, qui dorent les pieds du palais des Camerlingues, de l’autre le canal et le pont de Saint Jean Chrysostome. Le soleil d’hiver n’ose jamais se lever sans saluer d’abord mon lit, mon bureau, ma cuisine, mes chambres et mon salon. […]
En somme, si je pouvais donner à tous mes sens, dont celui du toucher, autant d’aliments qu’à ma vue, la maison dont je fais l’éloge, me serait un paradis, car elle m’offre tous les objets de distraction possibles. N’oublions pas les grands maîtres d’ici et d’ailleurs qui franchissent régulièrement mon seuil, ni la fierté qui ma transporte au ciel à la parade du Bucentaure, ni les régates, ni les fêtes, gloires continuelles du canal, sous le règne de mon regard. Que dire des lumières dans le soir, pareilles à des étoiles éparpillées, là où se vend la substance de nos déjeuners et de nos dîners ? Et des musiques qui, tard dans la nuit, me chatouillent les oreilles de leurs accords harmonieux ? on aurait le temps d’aller au fond de votre profonde intelligence des lettres et de la politique avant d’épuiser les plaisirs que me procure ce spectacle confortable. Si quelques esprit porté par un souffle de talent anime ces balivernes que j’écris, ce n’est pas à la faveur de la brise, de l’ombre, des violettes et de la verdure, mais plutôt des grâces que répand l’heureuse atmosphère de votre maison.
L’Arétin. Lettre à Domenico Bolani

Pont du Rialto
14 07 1538
Charles Quint et François I° ont joué à cache cache voilà un peu plus d’un mois au pied du château de Nice… dont le duc de Savoie a refusé de donner les clefs : on s’est causé via des intermédiaires, tout cela sous le parrainage du pape, mais il n’en est pas sorti grand’chose. Cette fois-ci, c’est à Aigues Mortes que se rencontrent les deux souverains, François I° y arrivant par terre, Charles Quint par mer à bord de ses galères. On s’embrasse, on fraternise, on échange collier de la Toison d’Or contre ordre de Saint Michel. On parle de beaucoup de choses, avant tout des ennemis communs, mais on gomme soigneusement tous les sujets qui fâchent. Il en est comme de ces beaux rêves, qui ne vous laissent au réveil que le déplaisir de les avoir crus vrais .
8 09 1538
Jean Calvin et Guillaume Farel, ont fatigué les Genevois, qui les chassent : le premier se réfugie à Strasbourg, le second retourne à Neufchâtel.
27 09 1538
Les Turcs mettent en fuite, pratiquement sans combattre la flotte de la Sainte Ligue Chrétienne, essentiellement celle du Génois Andrea Doria à la Prevesa, le lieu même de la bataille d’Actium, où quinze siècles plus tôt Octave défit Antoine et Cléopâtre. L’Islam prend la maîtrise de la Méditerranée pour 30 ans. À cette période, Soliman le Magnifique reconstruit les portes et remparts de Jérusalem.
1538
À Prévéza (à l’embouchure du golfe Ambracique, dans le nord-ouest de la Grèce) la flotte ottomane prend le dessus sur l’armada espagnole.
Les soyeux lyonnais obtiennent le monopole de la fabrication des soieries pour toute la France. Michel Servet est condamné pour son Apologie de l’astrologie appliquée à la médecine. Jugé et condamné, il s’évade. Condamné par contumace le 17 juin 1553 il est brûlé en effigie.
Aux questions des premiers missionnaires concernant leur mode de nourriture, les aztèques avaient répondu : el maiz, el frijol, el amaranto ; le maïs, les haricots et l’amarante. Cette dernière était respectée au point d’être intégrée à des rites au cours desquels ses graines, aspergées du sang des sacrifices humains, étaient distribuées aux fidèles qui les mangeaient. La chose était évidemment inacceptable pour les missionnaires, et l’Inquisition se chargea d’éradiquer l’amarante, qui en effet, disparut du Mexique. Et pourtant, c’est la seule céréale sans gluten, plus riche que le blé en protéines, lipides non saturés, fibres, calcium ou fer.
La première imprimerie des Amériques s’ouvre à Mexico, mais ce n’est pas pour éditer des livres aztèques : c’est le frère Juan de Zumárraga qui s’en est chargé, aidé par un juif converti, Jacobo Cromberger ; de 1536 à 1543, il est à la tête de l’Inquisition mexicaine, par l’intermédiaire de laquelle il va se charger de la destruction de la plus grande partie de l’importante littérature aztèque. Par la corruption et la torture, il fit sortir de leurs cachettes une quantité ahurissante de livres et de tableaux, surtout de la ville de Tezcuco, qu’il fit entasser sur la place du marché de Tlaltelolco et brûler : les témoins racontèrent que le feu dura plusieurs jours. L’Inquisition veillait vraiment à tout. Il dut y avoir tout de même ça et là quelques réactions : Élisée Reclus parle des prêtres qui, se refusant à admettre le caractère divin du Momotombo, un volcan du Nicaragua, y furent précipités par les indigènes.
Un peu plus tard, ce sont les Mayas qui bénéficieront de la sollicitude de l’Église catholique : En 1527, les Espagnols commencèrent à envahir les Mayas, mais ils ne soumirent la dernière principauté qu’en 1697. Ainsi, ils purent observer les sociétés mayas indépendantes pendant presque deux siècles. L’évêque Diego de Landa joua un rôle extrêmement important à cet égard, en bien comme en mal. Entre 1549 et 1578, il résida la plupart du temps dans la péninsule du Yucatán. Dans ce qui reste l’un des pires actes de vandalisme culturel de l’histoire, il brûla, pour éliminer le paganisme tous les manuscrits mayas qu’il put trouver, de sorte qu’il n’en reste que quatre. Puis il rédigea une description détaillée de la société maya et il recueillit auprès d’un informateur une explication embrouillée de l’écriture maya, laquelle, près de quatre siècles plus tard finit par livrer des indices pour son déchiffrement.
Jared Diamond. Effondrement. Gallimard 2005
Diego de Landa a décrit les spectacles qu’il a pu voir dans le temple de Kukulcan, à Chichén Itzâ où existaient deux théâtres face à l’escalier nord. Pour accélérer l’acculturation, les religieux y interdirent les représentations théâtrales mayas. Les Indiens ont des récréations très drôles et des comédiens qui jouent des farces avec beaucoup d’esprit… Ils ont des petites timbales qu’ils frappent avec la main, et une autre timbale faite d’un tronc creux, au son lourd et triste, qu’ils font résonner avec un long bâton, au bout duquel est attaché le fruit d’un arbre ; ils ont des trompettes longues et fines en bois creux, se terminant par des calebasses longues et tordues ; un autre instrument est fait d’une tortue entière : une fois qu’ils en ont sorti la chair, ils frappent la carapace avec la paume de la main, c’est un son lugubre et triste. Ils ont des sifflets en os de pattes de cerf, de gros coquillages et des flûtes de roseaux ; avec ces instruments ils font de musique pour les danseurs et ils ont deux danses, très viriles, qui méritent d’être vues. L’une est un jeu de joutes, qu’ils appellent colomché : ils font une grande ronde de danseurs en suivant le rythme de la musique ; en cadence, deux danseurs sortent de la ronde, l’un avec une poignée de javelots qu’il tient dressée tout en dansant, l’autre danse accroupi, tous deux au rythme de la ronde ; et celui qui tient les javelots les lance de toutes ses forces à l’autre qui, avec une grande habileté, muni d’une petite batte, les dévie ; quand il a tout lancé, il revient au même rythme dans la ronde et deux autres en sortent pour faire de même. Il y a une autre danse que dansent peu ou prou huit cents Indiens munis de petites bannières, au son et du pas long de la guerre ; parmi eux il n’y en a pas un qui ne suive en rythme ; et dans leurs danses ils sont pesants, car ils passent toute la journée à danser sans prendre de repos.
Landa ne s’est intéressé aux Mayas que pour mieux les connaître et ainsi avoir les meilleurs discours possibles pour les endoctriner. Il sera l’auteur d’une des plus importantes études sur les Mayas : Relation des choses du Yucatán. En 1562, il fera brûler dans l’autodafé de Mani 5 000 idoles et 27 codex des anciens Mayas. Il sera rendu responsable de la torture de 4 500 Indiens.
Quelques codex échappèrent au massacre, par volonté délibérée des conquérants ou par simple oubli. Parmi eux, le Codex Borbonicus, qui finira par être achetée aux enchères du XIX° siècle par l’Assemblée Nationale de la France : Le Codex Borbonicus figure parmi les six écrits en possession de l’Assemblée nationale, interdits de sortie du territoire depuis les années 1960. Avec ses 14 mètres de long, ses trente-six feuillets au format carré de 39 centimètres de côté pliés en accordéon, il décrit dans les moindres détails les calendriers divinatoire et solaire employés par les Aztèques, avant la conquête de leur empire par Hernan Cortès, en 1519. Ce manuscrit nahuatl, dont deux pages sont manquantes, acheté en 1826 par le Palais-Bourbon au cours d’une vente publique, est de provenance inconnue. Il aurait été volé en Espagne, dans la bibliothèque de l’Escurial, soit au moment de l’occupation de l’Espagne par les troupes napoléoniennes en 1808, soit lors de l’expédition française dans ce pays en 1823, sous Louis XVIII.
Les Aztèques utilisaient simultanément deux calendriers : l’un divinatoire de 260 jours et l’autre solaire de 365. Le premier, le Tonalpohualli, ou compte des jours, comportait 20 semaines de 13 jours. Et le second, le Xiuhpohualli, ou compte des années, 18 mois de vingt jours auxquels s’ajoutaient cinq jours supplémentaires où il ne se passait rien. Une fois tous les 52 ans, une Fête du feu nouveau venait célébrer la ligature de ces deux calendriers.
Le Codex Borbonicus peut ainsi être décomposé en quatre sections : un Tonalpohualli, un cycle de 52 ans, un Xiuhpohualli et un second cycle de 52 ans suivi d’une cérémonie du Feu nouveau. Quand a-t-il été conçu ? Pour les premiers américanistes à l’avoir étudié, il ne faisait aucun doute qu’il était antérieur à la conquête de l’Empire aztèque par les Espagnols. Mais, remarquant qu’aucun des codex reconnus comme précolombiens ne représente un cycle de 52 ans, un Xiuhpohualli et une cérémonie du Feu nouveau, des spécialistes ont, depuis, affirmé qu’il a été élaboré dans les toutes premières années ayant suivi l’entrée de Cortès à Mexico-Tenochtitlan, le 8 novembre 1519.
Par ailleurs, si l’origine aztèque du document n’est, en général, pas contestée, des experts se sont étonnés de la grande place qui y est accordée aux festivités consacrées à Cihuacoatl, la déesse femme-serpent de la fertilité. C’est pourquoi, explique Nathalie Ragot, de l’Institut national des langues et civilisation orientales, l’idée a été avancée que le manuscrit fut fabriqué, non pas dans la capitale de l’empire, Mexico-Tenochtitlan, mais dans la région de la cité-Etat de Culhuacan dont cette divinité était en quelque sorte la patronne.
Tous s’accordent pour parler d’une œuvre hors norme, non seulement par son format – c’est le plus grand de tous les codex -, sa précision et ses qualités esthétiques, mais également par sa thématique. Ainsi, pour Danièle Dehouve, directrice de recherches émérite au CNRS à l’École pratique des hautes études, le Codex Borbonicus correspondrait à un récit, remontant au début de l’ère coloniale, de l’ultime fête du Feu nouveau qui fut organisée, en 1506 – 1507, dans l’Empire aztèque avant sa chute. Selon elle, les apparentes contradictions de dates du document trouvent naturellement une explication si l’on admet que les fins de cycles de 52 ans y donnaient lieu non pas à une mais à deux années de transition : la première consacrée à des fêtes agraires, la seconde à la cérémonie du Feu nouveau. Or, indique-t-elle, la profusion de détails figurant dans la description de ces rites implique que sinon les peintres, du moins les personnes qui les ont renseignés aient eux-mêmes été témoins de ces célébrations.
Contrairement aux autres codex coloniaux, le Borbonicus aurait ainsi été conçu par les Aztèques non pas dans le but d’expliquer aux envahisseurs leur système complexe de calendriers, mais avec l’objectif de leur démontrer, par la création d’une œuvre au sommet sur le plan de la maîtrise technique et artistique, consacrée à l’événement le plus fastueux resté dans les mémoires, la grandeur de leur civilisation.
L’intérêt porté au Codex Borbonicus s’explique par la rareté des documents méso-américains d’origine précolombienne, dont bien peu ont survécu aux autodafés de l’Inquisition. On n’en connaît qu’une vingtaine, dont cinq à peine, ceux dits du groupe Borgia, font à peu près consensus. Parmi eux, aucun n’a été produit par l’Empire aztèque ou par une population parlant sa langue principale, le nahuatl.
À cela s’ajoutent les ouvrages coloniaux. Ces quelque cinq cents manuscrits, réalisés entre le XVI° et le XVIII° siècle, furent exécutés par des indigènes, sur ordre des autorités de la Nouvelle Espagne, afin de mieux comprendre l’histoire et les coutumes des Indiens qu’il s’agissait d’administrer ou d’évangéliser.
L’étude approfondie des colorants a permis de conclure que Le Codex Borbonicus a bien été créé à l’aide de colorants conçus à partir de matières premières organiques connues pour avoir été employées par les populations méso-américaines d’origine précolombienne. […] Le papier d’amate, à base d’écorce de ficus battue, est le même d’un bout à l’autre du document, ce qui exclut la possibilité que deux codex aient été accolés. En revanche, on n’a trouvé aucun indice à même de révéler si l’almanach fut produit avant ou après la conquête espagnole.
Vahé Ter Minassian. Le Monde du 26 octobre 2017

La page 14 du Codex Borbonicus représente le dieu Xipe Totec, Notre seigneur l’écorché, qui incarne le printemps et le renouveau de la végétation. Le prêtre qui représentait Xipe Totec se livrait à un rituel particulièrement macabre : il écorchait une victime et portait sa peau comme un vêtement pendant vingt jours. Ensuite, il se débarrassait de cette vieille dépouille sanglante et puante afin d’annoncer la renaissance de la nature.

La page 13 du Codex Borbonicus représente la 13° trecena du calendrier aztèque, qui était placée sous les auspices de la déesse Tlazolteotl. Celle-ci apparaît en haut à gauche, donnant naissance à Cinteotl. La lecture se fait de bas en haut et de gauche à droite. Les cases sont numérotées de 1 à 13. Le premier jour de la treizaine est 1-Tremblement (1-Ollin), suivi de 2-Silex, 3-Pluie, etc. jusqu’à 13-Eau.
03 1539
Au Mexique, l’Eldorado du nord s’appelle Cibola : Le vice-roi, Antonio de Mendoza, confie à un franciscain, le frère Marcos de Niza (Nice), une mission de reconnaissance. Celui-ci prend pour guide un des anciens compagnons de Cabeza de Vaca, Estebanico. Parti en avant-garde avec des indigènes, Estebanico va être tué d’une flèche sous les murs de Cîbola (Zuñi ?), et Marcos de Niza ne pourra que contempler à distance la ville dont il imagina la richesse à défaut de la palper. Mais il avait vu les vastes plaines remplies de vaches et de taureaux différents de ceux que nous avons en Castille, et les villages avec leurs maisons à étages où l’on montait par des échelles.
De retour à Compostela, le franciscain fera au vice-roi un rapport aussi dithyrambique que controuvé… Sept villes de Cibola bâties dans les nuages d’un pays d’or.
Jean-Marie Auzias, Bernard Lesfargues. Introduction au Voyage et à la Relation de Cabeza de Vaca. Babel Actes Sud 1979
31 05 1539
Hernando de Soto, gentilhomme d’Estremadure, à la tête d’une flotte de 10 navires emmenant 900 hommes, 350 chevaux, débarque en Floride dans la baie de Tampa, domaine des Indiens séminoles, lesquels savaient très bien se défendre et surtout utiliser à merveille ce terrain de marécages très difficiles, pour les hommes et à plus forte raison pour les chevaux. Des Indiens séminoles, ils passèrent chez les creeks, aux confins de la Géorgie et de l’Alabama ; les batailles se succédèrent, coûteuses de part et d’autre en vies humaines. L’imagerie courante sur les Indiens nous les montre quasiment toujours à cheval… en fait les tribus indiennes établies à l’est du Mississippi n’adoptèrent pas le cheval et restèrent sédentaires ; ils faisaient même la guerre à pied. Ce sont les tribus à l’ouest du Mississippi qui connurent des épousailles avec le cheval : les Apaches et surtout les Comanches. Il découvrit le Mississippi. La mort de de Soto amorça le début de la retraite des Espagnols qui dura jusqu’en 1543 ; ils avaient eu 1 400 morts. Tout cela, sans avoir jamais trouvé d’or. C’en était fini des tentatives de conquête espagnole au nord du Mexique.
À l’ombre de la voûte en fleur des catalpas
Et des tulipiers noirs qu’étoile un blanc pétale,
Il ne repose point dans la terre fatale ;
La Floride conquise a manqué sous ses pas.
Un vil tombeau messied à de pareils trépas.
Linceul du Conquérant de l’Inde Occidentale,
Tout le Meschacébé par-dessus lui s’étale.
Le Peau Rouge et l’ours gris ne le troubleront pas.
Il dort au lit profond creusé par les eaux vierges.
Qu’importe un monument funéraire, des cierges,
Le psaume et la chapelle ardente et l’ex-voto ?
Puisque le vent du Nord, parmi les cyprières,
Pleure et chante à jamais d’éternelles prières
Sur le Grand Fleuve où gît Hernando de Soto.
José Maria de Hérédia. Les trophées. 1893. Le tombeau du Conquérant
août 1539
François I°, par l’Ordonnance de Villers Cotterêts, rend obligatoire l’usage du langage maternel françois pour la rédaction de tous les actes administratifs et judiciaires.
| Article 110. Que les arretz soient clers et entendibles. Et affin qu’il n’y ayt cause de doubter sur l’intelligence des dictz arretz. Nous voulons et ordonnons qu’ilz soient faictz et escriptz si clerement qu’il n’y ayt ne puisse avoir aulcune ambiguite ou incertitude, ne lieu a en demander interpretacion. | Article 110. Afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence des arrêts de nos cours souveraines, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir ambiguïté ou incertitude, ni lieu à demander interprétation. | |
| Article 111. Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d’oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement. | Article 111. Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d’oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel [7] françois et non autrement. |

Auteur inconnu. Musée Condé Chantilly
L’ordonnance de Villers- Cotterêts a en fait été précédée par une série d’édits similaires qui en annonçaient la teneur et la signification. La Chambre des Comptes s’étant réfugiée en Piémont, il crée à Chambéry un parlement qui deviendra plus tard le Sénat de Savoie. Dans le même temps, les ouvriers typographes de Lyon se mettent en grève au cri de tric, tric, – grève, grève – ils veulent être mieux nourris et que leur 13 à 15 heures de travail quotidien soient mieux payées : la création d’une caisse d’entre aide – maladie, accident, assistance judiciaire – les y aidera.
Le vieux cliché selon lequel la France serait alors coupée en deux zones, plus ou moins séparées par la Loire : un pays de langue d’oc, au sud de cette dernière et, au nord, un pays de langue d’oïl, relève tout bonnement de l’image d’Épinal. Car si, malgré la variété des cultures (toutes ne reçurent pas les mêmes influences arabes) et des langues (le gascon, le limousin, le béarnais, le catalan, le provençal, etc. présentent quand même d’évidentes différences), on peut néanmoins admettre l’existence, au Sud, d’une civilisation occitane ; pour ce qui est du Nord, une telle affirmation frise le vœu pieux. Comment prétendre, en effet, à l’existence d’une France d’oïl, quand les habitants de plus des deux tiers du territoire concerné parlent qui le breton, qui l’alsacien, qui le flamand ? Si bien que la zone d’influence des trouvères sera, par la force des choses, bien plus réduite que celle des troubadours.
Marc Robine. Anthologie de la chanson française. Albin Michel 1994
La France naturellement partagée par la Loire eut deux patois auxquels on peut rapporter tous les autres, le picard et le provençal… Si le provençal eût prévalu, il aurait donné au français l’éclat de l’espagnol et de l’italien ; mais le midi de la France, toujours sans capitale et sans roi, ne put maintenir la concurrence du nord, et l’influence du patois picard s’accrut avec celle de la couronne. C’est donc le génie clair et méthodique de ce jargon, et sa prononciation un peu sourde qui dominent aujourd’hui la langue française.
Rivarol
Malgré la résilience des pays d’oc, si colorée, les provinces du bassin de Paris ont pris effectivement la direction politique et sociale du couple oc/oïl.
À ce propos, on doit se méfier des néologismes : l’Occitanie, expression essentiellement politique forgée à propos des pays d’Oc, est passée dans le langage courant. Les militants ont imposé ce terme et même ce néologisme, à l’ensemble des citoyens. C’est devenu maintenant un mot usuel et commode, ce qu’on appelle aujourd’hui quelquefois un mot-valise, et il n’y a pas de raison d’employer ce concept occitan.
Je viens de mentionner les notions de développement septentrional et parfois de sous-développement dans les régions centrales, sinon méridionales. La Gaule celtique, si essentielle à l’époque de la conquête romaine, a aujourd’hui entièrement disparu, sauf en Bretagne occidentale où elle n’est du reste que le résultat d’une immigration haut-médiéval ou d’Antiquité tardive en provenance de la Cornouaille britannique. Pour l’essentiel, la France est une latinité globale, mystérieusement constituée entre le II° et le VII° siècle de notre ère, à partir d’une imprégnation romaine puis chrétienne. Cette latinité a donc été formée par une vague qui est allée du sud vers le nord jusqu’à l’Angleterre un moment romanisée elle aussi, mais pas pour très longtemps. Mais il y a latin et latin : il y a des gens qui parlent vraiment le latin, même décadent voire puissamment évolué, depuis la Gironde et l’Auvergne jusqu’à la Provence et au Béarn. Il s’agit de cette zone occitane où le latin, fut-il abâtardi, s’est quand même assez bien conservé en dépit ou à cause de l’influence wisigothe. Ce latin est devenu, au gré des uns ou des autres, tantôt le provençal, tantôt l’occitan, selon l’idéologie du locuteur. On évoquera aussi la zone dite franco-provençale : elle correspond grosso modo à la région Rhône Alpes, incluant également la Suisse romande et le sud de la Franche Comté. Il y a donc deux vastes minorités dans la France globale : une minorité occitane, cet adjectif ayant fini sur le tard par être imposé grâce aux efforts d’une certaine tendance ouest-rhodanienne. Elle prend la suite du royalisme mistralien et provençal… Elle est corrélée également au républicanisme languedocien. Vient ensuite la susdite minorité franco-provençale, elle-même circum-lyonnaise, dauphinoise, stéphanoise. Au nord, on peut parler effectivement d’une immense et dynamique Oïlannie, autrement dit imprégnée de langue d’oïl et quelque peu pénétrée de germanismes, légués eux-mêmes par les invasions du second tiers du premier millénaire. Pour ce qui est du reliquat celtique, ne substituent chez nous qu’un petit nombre, pas si petit que cela en fait, de mots d’origine gauloise.
Par delà ces trois ensembles vastes – oc, oïl et franco-provençal -, il y a de petites ou moyennes entités linguistiques qui surnagent aujourd’hui encore, reconnaissables grâce à l’accent mosellan ou autres. On signalera d’abord les minorités non latines : ainsi les Basques de France qui prolongent leur ci-devant turbulents voisins d’Espagne et dont la langue, presque totalement originale, est une survivance du néolithique, voire du paléolithique. Ont-ils vraiment des parentés lointaines avec certaines tribus du Caucase ? Les Basques représentent en tous les cas le plus vieux fond de population de l’indigénat de la France. On se référera également avec les peuples qui coïncident avec les Alémaniques et les Franciques respectivement d’Alsace et de Moselle.. Il y a enfin la petite minorité flamande autour de Dunkerque et Cassel, dans la plus vaste région du Nord-Pas de Calais, celle-ci jadis rattachée par les armées de Louis XIV. Retour aux Latins : on situera également les Catalans des Pyrénées-Orientales perpignanaises… et puis les Corses. Au total, une dizaine de régions linguistique aujourd’hui presque totalement francisés : Catalans, Basques, Occitans, Franco-Provençaux, Bretons, Flamands, Alsaciens, Lorrains, Corses et, last but not least, Oïl. Il faudrait aussi approfondir les problème des diverses régions de la langue d’oïl : Normandie, Île de France, Champagne, Bourgogne, etc.
Emmanuel Leroy-Ladurie. Une vie avec l’Histoire. Tallandier 2014
Dans l’université de Paris, aux XIII°- XIV° siècle, les étudiants se répartissaient en quatre nations selon leur langue – picarde, française, franco-allemande, normande -. Les dictionnaires d’aujourd’hui ne s’y trompent d’ailleurs pas, qui parlent des dialectes de langue d’oïl ce qui, encore, ne veut pas dire grand chose dès lors qu’ils n’ont pas de racines communes… et UNE langue d’oïl, cela ne peut avoir de sens que si l’on entend par là l’ancêtre de notre français aujourd’hui, né à Paris. Et les dialectes régionaux furent le seul langage parlé par une majorité des habitants de la moitié nord de la France jusqu’au début du XVIII° siècle. Il fallait bien un vrai courage politique pour prendre une telle mesure, car 150 ans plus tôt, le français était encore bien mal vu, au moins chez les enfants de chœur de Notre Dame de Paris, à l’attention desquels Jean Gerson, grand maître de l’université, avait établi un règlement spécifiant que : Item, que chacun accuse son camarade dans les cas suivants : s’il a entendu parler français, s’il a juré, s’il a menti.
*****
Le bilinguise, qui précède largement l’édit de Villers-Cotterêts (1539), n’est pas dû à une politique, mais à une représentation sociale de la langue, influencée par les transformations politiques. Il est le fruit d’un rayonnement culturel de l’État royal. Peu à peu, les élites du sud apprennent à mépriser leur langue maternelle et se convainquent que le bon usage est celui de la cour française. Dès lors, le bilinguisme se répand comme un signe des distinction, les élites utilisent le français entre elles et avec les gens du nord, tout en conservant l’oc pour le quotidien et les rapports avec les humbles. Les linguistes appellent ces deux emplois hiérarchisés disglossie.
Léonard Dauphant. Géographies. Ce qu’ils savaient de la France (1100 – 1600). Champ Vallon. 2018
Mais quel était donc ce français ? Car les versions que l’on en donne aujourd’hui sont bel et bien des traductions, que les professionnels nomment translation, qui nécessitent donc des traducteurs, dont le plus souvent on ne donne pas le nom. Le Seuil édite aujourd’hui des textes donnant l’original à coté de la translation.
Exemple : Le Tiers Livre de Rabelais. Janvier 1997. Édition établie, annotée et préfacée par Guy Demerson, professeur émérite à l’Université Blaise-Pascal (Clermont-Ferrand). Texte original établi par Michel Renaud et les chercheurs du laboratoire Equi XVI de l’université Blaise-Pascal (directeur : Marie-Luce Demonet) Avec une translation de Guy Demerson.
|
Comment les femmes ordinairement appetent choses defendues Chapitre XXXIV |
Comment les femmes d’ordinaire convoitent les choses défendues. Chapitre 34. |
|
| On temps (dist Carpalim) que j’estois ruffien à Orléans, je n’avais couleur de Rhétoricque plus valable, ne argument plus persuasif envers les dames, pour les mettre aux toilles (8) et attirer aux jeux d’amour que vivement, apertement, detestablement remonstrant comment leurs maris estoient jalous. Je ne l’avais mie inventé. Il est escript et en avons loix, exemples, raisons et experiences quotidianes. Ayans cette persuasion en leurs caboches, elles feront leur mariz coquz infalliblement, par Dieu ! sans jurer, deussent elles faire ce que feirent Seymyramis, Pasiphäé, Egeste, les femmes de l’Isle Mandès en Ægypte, blasonnées par Hérodote et Strabo(9), et aultres telles mastines. | Au temps, dit Carpalim, où je menais une vie de noceur à Orléans, je n’avais pas d’effet de rhétorique plus efficace ni d’argument plus persuasif à l’égard des dames pour les faire tomber dans mes panneaux et les attirer aux jeux d’amour, que de leur faire voir au vif, avec clarté, à quel point leurs maris étaient d’une jalousie insupportable. Ce n’est pas moi qui l’avais inventé : on le trouve dans les livres et nous en avons quotidiennement des expériences, des maximes, des exemples, des justifications. Une fois cette persuasion entrée en leurs caboches, elles feront leurs maris cocus infailliblement, par Dieu ! (soit dit sans jurer), dussent-elles faire ce que firent Sémiramis, Pasiphae, Egeste, les femmes de l’île de Mandès en Egypte, dont Hérodote et Strabon ont fait le Portrait, et autres levrettes du même genre. | |
| Vrayment (dist Ponocrates), j’ay ouy compter que le pape Jean XXII (10), passant un jour par l’abbaye de Coingaufond (11) feut requis de l’Abbesse et meres discretes (12) leur conceder un indult (13) moyennant lequel se peussent confesser les unes ès aultres, alléguantes que les femmes de religion ont quelques petites imperfections secrètes, les quelle honte insupportable leurs est deceler aux hommes confesseurs : plus librement, plus familierement des diroient une aux aultres, soubs le sceau de confession. Il n’y a rien (respondit le Pape) que voluntiers ne vous oultroye, mais je y voy un inconvenient. C’est que la confession doit être tenue secrette. Vous aultres femmes à poine la celeriez. – Tresbien (dirent elles), et plus que ne font les hommes. | À la vérité, dit Ponocratès, j’ai entendu raconter que le pape Jean XXII, passant un jour par l’abbaye de Cognaufond, fut sollicité par l’abbesse et les mères du conseil de leur accorder un indult leur permettant de se confesser les unes aux autres ; elles alléguaient que les femmes entrées en religion ont quelques petites défauts intimes et que c’est pour elles une honte insupportable de les révéler à des confesseurs hommes : elle se les diraient les unes aux autres plus librement et plus simplement, sous le sceau de la confession. – Il n’y a rien là, répondit le pape, que je ne vous octroie volontiers, mais j’y vois un inconvénient : c’est que la confession doit être tenue secrète. Vous autres femmes auriez du mal à la garder pour vous. – Nous la garderions très bien, et mieux que ne le font les hommes. | |
| Au jour propre, le pere sainct leur bailla une boyte en guarde, dedans laquelle il avoit faict mettre une petite Linote, les priant doulcement qu’elles la serrassent en quelque lieu sceur et secret, leurs promettant en foy de Pape oultroyer ce que portoit leur requeste si elles la guardoient, ce neantmoins leurs faisant defense riguoreuse qu’elles ne eussent à l’ouvrer en façon quelconques sus poine de censure ecclesiasticque et de excommunication eternelle. La defense ne feut si tost faicte qu’elle grisloient en leurs entendements d’ardeur de veoir qu’estoit dedans, et leur tardoit que le Pape ne feut ja hors la porte pour y vacquer. Le pere sainct, avoir donné sa benediction sus elles, se retira en son logis. Il n’estoit encores trois pas hors l’Abbaye, quand les bonnes dames toutes à la foulle accoururent pour ouvrir la boyte defendue et veoir qu’estoit dedans. Au lendemain le Pape les visita en intention, ce leurs sembloit, de leurs depescher l’indult. Mais, avant entrer en propous, commanda qu’on luy apportast sa boyte. Elle luy feut apportée, mais l’oizillet n’y estoit plus. Adoncques leur remonstra que chose trop difficile leurs seroit receller les confessions, veu que n’avoeint si peu de temps tenu en secret la boyte recommandée. | Le jour-même, le saint Père leur confia en garde une boîte dans laquelle il avait fait mettre une petite linotte, en les priant affablement de la ranger en quelque lieu sûr et secret ; si elles la gardaient secrète, il leur promettait, foi de pape, de leur octroyer l’objet de la requête ; toutefois il leur défendait rigoureusement d’avoir à l’ouvrir sous quelques prétexte que ce soit, sous peine de censure ecclésiastique et d’excommunication éternelle. Cette défense ne leur fut pas si tôt exprimée qu’elles grillaient intérieurement du désir brûlant de voir ce qu’il y avait dedans et qu’il leur tardait que le pape eut passé la porte pour s’y employer. Le saint Père, après leur avoir donné sa bénédiction, se retira dans son logis. Il n’était pas encore à trois pas de l’abbaye que toutes les bonnes dames, en foule, accoururent pour ouvrir la boite interdite et voir ce qu’il y avait dedans. Le lendemain, le pape leur rendit visite, avec l’intention (leur semblait-il) de leur délivrer l’autorisation. Mais, avant d’aborder la question, il demanda qu’on lui apportât sa boîte. Elle lui fut apportée : mais l’oisillon n’y était plus. Alors il leur fit constater que ce serait une chose trop difficile de garder le secret de confession, vu que, même pendant un temps aussi bref, elles n’avaient pas conservé au secret la boîte qu’il leur avait tant recommandée. |
La progression du français dans les établissements scolaires est lente. Plusieurs Lecteurs Royaux du Collège de France, fondé en 1530, ont la hardiesse de l’utiliser. Richelieu ne réussit pas à faire vivre un seul établissement de langue française. Les principaux pionniers sont les protestants pour des raisons religieuses évidentes ; puis les Frères des Écoles Chrétiennes fondées le 24 juin 1681 à Reims par Saint Jean Baptiste de la Salle.
Picoche et Marcello. Histoire de la Langue Française.
Jean Racine a bientôt 22 ans. Sa famille, inquiète de le voir s’engager dans une carrière littéraire bien éloignée des enseignements et principes de ses maîtres jansénistes de Port-Royal, l’envoie auprès de son oncle maternel, Antoine Sconin, vicaire général d’Uzès, pour étudier la théologie, avec l’idée de lui obtenir un bénéfice ecclésiastique. Il raconte son voyage de Paris à Uzès à La Fontaine, dans un courrier du 11 novembre 1661 : […] Nous fûmes deux jours sur le Rhône, et nous couchâmes à Vienne et à Valence. J’avois commencé dès Lyon à ne plus guère entendre le langage du pays, et à n’être plus intelligible moi-même. Ce malheur s’accrut à Valence, et Dieu voulut qu’ayant demandé à une servante un pot de chambre, elle mît un réchaud sous mon lit. Vous pouvez vous imaginer les suites de cette maudite aventure, et ce qui peut arriver à un homme endormi qui se sert d’un réchaud dans ses nécessités de nuit. Mais c’est encore bien pis dans ce pays. Je vous jure que j’ai autant besoin d’un interprète, qu’un Moscovite en aurait besoin dans Paris. Néanmoins je commence à m’apercevoir que c’est un langage mêlé d’espagnol et d’italien ; et comme j’entends assez bien ces deux langues, j’y ai quelquefois recours pour entendre les autres et pour me faire entendre. Mais il arrive souvent que je perds toutes mes mesures, comme il arriva hier qu’ayant besoin de petits clous à broquette pour ajuster ma chambre, j’envoyai le valet de mon oncle en ville, et lui dis de m’acheter deux ou trois cents de broquettes; il m’apporta incontinent trois bottes d’allumettes. Jugez s’il y a sujet d’enrager en de semblables mal entendus ; cela iroit à l’infini, si je voulois dire tous les inconvénients qui arrivent aux nouveaux venus en ce pays, comme moi.
Au reste, pour la situation d’Uzès, vous saurez qu’elle est sur une montagne fort haute, et cette montagne n’est qu’un rocher continuel, si bien que quelque temps qu’il fasse on peut aller à pied sec tout autour de la ville. Les campagnes qui l’environnent sont toutes couvertes d’oliviers, qui portent les plus belles olives du monde, mais bien trompeuses pourtant ; car j’y ai été attrapé moi-même. Je voulais en cueillir quelques-unes au premier olivier que je rencontrai, et je les mis dans ma bouche avec le plus grand appétit qu’on puisse avoir ; mais Dieu me préserve de sentir jamais une amertume pareille à celle que je sentis ! J’en eus la bouche toute perdue plus de quatre heures durant : et l’on m’a appris depuis qu’il fallait bien des lessives et des cérémonies pour rendre les olives douces comme on les mange. L’huile qu’on en tire sert ici de beurre, et j’appréhendais bien ce changement ; mais j’en ai goûté aujourd’hui dans les sauces, et, sans mentir, il n’y a rien de meilleur. On sent bien moins l’huile qu’on ne sentirait le meilleur beurre de France. Mais c’est assez vous parler d’huile, et vous pourrez me reprocher, plus justement qu’on ne faisait à un ancien orateur, que mes ouvrages sentent trop l’huile.
Il faut vous entretenir d’autres choses, ou plutôt remettre cela à un autre voyage, pour ne vous pas ennuyer. Je ne me saurais empêcher de vous dire un mot des beautés de cette province. On m’en avait dit beaucoup de bien à Paris, mais, sans mentir, on ne m’en avait encore rien dit au prix de ce qui en est et pour le nombre et pour l’excellence ; il n’y a pas une villageoise, pas une savetière, qui ne disputât de beauté avec les Fouillon et les Menneville. Si le pays, de soi, avait un peu de délicatesse, et que les rochers y fussent un peu moins fréquents, on le prendrait pour un vrai pays de Cythère. Toutes les femmes y sont éclatantes, et s’y ajustent d’une façon qui leur est la plus naturelle du monde. […] ; et pour ce qui est de leur personne,
Color verus, corpus solidum et succi plenum. (Le teint naturel, le corps ferme et plein de suc. Terence) [14]
Mais comme c’est la première chose dont on m’a dit de me donner de garde, je ne veux pas en parler davantage ; aussi bien ce serait profaner une maison de bénéficier comme celle où je suis que d’y faire de longs discours sur cette matière. […]
Adiousias.

Un atelier de couturières en Arles. Antoine Raspal 1760 Musée Reatu

La Ferté-Milon – Statue de Jean Racine enfant
En 1700, un édit rend obligatoire l’usage de la langue française dans les actes officiels en Roussillon et Cerdagne, mais, 27 ans plus tard, Henri de Boulainvilliers, reconnaîtra que Le peuple du Roussillon se nomme et s’estime catalan et regarderait comme une dégradation ou une injure le nom de Français ou de Catalan français.
Pendant la Révolution, l’abbé Grégoire n’hésite pas à dire qu’ il faut d’urgence anéantir les patois, universaliser l’usage de la langue française.
Nous qui parlons notre langue, tandis que, chose cruelle, à dire, tant de nos compatriotes ne font que la balbutier.
Léon Gambetta à Bordeaux en 1871.
Il faut attendre la loi Guizot, ministre de l’enseignement sous Louis Philippe, en 1833, pour que l’enseignement du français touche massivement les enfants. Mais dans les régions comme l’Alsace, la Corse, le Pays Basque ou la Bretagne, les instituteurs utilisent aussi les langues régionales, qui restent très vivantes. Quand Jules Ferry intervient, le travail est déjà largement accompli : 90 % des enfants sont scolarisés. On passera à 100 % et on proscrira rapidement les langues régionales. Y compris souvent de la cour de l’école.
Pierre Encrevé. Libération des 11-12 mai 2002.
Au XIX° siècle, il y avait encore en Bretagne et dans le Centre des paysans qui ne se doutaient pas qu’ils étaient français. Les habitants de la France ont mis longtemps à se prendre d’un commencement d’affection pour la monarchie ou ensuite pour la République.
Théodore Zeldin
En Bretagne, à la veille de la grande guerre, on ne parlait couramment le français que dans les villes, et comme la population était essentiellement rurale, le breton était la langue courante, même si les enfants étaient punis à l’école lorsque surpris à le parler. Peu de soldats parlaient français en 1914 : le brassage obligé que connurent les régiments – ils étaient au départ, régionalisés fût tel que les survivants l’apprirent dans les tranchées ; et c’est le premier déclin important de l’usage du breton. On affubla ces soldats bretons du préfixe par lequel commençait le nom de dix sept communes d’Armorique : Plouc.
En se glissant sur la paillasse de bord, Ronan a expliqué à Pantxo que baragouiner était un mot inventé par les Français pour se moquer d’une langue qu’ils ne comprenaient pas. Pendant la guerre de 1870, les fantassins bretons réclamaient davantage de pain et de vin à leurs officiers pour mieux botter le cul aux Prussiens. Ces soldats ne parlaient pas français. Et c’est en breton qu’ils revendiquaient du bara frais et des pichets de gwin.
Ils scandaient Bara ! Gwin ! Bara ! Gwin ! prêts à mette la crosse en l’air
Cessez de baragouiner, hurlaient les gradés.
Depuis Napoléon III, la formule était restée. Et le mépris qui va avec.
Sorj Chalandon L’enragé. Grasset 2023
L’histoire du soldat François-Marie Laurent restera dans les mémoires. Ce cultivateur de 29 ans a laissé à Mellionnec, en centre Bretagne, sa femme et ses deux enfants. Dans la nuit du 1° au 2 octobre 1914, sur le front de Champagne, il est blessé au petit doigt de la main gauche. Sa dernière phalange est arrachée. Son capitaine lui conseille d’aller se faire soigner au poste de secours. Sur place, le médecin principal Buy trouve la blessure légère et soupçonne le soldat de s’être automutilé pour être évacué du front. François-Marie Laurent est incapable de s’exprimer en français. Arrêté, convaincu d’abandon de poste devant le conseil de guerre, il est fusillé le 19 octobre 1914. Il sera réhabilité 20 ans plus tard en 1933 quand la cour spéciale de justice le déclarera acquitté de l’accusation reconnue contre lui, et déchargera sa mémoire de la condamnation prononcée.
Anatole de Monzie, ministre de l’Instruction publique, publie le 14 août 1925 une circulaire par laquelle il imposait le seul langage français, dont le culte jaloux ne peut avoir jamais trop d’autels.
Plus tard, Francis Ponge – 1899 – 1988 -, enfonce le clou : La meilleure façon de servir la République, est de redonner force et tenue au langage.
Il fallait bien que l’affaire ne fût pas évidente pour qu’on en parla tant. Et l’attachement des français pour leur langue est bien unique… à quelle autre langue adresse-t-on de telles déclarations d’amour ?
J’ai longtemps cru qu’on avait le choix de sa langue. Alors je rêvais de parler le russe, le nahuatl, l’égyptien. Je rêvais d’écrire en anglais, la langue la plus poétique, la plus douce, la plus sonore. Pour mieux réaliser ce rêve, j’avais entrepris d’apprendre par cœur le dictionnaire, et je récitais de longues listes de mots.
Puis j’ai compris que je me trompais. On n’a pas le choix de sa langue. La langue française, parce qu’elle était ma langue maternelle, était une fatalité, une absolue nécessité. Cette langue m’avait recouvert, m’avait enveloppé, elle était en moi jusqu’au tréfonds. Cela n’avait rien à voir avec la connaissance d’un dictionnaire, c’était ma langue, c’est à dire la chair et le sang, les nerfs, la lymphe, le désir et la mémoire, la colère, l’amour, ce que mes yeux avaient vu premièrement, ce que ma peau avait ressenti, ce que j’avais respiré. Les mots n’étaient pas ceux d’une liste, ils étaient des choses, des êtres vivants. Ils étaient âpres, doux, légers, fugitifs et déroutants, décevants parfois, pièges mielleux, horreur physique, souvent résonnant comme des coques vides, mais aussi dansant, enivrant, les mots du jour, du jouir, de la jubilation, et même jouant avec la mort.
C’était la langue française. Ma langue. Ma personne, mon nom, en quelque sorte. Sans le savoir, sans le vouloir, elle me donnait sa beauté, sa douceur. En moi étaient tous les sons retenus depuis la petite enfance, les sons mouillés, les r gutturaux, les nasales, les sons qui font bouger les lèvres vers l’avant, et qui permettent aux autres de reconnaître de loin quelqu’un qui parle le français.
Pour moi qui suis un îlien, un descendant de Breton émigré à l’île Maurice, quelqu’un d’un bord de mer, qui regarde passer les cargos, qui traîne les pieds sur les ports, quelqu’un qui n’a pas de terre, qui ne s’enracine pas dans un terroir, comme un homme qui marche le long d’un boulevard et qui ne peut être ni d’un quartier ni d’une ville, mais de tous les quartiers et de toutes les villes, la langue française est mon seul pays, le seul lieu où j’habite. Non pas la langue que j’entends, ni celle qui s’écrit dans les livres, mais la langue qui parle au fond de moi, quelquefois même sans mots, juste un mouvement instinctif, quelque chose qui tremble, qui trouble, qui passe, qui pose des pierres.
La langue française, si belle, si souple, si flexible. Encore pleine de cette émouvante maladresse des langues neuves, de cette rugosité des langages de paysans. Multipliant les doublets, les struments, les auxiliaires. il s’en est allé, il pleut, quelle heure est-il ?, et tous ces diminutifs : soleil, alouette, demoiselle. Le rire et le savoir, éclatants dans ces mots, dans ces tournures, quelque chose de tendre, d’inachevé. Cette très grande précision dans les termes du réel, et ce flou charmant dans l’abstrait, dans l’idée. Cette langue si contraire au latin d’administrateurs et d’avocats, à l’allemand des prêcheurs et à l’anglais, langue d’archers, d’arpenteurs.
Comment imaginer un monde sans cette langue ? Par tout ce qu’elle porte de rural – les grandes plaines, les bocages, les rivières douces, les villages, les rites du blé, de la vigne, les secrets des dernières forêts, où, sous Louis XIV, erraient encore les meutes de loups et les hardes d’auroch – la langue française est munie d’éternité. Langue complète, faite de la graine et du son, langue métisse. Semblable au créole, encore vivante, encore mutante.
L’affreux, le détestable, c’est quand le pouvoir (économique, militaire, colonial) habite une langue, comme un énorme ver. L’horrible, c’est le rayonnement, je veux dire cet Ubu roitelet qui impose ses règles, savonne la bouche des enfants qui disent des gros mots ou parlent le patois dans la cour des écoles, ou, pis, ce bourgeois imbu qui tourne en dérision les accents du terroir, ce foutriquet vêtu de science qui singe les langues des puissants, et ce nostalgique momifié qui insuffle dans la veine séchée de l’agonisante ses relents d’accordéon et de poulbots larmoyants.
Sans doute n’y a-t-il jamais eu d’autre question que celle des frontières, maudites lignes en pointillé qu’il faudrait bien effacer. Le Rio Grande comme un Achéron noyant la misère des dos mouillés, le nouveau Rideau de fer condamnant les damnés de l’Est, Algésiras comme le chancre du monde moderne, enfermant derrière ses barbelés les enfants aux yeux trop noirs. Ghettos, camps, territoires infamants, et ces mers où chavirent les boat people. Contre cela, je voudrais tant que la langue française soit la langue de la liberté, la langue de l’espoir. Qu’elle renonce à ses pouvoirs et à son or, à ses centuries et à ses Mururoa, à ses minorités et à son droit du sang – quand c’est elle, avec ses merveilleux rêves, qui est le sang ! Qu’elle porte toujours, à tous ceux qui ont faim de réalité, les effluves de la terre douce, des champs profonds, la poudre d’or qui flotte au-dessus des aires, et le babil léger de l’enfance, comme pour faire durer éternellement le temps des cantilènes et des premiers romans.
Chaque fois qu’une langue meurt, c’est une tragédie qui touche le monde tout entier. Acaxée, zoé, faraon, langues vieilles comme la glaciation du Würm, et que l’intolérable suffisance des conquérants espagnols a effacées à jamais du continent américain. La langue française, si jeune et si forte, et mûre aussi de tant d’expérience, doit être surtout le lieu d’asile de tous ceux que l’aliénation de l’ère industrielle menace, et leur servir de mémoire. C’est son devoir, c’est aussi sa chance de survivre.
Jean Marie Le Clezio. L’Express. 15 Octobre 1993
cette rugosité des langages de paysans dixit Le Clézio, on peut la retrouver, comme il arrive parfois, en faisant un détour par une langue étrangère, en l’occurrence, l’italien d’Andrea Camillieri, que bien des Italiens ont eux-mêmes un mal certain à comprendre tant il fait usage d’idiomes siciliens – rien de plus vigoureux que le régionalisme italien -. Aussi, pour rester fidèle à cette spécificité le traducteur doit-il s’essayer à retrouver lui-même dans sa propre langue une originalité dont par définition le vocabulaire actuel n’est pas à même de rendre compte. Exercice difficile, qui peut vite devenir barbant à force d’être savant, sauf à être pratiqué avec un grand talent et Dominique Vittoz, qui a traduit d’Andrea Camillieri Maruzza Musumeci en 2009, chez Fayard, a ce grand talent ; originaire des marches entre Savoie et Dauphiné, elle exhume tout un patois francoprovençal, puis poitevin-saintongeais. Et c’est un enchantement. Et elle ne vous donnera même pas un lexique pour venir à votre secours : débrouillez-vous avec le contexte pour trouver le sens des mots que vous découvrez !
Une fois tous les épis battus, Gnazio attendit une journée de vent de terre pour vanner. Il prenait une pelletée de grains et de paille et la lançait en l’air. Le vent emportait la balle, plus légère, tandis que les grains retombaient par terre. Pour finir, il obtint quarante sacs de blé superbe, blond et dur.
Il alla au comptoir de Cosimo Lauricella avec un échantillon de son blé. Cosimo regarda, complimenta et lança un chiffre.
Gnazio en lança un autre. Ils firent pache. Gnazio empocha ses premiers pécuniaux gagnés avec sa terre.
Le soir, en mangeant sous l’olivier, Gnazio Manisco pensa qu’il avait quarante-sept ans et qu’il pouvait enfin prendre femme.
Il décida d’en parler à la mère Pina la prochaine fois qu’il la verrait passer sur la draille.
La mère Pina, soixante-dix ans, teint cireux, et corps recrénillé comme un vieux sarment, était toujours gaunée de la même robe, noire autrefois, qui tirait sur le verdâtre, d’un grand châle qui lui arrivait aux chevilles et d’un foulard couleur crotte de chien malade, sous lequel elle cachait ses cheveux blancs. Elle coltinait toujours sur son dos un sac rempli d’une bardouflée de plantes. Elle partait à pied de Gallotta, un village sur la montagne, avant le lever du soleil, pour faire sa tournée à Vigàta. Car la mère Pina savait des plantes pour tout, chez l’homme comme chez la femme.
Mal de tête ? Mal de ventre ? Mal à la poitrine ? Mal aux yeux ? Mauvais sort ? Manque d’appétit ? Manque de vigueur dans la troisième jambe ? Sang du mois trop abondant ? Grossesse qui ne venait pas ? Fluxions qui ne passaient pas ? Difficulté à caquer ? Rhume rebelle ? Amour malheureux ? Tromperie conjugale, masculine ou féminine ? Brouilles familiales ? Vieillards qui rechignaient à défunter ? Jeunettes qui avaient mis au levain et ne voulaient pas l’enfant ? Mal de dents ? Étourdissements ?
Les plantes de la mère Pina soignaient tout cela et le reste. Mais, en cas de besoin, l’ancienne pratiquait un autre métier. À force de courater par monts et par vaux, elle connaissait son monde comme personne, c’est pourquoi, à ses moments perdus, elle acceptait d’arranger des mariages.
Un soir où la mère Pina s’était arrêtée pour lui demander de l’eau avant d’attaquer la grimpette vers Gallotta, Gnazio l’entreprit.
Que disent les gens, mère Pina ?
L’ancienne le regarda, ébaffée : jamais auparavant Gnazio ne lui avait adressé la parole, il lui donnait à boire et s’en tenait là.
Que devraient-ils dire ? Rien.
Mais elle avait compris qu’il voulait quelque chose et elle s’attarda, son verre à moitié vide. Gnazio prit des chemins détournés.
– Mère Pina, ça fait combien de temps que vous passez sur cette draille ?
– Plus de soixante ans. La première fois que je l’ai descendue, c’était avec ma mère, je n’avais pas dix ans.
– Alors vous avez connu Cicco Alletto ?
– Bien sûr que je l’ai connu, pauvre de lui. Vous savez pourquoi il a détrancané ?
– Non. Les gens disent qu’il avait entendu des pleurs bizarres.
– Mais ça ne suffit pas à vous faire décoconner.
– Peut-être. Encore que… Ça dépend de l’endroit. Entendre pleurer ici ou, par exemple, au lieu-dit Les Vignes, ce n’est pas la même chanson.
– Et pourquoi ça ?
– Parce que La-Nymphe est un endroit spécial, ni terre ni mer.
Gnazio éclata de rire.
– Ni terre ni mer, vous déparlez ! Vous voyez ces arbres ?
– Pour sûr. Et alors ?
– Et alors, on n’a jamais vu des arbres pousser en pleine mer.
– Gnazio, que croyez-vous avoir sous les pieds ? Les pêcheurs et les marins disent que La Nymphe flotte sur la mer, que, dessous, il n’y a que de l’eau.
Gnazio devint aussi blanc qu’une merde de laitier.
– C’est pas des gandoises ?
– C’est ce qu’on raconte. Un endroit qui n’est ni terre ni mer prend de l’une et de l’autre. Si ça se trouve, ce pauvre Cicco Alletto s’est réveillé parce qu’il entendait pleurer, il a ouvert les yeux et découvert une bande de dauphins qui batifolaient dans sa fenière.
– Vous plaisantez ? demanda Gnazio, qui n’en menait pas large à l’idée que son terrain flottait sur la mer.
– Oui et non, rebriqua la mère Pina, en lui rendant son verre.
Deux soirs plus tard, alors que la mère Pina s’était arrêtée boire un verre d’eau comme à l’accoutumé, Gnazio se décida à sauter le pas et lui expliquer qu’il voulait se marier.
– Quel âge avez-vous ? demanda l’ancienne.
– Quarante-sept.
– En état de marche ? Gnazio n’y était pas. Si je marche ?
– Votre troisième jambe, oui.
Gnazio finit par comprendre et rougit. Ben, hésita-t-il.
– Depuis combien de temps elle n’a pas servi ? Gnazio calcula vite fait.
– Disons six ans.
– Vous vous mariez pour avoir des enfants ?
– Pardine ! Alors déballez la marchandise. Gnazio comprit et baissa son pantalon.
– À première vue, l’outillage est bon, dit-elle et elle s’en assura au toucher.
La main de l’ancienne était douce comme une écorce d’arbre, n’empêche qu’à ce contact étranger, Gnazio hissa pavillon.
– Tout beau ! fit l’ancienne en riant. Je vous trouverai une femme. Belle et jeune.
– Jeune ?
– Faut bien, si vous voulez des enfants.
– Mais elle voudra de moi si elle est jeune et belle ? Je suis vieux et j’ai une patte folle.
– Votre patte folle, faut avoir le nez dessus pour s’en apercevoir. En revanche, vous êtes propriétaire de dix arpents de terre et votre outil ferait pâlir de jalousie un gars de vingt ans. Ne tirez pas peine, je vous aurai vite trouvé une bonne épouse.
Alors, en prévision des noces, Gnazio retroussa ses manches.
Dominique Vittoz. Traduction 2009 de Maruzza Musumeci d’Andra Camillieri. Fayard.
C’est bien à cette sensation reine, à cette vie immédiate disait Eluard, que l’on reconnaît la littérature française. Non la plus belle de toutes, mais celle où à travers le tremblé des mots et le brouillard des larmes frémit la promesse du bonheur.
Mona Ozouf. Le Nouvel Observateur 19 septembre 1999
D’autres fois, c’est plutôt oui mais que oui oui : […] Je veux dire que la poésie française a souffert des tribulations du français. Il n’est pas question ici de médire de ma langue, c’est un superbe instrument rhétorique, mais force est de constater qu’après l’odieux Malherbe et trois siècles de chicaneries académiques, elle a été si bien purgée de son trouble et de ses humeurs, qu’elle est peu propre à exprimer la poésie. La concision, la clarté, le tranchant – qui sont de grandes vertus – n’y suffisent pas. Il faut à la poésie un certain tremblement que le français rend très malaisément. D’où la tentation de tomber parfois dans des jeux de miroirs et d’idées, de devenir cérébral, hermétique, d’où la distinction un peu exténuée de la production française aujourd’hui.
Nicolas Bouvier. L’échappée belle. Métropolis 1996
La grammaire est un formidable moyen d’organiser le monde comme on voudrait qu’il soit.
Delphine de Vigan. No et moi. Jean Claude Lattès 2007
Le Français est un créole du latin.
Alain Rey qui ainsi, fera grincer pas mal de dents.
Et parfois, il suffit de s’éloigner de quelques centaines de kilomètres de l’origine des langues latines – pour le Romanche – ou de quelques milliers – pour le Roumain – pour que ces langues dites latines deviennent parfaitement incompréhensibles. Et encore, dans ce texte de Paul Morand, il ne s’agit que de quelques mots empruntés directement au français et non de la langue dans sa globalité : Dans cette rue où les passants sont fort bousculés, notre langue ne l’est pas moins. Pierre Lescalopier disait déjà que les Roumains parlent une langue latine, mêlée de grec et de baragouin. Pour tenter le beau monde, les boutiquiers ont fait pleuvoir à ce point les mots les plus bizarres qu’ils obligeront le Parisien de passage à réviser son vocabulaire. Il lui faudra d’abord se faire à l’écriture phonétique : chauffeur s’écrit sofor ; garde-robe, gardirop ; mise en plis, mizanpli ; bonne femme, bonfam et femme de chambre, famdiçambre. Ce sont là des roumanismes courants, de même que massina pour automobile, sandoulie pour descente de lit, coafor pour coiffeur. Les confiseries sont dites bonbonerie, les cabinets particuliers, separeu. Haine de dame n’est pas l’enseigne d’un commerçant misogyne, mais veut dire vêtements de femme. La Blanche Camélie, nom charmant fait pour la poésie, c’était tout bonnement Au camélia blanc en français moldo-valaque. Galanterie signifie bonneterie. Cur sonnant fort mal en roumain, les terminaisons en cure sont proscrites : on ne dit pas manucure, mais manucuriste, pédicure, mais operator. Deux personnes qui se sont connues enfants vous disent parfois qu’elles ont enfanté ensemble. Si un Roumain va à l’étranger faire ses études, on le louera, à son retour, d’être devenu culte et voyagé ; touchant hommage rendu à la civilisation par les illettrés eux-mêmes. Il me souvient d’un pianiste pour soirées bucarestoises qui s’intitulait, sur ses cartes de visite : tapeur au plaisir avec violon. Ces néologismes saugrenus sont fréquents chez les petites gens qui veulent singer la bonne société ; dans le monde, les erreurs, fort rares, que j’ai notées relèvent plutôt de la juridiction de Lancelot : on y emploie volontiers réactionner pour réagir, grandomane pour mégalomane, et théoreticien. Le primare désigne le premier magistrat de la ville : c’est un composé de primat et de maire. Pour vous plaindre des courants d’air, dites : ça tire. On sympathise quelqu’un. Un produit est répartisé. Le verbe faire est employé bizarrement ; parfois, il veut dire aller : Fais à droite, fais à gauche. Souvent, il signifie : traiter de : Il m’a fait imbécile, il m’a fait cochon ou, mieux encore, il m’a fait bœuf. Mon ser, c’est : mon cher ; les Bucarestois ont un faible pour cette formule et leurs abondants discours en roumain sont criblés de mon ser. N’empêche qu’en général, le Roumain parle bien mieux le français que les Balkaniques les plus francisés, Juifs de Salonique ou Levantins de la grand-rue de Péra, qui s’écrient en se disputant : Tout ce que tu veux, tu dis, ou : Hélas ! de ma tête, ou : Que je sais, moâ, etc.
Paul Morand. Bucarest 1935
Pour la langue roumaine courante, le rapprochement avec nos langues régionales semble offrir plus de parentés : deux Roumains se disent au revoir dans une rue de Montpellier : à la reverderle. C’est exactement ce mot que certaines vieilles de Nice emploient encore pour se saluer. Et il y aurait encore tant à dire de ce français parlé par les Québécois, souvent plus proche des patois du centre ouest de la France que de notre français du XXI° siècle.
Il nous convient, à nous Français de France, de ne jamais oublier ce qu’a été la vie au long des siècles, sur le continent américain, de ce solide îlot humain, de cette colonie paysanne essaimée de notre terre : vie de maintenance et de fidélité. Vie difficile, patiente, tenace, de toute part et de toute façon menacée. Alors nous comprendrons mieux, et pour l’admirer davantage, ce traditionalisme religieux, politique, moral, linguistique. À Montréal, dans cette ville où l’américanisme, par ses films, ses lames de rasoir, ses clubs et ses cafétérias, ses machines, ses trusts de gas-oil, ses cigarettes et sa coca-kola, s’infiltre et se respire partout, un puriste qui se réclame de notre vieux parler louis-quatorzien fait œuvre de maintenance française.
En fait, la langue populaire, citadine et même paysanne, est devenue un curieux mélange – par parties très inégales – de français archaïsant et de néologismes américains. Au temps de l’immigration, il n’y avait pas d’automobiles. Et que ce véhicule ait été baptisé char (comme les tramways, les énormes wagons des trains transcontinentaux et aussi les voitures d’enfant) il faut bien néanmoins que les pneus d’Amérique soient des tires et le pot d’échappement le mofler : de sorte que la fumée du pot d’échappement deviendra la boucane du mofleur. Même les trappeurs, les guides de la forêt, les gardiens des tours à feu (les firetowers) diront un trail, une map, une dam, pour un sentier, une carte, une digue. Les creeks, c’est quelque chose de là-bas, rivières entre les lacs, déversoirs torrentueux, non ce qu’évoque chez nous, par exemple, le mot ruisseau. En règle générale, une règle qui s’explique et se justifie d’elle-même, tout ce qui date de l’immigration éveille encore le vieux vocable contemporain. Tout ce qui participe de l’évolution continentale, du machinisme et de la technique nord-américains ne pouvait qu’adopter le néologisme indigène.
Cette susceptibilité canadienne, il était naturel que ce fût à notre égard qu’elle se montrât le plus ombrageuse : les malentendus familiaux trouvent un terrain inépuisablement fertile, et il est rare au bout du compte que les torts n’y soient point réciproques. J’aurai trop souvent l’occasion de constater que nous n’en sommes pas exempts, et que, dans la plupart des cas, nous ne faisons que récolter la monnaie de notre pièce.
Maurice Genevoix. Canada. Flammarion 1945
Court florilège : Adamsberg, l’inusable commissaire de police cher à Fred Vargas prend une cuite magistrale dans un bar de Montréal :
– Excite-toi pas, man, mais tu ferais mieux de lâcher la batte pour ce soir et d’aller prendre une marche. Tu parles tout seul.
– Je te parle de ma grand’mère.
– Je m’en sacre royalement de ta grand’mère. Ce que je vois, c’est que t’es parti sur un flatte et que ça va mal finir. T’es même plus parlable.
– Je suis parti nulle part. Je suis assis là, à mon tabouret.
– Ouvre tes oreilles, le Français. T’es rond comme une bine et t’as les yeux dans le beurre. Tu t’es fait éconduire par ta blonde ? C’est pas une raison pour te foutre par terre. Allez, fais de l’air ! Je te sers plus.
– Si, affirma Adamsberg en tendant son verre.
– Tais ton bec, le Français. Mouve-toi d’ici, ou j’appelle les cochs.
Adamsberg éclata de rire. Les cochs. Quelle bonne rigolade !
– Appelle les cochs et s’ils s’approchent, je t’embroche !
– Criss, s’énerva le barman, on va pas javasser des heures. J’ai déjà vu neiger, man, et tu commences à me tomber sur le gros nerf. Sacre le camp, je t’ai dit !
Fred Vargas. Sous le vent de Neptune. Viviane Hamy 2004
Dans les Antilles françaises, l’humidité, la chaleur et le tempérament font fleurir la langue : Lucianise, il y a grand longtemps que mon cœur fait vip-vap devant la belleté de ton corps et la charmenceté de tes cocos-yeux qui éclairent plus fort que le soleil en carême. Le sommeil n’arrive pas à me prendre la nuit, si tellement mon esprit est occupé par ta pensée.
Raphaël Confiant. Le bataillon créole. Mercure de France 2013
Et, pas bien loin de là, en Louisiane, chez les Cadjins, ces Canadiens français qui vont être déportés par les Anglais de 1755 à 1762 et qui bien sûr conserveront leur langue tous en la laissant évoluer : Jusqu’à pas trop longtemps passé, Edius Raquin avait cru que la vie était un mouchoir marqué avec trois nœuds d’éternité. Un et deux pour la naissance et le mariage. Le troisième pour la mort se souvenir.
En bon Cadjin de la paroisse Évangéline, il faisait confiance au Bon Djeu, chérissait sa terre juste avant sa famille, persuadé que c’était mieux vivre qu’exister, mieux pour un époux et sa femme de se fier l’un à l’autre que de se faire la guerre ou d’avoir doutance du monde qui vous entoure.
Raquin avait choisi de rouler son temps au fond des bois, des marigots et des vasières. Il n’appréciait pas trop l’autorité. Il s’accordait bien avec la nature, pratiquait ses petites affaires tranquille. Aimait autant être seul que plusieurs, recherchait la compagnie de son chien Hip et ne se connaissait pas d’ennemis. Plutôt que l’anglais, héritage de la guerre confédérée, Edius parlait toujours la vieille langue des Normands, mâtinée, il est vrai, de petits ajouts red-necks, mais gardait jalousement les traditions de son père, Télesphore Raquin, enterré dans sa tombe, au boute du jardin.
Pour le souvenir du vieux, il fréquentait la messe, connaissait pas les différences de peau, partant du principe qu’icite, dans le sud-ouest de la Louisiane, les gensses pouvaient être riches ou pauvres, catholiques ou baptistes, blancs ou marrons, ils se mangeraient quand même pas le coton sur les épaules. C’est comme cil-là qu’était bien savant dans les livres ou pas capable de signer son nom, il avait le droit de respirer tout pareil. Que le chêne protège le Cadien ou le créole, le couleur ou le Nindien, mon vieux ! Que l’écrevisse soit dans leurs filets et le gombo dans leurs marmites ! Le beau soleil, la grande pluie, le retour des saisons donnaient assez la mesure et la continuation du bon vivre.
Aujourd’hui et demain la valse battrait encore à trois temps : un pour la lutte, l’autre pour l’amusement et le troisième pour la chasse.
Fils de piégeur, Raquin sortait d’une famille où on avait souvent marié première et seconde cousines. Dans les temps reculés, c’était pas bien la mode de s’épailler trop loin pour lier amitchié d’amour et la jeunesse faisait jamais arien pour mécontenter ses parents qui choisissaient pour elle.
En s’amarrant à la cadette d’un issu de germain de son oncle, Edius n’était, lui non plus, guère sorti du poulailler. Pourtant, il était tombé en amour vrai, séduit par la beauté comme si elle était accourue de loin.
Bazelle était si frayante qu’à peine passé le soir où ils avaient fait friend, il lui avait fabriqué une pichonne. C’étaient des jours mystérieux. On aurait pu croire qu’avec toutes les précautions de protéger leurs filles, les parents auraient jamais pu les avoir enceintes. Eh bien, ils les avaient. Comme partout quand on s’aime.
Edius s’était marié avec plaisir.
Dix-huit ans déjà avec Bazelle ! Dix-huit ans qu’ensemble ils reviraient la terre, peinaient sur la récolte et qu’entre eux l’ardeur d’aimer s’effaçait pas. Ils avaient inventé une bonne camaraderie.
Parfois, après l’usure du travail dans les champs, l’esprit d’Edius Raquin jonglait dans le vague à propos d’une maison blanche avec une galdrie à piliers qu’il finirait bien par construire avant que sa tite fille Azeline soit en âge et condition d’épouser un vaillant laboureur de ce canton de Bayou Nez Piqué. Quelqu’un comme Euclide Ardouin qui serait un gars d’sa qualité de monde. Ou p’t’être même comme Voicy Smith qui, contrairement à ce que pouvait laisser prévoir son nom, ne parlait pas un mot d’américain.
Avec des garçons tels qu’eux, on resterait pur Cadjin dans la clique de la famille. Et tant pis pour l’argent. Pas question de faire une bonne vie grâce à la chérité d’un Cou-Rouge sorti de Boston ou de Rochester. N’importe si l’élu serait pas un fringant jeune mister afistolé en gants beurre-frais, roulant boguet et équipage à deux chevaux de tire. Dans les mèches et étangs de la Louisiane, les résidents étaient contents de faire alliance entre eux et de toute façon, pensait Edius, mieux vaut aider notre voisin avec le ventre d’une pure jeune fille qu’attrapera forcément les mayères de son homme, plutôt que d’aller la mariocher à un gros richard de la ville.
Construire une vraie maison en bousillage avec un toit en tuiles de bois était un rêve éveillé qui prenait souvent Edius Raquin sous le chapeau. Souventes fois, il en discutait avec Bazelle, sa femme devant le Bon Djeu.
Bazelle l’écoutait les yeux grands ouverts, mais sa blouse et sa jupe n’étaient pas assez neuves pour qu’elle entre dans ses contes à dormir sur un pied.
— Mon mari ! elle disait, j’t’ai jamais refusé de parler avec to et notre amitié est si fort que j’aimerais mourir dans tes bras. Mais tu m’tracasses à vouloir toujours aller du côté de ce que tu pourras pas obtenir…
— J’te comprends pas, Bazelle. Quand je t’ai demandée à ton père, j’ai fini par t’avoir…
— Le moyen de faire autrement, coursailleur ! Tu m’avais fait Pâques avant Carême !
— Enfin, ils ont pas dit non…
— Parce que je t’ai aidé, gros nigaud. Les filles s’y connaissent à bloffer leurs parents… Je leur ai dit que t’avais d’quoi !
— J’avais les trente arpents laissés par Nonc Sosthène…
— Tu les avais all right, mais c’était pas les meilleurs clos de la paroisse, reprochait volontiers Bazelle en montrant ses mains rugueuses. Au moins trois ans, il a fallu adoucir les herbes farouches avant de penser au maïs !
Dans ces moments-là, Edius la dévisageait avec des yeux qui découvrent.
— Quo, mon cher bébé?
Il s’étonnait en cajolant sa bassette contre lui.
— Après toutes ces nuitées de bonne adonnance, je t’aurais rendue malhureuse?
— J’ai pas dit ça, Edius Raquin. J’ai dit que tu regardais toujours du côté de l’impossible.
— Je te ferai cette belle habitation, s’entêtait-il. Avec une galdrie à colonnes grecques sur le devant, une salle avec un lustre en cristal et des commodes dans la maison.
— A ouar ! Pourvu qu’ce soit pas comme le caraco en pou-de-soie! Vingt ans déjà que je l’attends!
—Fidieu! C’est donc ça la dispute?… Dimanche je t’offrirai une jolie p’tite camisole frayante ! Et je t’emmènerai giguer le two-steps au bal de Lapoussière!
Raquin s’échauffait. Donnait un bec à sa compagne. Un autre en pleine bouche. Fouillait sa langue. Elle avait beau essayer de se dégager, elle était prise. Il la tenait embrassée contre lui. Lutinait ses poitrines.
— Arrête, vieux bougue, c’est plus de ton âge ! Tu vas faire un imbécile !
Avec des rougeurs de chaleur sur le cou, elle le repoussait à grand force. S’en allait courotant vers sa cuisine. Attrapait son baquet, ramassait son frottoir, prête au grand lavage de la semaine.
Il la poursuivait avec ses mains travailleuses, la figure empourprée comme une crête de guine. D’un coup de tape, elle esquivait l’assaut sous ses cottes.
— Ote tes pattes de dessous là, malvenant !
Il la serrait dans un coin. Encore roulait des becs. Murmurait dans son oreille :
— Laisse le bon temps rouler, Bazelle! Viens prendre ton p’tit quart d’heure ! J’sens que vers toi je r’penche !
— Bestiau, la cabriole est plus de ton âge ! Tu vas casser ta pompe à sang !
— Menteries, mon cœur !
Glorieux, il lui donnait à tâter sa racine. Au tour de Bazelle de ricaner pas comme d’habitude.
—Vous z’êtes lourd comme un gros manche de pioche, missieu, elle roucoulait. Un bois si farouche que j’ai peur si vous venez en moi, vous allez me grafigner.
Signe qu’elle était consentante, Bazelle dégrafait il son linge.
Pas besoin de litage, ils se laissaient tomber là où ils se trouvaient. Le désir était la loi. Ça goûtait bon comme le passé.
— Tu te souviens, catin ? demandait Edius. T’as eu une belle nuit de noces, Bazelle ! Et une fois le château pris, a-t-on pas profité doucement de nos deux corps?
— Saleté d’homme, elle disait sous son poids, au lieu d’en jaser, fais-le ! Voyage avec boucoup de vitesse!
Elle prenait le restant de cheveux de son marié comme une crinière de mulet, lui redressait la nuque pour le cabrer sur elle, et, les yeux bien écarquillés dans les siens, le regardait s’élancer avec son fer.
— Pique-moi ! elle exigeait. Que ça s’arrête qu’avec le fi-follet… Une boule de lumière grosse comme une pelote de velours !
Une fois, il l’avait prise dans la pataterie. À même le sol. Il était fou par répétition. L’amour chauvage, on pouvait plus l’arrêter.
Bazelle le laissait faire. D’abord parce qu’elle aimait la lutte et la chevauche, c’est comme ça qu’il l’avait habituée. Mais aussi parce qu’une fois qu’il était allé jusqu’à toute éreinte, elle avait la paix pour un mois. Edius redevenait travailleur. Toujours, il prenait des résolutions.
— Je t’aimerai toute la balance de ma vie, il soufflait.
Il repartait se battre avec sa terre. Elle l’entendait passer dans la cour une fois ses mules attelées.
Encore étourdie, elle regagnait sa chambre par le derrière de la ferme, en essayant de pas rencontrer sa fille. À cette heure où battait le soleil, Azeline devait se trouver devant sa glace.
Bazelle se glissait le long des murs. S’immobilisait de temps à autre pour interroger les bruits en provenance de la maison. Elle conservait en elle, elle cultivait avec délices la sensation troublante d’avoir commis un inavouable péché. D’avoir transgressé l’ordre qui s’impose au devoir des habitudes conjugales. Pourquoi préférait-elle secrètement que son mari la prenne sans ménagements, en des lieux inavouables, plutôt qu’à heures dites, sur leur lit, toujours le même, qui était désigné pour enfanter et pour mourir?
Une fois, l’année précédente, elle avait osé se poser la question différemment.
Elle revenait du bayou où elle avait lavé son linge. Un pédleur nommé Oklie Dodds l’avait abordée du haut de sa haque au croisement de deux chemins. Le colporteur lui avait proposé des sucreries, des doudoucières sorties de sa giberne. Avant qu’elle eût pu faire autrement, il avait sauté du cabriolet et posé son bec de fouine sur ses lèvres. L’homme sentait le bois puyant et son haleine renvoyait une acre odeur de moonshine. Il était pris de boisson et le temps qu’elle se débarrasse de son fardeau qui lui encombrait les bras, il l’avait poussée contre un arbre. Son corps contre le sien, elle n’avait pas eu peur pour un cent. C’était plutôt l’étonnement d’une peau qu’elle ne connaissait pas qui l’avait retenue sur place, et bien qu’elle eût fait les gestes pour se dégager du bambocheur, un sacré coup de genou dans son entrejambe, elle n’était pas sûre de ne pas avoir ressenti une étrange exaltation, assez proche du désir.
En courant, elle était rentrée chez elle. Elle n’avait pas cherché à revoir l’homme ni pipé mot à Edius de cette drôle d’inconstance. Dans le confus de la lutte, elle avait arraché le bergo que le marchand portait en bandoulière pour sonner la trompe et alerter les chalands en arrivant devant chez eux. Elle s’était retrouvée avec l’instrument de cuivre entre les mains, détalant comme si le Djiable était après elle. Et plus tard, incroyable, elle n’avait jamais jeté le petit clairon. Au contraire, elle l’avait caché dans la bordure d’un champ où elle allait de temps à autre. Là, après s’être assurée qu’elle était bien seulette, elle bergonnait pour retrouver son plaisir enfoui. Jouait de la trompe comme un bateau perdu.
Ainsi vont les secrets qu’on enferme. Ils peuplent la nuit et aident les jours à galoper plus vitement.
En général, après les assauts de son mari, Bazelle filait dans sa chambre. À l’abri, dans la fraîcheur complice des murs blancs, elle baignait son visage. Elle tirait son chignon vers l’arrière, remettait de l’aplomb dans sa coiffure. Puis, en soupirant, elle se dirigeait jusqu’à un coin de la pièce, juste derrière le lit, et dégageait un trou pratiqué entre deux soliveaux. Dans sa main, elle tenait trois cents piasses. Un autre secret. Une autre liberté qu’elle s’était sauvée sur le ménage. Sol après sol. Privation après privation. Hiver après chaleur. Une clé pour s’ouvrir le monde si un jour elle sentait en elle, plus fort que la fidélité, l’envie de sarcher tout quèq’chose du tumulte qu’elle connaissait pas.
La Ville, là-bas, il devait s’en passer!
Doucement, les yeux de Bazelle se perdaient dans le vague. Même pour les honnêtes femmes, il arrive parfois que la vie ne soit plus qu’un long trottoir bordé de boutiques, de vitrines emplies de châles, de jupons, de robes gansées de dentelles et de chapeaux à capeline. Ainsi était le rêve des longs après-midi.
Et le bon temps roulait.
Jean Vautrin. Un grand pas vers le Bon Dieu. Grasset 1989
Et que dire de ce Romanche, langue officielle suisse, qui a aussi des racines latines, d’autres allemandes, parlé aujourd’hui par moins de 20 000 personnes, essentiellement dans le canton des Grisons.
| La Furmaziun cusseglia a tut las persunas che han da far cun dumondas da furmaziun en tut ils secturs: da la scolina sur la scola populara fin a la furmaziun da creschids. La bi-e la plurilinguitad en l’educaziun è in dals accents spezials. La Lia Rumantscha vul sviluppar ina ferma identitad rumantscha, però era promover il respect adequat e la chapientscha per las autras gruppas linguisticas. | La promotion de la langue et de la culture romanches doit avoir pour objectif que chaque personne de langue romanche pratique activement sa langue et la transmette à la génération suivante. Si nous n’atteignons pas ce but, notre langue et notre culture disparaîtront, et avec elles les avantages du bilinguisme et du plurilinguisme, qui sont notre clef décisive à l’ère de la mondialisation. | |
| La Lia Rumantscha accumpogna il svilup da la scola, elavura ideas e concepts, dat impuls per procurar per las premissas adequatas e necessarias per la scola rumantscha, promova l’integraziun linguistica e sociala dals novarrivads e sustegna contacts interculturals. La Furmaziun cumpiglia ils suandants champs d’activitad : Scola/furmaziun / Integraziun / Bi- e plurilinguitad . Detagls davart quests champs d’activitad chattais Vus en la navigaziun da la vart sanestra. | La Lia Rumantscha doit et veut se fixer pour but de promouvoir de manière continue la langue et la culture romanches. Dans son action de promotion du romanche, elle se concentrera à l’avenir plus fortement sur les acteurs de base que sont les familles, selon l’idée-force les Romanches se servent du romanche et le transmettent aux générations suivantes. |
*****
Autant de fois tu connais de langues, autant de fois tu es un homme.
Proverbe arménien
Le 30 octobre 2023, Emmanuel Macron, président de la République, inaugurera la Cité internationale de la langue française (ouverte du mardi au dimanche de 10h à 18 h 30.)
Ce n’est pas en enfermant la langue française dans un musée qu’on la protège. La langue ne doit pas être mise en boite, elle doit au contraire en liberté dans les rues pour rester vivante.
Dominique Bona, de l’Académie Française

restauré pour l’occasion
27 11 1539
Charles Quint veut châtier les Gantois révoltés, mais y aller par mer est dangereux : les corsaires anglais sont redoutables. Et si je passais par le Royaume de France ? On négocie, on prend moult précautions pour qu’il n’y ait pas de lézard, et la chose se fait. L’Empereur entre en France, accompagné du Dauphin Henri et du duc d’Orléans. Henri a maintenant vingt ans, il a quitté les geôles de son hôte voilà dix ans mais même si beaucoup d’eau à coulé sous les ponts, il en garde un cuisant souvenir : Charles Quint n’est pas en bonne santé, affaibli par des hémorroïdes chroniques et un refroidissement momentané : un jour, Henri saute sur l’arrière de son cheval, et serre l’Empereur dans ses bras, avec un vigoureux : Sire, vous êtes mon prisonnier ! Il laisse à l’Empereur le temps de blêmir avant que d’ajouter : Eh, c’était pour rire ! Bordeaux, Poitiers offrent des entrées, François I° vient l’accueillir à Loches et l’accompagnera désormais jusqu’à la frontière du Hainaut : Amboise, Notre Dame de Clery, Orléans, Étampes et Fontainebleau et entrée solennelle dans Paris le 1° janvier 1540 : le Roi avait mandé à la ville de faire à l’Empereur la plus magnifique entrée et la plus riche présent qu’il serait possible. Et Montmorency d’enchaîner qu’ils eussent à trouver de bons maistres peintres inventeurs pour faire les choses qui seroient trouvées en toute singularité. Et les choses furent bien faites et la fête dura même un peu plus que les roses.
Approche-toi, Charles, tant loin tu sois,
Du magnanime et prudent roi François,
Approche-toi, François, tant loin sois-tu,
De Charles plein de louable vertu
Clément Marot
Le gentil poète eut des vers plus inspirés, mais il est vrai que ceux-ci n’étaient que de commande… Les arrières pensées se bousculaient tant dans les coulisses qu’elle envahirent le devant de la scène, soulignant ainsi le triomphe de l’hypocrisie et de la tartufferie dans les relations entre les deux souverains. Puis l’Empereur finit par se remémorer ce pour quoi il était venu : châtier les Gantois, et il ne lésina pas sur le châtiment.
.jpg)
François I° reçoit Charles-Quint et le cardinal Alexandre. Fresque de Taddeo Zuccari
25 12 1539
Gonzalo Pizzaro, gouverneur de Quito, a rassemblé 350 Espagnols, 4 000 péons indiens, des troupeaux innombrables et des animaux de bât pour s’enfoncer plein est dans la forêt amazonienne, à la recherche d’or, bien sûr, mais encore de cannelle. Les Indiens connaissent bien la forêt où ils trouvent la coca dont ils font une abondante consommation : l’Erythroxylum coca, produit une feuille riche en alcaloïde dont le principal est la cocaïne ; elle insensibilise la muqueuse de la bouche et de l’estomac, atténue la sensation de faim et de soif, suspend l’apparition du soroche, le mal des montagnes [15]. Pour s’assurer le contrôle des territoires à coca, les Incas avaient mené des guerres longues et coûteuses contre la tribu sadique des Antis, ou Andes, qui ont laissé leur nom aux cordillères sud-américaines. Les Antis découpaient leurs prisonniers vivants et mangeaient crus les lambeaux de chair. Au bout de plusieurs semaines d’efforts surhumains, l’expédition parvint à un gros torrent, sans doute le Napo, un affluent du Marañon. Gonzalo fait alors construire un brigantin pour y charger malades, artillerie et bagages, dont le commandement est confié à Francisco de Orellana, homme de toute confiance, lui aussi natif de Trujillo ; ce dernier part en avant, pendant que le reste de l’expédition persévérait à pied dans son marécageux calvaire. Gonzalo Pizzaro ne revit jamais Francisco de Orellana, ni le brigantin ni ses passagers : ce dernier avait décidé de lui fausser compagnie et de se laisser aller au fil de l’eau. Il le fit si bien qu’il arriva à l’embouchure du Marañon au bout de 7 mois, dont de nombreux arrêts pour construire un autre bateau, réparer, refaire des vivres et découvrir, le 24 juin un village peuplé exclusivement de femmes au teint clair qui l’accueillirent à grand renfort de flèches : cela le marqua à tel point qu’il décida de débaptiser le Marañon pour le nommer Amazone.
Aucun village n’était distant de l’autre de plus d’un tir d’arbalète […] et il y avait un village qui s’étendait sur cinq lieues sans interruption d’une maison à une autre, ce qui était une chose merveilleuse à voir.
Gaspar de Carvagal, dominicain qui rédigera le voyage dans Descubrimiento del rio de las Amazonas.
Longtemps, ces propos seront pris pour de l’affabulation, puis les travaux du chercheur français Stephen Rostain, conforté par le Lidar, vinrent confirmer l’existence de ces cités-jardins sur les berges de la rivière Upano.
Ont ainsi été mis au jour dans la vallée d’Upano, bordant la rivière, un réseau de 6 000 monumentales plateformes artificielles en terre où étaient autrefois érigés bâtiments résidentiels et cérémoniels ; des places et rues suivant un schéma géométrique ; des champs agricoles et leurs importants canaux de drainage ; des routes larges et droites s’étendant sur de grandes distances, dont la plus grande mesure 10 mètres de large et s’étend sur 10 à 20 kilomètres.
Les chercheurs ont découvert que ces colonies avaient été occupées à une période à peu près contemporaine de l’Empire romain en Europe, entre environ 500 av. J.C. et 300 à 600 apr. J.C., par le peuple Upano – du nom de la rivière éponyme, qui traverse la province équatoriale de Morona-Santiago avant de se jeter au Pérou dans le río Marañón, affluent de l’ Amazone
Malgré le temps qu’il leur a certainement été nécessaire pour ces constructions, les Upano furent chassés de cette région cachée entre deux cordillères vers 300/400 apr. J.C., en raison d’une éruption du proche stratovolcan Sangay, explique Stéphen Rostain dans son article Les tertres artificiels du pîémont amazonien des Andes, Équateur. (Les Nouvelles de l’Archéologie, 2008). Plus tard, des groupes de culture Huapula seraient venus s’installer sur les monticules existants.
Bien qu’il soit difficile d’estimer les populations qui habitaient le large site il y a deux millénaires, celui-ci aurait pu abriter au moins 10 000 habitants, d’après Antoine Dorison, archéologue du CNRS et coauteur de l’étude. Voire jusqu’à 15 000 ou 30 000 à son apogée, soit la population estimée de Londres (Londinium), alors plus grande ville de la Grande-Bretagne romaine (Britannia). Une occupation dense donc, d’une société plus complexe qu’imaginé auparavant.
La caractéristique la plus remarquable du paysage, développent les spécialistes, est sans doute ce système de routes reliant les différents centres urbains, créant ainsi un réseau à l’échelle régionale. Un tel développement précoce et étendu dans le Haut-Amazonie est comparable aux systèmes urbains mayas similaires récemment mis en évidence au Mexique et au Guatemala.
Seulement, si les Mayas ou encore les Incas disposaient de pierres (calcaire, gré, stuc, andésite, granit, etc.) pour sortir de terre leurs fabuleux temples, les indigènes de l’Amazonie n’auraient pas eu accès à de telles ressources. Ils construisaient avec de la boue. Cela représente quand même une immense quantité de travail pour construire ces milliers de monticules et routes, décrit à l’AP José Iriarte, archéologue à l’université d’Exeter (Angleterre) qui s’intéresse à l’émergence des sociétés complexes dans les Amériques, mais n’a pas participé aux recherches.
Si, continue-t-il, l’Amazonie est souvent perçue comme une nature sauvage vierge avec seulement de petits groupes de personnes – le désert vert compte aujourd’hui seulement 34 millions de personnes sur 5 % de la surface terrestre (environ 6,9 millions de km²), selon Greenpeace (2016) – ces découvertes récentes nous ont montré à quel point le passé est vraiment nuancé.
Mathilde Ragot. Géo 12 janvier 2024
Sans guide, sans boussole, sans autres armes que l’épée, sans vivres, le Bateau Ivre du rebelle [16] avait parcouru plus de quatre mille kilomètres !
Jean Amsler. Les explorateurs. 1955
Il adapta ses bateaux, leur installa un semblant de voiles et, vogue la galère, se mit à faire de la navigation côtière jusqu’à l’île de Cubagua qu’il atteignit le 11 septembre 1540, dans le golfe de Paria, à l’ouest de la Trinité. La suite de ses aventures, une fois conté son exploit à la cour d’Espagne, fût moins glorieuse et il mourut lors de l’expédition suivante.
Gonzalo Pizzaro s’était donc retrouvé en pleine forêt vierge à 1 600 kilomètres de Quito, avec l’essentiel de sa logistique voguant sur les eaux amazoniennes, plein est. N’ayant même plus une scie, ni un clou ni un marteau pour entreprendre la construction d’un autre radeau, il décida de faire demi-tour ; on mangea les chevaux, puis les chiens, on captura les serpents, les poissons chats gélatineux, les rats d’eau. Et ce sont seulement 80 Espagnols faméliques, squelettes titubants, qui parvinrent à Quito en juin 1542, deux ans et demi après leur départ. 10 000 Indiens étaient morts. Tout cela pour une cannelle même pas aussi bonne que celle de l’orient, et pas du tout d’or ! Gonzalo se vit alors confier l’administration des mines d’argent de Potosi, dans l’actuelle Bolivie. On ne sait au juste de quoi furent alors peuplés ses rêves, mais Francisco de Orellana, l’ami d’enfance de Trujillo, dut y figurer en bonne place. Sa tête tombera le 9 avril 1548, marquant ainsi la fin de la grande Conquista.
Si l’univers de l’homme moderne est devenu problématique – sans pour autant accroître le bonheur ni le malheur des individus – c’est notamment à cause de l’acte inouï d’un marin génois, et du vœu prononcé par une reine de Castille, pieusement accompli par deux générations de capitaines.
Ils furent de deux sortes : la première génération tentait l’inhabituel par des moyens césariens ; la seconde sert la Couronne et continue une tradition. Tous sont Espagnols, bretteurs, brûleurs de cierges, machiavéliques et convertisseurs.
L’exécution de Gonzalo Pizarre, en 1548, achève l’ère des grands conquistadors ouverte en 1519 par Cortès. Jamais, dans l’histoire de l’Europe, pareil type ne reparaîtra, sauf peut-être au temps de Napoléon. Les monarchies, jalouses de leur légitimité, légueront leur zèle soupçonneux aux démocraties héritières qui, comme elles, se réclament de principes transcendants aux individus.
C’est à peine si, de Cortès à Gonzalo, s’est écoulée une génération d’hommes : le temps qu’il fallait au pouvoir central pour engranger la récolte et se prémunir contre les ambitions déréglées. Parmi ceux qui ont incarné cet âge grandiose de la Conquista, trois figures émergent : les conquérants heureux du Mexique et du Pérou, celui aussi qui tenta de conquérir l’Amérique du Nord et en mourut : Cortès, Pizarre, Soto. Ils sont bien différents. Aucune formule n’épuise la personnalité de Cortès, qu’une accumulation d’adjectifs élogieux ou sévères laisse inexprimée. Ses deux émules se caractérisent par ce qui leur manque lorsqu’on les compare à lui.
Seul un trait commun unit ces trois hommes et tous ceux, grands et petits, qui les ont suivis, imités, admirés ou trahis : l’énergie brute, ou plutôt une indomptable vitalité. En harnois d’acier sous le soleil de l’équateur, à travers bois, marais, déserts, parmi les anthropophages, les moustiques, les serpents, dédaigneux de toute hygiène, ils vont. Tous trois élancés, secs, capables à la fois de détentes brusques et d’efforts prolongés, ils n’ont ni foie, ni estomac, ni nerfs ; sélectionnés dès le berceau par l’incurie et la misère espagnole, par l’âpre climat de l’Estrémadure, seule la mort les arrête. Ils marchent, frappent, bravent, désirent, conquièrent, possèdent, dilapident, recommencent, tombent et meurent. Leur vie n’est qu’action.
Action solitaire. Par des mérites personnels, ils obtiennent la gloire et, croient-ils, la vie éternelle. Pour des fautes personnelles, ils sont tués. Ils ne connaissent que des individus : leur roi, la Vierge, Saint-Jacques, leur confesseur, leurs lieutenants désignés par un nom propre, leurs hommes individualisés, leur cheval, leur maîtresse, leur page, leurs ennemis. Montezuma, puis Cuauhtemoc, résument pour Cortès les Aztèques. Pizarre connaît Atahuallpa, mais ignore le peuple péruvien. Soto se consume de ne rencontrer dans les immensités nord-américaines aucun adversaire à sa taille.
Un trait commun surprend considérablement l’observateur moderne ; le grand conquistador choisit d’incarner l’Idée, la Foi, la Castille, non l’intérêt collectif.
Chacun des candidats conquérants tente isolément son entrada, comme le romanesque Amadis. Cortès rejette le contrôle de Velasquez ; Pizarre élimine celui de Pedrarias ; Soto, pour avoir évité de coordonner son action avec celle de Coronado, manque de subjuguer un continent. La rencontre de Bogota, si singulière, annonce une époque nouvelle : celle des gens pratiques.
Il est bon que le conquistador ait existé pour démontrer ce dont est capable un individu. Il est douteux qu’il renaisse jamais dans l’univers moderne, champ clos des machines et des masses.
Jean Amsler. Les explorateurs. NLF 1955
06 1540
L’édit de Fontainebleau met fin aux tentatives de conciliation avec les protestants : il s’agit désormais d’extirper l’hérésie et de faire disparaître la secte luthérienne.
27 09 1540
Frère de Giulia bella, rivale de Lucrèce Borgia, Alexandre Farnèse, pape sous le nom de Paul III, homme de grande culture, n’était probablement pas the right man in the right time dont aurait eu alors besoin une Église dans la tempête, mais il voyait tout de même juste et avait eu en main le rapport d’une commission nommée par ses soins pour dresser un état de l’Église et en proposer la réforme : […] Très Saint Père, comme le cheval de Troie, se déversèrent dans l’Eglise de Dieu une foule de mots et d’abus qui nous conduisirent à nous faire désespérer de son salut. Cette situation est connue jusque chez les infidèles et c’est pour cela qu’ils tournent en dérision notre religion et que le nom du Christ est déshonoré…
Bienheureux Père, tous les étrangers se scandalisent en entrant dans l’église de Saint Pierre, d’y voir la messe célébrée par certains prêtres ignorants et aux vêtements liturgiques immondes […] Cela vaut pour les autres églises. Les courtisanes vont dans la ville comme des matrones : elles circulent dans des coches à mules, escortées en plein jour par des nobles personnages, des familiers de cardinaux, des clercs. En aucune autre ville ne se voit un pareil désordre.
[…] Tu t’es choisi le nom de Paul…. Nous espérons que tu as été élu pour restaurer dans nos cœurs et dans nos œuvres le nom du Christ oublié par le peuple et par nous les clercs pour guérir nos maux […] pour détourner de nous la colère du Christ et que la vengeance méritée qui est déjà suspendue au-dessus de nos têtes.
Il a reçu Ignace de Loyola et ses compagnons qui veulent fonder la Société de Jésus, qui voue obéissance absolue au pape. Initialement orientés vers un pèlerinage à Jérusalem, avec conversion des Turcs au passage, Ignace et ses compagnons avaient réalisé la chose impossible et décidé qu’il était préférable de s’en remettre au souverain pontife… quel qu’il fut, mais qui saurait les envoyer là où il le jugerait nécessaire ; et puis, chose incroyable alors à Rome, en échange ils ne demandaient… rien ; Paul III se dit alors : des gens qui me vouent obéissance sans rien demander en retour, ce n’est pas demain la veille que je risque de revoir cela… c’est la main de Dieu.
Aussi, malgré la mauvaise volonté des cardinaux, mais avec l’affectueuse persuasion de Marguerite d’Autriche, bâtarde de Charles Quint et épouse de son petit-fils Ottavio Farnese, Paul III consacre l’existence des Jésuites par la bulle Regimini Militantis Ecclesiae.
Le 22 avril 1541, les dix premiers Jésuites : Ignace de Loyola, François Xavier, Pierre Favre, Diego Laynez, Salmeron, Rodriguez, Le Jay, Broët, Codure et Bobadilla éliront leur supérieur, Ignace de Loyola, non sans que celui-ci se soit fait plus que prier, mais bien engueuler par Diego Laynez. Avaient voté par correspondance, car déjà envoyés aux quatre coins du monde : Pierre Favre, François Xavier, Rodriguez.
Ignace avait eu une expérience douloureuse avec une femme : aussi tint-il à les tenir éloignées à jamais de son ordre : c’est François Xavier qui le rapporte : Isabelle Roser était une pieuse femme, très dévouée à Saint Ignace – elle l’aida de ses deniers longtemps – lui donna par la suite beaucoup d’ennuis -. Elle vint à Rome en 1543, quand la compagnie avait pris corps, voulut se consacrer à diverses œuvres fondés par saint Ignace et même, en 1545 (année du Concile de Trente), elle demanda d’être agrégée au nouvel Institut et de prononcer des vœux solennels. Non seulement elle ne fut pas exaucée, mais encore, s’étant rendue insupportable par son caractère et ses exigences, elle finit par recevoir l’invitation formelle de quitter Rome. Elle regagna Barcelone, devint franciscaine au couvent de Sainte Marie de Jésus et mourut paisiblement, tout à fait réconciliée avec saint Ignace. Mais lui, instruit par l’expérience, demanda au Pape que jamais la Compagnie ne fût autorisée à créer une branche féminine.
18 11 1540
Le parlement d’Aix décide de frapper les Vaudois, et surtout leurs barbes, prédicateurs itinérants dotés d’une formation aux Écritures plus solide que celle d’un curé de campagne. On ordonne la destruction des villages de Cabrières, Cabrièrette, La Coste, La Motte d’Aigues, Lourmarin, Mérindol, Paypin, Saint Martin, dans le Lubéron. François I° temporise et ordonne un sursis.
Bernard Palissy s’installe à Saintes comme peintre verrier. Après avoir vu une coupe de terre tournée es esmaillée d’une telle beauté que des lors, j’entray en dispute avec ma propre pensée : il va dès lors se consacrer à percer le secret de l’émail, passion qui dévorera ses biens : ….mais sur cela il me survint un autre malheur, lequel me donna grande fascherie, qui est que le bois m’ayant failli, je fus contraint brusler les estapes qui soutenoyent les trailles de mon jardin, lesquelles étant bruslées je fus contraint de brusler les tables et plancher de la maison.
L’émail était sa passion, mais cela ne l’empêchait pas de porter son intérêt sur bien d’autres sujets. Sans avoir reçu de formation spécifique en histoire naturelle, il se mit à donner des cours à Paris qui attirèrent rapidement les hommes les plus instruits de la capitale,… il fut l’un des rares hommes de son temps à dire que l’eau des fleuves provenait exclusivement des chutes de pluie. … il étudia les puits artésiens, proposa des plans pour les fontaines, étudia les fossiles, pensant qu’ils étaient les vestiges d’animaux et de végétaux, affirmant que d’autres fossiles étaient les témoins d’espèces disparues … il démontra que l’or potable, – remède très célèbre à l’époque -, n’était pas réellement potable et encore moins bénéfique, prouva que le mithridate – un remède chimique composé de quelques 300 ingrédients – était non seulement inutile, mais nuisible. Converti au protestantisme, il refusa toujours d’abjurer : emprisonné puis libéré sur les instances de son protecteur, Anne de Montmorency, il passera les dernières années de sa vie à la Bastille où il fut enfermé par la Ligue et mourut à l’âge de 80 ans, en 1589.
1540
Pedro de Valvidia traverse le désert d’Atacama, entre 2 chaines de la Cordillère des Andes et fonde Santiago du Chili.
Mendoza, le vice roi du Mexique, au vu des informations rapportées du nord par le frère Marc De Niza prend de vitesse le marquis del Valle, autrement dit Cortés, et envoie le gouverneur de Nouvelle-Galice, Francisco Vâzquez de Coronado, à la tête d’un millier d’hommes explorer ces contrées prometteuses, avec, pour guide. le frère Marc de Niza. Ce n’était pas de la reconnaissance : c’était de la colonisation : mille chevaux, bœufs, moutons et cochons, le tout part de Culicán, au bas du golfe de Californie. Après bien des péripéties et des drames – famine et anthropophagie, massacres et destructions – les Espagnols s’emparent de Cibola, après avoir cheminé par la vallée de la Sonora, du rio San Ignacio, rio Santa Cruz, rio Gila : Cibola n’est en fait qu’une misérable bourgade. Un détachement de l’expédition reconnait le cours inférieur du Colorado, puis le plateau lui-même, en bordure de canyon, avec le fleuve 1800 m plus bas, qu’ils cherchent à atteindre en vain. Ils parviennent jusque vers 40° nord, probablement aux abords du Missouri. Coronado a un accident qui l’empêche de remonter à cheval. Les Indiens se feront de plus en plus entreprenants et dangereux : on décidera de la retraite. Ils reviendront fourbus, – pour ceux qui en reviendront -, et sans avoir, bien entendu, découvert l’Eldorado.
Et c’est ainsi que débuta, dans les pires conditions, une marche vers le nord qui, en dépit des efforts prodigués par les Espagnols au XVIII° siècle, c’est-à-dire bien trop tard, sera remplacée au XIX° siècle par une marche vers l’ouest. Une marche dont les Espagnols ne sont plus les protagonistes.
Jean-Marie Auzias, Bernard Lesfargues. Introduction au Voyage et à la Relation de Cabeza de Vaca. Babel Actes Sud 1979
Mais… car il y a un mais et de taille : Coronado prit une initiative qui, avec le recul de quelques siècles, apparaît comme une véritable bénédiction pour les peuples indigènes, l’initiative la plus heureuse qui ait jamais été prise par le représentant d’un peuple en faveur d’un autre peuple, et ce, sans qu’aient été mesurées sur le moment, ses extraordinaires conséquences : l’abandon sur place du bétail. Nombre d’entre eux furent récupérés par les Indiens Pueblos installés à proximité, sans qu’ils en eussent vraiment l’usage. Les autres oublièrent rapidement le dressage et redevinrent sauvages : ce sont les mustangs qu’apprivoiseront les Indiens, probablement au début du XVIII° siècle : cela leur fera tout de même près de deux siècles de retour à la vie sauvage.
Ces terres étaient un paradis pour le cheval qui s’y multiplia tant et plus. Les Indiens du territoire entre la rive droite du Mississippi et les Rocheuses – essentiellement les Comanches et les Apaches – firent sa connaissance, ils se plurent, sortirent beaucoup ensemble et se marièrent pour plusieurs siècles. Dans la corbeille, le cheval apportera une enivrante liberté aux Indiens : les changements seront plus d’ordre quantitatif que qualitatif : plus de distances parcourues, plus de rapidité pour la chasse, donc plus de bisons tués, donc plus de pouvoir pour le clan. Car ceux qui adopteront le cheval, dans ces grandes plaines à l’ouest du Mississippi n’étaient pas agriculteurs, ils étaient déjà chasseurs-cueilleurs… mais chasseurs … à pied.
Cet accroissement de leur activité principale, la chasse, les mit en concurrence pour les mêmes terres, les différentes tribus devinrent rivales. Les grandes plaines américaines vont devenir le théâtre de deux siècles de chevauchées incessantes ; c’est de grand air que se saoulaient les hommes, célébrant les épousailles de tout un peuple avec une nature qui impose ses règles, le tout transcendé dans une cosmogonie à même de figurer au frontispice des tous les mouvements écologistes de notre XXI° siècle : le prédateur savait s’arrêter avant que de devenir exterminateur. Cette harmonie durera jusqu’à ce que le colt yankee installe sa suprématie.
Nul ne sait exactement comment et à quel moment les bandes comanches de l’est du Wyoming croisèrent pour la première fois le cheval, mais l’événement se produisit probablement vers le milieu du XVII° siècle. Les Pawnees, qui vivaient dans l’actuel Nebraska, possédaient des montures en 1680. Les Comanches devaient donc en avoir également à cette époque. Il n’y eut aucun témoin du rapprochement extraordinaire entre ces chasseurs de l’âge de pierre et les mustangs, aucune trace de ce qui se passa lorsqu’ils se rencontrèrent ni rien qui expliquât ce supplément d’âme qui permit au Comanche de comprendre le cheval bien mieux que quiconque. Quelle qu’en fût la cause – un éclat de génie accidentel, un lien particulier, subliminal, entre les guerriers et leurs montures -, elle dut faire tressaillir ces parias à la peau sombre du pays de la Wind River. Les Comanches s’adaptèrent au cheval plus tôt et plus complètement que n’importe quelle autre tribu de la région. Tout le monde ou presque s’accorde à les considérer comme le prototype du peuple cavalier d’Amérique du Nord. Personne n’égalait leur talent ou ne tirait mieux qu’eux à cheval. Parmi les autres tribus de cavaliers, seuls les Kiowas combattaient entièrement en selle comme les Comanches. Les Pawnees, les Crows et même les Dakotas se servaient principalement de leurs montures pour se déplacer. Ils se rendaient jusqu’au champ de bataille, puis mettaient pied à terre et ouvraient les hostilités. (Il n’y a qu’au cinéma que les Apaches donnent l’assaut à cheval) Aucune tribu en dehors des Comanches n’apprit à élever les chevaux – une activité extrêmement exigeante, impliquant de nombreuses connaissances, qui contribua d’ailleurs à les enrichir considérablement. Ils castraient toujours les troupeaux avec soin et ne montaient pratiquement que des hongres. Peu d’Indiens se donnaient cette peine. Il n’était pas rare qu’un guerrier comanche possède cent à deux cents montures et un chef, quinze cents. (Un chef sioux, par exemple, en avait généralement quarante) Leurs chevaux firent d’eux la tribu la plus riche mais permirent également en grande partie aux autres Indiens d’apprendre à monter.
Les premiers Européens et Américains qui virent les Comanches en selle ne manquèrent pas de noter leur dextérité. Athanase de Mézières, un agent indien espagnol d’origine française, les décrivit ainsi : Les Comanches sont un peuple si vaste et arrogant que lorsqu’on leur demande leur nombre, ils n’hésitent pas à le comparer à celui des étoiles. Ce sont des cavaliers si talentueux qu’ils n’ont pas d’égal, si audacieux qu’ils ne demandent et n’accordent jamais de trêve, et en possession d’un tel territoire – où abondent les pâturages pour leurs chevaux et les bisons qui leur fournissent tous les habits, la nourriture et les matériaux nécessaires – qu’ils possèdent presque toutes les commodités de la terre.
D’autres observateurs firent le même constat. Le colonel Richard Dodge, dont l’expédition entra très tôt en contact avec des Comanches, les considérait comme la meilleure cavalerie légère du monde, supérieure à toutes les troupes montées d’Europe ou d’Amérique. Catlin les tenait également pour d’incomparables cavaliers. Comme il l’explique, les soldats américains furent ébahis par ce qu’ils virent.
À pied, c’est l’une des races d’Indiens les plus laides et les plus négligées que j’aie jamais vues, mais dès qu’ils montent en selle, ils semblent subitement métamorphosés, écrivit Catlin. Je suis prêt à affirmer, sans hésitation, que les Comanches sont les cavaliers les plus extraordinaires qu’il m’ait été donné de voir à ce jour au cours de mes voyages. […] Parmi leurs prouesses équestres, l’une d’elles me stupéfia plus que tout ce que j’ai pu voir ou espéré voir dans ma vie : un stratagème de guerre, appris et pratiqué par tous les jeunes hommes de la tribu, qui consiste à laisser son corps retomber à l’horizontale le long de sa monture, le talon accroché au dos de l’animal, à l’abri des armes adverses… Dans cette merveilleuse posture, le cavalier reste suspendu, son cheval lancé à toute allure, sans lâcher son arc et son boucher, ainsi que sa longue lance de plus de quatre mètres.
L’astuce consistait à glisser un bras ou même la tête dans une boucle formée par une corde reliée à la selle ou à la crinière de la monture. Dans cette position, un guerrier comanche pouvait décocher vingt flèches dans le temps qu’il fallait à un soldat pour charger et décharger son mousquet (chacune de ces flèches pouvait tuer un homme à une dizaine de mètres). D’autres observateurs furent stupéfaits par leur technique de domptage. Un Comanche capturait un cheval sauvage au lasso, puis resserrait la boucle, étranglant l’animal jusqu’à ce qu’il se couche au sol. Quand ce dernier semblait quasi mort, la corde était détendue. Le cheval finissait par se relever, tremblant et couvert d’écume. L’Indien lui caressait alors doucement le nez, les oreilles et le front, puis soufflait de l’air dans ses naseaux. Ensuite, il jetait une lanière dans la bouche de la monture apaisée, enserrant sa mâchoire inférieure, l’enfourchait et s’en allait. Les Comanches étaient des génies pour tout ce qui touchait au cheval : l’élevage, le dressage, la vente et l’équitation. Et même le vol. Le colonel Dodge affirma qu’un Comanche pouvait pénétrer dans un bivouac où dormait une douzaine d’hommes, chacun relié à une monture par une longe, couper une corde à moins de deux mètres du dormeur, et s’enfuir avec l’animal sans réveiller une seule âme.[…] Les Comanches ont un sens de l’orientation particulièrement aigu : des pillards, tous âgés de moins de 19 ans sont parvenus à rejoindre Monterrey au Mexique depuis Brady’s Creek, au Texas – c’est à dire plus de 500 km – sans se tromper une seule fois et en s’aidant uniquement des instructions qu’ils avaient reçues.
Aucune autre tribu, à l’exception peut-être des Kiowas, ne vivait autant à cheval. Les enfants recevaient leur propre monture à quatre ou cinq ans. Très vite, les garçons apprenaient des tours, comme s’emparer d’objets au sol sur un animal lancé au galop. Le jeune cavalier s’exerçait d’abord avec des accessoires légers, puis de plus en plus lourds, jusqu’à être capable de ramasser un homme, sans aide et au grand galop. Porter secours à un camarade tombé au combat était l’une des obligations les plus élémentaires des guerriers comanches. Ils étaient initiés très tôt à l’astuce de la corde reliée à la selle. Souvent, les femmes montaient aussi bien que les hommes. Un observateur vit deux squaws équipées de lasso s’élancer à toute vitesse et attraper chacune du premier coup une antilope bondissante. Les femmes avaient leurs propres montures, ainsi que des mules et des chevaux plus dociles réservés au bât.
Quand ils ne volaient pas de chevaux, ou qu’ils ne les élevaient pas, ils les capturaient dans la nature. Le général Thomas James assista à l’une de ces prises en 1823, alors qu’il rendait visite aux Comanches pour acheter des montures. Un grand nombre de cavaliers poussèrent des troupeaux sauvages vers un profond ravin où les attendaient une centaine d’hommes munis de lassos enroulés. Quand les chevaux terrifiés se trouvèrent piégés, les Indiens les attrapèrent par l’encolure ou les pattes, soulevant des nuages de poussière et semant la confusion. Mais chaque cavalier eut un animal. Un seul cheval parvint à s’enfuir. Les Comanches se lancèrent à sa poursuite et, deux heures plus tard, le ramenèrent dompté et doux. En vingt-quatre heures, cent chevaux sauvages, voire plus, furent capturés dans une folle excitation et semblèrent aussi soumis à leurs maîtres que des bêtes de ferme. Ils traquaient les troupeaux pendant des jours, jusqu’à ce que les mustangs s’épuisent et qu’il soit plus facile de les attraper. Ils se postaient à proximité de sources, et quand les bêtes assoiffées s’étaient tellement gorgées d’eau qu’elles ne pouvaient plus détaler, ils se précipitaient sur elles. Si les Comanches disposaient d’un vocabulaire limité pour décrire la plupart des choses – un trait commun aux peuples primitifs -, leur lexique équin était vaste et très détaillé. Dans le seul domaine de la couleur, de nombreux mots permettaient de distinguer les chevaux en fonction de leur robe : brun, bai clair, roux alezan, noir, blanc, bleu, gris louvet, alezan, aubère, roux, saure, saure à crinière et queue noires, pie-roux, louvet et noir. Des termes distincts permettaient même de distinguer également les bêtes à oreilles rousses, saures et noires.
Le cheval jouait aussi un rôle essentiel dans un autre passe-temps cher aux Comanches : les paris. Les histoires d’arnaques liées à des courses de chevaux organisées contre des Comanches sont innombrables. L’une des plus célèbres nous vient de la frontière texane. Quelques Comanches s’étaient présentés à Fort Chadbourne, [après leur reddition, en 1875. ndlr] où des officiers les avaient défiés à la course. L’idée sembla laisser le chef indifférent, mais les militaires insistèrent tellement qu’il finit par accepter. Une course fut organisée sur un parcours de quatre cents mètres. Très vite, un guerrier imposant apparut sur une bête aux longs poils, un misérable canasson aux allures de mouton. Il frappait l’animal avec un gourdin. Peu impressionnés, les officiers sortirent leur troisième meilleure monture et parièrent de la farine, du sucre et du café contre des fourrures de bison. L’Indien l’emporta, en balançant son gourdin avec ostentation. Pour la course suivante, les soldats sortirent leur deuxième meilleure monture. Ils perdirent également. Puis ils insistèrent pour organiser une troisième course et finirent par présenter leur meilleure bête, une magnifique jument du Kentucky. Les paris furent doublés, triplés. Les Comanches acceptèrent tout ce que les soldats leur proposèrent. Au signal du départ, le guerrier poussa un cri, jeta son gourdin et fila comme le vent. À cinquante mètres de la ligne l’arrivée, il se retourna complètement sur sa selle et, avec des grimaces hideuses, fit signe à l’autre cavalier de le rattraper. Les perdants apprirent par la suite que le même cheval aux longs poils avait servi à délester les Indiens Kickapoos de six cents montures.
À la fin du XVII° siècle, la maîtrise du cheval avait conduit les Comanches à délaisser les terres rudes et froides de la Wind River pour des climats plus tempérés. L’implication de cette migration vers le sud était simple : ils contestaient la suprématie d’autres tribus sur le gibier le plus précieux du continent – les troupeaux de bisons des Plaines du Sud -.
S.C. Gwynne. L’empire de la lune d’été. Terre Indienne. Albin Michel 2012
Le cheval est un médium. Il est doué d’un sixième sens. Il sent tout, il sait tout de nous, même ce qu’on lui cache. Nos douleurs enfouies, nos regrets et nos remords inavoués, il les décèle et les porte sur son large dos, impassible et musculeux. Il sait reconnaître, à son poids, à son usage des aides, au battement de son cœur, le prétentieux, le modeste, le courageux, le craintif, le sourcilleux, l’inconscient. Il est indulgent avec les fragiles, mais ne passe rien aux acrimonieux. Il n’a pas besoin de voir pour comprendre – son champ visuel est très étendu sur les côtés, mais réduit vers le bas, et sa perception des couleurs limitée. Il ne donne qu’à proportion de ce qu’on lui offre. Il se confie seulement à qui veut bien, en silence, se confier à lui. Il respecte qui le respecte. La solitude le déprime. C’est un être très sociable, mais pas mondain. Il exige du tact, réclame de la complicité, demande qu’on murmure à son oreille, ne progresse que dans l’insinuation et la délicatesse. À condition qu’on l’aime, il est capable d’exploits extraordinaires. Il est équitable et l’iniquité lui fait horreur : les ordres irraisonnés le bloquent, les commandements violents le braquent, les punitions injustes le révoltent, mais la générosité décuple ses forces. Il est la version animale du juge de paix. Et il n’oublie rien du bien ou du mal qu’on lui a fait. Car sa mémoire est prodigieuse, qui se love dans moindre petit détail. Le cheval est un voyant hypermnésique. Il a un regard intérieur et la nuit, sa complice, ne lui fait jamais peur.
Jérôme Garcin. Le voyant. Gallimard 2014
24 10 1541
Charles Quint a débarqué des troupes au Péñon, à l’ouest d’Alger devenu le fief des corsaires de Barberousse qui infestent la Méditerranée et mettent à mal les relations entre l’Espagne et l’Italie, deux piliers de son Empire. Mais une méchante houle devient tempête et fait s’entrechoquer les navires ; face à cet ennemi inattendu, les assiégeants rembarquent en catastrophe et l’ordre est donné de lever l’ancre au plus vite avant que de voir couler tous les navires, sans même avoir engagé de bataille ; l’affaire sera tenue pour un échec et l’Europe va désormais percevoir les Barbaresques comme invincibles.
1541
Un navire portugais fait naufrage sur la côte est du Japon : les survivants sont le premier contact européen avec le Japon.
Dès mars 1536, Calvin a publié, mais en latin, ses réflexions sur l’ensemble des problèmes religieux : L’Institution de la religion chrétienne. Six chapitres :
- La loi : explication du Décalogue
- La Foi : le Credo
- La Prière : l’Oraison dominicale
- Les Sacrements : baptême et scène.
- Les faux sacrements : pénitence, confirmation, extrême-onction, ordre, mariage.
- La Liberté chrétienne, l’Église et l’État.
Mais c’est seulement fin 1541 que ce livre va connaître le succès, avec la version française, qui connaîtra quatorze rééditions. Il s’éloigne de Luther sur le contenu de l’Eucharistie : là où Luther, à l’instar des catholiques, croit à la présence réelle du Christ dans le pain et le vin du sacrement, Calvin ne veut y voir qu’un symbole et refuse donc de croire à la présence réelle du Christ. Par ailleurs, il s’oppose à la mise en place d’une Église hiérarchisée, les pasteurs ne devant leur situation qu’aux fidèles et aux autorités civiles.
En préambule, une adresse à François I°, exprimant la loyauté des sujets réformés auprès de l’autorité souveraine : A très haut, très puissant, et très illustre prince, François roi de France très chrétien, son prince et souverain seigneur, ce livre est une confession de foi envers toi. […] dont tu connaisses quelle est la doctrine contre laquelle d’une telle rage, furieusement sont enflammés ceux qui par le feu et par glaive troublent aujourd’hui ton royaume. Aucuns de nous sont détenus en prisons, les autres fouettés, les autres menés à faire amende honorable, les autres bannis, les autres cruellement affligés, les autres échappent par la fuite : tous sommes en tribulation tenus pour maudits et exécrables, injuriés et traités inhumainement. Contemple nos adversaires, je parle de l’état des prêtres. […] Pourquoi combattent-ils d’une telle rigueur et rudesse pour la messe ! Le purgatoire ! Les pèlerinages ! et tel fatras. […] Pourquoi sinon pourtant que leur ventre leur est pour Dieu, la cuisine pour religion ? […] Bref, ils sont tous un même propos ou de conserver leur règne, ou leur ventre plein.
À ce moment là, Calvin a été rappelé à Genève où il anime l’Église, contrôle l’État… et veille sur les Réformés français. Il est dangereux d’aimer la culture : théâtre, fêtes, danses sont interdits. La force du calvinisme est de pouvoir adorer Dieu partout : Dieu est présent là où est prêchée sa parole ; nulle structure préalable n’est nécessaire. Les disputes sont un des nombreux vecteurs de diffusion, qui mettent en lice des champions des deux camps, chacun avec un temps de parole, une réglementation précise et un arbitrage des autorités municipales qui désignent le vainqueur, entraînant ainsi la conversion de villes entières : elles seront nombreuses à Berne, Zürich, Lausanne.
Le calvinisme, effort pour restaurer dans la pensée et dans la piété la seule gloire de Dieu tout-puissant offrait une doctrine logique et claire, intégrant la révélation luthérienne du Salut par la Foi au désir humaniste de comprendre, et une organisation ecclésiale solide, que le réformateur saxon avait abandonné aux princes et que Calvin concevait hors de l’État. La transcendance absolue de Dieu est solidement établie, la possibilité de la justification par la Foi réaffirmée, avec la nuance tragique de la prédestination, qu’atténue la certitude du Salut pour qui a reçu la Grâce. Les signes de l’Église sont clairement définis, comme le sont les ministères. Comme chez Farel, la communauté joue un rôle important dans la désignation des anciens et des pasteurs. Et Calvin réussit, dans l’austère simplicité du Temple, à créer une liturgie riche et claire, capable de satisfaire le besoin humain de religiosité et de symboles, sans aucunement tomber dans l’idolâtrie papiste. Le Réformateur avait commencé la traduction du Psautier, les fidèles français vont préférer les textes si simples et si poétiques de Clément Marot. Dès 1539, il en publie une première tranche, la seconde en 1544. Théodore de Bèze achèvera l’ensemble en 1562. Lorsque ces psaumes furent mis en musique par Loys Bourgeois (1547) puis par Claude Goudimel, ce fut un extraordinaire succès et un incomparable moyen de nourrir la foi et la piété des fidèles. La rapide expansion du calvinisme doit évidemment beaucoup à l’existence de la Rome protestante. De Genève viennent les ouvrages, les feuillets, les lettres, les hommes. Et ceux qui fuient la persécution, n’ayant pas la vocation du martyre, se réfugient aux bords du Léman. Ainsi débute le courant que la violente répression d’Henri II gonfla brusquement, et qu’enregistre le nombre de demandes d’admission dans les rangs de la bourgeoisie de la ville : 81 en 1549, mais 587 en 1557…
Jean Jacquart. François I°. Fayard 1994
Christovão et son frère Estevão, fils de Vasco da Gama débarquent en Ethiopie avec 140 soldats : ils sont à l’origine des Burtukan, communauté métisse en Ethiopie qui, en conservant sa religion catholique va représenter le point de référence du catholicisme quand les Jésuites interviendront, presque un siècle plus tard, dans le pays.
Au sud de Casablanca, à El Jadida, les Portugais construisent dans une ancienne salle d’armes, dans les parties basse du château de 1514 une citerne afin de tenir les sièges. Elle sera ensuite fermée et oubliée jusqu’en 1916, où un commerçant la découvrira par hasard quand il souhaitait simplement agrandir sa boutique. Avec ses 6 nefs, ses 25 colonnes et son puits de lumière au centre, cette ancienne citerne de 1100 m² ne pouvait qu’attirer des réalisateurs de films, dont Orson Welles pour y tourner Othello.
30 08 1542
Nouvel édit qui s’en prend aux ecclésiastiques accusés de mollesse dans la lutte contre les hérétiques, constatant que la mauvaise semence d’erreurs s’accroît de jour en jour.
1542
Le pape Paul III crée la congrégation de la suprême Inquisition, appelé à devenir beaucoup plus tard le Saint Office.
_________________________________________________________________________________
[1] Incendié sous la Commune en 1871, l’actuel Hôtel de Ville a été reconstruit en 1882 par l’architecte Ballu.
[2] Il vaudrait mieux dire que l’on fit alors connaissance avec la fourchette, car, pour ce qui est de son usage, c’est autre chose : Au cours de l’âge de l’agriculture, la plupart des Européens portaient un couteau sur eux. Les fourchettes, qui avaient 2 dents seulement, restèrent confinées aux cuisines pendant plusieurs siècles. À Byzance cependant, on utilisa de petites fourchettes de table à partir du X° siècle. Mais l’Italie n’en découvrit l’usage qu’au XVI° siècle ; quant aux Français, à ce que l’on dit, c’est Catherine de Médicis qui la leur fit connaître lors de son mariage en 1533. L’instrument n’eut pas grand succès dans la population ; les fourchettes étaient en effet, difficiles à fabriquer et très coûteuses. La plupart des Européens continuèrent donc jusqu’au XVIII° siècle à manger avec leurs doigts et leur couteau. C’est alors que devint possible la production en masse de fourchettes, de couteaux et de cuillers ; on utilisait d’ailleurs ces dernières depuis toujours pour servir la soupe.
Hugh Thomas. Histoire inachevée du monde. Robert Laffont 1986
[3]
- François (19 janvier 1544 – 5 décembre 1560). Dauphin de France, devient François II, roi de France en 1559. Épouse la reine d’Écosse Marie Stuart en 1558. Aucune descendance.
- Elisabeth de France (2 avril 1545 – 3 octobre 1568). Devient reine d’Espagne en épousant Philippe II en 1559. Cinq enfants.
- Claude de France (12 novembre 1547 – 21 février 1575). Devient duchesse de Lorraine en épousant Charles III de Lorraine en 1559. Neuf enfants.
- Louis de France (3 février 1549 – 24 octobre 1550). Duc d’Orléans sous le nom Louis III, il meurt à un an et huit mois.
- Charles IX (27 juin 1550 – 30 mai 1574). Duc d’Orléans suite au décès de son frère Louis, il devient roi de France en 1560 à la mort de son frère ainé. Il épouse Elisabeth d’Autriche en 1570. Une fille.
- Henri III (19 septembre 1551 – 2 août 1589). Successivement duc d’Angoulême à sa naissance, duc d’Orléans en 1560, duc d’Anjou en 1566 pour devenir roi de Pologne en 1573. Roi de France en 1574 à la mort de son frère Charles, il épouse Louise de Lorraine-Vaudémont en 1575. Sans descendance.
- Marguerite de France (14 mai 1553 – 27 mars 1615). Reine de Navarre en 1572, puis reine de France – la Reine Margot – en 1589 en épousant Henri IV. Sans enfants.
- François de France (18 mars 1555 – 10 juin 1584). Duc d’Anjou, duc d’Alençon, comte de Touraine, duc de Brabant et duc de Château-Thierry. Sa mort à 29 ans fit de Henri de Navarre l’héritier le plus direct du trône de France.
- Victoire de France (24 juin 1556 – 17 août 1556). Meurt à Saint-Germain-en-Laye à deux mois.
- Jeanne de France (24 juin 1556). Mort-née.
[4] Le Savoyard Pierre Favre [né au Villaret, un hameau proche de Saint Jean de Sixt], le Portugais Bobadilla, le Navarrais François Xavier, les Espagnols Diego Laynez, Simão Rodriguez et Salmeron, Martin de Olave, puis un peu plus tard, les Français Paschase Broët et Jean Codure et un second Savoyard, Claude Jay.
[5] C’est probablement de ce séjour que le poète rapporta et fit admettre la règle insensée – ce qui est embêtant pour une règle – de l’accord du complément d’objet direct avec l’auxiliaire avoir.
[6] circule aussi une autre étymologie, venant de la réponse d’un espagnol au roi qui lui demandait ce qu’il y avait là-bas : ca… nada : là-bas, rien.
[7] … ce qui pouvait inclure les langues régionales selon Pierre Encrevé, linguiste. Libération des 11-12 mai 2002
[8] c’est un jeu de mots : les toiles sont le filet où le chasseur accule sa proie, mais aussi les draps
[9] La reine d’Assyrie, Sémiramis, selon Pline, eut un cheval pour amant ; Pasiphaé s’amouracha désespérément d’un grand Taureau… & de leur accouplage naquit le Minautore (Conti, Mythologie VI 5) ; Egesta fut la maîtresse d’un Fleuve qui, pour la circonstance, se transforma en ours ; les Egyptiennes de Mendès honoraient Pan en s’unissant à des boucs.
[10] Pape d’origine française mort en 1335 ; il ne quitta guère Avignon, et ne se rendit certainement pas à Fontevrault, mais il avait la réputation d’être malicieux.
[11] Selon la légende, les religieuses de Fontevrault (près de Saumur) auraient eu le privilège de se confesser à leur abbesse. L’histoire qui va suivre a été racontée en latin et en français avant Rabelais.
[12] Religieuses faisant partie du conseil de la supérieure.
[13] Privilège accordé par lettre du pape.
[14] Trois cent cinquante ans plus tard, comme le disait Julos Beaucarne, pour ça, les choses n’ont pas changé…
[15] En 2018 une expédition scientifique étudiera les phénomènes d’adaptation de l’homme à la haute altitude à la Rinconada, une ville de 60 000 habitants, pour la plupart Quechua et Aymara, dont 18 000 mineurs, à 5 300 m. d’altitude dans les Andes péruviennes, proche de la frontière bolivienne, au nord du lac Titicaca ; c’est une mine d’or. Ils trouveront des taux d’hématocrite de 85 % [l’hématocrite est le pourcentage de globules rouges par rapport au volume total de sang] En dessous de 1 500 mètres, en Europe, il tourne autour de 40 %. À 5 300 mètres, il y a 50 % de moins d’oxygène qu’au niveau de la mer, et donc la pression partielle d’oxygène dans le sang diminue en conséquence. Le mal aigu des montagnes – MAM – en anglais chronic mountain sickness – CMS – ou encore maladie de Monge, Soroche en Quechua, tient à cette rareté de l’oxygène. Pour s’adapter au manque d’oxygène, les hommes augmentent tous de façon exceptionnelle leur quantité de globules rouges, mais aussi un quart d’entre eux, donc un taux de prévalence très élevé par rapport à d’autres populations d’altitude, souffrent du mal chronique des montagnes. Mais, chose étonnante, ceci n’est pas vrai des femmes, qui semblent protégées par leur système hormonal. Les Indiens seraient là depuis environ 10 000 ans. Mais il est d’autres populations dans le monde qui vivent en altitude depuis beaucoup plus longtemps et qui n’en souffrent pas : les Tibétains, dans l’Himalaya depuis 25 000 ans – les performances des sherpas – et surtout les Éthiopiens sur leurs hauts plateaux depuis 100 000 ans. Ces derniers ont eu tout le temps qu’il fallait pour que leurs gênes ne les gênent pas, ce qui leur permet de glaner à grandes brassées les records du monde et autres médailles d’or des courses de fond et demi-fond.
[16] Les mots de traître, félon, seraient beaucoup mieux appropriés. Il est bien possible que les rites du solstice d’été aient imposé à cette tribu le départ temporaire des hommes. De son vivant, pratiquement personne ne le crut, de même pour les années suivantes, car personne d’autre n’avait rencontré ces guerrières. Mais cela, pour la simple raison que l’arrivée des Blancs en nombre signifia aussi apport de virus qui décimèrent ces populations. Il faudra attendre le XXI° siècle pour réaliser que l’Amazonie devait alors compter de huit à dix millions d’individus.


Laisser un commentaire