| Publié par (l.peltier) le 10 novembre 2008 | En savoir plus |
1626
À Cambridge, banlieue de Boston, dans le Massachusetts, le pasteur puritain Harvard crée un collège qui va prendre son nom en 1641, puis devenir l’université la plus célèbre des États-Unis ; l’enseignement principal y est celui de la théologie destiné aux futurs ministres du Seigneur.
… des différents rameaux de la Réforme protestante, le calvinisme est celui qui forme le terrain le mieux disposé pour l’éclosion des idées démocratiques, et, dans les colonies d’Amérique, la plupart des sectes procèdent du calvinisme. Le développement de l’éducation sera particulièrement marqué : enseignement primaire, bibliothèques, écoles, goût de la lecture, nombreuses imprimeries…
René Rémond L’Amérique Anglo saxonne. 1986
Peter Stuyvesant a fondé Nieuw Amsterdam l’année précédente, et ces hollandais vont donner une nouvelle jeunesse à Saint Nicolas, un des rares saints rescapés du protestantisme, dont le culte s’était maintenu dans le nord de l’Europe et notamment aux Pays Bas, où il avait pris le nom de Sinter Klaas, au cœur de la célébration de Noël, à coté du sapin devenu cher aux protestants. Sinter Klaas devient alors Santa Claus.
Pas bien loin de là, de l’autre coté des Appalaches, des Grands Lacs à la haute vallée du Mississippi, les cinq nations iroquoises transmettent depuis des siècles une autre appréhension du monde, une autre éducation : Dans les villages iroquois, la terre était détenue et travaillée en commun. La chasse se faisait en groupe et les prises étaient partagées entre les membres du village. Les habitations étaient considérées comme des propriétés communes et abritaient plusieurs familles. La notion de propriété privée des terres et des habitations était parfaitement étrangère aux Iroquois. Un père jésuite français qui les rencontra en 1650 écrivait : Nul besoin d’hospices chez eux car ils ne connaissent pas plus la mendicité que la pauvreté. […] Leur gentillesse, leur humanité et leur courtoisie les rendent non seulement libéraux en ce qui concerne leurs possessions mais font qu’ils ne possèdent pratiquement rien qui n’appartienne également aux autres.
Les femmes jouaient un rôle important et avaient un statut respecté dans la société iroquoise. En effet, le lignage s’organisait autour de ses membres féminins dont les maris venaient rejoindre la famille. Chaque famille élargie vivait dans la grande maison et lorsqu’une femme désirait se séparer de son mari elle déposait simplement les affaires de ce dernier devant la porte.
Les familles formaient des clans et une douzaine ou plus de clans pouvaient former un village. Les femmes les plus âgées du village désignaient les hommes habilités à représenter le clan aux conseils de village et de tribu. Elles désignaient également les quarante-neuf chefs qui composaient le grand conseil de la Confédération des cinq nations iroquoises. Elles assistaient aux réunions de clans, se tenaient derrière le cercle formé par les hommes qui discutaient et votaient les décisions. Si ces derniers allaient dans un sens trop éloigné de celui qu’elles souhaitaient, elles pouvaient les démettre et le remplacer.
Les femmes surveillaient également les récoltes et s’occupaient de l’administration générale du village tant que les hommes étaient à la chasse ou à la pêche. En outre, comme elles fournissaient les mocassins et la nourriture pour les expéditions guerrières, elles avaient également un certain contrôle sur les affaires militaires. Comme le fait remarquer Gary B. Nash dans son fascinant ouvrage sur les premières années de l’Amérique, Red, Blacks and Whites, le pouvoir était donc bien l’affaire des deux sexes, et l’idée européenne d’une domination masculine et d’une sujétion féminine en toutes choses était remarquablement étrangère à la société iroquoise.
On enseignait aux enfants iroquois aussi bien l’héritage culturel de leur peuple et la nécessaire solidarité entre tribus que le devoir de ne pas plier devant un quelconque abus d’autorité. On leur enseignait aussi l’égalité des statuts et le partage des possessions. Les Iroquois ne punissaient jamais cruellement leurs enfants. Le sevrage et la toilette n’étaient pas imposés autoritairement et les enfants étaient autorisés à franchir graduellement et de façon autonome ces étapes de leur éducation.
Tout cela, bien sûr, jurait parfaitement avec les valeurs européennes que les premiers colons apportèrent avec eux : une société divisée en pauvres et riches, contrôlée par les prêtres, par les gouverneurs, et par les hommes en ce qui concernait la vie familiale.
[…] Gary Nash dépeint ainsi la culture iroquoise : Nulle loi ni ordonnance, ni shérifs ni gendarmes, ni juges ni jurys, ni cours de justice ni prisons – tout ce qui compose l’appareil autoritaire des sociétés européennes -, rien de tout cela n’existait dans les forêts du Nord-Est américain avant l’arrivée des Européens. Pourtant, les limites du comportement acceptable y étaient clairement déterminées. Bien que mettant en avant la notion d’individu autonome, les Iroquois n’en avaient pas moins un sens aigu du bien et du mal. […] Celui qui volait de la nourriture ou se conduisait lâchement au combat était couvert de honte par son peuple et mis à l’écart de la communauté jusqu’à ce qu’il eût expié sa faute par ses actes et apporté la preuve, à la plus grande satisfaction de ses congénères, qu’il s’était moralement purifié de lui-même.
Façon de voir partagée aussi bien par les Iroquois que par les autres tribus indiennes. En 1635, les Indiens du Maryland firent la réponse suivante au gouverneur qui avait exigé que, au cas où l’un d’entre eux assassinerait un Anglais, le coupable lui fût livré afin d’en répondre devant les lois anglaises : C’est la coutume chez nous, les Indiens, lorsqu’un accident pareil se produit, de nous efforcer de racheter la vie d’un homme aussi vil en offrant cent brassées de perles. Aussi, puisque vous êtes étrangers ici et que vous êtes venus dans notre pays, vous devriez vous conformer à nos coutumes plutôt que de nous imposer les vôtres.
Howard Zinn. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Agone 2004
20 06 1627
Des corsaires venus de Salé, au Maroc, débarquent à Grindavik, au sud-ouest de l’Islande. Ils capturent quinze personnes et deux vaisseaux danois.
16 07 1627
Des corsaires venus d’Alger débarquent sur l’île Heimaey, la plus grande des îles Vestmann, au sud-ouest de l’Islande, tuent une trentaine de personnes et en capturent 242, cap sur Alger. Seule quelques uns d’entre eux pourront être rachetés et rentrer à la maison.
10 09 1627
Richelieu, ancien proviseur du collège de la Sorbonne, est arrivé au pouvoir depuis plus de 3 ans, à la faveur d’un retour en grâce de Marie de Médicis auprès de son fils Louis XIII. Il était devenu la tête des partisans – d’aucuns parlent de clan – de Marie, et Louis XIII avait reconnu la qualité du personnage. Il craint que la place forte protestante de La Rochelle ne devienne une tête de pont pour un débarquement anglais en France. Son exceptionnelle situation remontait à beaucoup plus loin que son occupation par les Protestants : c’est depuis Louis XI qu’elle bénéficiait de privilèges exorbitants : droit de trafiquer librement, même en temps de guerre, avec tous pays même ennemis, et d’accueillir tous étrangers, même de nations en guerre avec la France ! Il y avait de quoi être plus qu’agacé ! La ville est régulièrement approvisionnée par les Anglais ; 3 mois plus tôt, ceux-ci avaient débarqué sur l’île de Ré. Il décide de son siège : coté terre, une ligne de retranchement de 12 kilomètres, coté mer, une digue de pierre de 1 500 m. de large en travers de la rade ; la digue est renforcée par des navires coulés et des estacades de bateaux amarrés les uns aux autres par des chaînes ; deux flottes anglaises, tentent d’empêcher les travaux : elles sont repoussées : la ville capitulera 400 jours plus tard, anéantie : 22 500 morts, 5 500 survivants ! L’armateur et maire Jean Guiton, avait été le principal animateur de la résistance : Pourvu qu’il reste un homme pour fermer les portes c’est assez. Louis XIII graciera les survivants : la route pour le pouvoir absolu de Louis XIV était bien balisée.

de Henri Paul Motte 1881
Cependant la guerre civile se ralluma ; la cour, pour faire cesser ce fléau, recourut aux voies de la perfidie, et fit arrêter le prince de Condé, chef des rebelles. Louis XIII, né pour être maîtrisé, se laissa subjuguer par les manières insinuantes du jeune Albert de Luynes, simple gentilhomme, et fatigué de la tyrannie du florentin Concini, créé maréchal de France, sans avoir jamais paru dans les armées, il le fit tuer d’un coup de pistolet, par Vitry, capitaine des gardes, qui, sans l’avoir non plus trop méritée, obtint la place de la victime. Caligaï, plus infortunée que son époux, traitée comme une sorcière par ses juges, se défendit avec autant de fermeté que de noblesse, et périt sur l’échafaud.
Depuis cette révolution, Marie de Médicis n’éprouva que des revers, et l’ingratitude de son fils. Cette reine, originaire d’Italie, ne sachant ni dissimuler, ni être artificieuse comme les Italiennes, se méprit sur la connoissance des hommes, et protégea Richelieu qui devint son plus mortel ennemi. Exilée dans Blois, elle vit toute l’autorité passer entre les mains du duc de Luynes ; le duc d’Épernon, après l’avoir tirée de cette ville, leva des troupes : durant deux années, le roi et sa mère ne s’occupèrent que de nouvelles entreprises hostiles, et de nouvelles réconciliations peu durables. Toutes ces dissentions relevèrent les espérances des calvinistes dirigés alors par le duc de Rouan, général qui jouissoit d’une grande réputation militaire ; ils reprirent les armes, et leurs succès firent trembler la cour. De Luynes venoit de mourir en 1622 avec le titre de connétable, et le maréchal Lesdiguières de remplacer le favori dans cette dignité importante, quand un traité de paix suspendit les horreurs de la guerre civile.
La maison d’Autriche et celle des Bourbons semblèrent réciproquement abjurer leur haine. Louis XIII épousa Anne, fille de Philippe III, roi d’Espagne ; Richelieu, recommandé spécialement par la reine-mère, devenu tout puissant, oubliant toute reconnoissance envers sa bienfaictrice, parvint à affaiblir ces liens de la nature ; et la force de son génie supérieur donna une nouvelle direction à la politique du gouvernement qui, jusqu’alors, avoit protégé, en Allemagne, la maison d’Autriche.
Nommé premier ministre, Richelieu suivit le plan tracé par Henri IV, suscita, de toutes parts, des ennemis à l’empereur, et fit enlever la Valteline aux Espagnols. Ne pouvant plus souffrir de voir, pour ainsi dire, deux peuples et deux gouvernemens en France, le cardinal après avoir conclu une paix honorable avec l’Espagne, tourna ses efforts contre les calvinistes les attaqua, et les battit sur tous les points, en même temps qu’il contenoit les grands seigneurs du royaume, jaloux de son élévation et de son pouvoir despotique. Le ministre alla lui-même en 1627 mettre le siège devant la Rochelle, espèce de république qui étoit la principale place d’armes des religionnaires, et, malgré les flottes de l’Angleterre, malgré la bravoure et le désespoir des habitans, il vint à bout de s’emparer de cette ville, et ruina entièrement, par cette conquête, le parti des calvinistes qui opposèrent en vain en Languedoc quelque résistance. Il fallut enfin subir la loi, et redevenir des sujets soumis mais ils conservèrent tous les privilèges de l’édit de Nantes qui ne blessoient point la majesté royale, non plus que la tranquillité publique. Louis XIII lui-même, durant cette guerre civile, se montra avec toute la valeur de Henri IV, et lorsque la guerre civile n’étoit point encore terminée, ce roi vola en Italie au secours du duc de Mantoue, et se signala par de nombreux exploits contre les Espagnols.
Richelieu devoit une partie de son caractère, de son génie même, au fameux père capucin Joseph ; c’étoit l’ame du cardinal, celui qui soutenoit, qui affermissoit son courage dans les dangers. Plus d’une fois le ministre se crut sur le point de succomber : la reine-mère et les grands ne pouvoient supporter son despotisme ; toujours il se releva au moment qu’on le croyoit perdu ; mais il se vengea de ses ennemis avec une rigueur aussi injuste que barbare. Le maréchal de Marillac, décapité, Marie de Médicis, obligée de quitter le royaume, Gaston, frère du roi, également obligé de fuir, telles furent les principales victimes sacrifiées au ressentiment du ministre auquel il ne manquoit que le titre de roi pour l’être effectivement. Un cardinal se montrant, au dehors, le plus ferme appui des protestans qu’il venoit d’écraser dans l’intérieur de la France, soulevoit tout le nord de l’Europe luthérienne contre l’empereur Ferdinand II, augmentoit la rapidité d’un torrent qu’il auroit eu bien de la peine à arrêter, et qui l’eût peut-être entraîné lui-même, ainsi que la France, sans d’autres événemens qui survinrent.
Richelieu ne jouissoit pas tranquillement de son pouvoir ; sans cesse en butte à la haine des grands, il avoit sans cesse des précautions à prendre pour déconcerter leurs projets. Gaston, frère du roi, excitoit, du fond de la Lorraine, les seigneurs contre un rival odieux : c’était un ennemi foible, pusillanime, et dont l’amitié devint fatale à ceux qui embrassèrent le parti de ce prince. Le duc de Montmorency, gouverneur du Languedoc, commit, par générosité, l’imprudence de se déclarer pour Monsieur. Une seule bataille, celle de Caslelnaudari, fit échouer les projets de Gaston, et perdit le brave Montmorency qui, prisonnier de l’armée royale, périt dans Toulouse, sur un échafaud ; supplice aussi déshonorant pour le roi qui servoit aveuglément toutes les passions de son ministre, que pour le ministre lui-même dont le cœur étoit fermé à toute pitié. On peut dire que Louis XIII, surnommé le Juste, parla dans cette circonstance, comme auroit pu le faire Néron : les courtisans en larmes, demandoient la grâce du criminel : Allez lui dire, leur répondit Louis, que toute la grâce que je puis lui faire, c’est que le bourreau ne le touchera point, qu’il ne lui mettra point la corde sur les épaules, et qu’il ne fera que lui couper le cou.
Toutes les têtes se courboient devant l’impitoyable Richelieu ; il usa, il est vrai, de son autorité, pour la gloire de la monarchie : la France paroissoit le centre de la politique de l’Europe, et le génie de ce ministre donnoit le branle à toutes les grandes révolutions qui frappoient, dans ses fondemens, la puissance de la maison d’Autriche. Le plus dangereux des adversaires du cardinal, Gaston, avoit reparu à la cour, et ne causoit plus d’inquiétude : alors Richelieu fit marcher une armée dans les Pays-Bas, sous le commandement du cardinal de la Valette, fils du fameux duc d’Épernon. Les Espagnols, dans cette campagne et dans la suivante, ne démentant point leur première valeur, repoussèrent le prince de Condé de la Franche-Comté, rendirent inutiles les efforts des Français, et même pénétrèrent dans l’intérieur du royaume.
Cette invasion augmenta le danger de la position de Richelieu, et réveilla la haine mal assoupie de Gaston qui, pouvant se défaire du cardinal, n’osa exécuter le dessein qu’il en avoit formé. Les Impériaux s’avancèrent dans la Bourgogne ; la ville de Saint-Jean-de-Lône devint l’écueil de leurs conquêtes, et le duc de Weimar ainsi que le cardinal de la Valette les chassèrent du territoire fiançais : d’un autre côté, les armées françaises recouvrèrent la supériorité sur les Espagnols. Délivré de toute crainte de la part des ennemis extérieurs, Richelieu se vit de nouveau exposé aux traits de l’envie : une de ses créatures mêmes, le père Caussin, Jésuite, faillit le supplanter, et le perdre dans l’esprit d’un monarque timide, irrésolu, et que le faste du ministre révoltoit en secret. Richelieu triompha encore dans cette occasion , et le père Caussin fut éloigné de la cour.
La guerre se continuoit avec chaleur sur les bords du Rhin : la victoire couronna le duc de Weimar à la journée de Rheinfel où quatre généraux allemands, entre autres, Jean-de-Wert, tombèrent au pouvoir des Français ; mais du côté de l’Espagne, la France n’obtint pas les mêmes succès : la levée du siège de Fontarabie par le prince de Condé, troubla la joie que faisoit naître les exploits de nos armées en Allemagne. La prise d’Arras et le soulèvement de la Catalogne firent bientôt oublier ce revers.
La France étoit plus redoutée au dehors pour sa politique, qu’heureuse au dedans pour la sagesse de son administration ; les finances se trouvaient dans une espèce de délabrement ; le clergé perdit tout le mérite d’une bonne action, en contribuant de mauvaise grâce aux besoins de l’État. Les Français murmuroient contre le luxe de la cour, et même la Normandie se révolta, mouvement qui fut bientôt apaisé. Le jeune comte de Soissons, les ducs de Bouillon et de Guise, nouveaux adversaires du cardinal, levèrent contre lui une armée qui battit celle du roi à la Marfée ; mais le comte de Soissons trouva la mort dans les bras de la victoire. Un favori de Louis XIII, Cinq-Mars, ne craignit point de tramer la perte de Richelieu son bienfaicteur, devenu plus puissant que jamais. En 1642, ce conspirateur et ses complices portèrent dans Lyon leur tête sur un échafaud ; exécution terrible qui acheva de décourager l’ambition, et d’affermir l’autorité du ministre lequel ne jouit pas longtemps de son triomphe. Cette même année mourut Richelieu, après s’être servi d’un bras de fer pour terrasser les grands, en même temps que pour relever l’autorité royale ; et laissant la réputation d’un homme plus politique que religieux, qui n’eut jamais d’entrailles pour ses ennemis, d’un génie vaste qui, dans tous les siècles, dans toutes les contrées, eût opéré de grands changemens dans l’État.
En 1643 l’indolent Louis XIII suivit de près le cardinal au tombeau : sa mère, Marie de Médicis, l’y précéda de quelques mois, et mourut de misère dans la ville de Cologne.
M.E. Jondot. Tableau historique des nations. 1808
8 11 1627
Les troupes françaises anéantissent les Anglaises sur l’île de Ré : ils compteront plus de 3 000 morts dans leurs rangs.
1627
La puissante compagnie hollandaise des Indes occidentales, encore toute jeune – elle a été fondée en 1621 – souhaite se faire une place au soleil brésilien : ils y envoient 56 vaisseaux armés de 1 150 canons, transportant 3 500 soldats, qui attaquent et enlèvent Olinda, capitale du Pernambouc : ils veulent y produire sucre, tabac, bétail et bien entendu convertir les indiens au calvinisme. Mais les dirigeants de la compagnie firent quelques erreurs : croire qu’ils pouvaient se passer de Nassau et de sa force militaire et penser que les froides célébrations calvinistes pourraient enlever l’adhésion de catholiques déjà très adonnées à la musique, à la danse, à la fête. Les 2 batailles perdues de Guarapares en 1648 et 1649 contre les Portugais sonnèrent l’heure de la retraite. Le Brésil hollandais disparut définitivement avec la capitulation de Recife en 1654.
10 8 1628
Lancement du Vasa, navire de guerre de prestige, géant des mers, construit par le Hollandais Henrik Hybertsson sur ordre de Gustave II Adolphe de Suède ; longueur à la flottaison : 47.5 m., la coque : 61 m., hors-tout : 69 m. 52 m. de la quille au grand mât. Tonnage 1 210 tonnes. 3 mâts, 10 voiles : 1 275 m² au total. 48 canons de 24 livres, 8 de 3 livres, 2 de 1 livre et 6 obusiers, le tout pesant à peu près 80 tonnes. Sitôt hissé les voiles et trouvé un bon petit vent, il se couche et coule : il n’aura pas fait un mille. Les sabords des canons de la batterie basse étaient ouverts, permettant à l’eau de s’engouffrer dès la première gite. On récupérera ses canons, puis on l’oubliera jusque dans les années 1950. Renfloué le 24 avril 1961, il deviendra la première attraction du musée Vasa de Stockholm. Mal conçu, avec un centre de gravité beaucoup trop haut, dû en partie à la présence de trop nombreux canons en hauteur, l’architecte avait émis des objections aux canons en surnombre, mais le souverain avait fait la sourde oreille et il était mort avant l’achèvement. Grèves et contre-ordres avaient compliqué la construction. Il n’y aura pas de sanctions. Incompétence et autorité royale pesèrent lourd dans l’affaire. Des architectes contemporains disent qu’avec 50 cm de plus en largeur, le bateau aurait été stable…

le peintre, inconnu, a dû faire vite pour immortaliser l’image, car le temps lui fut compté …

Il était un trop grand navire
Il était un trop grand navire
Qui n’aura ja, ja, jamais navigué
Qui n’aura ja, ja jamais navigué
8 09 1628
Au large de Matanzas, près de la Havane, Piet Heyn, flibustier de son état, et hollandais de naissance, à la tête d’une véritable flotte de guerre de vingt navires, parvient à se rendre maître de l’armada y flotta – la flotte des galions espagnols – transportant 80 tonnes d’argent de Potosi : mais c’est la seule fois où cela arriva, dans toute l’histoire de la flibuste, qui, en temps ordinaire devait se contenter de proies beaucoup plus modestes et moins bien défendues. C’est à peu près l’époque où, en matière de navire de guerre, les avantages de la galère – évidents contre un voilier… quand il n’y a pas de vent – le cédèrent aux inconvénients : investissement humain trop lourd, encombrement du bateau l’empêchant de s’armer en canons suffisamment nombreux. Les navires de guerre seront des navires à voile jusqu’à l’invention de la vapeur.
La puissance maritime de l’Espagne n’a pas résisté aux déboires de la fin du XVI° siècle. Elle a, écrit Braudel, triomphé là où gagner était secondaire – à Lépante en 1571 – et perdu, ou commencé à perdre, là où se jouait la partie essentielle, dans l’Atlantique. Harcelée par la flotte anglaise, puis disloquée par la tempête, l’Invincible Armada a échoué en 1588 dans sa tentative d’invasion des îles Britanniques. En 1628, c’est une autre armada du Roi Catholique, celle de la Carrera de Indias, qui sera surprise et capturée au large de La Havane par l’amiral hollandais Piet Heyn. Plus rien ne peut désormais freiner la conquête du bassin méditerranéen par les navires nordiques. Après une première percée, aux environs de 1500, suivie d’un reflux consécutif aux deux dépressions de 1529-1539 et 1560-1575, ils sont de retour et cette fois en position d’imposer durablement leur prééminence sur les flottes italiennes, principalement sur celle de Venise.
À quoi tient leur supériorité sur les navires de la Sérénissime ? Pas encore au fait qu’ils seraient épaulés par des économies dominatrices. Ni les Provinces-Unies ni l’Angleterre ne peuvent encore se prévaloir de ce titre. Mais à des atouts qui furent pendant longtemps ceux des cités maritimes de la Péninsule : des navires moins coûteux, mieux construits, plus résistants, plus rapides, des équipages à la fois plus performants, plus aventureux, moins exigeants que ceux de la République de Saint-Marc. Confrontée à cette concurrence, l’Italie ne peut que perdre une partie des bénéfices du fret au profit des armateurs et des marins étrangers. Ce sont ces derniers qui non seulement effectuent désormais la quasi-totalité des livraisons de produits nordiques (laine anglaise, harengs salés, plomb, étain, cuivre, etc.), mais qui, après les avoir écoulés à Gênes, Livourne ou Naples, se chargent de transporter en Syrie ou en Égypte des marchandises jusqu’alors exportées par les navires italiens. En échange de quoi ils reviennent les cales chargées de soie, tissus précieux, épices, parfums, etc. Le relais est pris, et il l’est pour longtemps.
La crise italienne doit donc être examinée dans une perspective comparative. L’Italie ne décline que parce que ses principales concurrentes progressent à un rythme plus rapide que le sien. Comparée à ce qu’elle était aux environs de 1350, son économie n’est pas tombée, trois siècles plus tard, à un niveau inférieur. Ce qui a fait la grandeur de l’Italie du Trecenlo, c’est à bien des égards l’effacement de Byzance et le recul de l’Islam en Méditerranée. Ce qui fait qu’on peut parler de déclin au XVII° siècle, c’est qu’elle monte moins vite que la Hollande et l’Angleterre. C’est autrui, écrit encore Braudel, qui supporte, accepte ou brise notre grandeur.
Pierre Milza. Histoire de l’Italie. Arthème Fayard. 2005
1628
Le poète, qui a été soldat sous les ordres de Maurice de Nassau, sait de quoi il parle :
Enfin, je suis honteux de mon piteux état :
C’est un méchant métier d’être pauvre soldat.
Le service est pour nous ; Messieurs les capitaines
En ont la récompense aux dépens de nos peines,
Et pour paraître en mine, ils nous rendent tous gueux.
[…] De fatigues sans fin nous portons le fardeau,
À peine ayant le saoul de mauvais pain et d’eau.
Cependant ces messieurs veulent que, pour leur plaire,
Nous ayons l’œil gaillard, l’armure toujours claire,
Dérouillant notre fer et dehors et dedans,
Cependant que le jeûne enrouille toutes nos dents
Jean de Schélandre. Tyr et Sidon, 1628
Les portugais de Malacca repoussent non sans peine une attaque du sultan d’Aceh – le Banda Aceh qui sera le plus proche de l’épicentre du tsunami de 2004 -.
Dans son livre Exercitatio anatomica de modu cordis et sanguinis in animalibus, William Harvey, médecin anglais, est le premier à décrire la circulation sanguine, mettant en valeur le rôle primordial du cœur ; il devient ainsi l’un des fondateurs de la médecine moderne. Louis XIV ne s’y trompera pas, qui imposera l’enseignement de ses thèses.
La découverte de la circulation par Harvey fut l’aboutissement d’une longue série d’observations. En premier lieu, Harvey remarqua que le cœur durcissait lorsqu’il se contractait, ce qui le conduisit à le considérer comme un muscle. Ensuite, il établit que la dilatation des artères, lorsque le cœur se contracte, était due au fait que le cœur y poussait le sang (antérieurement, le phénomène était attribué à une action autonome des artères), et ses observations des battements de cœur plus lents des animaux l’aidèrent à réaliser que le cœur ne bat pas d’un seul tenant. Il observa l’action des valvules entre les cavités supérieures et inférieures du cœur, et prit alors conscience que le flux du sang se produit de façon continue dans une seule direction. Il s’attaqua ensuite à l’aspect quantitatif du problème et nota que, bien que le cœur ne contienne que 60 grammes de sang, étant donné qu’il bat en moyenne 72 fois par minute, le ventricule gauche devrait refouler 60 x 72 x 60 grammes de sang par heure dans l’artère principale, ou aorte. Le total s’élevait à 250 kg par heure, soit trois fois le poids d’un homme de taille moyenne. Pour Harvey, il était évident que les veines ne pouvaient fournir cette quantité de sang en une heure. C’est alors qu’il se demanda si, peut-être, le sang n’accomplissait pas un mouvement circulaire et, pour finir, il recommença une expérience de son vieux maître Fabricius, qui démontrait que les valvules des veines ne laissaient le sang circuler que dans un sens. C’était là, il le sentit, le point décisif qui bouclait sa théorie. La découverte de Harvey était le fruit d’un raisonnement brillant, fondé sur l’observation, mais, à l’époque où il publia ses résultats, Harvey ne savait toujours pas comment les extrémités des artères étaient reliées à celles des veines ; ce fut Malpighi qui, à l’aide de son microscope, découvrit le chainon important.
Colin Ronan. Histoire mondiale des sciences. Seuil. 1988
10 03 1629
Charles I°, roi d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande, s’oppose au Parlement quant à la levée d’impôts pour financer des guerres que le Parlement juge inutiles. Il a déjà mis en place des levées d’impôts indirects hors contrôle du Parlement. C’est une véritable lutte de pouvoir, centrée sur le cœur de la politique, l’argent, nerf de la guerre. En toile de fond, des tensions très grandes entre puritains presbytériens et anglicans, les premiers reprochant leur catholicisme aux seconds. [Charles I° avait épousé Henriette Marie de France, catholique, fille d’Henri IV]. Des députés se sont saisis du président de la Chambre des Communes pour qu’il retarde la dissolution demandée par le roi, le temps de faire voter des textes contre le catholicisme et les taxes douanières. C’en est trop : Charles I° dissout le Parlement, avec effet immédiat. Onze années de tyrannie – pouvoir personnel – vont s’ensuivre. Les nouvelles taxes et la question des libertés religieuses vont entraîner de nombreuses révoltes qui contraindront le roi à rétablir le parlement dans ses droits à partir de 1640.
27 05 1629
Louis XIII ordonne que Privas, ville protestante en révolte soit rasée, sa population et sa garnison massacrées.
4 06 1629
Naufrage du Batavia, – ou Jakarta – à à peu près 80 km à l’ouest de la côte ouest de l’Australie, sur l’archipel des Houtman Abrolhos.
Xavier Dorison les nomme Les naufragés du Jakarta, 2022, Simon Leys Les naufragés du Batavia 2003 … qu’importe, il s’agit bien du même navire et du même drame, même si les lectures sont relativement différentes, celle de Xavier Dorison, très marxiste, voulant en faire une histoire de dominants/dominés, avec une inversion des rôles après le naufrage quand Simon Leys ne s’exprime aucunement en ces termes, ne dit rien de la séparation des passagers en deux parties opposées en tout – les droits communs et autres crapules sinistres et les libres, appartenant à une classe sociale aisée – et préfère s’en tenir à une domination temporaire d’un psychopathe manipulateur sur une communauté au sein de laquelle on ne retrouvait que les classes sociales habituelles dans l’Europe occidentale terrienne, avec ses conflits, ses aigreurs et ses coups fourrés.
Présentons un peu les acteurs, dont le principal est ce Batavia lui-même : navire de la VOC – Vereenigde Oostindische Compagnie, la plus grande multinationale commerciale de l’époque – il est un des plus grands navires du monde. Double coque de chêne. 1 300 tonnes de déplacement. Passagers et équipage avoisinaient les 341 personnes, dont 38 passagers, des femmes et des enfants. Il emportait également 600 tonnes de cargaison, dont douze coffres de pièces d’argent et des bijoux et cadeaux pour le nabab de l’Inde.
La traversée de 15 000 milles marins jusqu’à Java, plus des 2/3 de la circonférence du globe, durait environ huit mois, dans les meilleures conditions. La vitesse moyenne était de 2.5 nœuds – 4.5 km/h -. Mais comme, sur les marchés occidentaux des épices , le temps était de l’argent, la VOC imposait à tous ses capitaines un itinéraire qu’avait perfectionné l’expérience, et qui comptait certains détours – car, à la voile, la route la plus rapide coïncide rarement avec le chemin le plus court : il s’agit avant tout d’éviter les zones de calme et de chercher les régions où l’on peut compter sur des vents constants et favorables. Ainsi, après le cap de Bonne espérance (la seule escale prévue, pour renouveler les provisions d’eau et embarquer des vivres frais), au lieu de se diriger directement vers Java en passant au nord de Madagascar, les navires descendaient d’abord vers le sud, presque jusqu’à la limite de l’océan Austral, pour profiter des puissants vents d’ouest, qui tournent tout autour du globe à partir du quarantième parallèle – les quarantièmes rugissants. Poussé rapidement par le vent et le courant, ils faisaient route à l’est, jusqu’à ce qu’il eussent estimé avoir à peu près atteint le longitude du détroit de la Sonde ; arrivés à ce point hypothétique que rien, au milieu d’un océan vide, ne leur permettait de reconnaître avec certitude ils changeaient de direction et, bénéficiaient alors des alizés du sud-est, naviguaient au grand largue, cap au nord, pour rallier Java, encore distant de quelque 2 000 milles. Toute fois, si ce changement de cap survenait trop tard, et les erreurs d’estimation étaient fréquentes, car la force du vent et des courants amenaient des navires à couvrir un distance très souvent supérieure à celle que leur médiocre vitesse apparente aurait pu faire supposer – les conséquences étaient parfois fatales, car ils se retrouvaient alors confrontés à l’une des côtes les plus inhospitalières qui soit, celle de l’Australie occidentale, qui oppose sur les centaines de milles, sans interruption ni abri naturel, ses murailles abruptes à la violence de l’océan indien Tout bateau qui approche de cette terre dans la nuit, ou qui s’y trouve poussé par une fraiche brise de mer, risque de ne pouvoir s’en dégager à temps ; à plus forte raison, ces pesants voiliers à grément carré, incapables de virer rapidement, se voyaient alors implacablement drossés contre les falaises. Aussi la consigne de sécurité que la VOC donnait à tous ses capitaines était d’éviter absolument les abords de cette Terra Australis incognita aux contours encore incertains.
[…] Mais, malgré les instructions qu’ils avaient reçues, tant que les navigateurs demeurèrent incapables de calculer leur longitude, ils continuèrent à ête exposés au danger d’une rencontre involontaire avec le continent australien. En deux cents ans, de tous les navires partis pour l’Insulinde, 2 % n’arrivèrent jamais à destination (et, au retour, 5 % ne regagnèrent jamais la Hollande). La plupart de ces disparus ne laissèrent aucune trace ; on devine seulement que beaucoup se perdirent sur la côte australienne, mais il est impossible d’en déterminer le nombre exact, car seuls quelques uns de ces naufrages ont pu être précisément localisés et identifiés, parfois avec des siècles de retard.
[…] Suivant l’usage général de la Compagnie, l’autorité suprême était détenue à bord non pas par un marin, mais par un terrien, un haut fonctionnaire dont l’expérience et les compétences étaient d’ordre purement administratif, politique et commercial, et qui portait le titre de subrécargue (opperkoopman) [1]. Toutes les responsabilités proprement nautiques – navigation, manœuvre, relations avec l’équipage – incombaient à un subordonné, le patron (schipper) secondé lui-même par un premier timonier (opperstuurman) et les deux assistants de celui-ci. Le patron n’était donc pas un capitaine au sens moderne du mot ; il était certes un marin expérimenté (la VOC n’aurait jamais confié ses précieux navires à des novices !) mais pour le reste, il n’avait en général reçu qu’une éducation rudimentaire, sinon nulle – le caractère encore très primitif de la navigation de la navigation astronomique ne requérait d’ailleurs guère de connaissances théoriques. Surtout, il n’était pas seul maître à bord après Dieu : il était seulement maître après le subrécargue.
Les principaux personnages :
| Subrécargue | Francisco Pelsaert, 33 ans, mais atteint d’une fièvre récurrente et cependant grand coureur de jupons. |
| Patron | Ariaen Jacobsz, = de 40 ans, marin endurant et habile mais médiocre navigateur. N’aime pas du tout Pelsaert. Faute de pouvoir séduire Lucretia, il prend la bonne, Zwaantie Hentrix, du genre facile, voire très facile. |
| Subrécargue assistant | Jeronimus Cornelisz, environ 30 ans, apothicaire cultivé, âme noire de ce drame ; psychopathe meurtrier, doté d’un bagout ravageur. |
| Homme d’Église | Gijsbert Bastaensz, qui espère trouver en Australie une paroisse à même de nourrir sa nombreuse famille. |
| La bourgeoise | Lucretia Van der Mijlen veut rejoindre son mari, employé de la VOC dans ses comptoirs asiatiques. |
| Sans grade | Wiebbe Hayes, obscur certes, mais intelligent. Il a pour lui une autorité naturelle, du jugement et du courage. |
Les conditions de vie à bord sont telles qu’elles inspireront ces mots à Samuel Johnson : Nul homme ne voudrait jamais se faire marin, à moins de n’être même pas capable de se faire jeter en prison. Car la vie à bord d’un navire est tout simplement celle d’une geôle où l’on serait de surcroit exposé à la noyade. Sur les navires qui faisaient la route de l’Insulinde, le scorbut emportait en moyenne de vingt à trente hommes par voyage.
Il n’est donc pas vraiment surprenant que le Batavia se soit empalé sur une arête de corail : la veille, il se croyait à 500 milles de la côte la plus proche, quand, en fait il n’en était qu’à 61 milles, au milieu de l’archipel des Abrolhos découvert accidentellement dix ans plus tôt par Houtman, un autre marin hollandais, 28° 30′ S, 113° 47′ E, aujourd’hui les récifs de Wallabi, un groupe d’îlots de corail situé à 61 milles à l’ouest de Geraldton, au large du continent australien. Les moyens de sauvetage étaient dérisoires par rapport au nombre de passagers : un grand canot gréé en sloop (un seul mât et un seul foc) et une petite yole ne pouvant embarquer au mieux qu’une cinquantaine de personnes.
Quand il devint évident que le Batavia était définitivement perdu, ce fut le chaos à bord : mercenaires et gabiers firent main basse sur les réserves d’alcool et de vin, et s’adonnèrent à une orgie sauvage. Tous les interdits furent balayés, des matelots ivres envahirent l’espace sacré du gaillard d’arrière, ils forcèrent l’accès de la grande cabine, enfoncèrent les coffres, s’emparèrent des chapeaux à plumes, des brocards et des chaines d’or de leurs chefs et se mirent à improviser avec frénésie une sorte de carnaval grotesque et désespéré.
[…] Le Batavia échoué se trouvait en bordure d’une vaste zone de hauts fonds qui, à marée basse, offraient de façon discontinue une sorte de passage à gué vers deux îlots, l’un minuscule, l’autre un peu plus grand, et l’on entrevoyait encore derrière eux, çà et là, les longues lignes blanches de la mer qui brisait contre d’autres terres basses. Pelsaert, le patron et les timoniers établirent leur centre d’opérations sur le petit îlot proche de l’épave et organisèrent un va-et-vient avec les deux embarcations pour transporter la plus grande parie des naufragés sur la seconde île, bientôt baptisée le Cimetière du Batavia (Batavia’s Kerkhof ; les cartographes l’appellent aujourd’hui Beacon Island, l’île de la Balise)
[…] C’est là qu’en cinq ou six voyages le canot et la yole débarquèrent plus de 180 personnes avec des vivres et une petite provision d’eau. 70 autres étaient restées sur le navire […] il s’agissait pour la plupart de soudards et de matelots qui ne voulaient pas dessaouler, mais il y avait aussi quelques individus que la peur de l’eau [dans la Hollande du XVII° siècle, à peine une personne sur sept savait nager] confinait dans la fausse sécurité de l’épave.
Simon Leys Les Naufragés du Batavia. Arlea 2003
Un seul espoir d’être secourus : gagner avec le canot et la yole le comptoir de la VOC à Java : 1 500 milles – 2 700 km -. Le canot, pas du tout conçu par cela, fut modifié par les charpentiers, principalement par un exhaussement des francs-bords, et quatre jours après le naufrage, en silence et dans le secret – cela n’aurait pu qu’être très mal perçu – , Pelsaert et Jacobsz embarquèrent 42 autres personnes, les meilleurs de l’équipage, Zwaantie, et un bébé à la mamelle… et vogue la galère. Colère et désespoir des naufragés restant à quai quand ils réalisèrent que les principaux responsables leur avaient fait faux bond. L’épave du Batavia résista neuf jours aux colères de l’océan, puis s’effondra brutalement, noyant cinquante hommes et c’est seulement une vingtaine, dont l’ancien apothicaire Cornelisz qui en réchappèrent et parvinrent à regagner l’île Beacon. La déshydratation avait déjà commencé à tuer plusieurs passagers. Cornelisz apparût dès lors comme le nouveau dépositaire de l’autorité légitime : ses premières initiatives parurent bien justifier la confiance que lui avaient témoigné ses compagnons; il réussit en effet à instaurer une discipline , il mobilisa les énergies, répartit les tâches, inventoria les ressources et en administra la distribution, rapporte Simon Leys.
Cornelisz avait déjà comploté avec Jacobsz pour engendrer une mutinerie, projet qui avait été tué dans l’œuf. Mais il avait gardé ce rêve dans un coin de sa tête et se mit à s’entourer d’inconditionnels grâce auxquels, le jour venu, il pourrait rester le chef, le projet étant de s’emparer du navire de la VOC qui viendrait les secourir si Pelsaert, Jacobsz réussissaient dans leur entreprise hasardeuse. Son gang grossit assez vite jusqu’à se trouver au nombre de vingt-quatre. Il estima alors que ce nombre représentait une trop petite proportion des naufragés et donc, il estima que c’est la nombre de naufragées qu’il fallait réduire. Diviser pour régner : il suffisait d’envoyer des naufragés sur d’autres îlots en leur promettant eau et nourriture régulièrement : un groupe fut envoyé sur l’île des Traitres (ainsi nommé car lieu d’embarquement de Pelsaert, Jacobsz et Cie sur le canot ) un autre groupe beaucoup plus important sur l’île des Phoques, en face du Cimetière, et enfin une vingtaine d’hommes menés par Wiebbe Hayes, sans grade obscur mais intelligent, (ce qui arrive beaucoup plus souvent qu’on ne croie) sur une l’île Haute, inexplorée jusqu’alors, à 6 milles au nord-ouest. Vingt jours après l’installation de ce dernier groupe, celui-ci envoya des signaux de fumée indiquant qu’ils avaient trouvé de l’eau, (en fait c’est sur une petite île voisine, joignable en tous temps à pied que se trouvait de l’eau en abondance, des tammars wallabies – kangourous nains, délicieux – beaucoup d’oiseaux et leurs œufs) : pour Cornelisz, c’était une mauvaise nouvelle, et ce d’autant que c’était la seule île occupée par des naufragés qui échappait à son contrôle. Ce que voyant, les naufragés des autres îles, et plus particulièrement ceux de l’île des Traîtres, tenteront de bricoler des radeaux avec les bois épars du Batavia pour rejoindre sur l’île Haute : découvrant cela, Cornelisz envoya ses nervis massacrer ces gens, hommes, femmes et enfants. En même temps, cette dispersion des naufragés sur les autres îles s’accompagnait d’assassinats déguisés parfois en condamnations à mort pour des fautes de trois fois rien, parfois en pseudo-missions pour renforcer les contingents des autres îles, parfois par le massacre des malades et des invalides, regroupés au même endroit : Cornelisz commençait son entreprise de réduction du nombre de naufragés par la plus radicale des solutions : le meurtre, et cela n’ira qu’en empirant. Les survivants devaient lui prêter serment d’allégeance. Si l’un des nervis se risquait à refuser d’exécuter un meurtre, c’est lui-même qui en devenait victime : on était bien au royaume du crime. Et portant, Cornelisz ne remplissait pas toutes les cases du parfait chef de gang : ne sachant pas nager, il avait failli se noyer lors du naufrage du Batavia, qu’il avait été un des derniers à quitter, il n’exécutait jamais lui-même les meurtres – 125 – qu’il ordonnait, il avait dû avoir recours à l’un de ses nervis pour persuader Lucrétia de partager sa couche en cessant de se refuser à lui. Donc, personnage complexe, du pain béni pour les psy de tout poil, qui se réclamait du peintre Torrentius comme maître à penser, qui n’était pas le diable, mais qui s’en approchait. Il avait été aussi très marqué par l’anabaptisme, religion dans laquelle il avait baigné toute son enfance, qui se complaisait à nier la faute originelle et à faire table rase de la science du bien et du mal. De la mi-juillet à fin août 1629, Cornelisz parvint à ramener les naufragés de l’île Beacon à 45 personnes. Début septembre aura lieu une bataille entre les troupes de Cornelisz – une vingtaine d’hommes – et celle de Hayes, – une cinquantaine d’hommes – à proximité de l’île Haute, qui mettra en valeur la première grosse erreur stratégique de Cornelisz : avoir très gravement sous-estimé la santé, la force et le nombre des hommes de Hayes ; il va devenir leur prisonnier.
Sur le canot, Pelsaert avait atteint Java le 7 juillet, – soit un mois de navigation – sans avoir à déplorer aucun décès… même le nouveau-né avait survécu ; il fait incarcérer aussitôt Ariaen Jacobsz, (ce qui était une belle bêtise, tant qu’on avait besoin d’un bon navigateur) – et repart sur la Sardam, un jacht de 20 hommes, rapide, mais qui, faute de repaires précis et en l’absence du grand marin qu’est Ariaen Jacobsz, se perd, à 50 milles au nord. Ces îles sont tellement basses qu’il faut s’en approcher très près pour les voir. On se gardera d’accuser la VOC de s’être ainsi empressé à envoyer un navire avant tout pour récupérer les douze coffres de pièces d’argent et des bijoux et cadeaux initialement destinés au nabab de l’Inde, plutôt que pour sauver les naufragés. Pour finir, le Sardam arrive le 17 septembre en vue de l’île de Hayes, tout occupé à combattre de mutins de Cornelisz : apercevant le navire, celui-ci fait un grand feu pour le guider, et c’est la fin pour les 38 mutins qui se retrouvent prisonniers sur le Sardam. Leur procès sera tardif, la bagout de Cornelisz parvenant à troubler le ministère public. Les exécutions eurent lieu sur l’île des Phoques dont le sol se prêtait mieux à l’érection d’une potence mais, sans fosse possible, la pendaison par strangulation était plus lente qu’avec une fosse. Le 2 octobre, on commença pas couper les mains de Cornelisz, avant de le pendre : il mourut très probablement d’hémorragie plutôt que de strangulation. Il avait fait assassiner 125 personnes. La dernière exécution aura lieu à Jakarta le 1° février 1630. Le 15 novembre 1629, le Sardam quitta les Abrolhos, emmenant 70 survivants dont 16 criminels, aux fers, abandonnant deux d’entre eux sur une plage déserte. Celui qui s’en sortit au mieux fut Wiebbe Hayes, avec une belle promotion et augmentation de salaire. La belle Lucretia, après avoir subi toutes ces avanies, se découvrit veuve en arrivant à Batavia, mais elle se remaria et vécut encore longtemps, semble-t-il.
Je n’ai passé que quinze jours aux Abrolhos, mais il me semble que j’y serais volontiers resté six mois. N’empêche, sans Cornelisz, si les rescapés du Batavia, avaient su s’organiser et exploiter les ressources des deux grandes îles et du lagon, ils auraient pu jouir là d’une paix qui ressemble assez au bonheur. Bien qu’elle soient généralement arides et presque sans cesse balayées du vent, les îles jouissent d’un climat très doux. Si les grains de pluie sont fréquents en hiver, la brise est constamment tiède et le soleil ne tarde jamais à reparaître, et alors, comme le bleu du ciel rejoint le bleu de l’océan, l’archipel tout entier se trouve transfiguré : mangé de lumière, il semble se dissoudre dans l’immensité.
Simon Leys Les Naufragés du Batavia. Arlea 2003

The replica of the Batavia on the Markermeer during a filmshoot. Photo credit: authorities/Wikimedia

50 mètres de long.

An image from the 1647 Dutch book Ongeluckige voyagie, van’t schip Batavia (« Unlucky voyage of the ship Batavia »)

2 : Beacon Island, lieu d’installation des naufragés, proche du site du naufrage.
Beacon Island, where the horrific events unfolded. Photo credit: Vunz/Wikimedia. A peu près 450 m x 250 m
27 06 1629
Paix de grâce d’Alais (aujourd’hui Alès) : les places de sûreté accordées jusqu’alors aux protestants sont supprimées : c’est la fin de leur puissance militaire.
1629
L’engouement pour le tabac est tel que Richelieu le décrète privilège royal, en contrôle l’arrivée en provenance du Nouveau Monde et en taxe lourdement la vente. Cela provoque rapidement la mise en culture du tabac dans le sud-ouest, adopté par le peuple et les soldats. La bonne société continue de priser. Dans le même temps, par ordonnance, il met en garde les adeptes contre l’altération de la santé que provoque sa consommation. Le fait de taxer un produit dont on condamne par ailleurs l’usage n’est donc pas chose nouvelle.
Quand nous sommes remplis d’humeur mélancolique
La vapeur du tabac ravive nos esprits ;
Lors de nouvelle ardeur entièrement surpris
Nous vaincrions le dieu Mars en sa fureur bellique
Abraham Bosse. Fumeurs
Mais le tabac n’était pas la seule corde à son arc fiscal : Après l’avènement de Louis XIII, et surtout à partir de Richelieu, l’augmentation est brutale. L’impôt direct nominal, la taille, fait plus que tripler alors que les prix, jusqu’au milieu du siècle, n’augmentent que de 50 à 60 %. En 1580, le collecteur des impôts prélevait 6.2 % du revenu brut des terres, il en prélève 13 % en 1650. C’est une véritable révolution. Au XVI ° siècle, en effet, la taille, destinée au Trésor royal, était moins élevée que la dîme, impôt perçu pour l’entretien de l’Église. Au XVII° siècle, la taille devient plus lourde que la dîme.
Jean Delumeau. Une Histoire du monde aux temps modernes. Larousse 2005
Jacques Le Mercier commence la construction de l’Hôtel Richelieu, futur Palais Royal.
Ferdinand II, empereur du Saint Empire romain germanique et catholique farouche promulgue l’édit de Restitution, qui n’était rien d’autre qu’un retour à la situation près de soixante ans plus tôt : toutes les terres qui avaient été confisquées à l’Église depuis l’édit de Passau en 1552 devaient lui être restituées y compris plus d’une centaine de monastères et de fondations. Par ailleurs, seuls les protestants qui avaient adhéré à la Confession d’Augsbourg de 1530, pouvaient continuer à bénéficier de la liberté de culte. Toutes les autres obédiences devaient être considérées comme des sectes et leurs congrégations devaient être dissoutes. De quoi donner une ardeur nouvelle au camp protestant de la guerre de Trente ans, qui, au demeurant, n’était pas en reste en matière d’excès : le pape ? un jumeau bâtard de l’Antéchrist oriental, Mahomet.

Paysans allemands jetant des chausse-trappes lors d’une attaque de la cavalerie suédoise, en 1634 à Schönau im Schwarzwald, au sud-ouest de l’Allemagne. Par Joseph Zimmermann. Cette fresque a été repeinte en 1771 pour représenter les troupes françaises. Zieglhar via Wikimedia Commons
28 01 1630
Le jeune – 27 ans – Mazarin, émissaire pontifical, rencontre Richelieu à Lyon ; ce dernier manifeste son intérêt pour ce brillant italien : ils se parlent 2 heures durant. Dès lors Mazarin se donne à Richelieu per genio. Il ne renoncera jamais à son choix, quoi qu’il pût lui en coûter… et il lui en coûtera… Mais le coût n’était pas financier, car en la matière, l’élève dépassera le maître, qui jugeait normal que les ministres veillent sur leur fortune en même temps que sur celle de l’État. On ne faisait alors pas la distinction entre servir et se servir. Elle viendra probablement à la Révolution : Talleyrand, à cheval sur les deux mondes, savait de quoi il parlait quand il demandait que les députés soient rémunérés : Si vous ne payez pas les députés, ils vous coûteront bien plus cher.
11 11 1630
Marie de Médicis a réalisé que le chef de ses partisans, le cardinal de Richelieu a pris tant d’importance que c’est son propre rôle qui va disparaître. À tort, elle l’estime grillé auprès de son fils. Elle exige du roi une explication au cours de laquelle elle somme son fils de choisir entre sa mère et le premier de ses ministres : Louis XIII n’est plus homme à s’en laisser ainsi conter et règle l’affaire par un désormais fameux : Nous sommes plus obligés à notre État qu’à notre mère. La journée des dupes se traduira par son exil : Belgique, Hollande chez sa fille, reine d’Espagne, Angleterre, Allemagne pour finir, à Cologne où elle mourra en 1642.
1630
Richelieu ne supporte pas que son hôte, le chancelier Pierre Séguier se cure les dents à table avec un couteau et donne l’ordre que les couteaux de table soient désormais à bouts arrondis. Débuts de la guitare.
Des catholiques fondent la colonie du Maryland, mais ils vont être rapidement supplantés par les protestants. La tolérance prônée par ces derniers ne s’exerçait guère qu’en interne : le refus d’un appareil d’Église important, la place privilégiée accordée au lien direct avec Dieu avaient vite provoqué la multiplication des obédiences, qui entretenaient inévitablement des rapports de rivalité, chacune cherchant à supplanter l’autre.
20 05 1631
Tilly, général wallon au service du Saint Empire, vainqueur de la bataille de la Montagne Blanche, ne peut retenir ses troupes mal payées, mal nourries aux portes de Magdebourg, ville luthérienne de près de 40 000 habitants, en Saxe : prise, pillée, elle est réduite en cendres par un incendie : le lendemain, elle ne comptera plus que 20 000 habitants.

Par Daniel Manasser, graveur strasbourgeois. 1632. Dans le médaillon en haut à gauche, le général Tilly.
30 05 1631
Théophraste Renaudot obtient le privilège de faire imprimer et vendre, par qui et où bon leur semblera, les nouvelles et récits de tout ce qui s’est passé et se passe tant dedans que dehors le royaume, avec un brevet qui lui donnait le droit d’imprimer et de diffuser son journal – La Gazette [2] – à perpétuité et exclusivement de tous les autres. C’est le premier journal : un peu de politique, de préférence étrangère – pour limiter le risque de déplaire – mais surtout des potins parisiens. Médecin natif de Loudun, ayant fait ses études à Montpellier, il était pays de Richelieu, ce qui peut assurer le succès d’une entreprise surtout si l’on y ajoute de l’obséquiosité à la pelle, célébrant ce merveilleux génie qui avait maintenu la paix, étendu nos limites, affermi notre État, restauré l’Église, honoré les armes, chéri les sciences, cultivé les rats et plus fait en un mot lui seul que tous ses devanciers ensemble.
Pensionné par le gouvernement, sa souplesse d’échine lui permettait d’être informé par les ministres qu’il disait seuls à savoir distinguer les choses qui doivent être tues de celles qu’il faut donner au public. Il percevait déjà les difficultés du métier, étant malaisé qu’entre 500 nouvelles écrites à la hâte, d’un climat à l’autre, il n’échappe quelqu’une à nos correspondants qui mérite d’être corrigée par son père le temps.[…] L’histoire est le récit des choses advenues. La Gazette dit seulement le bruit qui court. La première est tenue de dire toujours la vérité. La seconde fait assez si elle empêche de mentir. Il ne douta jamais que la presse était vouée à s’affirmer contre tous les rejets, toutes les critiques, toutes les censures, comme une marchandise dont le commerce ne s’est jamais pu défendre et qui tient cela de la nature des torrents qui se grossissent par la résistance. La III° République lui érigea deux statues, l’une à Paris, l’autre à Loudun que le gouvernement de Vichy fit déboulonner en décembre 1941 et août 1942, bel aveu de sa haine de la libre parole.
1631
Richelieu décide de faire de Brest la principale base de la Marine Royale et fonde une ville portant son nom, entre Chinon et Poitiers, à l’est de Loudun. Pour la première, cela se fera, pour la seconde, ce sera un échec, qui aurait bien besoin aujourd’hui d’un sérieux entretien. Une ville de plus donc, mais aussi une de moins : celle de Royan nid d’opposants, qu’il fait raser : maisons, remparts, jetées… tout.
Il avait confié la construction à Jacques Lemercier, architecte de la Sorbonne et du Palais Cardinal, aujourd’hui Palais Royal, d’un bourg clos de murailles et de fossés et de bâtir une halle, dans laquelle se tiendraient quatre foires annuelles et deux marchés par semaine.
La construction mobilisa plus de 2 000 ouvriers : rectangle de 700 m. sur 500 m., ceint de murs et de douves, elle est accessible par trois portes monumentales, une quatrième, factice, construite pour respecter la symétrie de l’ensemble. Deux places symétriques : la place Royale – actuelle place des Religieuses – et la place du Cardinal – actuelle place du Marché -, sur laquelle sont regroupés le presbytère, l’auditoire – actuellement la mairie -, la halle couverte et les commerces.
Afin d’en assurer le peuplement rapide, le cardinal exemptera la ville d’impôts. En contrepartie, les acquéreurs des parcelles constructibles cédées gratuitement s’engagent à y construire dans les deux ans un pavillon ou une maison selon les plans et devis déposés au greffe de la ville, tout en étant obligé de prendre pour entrepreneur l’un des deux choisis par le cardinal : MM. Thiriot ou Barbet. Un registre précis des transactions est tenu, ce qui permet aux historiens de connaître aujourd’hui la liste des propriétaires originels de la ville, des notables proches de Richelieu qui regrettent leur investissement à la mort du cardinal puisque leurs hôtels qui valaient initialement 10 000 livres ne se vendaient plus que 2 000 livres. À la mort du cardinal, la ville cessera de se développer, mais continuera d’avoir d’illustres visiteurs, tels Voltaire, Louis XIV, et La Fontaine qui persiflera :
Ce sont des bâtiments fort hauts ;
Leurs aspect vous plairait sans faute ;
Les dedans ont quelques défauts ;
Le plus grand, c’est qu’ils manquent d’hôtes.
Quant au XXI° siècle, il apparaît clairement que l’entretien général de la cité ne fait plus partie des priorités des collectivités locales pas plus que de l’État.
Seconde éruption du Vésuve.
Une douzaine de réductions guaranis établies dans le Guayra sont soumises aux razzias régulières des mamelus, ou bandeirantes ou encore Paulistes : des Portugais qui s’occupaient à approvisionner les marchés aux esclaves du Brésil. Ils parviendront à associer à leurs razzia les Indiens Tupis, tribu très voisine des Guaranis. Paulistes, parce qu’ils venaient de la ville de Saint Paul de Piratiningue – São Paulo – et plus précisément d’un collège crée en 1554 par les Pères Jésuites Emmanuel de Nobrega et José de Anquieta ! qui continuaient d’instruire, au temps des grandes razzias, pieusement et selon les règles les fils des nobles capitaines, chefs des expéditions esclavagistes contre les Guaranis chrétiens. Il va leur falloir tout abandonner, les troupeaux de bœufs comme les champs de coton.
Le Père Ruiz de Montoya organise alors la grande migration, qui, partie sur trois cents pirogues du Paranapané, gagneront le Paraná jusqu’à franchir par la terre les chutes, Grand Sault qui les mettront à l’abri des bandeirantes : 2 500 familles s’y trouvèrent réunies, qui durent franchir par voie de terre le dénivellé des chutes : cela dura huit jours. Les survivants, moins nombreux que les morts, se scinderont en deux colonnes, sous la direction des Pères Suarez et Contreras, se dirigeant vers les réductions de la Nativité et de Sainte-Marie Majeure sur l’Iguazu, affluent du Parana. D’autres restèrent pendant quatre mois au pied des chutes, affamés. Sous la pression permanente des Mamelus, une seconde migration sera effectuée en 1638. Un an plus tard le père Ruiz de Montoya obtiendra à Madrid l’autorisation d’armer les Guaranis. La même année, les Mamelus subirent une première défaite à Caazapaguazu. En mars 1641, alors qu’il y avait seulement 300 fusils pour armer les Guaranis et un seul canon, l’armée des Réductions vaincra les Mamelus à la bataille de Mbororé, sur l’Uruguay : 900 canots de mamelus et 6 000 Tupis contre 4 000 guaranis menés par le cacique Abiaru. Deux mille Tupis seront abattus, 90 canots coulés.
2 06 1632
En Ethiopie, les révoltés contre la religion romaine imposée en 1621 sont écrasés à Ouaïna-Dega (Wayna-Dega) par les troupes du négus Sousneyos. Quinze jours plus tard, il abdiquera en faveur de son fils Fazilidas. Les Jésuites seront chassés.
Quid de ces volte-face qui font si peu de cas de la vie humaine ?
Onze ans plus tôt, en 1621, Sousneyos s’était converti au catholicisme sous l’influence du Jésuite Paez et avait donc proclamé que, de ce fait, cette religion devenait celle du pays. Il y avait une sorte de contrat passé avec la papauté : je me rallie à toi si tu continues à me garantir la sécurité avec tes soldats – les 140 soldats des frères da Gama, débarqués en 1621 en Ethiopie -. Mais, l’année même de la mort du Père Paez – 1622 -, Sousneyos avait demandé au pape Grégoire XV de lui envoyer un patriarche pour remplacer l’Abouma, nommé par le patriarche de l’Église copte d’Égypte. Et Grégoire XV avait fait le choix funeste du rigide Afonso Mendes (1579-1656) comme patriarche catholique de l’Éthiopie, qui voulut abolir tous les usages orthodoxes jusque là en vigueur, avec, au cœur de l’affaire, la fin de la circoncision à laquelle était très attachés les orthodoxes et que bien sûr ne pratiquaient pas les Burtuka, descendants des soldats des frères de Gama. Mais autour de cette question, il y avait tous les changements que demandait Afonso Menes : une nouvelle ordination pour tout le clergé, une nouvelle consécration de toutes les églises, un nouveau baptême pour tous les chrétiens… on comprend la révolte de tous les chrétiens face à ce totalitarisme catholique initié par un crétin intégriste et obtu. Faziladas comprit vite la folie meurtrière de tout cela et expulsa les Jésuites : la méfiance vis-à-vis de toute influence culturelle venue de l’ouest pèsera lourd dans les orientations à venir du pays. Le père Luis Cardeira, qui s’était attardé dans le pays, y sera pendu en 1633.
1 08 1632
Les Jésuites, soucieux de se montrer réactifs et de ne pas monter dans un train en marche, – ils étaient aux premières loges pour savoir que Galilée allait être condamné – interdisent et condamnent la doctrine de l’atome. Et pour que cela entre bien dans le crâne des novices et profès de l’ordre, à l’Université de Pise, on leur fait dire tous les jours la prière : Rien ne provient des atomes / Tous les corps du monde resplendissent de la beauté de leurs formes. / Sans elles le globe ne serait qu’un immense chaos. / Au début, Dieu fit toutes les choses, pour que celles-ci engendrent quelque chose. / Considère comme rien ce dont rien ne peut venir. / Toi, ô Démocrite, tu ne formes rien de différent à partir des atomes. / Rien n’est produit par les atomes : donc les atomes ne sont rien.
1632
Nicolas Sanson a dessiné la carte géographique des postes et c’est Melchior Tavernier qui l’a gravée : on peut considérer qu’il s’agit de la première carte routière de France. Dès 1576, les messagers royaux ont été autorisés à acheminer aussi les correspondances privées.
22 06 1633
À la demande de l’Église pour qu’il écrive sur l’ensemble de la question relative aux deux conceptions de l’Univers – celle de Ptolémée-Aristote et celle de Copernic – autorisation assortie de la recommandation de ne pas présenter de conclusions catégoriques, Galilée avait publié en 1632 Dialogue sur les deux systèmes du Monde, salué dans toute l’Europe comme un chef d’œuvre scientifique et littéraire… dans toute l’Europe, sauf en Italie, où l’Église estima que le livre penchait beaucoup trop en faveur des thèses coperniciennes : Nous disons, jugeons et prononçons que toi, Galilée, par les éléments révélés par le procès et confessés par toi, tu t’es rendu pour ce Saint Office, très fortement suspect d’hérésie […] Tu as accordé soutien et créance à une doctrine fausse et contraire aux Écritures sacrées et divines, à savoir que le Soleil soit le centre pour la Terre, et qu’il ne se déplace pas d’est en ouest, et que ce soit la Terre qui se déplace et qu’elle ne soit pas le centre du monde.
Condamné par l’Église, avec l’indulgence due à ses 69 ans et au cardinal Bellarmin, il fut néanmoins contraint de se rétracter et assigné à résidence, affirmant à haute et intelligible voix : Oui, la Terre est fixe, au centre du monde, et en marmonnant : eppur, si muove ! – et pourtant, elle tourne ! -. Il avait aussi déjà tenu des propos qui en menèrent d’autres au bûcher : La Bible n’est pas le seul moyen de connaître et encore La Bible n’a rien à voir en matière scientifique. Il mourra en 1642 après neuf ans de résidence surveillée : cette année-là naissait Isaac Newton.
En fait, le calcul politique n’était pas étranger à l’affaire : face aux coups de boutoir du protestantisme, le pape Urbain VIII, – Maffeo Barberini – élu en 1623, érudit passionné d’arts, de lettres et de sciences et à ce titre ami de Galilée antérieurement à son élection, voulut montrer la détermination de l’Église à faire respecter les dogmes, sans en laisser le monopole aux protestants. Il avait aussi peut-être été quelque peu vexé de se reconnaître dans les traits de Simplicio, un simple qui défend le système de Ptolémée dans le livre de Galilée. Galilée sera réhabilité par Jean Paul II le 31 octobre 1992, mais beaucoup plus tôt, dès 1741, Benoît XIV autorisera la publication de ses œuvres et en 1757 les livres développant sa théorie seront retirés de l’index. En France, le gallicanisme permit de ne pas enregistrer le décret du Saint Office et, par le biais des franchises parlementaires, les ouvrages de Galilée purent être normalement diffusés.
Tout change, par l’arrêt du hardi Galilée,
La terre loin du centre est enfin exilée
Dans un brillant repos, le Soleil à son tour
Centre de l’Univers, Roi tranquille du jour,
Va voir tourner le Ciel et la Terre elle-même.
En vain l’inquisiteur croit entendre un blasphème :
Et six ans de prison forcent au repentir
D’un système effrayant l’infortuné martyr.
La terre, nuit et jour, à sa marche fidèle,
Emporte Galilée et son juge avec elle.
Louis Racine, [fils de Jean] La Religion, chant V, v.193-201, 1742
Je m’étais proposé de vous envoyer mon Monde pour ces étrennes, et il n’y a pas plus de quinze jours que j’étais encore tout résolu de vous en envoyer au moins une partie, si tout ne pouvait être transcrit en ce temps-là ; mais je vous dirais, que m’étant fait enquérir ces jours à Leyde et à Amsterdam, si le Système du Monde de Galilée n’y était point, à cause qu’il me semblait avoir appris qu’il avait été imprimé en Italie l’année passée, on m’a mandé qu’il est vrai qu’il avait été imprimé en Italie, mais que tous les exemplaires en avaient été brûlés à Rome au même temps, et lui condamné à quelques amende : ce qui m’a si fort étonné, que je me suis quasi résolu de brûler tous mes papiers, ou du moins de ne les laisser voir à personne. […] Car je ne me suis pu imaginer, que lui qui est italien, et même bien voulu du Pape ainsi que j’entends, ait pu être criminalisé pour autre chose, sinon qu’il aura sans doute voulu établir le mouvement de la Terre, lequel je sais bien avoir été autrefois censuré par quelques cardinaux, mais je pensais avoir ouïe dire, que depuis on ne laissait pas de l’enseigner publiquement, même dans Rome ; et je confesse que s’il est faux, tous les fondements de ma philosophie le sont aussi, car il se démontre par eux évidemment. […] Mais comme je ne voudrais pour rien du monde qu’il sortit de moi un discours, où il se trouva le moindre mot qui fût désapprouvé par l’Église, aussi aimé-je mieux le supprimer, que de le faire paraître estropié.
René Descartes, courrier à Monsieur l’abbé Mersenne
C’est le 22 juin 1633 que Galilée est contraint par l’Inquisition, à la demande expresse du pape Urbain VIII [1623-1644], de se présenter devant son tribunal.
Nous sommes au milieu de la révolution spirituelle qui s’amorce autour de Vincent de Paul. Les deux séries d’événements sont sans rapport apparent. Pourtant, l’une et l’autre traduisent la gêne de l’Église devant le monde qui surgit en dehors d’elle.
Pourquoi Rome s’engage-t-elle dans cette bataille qui, aujourd’hui, nous semble pitoyable et scandaleuse ? La question est importante. L’idée ordinaire, qu’il s’agit simplement d’une réaction de conservateurs obtus, est fausse. Même si elle est désormais bénie et acceptée par l’histoire polémique, la vérité est bien plus complexe.
Pour comprendre, il faut revenir en arrière. Rome n’a jamais été hostile aux savants. La plupart du temps, elle est demeurée indifférente. Mais depuis l’arrivée des jésuites le climat change. Grâce à deux jésuites importants, Robert Bellarmin, puis Claude Aquaviva, le centre de l’Église s’est doté d’une institution scientifique : le Collège romain. C’est, tout à la fois, une université, un centre de recherche et de débat, le cœur d’un réseau qui établit, pas à pas, des relations régulières avec les chercheurs répartis un peu partout en Europe. Le Collège romain est au centre d’une toile qui permet à Rome de suivre et de connaître l’évolution des principales sciences. C’est sans doute la première fois que l’Église, comme telle, s’intéresse aux travaux des savants. Il faut dire que cet intérêt est dans l’air du temps : Johannes Kepler, Tycho Brahé, Giordano Bruno, René Descartes, Biaise Pascal, Pierre Gassendi, sont les contemporains de Galilée.
Ce dernier fait partie des hommes que le Collège romain soutient publiquement. Il travaille. Ses multiples recherches ne débouchent pas sur des découvertes spectaculaires. En réalité, sa trouvaille principale est la cinématique. Il comprend que la force crée le mouvement. C’est l’histoire d’une bille lâchée d’une tour : sa vitesse s’accélère tout au long de sa chute. Mais comment mesurer cette accélération ? Galilée aura l’idée d’utiliser la mesure du temps ; ce qui ne va pas de soi, à l’époque. Il se servira d’un réservoir et d’un robinet qu’on ouvre au départ de la bille, et qu’on ferme lorsqu’elle touche terre ; sur le sol, s’il s’agit d’une chute perpendiculaire ; ou à l’extrémité d’un plan incliné, s’il s’agit d’une descente contrôlée. Au fond, ce qu’il invente (ou ce qu’il affirme), c’est l’une des règles fondamentales de la recherche scientifique : d’abord l’observation, puis l’expérience dont on tire la théorie. Et le cycle recommence à l’infini. Galilée ne philosophe pas, comme beaucoup de ses prédécesseurs ; il mesure, calcule et recommence ses expériences jusqu’au moment où il peut énoncer une loi. En somme, Galilée étend la méthode expérimentale, et se sert des mathématiques pour prouver des morceaux de vérités scientifiques.
Les jésuites du Collège romain apprécient cet esprit brillant. Le révérend père Clavius, l’une des autorités scientifiques de l’époque, le soutient sans hésitation. Or, Clavius est respecté : n’est-il pas l’un des hommes qui ont imaginé le système de mesure quantitative des phénomènes physiques ? Galilée lui semble être un de ses disciples.
Son autorité intellectuelle est parfaitement reconnue aux alentours de 1600. Pour les gens informés, il est clair qu’il partage l’opinion de Copernic (la Terre tourne sur elle-même, et autour du Soleil) ; mais il ne mentionne guère cette conviction. À cette époque, ce n’est pas son principal sujet d’étude. De plus, il souhaite demeurer prudent : sa réussite – il est professeur à Pise et à Padoue – suscite des jalousies. Mais on se garde de s’opposer à lui de front.
Ce n’est pas Galilée qui invente la lunette astronomique. Elle existait avant lui depuis près de vingt ans, tout particulièrement en Hollande. On vend d’ailleurs des lunettes très convenables à Paris, dès le début du siècle. Galilée apprend que les militaires s’intéressent à cet objet. Il estime qu’il est possible d’augmenter le grossissement de la visée ; il va y travailler, essentiellement pour gagner de l’argent. Les militaires sont de bons clients. En 1609, il réussit : sa lunette grossit sept fois. Grâce à elle, les marins pourront repérer les voiles ennemies avec plusieurs heures d’avance sur leurs adversaires.
Cette découverte passionne les Vénitiens ; ils demandent à Galilée s’il est possible de faire encore mieux. Il s’y emploie, et petit à petit réussit. Deux nuits de suite, il observe Jupiter, et découvre les quatre lunes qui brillent autour de cette grosse planète. Or, d’une nuit sur l’autre, les lunes changent de place : donc elles tournent autour de Jupiter.
Galilée est pris d’une frénésie d’observation. Il découvre d’abord que la surface de la Lune comprend des montagnes, des vallées, des déserts. Il veut tout voir : Vénus, puis Mars. En quelques années, ce chercheur qui n’est ni opticien ni astronome, obtient donc des résultats impressionnants. Il pourrait se borner à publier ses découvertes, mais cela ne lui suffit pas. Galilée est un provocateur, un homme qui veut être non seulement connu mais universellement respecté. Il souhaite que les gens de l’époque constatent, et admirent, ses découvertes. Il organise des soirées astronomiques. On s’y presse. À Bologne, à Florence, à Venise, au sommet du campanile de la basilique Saint-Marc, tout le petit monde universitaire se presse autour du maître. On ne sait trop s’il s’agit de cocktails mondains ou de réunions savantes. Les deux sans doute : l’ambiance est chaleureuse, personne ne songe à discuter les affirmations de Galilée. Le cardinal Bellarmin n’a-t-il pas participé lui-même à l’une de ces réunions ? Clavius n’a-t-il pas fait fabriquer une lunette copiée exactement sur celle de Galilée, pour l’usage du Collège romain ? Enfin, Kepler, qui, dans les premiers temps, avait écouté les sceptiques qui contestaient les précisions de la lunette, s’était publiquement rallié. Ces années-là, Galilée devient l’homme phare de l’Italie. Il est partout, il prend la parole lors de dîners organisés à son intention, il préside des conférences astronomiques. Faut-il préciser qu’il fait payer cher sa présence ? Il invente les comportements d’un universitaire de haut niveau américain. Il a besoin d’argent ; sa lunette est désormais en or massif.
Il ne lui reste qu’à conquérir Rome elle-même. Voilà Galilée devant les membres du Collège romain. Ceux-ci lui font un triomphe et lui décernent le titre de docteur honoris causa. S’il souhaite demeurer au sommet de la vague qui le porte, il lui faut se méfier de lui-même ; et aussi de ses ennemis, qui commencent à être nombreux.
Se méfier de lui-même, d’abord. Jusqu’à cette date, il s’est montré prudent. Il l’a d’ailleurs écrit à l’un de ses amis, quelques années auparavant. Mais le succès, semble-t-il, le grise. Lorsqu’on l’interroge publiquement sur les théories de Copernic, il n’hésite plus. Pour lui, Copernic a raison : les planètes tournent autour du Soleil, et la Terre en fait autant. En soi, ce n’est pas trop grave. Après tout, Copernic, en son temps, a expédié son ouvrage au pape, avec une dédicace élogieuse.
C’est une question de mesure. Or, pour beaucoup de cardinaux, Galilée en fait trop. Cette inquiétude n’est pas suffisante pour entraver son ascension intellectuelle. Mais, dans l’ombre, les dominicains s’en mêlent. On connaît les sentiments qu’ils portent aux jésuites : tout les oppose. Et surtout, la place que les uns et les autres occupent autour du Saint-Siège. D’un côté, le Collège romain, les écoles réparties dans toute l’Europe, et les missions du bout du monde ; de l’autre, une spiritualité ancienne, et l’Inquisition. Il faut que Galilée s’explique : pour les censeurs, ses propos sentent le soufre à cent pas.
Qu’importe : Galilée ne veut rien entendre. Il considère que Rome lui demeure favorable. D’ailleurs, le pape Paul V [1605-1621] ne lui accorde-t-il pas une audience pour le féliciter au nom de la chrétienté ? Et le grand-duc de Toscane ne vient-il pas de le nommer mathématicien à son service? Un poste convenablement rémunéré, et sans la moindre obligation.
C’est à peu près à ce moment que Galilée multiplie les maladresses et les petites bévues intellectuelles. C’est lui, crie-t-il sur les toits, qui a tout découvert. Délibérément, il ignore le nom de Kepler et des autres astronomes, qui pourtant le soutiennent. Il veut prouver lui-même que la Terre tourne sur son axe, et autour du Soleil. Il tire de son chapeau une preuve qu’il juge décisive : la théorie des marées. Il y a deux mouvements, déclare-t-il. L’un de jour, l’autre de nuit. D’où la certitude d’une marée positive et d’une marée négative. C’est absurde, et on ne tardera pas à le lui faire remarquer.
Il n’en a cure. Il se fait théologien – ce qu’il n’est pas – et prétend exposer une nouvelle interprétation de la Bible. Cette fois, les théologiens romains trouvent qu’il y va un peu fort. Un premier acte d’accusation est lancé contre lui, mais en secret. Les jésuites sentent le danger. Bellarmin intercède en sa faveur : les affirmations de Galilée, précise-t-il, ne sont que des hypothèses de travail. On veut bien l’écouter. En même temps, le célèbre jésuite conseille à Galilée de faire un peu moins de bruit.
Cette remarque déplaît à notre diva. La stratégie des jésuites – prudence et méthode – l’irrite. Il veut un procès retentissant qui lui permettra de pourfendre ses opposants. Il attendra. Avec habileté, les jésuites profitent de ce répit pour endiguer l’offensive : il y aura un petit procès en 1616. On condamne l’héliocentrisme de Copernic, on confisque certains de ses livres. Galilée n’est même pas mentionné. Les jésuites ont donc gagné ; ils ont dévié le torrent hostile. Mais Galilée ne l’entend pas de cette oreille. Il est vexé, honteux. On le fait recevoir, une fois encore, par le pape qui tente de le calmer. Sans succès. Galilée, désormais, veut régler ses comptes avec ses amis les jésuites qui l’ont, affirme-t-il, trahi. Il est en train de se brouiller avec ses seuls soutiens.
Galilée va demeurer à peu près silencieux pendant plusieurs années. Malheureusement, deux événements vont réveiller se bile.
D’abord, l’affaire des comètes. En 1618, trois comètes ont parcouru le ciel. Les jésuites ont suivi leur cheminement, et décrit avec précision et minutie leur comportement ; aujourd’hui encore, leurs observations sont exactes. Galilée n’a rien vu. Il tempête, déclare que les jésuites ont triché, qu’il s’agissait simplement de phénomènes atmosphériques. Cette fois, même ses défenseurs admettent qu’il est bien moins rigoureux qu’il ne l’affirme ; qu’en tout cas, il est souvent de mauvaise foi.
Deuxième secousse : le pape qui l’a soutenu meurt. Deux ans plus tard, après le bref pontificat de Grégoire XV [1621-1623], c’est Maffeo Barberini, grand admirateur de Galilée, qui est choisi. Il prend le nom d’Urbain VIII [1623-1644]. C’est un homme lucide ; il est convaincu qu’il faut réussir le rapprochement de l’Église et des scientifiques. Il compte sur Galilée pour mener à bien cette évolution dans les têtes. Il reçoit six fois de suite le grand homme, et le soutient ; il accepte la théorie des hypothèses. Selon lui, elle devrait permettre de calmer les esprits inquiets. Pour en finir, il commande à Galilée un ouvrage de récapitulation. Galilée accepte; il est très fier. En 1629, sous le titre Dialogue, l’ouvrage commandé par Urbain VIII paraît. C’est ce livre qui va précipiter la chute de ce personnage génial et étrange. Plus question d’hypothèses : l’auteur affirme, d’une manière péremptoire : il sait. Et il est le seul à avoir compris le ciel et ses mouvements. Délibérément – sans doute pour se faire plaisir -, il se moque du pape ; il en fait un benêt.
Voilà Urbain VIII écœuré. Il a voulu soutenir Galilée contre vents et marées, or ce dernier, manifestement, le méprise. Qui ne méprise-t-il pas, d’ailleurs ? Il met dans un même sac conservateurs, jésuites, savants qui n’appartiennent pas à son cénacle. Or, le pape, son ami, ne peut laisser passer l’insulte qui fait la joie des adversaires de Galilée. Celui-ci avait promis de faire une chose, et il a fait l’inverse. L’Inquisition, cette fois, est requise, Galilée interné dans sa maison de Florence – ce n’est pas un cachot – pendant qu’on instruit son procès.
Que dire sur le fond ? Galilée avait intuitivement raison, mais ses convictions n’étaient pas encore fondées scientifiquement. Son ouvrage était empli d’erreurs spectaculaires : par exemple, il avait ressorti sa théorie des marées dont tout le monde savait qu’elle ne valait rien (Kepler, à cette date, avait déjà donné l’explication exacte) ; une fois encore, il avait nié l’existence des comètes, etc. Pourtant, son ouvrage faisait publiquement sauter un barrage intellectuel : dans les domaines scientifiques, l’Église, affirmait-il, ne détenait aucune autorité particulière.
Il faut citer intégralement le texte que l’Inquisition fit signer à Galilée, le 22 juin 1633.
Moi, Galileo Galilei, fils de Vincenzo Galilei de Florence, âgé de soixante-dix ans, comparaissant en personne devant ce tribunal, et agenouillé devant vous, Très Éminents et Révérends Cardinaux, Grands Inquisiteurs dans toute la Chrétienté contre la perversité hérétique, les yeux sur les Très Saints Évangiles que je touche de mes propres mains.
Je jure que j’ai toujours cru, que je crois à présent et que, avec la grâce de Dieu, je continuerai à l’avenir de croire tout ce que la Sainte Église catholique, apostolique et romaine tient pour vrai, prêche et enseigne.
Mais parce que après que le Saint-Office m’eut notifié l’ordre de ne plus croire à l’opinion fausse que le Soleil est le centre du monde et immobile et que la Terre n’est pas le centre du monde et qu’elle se meut, et de ne pas maintenir, défendre, ni enseigner, soit oralement, soit par écrit, cette fausse doctrine ; après qu’il m’eut été notifié que ladite doctrine était contraire à la Sainte Écriture ; parce que j’ai écrit et fait imprimer un livre dans lequel j’expose cette doctrine condamnée, en présentant en sa faveur une argumentation très convaincante, sans apporter aucune solution définitive ; j’ai été, de ce fait, soupçonné véhémentement d’hérésie, c’est-à-dire d’avoir maintenu et cru que le Soleil est au centre du monde et immobile, et que la Terre n’est pas au centre et se meut.
Pour ce, voulant effacer dans l’esprit de Vos Éminences et de tout chrétien fidèle ce soupçon véhément à juste titre conçu contre moi, j’abjure et je maudis d’un cœur sincère et avec une foi non simulée les erreurs et les hérésies susdites, et en général toute autre erreur, hérésie et entreprise contraire à la Sainte Église ; je jure à l’avenir de ne plus rien dire ni affirmer de voix, et par écrit, qui permette d’avoir de moi un semblable soupçon, et s’il devait m’arriver de rencontrer un hérétique ou présumé tel, je le dénoncerais à ce Saint-Office, à l’inquisiteur ou à l’ordinaire de mon lieu de résidence.
Je jure aussi et je promets d’accomplir et d’observer strictement les pénitences qui m’ont été ou me seront imposées par ce Saint-Office ; et si je contrevenais, ce qu’à Dieu ne veuille, à l’une de mes promesses et serments, je me soumets à toutes les peines et châtiments qui sont imposés et promulgués par les Sacrés Canons et les autres Constitutions générales et particulières contre de semblables délinquants. Avec l’aide de Dieu et de ses Saints Évangiles, que je touche de mes mains.
Moi, Galileo Galilei soussigné, j’ai abjuré, juré, promis et engagé comme ci-dessus ; et, en foi de quoi, pour attester la vérité de ma propre main, j’ai signé la présente cédule de mon abjuration, et je l’ai récitée mot à mot à Rome, dans le couvent de la Minerve, le 22 juin 1633.
Voilà le texte incroyable qui allait ridiculiser l’Église et faire de son signataire un héros et un martyr ; ce qui était un peu excessif. En tout cas, le rapprochement entre l’Église et la science est renvoyé dans la nuit des temps à venir. Il faudra attendre 1757 pour que le pape Benoît XIV reconnaisse comme licite l’interprétation symbolique de la Bible en ce qui concerne le soleil. C’est seulement en 1846 que l’Inquisition retire Copernic et Galilée de l’index. Enfin, c’est Jean-Paul II qui réhabilite publiquement Galilée au cours d’une séance de l’Académie pontificale des sciences. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette déclaration était tardive.
Georges Suffert. Tu es Pierre. Éditions de Fallois 2000
1633
Missionnaire jésuite et supérieur de sa communauté au Japon depuis 24 ans, Cristóvão Ferreira est arrêté par les inquisiteurs du shogun Tokugawa. Torturé pendant 5 heures, il abjure et devient adepte du courant zen, partageant son temps entre l’écriture et la participation aux jugements gouvernementaux pour condamner les chrétiens, reconnus par le test du fumi-é : le piétinement d’une image chrétienne. Il mourra en 1650. C’est l’histoire d’un jeune jésuite lancé à sa recherche que reprendra Martin Scorsese dans Silence, sur les écrans en 2017 : l’inquisiteur et Ferreira lui-même se montrent très persuasifs dans leur attachement au bouddhisme…
vers 1633
Une maladie a fait perdre ses cheveux à Louis XIII : c’est la naissance de la perruque. Les bourgeois de Paris ont obligation d’éclairer l’extrémité des rues : ils ont donc installé des chandelles… qui coûtent cher ; mais comme cela coûte cher aussi de se faire surprendre par les gens d’arme en train de les éteindre prématurément, ils inventent une astuce qui consiste à mettre de l’eau sur la mèche, provoquant ainsi l’extinction des feux pour faire des économies de bouts de chandelle.
1632 à 1638
À Loudun, sud ouest de Chinon, la ville la plus calviniste de France après La Rochelle, de nombreux cas de possession démoniaque apparaissent au sein du couvent des Ursulines, où se trouvaient aussi bien des laïcs que des religieuses. Loudun est une ville qui relève de maladie : la peste vient d’y sévir a mis en terre le quart de la population : 3 000 sur les 14 000 du total. Peu auparavant Louis XIII avait dépêché Jean Martin de Lombardemont pour abattre les fortifications de la ville. La supérieure des Ursulines, mère Jeanne des Anges, née Jeanne de Belcier, se prît d’une passion dévastatrice pour Urbain Grandier, curé de l’église Saint Pierre du Marché ; il avait refusé d’être le confesseur du couvent, mais cumulait tout ce qu’il faut pour se mettre tout le monde à dos : bel homme, il plaisait et s’était marié, il éprouvait d’évidentes sympathies pour les protestants, il avait écrit un livre s’opposant au célibat des prêtres et un pamphlet contre Louis XIII : c’en était trop, l’homme était à abattre. Mère Jeanne des Anges va se mettre à accuser Urbain Grandier d’être le propagateur des œuvres du diable : convaincu de magie, sortilèges et maléfices, il sera brûlé le 18 août 1634, les jambes auparavant brisées par le supplice des brodequins [bris des os par écrasement dans un étau]. Les accusations de mère Jeanne des Anges venaient à point nommé : elle eut beau par la suite avouer qu’elle avait menti : on ne la crut point, en mettant cela sur le compte de la ruse du diable. Jean Jacques Surin, jésuite envoyé là pour exorciser Mère Jeanne des Anges et les Ursulines, à force d’écoute, sombrera dans la paralysie et l’aphasie, à mesure que la supérieure retrouve son équilibre. Richelieu était en fait derrière tout cela, trop heureux de faire ainsi payer au curé son pamphlet écrit bien des années auparavant. Les désordres dureront encore 4 ans. Mère Jeanne Marie des Anges aura une fin de vie glorieuse : tournées générales dans tout le pays pour y faire admirer ses stigmates, qui n’étaient en fait guère autre chose que des tatouages. Bien plus tard, Charcot s’intéressera beaucoup à l’affaire, qu’il mettra sur le compte de l’hystérie.
L’hystérie collective est à la psychosociologie ce que la foudre en boule est à la physique : un phénomène rare, mais attesté, dont les caractéristiques sont bien connues et qui pourtant reste largement inexpliqué !
Jean-Bruno Renard
La peste avait aussi ravagé Venise en 1630 : pour la conjurer les Vénitiens s’étaient mis à bâtir sur 1 156 627 pilotis de 4 mètres de long, en chêne, aulne et mélèze la basilique Santa Maria della Salute : elle sera terminée vers 1688. Baldassare Longhena, l’architecte, mourut avant la fin des travaux.

27 01 1635
Création de l’Académie française, avec pour mission de contrôler la langue, la littérature…et donc l’opinion. (cf la demande par Richelieu de la censure du Cid deux ans plus tard)
19 05 1635
La France s’engage dans la guerre de Trente ans en déclarant la guerre au roi d’Espagne : les armées françaises batailleront en Savoie et en Lorraine.
La guerre coûte cher, et son nerf – l’impôt – est malade : Les disparitions de Richelieu et de Louis XIII avaient avivé la crise politico-financière. Le nouveau régime avait fait naître des espoirs, très vite déçus. L’amertume n’en était que plus profonde. Depuis 1635, date du début de la guerre contre la maison d’Autriche, la France avait connu l’une des mutations les plus importantes de son histoire financière. Pour lever des armées, les entretenir, acheter des mercenaires, passer des marchés avec les munitionnaires, subventionner les alliés suédois et les princes allemands, il fallait chaque année de l’argent, énormément d’argent, qui s’ajoutait aux besoins ordinaires : les dépenses somptuaires de la Cour, les gages des officiers, les frais des ambassades.
Si l’on veut avoir une idée de l’augmentation démesurée des dépenses et de l’effort demandé durant ces années terribles, il suffit de considérer quelques chiffres : le budget de l’État, qui était en temps ordinaire de l’ordre de 40 à 45 millions de livres tournois, bondit à 120 millions en 1634, l’année des premiers efforts militaires, puis à 208 millions en 1635, l’année de la guerre. Il descendit à 88 millions en 1637, s’établit à 89 millions en 1642. Avec le ministère Mazarin, la croissance reprit : 124 millions en 1643, 141 en 1644, 136 en 1645. Il était de 142 millions en 1651 et de 109 en 1653 (la paix de Westphalie signée avec l’Empire en 1648 n’avait pas mis fin à la guerre espagnole). Françoise Bayard observe que les recettes ont été multipliées par quinze de 1575 à 1635 et par près de huit de 1575 à 1653.
Le système des impôts sous l’Ancien Régime était archaïque, improductif, injuste, hérissé d’exemptions scandaleuses et de particularités choquantes qui avaient le plus souvent perdu leur raison d’être. Mais la monarchie aux abois n’était pas capable de le réformer. De quoi d’ailleurs était-elle capable en la matière ?
Elle ne savait ni adapter ses recettes à ses dépenses, ni prévoir les unes et les autres, ni avoir la moindre vue d’ensemble de son budget annuel. Et s’il n’y avait eu que l’embarras chronique de capitaux ! Mais elle était constamment en alarme, prise à la gorge par ses fins de mois difficiles. Menacée de banqueroute, contrainte de multiplier les expédients douteux, les subterfuges désespérés, les artifices frauduleux, elle avait fini par s’en remettre à une catégorie sociale en pleine prospérité, les gens de finance, ces traitants et partisans avec lesquels elle signait des traités ou partis à des taux usuraires extravagants.
Cela faisait longtemps que l’exploitation du domaine royal, ses biens-fonds, ses seigneuries et ses forêts, même augmentée de droits annexes comme le greffe et le contrôle des actes, ne représentait plus qu’une faible part des ressources publiques. Pour faire face au flot des dépenses que nul ne savait endiguer, la pression fiscale dut s’accroître dans des proportions gigantesques, insupportables pour les populations.
La taille, le plus ancien des impôts directs, était d’origine féodale et militaire. Elle n’était pas d’une forte rentabilité. Ceux qui auraient eu les moyens de la payer en étaient exemptés : les nobles parce qu’ils acquittaient en principe l’impôt du sang, le clergé parce qu’il consentait au souverain un don gratuit, fort modeste par rapport à ses richesses. Au fil du temps, d’autres groupes sociaux y avaient échappé : les magistrats, les bourgeois de certaines grandes villes, comme Paris, Lyon, Bordeaux, Tours, Bourges, Poitiers… La taille et son supplément le taillon (institué en 1549) pesaient sur les autres, les ruraux, laboureurs, fermiers, petits et moyens propriétaires.
Dans les pays dits de taille réelle (pays d’États notamment), ils étaient assis sur les biens qualifiés de roturiers (des gentilshommes pouvaient les payer), tandis que dans les pays de taille personnelle ils étaient répartis entre les gens de roture. Leur perception était très ardue et, avant de remonter à Paris, donnait lieu à de multiples fraudes.
Dépourvu d’une administration financière rigoureuse et efficace – celle qui existait était décentralisée, morcelée, anarchique, avec des pouvoirs enchevêtrés tant dans la collecte des impôts que dans l’ordonnancement et la distribution des fonds publics -, l’État avait renoncé à percevoir lui-même les impôts indirects, comme les aides sur les boissons, les entrées ou octrois des villes et la fameuse gabelle ou impôt sur le sel, impopulaire entre tous. Ces impôts avaient été affermés. Puis on avait eu recours aux affaires extraordinaires, comme la création et la vente de nouveaux offices (au grand mécontentement des anciens titulaires qui voyaient diminuer la valeur de leur capital), la reprise et la revente de parties aliénées du domaine royal… Tout cela était également affermé ou plus exactement vendu sous forme de traités. Les traitants ou une compagnie de traitants versaient d’avance au roi une somme forfaitaire, fort en retrait de celle qu’il pouvait espérer, à charge pour eux de recouvrer l’impôt ou le produit des offices vendus et de se rémunérer sur la différence. Ces affaires extraordinaires représentaient souvent entre 25 et 40 % du budget de l’année. En 1635, elles s’élevèrent à plus de 75 % et en 1647 à 71 %.
[…] Les bases de l’organisation financière du royaume, mises en place dès le XVI° siècle, reposaient sur trois sortes de fonctions : les ordonnateurs, les comptables et les contrôleurs. Les premiers – le roi en son Conseil, le surintendant, les trésoriers de France, les élus – décidaient, chacun à leur niveau, de la collecte et de la répartition de l’impôt ; les seconds – les trésoriers de l’Epargne, les trésoriers des diverses caisses, les receveurs généraux et particuliers des généralités et des élections – avaient, sous les ordres des ordonnateurs, le maniement des espèces ; les derniers – le contrôleur général des finances, la Cour des aides, la Chambre des comptes – vérifiaient l’exactitude des opérations et les inscrivaient sur leurs livres de comptes ou s’occupaient des contentieux.
Au sommet de la pyramide se tenait le surintendant des Finances, dont la charge était une commission royale et non un office soumis à la vénalité. Ses pouvoirs étaient considérables. Disposant de l’ensemble des finances de l’État, il n’avait de comptes à rendre qu’au roi et n’était pas justiciable de la Chambre des comptes. Il était l’ordonnateur principal des fonds, ce qui lui laissait la liberté de décider comment seraient prélevées les ressources de la couronne, comment elles seraient distribuées. Toutes les dépenses du monarque – pensions, gratifications, dépenses civiles ou militaires, intérêts de la dette, arrérages… – passaient par lui. C’est à ses services qu’avaient affaire le lieutenant général des armées, l’officier de la maison du roi, le premier président, l’ingénieur ou le rentier.
Pour que le paiement devînt effectif, il lui suffisait de signer une ordonnance de paiement et de l’adresser au principal officier comptable, le trésorier de l’Épargne.
On a dit que le gouvernement royal, aux abois depuis l’entrée en guerre de la France (1635), avait affermé les impôts indirects et mis en partis les affaires extraordinaires (émissions de rentes, créations de nouveaux offices, augmentations de gages, aliénations de droits ou de biens domaniaux…). Pour les impôts directs – dont une grosse moitié seulement parvenait jusqu’à Paris, et encore très irrégulièrement -, un système peu éloigné du précédent avait fini par prévaloir. L’État, en effet, s’était mis à vivre sur les avances personnelles de ses principaux officiers comptables, en anticipation des recettes générales, moyennant, cela va de soi, remises généreuses et gros intérêts. Les expéditions de ces avances qui se faisaient à des taux de l’ordre de 15 % étaient rédigées au nom d’un domestique ou d’un homme de paille. La mise en partis de la taille en 1645 avait été le point d’orgue de cette politique de gribouille. Ainsi, comme l’a magistralement démontré Daniel Dessert, s’était opérée la fusion des affaires extraordinaires et ordinaires. L’appareil fiscal tout entier se trouvait monopolisé par des intermédiaires intéressés – traitants, partisans, officiers comptables – qui ponctionnaient directement la manne financière et s’enrichissaient par un processus de réinvestissement cumulatif. La machine tournait en vase clos. Quand ces publicains étaient eux-mêmes à court d’argent, ils empruntaient pour couvrir le déficit du Trésor. Les imbrications innombrables des flux monétaires, la masse des engagements et des quittances, les retards de tous ordres qui rendaient impossible l’apurement des comptes les amenèrent dans leur gestion quotidienne à confondre leurs propres deniers et ceux du souverain. Peut-être au début n’avaient-ils pas eu la volonté délibérée de commettre des indélicatesses, mais leur mode de vie fastueux, nécessaire pour créer la confiance, y conduisait selon une pente trop naturelle.
Le remboursement des créanciers du Trésor royal s’opérait par assignation des créances sur des fonds de recettes à venir. Ces fonds étaient autonomes et affectés : telle était la grande particularité du système. Il n’y avait pas, comme de nos jours, d’unité budgétaire. La péréquation entre les fonds était une pratique bannie, jugée dangereuse. L’assignation, autrement dit l’affectation, consistait en un ordre placé au bas d’un titre de paiement désignant le fonds à débiter et sa date de valeur. Si le fonds était consommé, il fallait renoncer à se faire payer, à moins d’obtenir une réassignation sur un fonds meilleur. La situation du créancier de l’État correspondait un peu à celle d’un créancier privilégié : s’il disposait d’une hypothèque de premier rang sur un bien d’excellente qualité facilement liquidable, il avait l’assurance d’être remboursé, mais la perdait si son hypothèque était de dernier rang, sur un bien surévalué et difficile à vendre ! La qualité d’un fonds était essentielle. Or tous n’étaient pas alimentés régulièrement. Certains languissaient du fait de la guerre, de l’agitation nobiliaire ou des jacqueries qui surgissaient dans les provinces.
Ce système fîsco-financier avait de fâcheuses conséquences. Aux grands déséquilibres budgétaires, dus à la conjoncture européenne, s’ajoutait une insuffisance chronique de trésorerie, génératrice d’une perpétuelle et épuisante course à l’argent. Une pièce maîtresse faisait défaut : une banque d’État chargée de gérer les à-coups de trésorerie. Si elle avait existé, nul doute que le visage de la monarchie eût changé : sa dépendance à l’égard des capitalistes privés n’aurait pas revêtu cet aspect pathétique.
Le droit de signer une assignation revenait au surintendant : cela lui conférait un immense pouvoir, d’autant plus que le pays connaissait une tragique pénurie des espèces, due aux faibles arrivages en Europe des cargaisons d’or et d’argent d’Amérique. Comme l’a montré Michel Morineau, les années 1640-1660 correspondent à la zone d’étiage. Le stock de métal précieux ne s’accroissait que de 0,3 à 0,4 % par an.
Bref, pour toutes ces raisons, le surintendant était le maître absolu des finances du royaume. Quel moyen tentant de favoriser ses amis ! Une fois l’ordonnance assignée, le trésorier de l’Épargne remettait au créancier des billets, reconnaissances de dettes qui finirent par circuler comme des effets de commerce ou de la monnaie fiduciaire, assortis d’un taux de dépréciation conséquent qu’expliquent les effets de la guerre, le resserrement des espèces, l’inflation débridée et l’incurie administrative. Ce fut sur une large échelle la première expérience de papier-monnaie.
Pour mener à bien son action, le surintendant se servait d’un document appelé l’état des fonds disponibles du roi ou état des recettes, qui comportait deux formes : l’une, prévisionnelle, dressée en début d’année, l’autre, définitive, au début de l’année suivante. Sa gestion se compliquait du fait que le roi pouvait librement émettre des mandements non causés, appelés ordonnances ou acquits de comptant. Ces titres, sans justification d’emploi, avaient été d’un usage limité au temps de Louis XIII (en moyenne 5 millions de livres par an entre 1630 et 1642). En 1644 et en 1645, leur montant s’éleva à près de 60 millions. En 1648, ils furent plafonnés à 3 millions par le Parlement, désireux de restreindre la liberté financière du monarque. Mazarin fit supprimer cette règle – du reste inappliquée – par un édit du 17 décembre 1652 et, dès lors, le montant des ordonnances de comptant reprit sa course ascensionnelle, au point de représenter durant la surintendance de Nicolas Fouquet une moyenne annuelle de 64 millions, soit environ 50 % des recettes de l’État. Portant généralement la signature du roi et d’un secrétaire d’État, elles donnaient injonction au surintendant ou au trésorier de l’Épargne de payer sans discussion et sans délai telle somme qui s’y trouvait inscrite. Ces fonds secrets servaient aux gratifications des courtisans, aux subsides des princes étrangers, à certaines dépenses militaires voire à tout autre usage. N’étant pas toujours prévisibles, ils bouleversaient le système des fonds dédiés : il fallait trouver sur-le-champ de l’argent liquide.
Parmi les officiers comptables les plus importants se trouvaient les trésoriers de l’Épargne, au nombre de trois, exerçant leur charge à tour de rôle. Ils avaient une multitude de correspondants, les trésoriers des maisons royales, de l’Extraordinaire des guerres, de la marine, des gardes, des Suisses, de l’artillerie, des fortifications, des parties casuelles (ces derniers chargés de prélever les taxes fiscales sur les officiers).
Le contrôleur général avait mission de tenir le registre des flux financiers et d’examiner les pièces des recettes et dépenses. Il était assisté des intendants des Finances (importants personnages à ne pas confondre avec les intendants de justice, police et finance des généralités). En 1649, Mazarin porta leur nombre de quatre à huit, puis en 1654 à douze. Fiscalité oblige !
La Cour des aides jugeait en dernier ressort les contestations en matière d’impôt. Quant à la Chambre des comptes, elle enregistrait les ordonnances de comptant, examinait les états au vrai ainsi que les comptes des officiers royaux, notamment ceux des trésoriers de l’Épargne, qui prêtaient serment devant elle.
Le surintendant ne travaillait pas seul. Il était assisté de deux ou trois directeurs des Finances et de deux sections particulières du Conseil du roi. Le Conseil des finances, souvent appelé la Grande direction, était composé du chancelier, du ou des surintendants, des secrétaires d’État, des contrôleurs et intendants des Finances, des trésoriers de l’Épargne. C’était l’organe central qui prenait les décisions essentielles, tant pour la levée des impôts, la création de ressources nouvelles, que pour l’ordonnancement des dépenses. Son travail était préparé par un comité restreint ou Petite direction, réunissant autour du surintendant quelques spécialistes des finances. La seconde section, qui avait moins d’importance, était le Conseil d’État et des finances, chargé de certains contentieux fiscaux et de l’adjudication des baux. Il était subordonné à la Grande direction.
Cette présentation rapide ne rend compte qu’imparfaitement de la réalité foisonnante, fluide et complexe des institutions d’Ancien Régime, où des attributions mal définies donnaient lieu à des confusions et des empiétements. À la vérité, les ordonnateurs ordonnaient mal, les comptables ne comptaient pas et les contrôleurs ne contrôlaient rien. Le manque généralisé de rigueur, l’incohérence des dépenses, la cascade embrouillée des opérations permettaient toutes les fraudes. Les collusions entre trésoriers et contrôleurs étaient fréquentes. Le rôle des intendants des Finances était mal défini : ils étaient plutôt les assistants du surintendant que du contrôleur général. Les champs de compétences de ces deux derniers personnages se recoupaient largement, d’où une compétition entre eux, quoique le second fût subordonné au premier.
Le plus choquant était l’osmose à peu près complète entre les membres de l’administration financière et les milieux d’affaires (prêteurs, traitants, partisans, munitionnaires). Les collecteurs des deniers du souverain, cousus d’or, se flattaient de voir l’État devenir leur obligé. Les trésoriers de l’Épargne, ceux des différentes caisses se faisaient bailleurs de fonds. Les traitants achetaient des charges d’intendant des Finances ou de contrôleur général. Seuls ou à plusieurs, ils convoitaient les commissions de receveurs généraux des Finances, chargés de la levée des tailles dans les provinces, ou les postes de trésoriers généraux des états, tous gros manieurs d’argent. D’où l’opacité des comptes, la prolifération des opérations illicites voire de la pure rapine.
Étant donné l’ampleur de ses attributions, on conçoit que le surintendant des Finances ait été considéré avec quelque méfiance par le pouvoir royal. Ce n’était pas la première fois que la fonction était dédoublée. […] Deux hommes piqués de jalousie, avait dit Richelieu, ne s’entendront jamais pour piller les deniers de l’Épargne ! Mazarin appliqua cette sage sentence à Servien et Fouquet.
Jean Christian Petitfils. Fouquet. Perrin 1999
Il n’est pas vraiment difficile d’instruire le procès de la fiscalité de l’Ancien Régime, mais on pourrait y espérer un peu plus de retenue, sans quoi c’est l’hôpital qui se moque de la charité… quand on sait que, dans notre V° République on dépense systématiquement depuis 1974 plus qu’on encaisse, et que l’on a recours pour ce faire à l’emprunt sur les marchés internationaux, ce qui nous représente le poste budgétaire le plus important du budget annuel : le remboursement des intérêts de la dette, plus que l’Éducation Nationale, plus que la Défense ! Les traitants du XVII° siècle prélevaient leur part, mais que font d’autres les banques du XXI° siècle qui renflouent chaque année nos gouvernements de flambeurs !
1635
Quatre cents Dieppois débarquent à la Guadeloupe, conquise par la France 3 ans plus tôt : ce sont surtout la misère, la maladie et la faim qui les attendent. Deux ans plus tard, la Martinique devient le centre de la colonisation dans la région. Encore trois ans, et des aventuriers s’emparent de l’île de la Tortue.
Henri III avait entrepris en 1576 la construction du Pont Neuf, à cheval sur la pointe avale de l’île de la Cité. Les pierres de taille coûtaient cher, les caisses royales avaient du mal à suivre… C’est Henri IV qui le terminera en 1607. Très rapidement, il devint le centre d’attraction de la capitale et même de la région tout entière, des voyageurs et étrangers… Les ponts étaient aussi à l’écart des odeurs pestilentielles des rues : Il circule dans toutes les rues de la ville un ruisseau d’eau fétide où se déversent les eaux sales de chaque maison et qui empeste l’air : aussi est-on obligé de porter à la main des fleurs de quelque parfum pour chasser cette odeur, rapporte un voyageur italien
Tout ce que la ville contenait de colporteurs, de petits merciers, de vendeurs de gris (bonimenteurs), de charlatans, vint proposer ses services dans cette foire permanente. Depuis longtemps les ponts attiraient la vie publique – Sur l’pont de Nantes, un bal y est donné… Sur le pont d’Avignon, on y danse, on y danse…- car l’espace manquait cruellement dans les villes et leur revêtement, beaucoup plus plat que celui des rues, tenait lieu de piste de danse. Pont-Neuf devint le nom générique d’un type de chansons, plutôt courte : la concurrence était rude et on ne pouvait espérer retenir l’attention du passant trop longtemps.
Les lestes chansons du Pont -Neuf
Epousent pamphlets et libelles,
On les ouït entre huit et neuf
Les lestes chansons du Pont-Neuf.
Leur papier est moins blanc qu’un œuf
Mais mon laquet les trouve belles :
Les lestes chansons du Pont-Neuf
Épousent pamphlets et libelles.
Saint-Amant
La grande vedette de la chanson populaire, Philippot le Savoyard, y prend place autour de cette année 1635. Il mourra sans doute vers 1670. Boileau s’y référait :
…ils (mes propres écrits) pourraient
Occuper les loisirs des laquais et des pages,
Et souvent, dans un coin renvoyés à l’écart,
Servir de second tome aux airs du Savoyard.
Phillipot était aveugle ; auteur-interprète, peut-être compositeur. Il existe un recueil des chansons du Savoyard, le fonds de commerce se cantonnant essentiellement dans la chanson paillarde et la chanson à boire. Son origine savoyarde n’est pas formellement prouvée ; il pourrait s’agir d’un nom de scène, les Savoyards s’étant déjà attiré une réputation de fameux chanteurs de rue.
Nostre Pont-Neuf, qui pourtant a de l’âge
De tes vertus s’entretient tous les jours ;
Là, son aveugle à gueule ouverte et torse,
À voix hautaine et de toute sa force
Se gorgiasse à dire des chansons ;
Là, sa moitié qui n’est pas mieux pourvue
D’habits, d’attraits, de grâces ni de vue,
Le secondant, plantée auprès de lui,
Verse au badaud la joie à plein mui.
Saint Amant au duc d’Orléans, frère de Louis XIII. 1644.
L’écriture du Savoyard conserva jusqu’au bout la franchise qui avait été celle des chansonniers hors salons et ruelles, … cette franchise de langage qui ne reculait jamais devant le mot cru et faisait si peur aux gens du XIX° siècle, engoncés dans les conventions bourgeoises du qu’en dira-t-on…. La revue que fait Philippot des appétits sexuels du citoyen de base est d’une drôlerie, et surtout d’une insolence si joyeuse qu’elle aurait fait chavirer d’horreur les chastes soupirants des romances en vogue sous l’impératrice Eugénie… Au reste, toute cette gaîté jaillissait au Pont-Neuf au moment même où le jeune janséniste Jean Racine faisait représenter son Andromaque.
Claude Duneton. Histoire de la Chanson Française. Seuil 1998
À présent je vous confesse
À présent je vous confesse
Que tout est plein de Cocus,
Que chacun bransle les fesses
Et qu’un chacun joue du cul.
Chacun fait cy, chacun fait ça,
Et tout le monde fait cela
Tout le monde joue et tout le monde baise,
Tout le monde met cul bas.
Les maris ont leurs Maistresses,
Les femmes ont leurs galands.
Les maris baisent sans cesse,
Les femmes incessamment.
La damoiselle suivante
Est pour le maistre d’Hostel,
Le laquais voit la servante,
Ou il s’en va au bordel.
Un clerc a bien l’impudence
Quand son maistre est au Palais
De baiser en son absence
Sa maistresse s’il luy plaist.
Tous les courteaux de boutique
En font tous leurs sobriquets,
Et en sont mélancoliques,
Pour n’estre dans les coquets.
Je suis l’illustre Savoyard.
Je suis l’illustre Savoyard,
Des Chantres le grand Capitaine,
Je ne mène pas mon soldat
C’est mon soldat qui me mène
Accourez filles et garçons
Écoutez bien notre musique,
L’esprit le plus mélancolique
Se réjouit à mes chansons.
Je suis l’Orphée du Pont-Neuf,
Voici les bêtes que j’attire,
Vous y voyez l’âne et le bœuf
Et la nymphe avec Satyre
J’ai chanté Bacchus et l’Amour
Car je vois que chacun les aime,
Maintenant je veux à mon tour
Devant vous me chanter moi-même.
J’ai signalé tous les lauriers
De nos vaillants foudres de guerre,
Comme de ceux qui les premiers
Et derniers combattent au verre.
Moi-même j’ai tant combattu
Dans le champ de la bonne chère
Que pour marque de ma vertu
Mes yeux ont perdu leur lumière
Mais ce vin dont je suis charmé
Malgré cette offense reçue,
Pour être toujours bien aimé
M’ôte le regret de la vue.
Homère, ce chantre divin,
Comme moi digne de mémoire,
Eut tant d’amour pour le bon vin
Qu’il perdit les yeux de trop boire.
Les courtisans du grand Henri,
Les enfants de la gibecière,
Me tiennent pour leur favori
Et m’en font tous le pied derrière.
Nos voisins les Opérateurs
Disent que dans leurs boîtelettes
Ils n’ont pour réjouir leur cœur
Rien si bon que mes chansonnettes.
Ces menteurs arracheurs de dents
En ma faveur sont véritables
Quand ils disent à tout venants
Que mes chansons sont délectables.
L’honnête homme en passant chemin
Ne croit pas en être moins sage
D’écouter le chant tout divin
D’un si ravissant personnage.
N’ayaez peur en chantant devant vous
Que votre bourse soit coupée,
Je ne vois point autour de vous
De noble à la courte épée.
Enfin, si vous êtes émus
De mes aimables gentillesses,
Je voudrais vous voir tous pendus
Au col de vos chères maîtresses !
Accourez filles et garçons
Venez ouïr notre musique,
Et que chacun de vous se pique
De bien accepter mes chansons.
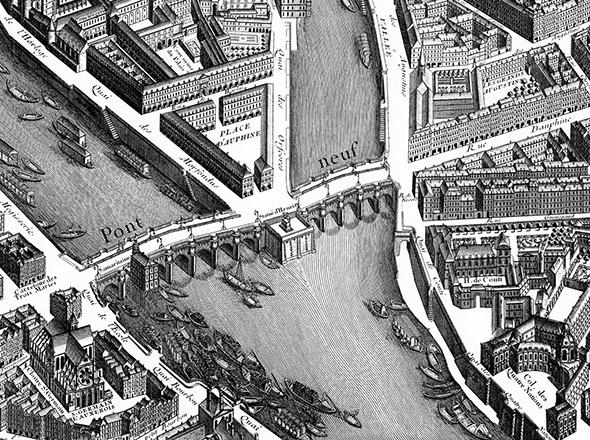


Par Paul Signac. 1863-1935
________________________________________________________________________________________________
[1] Un peu comme les révolutionnaires de la Convention mettaient aux côtés des généraux envers lesquels elle n’avait qu’une confiance limitée, un représentant politique, et encore comme Staline qui mettait un commissaire politique auprès de ses généraux.
[2] De gazetta, la petite pièce de monnaie qui, à Venise, correspondait au prix des avizzi, petites feuilles volantes d’informations spectaculaires et/ou croustillantes
Laisser un commentaire