| Publié par (l.peltier) le 30 octobre 2008 | En savoir plus |
20 01 1793
Louis XVI demande aux commissaires de la Convention : A-t-on des nouvelles de Monsieur de La Pérouse ? C’était le projet qu’il avait le plus à cœur.
21 01 1793
Louis XVI est guillotiné.
En décembre 1792, lors de son procès, Louis Sébastien Mercier avait résumé la position des opposants à la peine de mort : Nous avions la chance heureuse, si rare dans l’histoire des nations, d’avoir détruit la royauté sans avoir ensanglanté le trône. Ailleurs, on avait détruit le tyran sans détruire la royauté.
*****
Le meilleur régime politique est la monarchie absolue tempérée par l’assassinat.
Stendhal
Deux cents ans plus tard, on voit encore des témoignages silencieux de ce qui fût par beaucoup perçu comme la transgression d’un interdit, l’entrée dans un monde de malédiction : l’inscription sur la clef d’une porte intérieure d’une maison perdue dans la campagne à 20 kilomètres de Figeac, reprend l’année de cette mort : les trois premiers chiffres 1,7 et 9, sont inscrits normalement et le dernier, le 3, est basculé à l’horizontale, l’extrémité supérieure gauche du chiffre étant le centre de rotation. Ainsi placé, ce 3 représente les deux têtes de Louis XVI et de Marie Antoinette, et si ces paysans ont ainsi voulu marquer l’événement, c’est bien pour marquer leur indignation. Autre témoignage, peut-être plus répandu, chez les horlogers – Louis XVI était féru de serrurerie mais aussi d’horlogerie – qui mettent leurs pendules à la vente lorsqu’elles ne fonctionnent pas sur 10 h 10’… l’heure de la mort de Louis XVI.
Le Pelletier de Saint Fargeau, [un des ancêtres de Jean d’Ormesson] partisan de l’exécution du roi, était logique avec lui-même en se démenant pour qu’on n’en appelle pas au peuple sur ce sujet : déjà le vote de la Convention par appel nominal, – arraché par Marat -, n’avait été obtenu qu’à une seule voix de majorité ; le peuple n’aurait certainement pas voulu franchir le Rubicon en devenant régicide. Petit avantage pour Le Pelletier de Saint Fargeau, cela a permis que l’on retienne facilement la date de sa mort : la veille de celle du roi. Parmi les votants pour, le duc d’Orléans [1], dit Philippe Egalité, député de Paris à la Convention, ce qui ne lui permettra pas d’échapper à la guillotine quelques mois plus tard : Uniquement occupé de mon devoir, convaincu que tous ceux qui ont attenté ou attenteraient à la souveraineté du peuple méritent la mort, je vote pour la mort. Le talent que Malesherbes mit à défendre le roi ne pourra éviter la condamnation à mort.
On se montrait le repli du couloir de gauche où Robespierre avait dit bas à l’oreille de Garat, l’ami de Clavière, ce mot redoutable : Clavière a conspiré partout où il a respiré. Dans ce même recoin, commode aux apartés et aux colères à demi-voix, Fabre d’Églantine avait querellé Romme et lui avait reproché de défigurer son calendrier par le changement de Fervidor en Thermidor. On se montrait l’angle où siégeait, se touchant le coude, les sept représentants de la Haute Garonne qui, appelés les premiers à prononcer leur verdict sur Louis XVI, avaient ainsi répondu, l’un après l’autre : Milhe : la mort. – Delmas : la mort. – Projean : la mort. – Calès : la mort. – Ayral : la mort. Julien : la mort – Deshaby : la mort. Éternelle répercussion qui emplit toute l’histoire et qui, depuis que la justice humaine existe, a toujours mis l’écho du sépulcre sur le mur du tribunal. On désignait du doigt, dans la tumultueuse mêlée des visages, tous ces hommes d’où était sorti le brouhaha des votes tragiques : Paganel, qui avait dit La mort. Un roi n’est utile que par sa mort ; Milhau, qui avait dit : Aujourd’hui, si la mort n’existait pas, il faudrait l’inventer ; le vieux Raffion du Trouillet, qui avait dit : La mort, vite ; Goupileau, qui avait crié : L’échafaud tout de suite. La lenteur aggrave la mort ; Sieyès, qui avait eu cette concision funèbre : La mort ; Thuriot, qui avait rejeté l’appel au peuple proposé par Buzot : Quoi ! les assemblées primaires ! quoi ! quarante quatre mille tribunaux ! Procès sans terme. La tête de Louis XVI aurait le temps de blanchir avant de tomber ; Augustin-Bon Robespierre, qui, après son frère, s’était écrié : Je ne connais point l’humanité qui égorge les peuples, et qui pardonne aux despotes. La mort ! demander un sursis, c’est substituer à l’appel au peuple un appel aux tyrans ; Foussedoire, le remplaçant de Bernardin de Saint Pierre, qui avait dit : J’ai en horreur l’effusion du sang humain, mais le sang d’un roi n’est pas le sang d’un homme. La mort. Jean-Bon Saint André, qui avait dit : pas de peuple libre sans le tyran mort ; Lavicomterie qui avait proclamé cette formule : Tant que le tyran respire, la liberté étouffe. La mort ; Chateauneuf-Randon, qui avait jeté ce cri : La mort de Louis le Dernier ; Guyardin, qui avait émis ce vœu : Qu’on l’exécute Barrière Renversée ; la Barrière Renversée c’était la Barrière du Trône : Tellier, qui avait dit: Qu’on forge, pour tirer contre l’ennemi, un canon du calibre de la tête de Louis XVI. Et les indulgents : Gentil, qui avait dit : Je vote la réclusion. Faire un Charles I°, c’est faire un Cromwell ; Bancal, qui avait dit : L’exil. Je veux voir le premier roi de l’univers condamné à faire un métier pour gagner sa vie ; Albouy qui avait dit: Le bannissement. Que ce spectre vivant aille errer autour des trônes ; Zangiacomi, qui avait dit : Gardons Capet vivant comme épouvantail ; Chatillon, qui avait dit : Qu’il vive. Je ne veux pas faire un mort dont Rome fera un saint. Pendant que ces sentences tombaient de ces lèvres sévères et, l’une après l’autre, se dispersaient dans l’histoire, dans les tribunes des femmes décolletées et parées comptaient les voix, une liste à la main et piquaient des épingles sous chaque vote.
Victor Hugo. Quatre-vingt-treize. Carrefour 1994
La Complainte de Louis XVI aux Français, d’auteur anonyme, ne pouvait dans un tel climat manquer de devenir très populaire. On la chantait sur l’air de Pauvre Jacques :
O mon [2] peuple, que vous ai-je donc fait ?
J’aimais la vertu, la justice,
Votre bonheur fût mon unique objet
Et vous me traînez au supplice. (bis)
Français, Français, n’est-ce pas parmi vous
Que Louis reçut la naissance ?
Le même ciel nous a vu naître tous,
J’étais enfant dans votre enfance.
O mon peuple, ai-je donc mérité
Tant de tourments et tant de peine ?
Quand je vous ai donné la liberté,
Pourquoi me chargez-vous de chaînes ? (bis)
Tout jeune encor, tous les Français en moi
Voyaient leur appui tutélaire,
Je n’étais pas encore votre Roi,
Et déjà j’étais votre père.
Quand je montais sur ce trône éclatant
Que me destina ma naissance,
Mon premier pas dans ce poste brillant
Fût un édit de bienfaisance. (bis)
Nommez-les donc, nommez-moi les sujets
Dont ma main signa la sentence,
Un seul jour vit périr plus de Français
Que les vingt ans de ma puissance.
Si ma mort peut faire votre bonheur,
Prenez mes jours, je vous les donne,
Votre bon Roi déplorant votre erreur
Meurt innocent et vous pardonne. (bis)
O mon peuple ! Recevez mes adieux,
Soyez heureux, je meurs sans peine.
Puisse mon sang, en coulant sous vos yeux,
Dans vos cœurs, éteindre la haine
O mon peuple, que vous ai-je donc fait ?

par H. de la Charlerie
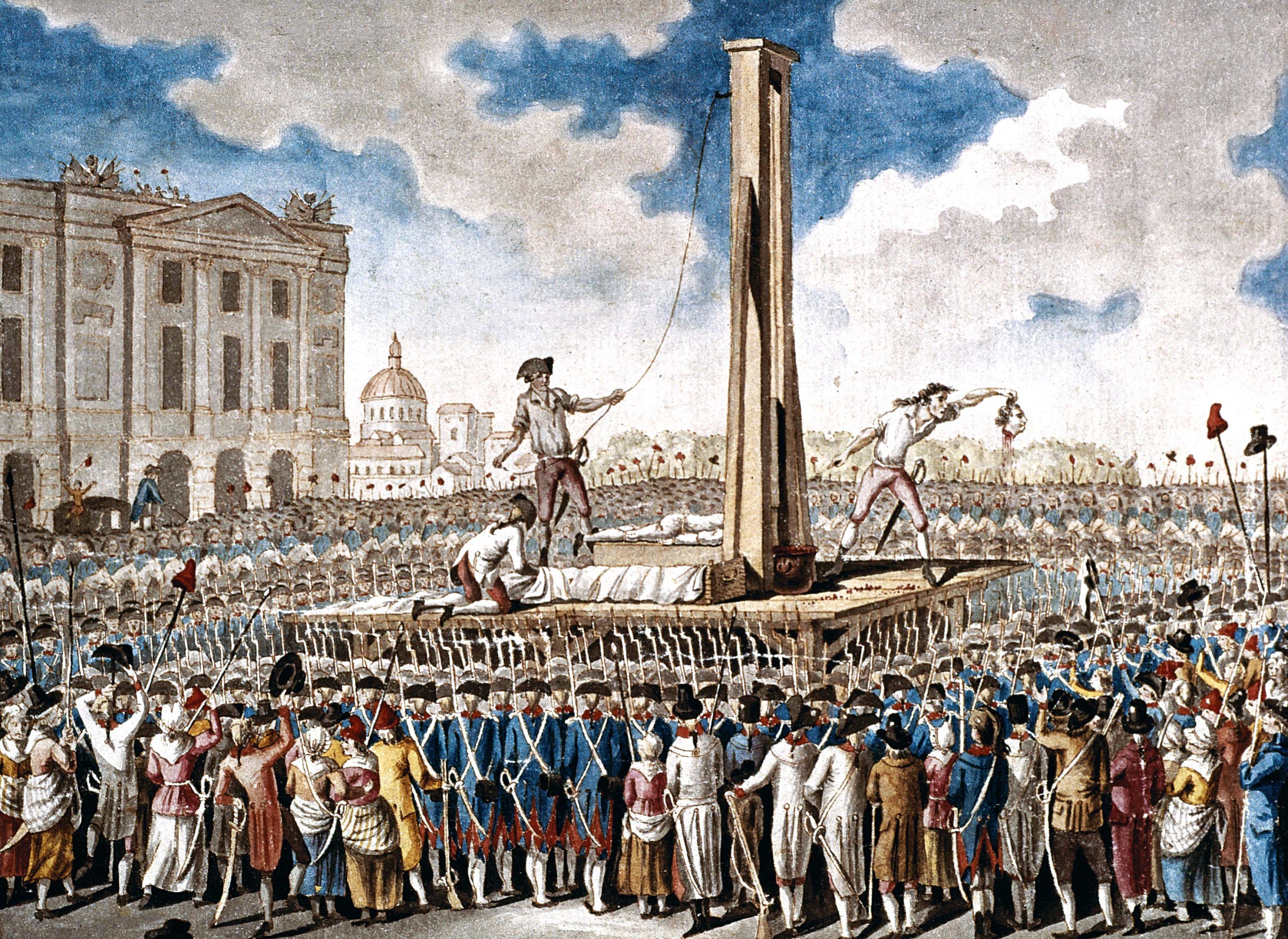
collection du musée Carnavalet, Paris.

Exécution de Louis Capet XVIe du nom, le 21 janvier 1793, estampe anonyme réalisée en 1793 et conservée au musée Carnavalet – Histoire de Paris. | Auteur anonyme via Wikimedia Commons
Soulèvement de l’Ouest et insurrection fédéraliste dans le Sud Est.
08 02 1793
La République proclame que les évêques et curés seront nommés par le corps électoral, et que tous les ecclésiastiques devront prêter serment à la république ; les réfractaires seront expulsés du territoire dans les huit jours.
20 02 1793
La presse du moment a avalisé les témoignages de révolutionnaires fanatiques sur l’exécution de Louis XVI : Le Thermomètre du Jour, les Annales patriotiques disent qu’on dût conduire le roi à l’échafaud un pistolet pointé sur la tempe, qu’une fois sous la lunette, il poussa un cri affreux et se débattit ; Jacques René Hébert dira qu’il s’était conduit comme un poltron.
C’en est trop pour son bourreau, Charles-Henri Sanson, qui envoie une mise au point à Antoine Delaure, directeur des Annales patriotiques, disant l’exacte vérité de ce qui s’est passé. Dans ce texte, le bourreau fait part de son admiration pour la calme assurance de Louis XVI face à la mort : Descendant de la voiture pour l’exécution, on lui a dit qu’il fallait ôter son habit. Il fit quelques difficultés en disant qu’on pouvait l’exécuter comme il était. Sur la représentation que la chose était impossible, il a lui-même aidé à ôter son habit (…)
Alors il s’informa si des tambours battraient toujours. Il lui fût répondu que l’on n’en savait rien et c’était la vérité. Il monta l’échafaud et voulut foncer sur le devant, comme voulant parler, mais on lui représenta que la chose était impossible encore. Il se laissa alors conduire à l’endroit où on l’attacha et où il s’est écrié très haut Peuple, je meurs innocent. Ensuite se retournant vers nous, il nous dit : Messieurs, je suis innocent de tout ce dont on m’inculpe. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. Voilà ses dernières et ses véritables paroles (…)
Il a soutenu tout cela avec un sang-froid et une fermeté qui nous a tous étonné.
Je reste très convaincu qu’il avait puisé cette fermeté dans les principes de la religion dont personne plus que lui ne paraissait pénétré ni persuadé.
24 02 1793
La Convention, manquant d’hommes pour mener la guerre, décrète une levée de 300 000 hommes. La conscription se fera par tirement [tirage au sort]. Elle ne concerne pas les fonctionnaires et les gardes nationaux qui en sont dispensés.
À partir de maintenant, et jusqu’à ce que nos ennemis aient été chassés du territoire de la République, tous les français sont réquisitionnés de façon permanente au service de l’armée. Les hommes jeunes combattront, les hommes mariés forgeront les armes et transporteront les vivres, les femmes fabriqueront des tentes et des vêtements, et serviront dans les hôpitaux ; les enfants transformeront la vieille toile en charpie et les vieillards se feront transporter dans les places publiques pour exciter l’ardeur des combattants.
2 03 1793
Début des émeutes contre la conscription en Vendée.
7 03 1793
Fin du droit d’aînesse, partage égalitaire des successions.
11 03 1793
À Machecoul, prospère cité du Marais vendéen, à l’est de l’île de Noirmoutier et au nord des Sables d’Olonne, l’appel à la conscription provoque le rassemblement, qui crée l’émeute, comme à Saint Florent, comme à Mortagne ou Chevillé. Mais à Machecoul, Souchu, ci-devant procureur, revenu depuis peu de Paris où il a été témoin des massacres de septembre et de l’exécution du roi, s’emploie à ce que l’émeute ne reste pas gratuite et c’est le curé intrus le premier à être torturé jusqu’à ce que mort s’en suive, puis les fonctionnaires, les gardes nationaux et tous ceux qui peuvent ressembler de près ou de loin à un patriote : tout ce monde va remplir la prison du château, d’où Souchu les fait sortir, liés deux par deux, pour les massacrer : ils seront ainsi plusieurs centaines à trouver la mort.
La guerre de Vendée est peuplée de ces personnages douteux, prêtres défroqués, fonctionnaires en rupture de charge, épaves d’une révolution qui, les ayant libérés d’une condition dans laquelle ils ne se sentaient guère à l’aise, n’a pas su les intégrer dans la société nouvelle. Ils étaient peu. N’étant plus rien, ils sont prêts à toutes les besognes, dans l’un ou l’autre camp, et passent de l’un à l’autre sans vergogne, pleins de rancœur et de violence, venimeux, et pis encore, contagieux.
Jean Huguet. Un Cœur d’étoffe rouge. Robert Laffont 1985
18 03 1793
À la tête des troupes autrichiennes, le prince de Saxe-Cobourg défait les Français à Neerwinden, nord-ouest de Liège.
19 03 1793
La conscription fait se lever les paysans partout en France, rapidement matés par la troupe, sauf en Vendée où toute une colonne est défaite au Pont-Charrault, marquant le début de la guerre de Vendée. Encore quelques jours, et l’ensemble de la Vendée sera aux mains des émeutiers, qui se sont donnés des chefs militaires à même de les organiser pour s’opposer victorieusement aux troupes de la Convention : Sapineau, Cathelineau, d’Elbée, Bonchamps, Stofflet, Charette, Royrand, puis, plus tard, pour remplacer d’Elbée, Henri La Rochejacquelein.
La Terreur est le produit, en 1792-1793, de la rencontre, en un certain nombre d’hommes de deux sentiments puissants : l’appétit du pouvoir et la peur […] Le second a fait irruption en Vendée, dès la première vraie bataille, celle du Pont Charrault, non loin de Saint Fulgent, au soir du 19 mars 1793. Là naquit la peur, sous sa forme la plus élémentaire, viscérale, hideuse, humiliante. Les gardes nationaux conduits par le général Marcé se virent, ce jour-là, entourés d’être qu’ils ignoraient, farouches, hirsutes, les chargeant à l’arme blanche et les décimant avec une hargne que les fusils, les canons mêmes, se révélèrent incapables de contenir. […] La peur de ces hommes fit la Vendée ; elle créa le premier mythe – il y en eut d’autres – de la Vendée, car comment justifier sa peur, c’est-à-dire : comment recouvrer quelque estime de soi quand on s’est laissé aller à une telle frousse sinon en grossissant les causes même de l’épouvante que l’on a montrée.
Et rien n’est plus redoutable qu’un homme qui a peur, car il n’aura de cesse, pour la conjurer, d’en inspirer une plus grande encore. Nous en avons un exemple, lorsqu’au lendemain du désastre de Pont Charrault, les survivants, à peine de retour à La Rochelle, y massacrèrent les prêtres et les quelques royalistes ayant eu la malchance de se trouver, ce jour-là, dans les prisons de la ville.
Jean Huguet. Un Cœur d’étoffe rouge. Robert Laffont 1985
6 04 1793
Institution du Comité de Salut Public : les Douze, qui ne seront rapidement plus que onze, Hérault de Séchelles étant rapidement exécuté comme trop proche de Danton. Ils siègent au pavillon de Flore, au Jardin des Tuileries. Un couloir donne accès au théâtre des Tuileries, où se tiennent les séances de la Convention. Il devient l’organe essentiel du gouvernement révolutionnaire.
- Barère 1755-1841
- Saint Just 1767-1794
- Robespierre 1758-1794
- Carnot 1753-1823
- Billaud-Varenne 1756-1819
- Couthon 1755-1794
- Jeanbon Saint-André 1749-1813
- Prieur de la Marne 1756-1827
- Collot d’Herbois 1749-1796
- Lindet 1746-1825
- Prieur de la Côte d’Or 1763-1832
13 04 1793
Les Girondins de la Convention mettent Marat en accusation. Mais il va être acquitté triomphalement.
23 04 1793
Les sans culottes se donnent une identité ; le mot existe depuis presque un an, qui désigne celui qui porte le pantalon de l’ouvrier ou de la petite bourgeoisie, et non la culotte de l’aristocrate.
Un sans-culotte, messieurs les coquins, c’est un être qui va toujours à pied, […] et qui loge tout simplement avec sa femme et ses enfants, s’il en a, au quatrième ou au cinquième étage. Il est utile, car il sait labourer un champ, forger, scier, limer, couvrir un toit, faire des souliers, et verser jusqu’à la dernière goutte de son sang pour le salut de la République. Le soir, il se présente à sa section, non pas poudré, musqué, botté, dans l’espoir d’être remarqué de toutes les citoyennes des tribunes, mais bien pour appuyer de toute sa force les bonnes motions, et pulvériser celles qui viennent de la faction abominable des hommes d’État.
Anonyme
Et il est bien vrai que l’activisme citoyen tournait à plein régime : 5 500 sociétés politiques sur l’ensemble du territoire ; 62 % des chefs lieu de cantons en sont pourvus ; 15 à 25 % de femmes en leur sein. On pétitionne à tout va, au point d’inquiéter les professionnels, bien embarrassés par cette surprenante expression de la citoyenneté.
18 05 1793
Réquisitions, impôts, arrestations de prêtres, saisies des biens et denrées font gronder les paysans savoyards : le Haut Faucigny, l’Albanais, Chambéry, Cluses, Faverges se soulèvent. Le plus spectaculaire fût à Thônes où la bataille fit rage… les troupes françaises finirent pas avoir le dessus : on pilla, brûla et égorgea pendant trois jours ; Marguerite Frichelet Avet, intrépide meneuse, fût exécutée sur le Pâquier, à Annecy.
Les produits alimentaires se vendent à des cours de plus en plus élevé, la hausse s’étend à toutes les denrées. Un ancien prêtre, Jacques Roux, va déclarer le 21 juin à la Commune de Paris : Qu’est-ce que la liberté quand une classe d’hommes peut, par son monopole, exercer le droit de vie et de mort sur ses semblables ? Liberté, Égalité, République, tout cela n’est plus qu’un fantôme…Le prix exorbitant des denrées, qui de jour en jour s’accroît au point que les trois quart des citoyens peuvent à peine l’atteindre, n’est-il pas de tous les moyens propres à opérer la contre révolution, le plus certain et le plus funeste ?
24 05 1793
Charles Bonaparte qui a suivi un temps Pascal Paoli, est mort voilà huit ans. En principe c’est sur l’ainé des enfants que repose alors la charge de la famille, mais dans la famille Bonaparte ce rôle revient au second : Napoléon qui, lui, ne suit pas du tout Pascal Paoli, en flirt permanent avec l’Angleterre, mais se bat pour la Révolution française. Les partisans des Paoli le prennent très mal et incendient la maison des Bonaparte à Ajaccio.
26 05 1793
Pascal Paoli entraîne la Corse dans la révolte contre le pouvoir révolutionnaire français, sur une toile de fond toujours d’actualité : les chefs de clan se brouillent et se réconcilient avec une mobilité et une inconstance incroyable. La liberté de la majorité des insulaires et l’argent du Trésor français paient toujours les frais de leurs querelles…
Comte de Volney. Enquête pour la Convention. 1793
2 06 1793
Marat, se faisant le relais des sans culottes qui ont fait irruption au sein de la Convention, obtient de celle-ci l’arrêt de 29 députés girondins.
11 06 1793
La famille Bonaparte quitte la Corse pour se réfugier dans un premier temps près de Toulon, puis près de Marseille. Napoléon s’en souviendra quand, quelques mois avant sa mort, vingt-huit ans plus tard, il confiera au général Bertrand : La Corse n’est pour la France qu’un inconvénient, une verrue qu’elle a sur le visage.
24 06 1793
La nouvelle constitution de l’An I de la première République débute par une nouvelle Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui se distingue de celle de 1789 par son exigence d’égalitarisme : elle ne sera jamais appliquée. Et pour cause : les articles 27, 33, 34 et 35 étaient pour n’importe quel gouvernement l’équivalent d’une balle dans le pied en légitimant la plupart des révoltes et révolutions. Mais c’était une légitimation des événements du 10 août 1792 : la chute de la monarchie.
Le peuple français, convaincu que l’oubli et le mépris des droits naturels de l’homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d’exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur l’objet de sa mission. – En conséquence, il proclame, en présence de l’Être suprême, la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoyen.
Article 1. – Le but de la société est le bonheur commun. – Le gouvernement est institué pour garantir à l’homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.
Article 2. – Ces droits sont l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.
Article 3. – Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.
Article 4. – La loi est l’expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.
Article 5. – Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d’autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.
Article 6. – La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu’il te soit fait.
Article 7. – Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s’assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. – La nécessité d’énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.
Article 8. – La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.
Article 9. – La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent.
Article 10. – Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par l’autorité de la loi, doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 11. – Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l’exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.
Article 12. – Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, seraient coupables, et doivent être punis.
Article 13. – Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 14. – Nul ne doit être jugé et puni qu’après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu’elle existât serait une tyrannie ; l’effet rétroactif donné à la loi serait un crime.
Article 15. – La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.
Article 16. – Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
Article 17. – Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l’industrie des citoyens.
Article 18. – Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n’est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu’un engagement de soins et de reconnaissance, entre l’homme qui travaille et celui qui l’emploie.
Article 19. – Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Article 20. – Nulle contribution ne peut être établie que pour l’utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l’établissement des contributions, d’en surveiller l’emploi, et de s’en faire rendre compte.
Article 21. – Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.
Article 22. – L’instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l’instruction à la portée de tous les citoyens.
Article 23. – La garantie sociale consiste dans l’action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.
Article 24. – Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n’est pas assurée.
Article 25. – La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.
Article 26. – Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une entière liberté.
Article 27. – Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l’instant mis à mort par les hommes libres.
Article 28. – Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.
Article 29. – Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.
Article 30. – Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.
Article 3 1. – Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n’a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.
Article 32. – Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l’autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.
Article 33. – La résistance à l’oppression est la conséquence des autres Droits de l’homme.
Article 34. – Il y a oppression contre le corps social lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.
Article 35. – Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.
30 06 1793
Les révolutionnaires officient à l’abbaye de Talloires, sur les bords du lac d’Annecy : On brûla pendant trois jours et trois nuits, chroniques du Moyen Âge, chartes, manuscrits, incunables, éditions rares, peintures, tableaux, sculptures sur bois, meubles anciens, vases sacrés, orfèvrerie, brocarts d’argent et d’or, toutes les archives et trésors inestimables accumulés pendant 8 siècles. Seules quelques épaves furent sauvées par les notables du bourg qui surent corrompre par la bonne chère et l’or les officiers municipaux chargés de cette œuvre de vandalisme. Peu après les révolutionnaires décidèrent que pour empêcher les cloches de la vieille abbaye de sonner, il fallait les détruire. Le grand clocher tomba de si haut que le démolisseur disait qu’il n’avait pas pu le mesurer.
D. Barlone. Talloires à travers les siècles. 1991.
06 1793
Dans l’ouest, les prêtres réfractaires sont arrêtés massivement : 73 prêtres sont acheminés vers Nantes, 1 494 vers Bordeaux et 827 vers Rochefort.
12 07 1793
Première expérience du télégraphe optique de Claude Chappe : un message est transmis de Belle ville à Saint Martin du Tertre, à 35 kilomètres, avec un relais à Écouen. Le succès entraîne le vote par la constitution d’un réseau, à commencer par celui de Paris à Lille qui permettra de connaître presque en temps réel la victoire des soldats de l’an II, à Condé sur l’Escaut. Chappe sera alors proclamé bienfaiteur de la Patrie, ce qui ne l’empêchera pas de se suicider le 23 janvier 1805, face aux difficultés rencontrées pour commercialiser son invention. Il faudra à peu près une trentaine d’années pour le mettre en place : une dépêche de 25 mots pouvait parvenir de Paris à Strasbourg en 6 heures par l’intermédiaire des 52 relais établis sur des sites élevés réquisitionnées par l’État, 4 h 30 pour Paris-Montpellier. Ces sémaphores étaient distants de 10 à 20 km, coiffés d’un mât sur lequel pivotent des bras de bois qui peuvent prendre différentes positions, signifiant des lettres ou des mots. Chaque tour dispose de deux télescopes pointant des deux côtés de la ligne. En 1832, ce sera le seul système de transmission de ce type au monde. À son apogée le télégraphe optique de Chappe compte 535 tours sur près de 5 000 kilomètres de réseau : deux grandes lignes : la Toulon-Marseille-Lyon-Paris, et la Bayonne-Paris, et, à partir de 1834, la transversale Avignon-Narbonne Toulouse-Bordeaux, puis en 1840, la Narbonne-Perpignan, justifiée par l’augmentation du trafic entraîné par la conquête de l’Algérie ; le monopole d’État qui en est à l’origine deviendra un frein pour les autres innovations à venir, tel le système télégraphique de Morse, qui se développera beaucoup plus librement en Angleterre et aux États-Unis.
13 07 1793
Charlotte Corday, fille de Pierre Corneille à quatre générations – bon sang ne saurait mentir -, assassine Marat. Elle est plus petite que lui, mais sait qu’elle le trouvera dans son bain, dont il fait un fréquent usage pour soulager une dermatose sévère due au champignon Malasezzia, avec une surinfection et présence massive de staphylocoques dorés qui faisaient de lui un condamné – Marat était physicien et médecin, et avant de répandre la terreur, soignait les belles marquises en leur pratiquant des étincelages -. Admiratrice des Girondins, elle se vengea ainsi de la récente arrestation de 29 d’entre eux. Son geste lui vaudra la guillotine. Sur le tableau qu’en a fait David, Le divin Marat, la poitrine blessée par une main sacrilège, on le voit tenir encore à la main un feuillet du billet qu’elle lui a remis : du 13 juillet 1793, Marie Anne Charlotte Corday au citoyen Marat. Il suffit que je sois bien malheureuse pour avoir droit à votre bienveillance.
![Jean-Paul Marat a été assassiné dans son bain par la révolutionnaire girondine Charlotte Corday. [Mort de Marat - Tableau de Jacques-Louis David (1793), conservé au Musée des Beaux-Arts de Belgique]](https://static.cnews.fr/sites/default/files/styles/image_640_360/public/xvmb6842d84-84f4-11e8-9994-b5e049951fd7-300x300_5dc57042437f2.jpg?itok=TeYvSfEZ)
Mort de Marat – Jacques-Louis David (1793), Musée des Beaux-Arts de Belgique

L’assassinat de Marat, par Jean Joseph Weerts. 1880
Lors de son procès : Marat pervertissait la France. J’ai tué un homme pour en sauver cent mille, un scélérat pour sauver des innocents, une bête féroce pour donner le repos à mon pays. J’étais républicaine bien avant la Révolution.
ODE À MARIE-ANNE-CHARLOTTE CORDAY
Quoi ! tandis que partout, ou sincères ou feintes,
Des lâches, des pervers, les larmes et les plaintes
Consacrent leur Marat parmi les immortels ;
Et que, prêtre orgueilleux de cette idole vile,
Des fanges du Parnasse, un impudent reptile
Vomit un hymne infâme au pied de ses autels ;
La Vérité se tait ! Dans sa bouche glacée,
Des liens de la peur sa langue embarrassée
Dérobe un juste hommage aux exploits glorieux !
Vivre est-il donc si doux ? De quel prix est la vie,
Quand sous un joug honteux la pensée asservie,
Tremblante, au fond du cœur se cache à tous les yeux ?
Non, non, je ne veux point t’honorer en silence,
Toi qui crus par ta mort ressusciter la France,
Et dévouas tes jours à punir des forfaits.
Le glaive arma ton bras, fille grande et sublime,
Pour faire honte aux Dieux, pour réparer leur crime,
Quand d’un homme à ce monstre ils donnèrent les traits.
Le noir serpent sorti de sa caverne impure,
A donc vu rompre enfin sous ta main ferme et sûre
Le venimeux tissu de ses jours abhorrés !
Aux entrailles du tigre, à ses dents homicides,
Tu vins redemander et les membres livides,
Et le sang des humains qu’il avait dévorés !
Son œil mourant t’a vue, en ta superbe joie,
Féliciter ton bras, et contempler ta proie.
Ton regard lui disait : Va, tyran furieux,
Va, cours frayer la route aux tyrans tes complices.
Te baigner dans le sang fut tes seules délices ;
Baigne-toi dans le tien et reconnais tes Dieux.
La Grèce, ô fille illustre, admirant ton courage,
Épuiserait Paros, pour placer ton image
Auprès d’Harmodios, auprès de son ami ;
Et des chœurs sur ta tombe, en une sainte ivresse,
Chanteraient Némésis, la tardive Déesse,
Qui frappe le méchant sur son trône endormi.
Mais la France à la hache abandonne ta tête,
C’est au monstre égorgé qu’on prépare une fête,
Parmi ses compagnons, tous dignes de son sort.
Oh ! quel noble dédain fit sourire ta bouche,
Quand un brigand, vengeur de ce brigand farouche,
Crut te faire pâlir aux menaces de mort !
C’est lui qui dut pâlir ; et tes juges sinistres,
Et notre affreux sénat, et ses affreux ministres,
Quand, à leur tribunal, sans crainte et sans appui,
Ta douceur, ton langage et simple et magnanime,
Leur apprit qu’en effet, tout puissant qu’est le crime,
Qui renonce à la vie est plus puissant que lui.
Longtemps, sous les dehors d’une allégresse aimable,
Dans ses détours profonds ton âme impénétrable
Avait tenu cachés les destins du pervers.
Ainsi, dans le secret amassant la tempête,
Rit un beau ciel d’azur, qui cependant s’apprête
À foudroyer les monts, et soulever les mers.
Belle, jeune, brillante, aux bourreaux amenée,
Tu semblais t’avancer sur le char d’hyménée,
Ton front resta paisible, et ton regard serein.
Calme sur l’échafaud, tu méprisas la rage
D’un peuple abject, servile, et fécond en outrage,
Et qui se croit alors et libre et souverain.
La vertu seule est libre. Honneur de notre histoire,
Notre immortel opprobre y vit avec ta gloire,
Seule tu fus un homme, et vengeas les humains.
Et nous, eunuques vils, troupeau lâche et sans âme,
Nous savons répéter quelques plaintes de femme,
Mais le fer pèserait à nos débiles mains.
Non ; tu ne pensais pas qu’aux mânes de la France
Un seul traître immolé suffit à sa vengeance,
Ou tirât du chaos ses débris dispersés.
Tu voulais, enflammant les courages timides,
Réveiller les poignards sur tous ces parricides,
De rapine, de sang, d’infamie engraissés.
Un scélérat de moins rampe dans cette fange.
La vertu t’applaudit. De sa mâle louange
Entends, belle héroïne, entends l’auguste voix.
Ô vertu, le poignard, seul espoir de la terre,
Est ton arme sacrée, alors que le tonnerre
Laisse régner le crime, et te vend à ses lois !
André Chénier, lui aussi guillotiné, le 7 thermidor an II (25 juillet 1794).
Le corps de Marat, embaumé, dont les yeux demeuraient grands ouverts, était placé sur un lit, avec la bouche ouverte. Il paraît que l’on avait dû couper un morceau de la langue qui dépassait.
Il fut recouvert d’un drapeau tricolore. La rigidité cadavérique empêchant de prendre l’attitude imaginée par David, on emprunta le bras d’un autre cadavre et on lui mit en main une plume de fer, symbole de l’écrivain patriote. Bras, main et plume dépassaient du drapeau tricolore recouvrant le corps. Mme de Créqui affirme dans ses souvenirs que l’adulation de la foule fut telle que le troisième bras se détacha, à la stupeur, pour ne pas dire l’horreur, des assistants proches du catafalque. Il faisait heureusement nuit quand cet incident grand-guignolesque se produisit.
La sépulture était prévue au centre du jardin de l’ancien couvent des Cordeliers. C’était trop près du domicile de Marat où on avait ramené son corps. Un cortège se forma vers 5 heures de relevée sous un soleil encore de plomb : Le corps sur un lit de parade porté par des hommes. La baignoire suivait portée par des femmes, d’après l’article du journal Le Thermomètre du Jour du 19 juillet 1793. Corps et baignoire précèdent une foule qui, dans une cohue invraisemblable, crie, pleure ou même rit.
Ce que le journaliste désigne par une baignoire est en réalité un sarcophage de porphyre en provenance du Louvre. À pas très lents, la procession prend l’itinéraire suivant : la rue de Thionville (rue Dauphine actuelle), le Pont-Neuf, le quai de la Ferraille, le pont au Change, pour s’arrêter plus longuement à la place du Théâtre-Français (Odéon actuel). Très souvent le cortège fait halte, ce qui permet d’arroser discrètement mais copieusement de vinaigre aromatisé le corps putréfié du héros de la soirée. Il est minuit quand, à la lueur des flambeaux (on a dépensé mille neuf cent quatre livres de flambeaux et lampions), Thuriot, président de la Convention, prononce un discours. Le cortège arrive enfin dans le jardin des Cordeliers, et le corps de Marat est enterré dans son sarcophage sous une grotte formée de roches granitiques dont l’entrée, fermée par une grille, est surmontée d’une urne contenant son cœur. Ce monument avait été très rapidement construit par l’architecte J.-T. Martin.
Le citoyen Jullien, en guise d’absoute, prononça une prière blasphématoire, due à la plume d’un certain Brochet, ancien domestique, que nous retrouverons le lendemain parmi les jurés du Tribunal révolutionnaire, chargés de juger Charlotte Corday : O Cor Jesu ! O Cor Marat… Si Jésus fut un prophète, Marat est un Dieu !…
Jean Epois. L’affaire Corday Marat
17 07 1793
Charlotte Corday est guillotinée. Soudain un orage éclata. De larges gouttes de pluie vinrent s’écraser dans la poussière. La foule devint houleuse ; on entendait chanter La Carmagnole.
Soudain, on cria : La voilà ! La voilà ! Elle était superbe dans sa longue chemise rouge que la pluie plaquait contre son corps. On eût dit une statue tant son beau visage était calme. Derrière la charrette, des jeunes filles se tenaient par la main et dansaient. Je fus pendant huit jours au moins amoureux de Charlotte Corday.
Pierre Notelet, qui prenait le frais à sa fenêtre, au 404 de la rue Saint Honoré. Lettre à son frère
Autre personne se trouvant sur le passage du cortège, Adam Lux, député extraordinaire de Mayence ; il en tomba amoureux fou de Charlotte, écrivit un Éloge de 17 pages, que François Henri Désérable retrouvera dans un grenier, traduira et insérera partiellement dans Tu montreras ma tête au peuple, chez Gallimard 2013 : pareille déclaration ne pouvait être pardonnée : il sera lui-même raccourci le 4 novembre 1793 par le rasoir national : sa lettre était datée de ce jour.
Je n’ai pas assisté au procès. J’aurai voulu apercevoir Charlotte, mais la salle était chaque fois bondée, à tel point qu’il me fut impossible d’y entrer. Je voulais voir cette femme que Fabre d’Églantine avait décrite comme une virago plus charnue que fraîche, sans grâce, malpropre, comme le sont presque tous les philosophes et beaux esprits femelles. Je me méfiais du tableau esquissé par le médiocre poète. J’avais raison: Charlotte était sublime.
La première fois que je la vis, c’était à la sortie du palais de Justice. Quand la charrette traversa les grilles de la cour du Mai, le ciel de Paris devint gris, comme si la mine de Dieu s’assombrissait. Un déluge éclata ; il fit nuit en plein jour. Dans les cieux, les anges pleuraient ; debout, les mains derrière le dos, appuyée sur les ridelles, Charlotte accueillait chaque goutte avec un sourire qu’elle garderait tout au long du trajet.
Je courais au-devant de la charrette pour me poster à divers endroits, de façon à mieux la voir. Et quand elle arrivait devant moi, je recommençais, bousculant les uns, écartant les autres, indifférent aux insultes que je recueillais. Charlotte semblait ne prêter attention à personne. Elle regardait les gens aux fenêtres. Peut-être aperçut-elle, à l’une d’entre elles, Danton, Robespierre et Desmoulins, sans savoir que c’était eux. Je les vis, moi, observer la marche funèbre. L’Incorruptible paraissait agité, il parlait sans cesse, enlevait ses lunettes, les remettait, remuait nerveusement. Mais les deux autres, fascinés, ne l’écoutaient pas.
La charrette roulait depuis une heure quand, pour la première et dernière fois, le regard de Charlotte croisa le mien. Je restai pétrifié devant ses yeux en amande qui bientôt ne verraient plus que la fureur des ténèbres. Elle me fixa longtemps, peut-être dix secondes, pendant qu’une foule furieuse, visages en sueur, chevelures en désordre, chemises à demi-arrachées, l’insultait continuellement. Elle, si calme, gardait une douceur inaltérable au milieu des hurlements barbares, ce regard si doux, si pénétrant, ces étincelles vives et humides qui éclataient dans ces beaux yeux, ces yeux dans lesquels parlait une âme aussi tendre qu’intrépide, ces yeux qui auraient pu émouvoir les rochers.
Cependant la pluie continuait de tomber sur sa chemise rouge qui lui collait maintenant à la peau, faisant apparaître ses formes. On devinait ses courbes gracieuses, arrondies, ses seins fermes que sa respiration soulevait. Le visage impassible, la bouche figée dans un demi-sourire, le regard pur et fier traversant les nuages, Charlotte interrogeait l’immensité. Et elle semblait voir dans les fureurs des plus sombres ombrages briller l’éternelle clarté.
L’orage ne dura pas longtemps. Il semblait fuir devant elle. Chaque pas des chevaux la rapprochait de la mort, mais elle restait d’un calme absolu, comme si ce voyage n’avait d’autre but que de rendre visite à une vieille amie. Ce n’était qu’une illusion : sous la chemise, ses sens se soulevaient à une cadence de plus en plus soutenue : à mesure qu’on approchait, sa respiration s’accélérait. Quand la charrette eut atteint la place de la Révolution, le soleil revient. Au pied de l’échafaud, Charlotte descendit, fière, intrépide, le front paisible, le regard serein. Au moment où le bourreau lui arracha son fichu, sa pudeur en souffrit. Elle avança d’elle-même au-devant de la mort. Un huissier céleste appliqua les scellés sur mon cœur : je sus, dès ce instant, que personne au monde jamais plus n’y entrerait.
À l’automne 1793, tous les clubs de femme seront dissous.

A Caen en 1793, par Tony Robert Fleury 1838-1911 Musée Bonnat
À Lyon, c’est Joseph Chalier qui est guillotiné, pour le début de l’exécution, mais comme la machine avait des ratés, on le finira au sabre. Joseph Chalier était un révolutionnaire ardent dont un partisan était devenu maire de Lyon quatre mois plus tôt, le 8 mars. Une armée révolutionnaire avait été levée, donnant lieu à une nouvelle taxe, évidemment impopulaire. Une manifestation avait eu lieu le 29 mai, et la municipalité Chalier, suspendue le 30. Une autre, provisoire avait été mise en place, chassant les envoyés de la Convention et traduisant Chalier en justice, pour conclure sur une condamnation à mort. Dès lors, la Convention ne pouvait plus que faire la guerre à Lyon.
22 07 1793
Alexander Mackenzie, en descendant quatre ans plus tôt le fleuve auquel il laissa son nom, restait quelque peu frustré, car son intention de départ était bien de trouver la rivière qui, prenant sa source dans les Rocheuses, mènerait au Pacifique, c’est à dire à un possible point d’embarquement des fourrures pour l’Asie, et essentiellement la Chine. Il était de nouveau reparti de Fort Chipeway le 10 juillet 1792, remontant la rivière de la Paix, sur le versant est des Rocheuses et passant l’hiver dans une cabane de rondins. Au mois de mai, des indiens lui indiquent comment regagner la Bella Coola River, qui se jette dans le Pacifique au nord-ouest de Vancouver par 52°21’N. Il écrit sur un rocher : Alexander Mackenzie, venu du Canada, par terre, Le vingt-deux juillet dix-sept cent quatre-vingt-treize.
Mackenzie a traversé l’Amérique du Nord dans sa plus grande largeur, s’imposant aux Indiens par son courage et par son endurance, attirant les pacifiques et négociant habilement avec eux, tenant en respect les malintentionnés. Au moment de toucher au but, il fût pris à partie par des groupes hostiles qui avaient reçu des coups de fusil des gens de Vancouver. Il les réduisit au silence sans effusion de sang, par la seule force de sa personnalité. Mais la route qu’il découvrit était inexploitable pour un trafic commercial. Elle avait cependant plus que la valeur d’un symbole, grâce aux documents topographiques et ethnographiques qu’il rapportait et à ses observations sur les Rocheuses. Passé plus tard à la Compagnie du Nord-Ouest, il engagea celle-ci à s’assurer les services du topographe David Thompson qui découvrit au commencement du XIX° siècle la route cherchée par les chasseurs de fourrures.
Pierre Jacques Charliat. Les Explorateurs. 1955
26 07 1793
L’avocat toulousain Bertrand Barère appelle du haut de la tribune de la Convention les troupes en charge de la guerre de Vendée à plus de vigueur et de rage : Cette guerre devient extraordinaire et inexplicable… C’est un cancer politique qui creuse dans l’État une plaie profonde… Cette guerre se compose de petits succès et de grands revers… Votre armée ressemble à celle du roi de Perse : elle traîne 120 voitures de bagages, tandis que les brigands marchent avec leur arme et un morceau de pain noir dans leur sac… Jamais vous en parviendrez à les vaincre tant que vous ne vous rapprocherez pas de leur manière de combattre… Faites la récolte des brigands et portez le feu dans leurs repaires…
07 1793
Une importante mission diplomatique anglaise dirigée par Lord Macartney arrive en Chine… mission diplomatique plutôt musclée, car forte de 700 soldats. N’ayant pas voulu prendre la mesure de l’importance des rites confucéens de présentation, Lord Macartney ne s’était pas plié au kowtow – le salut devant l’empereur – et cela n’avait fait qu’attiser les susceptibilités de chaque camp. Il s’agit de demander à la Chine quels sont les biens que pourraient bien lui fournir l’Angleterre, pour rééquilibrer un peu la balance commerciale entre ces deux grandes puissances, par trop favorable à la Chine, estiment les Anglais. L’empereur de Chine, Quianlong est profondément persuadé d’être à la tête de la première puissance mondiale – il est vrai que Canton est la première place commerciale du monde – et estime que le roi d’Angleterre George III est son vassal. Il confie à l’ambassadeur une lettre pour le roi George III : Notre empire céleste possède toutes choses en abondance et ne manque de rien dans ses frontières. Il n’y a donc nulle nécessité d’échanger les produits des barbares étrangers contre les nôtres. Lord Macartney repart donc bredouille, mais profondément vexé. Les choses n’iront pas en s’arrangeant jusqu’à ce que les Chinois réalisent, quarante ans plus tard, que l’empire avait déjà des pieds d’argile et que l’empereur ne voulait pas le voir, qu’en matière d’armement ils avaient des décennies, pour ne pas dire des siècles de retard sur l’Angleterre.
1 08 1793
Instauration d’un système métrique unique, dans tout le pays. Lakanal tente de créer une ligne de diligences Paris – Lille, en seize relais.
Marie-Antoinette est transférée à la Conciergerie, l’antichambre de la mort, partie médiévale du Palais de Justice, devenue prison quand le Palais de la Cité cessa d’être résidence royale, en 1392. Le concierge était alors le dignitaire en charge de la garde de la résidence royale. C’est l’équivalent de nos actuels QHS : Quartier de Haute Sécurité.
Cette marche accélérée vers la mort laisse indifférent son neveu, l’empereur d’Autriche qui ne lèvera pas le petit doigt pour la secourir. Ne restait dès lors à ses amis, au premier rang desquels le comte Fersen, que la corruption pour monter des tentatives d’évasion : tout comme au Temple, elles échoueront, démasquées par ceux qui n’avaient pas été achetés.
La République en guerre contre le reste de l’Europe a besoin de plomb pour fabriquer des balles. Les cercueils de la basilique de Saint-Denis en contiennent beaucoup. Donc la profanation des tombes royales peut avoir une utilité : l’idée en revient à Barère, qui, au nom du Comité de salut public, propose à la Convention nationale de détruire les tombes royales pour fêter le premier anniversaire de la prise des Tuileries, 10 août 1792. D’où le décret du 1° août 1793 : Les tombeaux et mausolées des ci-devant rois, élevés dans l’église de Saint-Denis, dans les temples et autres lieux, dans toute l’étendue de la République, seront détruits le 10 août prochain.
Le même Barère occupe encore la tribune de la Convention, et il s’agit toujours de la Vendée : cette fois-ci, le mot exterminer est prononcée : Représentants, le Comité de Salut public a préparé des mesures qui tendent à exterminer cette race rebelle, à faire disparaître leurs repaires, à incendier leurs forêts, à couper leurs récoltes. C’est dans les plaies gangrenantes que la médecine porte le fer et le feu, c’est à Mortagne, à Cholet, à Chemillé que la médecine politique doit employer les mêmes moyens et les mêmes remèdes : c’est faire le bien que d’extirper le mal ; c’est être bienfaisant pour sa patrie que de punir les révoltés… Louvois fut accusé par l’Histoire d’avoir incendié le Palatinat, et Louvois devait être accusé : il travaillait pour les tyrans. Le Palatinat de la République, c’est la Vendée ; détruisez-la, et vous sauvez la patrie.
Car c’est avec la Vendée que correspondent les aristocrates, les fédéralistes, les départementaires et les sectionnaires, c’est à la Vendée que se reportent les vœux coupables de Marseille, la vénalité honteuse de Toulon, les mouvements de l’Ardèche, les troubles de la Lozère, les conspirations de l’Eure et du Calvados, les espérances de la Sarthe et de la Mayenne, le mauvais esprit d’Angers et les sourdes agitations de quelques départements de l’ancienne Bretagne…
Représentants, détruisez la Vendée, Valenciennes et Condé ne sont plus au pouvoir de l’Autrichien ! Détruisez la Vendée, l’Anglais ne s’occupera plus de Dunkerque ! Détruisez la Vendée, l’Espagne se verra harcelée, conquise par les méridionaux joints aux soldats victorieux de Mortagne et de Cholet ! Détruisez la Vendée, et Lyon ne résistera plus, Toulon s’insurgera contre les Espagnols et les Anglais et l’esprit de Marseille se relèvera à la hauteur de la révolution républicaine ! Enfin, chaque coup que vous porterez à la Vendée retentira dans les villes rebelles, dans les départements fédéralistes et dans les frontières envahies…
En suite de quoi fut prononcé le décret du même jour :
[…] Article VI Il sera envoyé par le ministre de la Guerre des matières combustibles de toutes espèces pour incendier les taillis et les genêts.
Article VII Les forêts seront abattues, les repaires des rebelles seront détruites, les récoltes coupées, les bestiaux saisis.
Article VIII Les femmes, les enfants et les malades seront conduits à l’intérieur ; il sera pourvu à leur subsistance et à leur sureté avec tous les égards dus à l’humanité.
6, 7, 8 08 1793
Trois jours de saccage à l’abbaye de Saint Denis. En fait, ces trois jours n’y suffiront pas ; il y aura un arrêt puis les travaux reprendront du 12 octobre au 25 octobre. Tous les tombeaux en plomb sont fondus pour l’armée. On dénombre 54 corps dans le caveau des Bourbons. On s’occupera ensuite des Valois, des Carolingiens, des Mérovingiens. Tous les corps sont sortis de leur cercueil pour être déposés dans une fosse commune creusée à cet effet, et bien pourvue en chaux. Le 21 janvier 1817, ce qui reste des rois et reines de France sera à nouveau exhumé pour être entassé dans une dizaine de coffres placés dans un ossuaire. Louis XVIII en profite pour rapatrier également les restes de son frère Louis XVI et de Marie Antoinette du cimetière de la rue d’Anjou.
Le corps de Turenne, très bien conservé – il est mort en 1675 – est exposé dans la sacristie de Saint Denis, où le gardien vend les dents, puis en juin 1794, au Jardin des Plantes, avant de rejoindre les Invalides en 1800. Henri IV sauve sa tête, car elle est volée. Elle va beaucoup voyager : on la sait chez un comte allemand au XIX° siècle ; vendue à Drouot en 1919 à un antiquaire de Dinard, celui-ci la propose au Louvre en 1947, qui la refusera ; elle sera vendue en 1955 à un couple de retraités de Montmartre, lesquels la légueront en 2008 à Louis de Bourbon, duc d’Anjou, qui la fera authentifier par le Dr Philippe Charlier, médecin légiste de Garches. Le duc d’Anjou souhaite lui faire réintégrer Saint Denis. 51 statues furent soit détruites, soit seulement endommagées : il s’agissait en fait plutôt de démantèlement, effectué méticuleusement : on s’attaquait au nez et aux yeux pour que les souverains ne puissent plus ni voir ni sentir, on mutilait les attributs de leur pouvoir : mains, couronne, sceptre pour les empêcher de récupérer leur trône. Mais nombreuses furent les statues de marbre et de pierre sauvées et conservées grâce à Alexandre Lenoir, conservateur du Musée des Monuments français, anciennement couvent des Petits Augustins, où l’on rassemblait les prises de guerre. Il s’était résolument engagé dans la défense du patrimoine. Bien sûr, Napoléon nommera tout cela autrement : Le musée Napoléon (autre nom du musée des Monuments français) ne contenait que des objets légitimement acquis, soit par de l’argent, soit par les conditions de traité de paix, en vertu desquels ces chefs d’œuvre furent donnés en échange de cession de territoires ou de contributions.
Napoléon. Mémorial de Sainte Hélène.
On reconnut ce monarque [Louis XIV], sa haute taille, son âge au temps de sa mort et ces mêmes traits caractéristiques que les arts ont fait revivre. Le corps, bien conservé, était d’une couleur d’ébène. On développa une très longue bandelette qui entourait le cou pour mieux assujettir la tête. Il semblait que, jusque dans la mort, ce prince commandait le respect et que, par la sévérité de ses traits, il menaçait alors ses profanateurs. Incertains quelques instants, et bientôt indignés de cette majesté survivante à elle-même, ils s’empressèrent de précipiter le corps dans la fosse commune. Il tomba sur celui de Henri IV, le couvrit presque tout entier. Plusieurs descendirent dans la fosse avec une échelle […]. Il me fallut feindre l’indifférence du vulgaire en portant la main sur la bouche de Louis XIV pour détacher furtivement une de ses dents. Ce fut sans succès, à cause de l’adhérence des lèvres. Enfin, après un moment d’hésitation, je saisis à la main droite un ongle qui se détacha facilement […]. Je vis descendre une charretier du dépôt, dont le dessein n’était pas équivoque. C’était pour outrager de nouveau Louis XIV […]. Cet homme fit avec son couteau une large entaille au ventre du prince. Il en retira une grande quantité d’étoupe qui remplaçait les entrailles et servait à tenir les chairs. Avec le même instrument, il ouvrit la bouche, qui était aussi garnie d’étoupe. Ce spectacle donna lieu aux bruyantes et insultantes acclamations de la multitude […].Tous ceux qui restaient dans le caveau, plus ou moins conservés, vinrent ensuite combler cet abîme, qui parut engloutir, avec ces rois, toutes les générations qu’ils avaient gouvernées. La chaux vive fût employée pour consumer jusqu’aux éléments de ces corps que le temps avait épargnés.
Henri-Martin Manteau
Chez nous, en 1793, on viole le tombeau du roi Dagobert, après avoir brisé sa statue, et celle de la reine Berthilde, sa femme ; on disperse ces ossements qui y dormaient depuis 638. Puis c’est Clovis, dans la croisée du chœur, ensuite le frère de Charlemagne, ensuite Eudes ; après le grand Hugues Capet, c’est Henri I°, Louis VI le Gros, tous les tombeaux du temps de Saint Louis ; Philippe le Hardi est arraché à son coffre de plomb ; Louis X le Hutin, Jeanne de Laval, Philippe V le Long, Jeanne de Bourgogne, Charles le Bel, Philippe de Valois, Charles V, VI, VII, VIII, le roi Jean, Henri II, Catherine de Médicis, couchés en habits royaux, sont tirés de leur sommeil majestueux. Avec Du Guesclin et Turenne, Henri IV est dépouillé de son suaire. Louis XIII, reconnaissable à sa barbiche et à sa petite moustache, Louis XIV noir comme de l’encre, Louis XV en putréfaction, sont précipités au charnier. Les mains de justice, les quenouilles, se mêlent aux os, les couronnes et les croix aux lambeaux de chair, hors des suaires de cuir et de plomb, hors des draps dorés tout empouacrés de sanie : voilà ce que la France a fait de ses rois ! […] Sous le vent abstrait de l’Esprit, la France dessèche, détruit et recommence sans cesse ses expériences.
Paul Morand. Londres. 1933
Évidemment, depuis, comme le dit Julos Beaucarne, les choses ont bien changé, sais-tu ?
J’voudrais faire un slam pour une grande dame que j’connais depuis tout petit
J’voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi
J’voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j’ai grandi
J’voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu’on appelle Saint-Denis
Prends la ligne D du RER et erre dans les rues sévères d’une ville pleine de caractère
Prends la ligne 13 du métro et va bouffer au McDo ou dans les bistrots d’une ville pleine de bonnes gos et de gros clandos
Si t’aimes voyager, prends le tramway et va au marché. En une heure, tu traverseras Alger et Tanger.
Tu verras des Yougos et des Roms, et puis j’t’emmènerais à Lisbonne
Et à 2 pas de New-Deli et de Karashi (t’as vu j’ai révisé ma géographie), j’t’emmènerai bouffer du Mafé à Bamako et à Yamoussoukro
Et si tu préfères, on ira juste derrière manger une crêpe là où ça sent Quimper et où ça a un petit air de Finistère
Et puis en repassant par Tizi-Ouzou, on finira aux Antilles, là où il y a des grosses re-noi qui font « Pchit, toi aussi kaou ka fé la ma fille ! »
Au marché de Saint-Denis, faut que tu sois sique-phy. Si t’aimes pas être bousculé tu devras rester zen
Mais sûr que tu prendras des accents plein les tympans et des odeurs plein le zen
Après le marché on ira ché-mar rue de la République, le sanctuaire des magasins pas chers
La rue préférée des petites rebeus bien sapées aux petits talons et aux cheveux blonds peroxydés
Devant les magasins de zouk, je t’apprendrai la danse. Si on va à la Poste j’t’enseignerai la patience…
La rue de la République mène à la Basilique où sont enterré tous les rois de France, tu dois le savoir ! Après Géographie, petite leçon d’histoire
Derrière ce bâtiment monumental, j’t’emmène au bout de la ruelle, dans un petit lieu plus convivial, bienvenu au Café Culturel
On y va pour discuter, pour boire, ou jouer aux dames. Certains vendredi soir, y’a même des soirées Slam
Si tu veux bouffer pour 3 fois rien, j’connais bien tous les petits coins un peu poisseux
On y retrouvera tous les vauriens, toute la jet-set des aristocrasseux
Le soir, y’a pas grand chose à faire, y’a pas grand chose d’ouvert
À part le cinéma du Stade, où les mecs viennent en bande : bienvenue à Caillera-Land
Ceux qui sont là rêvent de dire un jour je pèse ! et connaissent mieux Kool Shen sous le nom de Bruno Lopez
C’est pas une ville toute rose mais c’est une ville vivante. Il s’passe toujours quelqu’chose, pour moi elle est kiffante
J’connais bien ses rouages, j’connais bien ses virages, y’a tout le temps du passage, y’a plein d’enfants pas sages, j’veux écrire une belle page, ville aux cent mille visages, St-Denis-centre mon village
J’ai 93 200 raisons de te faire connaître cette agglomération. Et t’as autant de façons de découvrir toutes ses attractions.
À cette putain de cité j’suis plus qu’attaché, même si j’ai envie de mettre des taquets aux arracheurs de portables de la Place du Caquet
Saint Denis ville sans égal, Saint Denis ma capitale, Saint Denis ville peu banale.. où à Carrefour tu peux même acheter de la choucroute Hallal !
Ici on est fier d’être dyonisiens, j’espère que j’t’ai convaincu. Et si tu m’traites de parisien, j’t’enfonce ma béquille dans l’…
J’voudrais faire un slam pour une grande dame que j’connais depuis tout petit
J’voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi
J’voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j’ai grandi
J’voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu’on appelle Saint Denis.
Grand Corps Malade. 2006
Donc, les choses ont bien changé, mais après Grand Corps Malade, elles changent encore, dans les années 2010, quand un maire communiste s’avise que ce Saint Denis de Grand Corps malade ne lui plaît guère, tout bien réfléchi, et s’avise que la basilique de Saint Denis serait mieux qu’aujourd’hui si demain on lui reconstruisait la deuxième tour dont elle était munie et qui avait été détruite au milieu du XIX° siècle. Ah la la, quel charivari !
La querelle autour de la restitution de la flèche, c’est le terme consacré, ne date pas d’hier. On peut même dire qu’elle remonte à sa déposition par l’architecte François Debret (1777-1850), alors chargé de la restauration de la basilique. Considéré comme une autorité en son temps, Debret avait repensé la façade occidentale, réaménagé l’intérieur très endommagé par la Révolution, et consolidé la flèche affaiblie par la foudre. Mais voilà qu’en 1845, une tempête secoue de nouveau la construction, haute de 81 mètres (le roi pouvait, dit-on, l’apercevoir depuis les terrasses de Saint Cloud). L’architecte décide de la démonter, non sans avoir au préalable réalisé un véritable travail de maquettiste. Il numérote les pierres, dessine les moindres détails, répertorie le plus petit piton, la plus modeste ardoise.
Son objectif : reconstituer l’ensemble à l’identique en le consolidant, comme il était d’usage à l’époque. C’était compter sans la hargne d’un autre architecte, jeune loup du patrimoine aux ambitions agressives. Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) accuse à hauts cris son confrère d’avoir utilisé des pierres trop lourdes. Dénigré, lâché par les politiques, Debret finit par démissionner, laissant la flèche en miettes, et ses plans dans des cartons.
Le temps passe, la ville de Saint Denis bascule à gauche, mais ses édiles ne se désintéressent pas de ce monument, tout clérical et teinté de monarchie soit-il. Dès le milieu des années 1980, le maire communiste Marcellin Berthelot s’empare du projet de restitution de la flèche, destiné à valoriser cette basilique située en plein cœur de la ville. Il le soumet à Jack Lang, qui ne dit pas non, mais pas vraiment oui non plus. L’affaire traîne, les plans restent en plan.
Son successeur, Patrick Braouezec, reprend le flambeau, mais la construction du Stade de France va vite mobiliser toutes les énergies. Il n’empêche, l’idée a la vie dure. Devenu président de la communauté d’agglomération Plaine Commune, M. Braouezec relance la machine en 2012, avec celui qui l’a remplacé à la tête de la ville, Didier Paillard. Les deux hommes constituent un comité de soutien plein de noms prestigieux, l’écrivain Erik Orsenna en tête, et sollicitent les services du patrimoine. Car non seulement la basilique est classée monument historique, mais elle appartient à l’État, seul habilité à donner une autorisation de travaux.
Le projet, estimé à 50 millions €, consiste à rendre la flèche à la basilique, et aux Dyonisiens, sans qu’il en coûte un sou à l’État. Comment ? En lançant un chantier école ouvert au public, et en utilisant des techniques anciennes. Les partisans de la restitution s’inspirent des expériences menées au château médiéval de Guédelon, dans l’Yonne, ou sur la frégate l’Hermione, à Rochefort (Charente-Maritime) : un chantier peut devenir un spectacle en lui-même et s’autofinancer en partie, grâce aux curieux qu’il attire.
Pour le reste, le comité dit avoir trouvé des mécènes. D’une pierre deux coups, donc. Ce qui nous intéresse, au-delà de la restitution de la flèche, souligne Patrick Braouezec, ce sont les possibilités d’insertion que peut offrir une telle entreprise pour le travail du vitrail, du bois, de la pierre, de la ferronnerie. Au moment où l’on cherche des sujets d’unité nationale, ce projet serait fédérateur.
Oui, mais le propriétaire ne l’entend pas de cette oreille. Notre principal obstacle, soupire M. Braouezec, c’est l’État. Aurélie Filippetti avait dit plutôt non, Fleur Pellerin plutôt rien du tout. À la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Ile-de-France, qui gère la basilique, on fait savoir que la question n’est pas d’actualité.
Les mauvaises langues soupçonnent l’administration du patrimoine, milieu réputé fermé, de bouder un projet qui n’est pas le sien. Mais ce sont d’abord des écoles de pensée qui s’affrontent. Ou plutôt, des doctrines, enracinées dans la tradition française presque aussi profondément que les fondations de la basilique elle-même. D’un côté, ceux qui veulent retrouver l’état d’origine d’un bâtiment, sur une ligne défendue en son temps par Viollet-le-Duc. De l’autre, ceux qui voient dans un monument ce que l’historien de l’architecture Alexandre Gady appelle un palimpseste archéologique : la somme des traces que le temps a laissées sur lui.
Ce qui est en jeu, à Saint-Denis, c’est la question de l’authenticité. Les spécialistes qui voient dans la reconstitution de la flèche un geste hérétique sont les tenants d’une vision archéologique du patrimoine. Ils s’inscrivent dans une longue histoire française et, au-delà, européenne. Le document fondateur de cette doctrine est la charte de Venise, un traité international signé en 1964.
Après les délires interventionnistes du XIX° siècle, et notamment ceux du très imaginatif Viollet-le-Duc, l’idée fit son chemin qu’il fallait regarder les monuments du passé comme des objets sur lesquels le temps a fait son œuvre. Donc, s’intéresser à toutes leurs strates et les conserver, plutôt que d’essayer de reconstituer un hypothétique état d’origine. Au fond, l’état d’origine, c’est quoi ? La forêt du quaternaire ? ironise Alexandre Gady, qui préside la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France. L’état le mieux documenté, c’est l’état actuel.
La timidité de l’État serait liée à cette vision des choses. Une position doctrinale sage, pour Philippe Bélaval, président du Centre des monuments nationaux qui exploite le parcours de la nécropole royale de Saint-Denis. Si l’on s’engage dans la reconstruction, où seront les limites ? interroge-t-il. Car les fantasmes ne manquent pas : dans les années récentes, d’autres projets ont été défendus, notamment celui du château de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), détruit en 1870, ou du palais des Tuileries, incendié en 1871. Tous deux refusés par le ministère de la culture. Un monument a une vie, et ses manques en font partie, estime Jean-Pascal Lanuit, directeur adjoint de la DRAC d’Ile-de-France, qui gère l’édifice et consacre beaucoup d’efforts à la rénovation de la façade. La disparition de la flèche est intéressante, elle doit être respectée.
Pour les opposants, le fait de reconstituer la flèche reviendrait à gommer l’histoire. Ou du moins, estime M. Gady, à la manipuler. Ce serait un mensonge, soutient-il. La règle souffre cependant des exceptions : un bâtiment démoli peut être reconstruit s’il l’est sur-le-champ. Ce fut le cas du Parlement de Bretagne, à Rennes, et du château de Lunéville, en Lorraine, respectivement ravagés par des incendies en 1994 et 2003. Tous deux ont fait l’objet de gros travaux.
Un monument peut aussi être restauré au jour le jour, une pierre changée par-ci par-là, une écaille rattrapée dans la peinture, mais c’est une autre histoire. Bien malin qui pourrait, par exemple, retrouver des pierres d’origine dans les châteaux de la Loire, construits en tufeau. Quand il s’agit de reconstruction, en revanche, le temps n’est pas un allié – au moins en France. Au bout d’un certain nombre d’années, les matériaux ont disparu, l’œil s’est habitué. Ne pas arbitrer entre différents états serait la meilleure manière de ne pas se tromper. Depuis plus d’un siècle et demi, la basilique de Saint-Denis est vue comme cela, décrite comme cela, peinte comme cela, observe Alexandre Gady.
Derrière ces considérations élevées, il y a aussi des questions d’argent. Le patrimoine français n’est pas en bonne condition, c’est un fait, et les moyens investis là ne le seraient pas ailleurs. Ce qui est mort est mort, martèle Dominique Cerclet, conservateur des monuments historiques à la DRAC Ile-de-France. S’il y a des fonds disponibles, il faut les mettre sur les parties vivantes ! Ne pas couvrir d’or certains endroits quand, dans tant de châteaux, les plafonds tombent.
Les mécènes ? Ils ne sont pas si nombreux et ce qu’ils dépensent d’un côté manquera fatalement à l’État solliciteur. Or les mécènes eux aussi veulent rêver. Pourtant la restauration minutieuse d’une façade ou d’un vitrail fait nettement moins vibrer que l’apparition d’une tour médiévale dans le ciel d’Ile-de-France – d’où l’intérêt de l’État à bloquer ce projet. Il y a bien sûr, dans la symbolique de cette flèche et dans son aspect conquérant, un élément très vendeur qui met en rogne les puristes.
Toute opération spectaculaire est soupçonnée à leurs yeux de tirer le patrimoine vers une forme de dysneylandisation rampante : les monuments seraient restaurés en fonction des goûts du public, et pour attirer des touristes. Lesquels, pour la plupart, souhaitent davantage vivre une expérience authentique que voir un lieu authentique, constate l’anthropologue Saskia Cousin, auteure de plusieurs enquêtes sur le tourisme. Ce qui les intéresse avant tout, c’est de pouvoir s’imaginer comment vivaient les gens autrefois. Pour cela, évidemment, des bâtiments entiers sont plus parlants que des ruines.
L’exemple le plus frappant, celui qui a fait couler le plus d’encre, c’est la reconstitution de la grille royale du château de Versailles, en 2008. De cet ouvrage conçu sous Louis XIV et déposé en 1771, on ne possédait que des illustrations de petite taille. Grâce à des fonds privés, il a été recréé dans une version richement tapissée de 10 000 feuilles d’or, qui a fait hurler bien des historiens de l’art. Faut-il montrer aux visiteurs ce qu’ils veulent voir ? Ou ce qu’ils admirent dans les films hollywoodiens ? Mais à Saint-Denis, l’affaire est bien différente, soutient Jacques Moulin, architecte en chef des monuments historiques, chargé de la basilique. Rien, dans la charte de Venise, ne contredit la restitution d’un monument pour lequel on a autant de documentation, affirme-t-il, avant d’ajouter : On a plus de plans et de dessins de cette tour que de tous les clochers médiévaux encore debout en France.
Nos voisins européens ne se sont pas posé tant de questions avant de reconstruire en Allemagne la Frauenkirche de Dresde, entre 1994 et 2005, ou en Pologne le château royal de Varsovie, durant les années 1970. Dans les deux cas, ces bâtiments avaient été détruits pendant la seconde guerre mondiale. Ces reconstitutions n’étaient pas simplement destinées à boucher un trou dans le paysage : elles avaient une portée symbolique, et un poids considérable en termes d’identité.
Exactement comme en aurait la restitution de la flèche de Saint-Denis, soutient fougueusement Erik Orsenna : cette ville est dévastée sur le plan industriel et social. Ses élus prennent les choses à bras-le-corps. Ils veulent une image architecturale forte et ont eu l’idée d’organiser un grand chantier autour de ce bâtiment magnifique : je les admire et je les soutiens avec enthousiasme.
Le chantier de restitution ferait événement durant une bonne quinzaine d’années et contribuerait à transformer la perception de cette commune, la plus ancienne de France. Philippe Bélaval lui-même avoue son embarras. Tout donne tort à ce projet sur le plan patrimonial, dit le président du Centre des monuments nationaux, gardien de la doxa, mais il faut bien reconnaître, que si ce chantier voyait le jour, cela pourrait avoir un effet d’entraînement considérable sur une ville insuffisamment visitée par rapport à sa valeur historique et artistique. Une telle mobilisation sociale serait un signe de confiance dans l’avenir, ce serait formidable.
Pourquoi, dans ces conditions, ne pas imaginer un arrangement ? Aux yeux de M. Bélaval, l’entreprise aurait plus de chances si les mécènes sollicités prenaient aussi en charge d’autres parties, moins glamour mais très endommagées de la basilique.
Encore faudrait-il que le débat soit ouvert, ce qui n’est apparemment pas le cas. Les partisans du projet se plaignent du silence que leur oppose le ministère de la culture. Il n’y a pas de non, mais un vide, se plaint Jacques Moulin. Ce qui devrait relever du débat d’idées se résume à une série de postulats qu’on ne peut pas discuter. Une colère relayée par Jean-Michel Leniaud, historien de l’art et directeur de l’Ecole nationale des chartes, à Paris. Je ne me prononce pas sur la faisabilité du projet, mais je regrette qu’on n’en parle pas, comme on ne parle jamais des projets de restauration en général. L’opinion n’est pas mêlée à cela, et c’est dommage. En France, quand on parle de patrimoine, c’est uniquement pour dire que les cathédrales sont en ruine et pour lancer des souscriptions… La flèche de Saint-Denis est une question de société qui mérite d’être discutée à tous les échelons possibles.
Il est vrai que les choix patrimoniaux sont d’importance, et concernent les citoyens. Faut-il privilégier les pierres ou les gens ? Les morts ou les vivants ? À cette question, les générations précédentes ont répondu, en Europe du moins, avec tact et beaucoup de prudence. Le fait de garder le passé est un véritable choix de société, qui engage plus que de simples moyens techniques. Mais il faut garder en mémoire que la plupart des bâtiments ont beaucoup évolué avec les années.
La flèche de Saint-Denis elle-même est, à l’origine, un ajout sur une église déjà vieille d’un siècle. Enfin, les doctrines, aussi sages soient-elles, sont sujettes aux modes. Elles varient avec les époques. Conçues pour préserver les monuments des changements d’humeur de ceux qui les restaurent, elles finissent souvent par avaler toutes les transformations, pourvu que le temps les ait absoutes.
Viollet-le-Duc, encore lui, fit restaurer la cité fortifiée de Carcassonne en essayant de retrouver la forme idéale d’une forteresse du XIII° siècle. Il fut très critiqué au XX° siècle, notamment pour avoir couvert d’ardoises, matériau du Nord, les tours qui jalonnent le mur d’enceinte. Après lui, un architecte entreprit même de remplacer cette couverture par des tuiles, mais il s’arrêta en chemin, laissant un ensemble disparate. Cent cinquante ans plus tard, tout est classé au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Raphaëlle Rérolle. Le Monde du 14 03 2015
10 08 1793
Inauguration du Museum Central des Arts de la République, qui en 1803 deviendra le Musée Napoléon, puis finalement le musée du Louvre le 22 juillet 1816 ; le départ sera modeste, avec 660 œuvres ; mais rapidement leur nombre va aller en croissance géométrique, avec le pillage systématique des guerres napoléoniennes, à telle enseigne que, la place étant insuffisante pour exposer tout cela, de 1793 à 1814 les expositions seront temporaires.
23 08 1793
Carnot décide la levée en masse : réquisition de tous les hommes de 18 à 25 ans, célibataires ou veufs sans enfants : les effectifs de l’armée vont atteindre ainsi 800 000 hommes.
25 08 1793
Marseille, reprise aux Fédéralistes, devient Ville sans nom. Lyon est assiégée : […] nous sommes bivouaqués dans les fossés et cette nuit, au lieu d’essayer mon lit, je suis allé sur les hauteurs pour voir l’effet du bombardement de l’armée de Kellermann sur les rebelles, et infidèle ville de Lyon … l’on voyait les bombes écraser les anarchistes et les flammes s’élever dans plusieurs endroits, je suis étonné qu’ils ne se rendent pas à ce feu incendiaire que l’on ne pouvait voir de sang froid surtout en réfléchissant que beaucoup de patriotes en seraient victimes…
Borel, caporal fourrier, depuis Limonest.
Philippe Pinel est nommé médecin des aliénés de l’hôpital Bicêtre, où il commence par suivre de près les pratiques de Jean-Baptiste Pussin qui tente d’établir une pratique morale des aliénés, en demandant que l’on prenne en compte la part de raison qui leur reste : il va commencer par supprimer l’usage des chaînes ; en 1795, Philippe Pinel sera nommé médecin-chef de La Pitié Salpêtrière où il commencera à réformer l’organisation de l’hôpital.
27 08 1793
Les royalistes de Toulon ouvrent leur ville aux Anglais.
29 08 1793
La France est entrée en guerre contre l’Angleterre et l’Espagne. Dom Ventura Caro et Antonio Ricardos, deux grands capitaines espagnols, donnèrent bien du fil à retordre aux troupes françaises de part et d’autre des Pyrénées. Dans les colonies, et notamment à Saint Domingue où a éclaté une insurrection deux ans plus tôt, les sentiments que nourrissent les esclaves pour les représentants du pouvoir risquent de mettre à mal la défense des îles, aussi Sonthonax et Polverel, commissaires civils à St Domingue, y abolirent l’esclavage, se ralliant ainsi Toussaint Louverture ; cette émancipation impromptue offrait le grand avantage pour la République de pouvoir lever des troupes pour la défense de l’île, car on est en droit de mobiliser des citoyens, pas des esclaves. Toussaint Louverture allait être nommé en 1797 par le Directoire commandant en chef de l’armée coloniale, son premier souci étant alors d’éliminer son rival André Rigaud.
5 09 1793
Les conventionnels suivent Barrère qui, au nom du Comité de salut public, veut mettre la terreur à l’ordre du jour : Nous voulons une armée révolutionnaire [qui] exécutera enfin ce grand mot qu’on doit à la Commune de Paris : Plaçons la Terreur à l’ordre du jour. C’est ainsi que disparaîtront au même instant les royalistes et les modérés, et la tourbe contre-révolutionnaire qui vous agite.
*****
La bêtise, au commencement, la paresse, la négligence ? Le jaune, le beige, le fadasse ? Allons-donc ! Le rouge, oui. Le sang. Au commencement était le sang. La haine. La violence, la guerre, le crime ; puis la revanche de la défaite, le châtiment de l’assassinat ; et la revanche de la revanche, le châtiment du châtiment…
Tuer était bon, les hommes s’aperçurent que c’était bon – agréable, facile : il n’y fallait que du sentiment… Tous les lieux, tous les outils faisaient l’affaire ; quant aux prétextes, on n’en manquait jamais : race, religion, parti, nation, pour être l’ennemi, il suffisait que l’autre fût autre. Les hommes savaient pourquoi ils tuaient ; ils comprenaient aussi, même quand ils le regrettaient, pourquoi ils mouraient ; chacun était l’autre d’un autre.
Françoise Chandernagor. La chambre. Gallimard 2002
15 09 1793
Les Français, sous les ordres de Kellermann, contre-attaquent dans la vallée de l’Arve, et battent les Sardes à Cluses, puis à Méribel (entre Magland et Sallanches) le 28 Septembre. Ces derniers se replient en piedmont en passant par le col du Bonhomme, abandonnant canons, munitions et bagages. La légende veut que les Sardes, parvenus au pont sur le Nant Borrant au sommet de la voie romaine, aient basculé dans les gorges plusieurs tubes d’artillerie, récupérés plus tard par les locaux pour être transformés en socs, pioches, fers de mulets, cloches et clochettes…
27 09 1793
Mort de Mgr Michel Conseil, évêque de Chambéry né à Megève en 1716 au chalet de la Vieille ; ayant refusé de souscrire à la constitution civile du clergé, il fut retenu prisonnier en son palais où il mourut d’hydropisie de poitrine. Sa mère était la sœur du général Muffat de Saint Amour ; son père était notaire, devenu très aisé en peu de temps grâce aux réquisitions de grain et de fourrage qu’il payait selon son bon plaisir.
1 10 1793
Décret de la Convention sur la Guerre de Vendée : La Convention nationale compte sur le courage de l’armée de l’Ouest et des généraux qui la commandent pour terminer d’ici au 20 octobre l’exécrable guerre de la Vendée. La reconnaissance nationales attend l’époque du 1° novembre prochain pour décerner des honneurs et des récompenses aux armées et aux généraux qui, dans cette campagne, auront exterminé les brigands de l’intérieur et chassé sans retour les hordes étrangères des tyrans de l’Europe
[…] Il y a assez longtemps que la Vendée fatigue la République. Marchez, frappez, finissez ! Précipitez-vous sur ces bandes insensées et féroces… Écrasez-les ! Que chacun se dise : Aujourd’hui s’anéantisse la Vendée ! et la Vendée sera vaincue.
Cinquante ans plus tard, donc même en ayant laissé du temps au temps, Jules Michelet fera preuve du même étonnement d’incompréhension face à ce soulèvement : Phénomène incroyable d’ingratitude, d’injustice et d’absurdité… Au moment où le monde s’élance vers la France, se donne à elle, devient français de cœur, un pays fait exception ; il se rencontre un peuple si étrangement aveugle et si bizarrement égaré qu’il arme contre la Révolution, sa mère, contre le salut du peuple, contre lui-même. Et par un miracle du diable, cela se voit en France ; c’est une partie de la France qui donne ce spectacle : ce peuple étrange est la Vendée.
Jules Michelet. Histoire de la Révolution française ; 1847-1853. Paris T II
9 10 1793
Assiégée, bombardée, ravagée par les incendies et la famine, Lyon se rend : le siège avait commencé en août. La muscadinerie est aux abois dans notre ville, constate avec satisfaction un officier municipal. Chaque jour, la fusillade va son train. Chaque jour des têtes tombent. Quel ciment pour la République !
vers 10 10 1793
Si vous persistez dans votre cruauté, si vous immolez la reine, vos succès mêmes périront au milieu de vous. Ne vous y trompez pas ; c’est peut-être la destruction de la royauté, des ordres privilégiés qui irrite contre vous la plupart des gouvernements de l’Europe, mais ce qui soulève les nations, c’est la barbarie de vos décisions. (…) Là où il existait un trône, vous avez élevé un échafaud.
Madame de Staël.
12 10 1793
Première audience de la reine devant le Tribunal révolutionnaire : Non contente de dilapider d’une manière effroyable les finances de la France, fruit des sueurs du peuple, pour vos plaisirs et vos intrigues, de concert avec d’infâmes ministres, vous avez fait passer à l’empereur des millions pour servir contre le peuple qui vous nourrissait.
Martial Joseph Armand Herman, protégé de Robespierre, président du tribunal.
16 10 1793
Marie Antoinette est guillotinée sur l’immense place de la Révolution, aujourd’hui place de la Concorde. Le procès n’a été qu’une parodie, mené par Fouquier-Tinville et Hébert qui avait déclaré au Comité de Salut Public : J’ai promis la tête d’Antoinette, j’irai la couper moi-même si on tarde à me la donner. Je l’ai promise aux sans-culottes qui me la demandent et sans qui vous cessez d’être !
On sera allé jusqu’à l’accuser d’inceste, mettant ainsi de son coté l’ensemble des femmes de l’assistance : trop, c’est trop, et les hommes qui avaient monté l’affaire, n’avaient pas senti que cela les desservirait. Il y avait pourtant un fondement à cela : le dauphin, depuis qu’il avait été confié au cordonnier Simon, avait pris goût à la dangereuse mais fantastique liberté qu’est, pour un enfant de 8 ans, la suppression totale, du jour au lendemain, de toute éducation, c’est-à-dire de toute contrainte ; et de chanter à pleins poumons Dansons la carmagnole et quelques autres, etc… Ce relâchement avait sans doute donné libre cours au ressentiment qu’il pouvait éprouver envers celle qui avait été jusque là en charge de son éducation, sa mère. Habilement manipulé par Hébert, ce dernier parvint à lui faire signer une déposition dans la quelle il attestait que sa mère et sa tante abusaient de lui sexuellement. L’aptitude d’un enfant au mensonge est une affaire bien ancienne. La manipulation mit en fureur Robespierre : Cet imbécile d’Hébert, il faut qu’il lui fournisse au dernier moment ce triomphe d’intérêt public. Marie Antoinette, ulcérée, avait alors répondu : Si je n’ai pas répondu, c’est que la nature elle-même refuse de répondre à de telles accusations faites à une mère. J’en appelle à toutes les mères !
Mais pour finir, les chefs d’accusation retenus ne concernèrent que l’intelligence avec l’ennemi. Dans ses conclusions, le président a écarté le coté politique du procès et a tout ramené, en somme, à une seule accusation. On ne demande pas aux jurés s’ils considèrent Marie-Antoinette comme une femme gaspilleuse, dénaturée, adultère, incestueuse, mais uniquement si l’ex-reine est coupable d’avoir été en relations avec l’étranger, d’avoir souhaité et favorisé la victoire des armées ennemies et l’insurrection à l’intérieur du pays.
Marie-Antoinette est-elle, au sens légal, coupable de trahison et convaincue de ce crime ? Question à deux tranchants, qui exige une double réponse. Sans aucun doute – et c’est là la force du procès – elle était du point de vue de la république réellement coupable. Elle a été indéniablement en relations constantes avec l’ennemi, nous le savons. Elle s’est rendue effectivement coupable de haute trahison en livrant à l’ambassadeur d’Autriche les plans d’attaque militaire de la France et elle a employé et favorisé n’importe quel moyen légal ou illégal susceptible de rendre le trône et la liberté à son époux.
L’accusation est donc fondée. Mais – point faible du procès – elle n’est pas prouvée le moins du monde. Aujourd’hui, les documents qui convainquent, sans équivoque possible, Marie-Antoinette du crime de haute trahison contre la république, sont connus et imprimés ; on les trouve aux archives nationales de Vienne, dans les papiers laissés par Fersen. Mais le procès eut lieu à Paris le 16 octobre 1793, et à ce moment-là, l’accusateur public ne pouvait disposer d’aucun de ces documents. Aucune preuve matérielle de la trahison commise ne pouvait être mise sous les yeux des jurés.
Un jury honnête, impartial, serait sans doute très embarrassé. Si ces douze républicains suivent leur instinct ils doivent certes condamner Marie-Antoinette, car chacun d’eux est convaincu que cette femme est l’ennemie mortelle de la république, qu’elle a fait tout ce qu’elle a pu, tantôt pour rendre le pouvoir royal à son mari, tantôt pour le conserver intact à son fils. Cependant, le droit, pris à la lettre, est du coté de l’accusée : la preuve effective, évidente, fait défaut. En tant que républicains, ils sont en droit d’estimer que Marie-Antoinette est coupable, mais comme jurés assermentés, ils doivent s’en tenir à la loi, qui ne connaît d’autre faute que celle qui est prouvée. Ce conflit intérieur leur est heureusement évité. Car ils savent que la Convention n’exige pas du tout d’eux une sentence juste. Elle les a délégués non pour juger, mais pour condamner une femme qui a mis la sécurité de l’État en danger. Ils doivent ou livrer la tête de Marie Antoinette, ou tendre la leur. Les douze jurés ne délibèrent donc que pour la forme, et s’ils paraissent réfléchir plus d’une minute, ce n’est que pour faire croire à une délibération là où en réalité la sentence est arrêtée depuis longtemps.
Stefan Zweig. Marie Antoinette. Insel Verlag Leipzig 1932
Cela donna lieu aux plus grandes heures de la littérature de caniveau, la calomnie à chaque ligne, au premier rang desquelles Le père Duchêne du rustique Hébert. La grande communauté des haineux ne s’était pas trouvée à pareille fête depuis Mazarin. Parmi la foule qui se presse pour assister à l’exécution, un jeune peintre qui aura passé sa vie à être du coté du pouvoir, – je retourne ma veste, et puis mon pantalon – croque le dernier portrait de Marie Antoinette : David. Danton l’aperçoit et l’apostrophe : Valet !
D’un coup de crayon, il fixe, de manière impérissable, le visage de Marie-Antoinette allant à l’échafaud, esquisse d’un grandiose effroyable, d’une puissance sinistre, prise toute chaude sur le vif : une femme vieillie, sans beauté, fière encore seulement, la bouche orgueilleusement fermée, comme pour proférer un cri intérieur, les yeux indifférents et étrangers, elle est là, dans la charrette, avec les mains liées dans le dos, aussi droite et aussi fière que sur un trône. Dans chaque trait du visage pétrifié se lit un mépris indicible, une énergie inébranlable s’affirme dans le buste cambré ; une résignation qui s’est muée en fierté, une souffrance qui est devenue une force intérieure, donnent à cette figure tourmentée une nouvelle et terrible majesté. La haine même ne saurait nier sur cette feuille la noblesse avec laquelle Marie-Antoinette, par son attitude sublime, triomphe de l’opprobre de la charrette.
Stefan Zweig. Marie Antoinette. Insel Verlag. Leipzig 1932

Joseph-Emmanuel van den Büssche met en scène le peintre David. Ce dernier, installé à une fenêtre d’un immeuble lors du passage de la charrette qui conduisait la reine à l’échafaud, a représenté la reine lors de ses derniers instants.

Quelques heures avant d’être emmenée à l’échafaud, elle écrit à Madame Elisabeth, sœur de Louis XVI, en charge alors de ses deux enfants. Il aura fallu cette course accélérée vers la mort pour que le personnage acquière une densité qu’on ne lui avait jamais connue : C’est à vous, ma sœur, que j’écris pour la dernière fois. Je viens d’être condamnée, non pas à une mort honteuse, elle ne l’est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère. Comme lui innocente, j’espère montrer la même fermeté que lui dans ses derniers moments. Je suis calme comme on l’est quand la conscience ne reproche rien. J’ai un profond regret d’abandonner mes pauvres enfants ; vous savez que je n’existais que pour eux et vous, ma bonne et tendre sœur. Vous qui aviez par votre amitié tout sacrifié pour être avec nous, dans quelle position je vous laisse ! J’ai appris, par le plaidoyer même du procès, que ma fille était séparée de vous. Hélas ! la pauvre enfant, je n’ose pas lui écrire, elle ne recevrait pas ma lettre ; je ne sais pas même si celle-ci vous parviendra. Recevez pour eux deux ici ma bénédiction ; j’espère qu’un jour, lorsqu’ils seront plus grands, ils pourront se réunir avec vous et jouir en entier de vos tendres soins. Qu’ils pensent tous deux à ce que je n’ai cessé de leur inspirer : que les principes et l’exécution exacte de ses devoirs sont la première base de la vie, que leur amitié et leur confiance mutuelle en fera le bonheur. Que ma fille sente qu’à l’âge qu’elle a, elle doit toujours aider son frère par les conseils que l’expérience qu’elle aura de plus que lui et son amitié pourront lui inspirer ; que mon fils, à son tour, rende à sa sœur tous les soins, les services que l’amitié peut inspirer ; qu’ils sentent enfin tous deux que, dans quelque position où ils pourront se trouver, ils ne seront vraiment heureux que par leur union ; qu’ils prennent exemple en nous. Combien, dans nos malheurs, notre amitié nous a donné de consolations ! Et, dans le bonheur, on jouit doublement quand on peut le partager avec un ami ; et où en trouver de plus tendre, de plus uni que dans sa propre famille ? Que mon fils n’oublie jamais les derniers mots de son père, que je lui répète expressément : qu’il ne cherche jamais à venger notre mort !
J’ai à vous parler d’une chose bien pénible à mon cœur. Je sais combien cet enfant doit vous avoir fait de la peine. Pardonnez-lui, ma chère sœur ; pensez à l’âge qu’il a, et combien il est facile de faire dire à un enfant ce qu’on veut, et même ce qu’il ne comprend pas. Un jour viendra, j’espère, où il ne sentira que mieux tout le prix de vos bontés et de votre tendresse pour tous deux.
Il me reste à vous confier encore mes dernières pensées. J’aurais voulu les écrire dès le commencement du procès ; mais outre qu’on ne me laissait pas écrire, la marche a été si rapide que je n’en aurais réellement pas eu le temps.
Je meurs dans la religion catholique, apostolique et romaine, dans celle de mes pères, dans celle où j’ai été élevée, et que j’ai toujours professée. N’ayant aucune consolation spirituelle à attendre, ne sachant pas si il existe encore ici des prêtres de cette religion, et même le lieu où je suis les exposerait trop s’ils y entraient une fois, je demande sincèrement pardon à Dieu de toutes les fautes que j’ai pu commettre depuis que j’existe ; j’espère que, dans sa bonté, Il voudra bien recevoir mes derniers vœux, ainsi que ceux que je fais depuis longtemps pour qu’il veuille bien recevoir mon âme dans sa miséricorde et sa bonté.
Je demande pardon à tous ceux que je connais, et à vous, ma sœur, en particulier, de toutes les peines que, sans le vouloir, j’aurais pu leur causer. Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu’ils m’ont fait. Je dis ici adieu à mes tantes et à tous mes frères et sœurs. J’avais des amis ; l’idée d’en être séparée pour jamais et leurs peines sont un des plus grands regrets que j’emporte en mourant ; qu’ils sachent du moins que jusqu’à mon dernier moment j’ai pensé à eux.
Adieu, ma bonne et tendre sœur ; puisse cette lettre vous arriver ! Pensez toujours à moi ; je vous embrasse de tout mon cœur, ainsi que ces pauvres et chers enfants. Mon Dieu, qu’il est déchirant de les quitter pour toujours ! Adieu, adieu : je ne vais plus m’occuper que de mes devoirs spirituels. Comme je ne suis pas libre dans mes actions, on m’amènera peut-être un prêtre ; mais je proteste ici que je ne lui dirai pas un mot, et que je le traiterai comme un être absolument étranger.
La lettre s’arrête ainsi brutalement, peut-être interrompue par un garde, ou plus simplement par l’épuisement. Elle aura le cheminement tortueux de bien des écrits. Marie Antoinette la remit au geôlier Bault pour qu’il la remette à sa belle-sœur, ce qu’il ne fit pas ; mais il la transmet à Fouquier Tinville, qui ne transmet pas. Deux ans plus tard, quand lui-même montera sur l’échafaud, c’est un obscur député, Courtois, chargé de faire le tri dans les papiers de Robespierre, qui, prenant goût à sa tâche élargira sa mission en fouinant dans tout le tribunal révolutionnaire où il trouvera la lettre de Marie Antoinette. Il la gardera vingt ans et la remettra alors à Louis XVIII, croyant ainsi, mais en vain, échapper à l’exil.
À la fin de la vie des pensées jusqu’alors informes surgissent clairement dans l’esprit, elles sont comme d’heureux et brillants génies qui se posent sur les cimes du passé.
Goethe
Elle sera enterrée au cimetière de la rue d’Anjou, là où reposait déjà son époux depuis neuf mois. Incorrigiblement frivole du temps de sa jeune splendeur, d’une grâce qui s’adressait aussi bien aux petits, aux domestiques qu’aux puissants, qui aurait pu alors deviner qu’elle se révélerait aussi bravement courageuse, aussi digne, aussi forte, dans cette longue marche de quatre ans vers la mort, du départ de Versailles, le 6 octobre 1789 à l’échafaud de la place de la Concorde le 16 octobre 1793. Fidèle jusqu’au bout à son serment de rester aux cotés du roi ; préoccupée constamment de l’éducation de ses enfants, abandonné des siens, les Habsbourg, restant toujours debout face à son pire ennemi : la calomnie ?


Marie-Antoinette conduite à son exécution le 16 octobre 1793, par William HAMILTON (1751 – 1801)
17 10 1793
Les Blancs sont mis en déroute à Cholet ; le généralissime d’Elbée et Bonchamps sont blessés. Le prince de Talmont prend la décision de franchir la Loire pour la virée de Galerne, [la Galerne est un vent froid du nord-ouest qui sévit en hiver] malheureuse expédition qui le mènera jusqu’à Granville dont ils ne pourront s’emparer. La retraite sera alors décidée pour aboutir au désastre de Savenay le 23 décembre.
23 10 1793
Entre la rose de Notre Dame de Paris et le triple portail se tient une file de 28 statues couronnées formant une frise continue : il s’agissait des 28 générations de rois de Juda, ancêtres de la Vierge, de David jusqu’à Jésus. Mais on ne sait cela que depuis peu de temps : au XVIII° siècle, toutes les autorités archéologiques croyaient fermement qu’il s’agissait des 28 rois de France prédécesseurs de Philippe Auguste, en commençant par Childebert. Les vandales passèrent la corde au cou de toutes ces statues pour les précipiter sur le parvis, sur lequel elles se brisèrent.
30 10 1793 (9 brumaire an II, dans le calendrier révolutionnaire).
21 députés girondins sont guillotinés. Quand ils arrivèrent au pied de l’échafaud, sur cette place dont le nom change au gré des régimes politiques – place Louis XV sous Louis XVI, place de la Révolution après le 10 août, place de la Concorde sous le Directoire, le Consulat et l’Empire, place Louis XVI sous Louis XVIII, et de nouveau place de la Concorde aujourd’hui -, il était onze heures du matin. Le brouillard voilait le soleil ; il pleuvait. Jamais l’hymne composé par Rouget de Lisle n’avait résonné avec tant de ferveur.
C’est Sillery qui, le premier, arriva sur la plate-forme. Le député de la Somme, doyen des condamnées, salua la foule, à droite, à gauche, tel l’artiste qui s’apprête à quitter la scène de sa vie. Faucher, Carra, Lesterpt-Beauvais, Duperret, furent les suivants. Le sang giclait, débordait du panier, des caillots se formaient; l’échafaudage s’imprégnait de la couleur écarlate, de telle sorte qu’il fallut, après que la lame du couteau se fut abattue sur la nuque de Lacaze, le nettoyer à grand renforts de seaux d’eau.
Le chœur diminuait à mesure que le sacrifice continuait. Boileau, Antiboul, Gardien, Lasource, Brissot, Lehardy, Duprat furent sacrifiés.
Ducos était assis à côté de Fonfrède. Quand ce fût son tour, il embrassa son ami une dernière fois : Mon frère, c’est moi qui t’ai conduit à la mort ! lui dit-il. Et ce frère d’alliance, qui bientôt le rejoindrait dans l’autre monde, tentait de le consoler : Au moins, nous mourrons ensemble !
Le chant funèbre perdait son intensité, pas sa vigueur. Ils n’étaient plus que six – Gensonné, Mainvieille, Fonfrède, Duchastel, Vergniaud et Vigée. Et les six usaient leurs dernières forces dans les paroles de La Marseillaise, paroles somptueuses desquelles ils puisaient l’énergie d’aller mourir. Gensonné, au moment de monter sur l’échafaud, me chercha du regard. Il ne trouva que mes yeux rougis de larmes.
Bientôt, il n’en resta plus que deux. On a souvent affirmé que Vergniaud eut l’honneur de passer sur la planche en dernier. Comme je l’ai déjà dit, c’était le chef naturel des Girondins et il eût été dans l’ordre des choses qu’il restât en vie jusqu’à la fin du funeste spectacle, le cérémonial de l’assassinat judiciaire assignant de coutume la dernière place au plus coupable des accusés, c’est-à-dire, aux yeux du tribunal, à celui qui était à la tête de sa faction. Le bourreau, d’ailleurs, ne s’y tromperait pas quelques mois plus tard, qui laisserait à Hébert, puis Danton les égards du dernier supplicié.
Et pourtant, ce jour-là, c’est avec Vigée, et non Vergniaud, que le sacrifice allait s’achever. Il fut le vingtième à passer sur la planche. Il chantait encore sur la bascule : Contre nous de la tyrannie, l’étendard sanglant est levé ! Le couteau tomba ; le silence aussi.
Comprenez, Monsieur, que ce silence fit la plus grande impression sur mon âme. C’était le 31 octobre 1793, dixième jour du deuxième mois de l’an II de la République. Il était onze heures et demi. En un demi-tour de cadran, la Révolution avait achevé de dévorer ses propres enfants.
François Henri Désérable. Tu montrera ma tête au peuple. Gallimard. 2013
La Convention dissout toutes les assemblée féminines.
La convention décrète, après la chute de Lyon :
- Article 1° : Il sera nommé par la Convention nationale, sur la présentation du Comité de Salut Public, une commission extraordinaire, composée de cinq membres, pour faire punir militairement, et sans délai, les contre-révolutionnaires de Lyon
- Article II : Tous les habitants de Lyon seront désarmés. Leurs armes seront distribuées sur le cham, aux défenseurs de la République. Une partie sera remise aux patriotes de Lyon qui ont été opprimés par les riches et les contre-révolutionnaires.
- Article 3 : La ville de Lyon qui s’est donnée aux émigrés sera détruite. Tout ce qui fût habité par le riche sera démoli ; il ne restera que la maison du pauvre, les habitations des patriotes égarés ou proscrits, les édifices spécialement employés à l’industrie et les monuments consacrés à l’humanité et à l’instruction publique.
- Article 4 : Le nom de Lyon sera effacé du tableau des villes de la République. La réunion des maisons conservées portera désormais le nom de Ville-Affranchie.
- Article 5 : Il sera élevé sur les ruines de Lyon une colonne qui attestera à la postérité les crimes et la punition des royalistes de cette ville, avec cette inscription :
Lyon fit la guerre à la Liberté ; Lyon n’est plus.
Le 18° jour du premier mois -Vendémiaire- de l’an II de la République française une et indivisible.
C’est Fouché, arrivé à Lyon le 10 novembre, et Collot d’Herbois, arrivé le 7, qui se chargeront de la besogne, prenant la relève d’un Couthon jugé trop mou dans ses actes, en dépit d’un verbe qui ne recule jamais devant la surenchère.
Octobre 1793
Les premiers vols en montgolfière ont seulement dix ans. Le chimiste Louis-Bernard Guyton de Morveau, membre du Comité du salut public, convainc ses pairs de commander la construction d’un ballon neuf aisément utilisable en campagne et capable d’emporter deux observateurs. Le physicien Jean-Marie-Joseph Coutelle, secondé par Nicolas-Jacques Conté, l’inventeur du crayon, s’y attelle dans l’ancien domaine royal de Meudon. En quatre mois, le premier ballon est construit en taffetas recouvert d’un vernis. D’un diamètre de 9 mètres, il est gonflé avec de l’hydrogène fabriqué sur place à l’aide de fourneaux. Une nacelle permet d’emporter deux passagers. L’un pour assurer la manœuvre, l’autre pour effectuer les observations. À 300 mètres d’altitude, l’Entreprenant, tel est son nom, permet d’observer jusqu’à 29 kilomètres.
2 11 1793
Loi sur les enfants naturels.
Les dix huit cloches de Megève et des chapelles alentour, Demi Quartier et Praz, sont descendues, et acheminées au quartier de Cluses ; elles pesaient au total 5 956 livres.
Olympe de Gouges est guillotinée : le 20 mars, la République avait été déclarée une et indivisible. Dire le contraire était passible de mort. Le 19 juillet, Olympe de Gouges publie Les Trois Urnes ou le salut de la patrie, par un voyageur aérien : elle y demande que chaque département puisse choisir le type de gouvernement qu’il souhaite, afin d’éviter la guerre civile. Elle est dénoncée et arrêtée avant même d’avoir pu afficher son texte.
10 11 1793
À Lyon, Collot d’Herbois et Fouché ont estimé que la mise au pas de la ville rebelle devait commencer par une fête : Le comédien sifflé et l’ancien prêtre [seulement séminariste. ndlr] devenu son assistant font précéder la tragédie véritable d’une courte pièce satyrique, qui est peut-être la plus provocante et la plus impudente de toute la Révolution française : une sorte de messe noire célébrée au grand jour. La fête funèbre en l’honneur du martyr de la liberté Chalier est le prétexte de ce débordement d’athéisme. Comme prélude, à huit heures du matin, toutes les églises sont dépouillées de leurs derniers emblèmes religieux ; les crucifix sont arrachés des autels, les nappes et les chasubles sont enlevées […] quatre jacobins venus de Paris portent sur une litière recouverte de tapis tricolores le buste de Chalier, complètement submergé de fleurs ; à côté repose une urne, qui contient ses cendres, et, dans une petite cage, une colombe […] solennels et graves, les trois proconsuls marchent derrière le brancard, dans ce service religieux d’une nouveau genre destiné à attester pompeusement au peuple de Lyon la divinité du martyr de la liberté, de Chalier, le dieu sauveur mort pour eux. Mais une aberration de goût stupide et particulièrement pénible avilit encore cette cérémonie : une bande bruyante traîne en triomphe, dansant une sorte de danse du scalp, les vases sacrés, les calices, ciboires et images saintes volées dans les églises; derrière trotte un âne, sur les oreilles duquel on a réussi à faire tenir une mitre d’évêque, également dérobée. À la queue d’un pauvre grison on a attaché un crucifix et la Bible ; ainsi, à la pleine lumière du jour, pour l’ébaudissement d’une populace hurlante, l’évangile se balance à la queue d’un âne et traîne dans la boue du ruisseau. […] un grand bûcher est finalement allumé. Joseph Fouché, qui, il y a peu de temps encore portait la tonsure, regarde gravement, avec ses deux collègues, l’évangile qu’on détache de la queue de l’âne et qu’on jette au feu, où il devient fumée au milieu des flammes qu’alimentent des habits ecclésiastiques, des livres de messe, des hosties et des statues de saints. Ensuite, l’on fait boire le quadrupède à robe grise dans un calice sacré, pour le récompenser de son concours blasphématoire, et, après ces manifestations de mauvais goût, les quatre jacobins reprennent sur leurs épaules le buste de Chalier et le portent à l’église, où il est posé solennellement sur l’autel, à la place du Christ, qui a été mis en pièce. […]
Si antipathique que soit cette première journée de Joseph Fouché à Lyon, ce n’est toutefois que du théâtre et une sotte mascarade : il n’y a pas encore de sang versé. Mais, dès le lendemain, les consuls deviennent inaccessibles; ils s’enferment dans une maison écartée, dont des factionnaires armés interdisent l’entrée à tous ceux qui n’ont pas d’autorisation : la porte est ainsi, symboliquement, barricadé à toute clémence, toute prière, toute indulgence. Un tribunal révolutionnaire est crée […]
Stefan Zweig. Fouché. Insel Verlag. 1929
16 11 1793
À Nantes, Jean-Baptiste Carrier fait embarquer 90 prêtres réfractaires, liés deux à deux sur des gabarres [péniche à fond plat]. Seul le curé de Machecoul s’inquiète en voyant sur le fond du bateau des pierres plates et blanches cachant des trous. Voyant de l’eau s’infiltrer, il conseille à ses voisins de se donner mutuellement l’absolution. Ses hommes de main défoncent la coque des gabarres une fois bien prises dans le courant. L’abbé Julien Landeau, curé de Saint-Lyphard, a survécu au massacre. Mal ficelé, il avait réussi à détacher ses liens l’unissant à un vieux moine. Il parvient à attirer l’attention d’une barque. Les bateliers le hissent à bord, mais le laissent aussitôt sur la rive de peur d’être dénoncés. Défaillant de froid, de faim et de fatigue, Landeau trouve refuge dans une chaumière qu’il doit, là encore quitter avant l’aube, pour ne pas mettre en danger ses hôtes. Une femme de son pays lui offre l’asile le temps que son frère, paludier à Guérande, vienne le chercher. C’est le seul survivant du massacre des 90 curés.
Jean-François Carrier décide d’appliquer cette noyade par contrainte à grande échelle pour se débarrasser des milliers de Vendéens qui encombrent la prison de la ville. On aura vu des prêtres et des religieuses attachés face à face, nus dans des gabarres, pour être coulées dans la Loire. Les terroristes nommaient cette mise en scène un mariage républicain et la Loire la baignoire nationale. Il faudra probablement attendre la guerre civile espagnole pour renouer avec pareilles perversions. Entre les derniers jours de 1793 et février 1794, de 1 800 à 4 800 victimes disparaîtront dans la Douce Loire, au Bras de la Bourse, à la Sècherie, à l’île Cheviré en aval de Trentemoult, à Chantenay, dans la baie de Bourgneuf…
Un siècle plus tard, de 1926 à 1928, les autorités civiles enterreront de fait une partie de ces noyés en comblant le Bras de la Bourse aujourd’hui rive droite du Bras de la Madeleine, juste au sud de la Bourse du Commerce : c’est l’extrémité SO du centre de la ville.
17 11 1793
À Lyon, les exterminateurs s’impatientent. Les démolitions sont trop lentes, il faut des moyens plus rapides à l’impatience républicaine, l’explosion de la mine et l’activité dévorante de la flamme peuvent seules exprimer la toute puissance du peuple… elle doit avoir les effets du tonnerre.
Joseph Fouché, Jean-Marie Collot d’Herbois
22 11 1793
Louis Marie Turreau, promu général de division le 4 du mois, se voir confié le commandement en chef de l’armée de l’Ouest : il va s’employer à faire de la Vendée un désert avec ses colonnes infernales.
À l’époque où le général Turreau prit le commandement effectif de l’armée de l’Ouest, à la fin de décembre 1793, la Vendée, à l’exception de la partie de Charrette, était soumise… Il était facile d’y maintenir la paix, mais Turreau avait conçu un plan de destruction générale en employant le fer et le feu. Il annonça son plan comme une promenade de dix jours dans la Vendée. En fait, il ne fallut que ces dix jours pour remettre sur pied tout ce qui restait de la population de Vendée et rallumer une guerre à mort dans toute l’étendue du pays. Turreau persista dans son plan et ne sut employer que la flamme.
Savary, futur ministre de la police de Napoléon.
26 11 1793
L’administration de Cluses arrête que les chapelles de villages et autres existant sur les routes ou dans les bois ne servant qu’à entretenir le fanatisme et à loger les brigands ou à faciliter leur rendez-vous seraient vendues par les municipalités…à l’exception des articles proscrits… qu’elles devaient anéantir. À Megève, Melchior Gaiddon, en exécution de ce décret, décida de démolir les quinze oratoires le long du chemin menant au bois des Crétêts et de démolir la chapelle du même nom. Immédiatement après les fêtes de Noël, on fit commander les femmes reconnues les plus dévotes pour raser les oratoires des quinze mystères tendant à Notre Dame des Crétêts. La terreur était si générale que plusieurs eurent la faiblesse de prêter leurs mains à ce sacrilège dessein, mais ce fut en versant des larmes
Abbé Jean Marie Clément Berthet.
Le maire de Demi-Quartier, François Allard, limita les dégâts en saoulant Melchior Gaiddon, ce qui permit aux démolisseurs de s’éclipser et à la chapelle d’échapper à la destruction. Mais celle de la Molettaz, construite en 1667 près du cimetière des pestiférés, comme celle du Calvaire, route de Glaize, furent détruites. Le 27 mars 1794, il s’acharna encore à raser les Chapelles de Darbon et d’Odier.
4 12 1793
À Lyon, Fouché et Collot d’Herbois ont pris leur temps pour préparer leur besogne. Le temps est maintenant venu : de bon matin soixante-neuf jeunes gens sont tirés des prisons et liés deux par deux. Mais on ne les conduit pas à la guillotine, qui, suivant les paroles de Fouché, travaille trop lentement […] on les conduit dans la plaine des Brotteaux, au-delà du Rhône. Deux tranchées parallèles, creusées en hâte, permettent déjà aux victimes de deviner leur sort, et les canons placés à dix pieds d’eux, indiquent la méthode de massacre en masse qui va être employée. […] le même jour, c’est deux cent dix têtes de bétail humain qu’on envoie là-bas, et qui, en quelques minutes, sont abattues par la mitraille et par les salves de l’infanterie […]
Il salue la conquête de Toulon avec des larmes de joie et, en outre, pour célébrer ce jour, il envoie deux cents rebelles devant la bouche des fusils. Deux femmes qui avaient insisté avec trop de passion auprès de ce tribunal de sang pour la libération de leur mari, sont jetées sous la guillotine […] mille six cents exécutions en quelques semaines.
Stefan Zweig. Fouché. Insel Verlag. 1929
19 12 1793
Bonaparte, sous les ordres de Dugommier, s’illustre au siège de Toulon, repris aux fédéraux, aux royalistes et aux Anglais. Cela lui laisse suffisamment de loisirs pour conter fleurette à Désirée Clary. Toulon, débaptisé, devient Port de la Montagne.
Carrier envoie un courrier à la Convention, dont le bouillon passera à la postérité, où il dit les flots de sang de la virée de Galerne : Vous avés décrété qu’il n’existait plus de Vendée, vous décrétérés bientôt qu’il n’existe plus un seul brigand. L’affaire du Mans a été si sanglante, si meurtrière pour eux que depuis cette commune jusqu’à Laval, la terre est jonchée de leurs cadavres […]. Le 28, Westermann et l’adjudant général Hector sont entrés tous deux dans Ancenis avec peu de forces par deux portes opposées, ils ont fait une boucherie épouvantable des brigands, les rues de cette commune sont jonchées de morts, ils n’ont pas perdu un seul homme, nous n’avons eu qu’un blessé […]. Le 29 au soir, Westermann s’est emparé des Touches, où il a massacré 300 ou 400 brigands […]. La défaite des brigands est si complète que nos postes les tüent, prènent et amènent à Nantes par centaines ; la guillotine ne peut plus suffire, j’ai pris le parti de les fusiller. […] J’invite mon collègue Francastel à ne pas s’écarter de cette salutaire et expéditive méthode, c’est par principe d’humanité que je purge la terre de la liberté de ces monstres […]. Vive, vive la République, encore quelques jours et il n’existéra plus un seul brigand sur les deux rives de la Loire.
22 12 1793
Lazare Hoche flanque une raclée aux troupes autrichiennes à Wœrth-Frœschwiller, dans le département du Bas-Rhin. Un boulet coupe l’arbre sous lequel il se tient, suivi d’un autre qui tue son cheval ; il en prend un autre et galope pour stimuler ses troupes : Allons camarades, les canons à six cents livres la pièce ! Les grenadiers redoublent d’ardeur : Adjugé ! Général… À nous les canons ! Les redoutes autrichiennes à 3 étages sont emportées à la baïonnette. Ceci va coûter cher au trésor de l’armée, car Hoche tient ses promesses : le 3° hussards reçoit 3 000 livres pour 6 pièces ; le 14° dragons, 2 400 pour 4 pièces ; le 2° bataillon du 55° de ligne également 2 400 pour 4 pièces ; et le 4° bataillon du Bas-Rhin également 2 400 pour 4 pièces ; soit 18 pièces prises à l’ennemi.
23 12 1793
Ce qu’il reste de l’armée catholique et royale est anéanti à Savenay. Il n’y a plus de Vendée : elle est morte sous notre sabre avec ses femmes et ses enfants. Je viens de l’enterrer dans les marais et dans les bois de Savenay. J’ai écrasé les enfants sous les pieds de mes chevaux, massacré les femmes qui, au moins pour celles-là, n’enfanteront plus de brigands. Je n’ai pas un prisonnier à me reprocher. J’ai tout exterminé. Mes hussards ont tous attaché à la queue de leurs chevaux des lambeaux d’étendards et de brigands. Les routes sont semées de cadavres. Il y en a tant que, sur plusieurs points, ils font des pyramides. Kléber et Marceau sont là. Nous ne faisons pas de prisonniers, car il faudrait leur donner le pain de la liberté et la pitié n’est pas révolutionnaire.
Westermann, à la Convention
Les estimations les plus basses du nombre de morts de la guerre de Vendée sont de 450 000 morts, 300 000 coté vendéen, 150 000 coté républicain, sur un territoire de l’ordre du cinquantième de celui de la France et sur seulement 14 mois. Pour situer au mieux son importance au sein des guerres civiles, on peut retenir les 600 000 morts de la guerre de Sécession, sur un territoire égal à au moins deux fois la France et sur 4 ans, de 1861 à 1865, la guerre d’Espagne, sur un territoire presqu’égal à la France et sur 3 ans, de juillet 1936 à avril 1939 : 400 000 morts. Qu’importe que l’on estime adéquat ou non le terme de génocide, les disputes d’historiens sont en l’occurrence d’une ridicule insignifiance, toujours est-il que pendant quatorze mois, des Français se sont entretués jusqu’à ce que l’hécatombe atteigne ce chiffre terrifiant de 450 000.
Il faut être très prudent avec le concept de Terreur, dont la datation et la définition restent très flottantes. Surtout, il ne faut pas croire que cette période, en gros du printemps 1793 à l’été 1794, correspond à un système totalitaire tout puissant. Au contraire, ce qui se passe justement, c’est l’absence d’un État fort.
Le Comité de salut public, crée en avril 1793, qu’on considère généralement comme une sorte de pouvoir exécutif et qu’on associe au gouvernement de la Terreur avec, en son centre, la personnalité de Robespierre, ne contrôle en fait pas grand chose, du moins pas avant mars 1794. Il est en rivalité avec d’autres instances qui possèdent également des légitimités fortes : d’un coté, le Comité de sûreté générale, autre grand comité de gouvernement, qui a la haute main sur la police ; de l’autre coté, la Commune insurrectionnelle de Paris qui, depuis le 10 août 1792, possède le pouvoir militaire et se trouve liée aux sans-culottes – ceux-ci contrôlant de fait le ministère de la Guerre -. Les concurrences entre institutions révolutionnaires expliquent les surenchères et les jeux politiciens.
Sur la Vendée en particulier, Robespierre se tait. On peut le lui reprocher, mais il n’a pas les moyens d’intervenir avant mars 1794.
Jean Clément Martin. L’Histoire Juillet-Août 2006
1793
Mise en service des malles-poste. Les États-Unis créent le dollar. Quelques années plus tard, quand il sera élu à la présidence, Thomas Jefferson se mettra dans les pas des physiognomonistes – une pseudo science de l’époque qui affirmait que l’aspect extérieur est la manifestation de la nature profonde – pour imposer comme emblème du pays le pyrargue [ou encore l’orfraie], dont la tête blanche et les yeux jaunes signifient noblesse et courage. Ce charognard ne plaisait pas à Benjamin Franklin qui parlait d’un couard lamentable, qui a pour habitude de fuir les oiseaux de la taille d’un moineau et il lui préférait le dindon. Mais le dindon faisait vraiment trop plouk, et le charisme du pyrargue fit que c’est ce dernier qui l’emporta.
Thomas Jefferson n’avait sans doute pas pris le temps de se documenter car on trouvait alors déjà des gens fort sérieux – Catesby : Histoire naturelle de la Caroline, de la Floride, des îles Bahamas 1754 – pour affirmer que les pyrargues, détachée de la branche des vautours d’Afrique il y a quelque millions d’années, ne sont même pas des chasseurs mais juste des charognards.
Et tout récemment, dans Life Histories of North American Birds, 1937, Arthur Cleveland Bent dit que le pyrargue ne mérite guère la distinction d’être l’emblème national. Ses mœurs de charognard, son attitude peureuse et lâche, sa façon d’agresser le balbuzard, plus petit et moins fort, n’inspirent guère le respect.
Un capitaine anglais, George Bowen, témoigne devant l’amirauté de Morlaix sur l’expédition de La Pérouse qu’il a lui-même aperçu, dans son retour du port de Jackson à Bombay, sur la côte de la Nouvelle-Guinée, en mer orientale, les débris du vaisseau de M. de La Pérouse, flottant sur l’eau.
Plus troublant, dans un texte anonyme daté de 1794, l’auteur s’étonne que l’on n’ait pas porté plus attention à un ouvrage publié à Paris, Découvertes dans la mer du Sud. Nouvelles de M. de la Peyrouse jusqu’en 1794 ; traces de son passage trouvées en diverses isles et terres de l’Océan pacifique ; grande isle peuplée d’émigrés français, dans lequel on trouve, en date du 14 mai 1791 : Nous vîmes distinctement un homme qui se promenait sur la cime d’un rocher, et qui faisait des gestes pour nous appeler.
Une chaloupe l’ayant récupéré, il fut amené et présenté à M. de Grivalsa. Il déclara qu’il s’appelait Lepaute d’Orgelet [en fait Lepaute d’Agelet], qu’il était astronome et qu’il avait suivi M. de Lapérouse. L’homme, très affaibli, explique alors que, un incendie s’étant déclaré à bord le 16 mars 1788, tout le monde était descendu, la plupart des membres d’équipage furent massacrés, dont Lapérouse, et que lui et huit autres compagnons purent fuir sur une chaloupe pour arriver sur cette île inhabitée, sans vivres et sans armes, et qu’il était le seul survivant. Le Français, malgré les soins, meurt le 24 mai. [3]
_______________________________________________________________________________________
[1] Il s’agit de la quatrième branche des Orléans, celle qui commence avec Philippe I°, frère de Louis XIV, † 1701, dont le fils fût régent à la mort de Louis XIV, dont le petit-fils fût ce Philippe Egalité, lui-même père de Louis Philippe, dernier roi des Français.
[2] Une chanson n’a pas pour fonction de décrire fidèlement la réalité… certes, mais dans le cas présent, il est intéressant de préciser qu’en fait Louis XVI ne disait pas mon peuple, mais mes peuples, soulignant ainsi combien il avait conscience de la grande diversité de la France.
[3] Ces deux derniers témoignages qui viennent embrouiller les pistes ont été cités pour illustrer la difficulté que peuvent rencontrer les historiens pour distinguer le vrai du faux. En l’état de la recherche actuelle, ils ne semblent pas crédibles et pourtant il y a bien eu dans cette expédition un Lepaute d’Agelet, astronome et horloger.
Laisser un commentaire