| Publié par (l.peltier) le 17 octobre 2008 | En savoir plus |
5 03 1832
Jeanne Villepreux Power, 38 ans vit à Messine où elle a suivi son époux James Power qui y fait des affaires. Autodidacte passionnée, elle fait faire des Aquaria, que l’on nommera gabiolines à la Power, cages à la Power en Angleterre, l’ancêtre de l’aquarium, avant tout pour y observer l’argonauta argo, objet de la grande dispute de biologie marine de l’époque : l’argonauta argo squatte-t-il sa maison comme le fait le Bernard l’ermite ou bien la construit-il lui même ? C’est elle qui va constater qu’il est bien autoconstructeur. Elle va beaucoup publier sur la biologie marine, sera reconnue en Sicile, dans les sociétés savantes de l’époque, mais restera quasiment inconnue en Europe, l’une des raisons étant le naufrage en 1838 du brigantin Bramley sur lequel elle avait 16 caisses de spécimens et d’affaires pour Londres, mais aussi le détournement à leur seul profit de plusieurs mémoires qu’elle avait envoyé à des scientifiques. On la considère aujourd’hui comme la mère de la biologie marine.
mars 1832
L’Académie de médecine de Paris a envoyé deux de ses membres à Varsovie en 1831 pour se renseigner sur une nouvelle maladie, le choléra, apparue en Russie en 1829. Ils en reviennent contaminés et leur entourage de même. Le bilan sera très lourd : 94 666 morts, dont 18 402 dans la capitale. Plus de 1 % des populations du Var et des Bouches du Rhône y succombera. L’épidémie, dont mourront le premier ministre Casimir Périer et d’autres grands personnages, a surtout sévi dans les quartiers pauvres, semant la panique et déclenchant des réactions d’hostilité à l’égard des riches, accusés de répandre le mal. Dans le monde, de 1817 à 1835, on estime à 50 millions les victimes du choléra.
L’irrésistible avancée du fléau était déjà connue : apparu pour la première fois au Bengale en 1817, le choléra s’était arrêté aux portes de l’Europe en 1824. Le déplacement des troupes britanniques et les échanges commerciaux avaient contribué à la propagation d’une première pandémie, du sous-continent indien jusqu’à l’Oural et aux bords de la mer Caspienne. À Java, près de 100 000 personnes avaient péri. En 1826 commença la deuxième pandémie, qui allait cette fois-ci toucher l’Europe en son cœur, puis franchir l’Atlantique, par l’entremise de migrants irlandais partis de leur terre natale vers le Québec.
[…] La deuxième pandémie de choléra, qui sévit à partir de 1826-1827, fut suivie par cinq autres jusqu’au XX° siècle. Durement éprouvée en 1832, la France fut frappée davantage encore en 1853-1854, lors de la troisième pandémie, qui s’étendit de la Chine à l’Amérique du Sud. Cette fois-ci, les soldats français impliqués dans la guerre de Crimée furent à la fois les vecteurs de la maladie, la convoyant des côtes méditerranéennes vers la mer Noire, et ceux qui lui payèrent un lourd tribut. Plus de 140 000 Français furent fauchés par cette nouvelle flambée. Au même moment, de l’autre coté de la Manche, le médecin John Snow identifiait pour la première fois, de manière rigoureuse, la source de contamination la plus fréquente lors des épidémies : l’eau potable et les fontaines auxquelles s’approvisionnaient les citadins étaient l’une des premières causes de propagation de la maladie.
Nicolas Delalande. Histoire Mondiale de la France, sous la direction de Patrick Boucheron et 132 auteurs encadrés par Nicolas Delalande, Florian Mazel, Yann Potin, Pierre Singaravélou. Seuil 2018
On nous l’avait cependant annoncé bien longtemps à l’avance ; on nous avait fait suivre sur la carte rapide sa marche rapide et menaçante […] Le Parisien n’a pas peur du mal qu’il ne voit pas, et comme l’épidémie se faisait attendre, il s’est imaginé qu’elle reculait devant nos calembours… […] On rapportait des exemples de personnes atteintes sur la route, hors de la portée des secours ; et tout le monde ne pouvait pas emporter un médecin dans sa voiture […] La crainte de fuir donna le courage de rester. […] Ce qu’on voulait, c’était le chiffre des morts, ce chiffre terrible qui augmentait sans cesse… Si la mortalité s’accroissait, c’était bon signe, elle ne durerait pas. Si elle diminuait, c’est que le mal touchait à sa fin
Anaïs Bazin, avocat et historien. L’époque sans nom. Esquisses de Paris 1830 – 1833
De quoi s’agit-il au juste ? Est-ce un vent mortel ? Sont-ce des insectes que nous avalons et qui nous dévorent ? […] Le choléra nous est arrivé dans un siècle de philanthropie, d’incrédulité, de journaux, d’administration matérielle.
Chateaubriand. Mémoires d’outre-tombe
J’entendais sous mes fenêtres la rage des ouvriers qui croyaient à une fantastique mesure d’empoisonnement. […] Mais tout le monde disait que le déplacement et le voyage étaient plus dangereux que salutaires, et je me disais aussi que si l’influence pestilentielle s’était déjà, à mon insu, attachée à nous, au moment du départ, il valait mieux ne pas la porter à Nohant, où elle n’avait pas pénétré et où elle ne pénétra pas.
Georges Sand. Histoires de ma vie
La ville était affolée ; elle croyait aux empoisonneurs ; sans cause apparente, elle se ruait sur des hommes inoffensifs, les déchirait et les jetait à la rivière. Les républicains étaient soupçonnés de répandre des matières empoisonnées sur les étaux de boucherie afin de porter préjudice au gouvernement du roi. Dans le faubourg Saint Antoine, des affiches accusaient : Le choléra est une invention de la bourgeoisie et du gouvernement pour affamer le peuple… Aux armes !
Maxime du Camp, ami de Flaubert. Souvenirs littéraires
22 07 1832
Le duc de Reichstadt meurt à 21 ans de tuberculose au palais de Schönbrunn ; Metternich avait interdit à sa mère de venir le voir. Fils unique de Napoléon I°, avec lui s’éteint la succession en ligne directe. Mais les collatéraux ne vont pas tarder à montrer le bout du nez.
3 10 1832
Inauguration du canal du Rhône au Rhin.
1832
Loi Soult : le service militaire est ramené à 7 ans avec tirage au sort. 1° revue féministe : La femme libre.
Victor Hugo poursuit sa guerre commencé sept ans plus tôt contre les démolisseurs du patrimoine bâti : Il faut le dire et le dire haut : cette démolition de la vieille France, que nous avons dénoncé plusieurs fois sous la Restauration se continue avec plus d’acharnement et de barbarie que jamais. Depuis la révolution de juillet, avec la démocratie, quelque ignorance a débordé et quelque brutalité aussi. Dans beaucoup d’endroits, le pouvoir local, le conseil municipal, la curatelle communale a passé des gentilshommes qui ne savaient pas écrire aux paysans qui ne savent pas lire. On est tombé d’un cran. En attendant que ces braves gens sachent épeler, ils gouvernent. La bévue administrative, produit naturel de cette machine de Marly, qu’on appelle la centralisation, la bévue administrative s’engendre toujours comme par le passé du maire au sous-préfet- du sous-préfet au préfet, du préfet au ministre. Seulement, elle est plus grosse.
Notre intention est de n’envisager ici qu’une seule des innombrables formes sous lesquelles elle se produit aux yeux du pays émerveillé. Nous ne voulons traiter de la bévue administrative qu’en matière de monuments, et encore ne ferons-nous qu’effleurer cet immense sujet que vingt-cinq volumes in-folio n’épuiseraient pas.
Nous posons donc en fait qu’il n’y a peut-être pas en France, à l’heure qu’il est, une seule ville, pas un seul chef d’arrondissement, pas un seul chef-lieu de canton où il ne se médite, où il ne se commence, où il ne s’achève la destruction de quelques monument historique national, soit par le fait de l’autorité centrale, soit par le fait de l’autorité locale de l’aveu de l’autorité centrale, soit par le fait des particuliers sous les yeux et avec la tolérance de l’autorité locale.
Nous avançons ici avec la profonde conviction de ne pas nous tromper.et nous en appelons à la conscience de quiconque a fait, sur un point quelconque de la France, la moindre excursion d’artiste et d’antiquaire. Chaque jour quelque vieux souvenir de la France s’en va avec la pierre sur laquelle il était écrit. Chaque jour nous brisons quelque lettre du vénérable livre de la tradition.[…]
Dans le nombre on rencontre certaines gens auxquels répugne ce qu’il y a d’un peu banal dans le magnifique pathos de juillet, et qui applaudissent aux démolisseurs pour d’autres raisons, des raisons doctes et importantes, des raisons d’économistes et de banquier.
À quoi servent ces monuments, disent-ils ? Cela coûte des frais d’entretien et voilà tout. Jetez-les à terre, et vendez les matériaux. C’est toujours cela de gagné. Sous le pur rapport économique, le raisonnement est mauvais. Nous l’avons déjà établi plus haut, ces monuments sont des capitaux. Beaucoup d’entre eux, dont la renommée attire les riches pays en France, rapportent au pays bien au-delà de l’intérêt de l’argent qu’ils ont coûté. Les détruire, c’est priver le pays d’un revenu. […]
Qu’on nous permette de transcrire ici ce que nous disions en 1825 : Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays. Une loi suffirait : qu’on la fasse. Quels que soient les droits de propriété, la destruction d’un édifice historique et monumental ne doit pas être permise à ces ignobles spéculateurs que leur intérêt aveugle sur leur honneur, misérables hommes et si imbéciles qu’ils ne comprennent même pas qu’ils sont des barbares. Il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté ; son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde ; à vous, à moi, à nous. Donc, le détruire, c’est dépasser son droit.
Ceci est une question d’intérêt général, d’intérêt national. Tous les jours, quand l’intérêt général élève la voix, la loi fait taire les glapissements de l’intérêt privé. La propriété particulière a été souvent modifiée dans le sens de la communauté sociale. On vous rachète de force votre champ pour en faire une place, votre maison pour en faire un hospice. On vous rachètera votre monument.
S’il faut une loi, répétons-le, qu’on la fasse. Ici nous entendons les objections s’élever de toutes parts : Est-ce que les chambres ont le temps ? Une loi pour si peu de choses !
Une loi pour si peu de choses !
Comment, nous avons quarante quatre mille lois, dont nous ne savons que faire, quarante quatre mille lois sur lesquelles il y en a à peine dix de bonnes. Tous les ans, quand les chambres sont en chaleur, elles en pondent par centaines, et dans la couvée, il y en a tout au plus deux ou trois qui naissent viables. Eh bien malgré tout, on fait des lois sur tout, contre tout, à propose de tout.
Pour transporter les cartons d’un ministère d’un coté de la rue de Grenelle à l’autre, on fait une loi. Et une loi pour les monuments, une loi pour l’art, une loi pour la nationalité de France, une loi pour les souvenirs, une loi pour les cathédrales, une loi pour les plus grands produits de l’intelligence humaine, une loi pour l’œuvre collective de nos pères, une loi pour l’histoire, une loi pour l’irréparable qu’on détruit, une loi pour ce qu’une nation a de plus sacré après l’avenir, une loi pour le passé ; et cette loi juste, bonne, excellente, sainte, utile, nécessaire, indispensable, urgent, on n’a pas le temps, on ne la fera pas !
Risible ! Risible ! Risible !
Victor Hugo. Guerre aux démolisseurs. Revue des deux mondes 1832
Canal du Rhône au Rhin. Ligne de chemin de fer Saint Étienne Lyon. Première conserverie de sardines aux Sables d’Olonne. En 1860, on en comptera 22 dans le seul Morbihan. Frédéric Sauvage, enfant de Honfleur, invente l’hélice à pales, ou hélice à propulsion, qui va remplacer les roues à aube.
Les bateaux à roues à aube [pour les américains, le sternwheeler a une seule roue à l’arrière, le sidewheeler a deux roues, une sur chaque coté] auront leur grande époque de 1830 à 1870. Leur faible tirant d’eau les destinait à naviguer surtout en eaux calmes : lacs et canaux et cela entraîna dans certains pays d’Europe mais aussi en Amérique un important développement de la navigation fluviale par création d’un réseau de canaux : tout le monde a en tête les images des steamers du Mississippi. En Allemagne : canal de Kiel de la Baltique à la mer du Nord [1887 à 1895], de Rotterdam à Bâle à partir de 1840, et de Rotterdam à la mer du Nord ; aux États-Unis, en 1825, canal du lac Érié qui relie les Grands lacs à New-York, et liaison de l’Atlantique aux Grands Lacs. En 10 ans 4 800 km de canaux furent construits dans l’est des États-Unis. Et bien sur les réseaux préexistants en Grande Bretagne et en Hollande.
L’Irlandais Aeneas Coffey fait breveter sa machine à distiller qui va remplacer dans la fabrication du whisky le traditionnel alambic – analogue à celui que l’on utilise en France pour le Cognac – qui demandait beaucoup de main-d’œuvre et donc en final, imposait pour le whisky un prix élevé ; ce sont 2 colonnes métalliques de 15 mètres de haut, qui permettent de distiller en continu les bouillies de céréales, amenant donc une augmentation considérable de la production et une diminution en conséquence des coûts. Et pour relever le goût de ces alcools, faits de plus en plus avec de l’orge non malté [1], du blé, du maïs, on va les mélanger à des alcools provenant de pur malt pour donner ainsi des blended.
Résumé de Whisky ou Scotch ? Bernard Kapp. Le Monde 5 12 2000
Dans l’Angleterre voisine Earl Grey s’occupe à des choses plus sérieuses : réformer la loi électorale et commercialiser la marque de thé à la bergamote qui porte son nom.
14 05 1833
Mehemet Ali, Khédive d’Égypte, taille des croupières au sultan ottoman et grignote ses territoires : il acquiert ainsi la Syrie dans le cadre de la convention de Kutâhyeh signée sous l’égide de la France et de la Russie.
C’est une des étapes d’une tentative d’évolution importante du Moyen-Orient, sur toile de fond d’un empire ottoman qui commence à être sur le déclin, empire théocratique puisque sans existence hors de l’islam. C’est la naissance d’un nationalisme arabe, avec le rêve d’une grande nation arabe, partout où ils sont présents. Il sera incarné un temps par Ibn Séoud, d’Arabie, puis par Nasser, farouchement laïc. [Khadafi ratera toutes ses tentatives de ce côté-là]. La mort de Nasser laissera un grand vide [son successeur Anouar el Sadate ne sera populaire qu’à l’étranger, pas dans le monde arabe, puisqu’il avait osé faire la paix avec Israël !]. Cette absence de leader nationaliste et charismatique dans le monde arabe laissera le champ libre à une nouvelle offensive du radicalisme musulman, qui finira par susciter le terrorisme qui se dit religieux de Daech, au début du XXI° siècle.
26 07 1833
À Londres, la Chambre des Communes vote l’abolition progressive de l’esclavage dans toutes les colonies britanniques. Le processus d’émancipation est prévu pour se terminer le 1° août 1840. Il est prévu de confortables indemnités pour les planteurs, au total 20 millions de livres. Le Premier ministre whig (ou libéral) Charles Grey soutient l’initiative. Je rends grâce à Dieu d’avoir vécu un tel jour où l’Angleterre accepte de payer 20 millions de livres sterling pour l’abolition de l’esclavage, déclare William Wilberforce. Celui-ci avait réussi à faire interdire la traite en 1807 et, en 1823, participé avec Thomas Fowell Buxton à la fondation de la Société anti-esclavagiste (Anti-Slavery Society), à l’origine de la nouvelle loi. Ces abolitionnistes avaient fait grande publicité au récit autobiographique d’un ancien esclave, affranchi pour finir – The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa the African, written by himself, publié en 1789 ; c’était l’un des très rares témoignages direct des traites négrières, par une de ses victimes. Il faut faire une distinction entre les dates de l’abolition de l’esclavage et la réalité :
Le trafic de contrebande s’est reporté sur la côte angolaise vers Benguela, vers les régions clandestines de Cabinda où le trafic est aux mains d’Africains indépendants, et se poursuivit surtout à partir du Mozambique. Il est signalé sur la côte congolaise jusque dans les années 1890 par les premiers explorateurs de l’arrière-côte. Au Brésil, peut-être un million d’esclaves complémentaire sont arrivés dans le premier tiers du siècle. Environ 750 000 esclaves ont débarqué après 1831, date théorique de la suppression de la traite par le Brésil qui, ce faisant, négociait la reconnaissance de son indépendance par la Grande Bretagne.
Catherine Coquery-Vidrovitch. Les routes de l’esclavage. Histoire des traites africaines, VI° – XX° siècle. Espace libre Albin Michel.2018
Il est des économistes pour dire haut et fort que les mouvements abolitionnistes ont assuré la respectabilité de cette mesure, mais qu’en fait il n’y là qu’une rationalité économique qui fait que, avec l’arrivée de la machine, le coût énergétique de celle-ci est beaucoup moins élevé que celui d’un esclave. Et, ce qui ne gâche rien, la machine, elle, ne se révolte pas. Dans la France du XXI° siècle, Jean-Marc Jancovici est l’un de ces économistes, rappelant entre autres qu’un tracteur développe la même puissance que 600 hommes.
2 10 1833
Jean Rochette et les époux Martin, aubergistes à Peyrebeille – 1 260 m d’altitude – près du Mezenc sur la commune de Lanarce, sont guillotinés devant l’auberge après avoir soit disant trucidé au moins un voyageur pour le dépouiller ; 20 000 personnes ont fait le déplacement pour assister au spectacle ! La légende, le théâtre et le cinéma – Claude Autant Lara – feront d’eux des assassins professionnels en leur attribuant un nombre de crimes sans doute excessif. Pas besoin de studio pour tourner, le site naturel était parfait pour du cinéma d’horreur. Jean Antoine Enjolras avait été découvert deux ans plus tôt, le 26 octobre 1831, au bord de l’Allier, genoux broyés, crâne fracassé. Il avait passé la nuit à l’auberge de Peyrebelle quelques jours plus tôt. Les juges se sont contentés de cela pour envoyer les époux Martin et Jean Rochette à la guillotine. Il n’y avait pas de preuves, il n’y eut pas d’aveux. La médecine légale était encore balbutiante. Les époux Martin, royalistes, étaient une bonne occasion pour des juges républicains d’éliminer ainsi toute velléité de chouannerie.
1833
Ferdinand VII, roi d’Espagne meurt après avoir aboli la loi salique et désigné sa fille Isabelle, 3 ans, pour lui succéder, privant ainsi du trône son frère Charles. C’est donc son épouse Marie Christine qui va assurer la régence. Mais la noblesse préfère Charles, plus absolutiste, et sort les fusils. L’Europe sur laquelle souffle un vent de libéralisme ne peut l’entendre ainsi et vient appuyer les partisans d’Isabelle : Autriche, France Angleterre et même le Portugal, partagé sur la question, et qui, selon le camp, soutient l’un ou l’autre. Et les arrières pensées poussent fort car la grande affaire des monarchies – le mariage – est à la une : une enfant de trois ans, on a le temps de s’entredéchirer avant que de lui trouver un mari. Pour finir, – cela dura treize ans, jusqu’en 1846 – le camp d’Isabelle l’emportera : on lui donnera pour mari son cousin germain François de Bourbon, homosexuel notoire surnommé Paquita ; elle aura tout de même onze enfants dont les pères étaient choisis dans le monde de la culture, de l’armée et de la diplomatie : dans le fond, pour la santé des enfants il y avait peut-être moins de risques à les faire ainsi qu’avec son cousin !
Manifestation contre les machines à vapeur aux mines d’Anzin : les ouvriers détruisent les pompes extrayant l’eau des galeries. Thiers fait adopter la loi sur l’expropriation pour utilité publique. Kuhlmann invente l’acide sulfurique. L’allemand Jakob Friedrich Kammerer crée la première usine d’allumettes : elle avait en fait été inventée par Charles Sauria, (1812 à Poligny, † 1895, dans la misère), en 1831 – allumette à friction – quand il n’était qu’étudiant : son professeur avait alors présenté la découverte aux Allemands… qui en firent bon usage, via un brevet obtenu par le suédois Lönstrom. Charles Sauria devint un modeste médecin de campagne. Début de la parution de la carte d’état major au 1/80 000°, en 274 feuilles : elle sera achevée en 1882. Carte d’état major, comme son nom l’indique, c’est à l’usage de l’état major, c’est à dire des officiers supérieurs… et donc, cela veut dire que les officiers de terrain, les lieutenants, capitaines, et même commandant n’ont pas ces cartes à leur disposition, et quand bien même ils les auraient, on ne leur a pas appris à les lire… La carte est encore entourée de secret. L’île de Sumatra connaît un séisme de magnitude 9. L’archipel des Malouines devient anglais, et il va le rester… scrogneugneu. Frédéric Ozanam fonde la Société de Saint Vincent de Paul, et Vidocq le Bureau de Renseignements pour le commerce, ancêtre des Agences de notation, lesquelles, dès le départ donc, furent marquées du sceau du milieu : François Eugène Vidocq n’était pas Frédéric Ozanam. Condamné très tôt au bagne, – le chemin de Paris à Brest s’effectue à pied, enchaîné aux autres bagnards – il échoue dans deux tentatives d’évasion, réussit la troisième, est repris et enfermé au bagne de Toulon d’où il s’évade en 1800. En 1809, il propose ses services d’indic à la préfecture de police de Paris, avec un succès certain, puisque, deux ans plus tard, le préfet le nomme à la tête de la Brigade de sûreté, constituée d’anciens condamnés qui ont pour mission d’infiltrer le milieu. Il va y déployer toutes ses qualités, y imposant des registres avec un système de fiches et introduisant la criminalistique en systématisant les études balistiques ou les prises d’empreintes digitales comme celle de chaussures ; il se fera autant d’ennemis chez les voyous que chez les policiers, tant et si bien qu’il démissionnera en 1827, et publiera ses mémoires un an plus tard : gros succès. Le personnage inspirera à Honoré de Balzac son Vautrin de la Comédie Humaine, à Alexandre Dumas père le policier Jackal des Mohicans de Paris, et à Victor Hugo plusieurs personnages des Misérables : Jean Valjean, Inspecteur Javert, Thénardier, et même des écrivains anglais comme Conan Doyle, Herman Melville.

Eugène François Vidocq, dans The Illustrated London News, 29 mars 1845. | Artiste inconnu / The Illustrated London News / domaine public via Wikimedia Commons
Chateaubriand est allé rendre visite à Charles X, en exil à Prague : Je gravis des rues silencieuses, sombres, sans réverbères, jusqu’au pied de la haute colline que couronne l’immense château des rois de Bohème. L’édifice dessinait sa masse noire sur le ciel ; aucune lumière ne sortait de ses fenêtres ; il y avait là quelques chose de la solitude, du site et de la grandeur du Vatican, ou du Temple de Jérusalem vu de la vallée de Josaphat. On n’entendait que le retentissement de mes pas et de ceux de mon guide ; j’étais obligé de m’arrêter par intervalles sur les plateformes des pavées échelonnés, tant la pente était raide. À mesure que je montais, je découvrais la ville au-dessous. Les enchaînements de l’histoire, le sort des hommes, la destruction des empires, les desseins de la Providence se présentaient à ma mémoire en s’identifiant aux souvenirs de ma propre destinée.
Chateaubriand. Mémoires d’outre-tombe.
Premier réseau rationnel d’égouts à Partis créé pour recueillir les eaux de pluies et celles du nettoyage des rues, déversées par les bornes fontaines. Les égouts peu à peu permettent à l’eau de circuler sous la ville qui parallèlement se développe et respire : ses déchets sont drainés par le réseau souterrain qui la débarrasse de ses eaux usées, acheminées vers les champs d’épandage pour fertiliser les cultures autour de la capitale.
1 01 1834
Entrée en vigueur du Zollverein, union douanière allemande. Le 22 mars 1833, la Bavière, le Wurtemberg, la Prusse et la Hesse avaient déjà signé un accord qui abolissait entre eux toute frontière douanière. Le 10 mai, ils avaient été rejoints par les États d’Allemagne centrale, déjà liés par une convention identique : l’union économique de l’Allemagne était dès lors réalisée. Mais on avait compris depuis la fin des guerres napoléoniennes qu’il fallait parler de cela dès l’enfance : Guillaume de Humboldt, le frère d’Alexandre, était alors ministre des cultes et de l’enseignement en Prusse et avait mis en place l’enseignement de la géographie dès l’école primaire ; des livres avaient été édités, reproduisant les paysages d’Allemagne. C’est là qu’est née la géographie en tant que matière donnant lieu à être intégrée aux programmes d’enseignement. En 1853, cette union refusera l’admission de l’Autriche : la volonté d’union politique était déjà dans l’air, et pour ce faire, Bismarck trouvera le terrain déjà bien préparé.
08 1834
Alphonse de Lamartine est assis sur les marches du Parthénon et digresse sur le traduttore, traditore italien [traduction, trahison] : De tous les livres à faire, le plus difficile à mon avis, c’est la traduction. Or, voyager, c’est traduire ; c’est traduire à l’œil, à la pensée, à l’âme du lecteur, les lieux, les couleurs, les impressions, les sentiments que la nature ou les monuments humains donnent au voyageur. Il faut à la fois savoir regarder, sentir et exprimer ; et exprimer comment ? Non pas avec des lignes et des couleurs, comme le peintre, chose facile et simple, non pas avec des sons, comme le musicien, mais avec des mots, avec des idées qui ne renferment ni sons ni lignes, ni couleurs. Ce sont les réflexions que je faisais assis sur les marches du Parthénon, ayant Athènes et le bois d’olivier du Pirée, et la mer bleue d’Égine devant les yeux, et sur ma tête l’ombre majestueuse de la frise du temple des temples. Je voulais emporter pour moi un souvenir vivant, un souvenir écrit de ce moment de ma vie ! Je sentais que ce chaos de marbre si sublime, si pittoresque dans mon œil, s’évanouissait de ma mémoire, et je voulais pouvoir le retrouver dans la vulgarité de ma vie future. Écrivons donc : ce ne sera pas le Parthénon, mais ce sera du moins une ombre de cette grande ombre qui plane aujourd’hui sur moi. Du milieu des ruines qui furent Athènes et que les canons des Grecs et des Turcs ont pulvérisées et semées dans toute la vallée et sur les deux collines où s’étendait la ville de Minerve, une montagne s’élève à pic de tous les cotés – d’énormes murailles l’enceignent ; et, bâties à leur base de fragments de marbre blanc, plus haut avec les débris de frises et de colonnes antiques, elles se terminent dans quelques endroits par des créneaux vénitiens. Cette montagne ressemble à un magnifique piédestal, taillé par les dieux mêmes pour y asseoir leurs autels.
16 10 1834
Incendie du Palais de Westminster, épargné par l’incendie de Londres en 1666 : seuls Westminster Hall, la tour des Joyaux, la crypte de la chapelle Saint-Étienne et les cloîtres échappent à la destruction. Les Londoniens hésiteront longtemps entre reconstruire en gothique ou en classique… le gothique finira par l’emporter. En 1836, après l’examen de 97 propositions, la commission royale optera pour l’architecte Charles Barry. La première pierre sera posée en 1843, la Chambre des Lords achevée en 1847 et la Chambre des Communes en 1852. La plupart des travaux seront réalisés avant 1860, les derniers en 1867.
1834
Canal de Bourgogne, creusé par les forçats de terre, des vagabonds sortis pour l’occasion de leur maison de force. Xavier Jouvin modernise la ganterie grenobloise : il augmente le nombre de tailles, invente l’emporte pièce. À la fin du second empire, la ganterie fera travailler près de la moitié des ouvriers grenoblois. Création dans le cadre départemental du Certificat d’Études Primaires. Les Boers, colons d’origine hollandaise établis dans la région du Cap, s’opposent à la domination britannique ; l’abolition de l’esclavage est le principal différent qui oppose les deux communautés ; emmenés par Pretorius, les Boers vont migrer vers le nord pendant 5 ans, en quête de la Terre promise que Dieu leur a forcément, réservé quelque part à leur intention en Afrique – c’est le Grand Trek -. Après avoir affronté et vaincu les Zoulous, ils fondent les États du Natal, d’Orange et du Transvaal, que Londres mettra vingt ans à reconnaître, au grand dam des colons anglais de la colonie. Mis à part l’universalité de la souveraineté anglaise, le Canada est un foyer de tensions, la dissension première étant celle qui oppose Canadiens francophones et Canadiens anglophones : Louis Joseph Papineau, chef du parti patriote du Bas Canada, le Canada francophone, adresse à Londres 92 résolutions pour obtenir plus de représentation démocratique au Parlement du Bas Canada : ces propositions seront quasiment toutes rejetées par les 10 propositions de Russel en 1837, ce qui va enclencher de 1837 à 1838 une véritable guerre civile – la rébellion des Patriotes -.
À 22 ans, l’américain Cyrus Hall McCormick, dépose le brevet d’une moissonneuse mécanique tractée par un cheval ; constituée d’un rabatteur qui couche le blé et d’une roue porteuse qui actionne une scie, elle connaîtra un grand succès.
À cette période, c’est Alfred de Musset qu’Aurore Dupin, baronne Dudevant, alias George Sand avait pour amant. Elle lui écrit en stéganographie, – l’art de la dissimulation, une invention de Johannes Zeller de Heidenberg, en français Jean Trithème, (1462-1516) – une lettre d’amour apparemment très classique ; mais, si on enlève une ligne sur deux, cela devient de l’érotisme bien cru ! Il n’est pas certain qu’elle en soit l’auteur, car on ne la retrouve pas dans la publication de leur correspondance ; mais, quel qu’il soit, l’auteur possédait une belle maîtrise de la langue et en jouait en virtuose ; quant à Alfred de Musset, on comprend mieux qu’il se soit lassé rapidement de cet érotisme mondain ; elle me fatigue...
Je suis très émue de vous dire que j’ai
bien compris, l’autre jour, que vous avez
toujours une envie folle de me faire
danser. Je garde un souvenir de votre
baiser et je voudrais que ce soit
là une preuve que je puisse être aimée
par vous. Je suis prête à vous montrer mon
affection toute désintéressée et sans cal-
cul. Si vous voulez me voir ainsi
dévoilée, sans aucun artifice mon âme
toute nue, daignez donc me faire une visite.
Et nous causerons en amis et en chemin.
Je vous prouverai que je suis la femme
sincère capable de vous offrir l’affection
la plus profonde et la plus étroite
amitié, en un mot, la meilleure amie
que vous puissiez rêver. Puisque votre
âme est libre, alors que l’abandon où je
vis est bien long, bien dur et bien souvent
pénible, ami très cher, j’ai le cœur
gros, accourez vite et venez me le
faire oublier. À l’amour, je veux me sou-
mettre entièrement.
Votre poupée
01 1835
À Bahia – Brésil – 1 500 Malé – les Noirs musulmans qui savent lire et écrire l’arabe – se soulèvent avec à leur tête, Manuel Calafate, Aprigio, Pao Inácio, pour libérer leurs compagnons musulmans, en tuant les Blancs et les mulâtres considérés comme traitres. Ils sont armés mais sont dénoncés par un esclave : massacrés par la Garde Nationale, par la police et par des civils armés. 7 morts du côté des Blancs, 70 du côté des Noirs. 200 esclaves seront déférés devant les tribunaux, dont les condamnations iront de la peine de mort aux travaux forcés, au bannissement et au fouet. Plus de 500 Africains seront expulsés du Brésil et réembarqués vers l’Afrique.
02 1835
Un certain chevalier d’Asda et Clavière font rouler sur les grands boulevards une diligence à vapeur, en présence du couple royal, qui les en félicite. Ils n’avaient en fait rien inventé, s’étant contenté d’importer cette machine d’Angleterre, sans la payer à son inventeur, Macerone, qui ainsi fût ruiné.
21 06 1835
Trait de courage d’un chasseur [2] des Alpes, dans le Val Montjoie, rapporté – sic -par Samivel dans La grande ronde autour du Mont Blanc. Glénat 1987.
Ce soir là, les bergers de Nanboran se retiraient tranquillement avec leurs troupeaux lorsque tout à coup il est sortis de la forès voisine un énorme ours blanc (sic). L’alarme s’en est donnée… L’épouvante, etc. Le lendemain Lubin Mollard, jeune et habile chasseur suit les traces de l’annimal carnivore et d’une main sure ajuste un coup de carabine à son adversaire. L’ours pousse des urlements épouvantables et vien droit sur les chasseur qui lui ajuste un second coup. L’annimal revient plus fort que jamais. Le chasseur ne pouvant s’enfuir vu que derrière il y avait un énorme précipice n’a eu que le temps d’enfoncer sa balle à six pouces de profondeur et sans se déconserter lui ajuste un troisième coup qui lui casse l’épaule. L’annimal revient une troisième fois avec une gueule écumante des yeux étincelan de rage mais ne peut franchir un petit escarpement à cause de sa blessure et cherche un autre chemain. Alors le chasseur a eu le temps de mettre son arme en état de se défendre de nouveau, ayant soin de monter sur les pointes de rocher dont l’ours ne pouvait l’atteindre. L’annimal allait être au sommet de la montagne là ou commencent les Glaciaires Eternelles. Notre jeune homme croyant de perdre sa proie redouble de courage et d’habileté, et parvien à lui couper chemain, lui ajuste son coup sur la tête. Voilà l’ours qui tombe comme mort mais repart aussi vite… Le chasseur lui ajuste son neufyème coup qui lui ouvre le crâne. L’annimal tombe mort. Le chasseur s’en approche mais il ne pouvait le remuer tant il était lourd. Il l’a glissé sur une colline de neige durcie jusqu’au bas de la montagne. Cet là ou s’est rassemblé tous les jeunes pâtre. Ils l’ont emporté à la chaumière du chasseur comme en espèce de triomphe en le félicitant de son intrépidité. Louange qui lui était bien dû… Lui seul a ozé l’attaquer, lui seul la vincu.
L’écriture est celle, sinon d’un illettré, du moins d’un homme qui n’est pas resté bien longtemps à l’école. Mais, même écrits convenablement, les idiomes locaux réservent des surprises : La toponymie de la région est intrigante et réserve bon nombre de surprises et de faux amis. Vous regardez le mont Rose en imaginant de glorieux couchers de soleil rougeoyant sur les neiges éternelles ; pas du tout, car rosa, ou reuse, veut dire glacier en patois local. Il s’agit simplement d’une montagne recouverte de glace. L’aiguille du Brouillard vous inquiète : vous la considérez avec respect, elle et sa brume permanente qui la rend inaccessible. Mais non : brouillard est une déclinaison valdotaine de brolliat ou breuil, un simple petit bois marécageux. Le col de la Roue est une déformation de Yarou, abrupt en patois de Maurienne, et le hameau Les Fesses vient des faisses, une bande de pré entourée de futaies. Quand il s’est agi, à la fin du XIX° siècle, de nommer les sommets, les cols et les pics, les paysans les ont souvent désignés aux alpinistes à partir des bois, des prés, des glaces, des eaux, des grottes, des roches, ou des champs, des cultures, des chemins, des constructions, des habitations qui se trouvaient à leur pied. Ni le sublime, ni la poésie, ni même le curieux, n’ont, bien souvent, leur place dans la toponymie de la montagne, qui préfère le concret, le banal, la proximité quotidienne, regardant vers ce qu’il y a en bas plutôt que ce qui se voit en haut. Parfois, cependant, les légendes et les croyances traditionnelles s’immiscent dans cette langue terre à terre pour offrir quelques saut du Diable, grotte aux Fées, plan des Dames. Marcher sur ce chemin la carte à la main revient à réactiver les patois valdotain, savoyard, valaisan, qui continuent à vivre dans cette lecture du relief, du paysage ancestral, du mode de vie pastoral, où les torrents sont des nants, des dorons, la grotte une balme, la forêt une joux, l’avalanche un lavancher, la maison d’alpage un chalet, le col un forclaz, le pierrier un clapier, une casse ou une ravine, le pin sylvestre une daille, le hêtre un fayet ou un fou, l’abreuvoir un bachu ou un bachasson, les hauts pâturages des chaux et l’étable voûtée d’altitude une crottes.
Antoine de Baecque. La Traversée des Alpes NRF Gallimard 2014
Des études plus fines montreraient très certainement que ce patois savoyard, dit franco-provençal a emprunté très souvent des mots à la langue d’Oc, en les déformant juste pour les personnaliser : il en va ainsi de la baume occitane qui devient la balme, le clapas occitan un clapier, la faïsse (terrasses cultivées), une fesse. Quelquefois le mot vient même directement du latin : ainsi le fagus latin – hêtre- devient fayet.
La prestigieuse collection nrf Gallimard nous avait habitués à des livres d’une autre pointure. Curieux homme que cet Antoine de Baecque, tout Normalien qu’il soit et fort en vue dans le monde historico-culturel : il ne cesse de vitupérer contre la société de consommation et dans le même temps ne cesse de dire son addiction à L’Équipe, qu’il a tant de mal à trouver sur son chemin… le supporter accro du foot qui ne supporte pas la société de consommation ! y’a comme un gros couac ! Il devrait créer une association pour la promotion du foot et de l’écologie : ça ferait sinon un tabac, au moins des étincelles. La plus grande crainte du monsieur : le profond ennui qui l’envahit à se trouver seul dans un refuge avec quelques heures sans rien à faire. C’est vrai quoi ! on devrait avoir la télé dans les refuges ! La solitude, c’est un machin absolument insupportable ! On se retrouve face à soi-même et si on a la peur du vide, c’est terriblement anxiogène !
Faute de pouvoir lire l’Équipe, le bonhomme s’occupe de lui : Deux réveils, le premier vers une heure, pour me masturber sur l’image d’une fille sodomisée, trouvée dans un bout de magazine porno déchiré dans un coin obscur du refuge hier soir. Misère sexuelle des marcheurs solitaires. (page 150)
Pôv garçon ! Heureusement que tous les autres solitaires du monde nous fichent la paix avec leur sexualité, entre les navigateurs solitaires, les explorateurs, les prisonniers, les innombrables déportés, les soldats, les ouvriers sur des chantiers lointains, sur les barges de pétrole off-shore, encore bon nombre de religieux et de prêtres, sans oublier les cosmonautes etc… c’est que ça en fait du monde ! Les récits ne seraient plus qu’une masturbation permanente, 24 h/24, sept jours sur sept. Et si cette immense majorité de solitaires occasionnels ou permanents ne s’exhibe pas comme de Baecque, c’est tout simplement que la notion de pudeur prévaut chez eux. Mais quand on est un gauchiste patenté, on est transparent, n’est-ce pas, on dit tout, TOUT ! Alors, la pudeur, vous pensez-bien : ce n’est qu’un vieux machin de catho psycho frigide, bon pour la poubelle, n’est-ce pas ? Pas une seconde ne lui vient en tête qu’en la matière, la transparence est synonyme d’exhibitionnisme, et que la pudeur est encore la meilleure façon de ne pas enquiquiner les autres avec son petit tas de secrets. On peut raconter ces histoires à un médecin ou à un psy, mais les choses sont claires : on les paie pour cela. Pour ses vieux jours, il pourrait ouvrir un gîte d’étape qu’il nommerait en toute transparence À la p’tite branlette, avec en invite : Pour tromper l’ennui mortel du refuge, vous pouvez lire L’Équipe et consulter les sites porno de votre choix sur internet : 2 € la demi-heure. Et on y passerait en boucle : Et l’on s’en fout d’attraper la vérole, et l’on s’en fout pourvu qu’on tire un coup. Antoine de Baecque n’est qu’un énervé de la ville, incapable du moindre paragraphe pour dire la beauté du monde, incapable de goûter la solitude, faisant son GR comme un militaire qui remplit une mission, je n’ai pas à avoir d’états d’âme, moi, scrogneugneu ! Plus tocard qu’authentique. Bobo tendance Libé : la cohérence, c’est pas ma tasse de thé. La posture tient lieu de personnalité. Le paysan est devenu exploitant agricole et le randonneur devient technicien de la montagne, brandissant bien haut à longueur de pages les couleurs de la FFR et de ses créateurs… tant il est vrai qu’il n’est pas donné au premier Normalien venu de jouer dans la même cour que Jacques Lacarrière, Nicolas Bouvier ou Samivel.
28 07 1835
Giuseppe Fieschi, Corse râblé, avec une campagne de Russie à son palmarès puis un service et trahison auprès de Murat à Naples, a bricolé un arsenal de 25 fusils au 3° étage du 50, boulevard Saint Martin où passe Louis Philippe et ses trois enfants : on célèbre le 5° anniversaire de la Révolution de juillet : il y a de quoi balayer les 12 mètres de large du boulevard. Fieschi met le feu à la traînée de poudre qui court le long des lumières des canons : les balles font un carnage dans le cortège, mais 3 des 25 fusils lui pètent aussi à la figure, le blessant grièvement. On comptera 18 morts et une vingtaine de blessés graves. Il avait deux complices, aussi tordus que lui : c’est l’un d’eux qui avait bourré trois fusils de mitraille pour qu’ils explosent et le tuent. Tous trois seront exécutés six mois plus tard.
11 09 1835
La machine à vapeur de Charles Dietz va de la Nation à Versailles en 1 h 15’ en tirant une diligence de trente deux personnes. Le 14 juin suivant, à l’occasion de l’inauguration de la ligne, François Arago exprimera ses doutes quant aux effets sur l’organisme des changements brusques de température et de son lorsque le train passe dans un tunnel.
Je me suis réconcilié avec les chemins de fer ; c’est décidément très beau. Le premier que j’avais vu n’était décidément qu’un chemin de fabrique. J’ai fait hier la course d’Anvers à Bruxelles, et le retour. Je partais à quatre heures dix minutes et j’étais revenu à huit heures un quart, ayant dans l’intervalle passé cinq quarts d’heure à Bruxelles, et fait vingt-trois lieues en France. C’est un mouvement magnifique qu’il faut avoir senti pour s’en rendre compte. La rapidité est inouïe. Les fleurs du bord de chemin de fer ne sont plus des fleurs, ce sont des tâches ou plutôt des raies rouges ou blanches ; plus de points, tout devient raie ; les blés sont de grandes chevelures jaunes, les luzernes sont de longues tresses vertes ; les villes, les clochers et les arbres dansent et se mêlent follement à l’horizon ; de temps en temps, une ombre, une forme, un spectre debout paraît et disparaît comme l’éclair à côté de la portière ; c’est un garde du chemin qui, selon l’usage, porte militairement les armes au convoi. On se dit dans la voiture : c’est à trois lieues, nous y serons dans dix minutes. Le soir, comme je revenais, la nuit tombait ; j’étais dans la première voiture. Le remorqueur flamboyait devant moi avec un bruit terrible, et de grands rayons rouges, qui teignaient les arbres et les collines, tournaient avec les roues. Le convoi qui allait à Bruxelles a rencontré le nôtre. Rien d’effrayant comme ces deux rapidités qui se côtoyaient et qui, pour les voyageurs, se multipliaient l’une par l’autre. On ne se distinguait pas d’un convoi à l’autre ; on ne voyait passer ni des wagons, ni des hommes, ni des femmes, on voyait passer des formes blanchâtres ou sombres dans un tourbillon. De ce tourbillon sortaient des cris, des rires, des huées. Il y avait de chaque côté soixante wagons, plus de mille personnes ainsi emportées, les unes au nord, les autres au midi, comme par l’ouragan.
Il faut beaucoup d’efforts pour ne pas se figurer que le cheval de fer est une bête véritable. On l’entend souffler au repos, se lamenter au départ, japper en route ; il sue, il tremble, il siffle, il hennit, il se ralentit, il s’emporte ; il jette tout le long de la route une fiente de charbons ardents et une urine d’eau bouillante : d’énormes raquettes d’étincelles jaillissent à tous moments de ses roues ou de ses pieds, comme tu voudras ; et son haleine s’en va sur vos têtes en beaux nuages de fumée blanche qui se déchirent aux arbres de la route.
On comprend qu’il ne faut pas moins que cette bête prodigieuse pour traîner ainsi mille ou quinze cents voyageurs, toute la population d’une ville, en faisant douze lieues à l’heure. Après mon retour, il était nuit, notre remorqueur a passé près de moi dans l’ombre se rendant à son écurie, l’illusion était complète. On l’entendait gémir dans son tourbillon de flamme et de fumée comme un cheval harassé.
Il est vrai qu’il ne faut pas voir le cheval de fer ; si on le voit, toute la poésie s’en va. À l’entendre, c’est un monstre, à le voir, ce n’est qu’une machine. Voilà la triste infirmité de notre temps : l’utile tout sec, jamais le beau. Il y a quatre cents ans, si ceux qui ont inventé la poudre avaient inventé la vapeur, et ils en étaient bien capables, le cheval de fer eut été autrement façonné et autrement carapaçonné ; le cheval de fer eut été quelques chose de vivant comme un cheval et de terrible comme une statue. Quelle chimère magnifique nos pères eussent faite avec ce que nous appelons la chaudière ! Te figures-tu cela ? De cette chaudière, ils eussent fait un ventre écaillé et monstrueux, une carapace énorme, de la cheminée une corne fumante ou un long cou portant une gueule pleine de braise ; ils eussent caché les roues sous d’immenses nageoires ou sous de grandes ailes tombantes ; les wagons eussent eu aussi cent formes fantastiques, et le soir, on eut vu passer près des villes tantôt une colossale gargouille aux ailes déployées, tantôt un dragon vomissant le feu, tantôt un éléphant la trompe haute, haletant et rugissant, effarés, ardents, fumants, formidables, traînant après eux comme des proies cent autres monstres enchaînés, et traversant les plaines avec la vitesse, le bruit et la figure de la foudre. C’eût été grand.
Mais nous, nous sommes de grands marchands bien bêtes et bien fiers de notre bêtise. Nous ne comprenons ni l’art, ni la nature, ni l’intelligence, ni la fantaisie, ni la beauté et ce que nous ne comprenons pas, nous le déclarons inutile du haut de notre petitesse. C’est fort bien. Où nos ancêtres eussent vu la vie, nous voyons la matière. Il y a dans la machine à vapeur un magnifique motif pour un statuaire ; les remorqueurs étaient une admirable occasion pour faire revivre ce bel art du métal traité au repoussoir. Qu’importe à nos tireurs de houille. Leur machine telle qu’elle est dépasse déjà de beaucoup la portée de leur lourde admiration. Quant à moi, on me donne Watt tout nu, je l’aimerais mieux habillé par Benvenuto Cellini.
Victor Hugo. En voyage. France et Belgique, 1837
Victor Hugo est beaucoup plus convaincant quand il se fait défenseur des monuments anciens que détracteur de l’esthétique industrielle, résolument inapte à envisager que ces formes nouvelles puissent représenter une esthétique… et que je rêve de l’habiller en monstre, en n’importe quoi, mais l’habiller que diable ! Et cinquante ans plus tard, face à la Tour Eiffel, Huysmans déploiera avec un grand talent le même obscurantisme pour la dézinguer. Mais la Tour Eiffel, contrairement au programme initial, résistera au temps, finira par faire partie du paysage et il faudra bien admettre qu’il y aura toujours une catégorie de personnes, le plus souvent fort cultivées, totalement allergiques au nouveau, qu’il se nomme encore plus tard Beaubourg ou Pyramide du Louvre.
28 11 1835
Pierre François Lacenaire, le monstre bourgeois, est en prison pour double meurtre : condamné à mort quinze jours plus tôt, la sentence sera exécutée le 9 janvier 1836 ; en attendant, crâne, monsieur versifie :
Salut à toi, ma belle fiancée
Qui dans tes bras va m’enlacer bientôt
À toi ma dernière pensée
Je fus à toi dès le berceau.
Salut ô guillotine ! expiation sublime,
Dernier article de la loi
Qui soustrais l’homme à l’homme et le rends pur de crime
Dans le sein du néant, mon espoir et ma foi.
Pierre François Lacenaire. Extrait de Dernier chant.
28 12 1835
En Amérique, chaque tribu indienne a joué sa propre partition face au gouvernement fédéral : Choctaws et Chickasaws ont rapidement accepté de s’expatrier à l’ouest, au-delà du Mississippi. Les Creeks se sont obstinés mais ont fini par le faire sous la contrainte. Les Cherokees pratiquent une résistance passive. Seuls les Séminoles, vivant en Floride, décident de combattre le gouvernement et ce jour-là, ils attaquent une colonne de cent dix soldats, ne laissant que trois survivants : l’un d’eux racontera : Il était huit heures. J’ai entendu soudainement un coup de feu (…) suivi d’un tir de mousquet. (…) Je n’ai pas eu le temps de me demander ce que cela signifiait que déjà une salve de quelque mille fusils était tirée sur notre front et le long de notre flanc gauche. (…) Je pouvais seulement voir leurs têtes et leurs bras émerger des hautes herbes, tout près et plus loin ainsi que de derrière les pins. Quelque quarante ans plus tôt, le général Georges Washington conseillait ainsi un officier : Général Saint Clair, en trois mots : attention aux surprises (…) Encore et toujours : attention aux surprises. La guerre dura 8 ans, coûta la vie à 1 500 soldats et 20 millions $.
1835
Charles Albert, roi de Sardaigne, développe une politique concernant les voies de chemin de fer avec un plan et une vision d’ensemble tout à fait exceptionnels : il veut construire un véritable réseau de communications internationales, en reliant son petit royaume aux nations du Nord et de l’Ouest, au-delà des montagnes. Le premier, il conçoit l’idée d’une tunnel ferroviaire sous le Mont Cenis.
Le royaume sarde fût le premier à proposer que les locomotives ne s’arrêtent pas aux frontières, – Jean Berge 1911 – tandis que les voies ferrées françaises furent construites n’ayant aucun plan d’ensemble et n’ayant d’autre idée que de souder la capitale aux grands centres de province – F. de Lannot de Bissy.
Mais, dans les auberges de Naples, la qualité du service est encore bien rustique, le moustique bien virulent ; Alexandre Dumas s’en fait l’écho : Une auberge italienne est une habitation assez tolérable encore l’été ; mais l’hiver, attendu qu’aucune précaution n’a encore été prise contre le froid, c’est quelques chose dont on ne peut se faire aucune idée. On arrive glacé, on descend de voiture, on demande une chambre ; le maitre de maison, sans se déranger de sa sieste, fait signe au garçon de vous conduire. Vous le suivez, dans la confiance que vous avez de trouver un abri ; erreur, vous entrez dans un énorme galetas aux murs blancs, dont l’aspect seul vous fait frissonner. Vous parcourez des yeux votre nouvelle demeure, votre vue s’arrête sur une petite fresque ; elle représente une femme nue, en équilibre au bout d’une arabesque ; rien que de la voir vous grelottez. Vous vous retournez vers le lit, vous trouvez qu’on le couvre d’une espèce de châle de coton et une courtepointe de basin blanc ; alors les dents vous claquent. Vous cherchez de tous côtés la cheminée, l’architecte l’a oubliée : il faut en prendre votre parti. En Italie, on ne sait pas ce que c’est que le feu ; l’été on se chauffe au soleil, l’hiver au Vésuve ; mais comme il fait nuit et que vous êtes à quatre-vingt lieues de Naples, vous vous empressez de fermer les fenêtres. Cette opération accomplie, vous vous apercevez que les carreaux sont cassés ; vous en bouchez un avec votre mouchoir roulé en tampon, vous murez l’autre avec une serviette tendue en toile. Vous vous croyez enfin barricadé contre le froid ; alors vous voulez fermer votre porte ; la serrure manque ; vous poussez votre commode contre, et vous commencez à vous déshabiller. À peine avez-vous ôté votre redingote, que vous sentez un coulis atroce : ce sont les panneaux qui ont joué, et qui ne touchent ni du haut ni du bas ; alors vous détachez les rideaux des fenêtres et vous en faires des rouleaux ; puis, quand tout est bien calfeutré, quand vous le croyez, du moins, vous faites le tour de votre appartement avec votre bougie. Un dernier courant d’air, que vous n’avez pas encore senti, vous la souffle dans les mains. Vous cherchez une sonnette, il n’y en a pas ; vous frappez du pied pour faire monter quelqu’un, votre plancher donne sur l’écurie. Vous dérangez votre commode, vous tirez vos rideaux de leur fente, vous rouvrez votre porte et vous appelez : peine perdue, tout le monde dort ; et quand on dort, on ne se réveille pas, en Italie : c’est aux voyageurs de se procurer eux-mêmes ce dont ils ont besoin… Et comme, à tout prendre, c’est encore de votre lit que vous avez le plus à faire, vous le gagnez encore à tâtons, vous vous couchez suant d’impatience, et vous vous réveillez raide de froid.
L’été, c’est autre chose ; tous les inconvénients que nous venons de signaler, disparaissent pour faire place à un seul, mais qui, à lui seul, les vaut tous : les moustiques. Il n’est point possible que vous n’ayez pas entendu parler de ce petit animal, qui affectionne particulièrement le bord de la mer, des lacs et des étangs ; il est à nos cousins du nord ce que la vipère est à la couleuvre. Malheureusement, au lieu de fuir l’homme et de se cacher dans les endroits déserts comme celle-ci, il a le goût de la civilisation, la société le réjouit, la lumière l’attire : vous avez beau tout fermer, il entre par les trous, par les fentes, par les crevasses : le plus sur est de passer la soirée dans une autre chambre que celle où l’on doit passer la nuit ; puis, à l’instant même où l’on compte se coucher, de souffler sa bougie et de s’élancer vivement dans l’autre pièce. Malheureusement, le moustique a les yeux du hibou et le nez de l’hyène ; il vous voit dans la nuit, il vous suit à la piste, si toutefois, pour être plus sûr encore de son affaire, il ne se pose pas sur vos cheveux. Alors, vous croyez l’avoir mis en défaut, vous vous avancez en tâtonnant vers votre couchette, vous renversez un guéridon chargé de vieilles tasses de porcelaine que, le lendemain, on vous fera payer pour neuves ; vous faites un détour pour ne pas vous couper les pieds sur les tessons, vous atteignez votre lit, vous soulevez avec précaution la moustiquaire qui l’enveloppe, vous vous glissez sous votre couverture comme un serpent, et vous vous félicitez de ce que, grâce à ce faisceau de précautions, vous avez acheté une nuit tranquille ; l’erreur est douce, mais courte : au bout de cinq minutes vous entendez un petit bourdonnement autour de votre figure; autant vaudrait entendre le craquement du tigre et le rugissement du lion. Vous avez enfermé votre ennemi avec vous ; apprêtez-vous à un duel acharné : cette trompette qu’il sonne est celle du combat à outrance. Bientôt, le bruit cesse ; c’est le moment terrible : votre ennemi est posé où ? vous n’en savez rien ; à la botte qu’il va vous porter il n’y a pas de parade. Tout à coup vous sentez la blessure, vous y portez vivement la main, votre adversaire a été plus rapide encore que vous et cette fois vous l’entendez qui sonne la victoire ; le bourdonnement infernal enveloppe votre tête de cercles fantastiques et irréguliers, dans lesquels vous essayez vainement de le saisir, puis une seconde fois le bruit cesse. […] Une minute après, le bourdonnement satanique recommence : oh alors, vous rompez toute mesure, votre imagination se monte, votre tête s’exaspère, vous sortez de votre couverture, vous ne prenez plus aucune précaution contre l’attaque, vous vous levez tout entier dans l’espoir que votre protagoniste commettra quelque imprudence, vous vous battez le corps des deux mains, comme un laboureur bat la gerbe avec un fléau ; puis enfin, après trois heures de lutte, sentant que votre tête se perd, que votre esprit s’égare, sur le point de devenir fou, vous retombez épuisé, anéanti de fatigue, écrasé de sommeil; vous vous assoupissez enfin. Votre ennemi vous accorde une trêve, il est rassasié : le moucheron fait grâce au lion ; le lion peut dormir.
Le lendemain, vous vous réveillez, il fait grand jour ; la première chose que vous apercevez, c’est votre infâme moustique cramponné à votre rideau, et le corps rouge et gonflé de votre plus pur sang ; vous éprouvez un moment d’effroyable joie, vous approchez la main avec précaution, et vous l’écrasez le long du mur comme Hamlet Polonius ; car il est tellement ivre, qu’il ne cherche même pas à fuir. En ce moment, votre domestique entre, vous regarde avec stupéfaction, et vous demande ce que vous avez sur l’œil ; vous vous faites apporter un miroir, vous y jetez les yeux, vous ne vous reconnaissez pas vous-même : ce n’est plus vous, c’est quelque chose de monstrueux, quelque chose comme Vulcain, comme Caliban, comme Quasimodo.
Alexandre Dumas. [père] Impressions de voyage en Suisse, 1835
Proclamation de l’indépendance de la Nouvelle Zélande : l’United Tribes of New Zeland prend acte que les Maori sont un peuple souverain, doté de droits légitimes et méritent protection.
Henry Creswicke Rawlison, officier anglais détaché auprès de l’armée du Shah d’Iran, s’attèle au déchiffrement de l’inscription de Bèhistun, 15 mètres de haut, 25 mètres de large, perchée sur le haut d’une falaise des monts Zagros, 100 mètres au-dessus de l’ancienne route qui reliait Babylone à Ecbatane, dans l’actuelle province de Kermanshah. Des dimensions aussi imposantes ne pouvaient l’avoir laissée hors du champ de la curiosité des humains : Ctésias, un historien grec, en fait mention vers ~ 400, et plus tard, Tacite, Diodore de Sicile, et au XVI° siècle – 1598 – l’anglais Robert Shirley : l’ignorance de la signification des caractères cunéiformes permit de raconter n’importe quoi pendant longtemps sur leur origine.
Il s’agit de trois inscriptions, un même texte en trois langues différentes : vieux perse, élamite et akkadien (ou babylonien).
Le texte en vieux-perse contient 414 lignes en cinq colonnes ; l’élamite 593 lignes, représentant deux versions en huit colonnes, et le texte akkadien 112 lignes. L’inscription a été illustrée d’un bas-relief représentant Darius, un arc dans la main gauche et levant la droite, paume vers l’extérieur, foulant au pied le mage mède Gaumata, deux domestiques, grandeur nature et dix personnages hauts d’un mètre, corde au cou et mains attachées dans le dos, représentant les peuples conquis. Le dieu Ahura Mazda flotte au-dessus, donnant sa bénédiction au roi. Un personnage semble avoir été ajouté après les autres, et curieusement, la barbe de Darius est un bloc de pierre indépendant fixé par des goupilles et du fil de fer.
On pense que Darius avait placé spécifiquement l’inscription en ce lieu pour la rendre infalsifiable – la lisibilité passant au second plan de ses impératifs : le texte est complètement illisible au niveau du sol. Elle a été réalisée vers ~515.
Rawlison parvient, en se livrant à ce qui n’est pas encore nommé escalade, à copier le texte en vieux perse, placé sous le bas-relief, et à le déchiffrer à l’aide du syllabaire de l’allemand Friedrich Grotenfeld, expert en cunéiforme : par chance, la première partie du texte donne une liste de rois perses identiques à celle qui est mentionnée par Hérodote. En mettant en correspondance les noms et les caractères, Rawlinson peut, vers 1838, déchiffrer les caractères cunéiformes utilisés pour le vieux persan : Je suis Darius, le roi des rois, roi des peuples…. La volonté d’Ahura Mazda m’a accordé la royauté…
La première version élamite se trouve à droite du bas-relief, la seconde à la gauche de la version vieux perse, et la version akkadienne, à gauche de la scène sculptée, séparée d’elle par un ressaut : elles seront copiées en 1843, en prenant l’empreinte des textes sur du papier mâché : c’est avec la collaboration d’Edward Hincks, de Julius Oppert et de Willima Henry Fox Talbot, qu’il parvient au déchiffrement de l’akkadien. Edwin Norris et d’autres sont les premiers à en faire autant pour l’élamite. L’inscription de Bèhistun est à l’écriture cunéiforme ce que la pierre de Rosette avait été aux hiéroglyphes égyptiens, quinze ans plus tôt.
29 01 1836
Louis Napoléon, 28 ans, s’essaie à la parabole en politique : Je considère le peuple comme un propriétaire et les gouvernements quels qu’ils soient comme des fermiers. Si le fermier administre la terre avec habileté et probité, le propriétaire, heureux de voir les réserves s’augmenter de jour en jour laissera le fermier gérer en paix durant toute sa vie le bien qu’il lui a confié.
Après la mort du fermier, le propriétaire remettra à la même place les enfants de celui qu’il aimait et qui lui a rendu service.
Voilà pour la monarchie.
Mais si, au contraire, le fermier trompe la confiance du maître – dilapide ses revenus et ruine la terre – alors le propriétaire, avec raison, le renverra, fera ses affaires par lui-même et mettra à la gestion de ses domaines des hommes auxquels il laissera moins d’autorité et qu’il remplacera d’année en année afin qu’ils ne prennent point pour un droit irrévocable la place qu’il leur accorde.
Voilà pour la république.
Je ne vois donc pas dans ces deux administrations différentes de principes fondamentaux contraires ; l’une et l’autre, suivant les circonstances, peuvent amener de bons résultats.
Louis Napoléon à Narcisse Vieillard, depuis Arenenberg, la résidence de sa mère Hortense sur les bords du lac de Constance.
6 03 1836
Le Texas est encore terre mexicaine, mais déjà peuplé de nombreux Américains dont certains sont enfermés dans le Fort Alamo, proche de San Antonio de Bexar. Les Mexicains ne sont pas chauds pour venir s’installer au nord du Rio Grande et Fort Alamo, c’est pour les Américains la clef du Texas. On n’en est pas à la première révolte contre le pouvoir mexicain et l’indépendance a d’ailleurs déjà été proclamée unilatéralement le 2 mars 1834. Sam Houston, le commandant en chef des troupes texanes a ordonné l’évacuation ; les assiégés avec à leur tête William Barret Travis ont refusé d’obéir : les 5 000 soldats mexicains du dictateur général Antonio López de Santa Anna auront mis 13 jours pour en finir avec les 200 Texans ; parmi eux David Crockett qui va devenir une légende américaine, d’abord héroïco comique, puis héroïco sentimentale, jusqu’à être détrônée par les héros de la guerre de Sécession. Les appels en renfort n’auront été qu’à peine entendus : seulement 32 volontaires parviendront à rejoindre les assiégés. La veille de l’assaut final, le 5 mars, William Travis a tracé une ligne dans le sable en proposant à ceux qui voulaient quitter les lieux de franchir la ligne : personne ne le fera… personne… sauf Louis Rose, le seul français présent, un vétéran des campagnes napoléoniennes, qui sera donc le seul rescapé de l’hécatombe. Dans le fond, on le comprend : on n’échappe pas aux balles et aux canons des Prussiens, Anglais, Russes et Autrichiens, Espagnols pendant 20 ans, pour venir mourir sous des balles mexicaines… et puis, franchir la ligne, c’est bien une des rares choses qu’il n’avait jamais faite. Trois semaines plus tard, Santa Anna se livrait à un autre massacre à Goliad, une ville voisine où il ordonnera le massacre de 350 soldats texans qui s’étaient constitués prisonniers. Il faisait ainsi 350 martyrs dont s’emparera la légende. Le général Sam Houston aura raison des troupes de Santa Anna un mois et demi plus tard, le 21 avril, à San Jacinto, dans les marécages qui bordent la rivière Austin. C’était la fin de la domination mexicaine au nord du Rio Grande. Indépendant, le Texas aura du mal à assurer seul sa sécurité, – il comptait alors moins de 40 000 habitants – et deviendra un État américain à part entière en 1845, déclenchant ainsi une guerre entre le Mexique et les États-Unis qui durera jusqu’en février 1848.
19 05 1836
Cynthia Ann Parker, 9 ans, vit à Fort Parker où ses parents baptistes s’étaient posés, pionniers éloignés bien loin à l’ouest de leur coreligionnaires, à l’extrême limite de la frontière indienne au-delà de laquelle se trouvaient les derniers Indiens sauvages d’Amérique : les Apaches et les Comanches, sur un territoire de quelques 385 000 km², couvrant au moins pour partie les actuels États du Texas, Nouveau-Mexique, Colorado, Kansas et Oklahoma. Seuls les Sioux Lakotas contrôlaient un territoire aussi vaste dans les grandes plaines du Nord. Fort Parker est à 150 km au sud de l’actuelle Dallas, au nord-ouest de Houston : ils bénéficient là de concessions à perpétuité sur un total de 6 500 ha : des bois, de la bonne terre, de l’eau, du gibier, du poisson : que peut-on rêver de mieux ! Ce matin-là, dix des seize hommes étaient aux champs, hors l’enceinte fortifiée. Une bonne centaine de Comanches et quelques Kiowas à cheval se présentèrent devant le fort, munis d’un drapeau blanc : ils demandèrent une vache et de l’eau et purent ainsi entrer dans le fort où, très vite ils se mirent à massacrer les présents. En une demi-heure, cinq hommes étaient morts, deux femmes blessées et cinq personnes enlevées : deux femmes et trois enfants, dont Cynthia Ann et son frère cadet John Richard. Douze ans passeront pendant lesquels Cynthia Anna vivra au sein des Comanches : devenue femme, elle avait épousé Peta Nocona, un important chef de guerre, lui donnant trois enfants, dont Quanah, l’aîné, qui deviendra le plus prestigieux des chefs Comanches… une fois obtenue leur reddition au pouvoir blanc de Washington, en 1875. Cette femme blanche est au cœur du dernier grand affrontement entre les Américains blancs et les Comanches. Elle refusera à plusieurs reprises de retourner chez les WASP : mon mari est bon, aimable et je ne peux pas abandonner mes enfants. Mais elle y sera contrainte en 1860, par les Texas Rangers. Son histoire sera reprise par John Ford en 1956 dans La prisonnière du désert avec John Wayne dans le rôle de James Parker et Natalie Wood dans celui de Cynthia Ann.
4 06 1836
Des ouvriers effectuent des travaux de réparation sur la cathédrale de Chartres ; ils allument un brasero et c’est l’incendie, qui détruit toute la charpente de châtaignier du XIII° siècle. L’ingénieur Émile Martin remportera le concours de la reconstruction, et fera le choix d’une charpente métallique, solide, durable et anti-feu. La fabrication, le transport et l’assemblage dureront six mois.
Incendie de la cathédrale de Chartres du 4 juin 1836 par Charles Fournier Désormes – Domaine public
07 1836
La presse cherche à conquérir les classes moyennes : pour ce faire, il faut s’efforcer de proposer un prix raisonnable et donc faire appel à la publicité pour assurer la partie manquante du financement. C’est ce que prône Émile de Girardin, directeur de La Presse. Il le dira deux ans plus tard : En France, l’industrie du journalisme repose sur une base essentiellement fausse, c’est-à-dire plus sur les abonnements que sur les annonces. Il serait désirable que ce fût le contraire. Les rédacteurs d’un journal ont d’autant moins de liberté de s’exprimer que son existence est plus directement soumise au despotisme étroit de l’abonné, qui permet rarement qu’on s’écarte de ce qu’il est habitué à considérer comme des articles de foi. Les aigris, – ceux qui se sont essayés à la chose et n’y ont pas réussi – ne peuvent supporter cela et Armand Carrel, du National, met sa grande plume à leur service. Le ton monte, pour aboutir à un duel au pistolet dans le Bois de Vincennes. Touché à l’aine, Carrel mit deux jours à mourir et Girardin, touche à la cuisse, échappa de peu à l’amputation. Dieu, qu’au nom de beaux principes, on met en jeu sa vie ! C’est beau, c’est grand, sauf que… sauf qu’en toile de fond, il y avait un bon gros chantage bien nauséeux, Girardin menaçant à mots couverts, Carrel de révéler sa liaison avec la femme d’un officier : Les renseignements ne nous manqueront pas, qui nous seraient nécessaires pour la biographie de plusieurs rédacteurs de ces journaux si nous étions jamais contraints de la publier…
*****
Un peu plus de cent cinquante ans plus tard, François Ruffin, du Monde diplomatique relèvera que les écoles françaises de journalisme ont en commun d’être dépourvues de bibliothèques, ce qui signifie que les responsables qui élaborent les programmes estiment que les moyens modernes de communication, au premier rang desquels Internet, remplacent sans difficulté les bibliothèques.
Peut-on concevoir une grande école, qui plus est de journalisme, sans bibliothèque ? C’est pourtant possible, le CFJ [Centre Français du Journalisme] l’atteste : en guise de rayonnages d’ouvrages, une très modeste documentation, avec des magazines, un Quid, quelques dictionnaires, un manuel de la ponctuation… Une centaine d’usuels, à peine.
Cette indigence ne résulte d’aucun calcul, elle correspond au programme de l’établissement, jamais formulé comme tel : puisque, pour faire du journalisme, aucun savoir n’est requis, à quoi pourraient donc servir les instruments du savoir ? A l’ESJ de Lille, d’ailleurs, un immense fonds subsiste… rarement consulté, comme le raconte le documentaliste : Les étudiants arrêtent quasiment de lire des livres lorsqu’ils passent le seuil de l’école de journalisme (…), comme s’ils devaient d’ores et déjà acquérir et intérioriser les réflexes en vigueur dans les rédactions.
Les élèves ne parcourent même plus les essais qu’ils critiquent. Ainsi de Benoît, pour un ouvrage sur la guerre d’Algérie. Poursuis ton papier sur le livre de Jacques Duquesne, lui conseille une intervenante de France-Culture. – Mais je ne l’ai pas ouvert! – Pas la peine. Il faut faire vite. Lis juste une critique du Monde. Une recommandation qu’elle renouvelle pour un film de Claude Lanzmann (non visionné) et une étude sur les working poor.
Avec quatre séminaires en deux ans, perdue dans le no man’s land des brèves, des flashes et des filets, la culture générale vivote en marge de la pratique. Plus inquiétant, l’absence de réflexion dans la pratique. C’est flagrant pour les micro-trottoirs sur Loft Story ou les info-divertissements, comme le Salon du chocolat. Mais c’est le cas, aussi, pour des sujets plus politiques. Les élèves multiplient les papiers, trois mois durant, sur les péripéties concernant les retraites, le PARE, les 35 heures… sans voir plus loin que le bout de leurs dépêches AFP, sans rien savoir de l’Unedic ou de la gestion paritaire, sans comparer capitalisation et répartition. Ils rédigent, pour un hebdomadaire, six pages sur l’euro, le roman d’une naissance sans le moindre questionnement sur les critères de Maastricht, leurs conséquences sociales, la souveraineté nationale, etc. La monnaie unique est ainsi décrite comme novatrice, et surtout nécessaire : Difficile en effet de commercer au sein du Marché commun (…) quand des fluctuations de monnaie peuvent à tout moment faire varier les prix d’un pays à l’autre. Cette appréciation ne résulte d’aucun choix, plutôt d’un non-choix. D’une non-pensée, qui naturalise les mécanismes historiques, financiers ou sociaux. Qui présente, comme nécessaire et positif, ce qui est. Qui épouse sans effort le consensus.
C’est cette surenchère par le bas, ce culte du moins-pensant, que stigmatise un élève : Il y a un manque vraiment désespérant d’interrogations, de confrontations sur le fond, qui engendre un conformisme. Dans une école, c’est navrant. Ces confrontations sur le fond, le CFJ ne les encourage pas, voire les décourage. Mais la plupart des étudiants n’y aspirent pas davantage. Entre eux, jamais d’empoignades, jamais de débats. Sur le libéralisme, l’écologie, la place de l’État, la fermeture de Michelin, rien. Seul Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain – pour ou contre ? Facho ou rétro ? – éveille une mini-controverse.
Une parole publique anémiée, une pensée exsangue… en un lieu où se forment les agitateurs (supposés) de la démocratie. Comment expliquer ce paradoxe apparent ? La faute à l’époque, sûrement, désenchantée. Ces jeunes ont grandi dans la crise, génération pragmatique, sans utopies ni illusions. C’est ça, l’esprit du temps, notait Cornélius Castoriadis. Tout conspire dans le même sens, pour les mêmes résultats, c’est-à-dire l’insignifiance.
François Ruffin, Responsable du journal Fakir (Amiens), auteur des Petits soldats du journalisme, Les Arènes, Paris, 2003. Le Monde diplomatique Février 2003
Si la presse n’existait pas, il faudrait ne pas l’inventer
Honoré de Balzac Monographie de la presse parisienne. 1842, qui dit ainsi que le problème n’est pas nouveau.
Lequel Balzac, en cette année 1836 dans le Lys dans la vallée, s’en prenait aussi à d’autres courroies de transmission de l’information : l’enseignement : L’éducation moderne est fatale aux enfants… Nous les bourrons de mathématiques, nous les tuons à coups de science et les usons avant le temps.
25 10 1836
L’obélisque de Louxor – 250 tonnes, 23 m de long -, donné à la France par le vice roi d’Égypte Méhémet Ali, reconnaissant à Champollion d’avoir rendu à l’Égypte trois mille ans de son passé en décryptant les hiéroglyphes de la Pierre de Rosette, est érigé sur la place de la Concorde.

Jean François Champollion (1790-1832). Traduction du texte principal des hiéroglyphes gravés sur la face sud de l’obélisque de la Concorde. (Extrait du livre Le grand voyage de l’obélisque de Robert Solé paru aux Editions du Seuil) (DR)

« enlèvement » de Louxor

Érection de l’Obélisque de Louxor, 25 octobre 1836, détails, aquarelle. Cayrac, 1837 – Dépôt du musée du Louvre (Musée national de la Marine / P.Dantec)
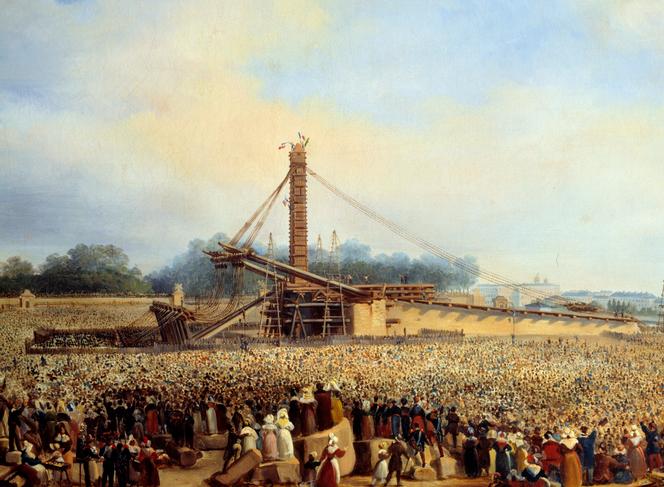
Erection de l’obélisque de Louxor place de la concorde » (à Paris, le 25 octobre 1836), de Francois Dubois. JOSSE/LEEMAGE/PARIS, MUSÉE CARNAVALET

Méhémet Ali, d’origine albanaise, avait combattu Bonaparte en 1799-1801, puis détruit le pouvoir des beys mamelouks tout en s’assurant l’autonomie à l’égard de Constantinople, étendu le territoire de l’Égypte au point d’inquiéter les puissances européennes qui l’obligeront en 1840 à restituer au sultan la Syrie et la Crète, en échange d’un décret impérial le proclamant vice-roi héréditaire. Il fit de l’Égypte un État moderne et cohérent : grands travaux d’aménagement du territoire, modernisation de l’agriculture, création d’industries nouvelles, réforme de l’administration, de l’armée et du système scolaire.

Portrait de Méhémet-Ali, par Auguste Couder (1789-1873) (Wikimedia commons)
L’obélisque a été ramené d’Égypte par un bateau spécialement construit à cet effet : le Louxor : l’affaire a duré à peu près trois ans.
Le 25 octobre 1836, l’obélisque de Ramsès II, provenant du temple de Louxor en Haute-Égypte, offert à la France par Méhémet-Ali, vice-roi d’Égypte, est érigé place de la Concorde, à Paris. Ultime étape d’une affaire d’État de sept années, au prix d’exploits techniques révolutionnaires et de la volonté sans faille d’un homme, Apollinaire Lebas, prêt à donner sa vie en cas d’échec de la mission qui lui a été confiée. Le jour de l’érection du monument, l’ingénieur du génie marine est sous le monolithe de 230 tonnes, pendant l’opération, sûr d’y passer si l’affaire tourne mal.
Le Musée national de la marine à Paris met en scène cette expédition mémorable, de Louxor à Paris, d’un coût inouï : Un million trois cent mille francs or seront dépensés, affirme Alain Niderlinder, commissaire de l’exposition. Le Luxor, navire de transport, est construit à Toulon, avec trois mâts démontables pour passer sous les ponts de la Seine, et une poupe détachable, afin de charger le monolithe de 22 mètres par l’arrière sans risquer de le casser. À fond plat, faible tirant d’eau et cinq quilles, il doit tenir la haute mer, chargé à bloc. Des tonnes de vivres et de matériel sont embarquées avec cent vingt et une personnes, officiers, matelots et ouvriers spécialisés.
[…] En 1829, Méhémet-Ali propose à la France de lui faire don des deux obélisques d’Alexandrie. Les Anglais en veulent autant. En fin limier, Jean-François Champollion – qui, à partir de 1821, avait déchiffré les hiéroglyphes – entre en jeu. Il est convaincu qu’il faut faire changer d’avis le vice-roi et obtenir les obélisques édifiés par Ramsès II à Louxor, précise M. Niderlinder. Champollion emporte l’affaire, en conseillant aux Anglais d’accepter l’obélisque d’Alexandrie et de viser haut en demandant, aussi, celui de Karnak, le plus grand de tous… qu’il savait intransportable. Devant le coût de l’opération, les Anglais renoncent.
Le Luxor quitte Toulon, en avril 1831, commandé par le lieutenant de vaisseau Raymond de Verninac Saint-Maur. Le second, Léon de Joannis, polytechnicien, dessinateur de talent, croque chacune des étapes. Comme cette vue du navire, méconnaissable sous un tas de planches et de nattes, arrosé chaque jour pour que la coque et les mâts résistent au feu solaire qui fait éclater le bois. Ses dessins, aquarelles et peintures, qu’il signe à l’encre noire, d’une écriture ronde, animent l’exposition, avec les lettres, plans et récits.
Deux grandes maquettes réalisées, en 1847, par l’atelier du Musée national de la marine montrent l’abattage de l’obélisque, couché sur un glissoir par un jeu de cordages, poulies et cabestans, actionné par deux cents hommes. Il faut près de deux mois pour tracter le monolithe, de sept mètres en sept mètres, sur un demi-kilomètre, jusqu’à son chargement à bord.
Reste à descendre les 750 kilomètres du fleuve roi jusqu’à son embouchure. La crue du Nil est au plus bas, il faut attendre l’été suivant. Le Luxor arrive enfin à Alexandrie, le 2 janvier 1833, où l’attend le Sphinx, la première corvette à vapeur de la marine française, chargé de le remorquer jusqu’à Toulon. Ravitaillement au charbon à Corfou : il en consomme près d’une tonne à l’heure ; quarantaine à Toulon ; puis l’Atlantique à affronter ; le périple est sans fin jusqu’au Havre.
Pour remonter la Seine, vingt-huit chevaux assurent le halage du Luxor. Une fois amarré sous la place de la Concorde, trois ans de plus seront nécessaires à Louis-Philippe pour départager les Parisiens et décider où ériger l’obélisque. La polémique fait rage. Certains le veulent à la Bastille, d’autres au Louvre. Le 24 octobre 1836, un premier essai fait un mort à la Concorde : une petite grue s’est détachée.
Le mardi 25 octobre, Louis-Philippe attend, à l’hôtel de la Marine, le succès de l’opération pour se montrer au balcon ; 200 000 Parisiens se serrent sur la place dans un silence de mort. Après trois heures de suspense, le rayon de soleil pétrifié qui porte la signature de Ramsès II est enfin dressé ; en place de la guillotine, de sinistre mémoire. Cent musiciens interprètent les Mystères d’Isis, de Mozart. Sur l’aquarelle qui relate la scène (1837), Cayrac montre Apollinaire Lebas, debout avec son porte-voix, au pied de l’Obélisque
Florence Evin. Le Monde du 19 02 2014

Le Sphinx remorquant le Luxor, François Roux (1811- 1882), aquarelle sur papier, vers 1880/82 (Galerie Delalande / Paris)
30 10 1836
Louis Napoléon Bonaparte, 28 ans, échoue dans sa tentative de soulèvement de la garnison de Strasbourg. Il gagne d’abord la Suisse, qui refuse la demande de la France de l’extrader, puis se fait offrir par Louis-Philippe un voyage en Amérique : cinq mois, de Rio à New-York : les États-Unis avec lesquels il ne se sentira aucun atome crochu : Ce pays a une force matérielle immense, mais de force morale, il en manque totalement […] Parmi ce peuple de marchands, il n’y a pas un homme qui ne spécule […] notre nature est composée d’un être moral et d’un être matériel. Ici, il n’y a que le second de connu : gagner de l’argent, voilà le seul mobile.
Le 10 juillet 1837, il est en Angleterre qu’il connait déjà, qu’il apprécie et qui l’apprécie. Il la connaîtra bien, sa révolution industrielle, son ouverture intellectuelle, ses brillants esprits scientifiques autant que littéraires ; il y sera toujours bien traité, bien reçu, au moins par l’aristocratie si ce n’est par le gouvernement. L’héritage de sa mère Hortense lui permet de vivre sur un grand pied : dix-sept domestiques, s’il vous plait ! Ces très bonnes relations orienteront fortement ses choix économiques une fois au pouvoir.
1836
Aménagement des Champs Élysées, Arc de Triomphe. Louis-Philippe inaugure la première ligne de chemin de fer à ne transporter que des passagers entre Paris et Saint Germain. Cinq ans plus tard, la France comptera 550 km de ligne de chemin de fer. Rail et charbon vont devenir indissociables pour un bon siècle. Et quelques décennies plus tard, le passage de la marine à voile aux navires à vapeur va encore renforcer le poids du charbon dans l’économie : 800 000 tonnes en 1820, 5 millions de tonnes en 1847, (pour une consommation de 7.5 millions de tonnes). Carte de la lune par les allemands Wilhelm Beer et Johann Heinrich Mädler. Aristide François, pharmacien à Chalons sur Marne, en poursuivant les recherches effectuées par Cadet de Vaux, met au point une liqueur à base de sucre qui va être à même de stabiliser l’indispensable prise de mousse du Champagne, et ainsi ramener le taux de casse des bouteilles à 1 % quand il pouvait alors aller jusqu’à 40 %.
Eugène Schneider a été embauché en 1821 dans la banque Sellières ; son frère Adolphe a pris, à vingt deux ans, la direction d’une usine de ce même M. Sellières. Ils ne leur manque plus que l’argent, qu’ils trouveront dans la corbeille de mariage de leurs épouses, pour satisfaire leur ambition : reprendre l’ancienne fonderie royale du Creusot et en faire le premier centre métallurgique français. Les grands besoins des chemins de fer naissants et de la navigation à vapeur prendront très largement le relais de l’armement, sur le déclin dès la fin du 1° empire. Schneider fournira aussi la charpente de la gare d’Austerlitz, construira le port de Casablanca, le pont Alexandre III à Paris, des ponts sur le Tonkin, puis fera de nouveau de l’armement à partir de 1870. Le chiffre d’affaires, de 2,2 millions de francs en 1836, passera à 133 millions à la veille de la deuxième guerre mondiale. L’entreprise du Creusot deviendra encore l’archétype du paternalisme patronal : assistance médicale gratuite aux employés, écoles, maisons de retraite, logements sociaux… mais on travaille encore 12 h. par jour et on ne prend que 8 jours de congé par an…
À Toulon, début des travaux des arsenaux du Mourillon, de Castigneau et de Miéssiessy : ce sera chose faite en 1862. Début de l’expérience de Mana, en Guyane : après plusieurs expériences désastreuses, un autre type de colonisation fût tenté pendant dix ans avec quatre cent soixante dix sept Africains, qui, au terme de la loi contre la traite du 4 mars 1831, furent libérés tout en devant un engagement de sept ans à l’État ; lequel confia l’affaire à une religieuse, Anne-Marie Javouhey, fondatrice de la congrégation missionnaire Saint-Joseph de Cluny, et déjà munie d’une riche expérience en matière de colonisation : le 18 septembre 1835 était crée l’Établissement de Mana, dont l’accès était interdit à toute personne non autorisée. Mère Javouhey, très inspirée des missions jésuites du Paraguay chez les Indiens Guarani au XVII°, nourrissait un projet de société entièrement noire du haut en bas de l’échelle sociale : il n’y aura aucun mélange de Blancs, tous seront noirs, les chefs noirs, le protecteur seul sera blanc. Les lépreux y vivaient dans le village d’Acarouany (qui est aussi une rivière). Et l’affaire tourna rond pendant dix ans, le temps de se faire nombre d’ennemis à l’extérieur, chez les voisins immédiats aussi bien qu’à Paris où l’on fronçait fort le sourcil à voir ces gens se débrouiller très bien tout seuls, sans se sentir contraints à passer par les cultures d’exportation pour vivre : il y fut mis fin le 4 novembre 1854 [3] . Quatre ans plus tard naissait sur ce village même de Mana l’établissement pénitentiaire bien connu : le bagne de Cayenne.
Paulin Talabot, polytechnicien, participe à la création de la Compagnie des Mines de la Grand’ Combe et des chemins de fer du Gard. Au cours de voyages en Angleterre, il est allé se former auprès de Robert et George Stephenson qui l’initient et l’aident pour installer son propre chemin de fer entre Beaucaire et la Grand’ Combe où se trouvent d’importants gisements en charbon. Ceci pour l’aspect technique. Le financement sera assuré par James de Rothschild.
10 06 1837
Après avoir été abandonné pendant près d’un demi-siècle, le château de Versailles devient le musée d’Histoire de France : c’est l’architecte Frédéric Nepveu qui a dirigé les travaux de transformation.
10 11 1837
Karl Marx, 19 ans a commencé par être étudiant en droit à Bône, université la plus proche de Trêves où se trouve sa famille. Il change alors d’université pour aller à Berlin. Il a déjà pris l’habitude de dépenser sans compter l’argent des autres : pour l’instant, c’est celui de son père. Plus tard, ce sera celui de Friedrich Engels qui s’amusera à lui tirer le portrait. Plutôt porté sur la castagne et la chope de bière, il a laissé des souvenirs colorés : Qui vous poursuit de ses folles rodomontades ? Un natif de Trêves, noir de poil, monstre vigoureux. Il ne marche, ni ne sautille, mais bondit sur ses talons Et il tempête, rageur, comme s’il voulait saisir Le vaste dais du ciel et le tirer sur terre, Les bras grands ouverts et levés bien haut. Serrant ses poings furieux, il délire sans cesse Comme si dix mille diables étaient à ses trousses. Un soir de grande remise en question, il s’ouvre à son père de son désir profond de changement d’orientation, laissant le droit pour la philosophie : Cher père, il y a des moments, dans la vie d’un homme, qui sont comme des postes-frontières marquant la fin d’une période et indiquant clairement une nouvelle direction. En de tels moments de transition, on se sent obligé de regarder le passé et l’avenir avec des yeux d’aigle pour être conscient de la réalité. En vérité, l’histoire du monde elle-même aime à regarder ainsi en arrière, à faire le bilan, ce qui donne parfois un sentiment de recul ou de stagnation, alors qu’il s’agit simplement de s’asseoir dans un fauteuil pour se comprendre soi-même et embrasser intellectuellement toute l’activité de son propre esprit. En de tels moments de mutation, chacun peut céder au lyrisme, car toute métamorphose est en partie comme un chant du cygne, en partie comme l’ouverture d’un ample et nouveau poème […]. Chacun a alors le sentiment qu’il doit élever un mémorial à ce qu’il a vécu, de telle façon que l’expérience retrouve dans les émotions ce qui a été oublié de l’action. Il n’y a pas meilleur lieu pour élever un tel mémorial que le cœur d’un père, le plus indulgent, le plus empathique, dont le soleil de l’amour réchauffe toutes nos actions. Et quel meilleur pardon espérer pour ce qui est blâmable que de tenter de le faire reconnaître comme la manifestation d’une nécessité ? Et comment faire au moins admettre que ce qui vient, pour l’essentiel, du hasard ou d’erreurs intellectuelles ne mérite pas d’être critiqué comme résultant de l’action volontaire d’un cœur perverti […] ? À la fin d’une année passée ici, je regarde en arrière, mon cher père, et permettez-moi de regarder ma vie comme je regarde la vie en général, c’est-à-dire comme l’expression d’une activité intellectuelle se développant dans toutes les directions, en sciences, en arts et dans la sphère privée […]. Attristé par la maladie de Jenny [sa fiancée, de quatre ans son aînée] et par mes vains efforts intellectuels pour échapper à l’idolâtrie qui m’animait pour une pensée que maintenant j’exècre, je suis tombé malade, comme je te l’ai déjà écrit, mon cher père. Quand j’ai été mieux, j’ai brûlé mes poèmes et mes débuts de romans, pensant à renoncer totalement, car, jusqu’à aujourd’hui, rien ne me permet de penser qu’il existe la moindre preuve de mon talent […]. Et même mon séjour à Berlin, qui aurait dû me plaire infiniment, m’inciter à contempler la nature, m’a laissé indifférent […] car, finalement, aucune œuvre d’art n’est aussi belle que Jenny […]. Mais, mon cher, très cher père, ne serait-il pas possible d’en parler avec vous personnellement ? La santé de mon frère, de ma chère maman, votre propre maladie (que j’espère peu sérieuse), tout cela me fait désirer me précipiter vers vous, et cela en fait presque une nécessité. Je serais déjà là si je n’avais douté de votre permission de me voir quitter Berlin. Croyez-moi, mon cher, cher père, je ne suis animé par aucune intention égoïste (même si ce serait une bénédiction pour moi de revoir Jenny) ; mais il est une pensée qui m’émeut et que je n’ai pas le droit d’exprimer. Et, bien qu’il soit difficile de l’admettre, comme me l’écrit ma chère Jenny, ces considérations sont sans valeur, comparées à l’accomplissement de devoirs sacrés. Je vous supplie, cher père, quoi que vous décidiez, de ne pas montrer cette page de ma lettre à ma mère : mon arrivée à l’improviste pourrait aider cette femme si magnifique à se rétablir […], tout en espérant que s’éloigneront les nuages qui se sont assemblés sur la famille, et qu’il me sera donné de souffrir et de pleurer avec vous, peut-être aussi de vous donner des preuves de mon amour profond et démesuré que j’exprime en général si mal. Dans l’espoir que vous aussi, cher, très aimé père, vous preniez en compte l’état de trouble de mon esprit pour me pardonner les errances de mon cœur, submergé par mon esprit, et que vous recouvriez vite votre santé en sorte que je puisse vous serrer dans mes bras et vous dire toutes mes pensées. Votre fils à jamais aimant. Il ajoute en post-scriptum : S’il vous plaît, cher père, excusez mon mauvais style et mon écriture illisible. Il est presque quatre heures du matin, la chandelle arrive à sa fin, mes yeux sont fatigués, une excitation extrême a pris possession de moi et je ne saurai calmer ces spectres turbulents avant d’être avec vous, qui m’êtes si chers. S’il vous plaît, faites part de mes pensées à ma douce et merveilleuse Jenny. J’ai lu sa dernière lettre douze fois et j’y découvre chaque fois de nouvelles délices, y compris de style. C’est à mon avis la plus belle lettre jamais écrite par une femme.
Marx expédie sa lettre et attend la réponse paternelle, qui ne vient pas : gravement atteint par la tuberculose, son père ne souhaite pas que son fils le voie dans cet état. Karl restera donc à Berlin pour Noël. Le 10 février 1838, son père lui répondra enfin :
Cher Karl, […]
Aujourd’hui, j’espère être capable de me lever quelques heures et de voir si je suis capable de rédiger une lettre. En fait, je tremble, j’y arrive, mais… je n’ai pas la force de m’embarquer dans une discussion théorique avec toi. Tant mieux si ta conscience s’harmonise modestement avec ta philosophie et est compatible avec elle. Sur un seul point, tu as sagement observé dans ta lettre un silence aristocratique : sur la mesquine question de l’argent dont la valeur, pour le père de famille, est grande, même si tu ne sembles pas le reconnaître. Je m’en veux de t’avoir laissé trop libre sur ce sujet. Nous sommes au quatrième mois de l’année scolaire et tu as déjà tiré 20 thalers. Or je n’en ai pas gagné autant cet hiver. Tu as tort de dire que je te méjuge ou que je ne te comprends pas. Je fais totalement confiance à ton cœur et à ta moralité. Je t’ai toujours fait confiance, même dans ta première année de droit où je ne t’ai pas demandé d’explications sur cette ténébreuse affaire [le duel de Karl]. C’est justement ma confiance en ta haute moralité qui l’a permis. Et, Dieu merci, c’est encore le cas. Pour autant, cela ne me rend pas aveugle […]. Tu dois croire que tu es au plus secret de mon cœur et que tu es l’un des plus puissants leviers de ma vie. Ta dernière décision [changer de sujet d’étude] est méritoire, sage, et mérite d’être mise en œuvre ; si tu fais ce que tu as promis, cela portera ses meilleurs fruits. Sois sûr qu’il n’y a pas que toi qui fasses un grand sacrifice. C’est vrai de nous tous. Mais la raison doit triompher. Je suis fatigué, cher Karl, je dois m’interrompre […]. Ta dernière proposition me concernant [venir le voir] se heurte à de grandes difficultés. Quel droit ai-je de t’en prier ? Ton père fidèle.
Sa mère ajoute un mot : Mon cher Karl adoré, Pour l’amour de toi, ton cher père a pour la première fois refait l’effort de t’écrire. Ton bon père est très faible ; Dieu fasse qu’il recouvre vite ses forces. Je vais bien, cher Karl, et je suis calme, résignée à ma situation. La chère Jenny se conduit comme une fille adorable pour ses parents, et nous réconforte par son état d’esprit, comme si elle était une enfant de la famille qui essaie toujours de voir le bon côté des choses. Écris-moi pour me dire si tu vas bien. Je suis la plus fâchée que tu ne viennes pas pour Pâques. Je laisse mes sentiments aller au-delà de la raison et je regrette, cher Karl, que tu sois, toi, bien trop raisonnable. Tu dois prendre ma lettre comme une mesure de mon amour profond. Il est des moments où l’on ressent beaucoup et où l’on dit peu. Aussi te dis-je au revoir, mon cher Karl, écris vite à ton cher père, cela aidera certainement à sa guérison rapide. Ta mère qui t’aime à jamais.
Et sa sœur Sophie aussi : Cher père se sent mieux. Les choses s’arrangent. Cela fait bientôt huit semaines qu’il est au lit, et il n’en est sorti qu’il y a quelques jours pour qu’on puisse aérer la chambre. Aujourd’hui, il a fait un gros effort pour t’écrire ces quelques lignes de sa main tremblante. Notre pauvre père est maintenant très impatient. Rien d’étonnant : il a été tout l’hiver hors de ses affaires. Le besoin qu’il en ressent est maintenant quatre fois plus grand qu’avant. Chaque jour, je chante pour lui et lui fais la lecture. Envoie-moi enfin la chanson que tu me promets depuis longtemps. Écris vite. Cela sera une distraction pour nous tous. Caroline n’est pas bien. Louise est couchée ; il semble qu’elle ait la scarlatine. Émilie conserve un bon moral. Quant à Jette [Hermann, son frère cadet], il n’est pas précisément de sa meilleure humeur.
Caroline, Emilie et Hermann mourront bientôt, son père le 10 mai 1838. Karl ne se rendra pas à Trêves pour l’enterrement et sa mère ne lui versera pas sa part d’héritage, soit la somme appréciable de 6 000 franc-or, car il aurait fallu pour cela vendre la maison où vit encore la famille. Il lui faudra attendre plus de dix ans , le 10 février 1848, pour le faire.
1837
1° trottoirs asphaltés à Paris. Les anglais William F. Cooke et Charles Wheatstone, inventent le télégraphe électrique. De son coté André Marie Ampère énonce aussi le procédé devant ses élèves de l’École polytechnique : Autant d’aiguilles aimantées que de lettres de l’alphabet, qui seraient mises en mouvement par des conducteurs qu’on ferait communiquer successivement avec la pile, à l’aide de touches de clavier qu’on baisserait à volonté, pourraient donner lieu à une correspondance télégraphique qui franchirait toutes les distances, et serait aussi prompte que l’écriture et la parole pour transmettre la pensée. Le peintre américain Samuel Morse en revenant d’Europe en 1832, à bord du paquebot Sully, est entrepris par un passager qui lui décrit les expériences d’Ampère, titillant ainsi sa curiosité jusqu’à ce qu’il invente ce code alphabétique qui ne demande qu’une seule ligne de transmission et un dispositif d’émission et de réception : au départ, un manipulateur fournit des impulsions électriques grâce à une pile ; à l’arrivée, un dispositif permet, par un levier métallique basculant sous l’effet d’un électro-aimant, de mettre en contact un poinçon avec un ruban de papier enroulé sur un cylindre animé d’un mouvement de rotation par un mécanisme d’horlogerie.
On doit à Ampère une conception sur les rapports entre magnétisme et courant électrique qui relie les différents résultats expérimentaux connus à l’époque : relations entre les courants et leurs effets sur les aimants, et inversement, action des aimants sur les courants électriques. D’où l’hypothèse qu’un aimant est composé de molécules magnétiques et qu’un courant circule de façon permanente dans chacune de ses molécules. Frédéric Kuhlmann achète une petite usine de produits chimiques à la Madeleine, près de Lille, qui deviendra un empire industriel. Les sociétés familiales Peugeot, Japy et Compagnie, créées en 1832, construisent leur première usine au lieu dit Terre Blanche, dans le Doubs, sur la commune de Hérimoncourt : ils construisent leur réputation avec deux spécialités : les outils forgés – marteaux, limes, tenailles – et les articles laminés – scies à bois, scies à métaux, fers de rabots etc – . Ils s’offriront le logo du lion en 1850 : l’animal figure déjà sur les armoiries de la Franche Comté depuis 1279.
Woodbine Parish, consul anglais à La Plata, décrit l’habillement d’un gaucho de la pampa : Prenez toutes les pièces de son habillement, examinez tout ce qui l’entoure et, à l’exception des objets de cuir, qu’y aura-t-il que ne soit anglais ? Si sa femme porte une jupe, il y a 99 chances sur 100, qu’elle ait été fabriquée à Manchester. Le chaudron ou la marmite dans lesquels elle cuisine, l’assiette en faïence dans laquelle il mange, son couteau, ses éperons, le mors de son cheval, le poncho qui le couvre, tout vient d’Angleterre. Les pavés sur lesquels il marche dans les rues de Buenos Aires viennent d’Angleterre.
Prosper Mérimée découvre l’abbaye de Conques : Tant de richesses dans un pareil désert !
La Suisse se modernise rapidement avec la naissance du tourisme dont elle est une des principales bénéficiaires : C’est en 1815, au retour de la paix, que la Suisse a commencé à devenir le grand chemin des touristes. L’Angleterre versa ses enfants par milliers sur le continent, et ses enfants qui ont, outre leurs guinées, certain instinct pittoresque et le goût des grandes scènes de la nature, prirent, des tout premiers, la route de nos montagnes. La Suisse devint à la mode : la Suisse fit fureur parmi les fils et les filles d’Albion. De cette époque datent pour le pays de grands changements ; la transformation de la Suisse agreste, sauvage, hospitalière, en Suisse enjolivée, civilisée jusqu’au sommet des montagnes, renommée pour l’excellence de ses hôtels, et la cupidité de ses aubergistes.
Mais ce n’est pas tout. À cette époque aussi remonte l’apparition des itinéraires, et la création de cette sorte d’art-boutique qui, depuis vingt ans, spéculant sur l’esprit touriste, lui fait et lui vend cette Suisse enluminée, cette Suisse du commerce, cette Suisse verte et bleue, cette Suisse, non pas certes décolorée, mais abominablement fardée de gomme-gutte et d’indigo, cette Suisse méconnaissable, et la seule néanmoins que l’on connaisse aujourd’hui dans les quatre parties du monde.
Grand malheur pour un pays quand c’est la boutique qui se charge de le faire connaître au monde ! Oubliez la Suisse, et voyez cette fille jeune et belle, mais dont un infidèle portrait éloigne les amants qui, sans lui, l’eussent adoré. Elle attend, mais en vain ! Une déplaisante image éloigne d’elle ceux qui ne l’ont pas vue, ou, fascinant les yeux mêmes de ceux qui l’approchent, leur fait voir dans son visage tous les défauts du portrait. Grand malheur pour un pays quand la boutique, prenant les devants sur l’art, lui gâta son domaine avant qu’il n’y soit rentré, l’y retient à la porte jusqu’à ce qu’elle en soit sortie ! Voyez ces champs fleuris, ces parc sombres, cette rive enchantée, le maître est là sur la colline voisine, mais il n’entrera point. Avant lui les forbans ont débarqué, leurs cris y retentissent, leurs haches mutilent les bois, leurs chiens y dévastent les guérets, leur prodigue avarice y coupe l’arbre pour atteindre au fruit, car ils ne veulent point goûter, jouir, ils ne veulent que piller et vendre.
Pendant que les Anglais, durant les premières années de la Restauration, nous arrivaient en foule, l’on en était encore, en France, à connaître la Suisse par les décors de l’Opéra. Ils ont beaucoup voyagé dans un temps, les Français, c’est sous l’Empire. Napoléon leur a fait voir du pays ; Napoléon les envoya même chez nous ; ils virent nos plaines, ils se battirent sur nos montagnes, ils connurent nos pâtres ; mais la paix venue, nous ne les revîmes plus. C’est que, pour les Français, l’Univers, c’est la France : si la France s’agrandit, ils bougent ; si elle reprend ses limites, ils restent chez eux ; quant aux autres pays, on les leur apporte tout confectionnés : ils les achètent pour deux sous dans les pittoresques, ils les voient pour rien aux vitres des boutiques, ils les lisent dans les lettres de leurs voyageurs et dans les feuilletons de leurs journaux. De là, chez ceux d’entre eux qui visitent les pays étrangers, cette facilité remarquable à les savoir par cœur quand ils y entrent, et à ne pas les avoir davantage quand ils en sortent.
Cependant, depuis quelques années, des Français ont parcouru dans nos contrées, qui n’étaient ni des régiments, ni des commis-voyageurs, mais des touristes véritables. Moi-même, dès 1830, j’en rencontrai au Rhigi et ailleurs, qui étudiaient la contrée, un itinéraire à la main, un lorgnon sur la belle nature. Ces premiers venus, rentrés au pays, contèrent, à ce qu’il paraît, d’admirables choses qui firent venir les seconds, qui nous amenèrent les troisièmes. Tout aussitôt, la boutique française s’émut à son tour. Écrivains, colorieurs, graveurs, se mirent à l’œuvre. L’impulsion était donnée, le succès fut grand, il menace d’être pyramidal, comme on dit. Aujourd’hui Paris confectionne la Suisse, il l’emballe, il l’exporte, il nous l’expédie à nous-mêmes.
Rodolphe Töpffer. Du paysage alpestre, 1837

Passage du mont saint Bernard. Série Les Touristes. Vers 1830 Eugène Charles Guérard. Compiègne musée de la voiture

Chemin des échelles, dans le Valais. Série Les Touristes. Vers 1830 Eugène Charles Guérard. Compiègne musée de la voiture

Descente du Fullhorn, dans le canton de Berne. Série Les Touristes. Vers 1830 Eugène Charles Guérard. Compiègne musée de la voiture
La naissance du Panier à salade met au rencart boulets et chaînes des forçats… en France. Révolte des Canadiens français, matée par les forces régulières britanniques. Lord Durham préconise l’anglicisation du pays. Il leur fallait tout de même une grande candeur et une grande naïveté aussi à ces patriotes franco-canadiens, pour avoir choisi comme hymne national À la claire fontaine, une chanson anonyme du XVIII° siècle. C’est le marquis de Montcalm qui l’avait amenée avec ses troupes, 80 ans plus tôt.
C’était rapidement devenu un chant de résistance codé. La claire fontaine était une métaphore du fleuve Saint-Laurent, alors bordé de chênes. Je m’y suis baigné signifie l’installation des Français dans la vallée du Saint-Laurent. La rose symbolise les Anglais et le rosier, l’Angleterre. L’amie (ou la maîtresse, selon les versions) représente la France que jamais je n’oublierai.
Wikipedia
À défaut d’expérience en matière révolutionnaire, et si Louis Philippe n’était pas disposé à les aider, ils auraient pu au moins demander conseil à quelques maréchaux d’Empire qui leur auraient certainement dit qu’on ne choisit pas une des plus limpides chansons françaises pour emmener des piou-piou au casse-pipe ; pour cela, il y faut de la gnôle et une bonne Marseillaise bien saignante.
À la claire fontaine,
M’en allant promener,
J’ai trouvé l’eau si claire
Que je m’y suis baignée
Il y a longtemps que je t’aime,
Jamais je ne t’oublierai
Sous les feuilles d’un chêne,
Je me suis fait sécher ;
À la plus haute branche,
Un rossignol chantait.
Chante, rossignol, chante,
Toi qui as le cœur gai ;
Tu as le cœur à rire,
Moi je l’ai à pleurer
J’ai perdu mon ami,
Sans l’avoir mérité,
Pour un bouquet de roses
Que je lui refusai …
Je voudrais que la rose
Fût encore au rosier,
Et que mon ami Pierre
Fût encore à m’aimer.
Je voudrais que la rose
Fût encore au rosier,
Et que le rosier même
Fût encore à planter.
Aux États-Unis, le pouvoir fédéral signe un Nième traité avec les Indiens Ojibwés, installés à l’ouest du lac Michigan : indemnités contre territoires … le marchandage ordinaire ; mais le traité comporte un article savoureux : Le privilège de chasser, pêcher et récolter le riz sauvage sur les terres, les rivières et les lacs inclus dans les territoires cédés est garanti aux Indiens aussi longtemps qu’il siéra au bon plaisir du président des États-Unis. [pour l’heur Martin Van Buren]. Ce bon plaisir a un délicieux fumet d’Ancien Régime !
Dernière héritière de la dynastie hanovrienne, Victoria, à 18 ans, monte sur le trône d’Angleterre : elle va y rester 64 ans !
Cette époque victorienne est marquée par la coïncidence de la rigueur morale et de la réussite commerciale
E. Halevy
Cette ère des classes moyennes va être marquée par le respect du passé, le désir de stabilité, le conservatisme dans le progrès, le puritanisme et la respectabilité, qui vont de pair avec leurs corollaires antithétiques : l’hypocrisie, le cant, et le snobisme, pour aboutir … à l’orgueil national.
Paul Leuilliot. Histoire Universelle La Pléiade 1986
Dès 1835, on pouvait lire un concentré de cette insupportable morgue : Je n’ai encore jamais trouvé un orientaliste qui pourrait nier qu’une seule étagère d’une bonne bibliothèque européenne vaut toute la littérature écrite en Inde et en Arabie.
Thomas Babington Macaulay politique libéral et historien, un temps en poste en Inde. Rapport sur l’éducation en Inde – Minute on Indian Education –

Victoria

Portrait de la reine Victoria réalisé par Alexander Melville.

Portrait de la reine Victoria réalisé par Franz Xaver Winterhalter en 1819.
À peu près en même temps que Victoria s’installait à Buckingam Palace, l’orang outan Jenny s’installait à Regent’s park, le zoo de Londres, ouvert dix ans plus tôt : la visite de la première à la seconde lui inspira ces deux mots : désagréablement humaine ! Mais quand elle se cantonnait au cercle familial, elle pouvait tomber sur des réponses qu’elle n’attendait pas : elle réprimande un jour son fils Edward, profondément occupé à tricher aux cartes : Savez-vous ce qui arrive aux petits garçons qui trichent au jeu ? Oui, répond le prince, ils gagnent.
Le traité de la Tafna assure à l’émir Abd el Kader les provinces d’Oran et d’Alger.

Printemps 1838
L’Anglais Simpson explore les côtes arctiques du continent américain : il arrive sur la presqu’île de Kent d’où il aperçoit l’île Victoria
4 09 1838
La comtesse Henriette d’Angeville dérobe à Marie Paradis sa victoire au Mont Blanc : la supériorité innée des aristos sur le petit peuple lui permit d’empocher sans peine la gloire d’avoir été la première femme au sommet du Mont-Blanc, se permettant même d’inviter Marie Paradis, de trente ans son aînée, au banquet qu’elle offrit pour fêter sa victoire ! Il me tardait de célébrer mes fiançailles, de l’épouser à la face d’Israël, par le plus radieux soleil et de m’enivrer des grands et puissants souvenirs que je rapporterais de ces jours, de cette heure délicieuse pendant laquelle je reposerais sur son sommet (…) Quel bonheur de n’être éprise que de la tête et pour un amant glacé. Henriette d’Angeville, la fiancée du Mont Blanc. La réponse du berger à la bergère se fit un peu attendre, mais arriva : Mademoiselle Henriette d’Angeville est une vieille folle et une insupportable blagueuse qui, n’ayant jamais su monter les marches de l’hyménée, s’amuse à grimper virginalement le Mont Blanc. Herménous. 1846.
1 10 1838
En Amérique, quelque 500 Cherokees ont accepté en 1836 de signer un traité qui les expatrie à l’ouest. Mais les 17 000 autres ont poursuivi une résistance passive : ils se font finalement parquer par l’armée dans ce que l’on peut bien appeler des camps de concentration et ce jour-là, un premier détachement se met en route pour ce qui allait rester dans l’histoire sous le nom de Chemin des larmes : 645 chariots entourés d’une foule de gens, en route vers l’ouest, commençant à mourir de maladie, de soif, de chaleur ou de froid. Au milieu de l’hiver, ils s’arrêtèrent sur la rive du Mississippi, presque gelé : des centaines de malades et de mourants étaient entassés dans les chariots ou étendus sur le sol. On estime à 4 000 le nombre de Cherokees morts soit dans les baraquements des camps soit au cours de cette marche vers l’ouest.
16 12 1838
En Afrique du Sud, en terre zoulou, ces derniers sont vaincus par les Boers qui fuient les Anglais, qui voulaient leur imposer leurs lois et l’abrogation de l’esclavage.
1838
Les Anglais lancent l’Ironside qui traverse l’Atlantique, puis le Queen Elisabeth en 1839, qui assurera la liaison avec les Indes. Début des travaux du canal de la Marne au Rhin, achevé en 1853. Baptiste Alexis Victor Legrand trace le réseau grandes lignes de chemin de fer en étoile centrée sur Paris, connu sous le nom d’Étoile de Legrand, qui double en quelque sorte le réseau routier du XVIII° siècle, et va modeler grandement l’économie de la France. Se référant au diamètre de la Terre, l’Allemand F. W. Bessel parvient à mesurer la distance d’une étoile. M. J. Schleiden et T. Schwann, eux aussi Allemands, découvrent que la cellule est l’unité élémentaire universelle du vivant, animal et végétal. Werner Siemens, lieutenant d’artillerie à Wittenberg, en Saxe, sur les rives de l’Elbe, donc encore Allemand, est témoin d’un duel : pour cela, il est condamné à 5 ans de forteresse à Magdebourg – ça ne plaisante pas là-bas – ; mais il obtient d’aménager une partie de sa cellule en laboratoire où il développe une technique de galvanisation. Gracié par le roi, il retrouve les ateliers de l’artillerie à Berlin où il inventera l’enrobement des câbles de cuivre par la gutta-percha, une résine remarquable qui permet une étanchéité totale des câbles sous-marin…. L’entreprise Siemens était née … elle ne cessera de prospérer.
Jacques Boucher de Crèvecœur de Perthes, naturaliste, découvre dans les sables de Saint Acheul, qui sont des terrasses alluviales de la Somme, dans les actuels faubourgs d’Amiens (d’où le nom de la période culturelle : acheuléen, de 2 m.a. à 0.5 m.a., le début du paléolithique) des bifaces bien affûtés qui ont aux environs de 0.7 m.a., donc beaucoup plus que 6 000 ans : ce sont les premiers coups de butoir dans les récits bibliques de la création, pris à la lettre, avec intégrisme : c’est la naissance de la préhistoire, naissance douloureuse qui commença par susciter sarcasmes et railleries ; ce sont les Anglais qui furent les premiers à apporter leur caution à son ouvrage paru en 1847, Antiquités celtiques et antédiluviennes.
De découverte en découverte, notre origine ne cesse de fuir vers un passé de plus en plus lointain.
Gabriel Camps
L’amiral du Petit Thouars voit encore neuf statues debout sur l’île de Pâques. L’Angleterre installe un consulat britannique à Jérusalem.
Les Jésuites avaient fondé en 1789 l’université Georgetown à Washington dont l’accès était gratuit. En cette année 1838, ils étaient au bord de la faillite qu’ils n’évitèrent qu’en vendant 272 esclaves attachés au fonctionnement de l’université, qui leur rapportèrent, en valeur 2010, 3.3 millions $. Ces esclaves avaient été recensés et donc, pour les descendants, des recherches étaient possibles, qui seront entreprises dans les années 2010. Auparavant, la version officielle voulait qu’ils soient tous morts d’une épidémie une fois arrivés sur les lieux de leur nouveau propriétaire, ce qui arrangeait les nombreux tenants des affaires rapidement classées.
______________________________________________________________________________________
[1] Le malt est de l’orge que l’on a fait germer puis sécher dans un local chauffé par un feu de tourbe, plutôt que de charbon. Le scotch est le whisky écossais, le bourbon et le rye, des whisky américains, le premier à base de maïs, le second à base de seigle, le paddy est un whisky irlandais. Il y a aussi des whisky japonais et même français, depuis peu.
[2] Orsel, chasseur de Saint Rhémy, dans le Val d’Aoste, tua le dernier ours des Alpes, en 1856.
[3] C’est l’activité de l’ordre des sœurs de Saint Joseph de Cluny à laquelle il fut mis fin, mais les sœurs restèrent en Guyane : Christian Dedet dit grand bien d’elles dans Le secret du Docteur Bougrat Phébus 1988 : on est alors dans les année 1926/1927
Laisser un commentaire