| Publié par (l.peltier) le 9 octobre 2008 | En savoir plus |
9 04 1865
Les États-Unis et la Prusse demandent à la France de quitter le Mexique. Le général Robert E. Lee rencontre le général Grant à Appomatox et signe la déclaration de reddition ; le général Ulysses S. Grant et ses adjoints William T. Sherman et Philip Sheridan avaient pris le commandement de l’armée de l’Union un an plus tôt. C’est la fin de la guerre de Sécession qui aura fait 498 000 morts, dont 364 179 chez les Nordistes, 133 821 chez les Sudistes, c’est à dire à peine plus de 1,5 % d’une population totale de 31.5 millions, plus que l’ensemble des guerres modernes des États-Unis (1° et 2° guerres mondiales, guerre de Corée et du Vietnam). Début de longues années de misère pour beaucoup, de colossales fortunes pour d’autres, beaucoup plus rares : Jay Gould, John Pierpont Morgan, Philip Armour, (qui avait obtenu la fourniture de porc salé aux armées de l’Union et bénéficié de l’effondrement des cours du porc), Andrew Carnegie, James J. Hill, John D. Rockefeller … autant de gens qui avaient à peine plus de vingt ans quand la guerre éclata et qui devinrent fournisseurs de l’armée plutôt que d’aller se battre. Les premiers navires cuirassés ont fait leur apparition ; grâce au fusil à canon rayé mis au point par le Français Cunié, il est devenu beaucoup plus facile de tuer.
Lorsque Grant arrive près d’Appomattox Court house, dans la maison de McLean, Lee est déjà là, dans son uniforme impeccable. Grant, lui, n’a pas songé à se changer. Son uniforme est crotté. Il ne l’a pas fait pour humilier ses adversaires, il est venu comme il était, plein de boue de son campement. À son arrivée, la solennité s’abat sur les lieux et écrase tous les hommes qui sont là. Le visage de Grant, à cet instant, est étrange. Ce qu’il exprime le plus, c’est l’abattement. Comme s’il était dévasté par cette victoire. Comme si ce moment qui mettait un terme à quatre années de saignement et de carnage le plongeait dans la plus profonde tristesse. Lee reste digne, exemplaire. Pour échanger quelques mots avant la signature de la reddition, Grant rappelle à Lee qu’ils se sont déjà vus. C’était lors des campagnes mexicaines. Il se souvient bien de l’aura que le général confédéré avait déjà à l’époque. Il a évoqué ce souvenir pour dire son respect, mais c’était une autre vie et Lee ne se souvient pas … Tant d’hommes sont morts depuis. Ils se serrent la main. Lincoln a autorisé Grant à offrir à Lee de généreuses conditions de reddition. Les soldats sudistes seront désarmés et nourris. Les officiers seront libres. Il faut déjà penser à la réconciliation. Lorsqu’ils sortent de la maison d’Appomattox, les soldats de l’Union hurlent spontanément de joie mais Grant les fait taire d’un geste de la main. On ne fête pas la victoire dans une guerre civile. L’ennemi d’hier est le voisin de demain. Les rangs se taisent. Et les hommes font une haie d’honneur à la délégation sudiste, qui repart, mâchoire serrée, annoncer aux troupes qu’ils ont perdu le guerre mais qu’ils auront à manger ce soir.
Laurent Gaudé. Écoutez nos défaites. Actes Sud 2016
En 1865, alors que la Triple Alliance annonçait l’imminente destruction du Paraguay, le général Ulysses Grant célébrait à Appomatox la reddition du général Robert Lee. La guerre de Sécession se terminait par la victoire des centres industriels du Nord, 100 % protectionnistes, sur les planteurs libre-échangistes de coton et de tabac du Sud. La guerre qui allait déterminer le destin colonial de l’Amérique latine commençait en même temps que prenait fin celle qui avait rendu possible la consolidation des États-Unis comme puissance mondiale. Devenu peu après président des États-Unis, Grant affirma : Pendant des siècles l’Angleterre a pratiqué le protectionnisme, elle l’a poussé à l’extrême et en a obtenu des résultats satisfaisants. Il ne fait pas de doute qu’elle doit sa force actuelle à ce système. Depuis deux siècles, elle a jugé profitable d’adopter le libre-échange, car elle pense que le protectionnisme ne peut plus rien lui rapporter. Alors, très bien, messieurs, la connaissance que j’ai de mon pays me porte à croire que dans deux cents ans, lorsque l’Amérique aura tiré du protectionnisme tout ce qu’il peut lui offrir, elle adoptera également le libre-échange.
Deux siècles et demi auparavant, le jeune capitalisme anglais avait exporté dans ses colonies du nord de l’Amérique ses hommes, ses capitaux, ses modes de vie, ses élans et ses projets. Les treize colonies, vannes d’évacuation pour la population européenne excédentaire, mirent rapidement à profit le handicap que leur imposait la pauvreté de leur sol et de leur sous-sol et constituèrent une conscience industrialisatrice que la métropole laissa s’épanouir sans problèmes majeurs. En 1631, les colons de Boston, nouveaux arrivants, lancèrent sur les eaux de l’Océan un voilier de trente tonnes, le Blessing of the Bay, qu’ils avaient construit eux-mêmes, et dès lors l’industrie navale connut un essor étonnant. Le chêne blanc, abondant dans les forêts, donnait un bois excellent pour les œuvres vives et les charpentes intérieures ; le pont, le beaupré et les mâts étaient en sapin. Le Massachusetts subventionnait les producteurs de chanvre pour les cordes et les cordages et encourageait la fabrication locale des voiles. Au nord et au sud de Boston, des chantiers prospères s’installèrent tout au long des côtes. Les gouvernements des colonies accordaient des subventions et décernaient des prix aux manufactures de toute espèce. On stimulait la culture du lin et la production de la laine, matières premières pour la fabrication de tissus qui, s’ils n’étaient pas très élégants, avaient au moins le mérite d’être solides et nationaux. Pour exploiter les gisements de fer de Lyn, on créa en 1643 la première fonderie ; en peu de temps, le Massachusetts approvisionna toute la région en fer. Comme les encouragements à la production textile paraissaient ne pas donner de résultats suffisants, cette colonie opta pour la contrainte : en 1655, elle vota une loi menaçant chaque famille de sanctions graves si elle ne comptait pas au moins un fileur en activité et assurant une production intense. Chaque comté de Virginie était obligé, à la même époque, de désigner des enfants aptes à l’apprentissage dans l’industrie textile. En même temps, l’exportation des cuirs était interdite : ils devaient être transformés localement en bottes, en courroies, en harnais.
Les inconvénients contre lesquels l’industrie coloniale doit lutter ont les origines les plus diverses mais ne proviennent pas de la politique coloniale anglaise, affirme Kirkland. Au contraire, les difficultés de communication faisaient que la législation prohibitive perdait presque toute sa force à tant de milles de distance et favorisaient la tendance à l’approvisionnement sur place. Les colonies du Nord n’envoyaient à l’Angleterre ni argent, ni or, ni sucre ; en revanche, leurs besoins provoquaient un excès d’importations qu’il fallait nécessairement trouver le moyen de contrecarrer. Les relations commerciales n’étaient pas très actives d’un côté à l’autre de l’Océan et il devenait indispensable de développer les manufactures locales pour survivre. Au XVIII° siècle, l’Angleterre prêtait encore si peu d’attention à ses colonies du Nord qu’elle n’empêchait pas le transfert vers leurs ateliers des techniques métropolitaines les plus avancées, réalité qui démentait les interdits de papier du pacte colonial. Ce n’était certes pas le cas des colonies latino-américaines qui fournissaient l’air, l’eau et le sel au capitalisme européen grandissant, et pouvaient entretenir avec largesse les goûts de luxe de leurs classes dominantes, en important d’outre-mer les objets les plus fins et les plus coûteux. Seules les activités tournées vers l’exportation étaient en expansion en Amérique latine, et le restèrent au cours des siècles qui suivirent : les intérêts économiques et politiques de la bourgeoisie minière ou terrienne ne coïncidèrent jamais avec la nécessité d’un développement économique intérieur, et les commerçants étaient moins liés au Nouveau Monde qu’aux marchés étrangers des métaux et des denrées alimentaires qu’ils vendaient et aux sources étrangères des articles manufacturés qu’ils achetaient.
Quand elle proclama son indépendance, la population nord-américaine était équivalente à celle du Brésil. La métropole portugaise, aussi sous-développée que l’espagnole, exportait son sous-développement dans sa colonie. L’économie brésilienne avait été orientée pour le profit de l’Angleterre, qu’elle approvisionna en or pendant tout le XVIII° siècle. La structure sociale de la colonie reflétait cette fonction de pourvoyeuse. La classe dirigeante brésilienne n’était pas formée, comme celle des États-Unis, de fermiers, de fabricants actifs et de commerçants de l’intérieur. Les principaux interprètes des idéaux des classes dominantes des deux pays, Alexander Hamilton et le vicomte de Cairû, expriment clairement la différence. Ils avaient été tous les deux disciples d’Adam Smith, en Angleterre. Mais alors qu’Hamilton était devenu le champion de l’industrialisation et proclamait que l’État devait encourager et protéger les manufactures nationales, Cairû croyait en l’opération magique de la main invisible du libéralisme : laisser faire, laisser passer, laisser vendre.
À la fin du XVIII° siècle, les États-Unis possédaient déjà la deuxième flotte marchande du monde, entièrement constituée de bateaux construits dans les chantiers nationaux, et les usines textiles et sidérurgiques étaient en plein essor. Peu après naquit l’industrie mécanique : les fabriques n’avaient plus besoin d’acheter à l’étranger leur matériel. Les puritains pleins de ferveur du Mayflower avaient jeté les bases d’une nation dans les campagnes de la Nouvelle-Angleterre ; sur le littoral aux baies profondes, le long des grands estuaires, une bourgeoisie industrielle avait prospéré sans discontinuer. Le trafic commercial avec les Antilles, qui incluait la vente d’esclaves africains, joua dans ce sens, comme nous l’avons vu, un rôle capital, mais l’exploit nord-américain ne pourrait s’expliquer s’il n’avait été animé, dès le début, par le plus ardent des nationalismes. George Washington l’avait préconisé dans son message d’adieu : les États-Unis devaient suivre une route solitaire. Emerson, en 1837, proclamait : Nous avons écouté les muses raffinées de l’Europe pendant trop longtemps. Nous marcherons avec nos propres pieds, nous travaillerons avec nos propres mains, nous parlerons selon nos propres convictions.
Les fonds publics facilitaient le développement du marché intérieur. L’État ouvrait des routes et des voies ferrées et construisait des ponts et des canaux. Au milieu du siècle, la Pennsylvanie participait à la gestion de plus de cent cinquante sociétés d’économie mixte, tout en administrant les cent millions $ investis dans les entreprises publiques. Les opérations militaires de conquête, qui enlevèrent au Mexique plus de la moitié de son territoire, contribuèrent également, dans une large mesure, au progrès du pays. L’État ne se contentait pas de participer au développement par des investissements et des dépenses militaires destinés à l’expansion ; dans le Nord, il avait commencé à appliquer un strict protectionnisme douanier. Les propriétaires terriens du Sud étaient, au contraire, libre-échangistes. La production du coton doublait tous les dix ans et, si elle fournissait d’importants revenus à la nation tout entière et alimentait les tissages modernes du Massachusetts, elle était surtout dépendante des marchés européens. L’aristocratie du Sud était liée avant tout au marché mondial, comme l’Amérique latine ; du travail de ses esclaves provenaient 80 % du coton utilisé dans les filatures européennes. Quand le Nord ajouta au protectionnisme industriel l’abolition de l’esclavage, la divergence totale d’intérêts déclencha la guerre. Le Nord et le Sud formaient deux mondes en vérité opposés, deux époques historiques différentes, deux conceptions antagoniques du destin national. Le XX° siècle gagna cette guerre du XIX° siècle :
Chante, chante, homme libre… Le Roi Coton si vieux est mort et enterrés’écriait Claude Fohlen, poète de l’armée victorieuse. Après la défaite du général Lee, les tarifs douaniers prirent une valeur sacrée ; on les avait renforcés pendant le conflit pour obtenir des ressources, on les garda pour protéger l’industrie victorieuse. En 1890, le Congrès vota le tarif McKinley, ultraprotectionniste, et la loi Dingley releva les droits de douane en 1897. Peu après, les pays développés d’Europe se virent obligés à leur tour de poser des barrières de protection devant l’irruption des produits nord-américains dangereusement compétitifs. Le mot trust avait été prononcé pour la première fois en 1882 ; le pétrole, l’acier, les denrées alimentaires, les chemins de fer et le tabac étaient entre les mains des monopoles, qui avançaient avec des bottes de sept lieues. Le Sud devint une colonie intérieure des capitalistes du Nord. Après la guerre, la propagande pour la construction de filatures dans les deux Carolines, la Géorgie et l’Alabama, prit le caractère d’une croisade. Ce n’était pas le triomphe d’une cause morale, les industries nouvelles ne naissaient pas par pur souci humanitaire : le Sud offrait une main-d’œuvre moins chère, de l’énergie à bon marché et des bénéfices substantiels, qui atteignaient parfois 75 %. Les capitaux venaient du Nord pour lier le Sud au centre de gravité du système. L’industrie du tabac, concentrée en Caroline du Nord, dépendait du trust Duke, réinstallé dans le New Jersey pour profiter d’une législation plus favorable ; la Tennessee Coal and Iron Co., qui exploitait le fer et le charbon de l’Alabama, passa en 1907 sous le contrôle de la U.S. Steel, qui décida dès lors des prix et élimina ainsi la concurrence gênante. Au début du siècle, le revenu per capita, dans le Sud, avait baissé de moitié, comparé au niveau d’avant la guerre.
Avant la guerre de Sécession, le général Grant avait participé à la spoliation du Mexique. Après la guerre, le même général fut un président aux idées protectionnistes. Tout relevait du même processus d’affirmation nationale. L’industrie du Nord orientait l’histoire et, déjà maîtresse du pouvoir politique, elle veillait, du gouvernement, à maintenir dans une forme florissante ses intérêts principaux. La frontière agricole se dilatait à l’ouest et au sud, aux dépens des Indiens et des Mexicains ; mais elle n’agrandissait pas les latifondi sur son passage, elle implantait de petits propriétaires dans les nouveaux espaces occupés. La terre promise n’attirait pas seulement les paysans européens ; les maîtres artisans les plus divers et les ouvriers spécialisés en mécanique, métallurgie et sidérurgie arrivèrent également d’Europe pour enrichir l’intense industrialisation nord-américaine. À la fin du siècle dernier, les États-Unis étaient déjà la première puissance industrielle du globe ; en trente ans, après la guerre civile, les usines avaient multiplié par sept leur rendement. La production de charbon américain égalait déjà celle de l’Angleterre, et celle de l’acier lui était deux fois supérieure ; les voies ferrées étaient neuf fois plus développées. Le centre de l’univers capitaliste commençait à se déplacer.
Comme l’Angleterre, les États-Unis allaient prôner, à partir de la Seconde Guerre mondiale, la doctrine du libre-échange, de la liberté commerciale et de la libre concurrence, mais pour la consommation extérieure. Le Fonds monétaire international et la Banque Mondiale virent le jour en même temps, afin de refuser aux pays sous-développés le droit de protéger leurs industries nationales et de décourager chez eux l’action de l’État. On attribua des propriétés curatives infaillibles à l’initiative privée. Néanmoins, les États-Unis n’abandonnèrent pas une politique économique qui reste rigoureusement protectionniste et qui écoute attentivement les voix de sa propre histoire : dans le Nord, on ne confondit jamais la maladie avec le remède.
Eduardo Galeano. Les veines ouvertes de l’Amérique Latine. Terre humaine Plon
Les Russes voulurent prendre la place des Américains sur le marché du coton, réduit à rien par la guerre. Les terres adéquates étaient à l’est de la mer d’Aral, à l’est de la Caspienne : mais le coton a besoin d’eau… que l’on prit dans les deux fleuves qui alimentent la mer d’Aral : l’Amou Daria – anciennement Oxus – et le Syr Daria – anciennement Axertès – ; c’est le début de l’assèchement de la mer d’Aral.
14 04 1865
Abraham Lincoln, est assassiné au théâtre Ford de Washington par John Wilkes Booth, un sudiste fanatique, d’une balle de revolver dans la nuque. L’assassin enjambe la balustrade qui le sépare de la scène et lance à l’assistance : Sic semper tyrannis : – Qu’il en soit toujours ainsi des tyrans – . Il s’enfuit à cheval mais sera tué quelques jours plus tard avec ses complices ; la petite bande qui avait ses habitudes à la taverne de Mary Surratt [elle sera pendue] n’avait pas de commanditaire.
Pendant quatre années la haute figure d’Abraham Lincoln a animé la lutte du Nord, – la guerre de Sécession – mais par son humanité, sa sagesse et la mesure de ses vues, la noblesse de sa pensée, son nom et sa mémoire appartiennent à toute l’Union sans distinction de camp. Il prend place, après Jefferson, après Jackson, dans la galerie des présidents dont le séjour à la Maison-Blanche a écrit un nouveau chapitre dans l’histoire des États-Unis. Il est lui aussi un self-made man et sa carrière illustre à merveille l’existence des pionniers de l’Ouest : mais il a surtout apporté une conception de la démocratie généreuse, optimiste, résolument confiante dans la bonne volonté et les possibilités de chaque homme. On rapporte de lui des traits d’humanité qui honorent l’homme. Cette guerre qu’il n’avait pas voulue, à laquelle il avait dû se résoudre pour sauver l’Union dont il avait reçu la charge en dépôt, il entendait en effacer au plus vite les blessures ; vivant il eût fait prévaloir des solutions de réconciliation et d’oubli. Mais le geste d’un fanatique fit coïncider son assassinat avec la fin de cette affreuse guerre civile : la sagesse de Lincoln, sa magnanimité et sa largeur de vues manquèrent soudain aux États-Unis sortant de la guerre, comme quatre-vingts ans plus tard presque jour pour jour et dans des circonstances assez semblables, au début d’un nouveau mandat, Franklin Roosevelt fit défaut aux États-Unis victorieux dans la difficile tâche d’organiser la paix.
René Rémond. Histoire Universelle. La Pléiade 1986
Les cimetières sont peuplés de gens irremplaçables, dit-on pour faire systématiquement confiance à la vie, aux talents des remplaçants. C’est vrai bien souvent mais ce ne le fut pas pour Lincoln dont la mort prématurée fut une véritable catastrophe pour les États-Unis. Il fallait un talent et un poids hors du commun pour gérer au mieux cette sortie de guerre, et son successeur, Andrew Johnson, n’avait ni ce poids ni ce talent, et quand la loi de l’État renonce à son pouvoir, c’est la loi du clan qui prend la place : et ainsi l’on verra fleurir dans le sud ces poisons que sont les codes noirs, la ségrégation, et ce gangstérisme que sera le Ku Klux Klan, au racisme nauséeux, fondé à Pulaski, dans le Tennessee en décembre 1865. Ce n’était au départ qu’un club de mecs qui voulaient vider ensemble des chopes de bière en rigolant sur le dos des negroes. Mais le vilain petit canard grandira très vite, sous la houlette du général sudiste Nathan Forrest. Il sera à l’apogée de sa puissance quand l’État fédéral commencera à réagir en 1868 en l’interdisant légalement avec la proclamation d’une loi martiale en 1872 ; mais il était déjà trop tard, et finalement la ségrégation finira par s’imposer dans les États du Sud.

27 04 1865
Le SS Sultana, un steamer à roues à aubes naviguant sur le Mississipi, long de 80 mètres, jaugeant 1 750 tonneaux, 85 hommes d’équipage est normalement affecté au commerce du coton, mais la guerre de Sécession l’a amené à faire fréquemment du transport de troupes. Avec 100 passagers civils et un grand nombre de soldats (approximativement 2 100) de l’Union, et plusieurs prisonniers de l’armée confédérée, le navire est gravement surchargé, sa capacité maximale étant de 376 personnes. Une panne l’a amené à accoster à Pittsburg où, tant bien que mal, on a rafistolé la chaudière, qui, sollicitée bien au-delà de ses capacités, explose vers 2 heures du matin, provoquant l’embrasement du bateau en bois. On évaluera le nombre de morts entre 1 500 et 1 900. Le drame ne fit pas vraiment la Une des journaux, encore occupée par l’assassinat de Lincoln, treize jours plus tôt.

5 05 1865
Napoléon III accorde aux musulmans algériens la nationalité française, leur statut personnel continuant cependant à être régi par la loi coranique ou les coutumes berbères. Et à ceux qui acceptaient de renoncer à leur statut de civil musulman, était accordée la citoyenneté entière. Ceux-là eurent, dès lors, accès à la fonction publique française et se virent reconnaître des droits de représentation politique dans les institutions locales. Mais ils furent très peu nombreux à vouloir bénéficier de ces dispositions : on parle de 130 demandes !
Comme vous il y a vingt siècles, nos ancêtres aussi ont résisté avec courage à une invasion étrangère et, cependant, de leur défaite date leur régénération. Les Gaulois vaincus se sont assimilés aux Romains vainqueurs et de l’union forcée entre les vertus contraires de deux civilisations opposées est née avec le temps cette nationalité française qui, à son tour, a répandu ses idées dans le monde entier.
Napoléon III
11 05 1865
Jules Jaluzot et Jean Alfred Duclos fondent Le Printemps sur un terrain en friche du quartier Saint Lazare.
14 06 1865
La valeur légale du chèque est reconnue.
21 06 1865
Création d’un enseignement professionnel. Physicien, directeur de l’Observatoire de Paris, député des Pyrénées Orientales, François Arago y avait consacré quelques joutes oratoires à l’Assemblée : Il y a chez nous un grand nombre d’autorités universitaires qui ont peu de goût, peu de bienveillance, pour les études scientifiques (…). Il a été dit ici même qu’elles étaient un métier de manœuvre […] Ce n’est pas, en effet, avec de belles paroles qu’on fait du sucre de betterave ; ce n’est pas avec des alexandrins qu’on extrait la soude du sel marin…
14 07 1865
Ascension franco-anglaise du Cervin – 4 478 m. -, sur la frontière entre la Suisse – Zermatt – et l’Italie – Breuil Cervinia -. Ils sont déjà nombreux ceux dont ce magnifique sommet est devenu le but de toute une vie. Toutes ces tentatives se concentraient autour de la rivalité entre le guide valdôtain Jean-Antoine Carrel et l’Anglais Edward Whymper. Pour rassembler tous les atouts, ce dernier avait pris contact avec le valdôtain mais n’avait pas accepté ses conditions : emmener son frère Jean-Jacques. Donc ils allaient rester rivaux. En 1857, Jean Antoine Carrel, a fait une tentative en compagnie de son frère Jean Jacques et d’Aimé Gorret ; ils ont dû s’arrêter à l’arête du Lion. L’Irlandais John Tyndall s’y lance en 1862 en compagnie de deux guides suisses et de Jean Antoine Carrel, mais recruté en tant que porteur, ce qu’il ne goûte guère et il le fera savoir : ils atteignent le pic qui sera par après nommé Tyndall et s’arrêtent au passage de l’Enjambée. Au cours d’une tentative ultérieure, Carrel atteindra la crête du coq, à 4032 m.
Whymper et Lord Douglas ont engagé Taugwalder père et fils, respectivement guide et porteur à Zermatt. Ils forment une caravane de 7 personnes. Edward Whymper, artiste dessinateur de 25 ans, est déjà un alpiniste au palmarès prestigieux, Charles Hudson, vicaire dans le Lincolnshire, est considéré comme le meilleur montagnard amateur de son temps – il vient de faire, sans guide, le Mont Blanc par le Goûter, en redescendant par les Grands Mulets -; Hadow, son pupille, 19 ans, est bon marcheur mais alpiniste inexpérimenté, lord Francis Douglas, environ 20 ans est déjà un excellent alpiniste. Un autre guide, chamoniard, est venu renforcer la cordée : Michel Croz. Ils atteignent le sommet par l’arête suisse du Hörnli, ce que voit à la jumelle Jean Antoine Carrel qui renonce pour cette fois mais ce n’est que partie remise.

La première ascension du Cervin. Gustave Doré

dessin de Whymper
À la descente, c’est le drame : l’un d’eux dévisse, en entraîne trois autres, dont Michel Croz : le dernier à être emporté est Francis Douglas, puis viennent, dans l’ordre Taugwalder père, Edouard Whymper et Taugwalder fils. Ces trois derniers seront saufs… car la corde s’est rompue entre Francis Douglas et Taugwalder père. Que s’est-il passé ? la corde s’est-elle cassée seule, sous l’effet du choc, ou bien Taugwalder père l’a-t-il coupée d’un geste rapide et sur ?

Le désastre du Cervin. Gustave Doré

Das gerissene Seil im Matterhorn Museum von Zermatt. L a corde est en chanvre de Manille – Manila Hanft –
Le récit que fît Whymper de ce drame l’innocente complètement : pour Whymper, la corde s’est rompue toute seule : Hadow vient de glisser : il entraîne dans sa chute Michel Croz, qui s’était séparé de son piolet pour l’aider à franchir un passage pourtant facile, Charles Hudson est entraîné à son tour, et enfin Lord Francis Douglas : … Tout ceci se passa avec la rapidité de l’éclair. À peine le vieux Pierre et moi eûmes-nous entendu l’exclamation de Croz que nous nous cramponnâmes de toutes nos forces au rocher ; la corde bien tendue entre nous, nous imprima à tous deux, au même moment, une violente secousse. Nous tînmes bon le plus possible ; mais par malheur, la corde se rompit entre Taugwalder et lord Francis Douglas, au milieu de la distance qui les séparait.
Pendant quelques secondes, nous pûmes voir nos infortunés compagnons glisser sur le dos, les mains étendues pour tâcher de s’arrêter dans leur chute effrayante. Ils disparurent l’un après l’autre à nos yeux, sans avoir reçu la moindre blessure, et roulèrent d’abîme en abîme, jusque sur le glacier du Cervin, à 1 200 mètres en dessous de nous. Dès l’instant où la corde s’était brisée, nous ne pouvions plus les secourir.
Ainsi périrent nos malheureux compagnons ! Pendant près d’une demi-heure, nous restâmes à l’endroit où nous nous trouvions, sans oser faire le moindre mouvement. Paralysés par la terreur, les deux guides pleuraient comme des enfants et tremblaient tellement que nous étions menacés à tout instant de partager le sort de nos amis. Le vieux Pierre ne cessait de s’écrier :
Chamonix ! Oh ! que va-t-on dire à Chamonix !
Ce qui signifiait dans sa pensée : comment croire que Croz eût jamais pu tomber ? Le jeune homme ne faisait que sangloter et répétait, en poussant des cris aigus :
Nous sommes perdus, nous sommes perdus !
Attaché à la corde, entre eux deux, je ne pouvais faire un pas, tant pour remonter que pour descendre. Je priai donc le jeune Pierre d’avancer un peu ; il n’osait pas. Impossible de faire un seul mouvement s’il ne s’y décidait pas. Comprenant le danger, le vieux Pierre se mit aussitôt à crier :
Nous sommes perdus, perdus !
Les craintes du vieux étaient bien naturelles ; il tremblait pour son fils ; celles du jeune homme n’étaient que lâcheté, car il ne pensait qu’à lui.
Edward Whymper. Escalade dans les Alpes de 1860 à 1869. Ed. Librairie A. Jullien Genève 1922.
- Les interrogatoires de police qui suivirent le drame, s’ils ne parviennent pas à tout élucider, précisent tout de même quelques points :
Entre Lord Douglas et Taugwalder père la corde a été moins épaisse qu’entre Michel Croz et Lord Douglas d’un coté, et Taugwalder père et Taugwalder fils de l’autre coté… Whymper. - Je me suis attaché à Lord Douglas par une corde spéciale… Si j’avais trouvé que la corde employée entre Lord Douglas et moi n’était pas assez solide, je me serais bien gardé de m’attacher avec elle à Lord Douglas, et je n’aurais pas voulu le mettre en danger, pas plus que moi-même. Si j’avais trouvé cette corde trop faible, je l’aurais reconnu comme telle avant l’ascension du Mont Cervin et je l’aurais refusée. Pierre Taugwalder.
Quelle est votre opinion sur la rupture de la corde ?
Je ne puis le dire, mais le poids des trois personnes avec la force de leur chute aurait pu briser une corde bien plus solide . Pierre Taugwalder. - Qui a fourni la corde qui vous attachait à Lord Douglas ?
La corde a été fournie par MM. les touristes. J’ajoute que, pour me maintenir plus solidement, je me suis tourné contre la montagne, et comme la corde entre Whymper et moi n’était pas tendue , j’ai pu heureusement la rouler autour d’une saillie de rocher, ce qui m’a donné la force nécessaire pour me sauver. La corde qui m’attachait à Douglas et les autres personnes m’a donné par la chute de telles secousses que je suis bien souffrant à l’endroit où la corde a passé mon corps. Pierre Taugwalder. - Les interrogatoires finiront par un non lieu :
Considérant :
que des faits ci dessus il ne résulte aucun acte délictueux ;
que M. Hadow a occasionné l’accident ;
que de l’exposé des faits qui précède personne ne peut-être accusé d’une faute ou d’un délit, Il est décidé :
Il n’y a pas lieu de donner suite à la présente enquête, par contre il est porté une décision de non lieu avec frais à la charge du fisc.
Commission d’enquête pour le district de Viège. 1865.
Mais l’affaire n’en resta pas là et la tragédie du Cervin suscita d’innombrables rumeurs qui, loin de s’estomper, s’amplifièrent finalement en une terrible accusation : les trois survivants, et nommément le guide Zermattois Taugwalder père, avaient (ou auraient, le texte admet les deux traductions) coupé la corde à l’instant décisif, pour sauver leur propre vie d’une mort assurée.
Werner Kämpfen, Ein Bürgerechtsstreit im Wallis. Zürich, 1942. Traduction de Claude Macherel.
Il est vrai qu’il y a de quoi s’étonner des contradictions entre la version de Whymper de 1922 et celle de Taugwalder, à l’occasion de son témoignage auprès des enquêteurs ; il n’y a par contre aucune contradiction entre le témoignage de Taugwalder et celui – très court et concis – de Whymper, toujours devant la commission d’enquête. Pourquoi s’est-il plus tard éloigné du récit de Taugwalder ?
Whymper : la corde bien tendue entre nous, nous imprima à tous deux, au même moment, une violente secousse.
Taugwalder : J’ajoute que, pour me maintenir plus solidement, je me suis tourné contre la montagne, et comme la corde entre Whymper et moi n’était pas tendue, j’ai pu heureusement la rouler autour d’une saillie de rocher, ce qui m’a donné la force nécessaire pour me sauver.
Si Taugwalder dit vrai, Whymper n’aurait pas dû ressentir la secousse, car celle-ci aurait dû être encaissée intégralement par Taugwalder et le rocher autour duquel il était parvenu à enrouler la corde.
D’autre part, la photo de la seule extrémité de la corde rompue – représentée dans le récit de Whymper de 1922 – (l’autre extrémité a disparu avec Lord Douglas) permet de penser que cette corde a été coupée, tant la section apparaît nette et les torons tous bien sectionnés à la même longueur .
Il semble encore étonnant que les enquêteurs n’aient pas demandé à Taugwalder d’apporter ce qui restait de cette corde le reliant à Lord Douglas, – elle n’a pas été abandonnée pendant la descente puisqu’elle a été photographiée – : si elle avait été rompue, comme le rapporte Whymper, au milieu de la distance qui les séparait, cela enlevait toute possibilité de suspicion : il était matériellement impossible à Taugwalder d’aller couper cette corde à cette distance. Le fait que cette question n’ait pas été posée tend à faire penser que l’enquête a pris soin d’éviter tous les chemins qui pouvaient s’éloigner du non lieu… ce qui arrangeait tout le monde… Et aujourd’hui, avec les extraordinaires progrès des méthodes d’investigation policières, il est très étrange que tous les partisans d’un rétablissement de la vérité des faits par rapport au récit de Whymper se limitent à la recherche de témoignages, quand la priorité absolue devrait être donnée à tout ce qui pourrait faire parler cette corde, car tout de même, il doit bien être possible de dire si une corde en tension s’est rompue ou bien a commencée par être coupée avant de se rompre, une fois entamés les premiers torons.
C’est le début du grand alpinisme : sur les deux années 1864/65, Whymper gravira dans le Massif du Mont Blanc, le Mont Dolent, l’Aiguille d’Argentières, de Bionassay, la Verte par l’arête sud-est, et les Grandes Jorasses par l’arête sud-ouest. Le peintre John Ruskin, lui, parcourt les Alpes de 1832 à 1881, et il voit d’un très mauvais œil les débuts de l’alpinisme (la version alpiniste écolo n’est pas encore admise) : il apostrophe Whymper : Vous avez fait un champ de courses des cathédrales de la Terre… Les Alpes, que vos poètes ont aimé avec tant de respect, vous les considérez comme des mâts de cocagne dans des arènes d’ours, auxquels vous vous mettez en devoir de grimper, puis que vous redescendez avec des hurlements de joie.
À peu près dans le même temps, les Chamoniards exprimaient le respect qu’ils avaient de la hiérarchie catholique, en nommant Cardinal, Évêque, Moine et Nonne, quatre aiguilles d’altitude décroissante.
www.lumieresdaltitude.com/gallery.php?gallery
Les anniversaires, – en 2015, c’est le 150° -, sont le plus souvent le terrain privilégié des discours ronflants et redondants, habiles à masquer les arêtes parfois très coupantes de la réalité. À Zermatt, les montagnards suisses ont tenu à lui donner plus d’éclat et ce drame devient le sujet d’une pièce de théâtre The Matterhorn Story, qui se jouera en plein air, devant le Cervin, à 2 600 m du 9 juillet au 29 août 2015.
C’est un fin morceau de chanvre lové en huit et soigneusement ficelé en quatre endroits, à l’abri d’une épaisse vitrine du Musée alpin de Zermatt. Sa pâleur – qui tranche avec l’écrin rouge sur lequel il repose – et son extrémité – effilochée sur plusieurs centimètres – laisse présager qu’elle a été l’instrument d’un drame. Corde des premiers ascensionnistes du Cervin, celle qui a cassé entre Douglas et Taugwalder, 14.7.1865, confirme sobrement un écriteau.
Il y a cent cinquante ans, ce lien s’est rompu, provoquant la chute mortelle de 1 200 mètres des Britanniques Lord Francis Douglas, 18 ans, et Douglas Hadow, 19 ans, du mentor de celui-ci, le chapelain anglican Charles Hudson, 36 ans, et de leur très expérimenté guide chamoniard Michel Croz, âgé de 35 ans. Tous quatre venaient de réaliser la première du sommet du Cervin-Matterhorn (4 478 m) en compagnie d’un autre Anglais, Edward Whymper, 25 ans, et des guide et porteur zermattois Peter Taugwalder père et fils, 45 et 22 ans.
À la descente, Douglas Hadow, inexpérimenté et épuisé, a perdu l’équilibre, bousculant Michel Croz, qui se trouvait en tête, et entraînant Charles Hudson et Francis Douglas. Sous le choc, la corde maudite a cédé entre le quatrième grimpeur, Lord Francis Douglas, et le cinquième, Peter Taugwalder père.
Les dépouilles mortelles de Michel Croz, Douglas Hadow et Charles Hudson, déchiquetées, reposent toujours au cimetière de Zermatt. De Lord Francis Douglas, on n’a retrouvé qu’une chaussure, des gants et une ceinture… Le drame fit grand bruit, au point que la reine Victoria songea à interdire à ses sujets cet alpinisme trop meurtrier à son goût.
À Zermatt, une enquête et un procès ont abouti à la conclusion – essentiellement fondée sur la version de Whymper – que l’accident était imputable à la glissade de Douglas Hadow. Mais questions et rumeurs ont subsisté, mettant à mal l’honneur de Peter Taugwalder père, un guide jusque-là respecté et auteur de différentes premières.
Pourquoi était-il relié à Lord Francis Douglas par cette vieille corde peu solide alors que le groupe disposait d’une corde neuve et plus épaisse ? La corde s’est-elle rompue naturellement ou Taugwalder père l’a-t-il délibérément sectionnée pour échapper à une mort certaine ? L’homme souffrit tant de ces spéculations qu’il s’expatria plusieurs années au Canada, puis aux États-Unis.
On sait aujourd’hui qu’une fois suspendues au bout de la relique exposée au musée de Zermatt, les quatre premières victimes du Cervin-Matterhorn n’avaient aucune chance d’en réchapper. En 2005, un équipementier suisse l’a reproduite à l’identique, et un test de résistance a révélé qu’elle ne pouvait supporter plus de 150 kg. Mais les carnets de Whymper, Escalades dans les Alpes (Hoëbeke), publiés en 1871, font toujours référence. Et sans mettre directement en cause les Taugwalder, le graveur sur bois et illustrateur britannique y dresse d’eux le portrait peu flatteur de paysans cupides tout en se présentant implicitement comme le véritable héros de l’aventure. Une manière de s’afficher qui agace les Suisses, dont certains ont décidé de rééquilibrer l’histoire…
Parmi eux, Matthias Taugwalder, arrière-arrière-arrière-petit-fils de Peter Taugwalder père. Ce photographe et journaliste de 36 ans, originaire de Zermatt, a mené des recherches l’automne dernier. Je m’étonnais qu’on ne dispose encore aujourd’hui que de la version de Whymper, dit-il. Les journalistes n’ont pas fait leur travail, ni à l’époque ni plus tard. Il assure avoir retrouvé sans grande difficulté des documents historiques et avoir mené auprès de descendants des alpinistes anglais impliqués des entretiens prouvant que la vérité de Whymper est contestable.
Que recèlent ces trouvailles ? Mystère… Matthias Taugwalder en a vendu la primeur au quotidien allemand Stern qui les a publiées jeudi 9 juillet. Et le public pourra, promet-il, juger sur pièces grâce à une exposition desdits documents au Musée alpin de Zermatt. Dans un teaser vidéo sur son site Internet, Matthias Taugwalder diffuse aussi les extraits d’une interview de Reinhold Messner, rallié à sa cause. Il est évident que Whymper a enjolivé les événements en sa faveur, assène l’alpiniste italien, vainqueur sans oxygène des quatorze plus hauts sommets de la planète, ajoutant sans donner de détails que l’accident est comme un crime qu’on aurait imputé aux Taugwalder et qui leur a collé à la peau …
Livia Anne Richard n’est, elle, pas apparentée aux Taugwalder, mais c’est également une histoire de famille qui l’a conduite à s’intéresser à ceux qu’elle considère comme les véritables héros du Cervin-Matterhorn. En se rendant, il y a quatre ans, au festival musical Zermatt Unplugged, qu’organise un de ses cousins, cette auteure-metteuse en scène bernoise de 46 ans a découvert, dans le village perché à 1 600 mètres d’altitude, les monuments commémoratifs du drame dont elle ignorait tout. D’une plongée dans la documentation du Musée alpin, elle a tiré une pièce de théâtre. Interprétée par une quarantaine d’acteurs en costumes d’époque, la première de The Matterhorn Story a eu lieu jeudi 9 juillet. Elle sera jouée jusqu’au 29 août. Whymper savait exactement comment se dédouaner avec des réponses peu développées ou des omissions, estime Livia Anne Richard. Imaginez cet homme éduqué et éloquent et ces deux fermiers illettrés face aux enquêteurs…
Lors de son audition, Whymper a, par exemple, glissé que, pour des raisons inconnues de lui -, Taugwalder père avait utilisé la corde la moins solide pour la descente. Ce dernier s’en est expliqué en affirmant que le Britannique, dans sa hâte d’atteindre le sommet le premier, s’était débarrassé de la corde plus épaisse qui les reliait en la coupant, condamnant ainsi ses compagnons à en utiliser une peu fiable pour la descente. C’est la version la plus plausible, affirme Livia Anne Richard. C’est avant tout une histoire d’hommes, d’amitié, de trahison, d’ambition démesurée et de revanche, dit-elle, regrettant que Whymper – avec la crédibilité dont il jouissait – n’ait jamais tenté d’arrêter les rumeurs.
A l’époque, Whymper fréquente assidûment les Alpes depuis cinq ans pour les besoins de son métier lorsqu’il arrive à Zermatt, début juillet 1865. Devenu un alpiniste sérieux, il a cependant essuyé sept échecs, depuis août 1861, sur la pyramide asymétrique plantée sur la frontière italo-suisse qu’on appelle d’un côté Cervino (Cervin) et Matterhorn de l’autre. Tous les autres sommets de 4 000 mètres ont été vaincus. Par ailleurs, son compagnon de cordée régulier, Jean-Antoine Carrel, un guide italien de Valtournenche tout aussi obsédé que lui par cette montagne provocante, l’a laissé choir. Car Whymper a résolu de tenter l’aventure depuis le versant suisse, sans se soucier de priver ainsi l’Italie d’une gloire que Carrel considère due à sa patrie d’origine… Tandis que Carrel compose en hâte une cordée italienne, Whymper en improvise donc une autre, bien trop fournie et de niveaux trop disparates, avec Lord Francis Douglas, les Taugwalder, Charles Hudson, Douglas Hadow et Michel Croz.
Chris Keller, le comédien bernois de 28 ans qui incarne Edward Whymper dans la pièce de Livia Anne Richard, confesse cependant une certaine empathie pour le personnage. Je comprends sa fascination pour le Matterhorn, explique-t-il. Il est là comme un patron qui surveillerait Zermatt et il prend un nouveau visage chaque fois qu’on change d’angle pour le regarder. Pour endosser ce rôle, Chris Keller a lu les ouvrages de Whymper. Il passait pour être égoïste et arrogant, mais je crois comprendre ce qu’il a vécu, explique le comédien. Il était ambitieux, il aimait l’action et il craignait de ne pouvoir laisser son empreinte sur la montagne, de ne pouvoir s’extraire d’une vie sans éclat.
L’ambition était le plus gros problème de Whymper, et le village s’est divisé face à ce drame car c’était les débuts du tourisme pour Zermatt et c’était crucial, décrypte à son tour Joseph Taugwalder, 50 ans, employé dans une société de gestion de patrimoine zermattoise. Arrière-arrière-arrière-petit-fils de Peter Taugwalder père, lui aussi, il joue le rôle de ce dernier dans The Matterhorn Story tandis que son fils David, 22 ans, interprète celui de… Peter Taugwalder fils. Tous deux y voient une opportunité de réhabiliter leurs ancêtres. Pour la première de la pièce, Zermatt a fait porter une invitation à Buckingham Palace par un guide de haute montagne en tenue d’apparat, mais Sa Royale Majesté Elizabeth II n’a pas donné suite.
En tout cas, aucun drame ne devrait survenir sur le Cervin-Matterhorn en ce 150° anniversaire de la première ascension. En hommage aux quatre infortunés compagnons de Whymper et des Taugwalder et aux quelque 500 autres alpinistes qui y ont, depuis lors, laissé la vie, un couvre-feu de vingt-quatre heures sur la montagne a été décrété par les autorités suisses pour le 14 juillet.
Patricia Jolly. Le Monde 13 07 2015

Die sieben Gipfelstürmer vor dem 4478 Meter hohen Matterhorn: Peter Taugwalder senior (v. l.), Michel Croz, Charles Hudson, Lord Francis Douglas, Douglas R. Hadow, Edward Whymper und Peter Taugwalder junior

Edward Whymper

Michel Croz. Gravure d’Edouard Whymper. Summitpost.org
16 07 1865
Jean Antoine Carrel emmène au sommet du Cervin, Jean-Baptiste Bich, l’Abbé Amé Goret et Jean-Augustin Meynet. Ils ont pris la voie sud-ouest, l’arête du Lion, italienne, plus difficile que celle empruntée par Whymper, deux jours plus tôt. Le différend entre Whymper et Carrel n’était que technique et ils vont se retrouver pour faire ensemble le Chimborazo 6 130 m. en Équateur, et quelques autres 5 000. Surnommé le Bersaglier – le soldat – car il avait participé aux trois guerres de l’indépendance italienne, il gravira encore le Cervin pour sa 51° ascension à 62 ans, le 26 août 1891 ; le mauvais temps rendra la descente périlleuse et il mourra d’épuisement juste avant d’avoir retrouvé le plancher des vaches, mais ses deux clients Léon Sinigaglia et Charles Gorret seront saufs.
4 au 11 10 1865
Napoléon III et Bismarck [1] se sont rencontrés à Biarritz. Un peu moins de cinq ans séparent cette entrevue de la guerre de 1870. C’est à ce moment-là que Bismarck a fait le choix de la politique qui l’y conduirait. La relation des événements qui y ont mené est la plupart du temps bien réductrice : ramener la déclaration de la guerre de 1870 à l’histoire de la dépêche d’Ems, c’est prendre l’histoire par le petit bout de la lorgnette. Philippe Seguin, maire d’Épinal, ministre sous la première cohabitation de 1986 à 1988, président de l’Assemblée nationale de 1993 à 1997, premier président de la Cour des Comptes de 2004 à 2010, a cherché à rectifier ces présentations dans un Louis Napoléon le Grand paru chez Grasset en 1990. Il est ici très longuement cité : le caractère complexe de la période, la fréquente partialité des écrits qui lui sont relatifs, en faisaient une nécessité, même si elle vient mettre à mal le principe de cette chronologie, puisqu’elle couvre à peu près cinq ans, allant jusqu’à le défaite de Sedan, quand les textes à suivre ne la mentionnent que bien plus tard.
La confrontation des deux hommes à Biarritz apparaît comme l’un de ces événements qui transforment en inéluctable destin une histoire encore non écrite. Elle est comme une révélation pour Bismarck, dont la venue se plaçait sous le signe du doute et de l’humilité et qui va repartir plein de certitude et de détermination. Car avant l’entrevue, qui s’est déroulée dans sa majeure partie sur une terrasse du bord du rivage, Bismarck était pour le moins inquiet, persuadé que la pensée de Louis Napoléon comportait de mystérieux desseins qu’il était d’ailleurs venu découvrir… Pour la bonne cause, c’est-à-dire celle de l’Allemagne, il était peut-être prêt à écouter cet homme qui s’exprimait encore avec l’accent allemand. Désormais, à ses yeux, le dialogue a perdu toute importance. D’autant qu’ils se sont dit peu de choses. Louis Napoléon est resté dans le vague. N’ayant pas encore établi sa religion, il n’a pas parlé de compensations, soit qu’il n’ait rien à demander, soit qu’il estime prématuré, sur le moment, de le faire. Visiblement, il ne veut s’engager formellement envers aucun des deux futurs belligérants, cherchant à obtenir de chacun d’eux des garanties en cas de victoire. Il occupe une position de force, et estime ne pas avoir à se découvrir trop tôt. D’ailleurs, la déclaration de guerre n’est pas pour demain, et le conflit promet d’être long et indécis, comme le lui ont assuré ses généraux. Ceux-ci ne pronostiquent-ils pas pour la plupart la victoire de l’Autriche ?
Dès lors que les choses se passeraient comme chacun semble le penser, tout serait si simple : il empêcherait l’écrasement des Prussiens et obtiendrait en récompense une rectification de frontière sur le Rhin. Alors pourquoi s’engager à fond tout de suite ?
Après coup, lorsque les faits auront déjoué toutes les prévisions, y compris les siennes, on voit bien que c’est à ce moment seulement qu’il était en position de force, puisque Bismarck avait besoin d’assurances de sa part et qu’il était prêt à les payer au prix fort. Or, sur le principe des compensations [2], Louis Napoléon se montre à Biarritz tout à fait évasif. Pour jouer sur les deux tableaux, il a choisi sur ce point la prudence.
Il en dit assez, cependant, pour que Bismarck prenne le chemin du retour avec une triple certitude : Louis Napoléon n’a pas conclu d’alliance avec l’Autriche ; il est sans doute prêt à favoriser l’alliance de l’Italie avec la Prusse, et celle-ci peut désormais s’engager entièrement contre l’Autriche sans craindre de voir l’armée française se déployer sur le Rhin.
Peu après avoir quitté Biarritz, Bismarck écrira : Avant de le voir, j’avais peur. Depuis, je suis rassuré. Derrière son mystère, il n’y a rien… L’Empereur des Français est une grande incapacité méconnue.
Biarritz s’avérera donc, après coup, un échec diplomatique pour Louis Napoléon. Un échec qui aurait pu être réparé dans les semaines suivantes. Mais pourquoi aurait-on alors changé de stratégie, rien ne semblant de nature à remettre en cause les éléments de l’analyse sur laquelle elle se fondait ?
Ainsi, lorsque Bismarck, peu avant le déclenchement des hostilités, offre formellement à la France le Luxembourg et les bords de la haute Moselle, Louis Napoléon élude la proposition. Quelle raison aurait-il de l’accepter alors qu’il peut espérer bien davantage ?
Son action suit son cours logique. Il conseille à Victor-Emmanuel de s’allier aux Prussiens. Parallèlement, il obtient des Autrichiens la promesse de l’abandon de la Vénétie. De ce côté-là, les choses sont claires : quoi qu’il arrive, il aura apporté la Vénétie aux Italiens ; certes, l’alliance italo-prussienne ne vaut que pour trois mois. Même dans cette hypothèse, le résultat est atteint : le retour de l’Italie à la neutralité ne la priverait pas des territoires de Venise.
Dès lors, semble-t-il, Louis Napoléon est en droit d’attendre avec sérénité les événements. Il peut se cantonner dans une neutralité attentive, laisser se développer le conflit et, à l’instant qu’il jugera le plus propice, imposer sa médiation. Alors, un choix lui sera offert, s’agissant de gains territoriaux : une partie de la Rhénanie, le Luxembourg, la Belgique peut-être. Et il sera en mesure d’imposer une réorganisation de l’Allemagne en trois tronçons, dont la taille variera en fonction de ce qui se sera passé sur le terrain militaire : la Prusse dominera, grosso modo, les États du nord du Main, l’Autriche ceux du sud, et l’on prévoira entre les deux un État tampon.
Dans toute cette affaire, on a beaucoup critiqué le machiavélisme de l’Empereur, le caractère sournois de ses manœuvres, et son double jeu. On a prétendu qu’il s’était pris les pieds dans le tapis qu’il avait lui-même tissé. Il s’agit là d’un de ces jugements à postériori qui n’honorent pas toujours leurs auteurs.
En réalité tout l’échafaudage reposait sur cette poutre maîtresse : le conflit devait être long et indécis.
Comment en vouloir à Louis-Napoléon de l’avoir cru quand c’était l’opinion générale ? Maintenant encore, on peut se perdre en conjectures devant le spectacle d’une armée autrichienne, si brillante face aux Italiens qu’elle a écrasés sur terre à Custozza, le 24 juin, et sur mer, peu après, à Lissa, et qui s’avère incapable, malgré le concours de la Bavière, du Hanovre et de la Saxe, de contenir la poussée prussienne. Il est vrai que le meilleur des militaires autrichiens se trouve sur le front italien et que, face au formidable instrument guerrier conçu par Moltke, les forces opposées aux Prussiens et leur commandement laissent beaucoup à désirer. Si l’on ajoute à cela que le fusil prussien tire cinq coups pendant que l’autrichien n’en tire qu’un, l’événement paraît plus aisément explicable.
Quoiqu’il en soit, c’est la surprise générale quand, le 3 juillet 1866, les Autrichiens sont sévèrement battus à Sadowa. Le généralissime autrichien Benedek avait reçu l’ordre de Vienne d’engager une bataille défensive entre l’Elbe et la Bistriz ; son armée de deux cent vingt mille hommes a été coupée en deux par les Prussiens, et quarante mille soldats ont trouvé la mort.
La nouvelle produit dans toute l’Europe l’effet d’un coup de tonnerre, encore que les conséquences n’en soient pas aussitôt mesurées : on va même trouver des Français pavoisant leurs fenêtres pour fêter une si belle victoire du principe des nationalités.
Louis Napoléon, même s’il n’en laisse rien paraître, a tout de suite conscience de la gravité de l’événement et de ce qu’il représente comme danger pour la France. La situation créée n’a strictement rien à voir avec celle qu’il pouvait raisonnablement escompter.
[…] Au premier abord, tout ne parait pas trop mal tourner… L’un des scénarios initialement imaginés commence à se dérouler comme prévu. Dès le 4 juillet, l’Autriche fait appel à la médiation de la France. Il a dû en coûter beaucoup à François-Joseph de s’avouer ainsi vaincu, lui qui tient le roi de Prusse en si piètre estime. Comme l’a noté Charles de Gaulle, pour l’Empereur humilié en 1866, l’Allemagne prussienne apparaissait, comme au seigneur d’un château croulant, le palais neuf de son régisseur malhonnêtement enrichi. Le problème tient évidemment au fait que la médiation française se présente dans des conditions beaucoup moins favorables que celles qui avaient été imaginées. La Prusse est en position de force ; elle n’a aucun intérêt à un armistice rapide, et veut obtenir tout son dû avant de déposer les armes. Quant à la France, quel profit peut-elle légitimement retirer de l’affaire, quelles garanties peut-elle obtenir pour le futur ? Son intervention diplomatique, dans un contexte aussi limpide – un vainqueur et un vaincu – ne vaut pas très cher. Ce sont des bons offices qu’on lui propose, non une médiation dont l’évidence serait imposée.
Le ministre des Affaires étrangères, Drouyn de Lhuys, a le mérite de comprendre fort bien tout cela : une simple médiation amicale se bornerait à tirer les conséquences – assurément néfastes – de la situation qui vient d’être créée. Pour y parer, on doit faire évoluer cette situation, et modifier le jeu. Il faut donc une médiation musclée. Pour l’imposer, le ministre propose une démonstration militaire sur la frontière, afin d’appuyer politiquement la manœuvre et de démontrer qu’on est prêt à aller jusqu’au bout, il suggère de convoquer le Corps législatif en session extraordinaire.
Bismarck confirmera, plus tard, combien le ministre des Affaires étrangères avait vu juste : Un petit appoint de troupes françaises sur le Rhin, uni aux corps nombreux de l’Allemagne du Sud, eut mis les Prussiens dans la nécessité de défendre Berlin, d’abandonner tous leurs succès en Autriche.
L’impératrice plaide pour cette solution. Elle a senti la menace de l’orgueil et de la volonté de puissance de la Prusse. Elle a très bien compris le danger que fait courir à l’Europe son esprit dominateur. Elle sent qu’un jour ou l’autre, celle-ci s’en prendra à la France : Jamais, dira l’ambassadeur d’Autriche, depuis que je connais le couple impérial, je n’ai vu l’empereur si inexistant, ni l’impératrice prendre nos intérêts à cœur avec tant d’acharnement et de zèle.
De son côté, Eugénie se lamente : Ma voix n’a aucun poids et je suis à peu près seule de mon avis. On exagère les dangers d’aujourd’hui pour nous faire oublier ceux de demain.
Effectivement, en conseil des ministres, Rouher et d’autres que lui plaident contre la solution de Drouyn de Lhuys. Le ministre de l’Intérieur, La Valette, est particulièrement véhément : n’est-ce pas l’empereur lui-même qui a préconisé l’alliance italo-prussienne ? Comment dès lors intervenir sans paraître se renier ?
L’empereur s’est retiré, sans se prononcer. Le tour du débat a pu donner à penser que Drouyn l’avait emporté. Fausse impression. Pendant la nuit, peut-être Louis Napoléon a-t-il fait l’objet d’une ultime pression de la part des adversaires de la démonstration armée ? Toujours est-il que le lendemain la convocation du Corps législatif ne paraît pas au Moniteur. La France ne bougera pas. Officiellement médiatrice, elle ne sera en fait que simple spectatrice. Plus encore que celle de Sadowa, c’est la date du 5 juillet 1866 qui s’inscrit au calendrier comme une journée noire pour la France.
Pourquoi Louis Napoléon a-t-il renoncé à intervenir ? Traverse-t-il alors une phase de crise physique particulièrement aigüe, qui amoindrit sa capacité de décision ? C’est plus que probable : il venait de quitter précipitamment Vichy. On avait dû le sonder et il était rentré à Saint Cloud pour y prendre le lit sur l’ordre de ses médecins. L’ambassadeur de Prusse, Goltz, en informa son gouvernement par télégramme chiffré : J’ai trouvé l’Empereur secoué, presque brisé… Il paraît avoir perdu sa boussole de route.
Autant la maladie n’affecte en rien sa résolution sur le moyen et le long terme, autant dès qu’il y a lieu de prendre des mesures immédiates, le sort paraît suspendu à l’état de son mal. Il maintient ainsi fermement son cap sur le plan de la politique intérieure, mais en politique étrangère, où les réponses doivent être souvent données dans l’instant, son état de santé peut provoquer des dommages.
Il est possible, aussi, qu’il n’ait guère cru aux affirmations du maréchal Randon, qui se faisait fort d’amener immédiatement quatre-vingt mille hommes sur le Rhin, et deux cent cinquante mille dans les vingt jours, et qu’il les ait considérées comme autant de rodomontades.
Ce qui est certain, c’est qu’il a déjà conscience des insuffisances de l’armée française, une conscience angoissée face au nouveau défi auquel, immanquablement, elle va se trouver confrontée.
Enfin, n’est pas à exclure une réaction d’orgueil de sa part à l’idée de sembler fléchir devant les tenants de ce parti pro-autrichien qu’il a toujours combattu et qu’il n’est guère tenté de satisfaire.
Quoi qu’il en soit, et comme il n’était que trop prévisible, les conditions de la paix vont être dictées par la Prusse. Lors des négociations préliminaires de Nickolsburg, le 26 juillet, que confirmera la paix signée à Prague un mois plus tard, il est décidé de procéder à la dissolution de la Confédération germanique, ce qui revient à exclure complètement l’Autriche des affaires allemandes. Une Confédération de l’Allemagne du Nord est immédiatement constituée, dotée d’une armée et d’un budget communs, dont le roi de Prusse devient le président héréditaire. Enfin, la France reçoit de l’Autriche la Vénétie qu’elle rétrocède à l’Italie.
Louis Napoléon a donc obtenu du moins satisfaction sur un premier point. Les apparences sont encore sauves. Il est vrai qu’il est allé de lui-même au-delà des demandes initiales de Bismarck qui, pour relier entre elles les provinces prussiennes, souhaitait s’approprier les seuls territoires intermédiaires représentant quelque trois cent mille habitants. Or Bismarck s’en voir offrir dix fois plus avec l’annexion du Hanovre, du Hesse-Cassel, du Nassau et de Francfort.
Sans doute l’empereur espère-t-il que la bonne volonté dont il a fait preuve lui permettra de trouver pour la France quelques-unes des compensations sur lesquelles il croit se souvenir d’avoir obtenu à Biarritz, un accord de principe.
Ce sera pire que peine perdue. Non seulement Bismarck ne donnera rien mais, ne reculant devant aucune déloyauté, aucun coup bas, il va se servir de l’affaire pour placer la France en posture d’accusée sur la scène internationale et contribuer à son isolement. Il parviendra aussi à persuader l’opinion française que l’empereur et avec lui son pays ont subi une grave offense tout en sombrant dans le ridicule.
Une première demande fut promptement introduite par Drouyn de Lhuys : elle portait sur certains territoires de la Rive gauche du Rhin – donc des territoires allemands – et sur le Luxembourg dont on voulait, dans un premier temps, obtenir pour le moins la démilitarisation.
Bismarck refusa. Mieux, il fit publier son refus dans un journal français le Siècle – divulgation qui avait notamment pour but de montrer aux États allemands du sud combien un rapprochement était souhaitable avec la Prusse s’ils ne voulaient pas, un jour, se trouver sans protections face à de tels appétits. Drouyn de Lhuys paya de son poste ce qu’on affecta de considérer comme une gaffe. En fait, on avait été dupé. On décida pourtant de revenir à la charge.
Cette deuxième tentative paraissait poser moins de problèmes, car elle était conforme aux suggestions mêmes de Bismarck. Quand celui-ci avait refusé la première sollicitation française, il s’était ainsi exprimé devant Benedetti : Monsieur l’ambassadeur, ce serait la guerre entre nos deux pays. Je n’oserai même pas en parler au Roi… Il ne peut être question de vous céder une terre allemande ; mais regardez autour de vous les pays où l’on parle français ; il y a le Luxembourg ; il y a la Belgique.
Tout semblait donc indiquer non seulement qu’on avait obtenu le feu vert dans cette double direction mais que, de surcroît, Bismarck avait implicitement sinon formellement confirmé son engagement sur les compensations. Il est vrai que l’on n’était pas informé de ce que disait le ministre prussien, à peu près au même moment, à un général italien, de passage à Berlin : Louis veut un pourboire !
Pourboire ! L’intention méprisante est évidente. Mais n’y a-t-il pas lieu de noter qu’un pourboire, en bonne sémantique, désigne une gratification facultative ?
En tous cas, lorsque Bismarck reçoit à nouveau Benedetti venu lui demander le concours de ses armées au cas où l’empereur des Français serait amené par les circonstances à conquérir la Belgique, il lui demande de rédiger de sa propre main une copie de la communication pour la montrer au roi. Il met cette copie dans sa poche et l’y conserve jusqu’au jour… de juillet 1870, où il pourra démontrer pièce à l’appui – en la faisant publier dans le Times – que Louis Napoléon lui avait alors proposé un pacte déloyal.
Troisième et ultime demande française : le Luxembourg, dont l’acquisition devait être pour le moins tentée. Mais on n’obtient rien d’autre que l’évacuation du pays par les troupes prussiennes, qui s’y trouvaient d’ailleurs sans titre puisqu’elles s’étaient installées là au nom de la Confédération germanique, désormais dissoute.
Le bilan n’est donc pas vraiment fameux. Quand vient le moment de le dresser dans un texte connu sous le nom de circulaire La Valette – le ministre qui assurait l’intérim de Drouyn, en attendant l’arrivée de Moustier, qui abandonnait l’ambassade de Constantinople -, Louis Napoléon s’efforce de présenter les choses de manière avantageuse. L’intérêt de ce texte réside dans le fait surtout que Louis Napoléon, peu dupe de ses propres assertions, y indique sa volonté de donner à la France le moyen d’affronter la nouvelle donne. En même temps qu’une manière de démenti au reste de son propos, c’est la preuve qu’il a parfaitement compris les dangers qu’on voit désormais poindre à l’horizon.
Il commence pourtant par rappeler que la situation antérieure n’était guère plus brillante, insistant sur la puissance de l’ex-Confédération germanique, qui comprenait, avec la Prusse et l’Autriche, quatre-vingts millions d’habitants, s’étendant depuis le Luxembourg jusqu’à Trieste, depuis la Baltique jusqu’à Trente, nous entourait d’une ceinture de fer et nous enchaînait par les plus habiles combinaisons territoriales.
Il relève certains éléments de satisfaction : La coalition des trois coins du Nord est brisée. Le principe nouveau qui régit l’Europe est la liberté des alliances. Toutes les grandes puissances sont rendues les unes aux autres à la plénitude de leur indépendance, au développement régulier de leurs destinées…
Il fait valoir que la situation nouvelle résulte de la force des choses : Une puissance irrésistible, faut-il le regretter ? pousse les peuples à se réunir en grandes agglomérations en faisant disparaître les États secondaires.
Toutefois, concède-t-il, il y a dans les émotions qui se sont emparées du pays, un sentiment légitime qu’il faut reconnaître et préciser. Les résultats de la dernière guerre contiennent un enseignement grave et qui n’a rien coûté à l’honneur de nos armes : ils nous indiquent la nécessité, pour la défense de notre territoire, de perfectionner sans délai notre organisation militaire.
Si dur que soit pour lui le choc de Sadowa, Louis Napoléon a le mérite de ne pas rester indéfiniment prostré. Il est conscient des dangers que court désormais la France et de ce que pourrait être la suite des événements. Dès lors, sa religion est faite : il faut, et au plus vite, donner au pays les moyens de sortir victorieux d’un conflit avec la Prusse ou, mieux encore, prévenir l’affrontement par la démonstration d’une puissance militaire nouvelle susceptible de dissuader les évidentes velléités bellicistes d’un voisin devenu encombrant et redoutable.
Il y a longtemps, d’ailleurs, que Louis Napoléon s’était convaincu de la nécessité de procéder à une totale réorganisation de l’armée française. En Italie, il avait été effaré par l’état de désordre qu’il avait pu constater lui-même. Depuis lors, les choses ne s’étaient guère améliorées. Toutes les bonnes résolutions prises sur l’instant avaient été oubliées. Pourtant, n’est-ce pas Louis Napoléon qui, s’adressant aux généraux de l’armée d’Italie le 14 août 1859, leur avait dit : Que le souvenir des obstacles surmontés, des périls évités, revienne souvent à votre mémoire car, pour tout homme de guerre, le souvenir est la science même.
Pour ne rien arranger, la guerre du Mexique vient de vider nos arsenaux ; elle a compromis le moral de la troupe ; et quand il a été question de mobiliser sur le Rhin, on s’est vite aperçu que cela n’irait pas de soi. Surtout, la rapidité de la victoire prussienne a démontré chez l’adversaire une force qu’on ne lui soupçonnait pas.
Jusqu’ici, Louis Napoléon s’était contenté de quelques replâtrages. Il est vrai, que l’opinion, la classe politique, les généraux eux-mêmes restaient persuadés que notre armée était la meilleure d’Europe. Du coup, on avait renoncé à exiger davantage d’un Corps législatif qui trouvait qu’on en faisait déjà bien assez. Louis Napoléon s’était contenté d’imposer les chassepots, de faire adopter le canon à tube rayé et de mettre à l’étude un projet de mitrailleuse.
Pour modestes qu’ils fussent, ces efforts n’étaient pas sans mérite car nul en dehors de lui n’en reconnaissait vraiment la nécessité. En témoigne l’étonnement de Victor Duruy, lorsqu’il entend l’un de nos maréchaux se moquer des canons allemands qui se chargent par la culasse : On ne tire que trop de coups de canon […] Ce sont des mouvements d’horlogerie qui se détraquent.
À présent Louis Napoléon sait que la situation appelle des réformes autrement radicales, et que c’est probablement une question de vie ou de mort.
Déjà, lors de sa captivité au fort de Ham, il s’était prononcé pour un service militaire personnel et universel à court terme, avec une forte armée de réserve, c’est-à-dire pour une transposition du système prussien qui, du fait de notre avantage démographique, nous aurait assuré une supériorité permanente. Il n’a pas changé d’avis : la seule solution, pense-t-il est d’en venir à la nation armée, le nombre ayant désormais une importance décisive à la guerre. Pour cet homme acquis à l’idée que la différence entre les nations se situe sur le terrain économique, il n’est peut-être pas si facile d’expliquer alors à tous que l’influence d’une nation se mesure au nombre d’hommes qu’elle peut mettre sous les armes.
Notre situation n’est guère favorable. La Prusse, pays de vingt-deux millions d’habitants, a réussi, en 1866 à mettre sept cent mille hommes sur le pied de guerre. La même année, la France, pays de trente-six millions d’habitants, ne dispose que d’une armée active de trois cent quatre-vingt-cinq mille hommes, dont cent mille en Algérie, au Mexique ou à Rome.
C’est dire qu’il faudrait revoir le système de fond en comble. Est toujours en vigueur la loi de 1832 sur le recrutement, loi injuste et dépassée, qui fait du service militaire une sorte de loterie. Chaque année, le Corps législatif fixe les chiffres du contingent – cent mille, en règle générale, cent quarante mille en cas de conflit – après quoi les Français de vingt ans sont conviés à tirer au sort. Les mauvais numéros sont enrôlés pour sept ans, les bons sont libérés de toute obligation. Le remplacement à prix d’argent est autorisé, Louis Napoléon ayant été l’un des premiers à dénoncer cette traite des blancs, le droit pour un riche d’envoyer un homme du peuple se faire tuer à sa place. Combien de Français ne comptent-ils pas parmi leurs aïeux un grand-père ou un arrière-grand-père qui donna son sang parce qu’il n’avait pas tiré le bon numéro ?
Pourtant tout le monde, ou presque, est satisfait du système. En juillet 1866, Louis Napoléon se heurte ainsi au maréchal Randon, qui estime que tout va pour le mieux. Ce n’est pas l’opinion de l’empereur. Dès son retour de Vichy, en août, il a réuni autour de lui un groupe de travail comprenant le maréchal Niel, ouvert aux idées de réforme, les généraux Lebrun et Castelnau, ainsi que le fidèle et inévitable Fleury. Leurs premières réflexions débouchent sur la constitution d’une haute commission de réforme de l’armée, commission de vingt-trois membres où figurent tous les grands noms de l’armée, le prince Napoléon Jérôme, Rouher, Fould et quelques représentants du Conseil d’État. Présidée par l’empereur en personne, la commission se réunira régulièrement du 30 octobre au 12 décembre.
Louis Napoléon ne cache à personne l’objectif à atteindre : on doit en venir au service universel, et donc astreindre au service toutes les classes des conscrits. Il faut en outre, à côté de l’armée active, constituer une garde mobile de quelques quatre cent mille hommes.
Le projet qui sera arrêté au terme des travaux de la commission est déjà en recul par rapport aux intentions de l’empereur. On retient le principe d’une armée de huit cent quatre-vingt-quatre mille hommes : tout le contingent – cent soixante mille hommes – serait incorporé, soit pour six ans dans l’active, soit pour quelques mois dans la réserve, en fonction des résultats du tirage au sort ; une garde nationale mobile serait instituée où les jeunes – qu’ils viennent de l’active, de la réserve ou qu’ils soient exonérés – devraient servir pendant trois ans ; chaque année auraient lieu un ou deux appels de huit jours pour la garde mobile. Le système de remplacement serait maintenu, mais les remplacés seraient affectés à la garde mobile.
Le 20 janvier 1867, Niel, qui incarne la nouvelle politique, succède à Randon. Niel a six ans de plus que Louis Napoléon. Sorti de Polytechnique dans le génie, il s’est illustré à Constantine. Il a fortifié Paris en 1841 et 1842. En 1849, il a été blessé devant Rome. Nommé général, on l’a chargé d’une mission délicate auprès de Pie IX, mission qui ne fut pas étrangère au revirement du pape dont un motu proprio annonça alors quelques concessions aux idée libérales. Il était à Sébastopol et à Solférino, où son corps d’armée reçut tous les coups. C’est pour ces exploits que Louis Napoléon lui a donné son bâton de maréchal.
Les choses ne semblent donc pas trop mal parties. Mais voilà que s’élève contre le projet un formidable tir de barrage. Dans les milieux les plus divers, l’opposition à la réforme prend d’énormes proportions.
Pour le comprendre, il faut se souvenir d’abord que l’antimilitarisme est, à l’époque, fort répandu : des hommes aussi différents que Littré, Michel Chevalier … ou Déroulède ne croient pas à l’utilité de l’armée.
La France, qui est devenue riche, semble ne se soucier que de ses intérêts matériels. Les industriels craignent la raréfaction de la main d’œuvre résultant d’une nouvelle méthode de conscription. Les financiers appréhendent le coût du programme et les impôts nouveaux que sa mise en œuvre rendrait nécessaires. Paul Guériot nous éclaire sur la mentalité de l’heure en rapportant que lors des élections de 1869, sur plus de sept cents candidats, vingt deux seulement eurent le courage de leur profession de foi de ne pas faire allusion à une réduction possible des effectifs.
Certes, la vue des uniformes, bonnets à poil, colbacks, chapkas emplumées, buffleteries éclatantes, brandebourgs d’or et d’argent, sabretaches, fourragères [3], tout cela déclenche encore les sentiments cocardiers des Français, mais ne les conduit pas pour autant à soutenir le projet de l’empereur. Au contraire, il semble n’y avoir pour eux aucune raison de modifier le statu quo.
Les militaires ne sont pas les derniers à refuser les changements. Trochu s’exclame : Une telle armée serait nationale, c’est ce qu’il ne faut pas. Rando renchérit : Cette proposition ne nous donnera que des recrues. Ce sont des soldats qu’il nous faut. Changarnier, lui aussi, exprime son opposition. Selon le Prince de Joinville, le nouveau mode de recrutement écrasait outre mesure la race qui donne, hélas, quelques signes d’épuisement, et […] tuait la poule aux œufs d’or.
Quant aux Républicains, ils avaient transposé au domaine extérieur l’inepte théorie de l’invisible sentinelle, qui leur avait valu de si brillants résultats à l’intérieur : en cas de danger, assuraient-ils, on pourrait compter sur la levée en masse et l’esprit de patriotisme.
Dans l’entourage de l’empereur, l’hostilité au projet avait gagné certains proches qui estimaient, comme tout le monde, que la France n’était pas la Prusse et qu’elle n’accepterait jamais un système militariste. Son vieil ami Émile de Girardin affirmait que toucher à la loi française pour la prussifier, ce serait ameuter 600 000 familles, 4 200 000 personnes ! Émile Ollivier, dont le rapprochement devenait pourtant de plus en plus certain, laissait tomber : De ce projet, les ennemis de l’Empire se réjouissent, ses amis sont consternés.
Il fut vite clair que le corps législatif n’accepterait pas le texte. Des pétitions circulaient, maires et députés subissaient de fortes pressions. La perspective des prochaines élections se trouvait là pour incliner les plus fidèles au refus. À gauche, on était ravi de recevoir des mains de l’adversaire une telle arme de combat. De l’autre côté on redoutait les réactions du monde paysan à l’idée même de la conscription. 1869, c’était demain.
Vouloir se conformer, avant tout, aux sentiments réels ou supposés des citoyens : comportement aussi vieux que la démocratie mais qui, sous prétexte de la défendre, aboutit à la dévoyer. N’existe-t-il pas des circonstances ou l’homme public a le devoir de précéder l’opinion ? Si c’est dans l’intérêt national, l’opinion ne retiendra que provisoirement contre lui ce décalage momentané. À l’inverse, s’il la suit et que les choses tournent mal, elle sera la première à lui faire reproche de ne pas avoir osé lui montrer le chemin. Mais à l’époque, qui ose oser ?
Louis Napoléon, lui, mesure toute l’importance de l’enjeu ; il est décidé à aller jusqu’au bout.
À Ollivier qui lui a fait part de ses préventions, il rétorque : Je sais que ce projet est impopulaire. Il faut savoir braver l’impopularité pour emplir son devoir.
Pourtant, l’empereur accepte un geste de conciliation. Il laisse retoucher le projet avant même son dépôt : le service sera ramené de six ans à cinq ans dans l’armée active… Mais rien n’y fait. Le Corps législatif nomme une commission hostile au texte. Dans le pays, la contestation ne fait que croître : à deux élections partielles, des candidats favorables à la réforme sont battus. Pis, le rapporteur du budget est lui-même battu au conseil général.
Et la discussion s’éternise…
Pitoyable débat ! Piteuse discussion au cours de laquelle on voir les représentants que la France s’est donnée préparer par aveuglement son malheur. Le Corps législatif a bien mérité en ces jours-là la reconnaissance de Bismarck. Tous les Français devraient garder en mémoire le honteux florilège des déclarations de ceux qui ont alors inconsciemment décidé d’envoyer notre armée à la boucherie et de livrer aux Prussiens l’Alsace et la Moselle.
 tout seigneur tout honneur, écoutons d’abord celui dont tant de lycées, tant d’artères portent encore le nom, celui dont on fera le libérateur du territoire : l’ineffable Monsieur Thiers. Celui-ci, tout en affectant de soutenir le projet revu et corrigé, prétend que l’armée prussienne est beaucoup moins nombreuse qu’on le dit : On vous présente des chiffres de douze cents, de treize cent mille hommes comme étant ceux que les différentes puissances de l’Europe pouvaient mettre sur pied. Quand on vous les a cités, ils vous font une impression fort vive. Eh bien ! ces chiffres-là sont parfaitement chimériques. Je le dis parce qu’il faut rassurer notre pays. Il ne faut pas que les paroles qui sont prononcées ici le persuadent qu’il court des périls effroyables.
Donc, qu’on se rassure, notre Armée suffira pour arrêter l’ennemi.
Écoutons Jules Simon : Pour moi, je ne crois pas la guerre prochaine car la Prusse n’a pas d’intérêt à faire la guerre à la France. D’ailleurs, précise-t-il, je ne suis pas partisan des armées permanentes […] Nous vous demandons sans ambages de supprimer l’armée permanente et d’armer la Nation…
Écoutons cet autre futur héros de ls république renaissante, Jules Favre : Je repousse la loi pour qu’il soit dit en Europe que la Chambre ne se contente pas de vœux stériles pour la paix, mais que quand on lui met dans la main un bulletin de vote, elle sait en user et que ce n’est pas seulement un vœu mais un acte qu’elle entend accomplir.
Et encore : On vous dit qu’il faut que la France soit armée comme ses voisins ; que la sécurité est attachée à ce qu’elle soit embastionnée, cuirassée, qu’elle ait dans ses magasins des monceaux de poudre et de mitraille… Ma conscience proteste contre des semblables propositions… Je suis convaincu que la Nation la plus puissante est celle qui serait le plus près du désarmement.
Écoutons Joseph Magnin : Je repousse la loi parce qu’elle est une surcharge imposée à la population.
Et encore : Les armées permanentes sont en théorie jugées et condamnées. Je crois que dans un avenir prochain, elles disparaîtront.
Écoutons Ernest Picard : Par quelle aberration le Gouvernement peut-il songer à chercher les forces de la France dans l’exagération du nombre d’hommes ? […] Je vous conjure, dans l’intérêt de la France, de repousser ce projet de loi.
Écoutons Garnier-Pagès : Le militarisme est la plaie de l’époque ! Qu’est-ce que la force matérielle ? … Le budget de la guerre nous mène à la banqueroute. C’est la plaie, c’est le chancre qui nous dévore !
Écoutons Eugène Pelletan : Pas d’armée prétorienne ! Ou encore : Une invasion est-elle possible ? On s’indignerait si je formulais une prévision semblable, et on aurait raison.
Écoutons Émile Ollivier : Les armées de la France, que j’ai toujours trouvé trop nombreuses, vont être portées à un chiffre exorbitant. Mais pourquoi donc ? Où est la nécessité ? Où est le péril ? Qui nous menace ? … Que la France désarme et les Allemands sauront bien convaincre leurs Gouvernements à l’imiter.
Écoutons encore Jules Favre qui admoneste Niel : Vous voulez donc, s’écrie-t-il, faire de la France une caserne ! Et la réponse du ministre prend une pathétique résonance, quand on connaît la suite : Prenez garde d’en faire un cimetière !
Rouher lui-même n’est pas en l’occurrence d’un grand secours. Il ne manifeste aucune faveur pour une réforme dont il perçoit surtout les inconvénients politiques immédiats, et cache à peine ses réticences devant le Corps législatif, lors de la session d’automne 1867.
Le ministre d’État est d’autant plus écouté qu’il vient de parler sobrement et de façon apparemment sincère de l’affaire mexicaine, évoquant la faillibilité humaine qui rend périssables les plus étudiées des combinaisons conçues par l’homme. Alors on le croit quand il assure que l’expédition au Mexique n’a pas affaibli l’armée, que la France reste l’arbitre de l’Europe, que l’Allemagne n’est que la juxtaposition de la Prusse, de l’Autriche et d’États secondaires, et donc qu’il n’y a rien à craindre.
Comment, dès lors, chacun ne penserait-il pas que l’empereur doit se tromper, que son état de santé lui obscurcit le jugement et le rend exagérément pessimiste ?
Louis Napoléon sait, sent cela. Il souhaite en finir, quitte à devoir recourir à des moyens extrêmes. Décidé à briser la résistance qu’on lui oppose, il veut qu’on se batte sur la totalité du projet. Mais déjà Niel faiblit : Rouher l’a convaincu qu’il faudrait aller à la dissolution, après laquelle on risque de se retrouver avec un Corps législatif encore plus hostile et mal intentionné : Une dissolution, explique-t-il, serait funeste au système de gouvernement, le pays touché dans un de ses intérêts vitaux prendrait feu ; l’opposition compacte, disciplinée, derrière un mot de ralliement si simple, enlèverait le corps électoral.
L’argument est imparable. Alors, Louis Napoléon cède. Il pense à la dissolution mais il doit bien se rendre à l’évidence : il n’a pas, il n’a plus les moyens politiques d’atteindre son objectif. Sa tristesse et sa déception dépassent toute limite. La conscience du drame qui approche l’accable et le déchire.
C’est à l’occasion de son discours du trône de novembre 1867 que l’empereur met les pouces : il y annonce l’abandon du projet initial : Mon gouvernement, déclare-t-il aux députés vous proposera des dispositions nouvelles qui ne sont que de simples modifications à la Loi de 1832, mais qui atteignent le but que j’ai toujours suivi : réduire le Service pendant la paix et l’augmenter pendant la guerre.
Cette loi, qui sera votée le 14 janvier 1868 est effectivement une simple mise à jour du texte de 1832, dont elle conserve le système des bons numéros : le contingent restera à la discrétion du Corp législatif. Seule innovation qui subsiste, au moins sur le papier, la garde mobile ; mais celle-ci est complètement dénaturée : ses appels ne pourront excéder une journée ; ce sera une armée fantôme, sans instruction, sans encadrement, sans équipement.
Pour comble de malheur, Niel va bientôt mourir sans avoir pu entreprendre la mise en œuvre de la loi. Leboeuf qui lui succède négligera de l’appliquer. Il est vrai que les moyens budgétaires adéquats ne lui seront jamais consentis.
Ce qu’il y a de plus grave, c’est qu’au terme d’une logue année de débats, le pays est encore plus convaincu qu’auparavant de l’invincibilité de son armée.
Le véritable auteur de la guerre, a dit Montesquieu, n’est pas celui qui la déclare, mais celui qui la rend nécessaire.
La guerre de 1870 n’était pas inévitable. Louis Napoléon – même s’il était seul à voir clair – était trop conscient de l’infériorité relative de nos armes pour avoir pu la souhaiter un seul instant.
En juillet de l’année fatale, la Princesse de Metternich, qui relève de couches, a reçu la visite du couple impérial. Elle en a retiré la conviction que l’Empereur et l’Impératrice sont effondrés à l’idée d’une guerre. De fait, il n’y a pas lieu d’accorder une once de crédit à l’analyse de ceux qui prétendent que Louis Napoléon cherchait dans une victoire militaire le moyen de raffermir un empire ébranlé. Paris ne cessait de manifester sa mauvaise humeur à l’égard du régime. Mais l’opposition dans la capitale pouvait-elle faire oublier les résultats du plébiscite, et la conclusion qu’en tirait Gambetta : L’Empereur est plus fort que jamais ?
En revanche c’est un fait établi que Bismarck voulait cette guerre, l’estimant nécessaire pour accélérer et rendre irréversible l’union de l’Allemagne. Il est possible qu’il fût le seul à la vouloir. Il était l’un des seuls à pouvoir la déclencher. Cela a suffi.
Jocelyn-Émile Ollivier nous le rapporte : Quand, après la mort de Guillaume I° et de Frédéric III, l’étoile de Bismarck commença à pâlir, il s’efforça de démontrer au peuple allemand que c’était à lui seul et non à son souverain que devait être attribuée la gloire d’avoir déchaîné le conflit qui s’était terminé par la proclamation de l’unité allemande.
Bismarck dans ses Mémoires, a lui-même explicitement reconnu qu’il portait la pleine responsabilité du conflit : J’ai toujours considéré qu’une guerre contre la France suivrait fatalement une guerre contre l’Autriche… J’étais convaincu que l’abîme creusé au cours de l’histoire entre le Nord et le Sud de la patrie ne pouvait pas être plus heureusement comblé que par une guerre franco-allemande avant que l’organisation générale de l’Allemagne eût pu être réalisée.
Après Sadowa, la querelle sur les compensations a gravement détérioré les relations franco-prussiennes. Bismarck le sait. Il l’a voulu et s’en est réjoui. Ses efforts pour préparer patiemment, méticuleusement, la guerre, n’ont pas été vains. Mais on n’avait rien vu encore. Â partir de 1868, dès le moment où le chancelier estime son pays prêt pour la grande explication finale, il ne rate désormais aucune occasion de friction : de l’affaire du Luxembourg à celle des chemins de fer belges, tout lui est bon pour défier la France, son opinion publique et provoquer son gouvernement. Un nouveau prétexte va lui être offert avec le problème que crée la vacance du trône d’Espagne.
 tort ou à raison, la France considérait l’Espagne comme une sorte de chasse gardée : ses intérêts économiques y étaient dominants depuis le financement par des capitaux français de la construction du chemin de fer espagnol et Louis Napoléon s’intéressait de très prêt à la situation de la péninsule : il lui arrivait de rêver – bizarrement- à une union ibérique rassemblant Espagnols et Portugais.
C’est dire que la France ne pouvait raisonnablement se désintéresser des conditions de dévolution de la couronne d’Espagne. Déjà, pour des raisons évidentes, elle avait fait écarter la candidature d’un membre de la famille d’Orléans et tenté, sans succès, d’imposer un prince portugais.
Lorsque, sur les représentations de l’ambassadeur de France, Bismarck acquiert la certitude que Paris considérera comme absolument inacceptable la candidature d’un prince allemand, il comprend qu’il détient là un casus belli idéal et pousse de tout son poids en ce sens. Pour Paris, en effet, une telle solution est à tous égards intolérable : la France ne pourrait exercer aucune influence sur le nouveau roi, et se sentirait comme encerclée par les Allemands.
Henri Bergson, dans le discours de réception que nous avons déjà cité, note lucidement : Il est hors de doute que la candidature de Léopold de Hohenzollern fût suscitée par Bismarck en vue d’amener un conflit entre l’Allemagne et la France.
De fait, quand la nouvelle de cette candidature parvient en France, le 3 juillet 1870, elle produit l’effet d’une bombe.
 Paris, on est d’autant plus choqué par ce qu’on considère comme une véritable félonie que depuis son arrivée au pouvoir, le 2 janvier, Émile Ollivier peut croire avoir fait de son mieux, face à une opinion publique réticente pour améliorer les relations franco-prussiennes et diminuer les tensions. On est d’ailleurs d’autant plus surpris que le 30 juin encore, comme nous le rapporte Jocelyn Émile Ollivier, Thiers, qui aimait tant à jouer au prophète, affirmait que l’Allemagne ne cherchait pas à troubler le monde et qu’elle avait à sa tête un homme supérieur partisan de la paix .
Dès le lendemain de l’annonce de la candidature, Ollivier dépêche notre ambassadeur à Ems, où se trouve le roi de Prusse, pour lui faire connaître la réaction de la France. Le gouvernement prussien, prétend alors tout ignorer de l’affaire ; la reine d’Angleterre paraît contrariée, sans plus. Quant au Conseil des ministres espagnols, il fixe au 20 juillet – comme si de rien n’était – la date de l’élection de Léopold de Hohenzollern par les Cortès.
Dans le contexte d’alors, où l’excitation et l’exaspération générales n’épargnent ni les parlementaires ni la presse, Louis Napoléon s’efforce de garder la tête froide et cherche les voies de la conciliation. Non qu’il soit moins indigné que les autres ; mais il sait les risques que court le pays et il a parfaitement lu dans le jeu de Bismarck. Recevant l’ambassadeur d’Espagne, il s’en ouvre à lui très clairement : Comment pouvez-vous imaginer que Monsieur de comte de Bismarck qui a organisé tout cela de longue main pour nous provoquer, laisserait passer l’occasion ?
Gramont, le ministre des Affaires étrangères, n’a probablement pas l’accord de l’empereur lorsqu’il fait devant le corp législatif cette déclaration martiale. Nous comptons à la fois sur la sagesse du peuple allemand et l’amitié du peuple espagnol. S’il en était autrement, forts de votre appui et de celui de la Nation, nous saurions remplir notre devoir sans hésitation et sans faiblesse.
En tous cas, ce qui est dit a bien passé. Même Gambetta a applaudi. La France paraît résolue, et l’on va en tenir compte.
Guillaume I° n’a pas les mêmes raisons que Bismarck de vouloir à tout prix un conflit avec la France. Il demande donc discrètement au père de Léopold, son cousin, de retirer la candidature de son fils au trône d’Espagne. Ce que fait ledit cousin.
Guizot de s’exclamer alors : c’est la plus belle victoire diplomatique que j’ai jamais vu de ma vie. De fait, tout l’échafaudage du chancelier s’écroule. Bismarck a d’ailleurs prétendu qu’il aurait eu alors la tentation de démissionner. Pour le malheur général, il ne le fit pas. Mais tout paraissait devenir plus serein.
Pourtant l’opinion française et une partie de la Chambre ne considèrent pas comme suffisante l’annonce du retrait. Ce n’est pas Leopold mais son père qui s’est exprimé. Le gouvernement prussien, qu’on soupçonne d’être l’instigateur de toute l’affaire n’a pris aucun engagement officiel. Il faut l’obliger à se prononcer.
Le 12 juillet, en l’absence d’Ollivier, et sans que Louis Napoléon s’y soit opposé, un conseil restreint, tenu à Saint-Cloud, décide d’adresser au roi de Prusse un télégramme lui demandant des garanties pour l’avenir. Grammont avait expliqué tout uniment qu’une telle demande ne manquerait pas de fortifier le gouvernement devant l’opinion et devant les Chambres.
Cette initiative a souvent été considérée comme une grave faute. Il ne faut pas oublier d’abord, comme l’a noté l’ambassadeur britannique, lord Lyons, que dans cette affaire, le Gouvernement Français n’était pas à la tête de l’opinion, mais la suivait. Ensuite et surtout, que la guerre ne résulta pas de la réponse même de Guillaume I° mais de la présentation tronquée qu’en fit Bismarck.
Il est clair que si cette occasion n’avait pas déclenché le conflit, le chancelier en aurait créé une autre, puis une autre encore, aussi longtemps qu’il ne serait pas parvenu à ses fins.
De son côté, Émile Ollivier, qui n’assistait pas au conseil restreint de Saint-Cloud, est consterné. Lui aussi pense à démissionner ; son désarroi est sincère, mais il pèse le pour et le contre et ne veut pas desservir la France. Comme nous l’explique Bergson : Désavouer l’acte de l’Empereur, c’était, au cas où la guerre éclaterait, avoir déclaré, avoir déclaré solennellement, devant l’Europe et devant l’Histoire que l’Empire était agresseur et que la France était dans son tort. C’était aussi laisser la place libre à un ministère de Droite, qui attendait dans la coulisse, et qui eut été un ministère de guerre. En restant, on pouvait essayer de réparer le mal. Par le fait, Ollivier le répara dans la mesure du possible, puisqu’il obtenait du Conseil des Ministres, quelques heures après, la décision ferme de ne pas maintenir la demande d’un engagement pour l’avenir si l’on se heurtait à un refus du Roi de Prusse.
Rien d’irrémédiable n’était encore accompli. Guillaume I° est visiblement agacé par la demande qui lui est transmise. Pour autant sa réponse est rien moins que belliqueuse. Dans le résumé de sa journée qu’il transmet à Berlin le 13, il fait savoir qu’il a appris le désistement et qu’il l’a approuvé.
Quand il lit ce texte, Bismarck est atterré. Alors, cyniquement, il en rédige une nouvelle version, tronquée, qui va sonner le glas des espoirs d’apaisement : Après que les nouvelles de la renonciation du Prince héritier de Hohenzollern eurent été communiquées au Gouvernement impérial français par le gouvernement royal espagnol, l’ambassadeur français à Ems a exigé encore de sa majesté l’autorisation de télégraphier à Paris que sa majesté le roi pour tout l’avenir s’engageait à ne plus jamais donner son autorisation si les Hohenzollern devaient poser de nouveau leur candidature. Là-dessus, sa majesté le roi a refusé de recevoir encore une fois l’ambassadeur et lui a fait dire par l’adjudant de service que sa majesté n’avait plus rien à communiquer à l’ambassadeur.
Transformée en provocation par la volonté de Bismarck, la dépêche d’Ems, largement diffusée par ses soins, eut l’effet escompté sur l’opinion française. À Paris, dans la journée du 13, la foule est dans la rue, s’excite contre la Prusse et réclame la guerre.
Le gouvernement est chahuté. Gramont déclare à Louis Napoléon et à ses collègues que le ministère ne pourrait pas se maintenir s’il se présentait à la Chambre, le lendemain, sans avoir reçu une concession précise de la Prusse.
Tout se passe comme Bismarck l’a espéré et voulu. Sa dépêche a fait l’effet d’un camouflet. Le 14, l’empereur parle encore en conseil d’un congrès général, qui aurait à évoquer la question des garanties. Ollivier s’accroche à cette idée. Un texte est rédigé. Louis Napoléon, le soir, voit s’attrouper les Parisiens et les entend crier : À Berlin !
Le 15, au cours d’un nouveau conseil, Ollivier reconnaît à son tour :Si nous portions notre déclaration à la Chambre, on jetterait de la boue sur nos voitures et on nous huerait. À peu près au même moment, les Parisiens lancent des pierres dans les vitres anciennes de l’ambassade de Prusse.
Le sort en est jeté ; dans la nuit du 15 au 16, Thiers fait voter, par 245 voix contre 10, les premiers crédits pour la mobilisation de la garde mobile et pour la guerre. Nous avons fait, déclare-t-il, tout ce qu’il était honorablement et humainement possible de faire pour éviter la guerre… Notre cause est juste… Elle est confiée à l’armée française.
Pourtant, la situation diplomatique n’est pas favorable, loin de là. Bismarck a joué assez habilement pour que la France fasse figure… d’agresseur. L’Allemagne du Sud, en dépit de nos espoirs, choisit le camp de la Prusse, et la Bavière s’apprête à mobiliser. Il n’y a rien à attendre, du moins dans l’immédiat, de l’Autriche où joue contre la France l’influence hongroise dans la double monarchie, conséquence indirecte de la défaite de Sadowa dont l’établissement autrichien est tenu pour responsable. Rien à attendre non plus de l’Italie, avec laquelle Rome reste une pomme de discorde – l’évacuation, le 19 août, de la ville éternelle, intervenant beaucoup trop tard.
Ollivier, exténué, a pourtant la tragique imprudence que cette guerre, il l’accepte d’un cœur léger. Ce n’est pas ce qu’il a vraiment dit. C’est ce qu’on a retenu.
Louis Napoléon, lui, n’a pas le cœur léger. Bientôt, sur le chemin de la Lorraine, et de la guerre – dont la déclaration est notifiée le 18 à Berlin -, il sera salué, de gare en gare, par des foules qui crient : Vive l’Empereur ! Vive le prince impérial : Vive la France !
Sans doute éprouve-t-il des sentiments analogues à ceux que, soixante-huit ans plus tard, au retour de la désastreuse conférence de Munich et face à la même allégresse, traduira Édouard Daladier dans une formule aussi lapidaire que triviale. L’empereur montrera plus de tenue : L’enthousiasme ; écrit-il à Gramont, est une belle chose, mais parfois bien ridicule.
Cette guerre est probablement perdue, avant même d’avoir commencé. De Gaulle expliquera pourquoi, allant comme d’habitude, en traits fulgurants, droit à l’essentiel : La mobilisation, ordonnée le 14 juillet, a porté le 5 août à la frontière 250 000 hommes ; 60 000 sont dans les dépôts ou en Algérie, ou à Rome. Et nous n’avons rien d’autre qui puisse, de plusieurs mois, offrir quelque solidité. Encore ces forces sont-elles organisées, armées, transportées au milieu du pire désordre, car les grandes unités n’existent pas en temps de paix, il faut les constituer de toutes pièces à la frontière, leur désigner des états-majors, faire sortir des arsenaux leur canons, leurs caissons, leurs parcs, les doter à l’improviste de services et de matériels. Pendant ce temps, l’ennemi amène aux premiers chocs 500 000 hommes, organisés à l’avance en corps d’armée et divisions, garnit ses dépôts de 160 000 soldats et lève une solide landwehr de 200 000 hommes.
Les effets conjugués de l’imprévoyance, des autosatisfactions et des lâchetés qui ont empêché la réorganisation de l’armée française apparaissent très vite, dans toute leur dimension, même si certains mettront quelques temps à s’incliner devant l’évidence.
Gramont n’a-t-il pas expliqué qu’il s’était décidé à la guerre avec une confiance absolue dans la victoire ?
Thiers lui-même, Thiers qui, après la défaite soutiendra devant la commission d’enquête qu’il savait que la France n’était pas prête, est en réalité convaincu du contraire : tous ses propos de l’époque en apportent la démonstration.
Il n’est pas jusqu’à Niel qui, avant de mourir en août 1869 des suites de l’opération à laquelle l’a acculé le même mal que l’empereur, n’ait été persuadé de laisser à la France, malgré l’échec du projet de réforme, une armée apte à la protéger… Quelle erreur ! Et le nombre n’est pas seul en cause. Notre infanterie est probablement intrinsèquement meilleure que l’infanterie allemande ; elle fera d’ailleurs des prodiges. Mais, outre que la supériorité de l’artillerie ennemi compensait largement cette différence de valeur, la mobilité de l’armée allemande qui vit sur le pays et n’a pas à trainer d’encombrants convois, lui donne un grand avantage stratégique. Techniquement les Prussiens sont également en avance : ils disposent d’une cartographie supérieure en qualité et savent, eux, s’en servir. Enfin, leur armée, est toute entière tendue vers l’offensive. Elle a retenu la leçon de Clausewitz, et s’en tient à de simples et solides principes : mépriser la forme des manœuvres et les opérations subsidiaires : marcher droit, toutes forces réunies, jusqu’à la principale armée adverse pour obtenir au plus tôt un avantage décisif et poursuivre, vigoureusement cet avantage jusqu’à la victoire.
Comme si l’éclatante disproportion des moyens alignés par les deux pays ne suffisait pas, d’autres facteurs vont encore aggraver la situation et compromettre cette résistance minimale aux premiers chocs qui aurait permis, en stabilisant provisoirement les choses, d’en venir à une solution négociée ou d’espérer l’entrée en lice ultérieure d’alliés potentiels jusque-là attentistes.
On s’aperçoit vite que pouvoir civil et pouvoir militaire ne parviennent pas à délimiter leurs champs d’intervention respectifs : le comble de la confusion sera atteint à Sedan quand l’armée de Mac-Mahon, blessé, se retrouvera dotée… de deux commandants en chef : l’un désigné par le maréchal lui-même, l’autre nomme par le gouvernement. Entre le politique et le militaire, tout se mêle et s’entremêle aux détriments de l’un et de l’autre. Les décisions sont prises au hasard de l’évolution du champ de bataille et, pis encore, les considérations politiques l’emportent parfois sur les données stratégiques.
Le cas de Bazaine, qui va bientôt concentrer entre ses mains le commandement suprême – retiré à l’empereur – illustre bien cet état de choses. La façon dont il manœuvre est-elle vraiment le fait d’un chef militaire ? À le voir faire, ou plutôt, à le voir ne rien faire on a l’impression que, dans ces circonstances dramatiques, son principal objectif consiste non à combattre l’adversaire mais à préserver le capital que constitue à ses yeux les effectifs placés sous son autorité directe afin de pouvoir, le cas échéant, se trouver en bonne posture à la table des marchandages.
D’où vient que certains chefs militaires, de qualité assurément médiocre se montrent encore plus timorés qu’à l’ordinaire ? Est-ce une punition que la Providence inflige à Louis Napoléon pour avoir favorisé la promotion d’un certain nombre d’incapables ? N’a-t-il pas eu le tort d’écarter des hommes de valeur Certains le prétendent comme Joachim Ambert, qui fut général, député, écrivain, historien : Napoléon III devait périr par les généraux. Il y avait aussi dans son passé une terrible nuit, c’était celle où il fit arracher de leur lit les chefs les plus aimés de l’armée, les Cavaignac, les Changarnier, les Lamoricière et tant d’autres dont les noms sont inutiles à rappeler. Ces vaillants capitaines avaient bien mérité de la patrie, ils représentaient l’armée nationale, leurs noms se rattachaient à la conquête de l’Algérie, ils avaient vaincu l’émeute dans les rues, ils souffraient de leurs blessures et cependant, on les emprisonna sous un prétexte politique…
Leur arrestation fut le germe fatal qui conduisit Napoléon III à sa perte. Il ne put remplacer ces généraux frappés dans la force de l’âge, à l’heure où l’homme est dans toute sa puissance.
Pendant cette marche funèbre qui le conduisit de Châlons à Sedan, l’empereur Napoléon III reporta sans doute sa pensée sur cette nuit de décembre 1851 où il avait décapité l’armée. Il entendit des voix lointaines qui lui disaient : Varus, rends-moi mes légions !
Louis Napoléon est partie aux armées le 28 juillet. Discrètement. Il a pris le train à la petite gare de Saint-Cloud, dans une atmosphère dépourvue d’entrain. Il est vrai qu’il a lui-même prévu que ce serait long et difficile. L’accompagne son fils, à qui on a taillé un uniforme à la mesure de ses quatorze ans.
Ce départ est une erreur. Dans l’état de santé où il se trouve, Louis Napoléon ne sera jamais là-bas que d’une piètre utilité. Tout indique qu’il ne pourra longtemps exercer la réalité des fonctions de commandant en chef. Compte tenu des risques que le conflit fait courir au régime, sa présence à Paris, comme chef d’État, serait de beaucoup plus utile, au cas où tout tournerait mal, hypothèse qu’il n’a jamais écartée. Trop nombreux sont ceux qui pensent que Louis Napoléon a au moins en commun avec son oncle d’être condamné à la victoire pour survivre. Â quoi bon, dans ces conditions, renforcer cette impression en liant si explicitement son sort à celui de nos armes ? S’il n’avait pas quitté la capitale, Louis Napoléon aurait été moins personnellement impliqué dans nos revers éventuels et mieux placé pour prendre, sur le plan intérieur et extérieur, les mesures qu’auraient exigé les événements. Il aurait pu, par exemple, le moment venu, nommer un gouvernement d’union nationale capable de rassembler toutes les énergies. Alors que, dans l’éloignement où il se trouve, ses tentatives pour appeler tel ou tel resteront sans aucun effet.
Louis Napoléon a bien expliqué que la présence d’un chef magnétise ses troupes sur le terrain. En est-il si convaincu lui-même ?
Et tous cas, l’impératrice n’a rien tenté pour retenir son mari. De la même façon qu’elle s’opposera avec force à toutes ses velléités de retour. Ayant obtenu la régence, il est clair qu’elle veut donner à sa fonction sa pleine signification et en tirer tout le parti possible.
L’apparente indifférence d’Eugénie aux tortures physiques que subissait son mari a de quoi surprendre. À l’époque, elle n’est pas mieux informée que les autres de la nature du mal dont souffre l’empereur, lequel, lors de son exil à Chislehurst, confiera à l’urologue sir Henry Thompson ! Si j’avais su que j’étais atteint de la maladie de la pierre, jamais je n’aurais déclaré la guerre. On peut absoudre le manque de curiosité de l’impératrice, qui eût pu exiger de connaître les résultats de la consultation de ces sommités médicales qu’étaient les Nélaton, Ricard, Fauvel, Germain Sée et Corvisart, consultation qu’on mit sous pli scellée dans un tiroir de secrétaire ! Mais comment comprendre qu’Eugénie, témoin depuis des années de tant de souffrances et sachant l’empereur traité au chloral, ait pu la laisser partir vers le front ? Elle n’ignorait rien des souffrances de l’empereur, ayant souvent contribué à sauver la face dans maintes circonstances officielles. Car le martyre de Louis Napoléon est souvent difficile à dissimuler : dans les moments de crise, son visage s’altère, ses traits se tendent, il ne peut réprimer quelques gémissements.
Une explication est souvent avancée ; l’attitude d’Eugénie serait celle d’une femme qui a aimé et qui a été trompée. Pour elle, les douleurs que son mari endure dans le bas-ventre, et tout ce pus et ce sang, c’est le coup de pied de Vénus, c’est le passage de la justice immanente. Ne l’aurait-on pas entendu maugréer : Il n’a que ce qu’il mérite… c’est la vengeance de Dieu ?
Des sentiments de cette nature ne sont peut-être pas complètement absents de l’esprit d’Eugénie, mais ils n’ont rien d’essentiel. De même, il n’y a pas lieu de croire à la thèse, soutenue, par certains, de la concrétisation d’un vieux marché entre époux : le pouvoir contre la fidélité conjugale. Eugénie a voulu la régence, et pas seulement pour exercer un pâle intérim, prête qu’elle était à aller très au-delà des pouvoirs qui lui étaient reconnus et à violer la légalité. Son but est d’imprimer au régime certaines évolutions qui lui paraissaient nécessaires, en tenant compte, justement, de l’état où se trouve son mari.
L’a sûrement beaucoup frappée une confession de celui-ci qu’elle ne relatera que beaucoup plus tard, alors que, presque centenaire, silhouette noire, menue et digne, appuyée sur une canne à pommeau d’argent, elle égrenait de tristes souvenirs : il ne se croyait plus capable de supporter le fardeau si lourd du pouvoir suprême… Il avait pris et n’avait confié qu’à moi seul la résolution d’abdiquer, vers l’année 1874, lorsque le prince impérial serait en âge de monter sur le trône…
Quelles étaient donc les évolutions qu’Eugénie jugeait nécessaires ?
D’abord, et quoi qu’il arrive, donner un coup de barre à droite et contenir autant que faire se pouvait une libéralisation que – comme tant d’autres – elle attribuait à l’affaiblissement physique et moral de Louis Napoléon.
Ensuite, et surtout, s’adapter à une situation mouvante. L’empereur pouvait disparaître à tout moment, le risque étant d’autant plus grand qu’il affrontait l’ennemi en première ligne. Il fallait que la régence puisse alors tenir le pouvoir d’une main ferme, et de toute façon assurer en cas de défaite la continuité de l’État. Et si, d’aventure l’empereur parvenait à tirer son épingle du jeu, qui peut dire qu’Eugénie ne l’eut pas persuadé d’abdiquer pour raison de santé, prête à continuer de jouer un rôle de premier plan, en préparant l’accession au trône de son fils ?
Pour complexe qu’il soit, ce comportement n’a rien de condamnable et ce n’est pas comme on l’a dit, l’indice d’une volonté de puissance. Il y a tout lieu de croire qu’Eugénie n’avait pas d’autre objectif que d’assurer, dans l’intérêt supposé de la France, la pérennité de la dynastie.
Ainsi peut-on le mieux expliquer sa conduite au cours de cette période et le soin qu’elle apporte à magnifier le comportement militaire du prince impérial.
Le rôle qu’elle a imposé à Louis Napoléon, celui-ci va le payer de tortures sans nombre.
Arrivé à Metz le soir du 28, complètement épuisé, il constate aussitôt que tout va très mal : la mobilisation laisse beaucoup à désirer et les approvisionnements font défaut. Quelques jours plus tard, sa première impression confirmée il écrira : Tout n’est que désordre, incohérence, retards, dispute et confusion : l’armée est privée de tout, les magasins sont vides, et le chaos est devenu un spectacle coutumier.
Sur le terrain, les constatations d’un jeune officier rejoignent, en les illustrant, celles de l’empereur. Il s’agit du commandant Vidal qui, le 17 août, trois jours après son arrivée au camp de Châlons, placé à la tête de quatre compagnies au lieu des six annoncées, prévient son père : Nous sommes foutus ! Les paroles m’étaient dictées écrit-il, par la froide appréciation de tout ce que je voyais : absence de commandement ; allée et venues incessantes de troupes débandées, d’hommes isolés, de fricoteurs ; ordres donnés à tort et à travers ; distribution irrégulières, incomplètes ou nulles ; composition plus qu’hétérogènes des troupes réunies au camp de Châlons et qui en faisaient un troupeau plus qu’une troupe et surtout une inquiétude générale qui donnait aux physionomies un air morne, abattu […]. Lorsque le général Lacretelle prit le commandement de la division, le 27 août, il réunit les chefs de Corps, s’informa de la position des régiments, donna ses instructions, en un mot, fit ce qui n’avait jamais été fait par personne, et cette sollicitude jeta un rayon d’espoir au milieu de l’accablement général au double point de vue physique et moral.
Du côté des choix stratégiques, cela ne va guère mieux. Au conseil de guerre que Louis Napoléon a immédiatement réuni, Mac-Mahon déclare vouloir attaquer. Bazaine préconise la défense et Leboeuf ne sait que recommander. Finalement, il est décidé de donner la priorité à la Lorraine et de laisser l’initiative à l’ennemi, alors que l’on aurait pu utilement s’avancer sur le Rhin et la Moselle. On s’en tiendra à un coup de main sur Sarrebruck, qui sera d’ailleurs bien mené, mais non exploité.
Dès les premiers jours, Louis Napoléon a du mal à dissimuler à ses soldats l’état de délabrement physique dans lequel il se trouve. Il passe de longues heures à cheval, une sonde dans la vessie, le corps garni de serviettes pour éponger des pertes qu’il ne peut maîtriser. La façon dont il supporte son calvaire relève de l’héroïsme, s’accordent à dire encore aujourd’hui les médecins. Lorsque la souffrance est trop forte, son fils l’aide à descendre de cheval, il enlace de ses long bras un tronc d’arbre, inclinant le front sur l’écorce dans laquelle il enfonce ses ongles pour tenter d’oublier sa douleur.
Que de temps perdu ! Or voilà que les Prussiens passent à l’attaque. En deux jours à peine, ils s’assurent le contrôle de l’Alsace. Le 4 août Moltke – il en est le premier étonné – s’empare de Wissembourg. Le 5, Strasbourg tombe, Frossard, qui a attendu en vain l’aide de Bazaine est battu à Forbach.
C’est un double désastre. La guerre a pris en peu de temps un cours dramatique. Louis Napoléon, qui souffre toujours le même martyre et sent bien que son prestige est entamé, n’a plus qu’une pensée : protéger Paris. Mais comment ? En résistant dans Metz, en prenant position entre Nancy et Frouard, ou en rassemblant toute l’armée à Châlons ?
Le prince Napoléon Jérôme, Lebrun et Castelnau les poussent à envisager son retour à Paris. Bien que l’idée de quitter ses soldats lui répugne et le fasse hésiter, il finit par s’y résoudre, comprenant qu’il sera plus utile dans la capitale, et que sa présence y devient même indispensable.
Eugénie, informée du projet, s’y oppose en des termes d’un grande vivacité : Avez-vous réfléchi à toutes les conséquences qu’amènerait votre rentrée à Paris sous le coup de deux revers ? Pour moi, je n’ose prendre la responsabilité d’un conseil. Si vous vous y décidez il faudrait au moins que la mesure soit présentée au pays comme provisoire.
Il est clair que le retour de Louis Napoléon contrarie les plans de l’impératrice, qui souhaite par ailleurs que Bazaine prenne le commandement. Sa façon de voir semble partagée par les dignitaires du régime. Ollivier déclare : L’empereur est un obstacle à la victoire. Il ne peut pas commander et empêche qu’un autre commande à sa place ; voilà pour Bazaine. De leur côté, Persigny, Rouher et Baroche expriment ensemble le vœu que l’empereur reste au front pour partager la victoire finale ; voilà pour empêcher son retour.
Donc, conclut l’impératrice, qu’il reste aux armées puisque c’est son devoir et que son retour inquiéterait plus qu’il ne réconforterait. Mais qu’il n’exerce plus aucun commandement ! C’est ce qui va se passer.
Un bonheur n’arrive jamais seul. Elle a convoqué les Chambres le 9. Le jour-même, le Corps législatif renverse Emile Ollivier.
Acte doublement dérisoire : si le Corps législatif croit ainsi prendre sa part au redressement nécessaire, il se berce d’illusions ; et s’il entend désigner un premier bouc émissaire, il commet une bien piètre injustice. Car après un semestre à peine d’activité, le gouvernement Ollivier ne peut être raisonnablement tenu pour responsable de l’état de l’armée. Au pire, on peut reprocher à son chef, en tant qu’homme politique, d’avoir eu sa part dans une responsabilité collective dont le Corps législatif ne peut lui-même s’affranchir ; d’ailleurs n’est-ce pas celui-ci, bien plus que le président du Conseil, qui a entrainé le pays dans la guerre ?
Au mépris des lettres patentes qui définissaient ses pouvoirs de régente, Eugénie dévoile alors son jeu en constituant un nouveau gouvernement très marqué à droite, où l’on retrouve, revenu en force, tout le personnel politique de l’empire autoritaire et que dirige Cousin-Montauban. Peu après, sur proposition de Thiers et de Gambetta, Bazaine est promu par acclamations. Dans la foulée, Jules Fabre propose la déchéance de l’empereur, mais, bien qu’elle se situe dans la logique des décisions précédentes, sa proposition n’est pas retenue.
Louis Napoléon, lui, ne se fait guère d’illusions sur le sens de tout ce qui vient de se produire. À Lebœuf il confie, avec un reste d’humour : Nous sommes destitués tous les deux. Le 13, il remet son commandement à Bazaine.
Dès lors, il ne sait plus que faire. Commence pour lui un long chemin de croix, au cours duquel aucune souffrance, aucune humiliation ne lui sera épargnée.
Spectacle pitoyable que celui d’un empereur rongé par la souffrance et errant comme une âme en peine ; d’un empereur qui encombre, qui dérange et n’a plus de prise sur rien ; d’un empereur abandonné, qu’on observe furtivement avec quelque pitié et parfois même une pointe de mépris. Que peut-il faire, entre un gouvernement qui veut qu’on le sache aux armées et des chefs militaires qui ont d’autant moins envie de l’entendre que, s’il parle, c’est pour constater leurs erreurs. C’est en vain que son secrétaire particulier, Francheschini Pietri, adresse à Eugénie une dépêche confidentielle, implorant son rapatriement sanitaire.
Le 14, il quitte Metz. L’impératrice lui a fait dire à nouveau que s’il revenait à Paris, on lui jetterait à la face plus que de la boue.
Le 17, bagage inutile et encombrant, il est à Mourmelon. Napoléon Jérôme est là, qui lui lancera avec une certaine cruauté, et peut-être le secret espoir de le voir se ressaisir, car la régence n’a rien pour lui plaire : Vous ne commandez plus l’armée, vous ne gouvernez plus, que faites-vous ici ? (…)
C’est vrai, lui répond Louis Napoléon, j’ai l’air d’avoir abdiqué.
Le voilà qui brusquement, semble prendre des résolutions : Trochu est à Châlons. Louis Napoléon veut lui confier Paris et y faire retour avec lui. Plutôt que ne penser qu’à Metz, il faut couvrir la capitale : telle est sa conviction.
Eugénie ne veut pas en entendre parler ; elle ne craint pas seulement la fin de sa régence, mais une insurrection : l’empereur ne doit pas rentrer, il ne rentrera pas … en tout cas pas vivant. Et elle le lui fait savoir cette fois, sans aucun ménagement : Ne pensez pas à revenir à Paris si vous ne voulez pas déchaîner une épouvantable révolution… On dirait que vous quittez l’armée parce que vous fuyez le danger.
Eu Cousin-Montauban de doubler cet avertissement par une dépêche plus officielle : L’impératrice me communique la lettre par laquelle l’empereur annonce qu’il veut ramener l’armée de Châlons sur Paris. Je supplie l’empereur de renoncer à cette idée qui paraîtrait l’abandon de l’armée de Metz.
Meurtri et découragé, Louis Napoléon télégraphie en retour : Je me rends à votre opinion. Autour de lui, il confie : La vérité, c’est qu’on me chasse. On ne veut plus de moi à l’armée, on ne veut plus de moi à Paris.
Cependant, Mac-Mahon est assez bon pour accepter sa présence. Alors, il reste auprès de lui, et tente, une dernière fois, d’éviter le pire.
De toute évidence, le gouvernement veut lancer Mac-Mahon et l’armée de Chalons au secours de Bazaine dont on feint de croire qu’il déborde d’activité et qu’il attire ainsi à lui le maximum de forces ennemies. En fait la position que, par paresse, a choisie Bazaine est rien moins que favorable. Stratégiquement, c’est une erreur. Lui porter secours présente désormais beaucoup trop de risques.
Quand Mac-Mahon commence à faire mouvement, Louis Napoléon obtient que Reims soit sa première étape : de là on peut aller tout aussi bien vers Metz que vers Paris. Et quand Rouher vient auprès d’eux plaider la solution gouvernementale, Louis Napoléon retrouve assez de force pour argumenter et le convaincre de la nécessité du retour de l’armée sur Paris. Mais, bien que gagné à cette idée, Rouher ne réussira pas à imposer son nouveau point de vue.
Bazaine ayant fait connaître qu’il a l’intention de faire mouvement vers Montmédy, Mac-Mahon décide de s’y rendre. Le mot d’ordre est simple : sauvez Bazaine.
Louis napoléon continue de suivre, et se traîne, sans conviction, sans espoir, harcelé par la douleur, abruti par l’opium : Je suis à bout, dit-il, ah ! si je pouvais mourir !
Il a cependant la force d’écrire au maréchal : Pour moi, qu’aucune préoccupation politique ne domine autre que celle du salut de notre patrie, je veux être votre premier soldat, combattre et vaincre ou mourir à côté de vous, au milieu de mes soldats.
Et le voici à Sedan, où Mac-Mahon se retrouve bientôt enfermé. Louis Napoléon ne veut pas en partir. Il va chercher la mort à défaut de la victoire. Au plus fort de l’affrontement, il se déplace d’un endroit à l’autre, sans but, au pas de son cheval.
Spectacle cruel, shakespearien. Encore Richard III, quand il erre sur la champ de bataille a-t-il pu se battre et courir sa chance. Louis Napoléon ne s’est pas vu offrit la moindre opportunité. Il est hors du jeu, vaincu sans doute avant même que le sort de la bataille ne soit définitivement dessiné…
Le docteur Auger a raconté ces moments : De huit heures à midi, je n’ai pas quitté l’empereur. Les obus et les boulets sifflaient […] à nos oreilles ou éclataient sous nos pas […] Un moment, l’empereur met pied à terre derrière une petite haie. Un obus vient à éclater à dix pas de lui. Si cet homme n’était pas venu là pour se faire tuer, je ne sais en vérité ce qu’il venait y faire. Je ne l’ai pas vu donner un seul ordre pendant toute la matinée.
Ēmile Zola a compris toute la densité dramatique de ces instants. Il en rend compte : Les balles sifflent, comme un vent d’équinoxe ; un obus avait éclaté en le couvrant de terre. Il continue d’attendre. Les crins de son cheval se hérissaient, toutes sa peau tremblait dans un instinctif recul devant la mort qui, à chaque seconde, passait, sans vouloir ni de la bête, ni de l’homme. Alors, après cette attente infinie, l’empereur, comprenant que son destin n’était pas là, revint tranquillement.
Plus tard, dans son exil, Louis Napoléon a décrit les sentiments qui l’habitaient, expliquant comment, témoin impuissant d’une lutte désespérée, convaincu que, dans cette fatale journée, sa vie comme sa mort étaient inutiles au salut commun, il s’avançait sur le champ de bataille avec cette froide résignation qui affronte le danger sans faiblesse, mais aussi sans enthousiasme.
Peu après le drame, il a confié à Eugénie : Il ne m’est pas possible de te dire ce que j’ai souffert et ce que je souffre […] j’aurais préféré la mort à une capitulation désastreuse […]
Pourtant la capitulation, c’est lui qui va la décider, dans un sursaut d’autorité. La bataille est perdue et il est devenu inutile d’aggraver encore des pertes terribles. Assez de sang perdu, soupire-t-il. On retrouve là l’homme de Solferino, de Montebello, celui qu’a dépeint Canrobert : Il était presque muet tant la douleur le terrassait : c’était la vue du carnage et non sa propre douleur physique. Les généraux Ducrot et Verge se demandèrent s’il ne fallait pas regretter d’avoir montré le champ de bataille à l’empereur.
Louis Napoléon fait hisser le drapeau blanc au sommet de la citadelle. Au roi de Prusse, stupéfait d’apprendre qu’il se trouve là, il adresse un simple billet :
Monsieur mon frère,
N’ayant pu mourir à la tête de mes troupes, il ne me reste plus qu’à remettre mon épée entre les mains de votre Majesté
Je suis, de votre Majesté, le bon frère
Napoléon
Ambert décrit ainsi, la terrible scène finale : Seul dans un fauteuil de la sous-préfecture de Sedan, sous un toit brisé par les obus, entouré de morts et de mourants, il remit son épée à un aide de camp chargé de la déposer aux mains du roi de Prusse.
Il lui reste à prendre une dernière grande décision, une décision dont les motivations, les implications, les conséquences vont passer inaperçues dans la dramatique confusion du moment et la cadence échevelée des événements ultérieurs. Une décision dont le mérite, depuis l’heure de l’interminable hallali, n’a jamais été reconnue.
Bismarck, qui n’a rien d’un sot, pose immédiatement la vraie question, la question fondamentale : cette épée que remet Louis Napoléon, quelle est-elle ? Celle de l’empereur ou celle de la France ? C’est, avec sept décennies d’avance, le choix de 1940 entre l’armistice et la capitulation. Est-ce la France qui se rend ou tout ou partie de son armée ? La reddition est-elle un acte politique qui engage la nation tout entière, ou simplement un acte militaire imposé à une fraction de l’armée du fait de sa défaite sur une partie du champ de bataille ?
Bismarck accourt donc en personne auprès de l’illustre prisonnier, pour recueillir de sa bouche la réponse à cette question fatidique. Leur tête à tête a lieu de 2 septembre.
Bismarck propose à Louis Napoléon de négocier. Lui-même y a tout intérêt. Il a gagné. D’ores et déjà, il sait que ses buts de guerre sont atteints. À l’intérieur de ce qui va devenir l’Allemagne, la victoire remportée en commun donne un coup d’accélérateur puissant et décisif au processus d’unification. Et le succès prussien ne peut que se traduire par des gains territoriaux sur la France. Satisfait dans tous les domaines, le chancelier est assez fin politique et suffisamment renseigné pour ne pas pressentir ce qui risque de se produite bientôt à Paris : la révolution. Or, non seulement il exècre les révolutions, mais il peut aussi craindre qu’un nouveau gouvernement, pour asseoir sa légitimité en s’opposant à l’ennemi, ne décide de poursuivre les hostilités. L’issue finale ne ferait alors guère de doute. Mais que d’efforts à consentir, de retards à accepter, de dépenses à financer, de vies humaines à sacrifier, alors que le résultat est déjà à portée de la main ! Au demeurant le marché, pour une fois – doit lui paraître plus qu’équitable : en traitant avec l’empereur, la Prusse offre à celui-ci la garantie du pouvoir. Dès lors que l’empereur signe la paix, la Prusse veillera – et obtiendra par la seule menace de ses troupes – que la légitimité du signataire ne soit pas remise en cause.
Louis Napoléon n’ignore rien de tout cela. La tentation doit être forte : qui n’y aurait cédé ? En acceptant le marché, il peut sauver l’Empire. Les bonnes raisons ne manqueraient pas, qu’il serait aisé de mettre en avant, l’intérêt national pouvant facilement camoufler, même aux yeux des plus farouches adversaires de l’Empire, l’intérêt dynastique.
Pourtant, Louis Napoléon refuse. L’épée qu’il a remise, déclare-t-il au chancelier, n’est que celle de l’empereur. Aucun pourparler ne peut être engagé avec lui : Je suis, dit-il, prisonnier de guerre.
À ce moment précis, il a choisi de sacrifier l’Empire au nom de la France. Il a renoncé à rester le souverain par la grâce de la Prusse. Il a refusé de rentrer aux Tuileries, fut-ce en empereur autoritaire, dans le fourgons de l’ennemi.
Alors Bismarck l’interroge : Qui a le pouvoir de négocier ? Et Louis Napoléon de répondre : le gouvernement actuellement existant.
On a bien lu : le gouvernement actuellement existant. C’est à dire le gouvernement en place, qui pourrait être un autre demain ; ce serait alors à celui-ci de se prononcer. Louis Napoléon n’a pas voulu sacrifier ses soldats pour réserver l’avenir. Il n’aura pas voulu davantage lui faire insulte, fut-ce en contrepartie de son maintien aux affaires.
En d’autres termes, Louis Napoléon signifie à Bismarck que la France continue.
Il s’est trouvé au moins un historien pour comprendre et saluer la grandeur de ce geste. C’est Adrien Dansette qui résume ainsi les choses : Plus grand dans l’affrontement de la fortune que dans l’éclat de son destin, cet empereur qui a toujours recherché les suffrages populaires, s’efface dans un héroïsme obscur et passif que la foule ne peut comprendre.
On pourrait sans doute dire davantage. Le refus de Louis Napoléon est le premier acte de la revanche de la France.
Philippe Seguin. Louis Napoléon le Grand. Grasset 1990
7 12 1865
Suède : un référendum constitutionnel fait du Riksdag un parlement bicaméral.
1865
Syronite : 1° plastique par l’anglais Parkes. Le trafic fluvial décline, au profit du trafic ferroviaire. Un professeur de médecine montpelliérain, Fuster, prétend que la consommation de viande crue combat la tuberculose : la hantise de cette maladie était si répandue qu’elle fit naître la mode du steak saignant. À Paris, des eaux pures captées à la source circulent dans le réseau et sont distribuées, ainsi que de l’eau non potable pour arroser les parcs et nettoyer les rues. Pasteur dépose un brevet pour la conservation du vin, et trouve le remède à la pébrine, la maladie du ver à soie qui avait fait son apparition à Cavaillon en 1845 ; la production des cocons fabriqués par les vers à soie dans les Cévennes était tombée de 26 000 tonnes en 1853 à 5 000 tonnes en 1865. Il avait inventé le procédé alors nommé grainage cellulaire qui consiste à broyer dans un échantillon de chrysalides les corpuscules du parasite contaminant. Si leur proportion est très faible, la chambrée est considérée comme bonne pour la reproduction. C’est ainsi qu’il sauvera l’industrie de la soie. Pébrine, car les vers atteints étaient parsemés de petites tâches marron ressemblant à du poivre – pebre, en provençal. Mais il restait une autre maladie, la flâcherie, moins ravageuse
Joseph Oller installe une roulotte sur l’hippodrome de La Marche, en Basse-Normandie, et propose aux turfistes son invention : le pari mutuel. Dans le pari mutuel, la cote des chevaux est calculée sur la masse des paris enregistrés : plus le cheval est joué, plus sa cote est basse. Le bookmaker, lui, fixe la cote selon son estimation personnelle. Le preneur de pari mutuel ne prend aucun risque face aux parieurs, se contentant de leur fournir un service : calcul et répartition des mises. Dans la foulée, il ouvre plusieurs agences de paris dans la capitale, qui vont rapidement devenir lieux de loisirs, lesquels seront convertis en café-concert sitôt interdits les paris : ils auront pour nom les Fantaisies Oller, la piscine Rochechouart, premier centre hydrothérapique de Paris, le Nouveau Cirque – future salle Pleyel – et le Moulin Rouge.
Mise en service par la Compagnie Générale Transatlantique de 2 bateaux à hélice sur l’Atlantique.
Un convoi de femmes détenues part à Cayenne pour y trouver mari… quand les liens sacrés du mariage se font chaînes…
L’américain Cyrus W Field réalise la 1° liaison télégraphique Europe-États-Unis.
En Prusse, l’ensemble des organisations de renseignement est regroupé au sein de la Geheimfeldpolizei, dirigé par un as : Wilhem Stieber : il va installer en France un redoutable réseau d’espions qui pèsera son poids dans la défaite de 1870.
La Grande Bretagne, crée le Palestine Exploration Fund, parrainé par la reine Victoria, avec mission de vérifier que l’histoire biblique est une histoire réelle, à la fois dans le temps, dans l’espace et à travers les événements afin d’offrir une réfutation à l’incroyance. Il s’agissait bien de ne pas laisser le climat révolutionnaire crée par Darwin dans le monde scientifique contaminer la lecture de la Bible. On pensait que l’histoire était inscrite dans la Bible et l’on refusait encore d’admettre que la Bible était inscrite dans l’histoire.
L’Écossais Thomas Sutherland fonde à Hong Kong la HSBC – The Hongkong and Shanghai Banking Corporation – par laquelle passera la quasi-totalité des transactions financières concernant la guerre, puis la consommation d’opium. L’homme avait du flair et avait deviné que la Chine ne pourrait pas éternellement ignorer le système bancaire, car c’était bien de cela qu’il s’agissait : n’important que très peu, exportant énormément, la Chine ignorait tout de ce que peut être une dette publique, et donc, il n’y avait que des petites banques locales, mais aucune puissante, et les indemnités de guerre exigées par le traité de Nankin étaient le premier cas de figure qui montrait l’impuissance du gouvernement chinois à continuer à fonctionner comme il l’avait toujours fait ; la Chine avait besoin d’emprunter aux Banques pour payer ces amendes.
En 1993, avec le changement de statut de Hong Kong en perspective, le siège social sera transféré à Londres, avec un directeur général à Hong Kong à partir de 2010. Classée sixième entreprise mondiale en 2000. L’opium a cédé la place aux placements discrets des très nombreuses fortunes qui veulent jouer à cache cache avec le fisc de leur pays d’origine dont notre inénarrable ministre du budget sous François Hollande : Jérôme Cahuzac. La HSBC pourra s’offrir le luxe de payer 1.7 milliard $ en 2010 aux États-Unis pour mettre fin à de très nombreuses enquêtes sur des activités mafieuses quand ce n’est complices des terroristes…
Bakounine, revenu des bagnes russes, devient un farouche adversaire de Marx : De fait, tout les oppose. Marx est communiste : il souhaite la prise de contrôle de l’État par des partis communistes par le biais des urnes, là où c’est possible et grâce à la solidarité internationale des travailleurs. Bakounine est anarchiste : il aspire à abolir l’État et tous les pouvoirs ; il réfute l’existence même de l’Internationale : de surcroît, il veut imposer l’athéisme aux socialistes, ce qui exclurait de l’Internationale la plupart de ses adhérents britanniques, dont beaucoup soutiennent Karl. Enfin, Karl est juif – athée, mais juif -, Bakounine est antisémite.
Jacques Attali. Karl Marx ou l’esprit du monde. Fayard 2005
Marx redira à un journal américain, après la Commune de Paris qu’il n’est pas partisan systématique de l’usage de la violence pour une révolution… c’est selon …. En Angleterre, par exemple, la voie qui mène au pouvoir politique est ouverte à la classe ouvrière. Une insurrection serait folie là où l’agitation pacifique peut tout accomplir avec promptitude et sureté. La France possède cent lois de répression ; un antagonisme mortel oppose les classes, et on ne voit pas comment échapper à cette solution violente qu’est la guerre sociale. La choix de cette solution regarde la classe ouvrière de ce pays.
Karl Marx, au New York World
Plus tard, bien peu des partisans de Marx retiendront qu’il a recommandé d’employer, là où c’est possible, la voie démocratique pour conquérir le pouvoir. Jamais, il est vrai, il ne dit que ce pouvoir devra être rendu s’il est perdu par les urnes…
Jacques Attali. Karl Marx ou l’esprit du monde. Fayard 2005
12 02 1866
Le secrétaire d’État William Seward ordonne à Napoléon III de retirer ses troupes du Mexique, et, pour s’assurer cette fois-çi que l’ultimatum a bien été entendu, met 60 000 hommes à la frontière. Maximilien sera livré tôt ou tard aux troupes de Benito Juarez.
04 1866
Poussées par le simoun, un vent du sud, des nuées de sauterelles envahissent l’Algérie, jusqu’au littoral : elles dévorent tout et pondent des milliards de criquets ; quarante jours après leur éclosion, les criquets ont vu leurs ailes pousser : ils s’accouplent et deviennent sauterelles. En mai, la terre algérienne est transformée en fourmilière géante. La catastrophe survient après des années d’autres malheurs : deux années consécutives d’incendies géants dans les forêts domaniales, suite à de grandes sécheresses qui réduisent parfois les récoltes de moitié. On lutte contre le phénomène à grands renforts de bruit, d’outils etc… avec une efficacité mitigée. Un an plus tard, la disette devient famine : un tremblement de terre dans la Mitidja et c’est le typhus et le choléra qui s’installent.
Le 19 mars 1868, Jacquemaire, curé de Sainte Barbe du Tlélat, écrit à l’évêque d’Oran : Depuis deux mois, les Arabes qui ne se sont point encore livrés à la mendicité viennent vendre les bracelets, boucles d’oreilles et épingles, le plus bel ornement que possède la femme arabe, tous en or ou en argent. On ne leur paye pas la moitié de leur valeur, mais comme leurs besoins sont grands, ils acceptent ce qu’on leur offre.
Des femmes qui, quelques semaines auparavant, n’osaient pas regarder un homme dans les yeux, en sont réduits à prostituer leur petite fille. Chaque jour, on relevait sur les chemins, dans les champs, et jusque dans l’intérieur des villes et des villages, les cadavres d’hommes, de femmes et d’enfants morts de faim. À Mascara, le 3 décembre, on relevait dix cadavres d’indigènes morts de faim. Le 3, 14, le 5, 23. Tous ces morts gisaient dans des trous, au fond des ravins, sur les chemins, dans les ruisseaux même, et aussi dans un lieu que l’on appelle le marabout de Sidi-Bouran, espèce de nécropole, tombe anticipée, où se traînaient et s’entassaient tous ceux qui sentaient leur fin approcher.
Abbé Burzet
L’administration coloniale ne voudra jamais reconnaître la réalité de la famine du choléra et du typhus. Le Journal Officiel prétend qu’il n’y a plus lieu d’accorder de secours, les causes ayant disparu. Rochefort répondra dans La Lanterne : L’Officiel se trompe, ce ne sont pas les causes, ce sont les Arabes qui ont disparu : en 1866, le recensement donnait, indigènes et européens confondus, 2 931 000 habitants… en 1872 : 2 125 000 habitants ! Sur ces 800 000 morts, on peut en attribuer 500 000 au typhus et au choléra. Des colons en sont morts, mais aucun d’eux n’est mort de faim. À part quelques initiatives individuelles et des efforts importants du clergé – la Société des Attafs de Mgr Lavigerie, archevêque d’Alger – l’administration comme les colons voulurent délibérément tout ignorer.
Plus au sud, surtout en Afrique de l’Est, des décennies funestes s’annoncent pour le bétail : la pneumonie bovine était arrivée en Afrique du Sud quinze ans plus tôt ; elle arrivera au Tchad en 1870. La peste bovine, venue des steppes russes, avait atteint d’abord l’Égypte, puis le Soudan occidental en 1865 : elle ravagera régulièrement de cheptel d’Afrique australe et orientale à partir de 1889 ; plus de la moitié des chevaux et des moutons périront en 1865, des dizaines de milliers de vaches entre 1864 et 1866. Puis la famine en 1877, et encore la peste bovine à partir de 1896. À la fin du siècle, les Sotho auront perdu la moitié de leur bétail.
14 06 1866
L’armée italienne est battue par l’Autriche à Custozza.
06 1866
Georges Leclanché invente la pile économique à acide insoluble.
3 07 1866
Les Prussiens infligent une lourde défaite aux Autrichiens à Sadowa, entre Prague et Breslau. L’Autriche de Metternich restait depuis le Congrès de Vienne le centre des nouveaux équilibres européens. Les révolutions de 1848 l’avaient déjà bien affaiblie et avec cette défaite, les centres se déplacent ; on assiste à la montée en puissance de la Prusse qui crée une confédération de l’Allemagne du nord. Ce n’est là que la première partie du plan de Bismarck dont la seconde sera la guerre contre la France, quatre ans plus tard.
20 07 1866
La marine italienne est battue par les Autrichiens à Lissa, une île croate, à l’ouest de Korčula. C’est un moment charnière dans l’évolution tant des navires que de l’artillerie : les navires cuirassés tendent à supplanter les navires en bois, [la phase intermédiaire consistant à cuirasser des navires en bois] l’énergie vapeur tend à supplanter celle du vent transmise par les voiles, et les canons montés sur tourelle et chargés par l’affut supplantent les canons alignés devant leur sabords avec des angles de tir très fermés et que l’on chargeait encore par la gueule. L’Autriche est un vieux pays qui n’a pas de raison de renouveler sa flotte en permanence, donc ils ont encore beaucoup de navires en bois et de vieux canons, mais ses marins, de l’amiral au matelot ont de l’expérience ; l’Italie est un pays tout neuf, avec une marine idoine, donc à la pointe du progrès, tant pour les navires que pour l’artillerie, mais l’unité italienne n’est encore que de façade et les particularismes de chaque région sont encore prédominants : difficile de donner une cohésion à tout cela. Les commandements étaient certes de nationalités différentes, mais les matelots étaient majoritairement italiens des deux côtés. Les Autrichiens, se sachant inférieurs en artillerie, manœuvreront de façon à éviter son usage, et s’approchant des Italiens le plus vite possible, comme un boxeur qui, en cherchant à éviter les uppercuts, se colle à son adversaire. Le grand vainqueur technique sera l’éperonnage, que l’on dira promis à un grand avenir, ce qui s’avérera faux. Finalement, les Autrichiens auront perdu le Kaiser, mais coulé deux cuirassés italiens et fortement endommagés trois autres navires italiens.
On entendra ricaner des officiers autrichiens : Les Italiens nous tiraient dessus, sans se rendre compte qu’ils avaient oublié de mettre les boulets dans les canons ! Dans l’éloge fait au contre-amiral autrichien Wilhelm von Tegetthoff, on parlera de têtes de fer aux commandes de bateaux en bois qui eurent raison de bateaux en fer gouvernés par des têtes de bois.

Gravure parue dans le Harper’s weekly le 1° septembre 1866

Le Re d’Italia, devenu navire amiral en cours de bataille, éperonné et coulé par le SMS Ferdinand Max, navire-amiral de Tegetthoff. Mais pourquoi les drapeaux italiens semblent-ils être français ?
2 09 1866
La bière apparaît au Café de la Rotonde.
15 11 1866
Jean Macé, journaliste républicain et franc-maçon, crée la Ligue française de l’enseignement, mouvement d’éducation populaire qui va inspirer les lois sur l’école gratuite, obligatoire et laïque à la fin du XIX° siècle. Une pétition pour une instruction publique, gratuite, obligatoire et laïque est lancée avec l’aide de la presse libérale, et connaît un très grand succès. Le Mouvement national du sou contre l’ignorance lancé en septembre 1871 permet de recueillir en quinze mois plus de 1 300 000 de signatures remises à l’Assemblée nationale [4]. En novembre 1872, une nouvelle campagne est lancée auprès des élus locaux sur la question de la laïcité, c’est-à-dire de la neutralité de l’école publique subventionnée par l’État ou la commune. En 1886, plus du tiers des députés et des sénateurs sont membres de la Ligue.
Aujourd’hui, la Ligue de l’enseignement est la première coordination associative française avec près de 2 000 000 d’adhérents indirects, structurée territorialement avec les Fédérations Départementales et les Unions Régionales et par activité, avec ses Unions sportives – USEP, UFOLEP – ou son réseau de centres de vacances, Vacances pour tous. La Ligue de l’enseignement organise le Salon Européen de l’Éducation, les opérations Pas d’éducation, pas d’avenir, et Demain en France. Elle est par ailleurs partenaire de Lire et faire lire. Elle est membre fondatrice du Cidem (Civisme et démocratie), de l’Anacej – Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes -, du Réseau national des juniors et du Comité du service civique associatif. Elle a soutenu la création du réseau d’associations étudiantes Animafac dès sa création. La Ligue de l’Enseignement est membre fondateur de la CPCA – Coordination permanente des coordinations associatives – et du Forum Civique Européen. Sous la présidence de Léon Bourgeois, la Ligue appellera au développement des œuvres post et périscolaires afin d’implanter en tout homme les solides principes indispensables aux citoyens d’une démocratie. Soutenus par les pouvoirs publics, patronages, amicales d’anciens élèves, mutuelles, coopératives voient le jour sur tout le territoire et connaissent un grand succès qui inspirera au gouvernement la loi de 1901 sur les associations.
Avec le souci de mettre l’art, les techniques, les disciplines sportives au service de tous, elle créera des sections spécialisées, les UFO. La première, en 1928, l’UFOLEP – Union française des œuvres laïques d’éducation physique – et sa filiale, l’USEP – Union sportive de l’enseignement du premier degré, créée en 1939, permettra à des centaines de milliers d’enfants la pratique du sport. En 1933, ce sont la chorale, la danse, le théâtre, la musique la photo, la peinture, la sculpture, le folklore qui grâce à l’UFOLEA – Union française des œuvres laïques d’éducation artistique – deviendront accessibles au grand nombre, ainsi que le cinéma, grâce à l’UFOCEL, devenue plus tard l’UFOLEIS – Union française des œuvres laïques pour l’éducation par l’image et le son -. En 1934, dans le cadre de l’UFOVAL, elle s’attachera à développer les colonies de vacances et les centres d’adolescents. Tous les ans à l’automne la Ligue parraine à Paris, Porte de Versailles, un Salon de l’Éducation.
On le voit, en moins d’un siècle, la Franc Maçonnerie sera parvenue à constituer, sous le drapeau de la laïcité, une armée para-scolaire à même de mordre copieusement sur les plates-bandes de l’Église à travers ses très nombreux mouvements d’Action catholique, patronages et autres.
1866
John Osterhoudt fait breveter la boite de conserve à clef ; en 1924, G.A. Leighton améliorera l’affaire en dessinant deux obliques sur la surface du métal. Les frères Pallade et Simon Violet, drapiers à Thuir, dans les Pyrénées orientales, veulent profiter du succès du vin pour s’installer sur le marché en proposant un apéritif qu’ils nommeront Byrhh en reprenant des indicateurs du nuancier de couleurs de leurs draps : à une base de vin, ils ajoutent du quinquina et différentes épices – café, cacao, fleur de sureau, camomille -. Ils commencent par proposer cela comme un médicament, mais les pharmaciens s’y refusent ; en diminuant un peu la dose de quinquina, ils le proposent dès lors comme apéritif ; le produit se positionnera désormais comme boisson hygiénique, connaissant un succès mondial, s’offrant un Gustave Eiffel pour faire leur cave, utilisant la publicité comme personne. Le succès durera jusqu’à l’entre deux guerres, puis la concurrence des vins doux naturels – Banyuls, Muscats de Frontignan, Rivesaltes – le feront passer de mode et le régime de Vichy lui portera un sérieux coup – on ne pouvait en attendre moins de Vichy, Maréchal ou pas -. La marque est aujourd’hui aux mains de Pernod Ricard.
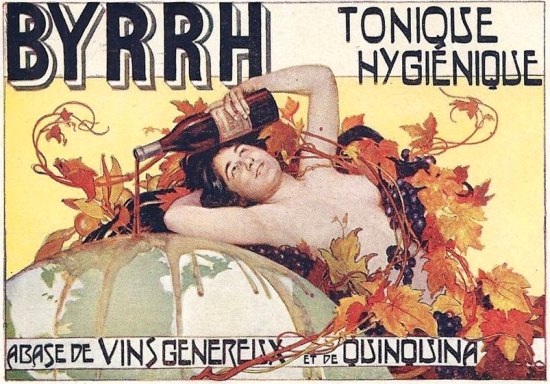
Laurent Desrousseaux

Léon Selves
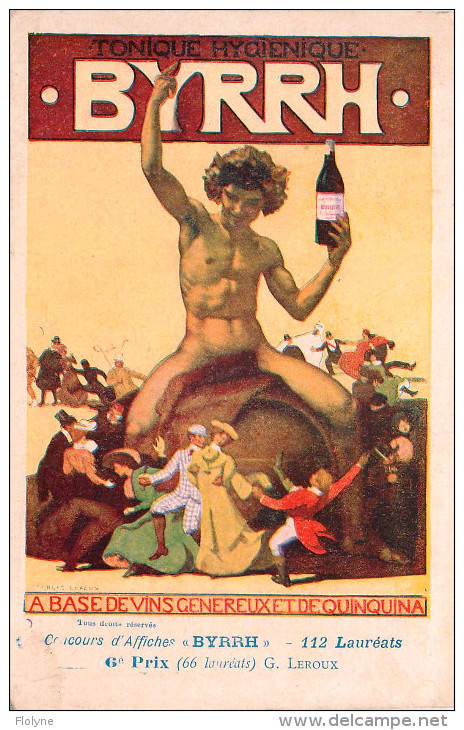
G. Leroux

Victor Leydet


Pose du premier câble télégraphique sous-marin transatlantique de la France à Terre Neuve. L’armée adopte le fusil Chassepot, qui se charge par la culasse : il représente un énorme progrès technique par rapport aux systèmes antérieurs, qui se chargeaient par le canon, demandaient une bonne minute pour le chargement, ne portaient qu’à 80 mètres, et dont les tirs se soldaient par environ 60 % d’échecs. Encore quinze ans, et ce sera la mitrailleuse Maxim – 11 coups/sec – puis le fusil à répétition, tout cela donnant une écrasante supériorité aux troupes coloniales sur les troupes indigènes.
À l’époque de la guerre d’Indépendance [des États-Unis contre l’Angleterre], les minute men – tireurs d’élite à la vue perçante capables de faire mouche à 900 mètres – utilisaient des fusils ordinaires. Mais il s’agissait d’une exception. D’ordinaire, au XVIII° siècle, les fusils n’étaient utilisés que pour couvrir une centaine de mètres, et on continuait de s’en servir plus souvent pour la chasse que pour la guerre. En 1807, le révérend Alexander Forsyth, pasteur écossais de l’Aberdeenshire, inventait l’amorce à percussion, qui conduisit à l’amorce d’acier et de cuivre. Forsyth effectua ses recherches dans la Tour de Londres, et lord Moira, alors commandant en chef de l’artillerie, fournit un suppléant à l’inventeur militaire pour le libérer de ses devoirs pastoraux. Napoléon offrit 200 000 livres à Forsyth contre le secret de son invention. Celui-ci refusa patriotiquement, bien que le gouvernement britannique ne lui ait rien donné jusqu’à ce qu’il soit sur son lit de mort. Ce système entra en usage après sa mort, en 1839, et fut hautement bénéfique, cette cartouche résistant au vent et à la pluie. La balle fut repensée peu de temps après par le capitaine John Norton, qui lui donna une forme cylindrique et une base creuse, à l’image des flèches en moelle de lotus qu’il avait pu observer en Inde.
Une fois encore, le service du matériel britannique tarda à mettre cette idée en œuvre. Les Français l’appliquèrent au fusil Miné, qui avait une portée de 500 mètres, et distançait donc le tir de précision de l’artillerie. De pair avec l’amorce de précision, cette nouvelle balle transforma la tactique de l’infanterie.
Au milieu des années 1860, les soldats d’infanterie armés de fusils devinrent la règle et non plus l’exception. À la même époque, les Prussiens adoptèrent le fusil à aiguille à chargement par la culasse, inventé par J. M. Dreyse dans les années 1840, et qui tirait une cartouche de papier. Cette arme pouvait être fabriquée en série : à la bataille de Sadowa, les Prussiens engagèrent 400 000 soldats d’infanterie munis de fusils à aiguille. Ils affaiblirent sérieusement l’Autriche, restée fidèle au fusil à chargement par le canon, mais leur victoire fut fatale à la future tranquillité de l’Europe, à laquelle l’Autriche avait jusqu’alors servi de rempart contre la Russie.
Le fusil à chargement par la culasse, contrairement au fusil à chargement par le canon, accrut la rapidité de tir des soldats, et leur permit de tirer à terre ou à couvert. Le feld-maréchal von Moltke était convaincu que ce type d’arme était plus favorable à la défense qu’à l’attaque, et que les batailles se remporteraient par conséquent par enveloppement. Les Américains, pendant ce temps, produisaient des pistolets en grand nombre. À partir de 1846, le revolver, essentiellement produit, au départ, par Samuel Colt, s’avéra particulièrement efficace dans les combats rapprochés, en particulier pendant la guerre du Mexique. Il s’ensuivit une demande massive de ce type d’arme en 1849, chez les chercheurs d’or de Californie. Toutes ces innovations américaines étaient caractérisées par des pièces entièrement interchangeables.
Le fusil, grâce aux méthodes de fabrication américaines, commença à être produit de la même façon. Il fut copié en Angleterre par Sir Joseph Whitford, l’armurier de Manchester ; dans les années 1860, la manufacture royale d’Enfield produisait 1 000 fusils par semaine. Chaque fusil était composé de 700 pièces. En place, fusiliers, en place ! adjurait le poète lauréat Tennyson dans un poème écrit en 1859, Tenez-vous prêts contre la tempête ! Le nouveau fusil Enfield fonctionnait avec des cartouches enduites de graisse qu’il fallait ouvrir d’un coup de dents avant de charger. La rumeur selon laquelle il s’agissait de graisse de bœuf ou de porc se répandit en Inde. Pour un hindou de caste, mordre dans de la graisse, quelle qu’elle soit, était un péché grave. De nombreux cipayes au service de l’armée britannique appartenaient à la caste des brahmanes et ils croyaient que, s’il leur arrivait de mordre dans cette graisse, il leur faudrait bien des vies avant de retrouver, à travers le cycle de la réincarnation, les sommets qu’ils pensaient avoir atteints. D’où la révolte des cipayes, en 1857.
Les Français, quant à eux, ne restaient pas inactifs. Leur chassepot, introduit en 1866, et inventé par un officier de ce nom, était supérieur au fusil à aiguille et au vieux mousquet, puisqu’il avait une portée de près de 600 mètres. Plus robuste que le fusil à aiguille, il pouvait tirer six à sept coups par minute. Mais le chassepot supportait mal un feu nourri et nécessitait un bon entretien. Mis à l’épreuve durant la guerre franco-prussienne, il fut vaincu par le vieux fusil à aiguille (les généraux français avaient pourtant assuré à leurs hommes que ce dernier s’enrayerait au bout de quelques salves). Le Second Empire s’effondra.
Pendant le reste du siècle, les puissances européennes se disputèrent la suprématie de la puissance de feu, bien qu’elles eussent déjà atteint un haut degré d’efficacité en 1871. Quel était le meilleur, le fusil lebel français, le männlicher, ou le lee-meetford 303? Le martiny-henry utilisait des cartouches métalliques, mais la poudre B donnait un avantage au lebel. En 1900, tous les États européens avaient des fusils à répétition à chargement par la culasse d’efficacité comparable, dont le calibre allait de .315 à .256. Ils utilisaient tous de la poudre non fumigène et avaient une portée de 1 800 mètres. On avait aussi mis au point des mitrailleuses capables de massacrer l’infanterie, comme le fusil pivotant à dix canons mû à l’aide d’une manivelle et alimenté en charge, conçu par R. J. Gatling, de Caroline du Nord. À ses débuts, en 1856, la mitrailleuse française (composée de vingt-cinq canons et tirant vingt-cinq coups par minute) fut considérée comme une arme sécréte. La discrétion excessive qui entoura sa fabrication l’empêcha d’être exploitée pleinement pendant la guerre de 1870. La mitrailleuse ne fut vraiment utilisée qu’à partir de 1884, lorsque sir Hiram Maxim eut conçu un fusil-mitrailleur à recul qui allait devenir l’arme cruciale de la dernière étape de l’édification des empires européens en Afrique, et des tranchées qui allaient le détruire. On pouvait tirer 2 000 coups par minute – progrès radical qui mit fin aux anciennes monarchies tribales, comme aux armées impériales européennes. La victoire des Britanniques dans la guerre du Matabélé en 1893, par exemple, reposa en grande partie sur un usage adroit des mitrailleuses.
La guerre de Sécession constitua un véritable laboratoire d’inventions militaires. Trains blindés, balles explosives, mines-pièges et obus à gaz furent tous utilisés pour la première fois dans ce conflit. C’était aussi la première fois depuis près d’un siècle qu’on utilisait la terreur contre des civils. Les activités des cuirassés Merrimac et Monitor transformèrent la guerre sur mer. On construisit même un sous-marin (s’inspirant des travaux de Fulton vers 1790), qui envoya un cuirassé par le fond au large de Charleston. Les mines sous-marines avaient été utilisées pour la première fois par les Russes en 1853 pour protéger leur base navale de Kronstadt, tandis que la torpille explosive autopropulsée était mise au point en 1864 par un inventeur du Lancashire, Robert Whitehead, à la demande des Autrichiens.
Hugh Thomas. Histoire inachevée du monde. Robert Laffont 1986
Le soldat français est brave, habile, endurant. Nos troupes, en particulier nos troupes coloniales sont aptes aux coups de main, aux opérations de commandos. Elles vont ainsi faire merveille en Algérie, en Cochinchine, en Chine et même, souvent, au Mexique. Peut-être, d’ailleurs y prennent elles de mauvaises habitudes. Car autant se manifestent leurs qualités et leur efficacité dans les phases tactiques, autant paraissent-elles empruntées dès qu’il s’agit de concevoir et de manœuvrer à plus grande échelle. On n’ a pas intégré dans les conceptions stratégiques les données nouvelles qu’impliquent les progrès techniques : l’évolution des armes, l’importance de la logistique, la rapidité des transmissions. Aucun chef militaire ne va se montrer apte à imaginer et à conduire une rénovation pourtant nécessaire de l’art de la guerre. On se bat comme sous le premier Empire malgré un armement autrement plus meurtrier : on charge à la baïonnette, par gros bataillons, on forme le carré pour se protéger de la cavalerie qui s’élance elle-même en rangs serrés… Il y a pire : les officiers supérieurs ont une mentalité de seigneurs de la guerre : il ne faut surtout pas qu’un concurrent leur vole le succès : pour éviter cela, ils sont prêts à tout compromettre…
La victoire de Crimée fera malheureusement oublier les récriminations que, devant l’ampleur du désordre et de la désorganisation de notre armée, exprime un saint-Arnaud: On ne fait pas la guerre sans pain, sans souliers, sans marmites, sans bidons. Anathème sur les ânes bâtés, sur les cuistres enchiffrés, sans prévoyance et sans politique militaire qui ont jeté à huit cents lieues de la France, avec la moitié à peine des moyens et des ressources nécessaires en personnel et en matériel, une armée de soixante-dix mille hommes !
De même, une fois le succès assuré en Italie, nul ne se souciera plus des constats accablants faits par Louis-Napoléon lui-même au début des hostilités. En 1870, à la veille d’affronter les Prussiens, les leçons des conflits antérieurs n’auront pas été tirées.
Philippe Seguin. Louis Napoléon le Grand. Grasset 1990
John Muir, né en Ecosse a émigré dans le Wisconsin quand il avait onze ans … Les forêts d’Amérique, pourtant si négligées par l’homme, ont du être pour Dieu un grand plaisir, car c’étaient les plus belles qu’il ait jamais plantées. Le continent entier était un jardin, et semblait depuis l’origine disposer de plus d’avantages qu’aucun autre parc ou jardin du globe […] Partout, sur tout ce continent béni, c’étaient beauté et mélodie avec une bienheureuse abondance, salubre et nourricière.
Les forêts américaines.
Lors d’une matinée lumineuse, du haut du col de Pacheca, un paysage se révéla : il découvrait la vallée du Yosemite, qu’il va explorer quasiment jusqu’à sa mort en 1914. Il se présentera comme un clochard poétique, un peu géologue, un peu ornithologue. Les indiens de l’Alaska le nommaient chef des glaces, et pour l’Amérique, il devint the wilderness sage – le sage des terres sauvages -. Il va devenir en 1892 président du Sierra Club, fondé à San Francisco pour explorer, embellir et rendre accessibles les régions montagneuses de la côte du Pacifique.
Kenneth White
La vallée du Yosemite était classée State Park (parc de l’Etat de Californie) depuis 1864, mais cela tenait plus du parc d’attractions que de la réserve naturelle. Il parvint à la faire classer Parc National en 1890, à l’instar du Yellowstone, qui l’était depuis 1872. C’est sous l’influence des idées et de la parole de John Muir que Theodor Roosevelt, dont l’administration se terminera en 1909, créera quarante-cinq millions d’hectares de réserves forestières et seize monuments nationaux, parmi lesquels le grand canyon du Colorado.
Dans un panthéon de figures mythologiques, il serait le dieu des enfants curieux, le dieu des enfants heureux de gambader dans l’herbe et de grimper aux arbres, il serait le saint protecteur de la joie d’aller dans le monde en courant.
Alexis Jenni. Une vie de John Muir. Éditions Paulsen 2020
Sous la plume de l’Allemand Ernst Haeckel, on voit apparaître le mot écologie : du grec oikos : maison, en l’occurrence celle qui nous est commune, la terre et logos : étude. Par écologie, on entend la partie de la science qui concerne l’économie de la nature, l’étude de l’ensemble des relations des organismes avec leur environnement physique et biologique. Le mot va en fait tomber dans l’oubli pendant une génération : c’est Warming, un botaniste danois, qui le sortira de l’oubli en 1895.
Le mot va tomber dans l’oubli, certes, mais pas vraiment la réalité qu’il nomme : en l’occurrence, c’est George Sand [1804-1876] qui se fait l’avocate de Gaïa, notre mère la Terre, s’inscrivant en droite ligne derrière Hildegarde von Bingen, Saint François d’Assise : Il y a un grand péril en la demeure, c’est que les appétits de l’homme sont devenus des besoins […] et que, si ces besoins ne s’imposent pas une certaine limite, il n’y aura plus de proportion entre la demande de l’homme et la production de la planète. Qui sait si les sociétés disparues, envahies par le désert, qui sait si notre satellite, que l’on dit vide d’habitants et privé d’atmosphère, n’ont pas péri par l’imprévoyance des générations et l’épuisement des forces de la nature ambiante ? […]
Gardons nos forêts, respectons nos grands arbres. Quand la terre sera dévastée et mutilée, nos productions et nos idées seront, à l’avenant, des choses pauvres et laides qui frapperont nos yeux à toute heure. Je sais bien que beaucoup disent : Après nous la fin du monde ! C’est le plus hideux et le plus funeste blasphème que l’homme puisse proférer… C’est la formule de sa démission d’homme, car c’est la rupture du lien qui unit les générations et qui les rend solidaires les unes des autres.
*****
L’écologie, une science en herbe ?
Je ne sais qui inventa et employa le premier le mot bizarre d’écologie mais une chose est certaine : la quasi-totalité des Français n’ayant aucune notion, même superficielle de grec ancien, aucun d’eux ne pense, en entendant ou en voyant ce mot, au grec oïkos (demeure, maison, foyer, lieu et milieu de vie) mais au mot école dont la connotation, comme disent les linguistes, est loin d’être enthousiasmante et positive. École de la nature, peut-être, donc école buissonnière mais école tout de même où tous, enfants et parents, éducateurs et éduqués, promeneurs et promenés, pollueurs et pollués, se doivent ou se devraient de retourner. Et ici je ne plaisante qu’à peine car je crois les fausses étymologies plus intéressantes et plus révélatrices que les vraies. L’inventeur du mot écologie fut un homme très doué pour les jeux inconscients du langage. Car que veut-il dire en fin de compte, ce mot fatal, si ce n’est :
1) scientifiquement : étude (ou discours) sur le milieu naturel vivant qui nous entoure et dont nous dépendons, et
2) non scientifiquement : retour à la véritable école, celle de la nature.
Ainsi, il aura fallu attendre les désastres et les constantes déprédations dus au progrès pour qu’à un âge déjà canonique, notre génération pose enfin la véritable équation de notre temps. L’équivalence majeure qui nous gouverne et nous contraint : prédation = déprédation ou, si l’on préfère : P = md2 (md2 étant le produit de la masse prédatisée par le carré de la destruction effective).
Mais revenons aux mots. J’ai dit prédation, donc prédateur. Un prédateur est un être vivant se nourrissant de proies. Mais ce terme de proie (qui vient du latin praed) n’avait à l’origine et dans les siècles qui suivirent qu’un sens strictement militaire. Il était synonyme de preneur de butin, d’enleveur de dépouilles. Ce n’est que bien plus tard qu’il prit un sens qu’on nommerait aujourd’hui écologique et désigna, au lieu du fauve humain entassant le butin des razzias, le fauve animal se nourrissant de proies vivantes. Déplacement de sens et de champ qu’il faut à nouveau corriger aujourd’hui car ce terme de prédateur convient mieux, de nos jours, à l’homme qu’à l’animal.
Que sont les prédations naturelles d’un renard comparées à celles de n’importe quel groupe de chasseurs ? Que sont celles (sur la forêt) d’un éléphant sauvage comparées à celles de n’importe quelle société de promotion immobilière du genre Paradis 2 000 ? Il est bien clair que l’homme est devenu un prédateur généralisé et original. Car il n’étend pas seulement sa prédation aux autres prédateurs animaux (ce qu’il fait depuis les origines et qui demeure, somme toute, le moins catastrophique) ni à la vie animale, végétale et même inorganique (puisqu’il est devenu prédateur d’espace, prédateur d’oxygène et d’ozone dans la haute atmosphère, voir bientôt prédateur de planètes) mais il l’étend à des domaines jusqu’alors intouchés, il devient prédateur de l’invisible, de l’immatériel, de l’immensurable, autrement dit il devient prédateur du futur.
Cette forme de prédation est à la fois récente et propre à l’homme. Jusqu’alors, ses ponctions sur l’univers se limitaient au présent et au monde immédiatement environnant. Maintenant sa prédation est généralisée, planétaire et ses ponctions se répercutent tout au long de l’espace et du temps. Et ne commençons pas à dire que tout cela remonte aux grands singes carnivores qui durent vivre de chair et de sang dans les steppes après la disparition des forêts. Traiter le futur comme la proie du présent – proie facile, innocente, prête à toutes les vorations – est le propos du nouvel homo de l’ère économique. Au point qu’il faudrait sans doute redéfinir sa condition et sa nature, le cerner non plus par ce qu’il ajouta au monde en tant qu’homo faber, homo sapiens mais au contraire par tout ce qu’aujourd’hui il lui retire en tant qu’homo praedator.
Dans son Système de la Nature, Linné dit quelque part, au début du chapitre sur l’homo sapiens, qu’il s’agit là d’une véritable réussite et qu’il lui semble que la Nature l’ait conçu dans un moment d’exaltation. Voici une phrase qui a pris une allure quelque peu exaltée. Car déjà, au temps de nos grands-pères, le doute s’insinuait dans les cervelles quant à l’utilité réelle de l’homme et donc, a contrario, quant à la nuisance réelle des nuisibles. Dans un ouvrage intitulé Notions d’histoire naturelle, destiné à l’enseignement primaire et datant de 1891, j’ai noté quelques phrases singulières. Passons sur la manie de l’époque de nommer les animaux domestiques familiers (chiens, chevaux, bœufs, rennes, chameaux) les commensaux de l’homme. Les non-commensaux, autrement dit les animaux sauvages, peuvent être utiles ou bien nuisibles. Mais à propos de ces derniers, l’auteur ajoute : Il est à remarquer que les animaux que nous nommons utiles ou nuisibles ne le sont que par rapport à nous. Car si nous les envisageons dans leur ensemble, nous verrons qu’il n’en est aucun de nuisible. Ce sont des concurrents qui nous disputent ce qu’il faut pour vivre et la Providence les met évidemment à même de se procurer les moyens de se nourrir et de perpétuer les espèces qui doivent, dans ses desseins et secrets impénétrables, échapper à toute destruction de la part de l’homme et dont sa justice se sert quelquefois pour nous châtier.
Texte désuet ou prémonitoire ? Telle était la timide écologie de nos grands-pères : une vision encore providentielle de la nature où Homme et Providence s’acharnent à faire et à défaire le monde. Mais la vision moderne, écologiste, bien que plus rationnelle et sans doute moins exaltée, est-elle véritablement scientifique ? Il suffit, dans les textes du XIX° siècle, de remplacer Providence par biotope et espèce par écotype, pour que le discours prenne une allure moderne sans rien modifier fondamentalement de son sens.
Il me semble que c’est là, non la faiblesse comme on pourrait le croire, mais la force de la vision écologique succédant à la vision providentielle de notre monde : elle s’inscrit dans l’évolution et non dans la révolution, elle continue sans le rompre vraiment le partage, le classement naïf que les anciens faisaient de la nature. Bref, quand elle sera plus assurée, qu’elle cessera d’être une science ou un discours en herbe, l’écologie deviendra certainement la seule force révolutionnaire de notre temps. Car, sans qu’on ait l’air d’y prendre garde, elle nous distille peu à peu le message redoutable : à savoir que plus on détruit le monde et moins on a d’emprise sur lui, moins on peut le changer.
Jacques Laccarière. 1977
Description du syndrome de Down, premier nom de l’actuelle trisomie 21.
La Corée n’apprécie pas les missionnaires français et leurs convertis : 9 missionnaires et 8 000 catholiques sont massacrés. En représailles, la marine française fait une descente dans un monastère sur l’île de Ganghwa et s’empare de 287 manuscrits Oé-Gyujanggak, des rituels de cérémonie religieuse et royale concernant essentiellement la dynastie Choson. La Bibliothèque nationale les laissera dormir jusqu’à ce qu’une étudiante coréenne les redécouvre en 1991 ; elle signale sa découverte à son gouvernement et celui-ci se met à les réclamer à la France qui finira en novembre 2010 par accepter de les prêter pour une longue durée à la Corée, puisque, selon la législation française les objets et œuvres figurant dans les collections de l’État sont inaliénables. Ceci découlant de l’étonnant usage qui vient couvrir le vol et la piraterie : en fait de meuble, possession vaut titre.
Depuis bien longtemps déjà, on cultive le riz dans la vallée du Pô, rive gauche. Cavour a fait creuser le canal qui va porter son nom et donner à cette céréale une importance capitale qui va faire de l’Italie le premier producteur – 60 % du total – d’Europe. Le prix est fixé à Verceil, capitale du riz italien. Avant la mécanisation, le travail, principalement exécuté par des femmes, y était rude. C’est dans ces rizières qu’est né Bella Ciao, révolte contre la dureté de ces conditions de travail. Le succès de ce chant de protestation deviendra planétaire : les Iraniennes révoltées contre les mollahs le reprendront en 2022 !
14 02 1867
La Justine, un brick français, fait route vers Cette – aujourd’hui Sète – chargée de soufre qu’elle est allée prendre en Sicile, riche de ce remède contre l’oïdium de la vigne. L’Olympia, un brick grec, venait de quitter Sète, chargé lui aussi d’un soufre qui y était raffiné, – trituration, broyage et compression – et allait à Marseille. Le temps est plus que mauvais, c’est la tempête et, dans le brouillard, les deux navires ne se voient que trop tard et ne peuvent éviter la collision : tous les deux coulent, à 300 m. de la plage des Aresquiers, sur la commune de Frontignan. Les poissons ne fréquenteront plus les lieux : ça sentait vraiment trop le soufre.
17 02 1867
L’empire d’Autriche-Hongrie devient une double monarchie héréditaire avec deux gouvernements distincts, à l’exception des ministères des Finances et de la Guerre. François Joseph devient empereur d’Autriche et roi de Hongrie.
On déclinera alors les voyelles comme suit :
| A | Austriae | ou | Austria |
| E | est | ou | erit |
| I | imperare | ou | in |
| O | orbi | ou | orbe |
| U | universo | ou | ultima |
Soit le retour sur scène du bon vieil empire sur lequel le soleil ne se couche jamais de Charles Quint et de Philippe II.
début mars 1867
Les dernières troupes françaises quittent le Mexique.
28 03 1867
Le British North America Act donne naissance au Dominion canadien, qui associe les provinces du Nouveau Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario et du Québec. Deux ans plus tard, la compagnie d’Hudson, renonçant à ses droits, apportait les territoires de l’ouest. Et deux ans plus tard encore, la Colombie britannique entrait à son tour dans la fédération. C’était la solution la plus satisfaisante trouvée pour que coexistent pacifiquement les deux communautés francophone et anglophone, sous l’aile protectrice de la monarchie anglaise. Le regroupement des Indiens à l’intérieur de réserves va être rapidement organisé. De toutes façons, il y a de la place pour tout le monde… on y est au large… les Canadiens français disent : nous on n’a pas d’histoire, mais on a de la géographie…
30 03 1867
Le tzar de toutes les Russies vend pour 7,2 millions $ l’Alaska aux États-Unis. Les Américains avaient eu 2 propositions en mains, l’une du Danemark pour acheter les îles Vierges, à l’Ouest de Porto Rico, l’autre de la Russie pour l’Alaska : toutes deux au départ au même prix. Ils n’avaient en disponible qu’un quart de la somme… il était donc exclu d’acheter les deux. Malheureusement les îles Vierges connurent dans les mois précédents un cyclone qui détruisit tout : qu’ils commencent par reconstruire se dirent les Américains, qui portèrent leur dévolu sur l’Alaska et ne s’en repentirent finalement pas : cette colonie, devenue le 49° État en 1959, fournit aujourd’hui la moitié du pétrole produit aux États-Unis… lequel pétrole avait déjà été découvert par les Russes.
Aujourd’hui, de nombreuses églises orthodoxes témoignent du passé russe du pays – les autochtones ayant trouvé dans la religion du colonisateur un ferment d’identité ; ce passé se vend par ailleurs très bien : dans les années 1970, quelques femmes se mirent en tête de créer une compagnie de danse russe… les maris rigolèrent un bon coup, mais redevinrent sérieux quand ils virent affluer les dollars rapportés par les 3 représentations par jours qu’elles donnent pour les croisiéristes à bord des paquebots de luxe en escale à Novoarchangelsk. Et quand la saison est finie, elles vont les rejoindre dans les Caraïbes pour continuer à propager la culture russe, à grand renfort de Kalinka !
1 04 1867
3° Exposition universelle, à Paris : 52 000 exposants. Victor Duruy institue la gratuité de l’enseignement primaire et met en place l’enseignement secondaire pour jeunes filles.
Que l’œuvre de Victor Duruy ait été laïque, il serait difficile de le contester, mais on s’est à l’époque profondément mépris sur la signification et l’importance de cette laïcité. Rien n’était plus sain, plus conforme aux traditions nationales que le programme de Victor Duruy. Il voulait faire des Français attachés à leur commune, à leur région, à leur métier, la tête libre, les pieds solidement fixés au sol et les mains armées de leur outils familiers (à l’inverse de Jules Ferry qui, plus ou moins consciemment, forma des citoyens du monde et non pas des Bretons ou des Lorrains)…
[…] Sans doute, sous la III° République, les conceptions idéologiques antireligieuses de Jules Ferry et de ses successeurs n’eussent-elles pas prévalu au même degré si l’instruction obligatoire et gratuite avait déjà été organisée selon les principes réalistes de Victor Duruy.
Adrien Dansette
Henri Marès, qui a découvert l’action du soufre sur l’oïdium – ou mildiou – se voit décerné à ce titre le grand prix international de l’Agriculture, conjointement avec Pasteur.
On sait ce qu’est le point vélique d’un navire ; c’est le lieu de convergence, endroit d’intersection mystérieux pour le constructeur lui-même, où se fait la somme des forces éparses dans toutes les voiles déployées. Paris est le point vélique de la civilisation. (…) Cette ville a un inconvénient. À qui la possède, elle donne le monde [5].
Victor Hugo. Introduction au Paris Guide, édité pour l’exposition
Et, la même année, il poursuivait son rêve européen : Au vingtième siècle, il y aura une nation extraordinaire. Cette nation sera grande, ce qui ne l’empêchera pas d’être libre. Elle sera illustre, riche, pensante, pacifique, cordiale au reste de l’humanité. Elle aura la gravité douce d’une aînée. Elle s’étonnera de la gloire des projectiles coniques, et elle aura quelque peine à faire la différence entre un général d’armée et un boucher ; la pourpre de l’un ne lui semblera pas très distincte du rouge de l’autre. Une bataille entre italiens et allemands, entre anglais et russes, entre prussiens et français, lui apparaîtra comme nous apparaît une bataille entre picards et bourguignons. Elle considérera le gaspillage du sang humain comme inutile. Elle n’éprouvera que médiocrement l’admiration d’un gros chiffre d’hommes tués. Le haussement d’épaules que nous avons devant l’inquisition, elle l’aura devant la guerre. (….)
Cette nation aura pour capitale Paris et ne s’appellera point la France ; elle s’appellera l’Europe. Elle s’appellera l’Europe au vingtième siècle, et, aux siècles suivants, elle s’appellera l’Humanité. L’Humanité, nation définitive, est dès à présent entrevue par les penseurs, ces contemplateurs des pénombres ; mais ce à quoi assiste le dix-neuvième siècle, c’est à la formation de l’Europe.
30 04 1867
Pierre Jean De Smet, encore une fois mandaté par les autorités de Washington pour présenter aux Indiens leurs propositions de paix, est à Sioux City. Il a rang de plénipotentiaire, avec un ordre de mission du colonel Bogy, alors en charge des Affaires Indiennes à Washington : Chacun connaît le merveilleux ascendant que vous exercez sur les tribus. Il n’est pas douteux que votre présence parmi elles est le meilleur moyen d’éviter la destruction des propriétés et le meurtre des Blancs […] Aucune instruction spéciale ne vous sera donnée. Je m’en rapporte complètement à vous pour la marche à suivre et les moyens à prendre.
Les généraux Parker et Sully se sont engagés à n’entraver en rien sa mission, une lettre du très prestigieux général Sherman, le vainqueur d’Atlanta, les y incite : Je demande qu’une assistance sans réserve soit apportée à ce prêtre catholique pour qu’il accomplisse sa mission pacifique et de bonne volonté, aussi réputé pour sa fidélité au gouvernement des États-Unis que pour son infatigable dévouement et son amour enthousiaste pour les Indiens.
De Smet obtiendra la soumission des Indiens, mais il y avait trop de Si pour que cela puisse s’inscrire dans la durée : si le gouvernement tient compte des justes réclamations des Indiens, si les annuités leurs sont régulièrement payées, si on leur fournit le matériel de construction promis, les tribus du Haut Missouri resteront en paix et les bandes hostiles cesseront leurs déprédations.
Plus que ses propres courriers, ceux des autres disent la dimension du personnage :
Fort-Rice, territoire de Cacotah, le 3 juillet 1868
Au révérend père P.J. De Smet, s.j.
Révérend père.
Nous soussignés, membres de la commission chargée de conclure la paix avec les Indiens, avons été présents à l’assemblée récemment tenue à ce fort, et désirons vivement vous exprimer notre haute appréciation des services importants que vous avez rendus, ainsi qu’au pays, par votre dévouement incessant et vos efforts couronnés de succès, pour amener les Indiens à s’aboucher avec nous et entrer en négociation avec le gouvernement. Nous sommes persuadés que nous ne devons les résultats obtenus qu’à votre long et pénible voyage jusqu’au cœur du pays ennemi, et à l’influence que vos travaux apostoliques vous ont donnée sur les tribus les plus hostiles.
Général W. S. Harney, commissaire de paix, J.-B. Sanborn, commissaire de paix. Général Alfred H. Terry, commissaire de paix.
Et une autre, d’un autre chef militaire américain à l’archevêque Purcell :
Monseigneur,
…La Commission de paix avait réussi à convoquer au mois de mai dernier sur la rivière La Platte les chefs indiens des tribus sioux les plus redoutables et belliqueuses. Mais les Unckpapagas persistaient à ne vouloir entrer dans aucun arrangement avec les Blancs, et il va sans dire que tout traité avec les Sioux devenait impossible, si cette grande et hostile tribu refusait d’y concourir… Seul de tous les Blancs, le père De Smet pouvait pénétrer chez ces cruels sauvages et en revenir sain et sauf. Un des chefs, lui adressant la parole pendant qu’il se trouvait au camp ennemi, lui dit : Si c’eût été tout autre homme que vous, Robe Noire, ce jour eût été son dernier.
Le révérend père est connu, en effet, parmi les Indiens sous le nom de Robe Noire et de l’Homme de la Grande médecine [ce qui relève du surnaturel]. Il est le seul homme auquel j’ai vu les Indiens témoigner une affection véritable. Ils disent, dans leur langage simple et ouvert, qu’il est le seul Blanc qui n’a pas la langue fourchue, c’est-à-dire, qui ne raconte jamais de mensonges…
L’accueil qui lui fut fait au camp ennemi fut enthousiaste et magnifique, où s’assemblaient plus de 3 000 Indiens […] Sitting Bull lui déclara qu’il renonçait à la guerre, et délégua plusieurs chefs pour accompagner le père à Fort-Rice où nous l’attendions… Depuis cinquante ans peut-être on n’avait vu, dans notre pays, une assemblée aussi nombreuse que celle qui se trouvait réunie à Fort-Rice. Les intérêts qu’on y devait discuter étaient bien au-delà de ce que nos amis peuvent se figurer […] Quiconque est au courant de la question indienne n’ignore pas que la paix avec les Indiens est nulle si elle ne comprend les Sioux qui, de toutes les tribus avec lesquelles nous avons eu à traiter jusqu’à ce jour, est la plus nombreuse, la plus belliqueuse et aussi celle qui a eu le plus à se plaindre des Blancs. Le traité qui a été signé par tous les principaux chefs n’attend plus que la sanction du Sénat pour passer à l’état de loi. Je suis persuadé qu’il est le plus complet et le plus sage de tous les traités conclus jusqu’ici avec les Indiens de ce pays […] Il est hors de doute que l’exécution des clauses de ce traité assurera la paix avec les Sioux. On comprendra l’importance de ce résultat si l’on considère qu’un général distingué [Sherman] estimait naguère que la guerre […] coûterait au pays 500 millions $.
Quel que soit le résultat final du traité que la commission vient de conclure avec les Sioux, nous ne pourrons jamais oublier et nous ne cesserons jamais d’admirer le dévouement désintéressé du révérend père De Smet, qui, âgé de soixante-huit ans, n’a pas hésité, au milieu des chaleurs de l’été, à entreprendre un long et périlleux voyage, à travers des plaines brûlantes, dépourvues d’arbres et même de gazon, ne rencontrant que de l’eau corrompue et malsaine, sans cesse exposé à être scalpé par les Indiens.
Major-général Stanley
Pierre Jean De Smet rendra son tablier à Saint Louis en 1870, vaincu par une néphrite qui le faisait souffrir depuis longtemps. Avec lui s’éteignait le dernier des grands VRP jésuites. Arrivé au paradis, sans escale au purgatoire, il ne formulera qu’une demande : s’il vous plait, dites- moi où sont les Indiens ?
_______________________________________________________________________________________________
[1] Nommé chancelier en septembre 1862, il était auparavant ambassadeur de Prusse en France.
[2] Pendant la guerre austro-prussienne de 1866, la France de Napoléon III n’est pas intervenue en faveur de l’Autriche. Elle a laissé la Prusse battre l’Autriche et chasser celle-ci d’Allemagne. Napoléon III se rend alors compte de la menace que la Prusse fait peser sur la France. Il demande alors des compensations pour récompenser sa neutralité passée.
La politique de Napoléon III vise à effacer les conséquences des traités de 1814 et 1815, qui avaient amputé le territoire français par rapport à la situation d’avant la révolution de 1789. Cela devrait contenter les Français et les rassembler autour du régime impérial qui est alors en difficulté à l’intérieur. Napoléon III demande d’abord beaucoup. Il veut la rive gauche du Rhin, afin d’éloigner le plus possible la Prusse de la France et d’avoir un obstacle difficile à franchir pour les Prussiens. Pendant la période révolutionnaire cette rive gauche du Rhin a été pendant longtemps annexée à la République, puis à l’Empire. Mais en 1866, les territoires réclamés appartiennent à la Bavière et à la Hesse. Les princes allemands concernés et Bismarck, le Prussien, refusent.
Napoléon III réclame alors bien moins. Il veut le retour aux frontières françaises d’avant 1814. Il souhaite récupérer les villes-places fortes de Landau et de Sarrelouis, ce qui permettrait de verrouiller un peu plus la frontière avec l’Allemagne. Il veut également acheter le Grand-Duché de Luxembourg que son propriétaire, le roi des Pays-Bas cherche à vendre. Bismarck favorise ces demandes et même propose que la France annexe la Belgique, en compensation de la possibilité pour l’Allemagne de s’unir avec les États allemands du Sud. Le Royaume-Uni s’oppose à l’annexion de la Belgique. Les États allemands sont contre l’annexion du Luxembourg qui depuis le Moyen Âge est considéré comme une terre allemande. Bismarck manœuvre alors pour faire échouer les demandes françaises. De plus la Conférence de Londres de mai 1867, déclare que le Luxembourg devient indépendant et neutre.
Les revendications territoriales françaises déplaisent aux États allemands du Sud (Grand-Duché de Bade, royaume de Wurtemberg et royaume de Bavière). Bismarck en profite pour s’en rapprocher. Il conclut avec eux des accords économiques (création d’un parlement douanier à Francfort) et militaires contre les ambitions françaises.
Napoléon III n’a rien obtenu et est humilié. Mais de plus il a poussé les États allemands du Sud à se rapprocher de la Prusse, et donc il a augmenté la menace allemande pour la France.
Wikipedia
[3] Explication de texte :
- Colback : Couvre-chef militaire d’origine turque. Sous le Premier Empire, il est plutôt réservé aux hussards et se compose d’une armature en osier recouverte de peau et de poils d’ours semblable au bonnet à poil porté par les grenadiers de la garde impériale.
- Chapkas: L’ouchanka est un chapeau traditionnel russe ou nordique, en fourrure, muni de parties rabattables qui peuvent couvrir les oreilles et la nuque, ou être relevées et nouées sur la coiffe. Dans le langage courant, on le désigne souvent sous le simple nom de chapka.
- Buffleteries: Les diverses bandes et courroies, généralement de cuir de buffle, qui font partie de l’équipement du soldat et qui servent à porter les armes et le fourniment.
- Brandebourg: Passement en forme de nœud plus ou moins sophistiqué, que l’on trouve sur les vêtements anciens, notamment sur les dolmans ou les uniformes d’officiers.
- Fourragères: Décoration récompensant une unité militaire, comme un régiment, navire, etc., ou civile, comme certains corps de sapeurs-pompiers français, pour faits de guerre ou de bravoure exemplaires
[4] Cette assemblée qui marche sur la pointe des pieds, roule son chapeau dans ses mains, sourit humblement, s’assied sur le bord de sa chaise et ne parle que quand on l’interroge. Victor Hugo
L’Histoire dira, si elle prend la peine de s’en occuper, quelle fut l’infatigable complaisance et l’incommensurable abaissement de cette première Assemblée du second Empire. L’étouffement de la parole le disputait à la prestesse du vote… Nul ne saura jamais ce que j’ai souffert dans cette cave sans air et sans jour où j’ai passé dix ans à lutter contre des reptiles. Montalembert [mais pourquoi donc n’a-t-il pas démissionné ? non seulement il en avait le droit, mais aussi le devoir. ndlr]
[5] lui-même, farouche opposant à Napoléon III le petit, était exilé depuis 1852, d’abord à Jersey, puis à Guernesey.
Laisser un commentaire