| Publié par (l.peltier) le 6 octobre 2008 | En savoir plus |
10 01 1876
On a découvert de l’or dans les Black Hills du Dakota : le gouvernement lance un ultimatum aux Indiens : tous ceux qui n’auront pas quitté les réserves avant ce 31 janvier seront considérés comme rebelles et traités en conséquence. La plupart vont se résigner.
7 04 1876
Stanley rapporte ses observations sur les sources du Nil : Du 17 janvier 1875 au 7 avril 1876, nous avons travaillé à relever les sources les plus méridionales du Nil, et à résoudre le problème incomplètement résolu par Speke et Grant, savoir si le Victoria Nyanza est, comme l’affirme Speke, un seul lac, ou s’il consiste en cinq lacs différents, comme le prétendaient divers explorateurs. Ceci a pu être fait de façon satisfaisante et maintenant Speke a toute la gloire d’avoir découvert la plus grande mer intérieure de tout le continent africain, ainsi que son principal affluent, la Kagera, et son effluent, le Nil. On doit de même lui reconnaître le mérite d’avoir compris mieux qu’aucun de ses contradicteurs la géographie des pays qu’il a traversés, et je tiens à dire toute mon admiration pour le génie géographique qui a tracé d’une main si sûre les grandes lignes des environs du lac Victoria.
Il reviendra en 1887 dans les parages, découvrant que la rivière Semliki, réunit le lac Albert au lac Édouard, et que donc, ce dernier peut-être considéré comme une des sources du Nil.
Il voudra vérifier ensuite que la rivière Lualaba, découverte par Livingstone au sud du lac Tanganyika, est bien le Congo : pour ce faire, il entreprendra sa descente avec sa petite embarcation le Lady Alice, qu’il devra bientôt abandonner : il arrivera, après mille difficultés, à l’embouchure, sur l’Atlantique en août 1877. Il doit accepter la présence de Savorgnan de Brazza sur le rive droite du Congo. L’exploit ne suscita pas l’enthousiasme en Angleterre, qui dédaigna ses propositions d’annexer pour le compte de l’Angleterre toute l’Afrique Centrale.
12 05 1876
L’Anglais Nares commande une expédition vers le pôle nord à la tête de deux navires, le Discovery et l’Alert. Il a emmené 55 chiens esquimaux et, pour les conduire un Danois du Groenland et deux esquimaux : le Danois va mourir rapidement et les chiens en feront autant pour ceux qui n’avaient pas encore déserté, en proie au piblouktou. Markham, l’un de ses hommes, parti avec 16 autres atteint 83°20′ N : le vieux record de Parry, datant de 1827, est battu.
22 05 1876
Élu sénateur le 30 janvier, Victor Hugo demande l’amnistie pour les condamnés de la Commune :
Il faut fermer toute la plaie.
Il faut éteindre toute la haine.
Quoi ! parce que, voyant des infortunes inouïes et imméritées, des lamentables pauvretés, des mères et des épouses qui sanglotent, des vieillards qui n’ont même plus de grabat, des enfants qui n’ont même plus de berceau, j’ai dit : me voilà ! Que puis-je pour vous ? À quoi puis-je vous être bon ?. Et parce que les mères m’ont dit rendez-nous notre fils ! et parce que les femmes m’ont dit : rendez-nous notre mari ! et parce que les enfants m’ont dit : rendez-nous notre père ! et parce que j’ai répondu : j’essaierai ! j’ai mal fait ! j’ai eu tort ! Non, vous ne le pouvez pas ! Je vous rends cette justice. Aucun de nous ne le pense ici. Faites grâce !
L’amnistie est refusée à la quasi unanimité : seulement huit voix pour la proposition de Hugo. Il faudra attendre 4 ans pour qu’elle soit votée, le 3 juillet 1880.
05 1876
Arthur Rimbaud s’engage dans l’armée royale des Indes néerlandaises.
Il embarque sur le vapeur Prinz van Oranje qui entre à Batavia, ancien nom de Jakarta le 23 juillet 1876. Le 15 août 1876, alors que son régiment se destine à aller combattre les troupes du sultanat d’Aceh, sur l’île de Sumatra, il s’enfuit de sa caserne, qui abrite de nos jours l’armée indonésienne. Des semaines qui suivent, il n’existe aucune trace ni récit car l’homme aux semelles de vent a cessé d’écrire, son dernier poème connu remontant à 1875. Il ne semble pas si compliqué de quitter Salatiga, bourgade de 1.000 habitants (contre 200.000 aujourd’hui) et de se cacher dans une gubuk (hutte recouverte de feuilles de noix de coco), au milieu d’une nature généreuse, au pied du volcan Merbabu.
Nager, broyer l’herbe, chasser, fumer surtout ; boire des liqueurs fortes comme du métal bouillant, comme faisaient ces chers ancêtres autour des feux. Le poète a-t-il concrétisé son rêve couché dans Mauvais sang ? Quelques semaines plus tard, il voguera vers l’Europe avant de rejoindre plus tard Chypre, puis le Yémen et l’Ethiopie. Inaugurée en 1997 sur la demeure coloniale du maire de Salatiga, une plaque rappelle que le poète français Arthur Rimbaud a séjourné à Salatiga du 2 au 15 août 1876 – Aux pays poivres et détrempés.
Géo / AFP 15 octobre 2024
La seule explication à tout cela tient sans doute au fait que c’était alors le moyen le plus économique pour voyager.
26 06 1876
Les Sioux emmenés par Tatanka Lyotake [bison en train de s’asseoir] – alias Sitting Bull -, Gall, Crazy Horse, Crow King, Rain in the Face, Twoo Moon, Bull Knife, et les Cheyennes, – 1 500 guerriers et 4 500 civils – massacrent sur les berges de Little Big Horn, dans le Montana, le 7° régiment de cavalerie du plus jeune général de l’armée, Custer, qui est tué. Mais cette défaite américaine ne change en rien leur politique : les Sioux doivent rendre les armes et accepter de vivre dans les réserves.




Sitting Bull

Korczak Ziolkowski a sculpté le chef Tasunke Witko des Oglala Lakota, surnommé Crazy Horse : Je veux tenter de corriger l’offense qui a été faite à ces gens. Il y est maintenant enterré et sa famille continue sa quête en n’acceptant que les dons et les frais d’entrée, et refuse tout financement gouvernemental. C’est, disent-ils, le plus grand monument au monde, à moins de 27 kilomètres du mont Rushmore, encore inachevé, plus de 70 ans après le début des travaux.
9 08 1876
Tramway à vapeur Montparnasse – Austerlitz.
10 08 1876
L’Américain Alfred Johnson, 30 ans, après 46 jours de mer, – il est parti le 15 juillet – en termine avec la première traversée de l’Atlantique d’est en ouest à la voile et en solitaire, avec, à la clef un chavirage qui aura duré vingt minutes. Centennial est un doris de 6.1 mètres de long, 1 grand’voile à come, 1 foc, 1 trinquette, une grande fortune carrée pour le vent arrière. Huit jours après le départ, il fera escale à Barrington, en Nouvelle Écosse, pour se débarrasser de son lest mobile en fonte dont il s’est rendu compte qu’il faussait le fonctionnement de son compas. Il déclinera plusieurs propositions d’aide de navires marchands qui le prenaient pour un naufragé, mais acceptera quand même 2 bouteilles de whisky quand il n’en avait souhaité qu’une ! Ce fut un voyage de cinglé. […] Nombreux sont ceux qui m’interrogent sur les raisons de cette traversée ; j’essaie de leur dire la vérité : si j’ai fait un tel voyage c’est parce que j’étais un damné inconscient ! Et c’est bien ce qu’ils pensent. Tous ses amis le diront à l’opposé de ce qu’il raconte là : en fait calme, réfléchi, discret, fort de n’avoir pas perdu un seul homme pendant les 27 ans de campagnes de pêche qui suivront.
 14 09 1876
14 09 1876
Le roi Léopold II de Belgique réunit le gratin des explorateurs pour préciser ses projets en matière de colonisation : Où ? Quand ? Combien ? Pourquoi, c’est pas la peine, il le sait.
Léopold II, jeune roi impétueux réunit trente-cinq explorateurs, géographes et hommes d’affaires issus des quatre coins de l’Europe pour faire le point sur la situation en Afrique centrale. Officiellement, son but était de mettre un terme à la traite afro-arabe des esclaves et de faire progresser les sciences, mais ses proches savaient qu’il voulait lui-même se tailler une grosse part de ce magnifique gâteau africain. La colère que suscitait chez lui le commerce des esclaves était d’ailleurs sélective : il ne parla jamais du trafic d’êtres humains à grande échelle auquel certains Occidentaux s’étaient eux aussi livrés peu de temps auparavant et qui à l’époque se poursuivait encore sur place ici et là. Cette conférence allait devenir célèbre. Des aventuriers venus de toute l’Europe et qui d’habitude, la chemise trempée de sueur, vagabondaient dans les tropiques furent logés pendant quatre jours au palais royal. Ils dînèrent avec le roi et son épouse et circulèrent dans les rues de Bruxelles dans d’élégants fiacres. Parmi eux se trouvait Lovett Cameron, l’homme qui avait traversé l’Afrique centrale d’est en ouest à travers la savane, au sud de l’équateur, Georg Schweinfurth, qui avait fait d’importantes découvertes dans les savanes au nord de la forêt équatoriale, et Samuel Baker, qui avait approché le territoire depuis le cours supérieur du Nil. Ces dernières décennies, des progrès considérables avaient été accomplis dans l’exploration de l’Afrique.
Jusqu’en 1800 environ, le continent pourtant le plus proche de l’Europe était, de tous, celui que les Européens connaissaient le moins. Depuis le XVI° siècle, des navires marchands portugais, néerlandais et britanniques en route pour les Indes s’étaient plus ou moins familiarisés avec les côtes, mais l’intérieur des terres en Afrique était resté pendant des siècles terra incognata. L’exploration n’allait pas plus loin que l’implantation de quelques petites factoreries européennes sur la côte ouest. Au début du XIX° siècle, l’Afrique était un des deux grands espaces vides sur la carte du monde de l’époque, l’autre était l’Antarctique. La région de l’Amazone était alors déjà en grande partie cartographiée
Soixante-quinze ans plus tard, cependant, les cartographes européens avaient une idée assez précise de l’emplacement des oasis, des routes des caravanes et des oueds du Sahara. Ils localisaient avec exactitude les volcans, les montagnes et les rivières dans la savane de l’Afrique méridionale. Les esquisses sur leur table à dessin se remplirent vite de noms de lieux exotiques et de peuples. Mais au centre de la carte sur laquelle se penchèrent les participants à la conférence de Bruxelles en 1876, il n’y avait qu’une grande tache blanche. Ils n’en avaient fait que le tour. On aurait dit une plaine dépourvue de nom, sans mots ni couleurs pour la décrire, un vide béant recouvrant pas moins d’un huitième du continent. Elle était tout au plus parcourue par une ligne en pointillé hésitante et incurvée. Cette tâche, c’était la forêt équatoriale. Cette ligne en pointillé mal dessinée, c’était le fleuve Congo.
Tandis qu’à Bruxelles on discutait et on allait au théâtre aux frais du roi, Stanley traversait l’Afrique centrale. Le 14 septembre 1876, le jour où Léopold clôtura la conférence, Stanley quittait la rive ouest du lac Tanganyika pour faire une percée jusqu’au cours supérieur du Congo. S’il y a bien un jour où le sort politique de la région fut, sinon scellé, du moins en grande partie décidé, ce fut celui-là. C’était alors certainement le cadet des soucis de Stanley (il avait plus à craindre de la forêt humide, des indigènes et des marchands d’esclaves), mais en entamant cette étape, il allait trouver le mystérieux fleuve qui devait le conduire à travers la forêt équatoriale prétendument impénétrable de l’Afrique centrale. À Bruxelles, il fut décidé ce jour-là de créer une union internationale, l’Association internationale africaine (AIA), pour désenclaver la région en question en créant un certain nombre d’implantations. L’association avait des comités nationaux, mais elle était présidée par Léopold.
La nouvelle de la traversée de Stanley fit en Europe l’effet d’une bombe. Le roi Léopold comprit aussitôt que Stanley était l’homme qu’il lui fallait pour réaliser ses ambitions coloniales. Il dépêcha, en janvier 1878, deux envoyés à Marseille pour l’attendre et le convoquer au palais royal à Laeken. De son côté, Stanley, en tant que Britannique, tenta d’abord de convaincre l’Angleterre de l’intérêt de son aventure mais, après son échec à Londres, il finit par accepter l’invitation de Léopold. Ils parlèrent longuement des projets. Le roi manifesta un tel enthousiasme pour l’entreprise que la reine se demanda ce qu’il allait advenir de lui s’il se ruinait pour cette folle chimère. Le premier secrétaire de I’AIA se plaignait auprès de la reine : Madame, arrêtons cela – je ne puis plus rien, je ne fais plus que me quereller avec Sa Majesté, mais il travaille derrière mon dos avec des filous. J’en deviendrai fou! Et le roi se ruine, mais se ruine à plat.
C’était peine perdue. Le souverain n’en faisait qu’à sa tête : en 1879, Stanley repartit pour l’Afrique centrale, cette fois aux frais de Léopold, pour une période de cinq ans. L’explorateur allait à présent voyager en sens inverse, d’ouest en est, en remontant le courant. Ce n’était pas la seule différence. Le voyage de Stanley de 1879 à 1884 était fondamentalement différent de celui de 1874 à 1877. La première fois, il avait voyagé pour le compte d’un journal, désormais il le faisait pour le compte de l’association internationale de Léopold. La première fois, il avait dû se débrouiller pour arriver le plus vite possible de l’autre côté de l’Afrique, à présent il devait créer en route des postes ici et là – une activité qui prenait du temps. Non seulement il devait négocier avec les chefs locaux, mais il devait trouver des effectifs pour occuper ces postes. La première fois, il était aventurier et journaliste, à présent il était diplomate et fonctionnaire.
[…] Pour fonder une implantation, Stanley et ses assistants avaient conclu des contrats avec les chefs locaux. C’est ainsi que procédaient depuis des siècles les commerçants européens à l’embouchure du Congo. En contrepartie d’une somme versée périodiquement, ils pouvaient s’installer sur un terrain. Ils louaient un lopin de terre. […]. Une telle entreprise donnait souvent lieu au préalable à des journées entières de palabres. À partir de 1882, cependant, Léopold estima qu’il fallait aller plus vite. Son association philanthropique internationale s’était à présent transformée en une entreprise commerciale privée à capitaux internationaux : le Comité d’études du Haut-Congo (CEHC). Ses agents devaient s’efforcer d’obtenir de plus grandes concessions, en bien moins de temps et préférablement de manière définitive. Au lieu de négocier longtemps pour se contenter du droit de louer une petite parcelle, ils devaient désormais acheter des régions entières à un rythme effréné. Mais cela ne suffisait pas non plus : Léopold ne cherchait pas seulement à acheter des terres, il voulait aussi obtenir tous les droits sur ces terres. Son initiative commerciale devenait un projet manifestement politique : Léopold rêvait d’une confédération de souverains indigènes qui dépendraient de lui. Dans une lettre à un collaborateur, il ne laissait planer aucun doute : La lecture des traités conclus par Stanley avec les chefs ne me satisfait pas. Il faut y ajouter au moins un article portant qu’ils nous délèguent leurs droits souverains sur les territoires […] Ce travail est important et urgent. Il faut que ces traités soient aussi courts que possible et qu’en un article ou deux, ils nous accordent tout.
David Van Reybrouck. Congo. Une Histoire. Actes Sud 2012
1876
Explosion de grisou à Saint Étienne : 216 morts. Dissolution de la 1°Internationale.
Charles Tellier arme le Frigorifique, trois mâts de 650 tonnes qui met 105 jours pour relier Buenos Aires à Rouen avec une cargaison de viande. C’est à Milan qu’est mis en service le premier crématorium.
On trouve dans les effectifs de l’armée coloniale néerlandaise des Indes un jeune homme de 22 ans : Arthur Rimbaud : il ne va pas s’y attarder.
Henry Wickham, botaniste, vivote en Amazonie dans une modeste ferme à Santarém, quand le Jardin botanique de Kew à Londres lui passe commande de graines d’Hévéa, payés 10 livres sterling le lot de 1 000 graines : si on a besoin d’argent, à ces conditions, on se met au travail, ce qu’il fit immédiatement sur le haut Tapajos, affluent rive droite de l’Amazone, proche de l’embouchure. Il envoie des milliers de graines en 1874 et en 1875, mais c’est un échec total : ces graines ont une courte durée de vie et ne supportent pas les 30 jours environ que mettent les voiliers pour traverser l’Atlantique. Mais en février 1876 est inaugurée la ligne Liverpool-Manaus avec un navire à vapeur qui réduit de moitié la durée du voyage : sur les 70 000 graines envoyées, 2 800 germeront : 4 % ! Dans le monde des botanistes de cette époque on considère cela comme un grand succès. Henry Wickham dans ses relations préfère passer pour un voleur célèbre que pour un inconnu honnête, et ça marche, car encore aujourd’hui au Brésil, on le prend pour un voleur de caoutchouc : il prétend n’avoir déclaré en douane que d’innocentes orchidées destinées à la reine Victoria, mais c’est faux : il n’y a eu aucune fausse déclaration pour la bonne et simple raison qu’il n’existait pas alors de réglementation au Brésil interdisant l’exportation de graines d’hévéa, lesquelles se sont donc faites avec la bénédiction et la célérité des douanes brésiliennes ! Probablement voulait-il être intégré dans le club très fermé des voleurs de grains de café ou de vers à soie… les anglais adorent les clubs…
Les jeunes plants vont être transportés dans des Wardian cases à Colombo, d’où elles repartiront pour Calcutta, Singapour et Ceylan où elles se trouveront tellement bien qu’elles mettront ainsi fin à l’âge d’or du caoutchouc en Amazonie. Pour être plus précis, l’affaire fut plus compliquée qu’il n’y parait, car, si les plants s’acclimatèrent très bien, il fallut par contre beaucoup de temps pour que les planteurs locaux acceptent le nouveau venu avec une réflexion apparemment de bon sens : pourquoi nous donner du mal à cultiver ces arbres quand ils poussent à l’état naturel en Amazonie ? Le succès vint de Henry N. Ridley, jeune botaniste anglais qui venait d’être nommé directeur du Jardin botanique de Singapour. Il démontra qu’il était possible, contrairement à ce que pensaient les Brésiliens, de saigner de jeunes arbres, n’ayant que 4 ans, et qu’une saignée quotidienne stimulait la production de latex. Il démontra encore, qu’à l’échelle industrielle, le latex pouvait être coagulé à l’acide acétique, ce qui se fait encore de nos jours. En 1900 arriva sur les docks de Londres la première cargaison de 4 tonnes de caoutchouc de Malaisie : dix ans plus tard, la Malaisie aura planté 40 millions d’arbres, faisant travailler des centaines de milliers de Chinois et Tamouls. Macintosh peut lancer ses imperméables, Dunlop ses pneumatiques, Henry Ford sa Ford T : les profits ne seront pas pour le Brésil.
Larousse crée le premier logo : la dent-de-lion, nom usuel du pissenlit, orné de la devise due à l’architecte, décorateur Emile Reiber : Je sème à tout vent. Le passage de la dent-de-lion à la Semeuse est le fait de Georges Moreau et Eugène Grasset, en 1890. Quant à la Semeuse de nos pièces, on la devra à Roty en 1897.
La reine Victoria prend le titre d’Impératrice des Indes : jusque là seulement reléguée dans l’ombre depuis l’installation de l’East Indies Company, la dynastie des Grands Mogols disparaît officiellement.
Un cyclone ravage le golfe du Bengale et le delta du Gange : les mâts des navires à 300 km de son cœur sont arrachés. Une vague de 15 mètres dévaste 141 km² et tue 215 000 personnes.
Richard Wagner fonde pour sa seule gloire le festival de Bayreuth, où il a fait construire avec l’argent de Louis II de Bavière le Festspielhaus.
Au Japon, l’heure de la fin a sonné pour les samouraïs : Un édit leur interdit de porter les sabres qui font leur fierté et leur honneur depuis des siècles. Il est aussi prévu de leur retirer la rente héréditaire qui leur était versée pour la remplacer par un misérable petit salaire. Avec la vieille classe aristocratique, privée de toute influence depuis que les shoguns sont sortis de la scène, les guerriers sont les grands perdants de la grande course modernisatrice. Pour une partie d’entre eux, c’en est trop. En 1877, retranchés dans une province du sud, ils déclenchent une dernière révolte. Elle est vite réprimée et tient du baroud d’honneur. Après environ sept cents ans d’existence, l’orgueilleuse caste disparaît. Ses derniers membres, ruinés, sont obligés de se tourner vers les plus humbles petits métiers. Si l’on en croit une des salles du magnifique musée de l’histoire d’Edo à Tokyo, c’est à des samouraïs en recherche de reconversion qu’on doit l’invention du rickshaw, le fameux pousse-pousse qui allait se répandre sur toute l’Asie.
François Reynaert. La grande histoire du monde. Fayard 2016
24 04 1877
Les slaves de l’empire ottoman se sont soulevés dans un passé proche, en Bosnie Herzégovine en 1875, et en avril 1876, en Bulgarie, où la répression ottomane a fait 15 000 morts. C’en est trop pour les Russes qui déclarent la guerre à l’empire ottoman ; elle est menée sur deux fronts, dans le Caucase et dans les Balkans. Le 19 janvier les Turcs, défaits signent un armistice à Andrinople, qui va mener au traité de San Stéfano, qui reconnait la suprématie de la Russie dans les régions de l’empire ottoman à majorité slave et orthodoxe. Serbie, Monténégro, Bulgarie, deviennent indépendants, cette dernière s’agrandissant de la Macédoine pour devenir la Grande Bulgarie.
17 06 1877
Le peuple Numipu, nommé Nez Percés par les Blancs, vit paisiblement dans la vallée de Wallowa, affluent de la rive gauche de la Snake River, via la Grande Ronde River, se consacrant à l’élevage du meilleur cheval qui soit : l’Appaloosas. Mais les Blancs ont décidé que cela ne pouvait durer et les ont sommés de déguerpir. Va s’ensuivre une poursuite de quatre mois : 800 Indiens, emmenés par leur chef Tonnerre qui roule dans la montagne, nommé Chef Joseph par les Blancs, vont parcourir près de 2 000 km dans les Rocheuses pendant quatre mois ; épopée faite d’escarmouches, de véritables batailles, d’embuscades, des pentes de White Bird Cañon à Clearwater River, de Lolo Pass à Big Hole River, de Tongher Pass au Yellowstone, de Cañon creek au Missouri. Les guerriers indiens vendront très chèrement leur peau. Parvenus près de la frontière canadienne, 300 d’entre eux parviendront à y rejoindre Sitting Bull et les siens : Chef Joseph se rendra le 5 octobre 1877, à Miles – il était à 70 km de la frontière canadienne -. Sitting Bull mourra le 15 décembre 1890 lors d’une fusillade près de Grand River : Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l’argent ne se mange pas.
*****
Je suis fatigué de me battre. Nos chefs ont été tués. Looking Glass est mort. Too-Hul-Hul-Sote est mort. Tous les anciens sont également morts… Celui qui dirigeait nos jeunes gens, Ollokot, est mort. Oh ! il fait si froid et nous n’avons pas de couvertures. Nos petits enfants meurent de froid. Certaines personnes parmi mon peuple se sont enfuies dans les collines, elles n’ont ni couverture ni nourriture. Personne ne sait où elles sont allées, peut-être sont-elles déjà mortes de froid. Je veux qu’on me laisse du temps pour rechercher mes enfants, et voir combien je peux en retrouver vivants. Il se peut que je les retrouve parmi les morts. Écoutez-moi, dites au Général Howard que je connais son cœur. Le mien est triste et tourmenté. À partir de ce jour, de l’endroit où se tient le soleil, je ne combattrai plus jamais !
Ils seront envoyés au Kansas puis en Oklahoma. avant de pouvoir revenir dix ans plus tard près de la Wallowa. Joseph s’adressa au Congrès : If I can not go to my own home, let me have a home in some country where my people will not die so fast.
Chef Joseph
16 08 1877
Gaspard fait la première de la Meije, 3 982 m, par le glacier des Étançons, face Sud, avec son client, le baron Boileau de Castelnau, résidant au Mas du Bouet, tout à coté de Montpellier. La concurrence était rude, surtout de la part du Révérend Coolidge qui tentait aussi l’ascension par la face nord. Gaspard dût descendre de Saint Christophe en Oisans à Bourg d’Oisans pour télégraphier au baron de venir le plus vite possible faute de quoi Coolidge arriverait le premier. La descente ne fût pas évidente : bivouac en altitude, dans la tempête. On ne connaissait pas encore la technique du rappel qui permet de récupérer sa corde (ce sera pour l’année suivante), et donc, chaque fois qu’il était nécessaire d’utiliser une corde, celle -ci restait sur place… à la fin les longueurs étaient insuffisantes…
Gaspard, premier guide de l’Oisans, était un personnage. Son père était troupelier, – berger spécialisé dans la transhumance des moutons -; dans le cas présent il s’agissait de la transhumance entre la haute vallée du Var, où il résidait le plus souvent (à Châteauneuf d’Entraunes) et l’Oisans. Un jour, son père, fatigué de voyager, posa son sac en Oisans. Cela signifiait que la famille avait peu de bien, et donc que les bouches étaient encore plus difficiles à nourrir que chez les pays, installés là depuis longtemps. D’où l’attirance de Gaspard pour cette activité de guide qui permettait d’arrondir les fins de mois et de se détourner de ses activités de paysan pour lesquelles il n’éprouvait guère d’attrait. Devenu une autorité morale certaine, il continua le plus longtemps possible à courir la montagne. Il fit sa dernière ascension de la Meije à 77 ans.

7 12 1877
L’inventeur américain Thomas Edison[1] présente pour la première fois en public le phonographe. Son appareil enregistre les vibrations sonores grâce à un stylet qui les grave sur un cylindre tournant en étain. Il permet aussi – et voilà la nouveauté – de les reproduire, les gravures étant ensuite restituées en sons par un diaphragme. Déposant dans la foulée le brevet de son invention, Edison prend de court Charles Cros, fameux poète et savant lagrassien. Ce dernier avait imaginé un appareil similaire, – le paléophone -, dont il avait déjà envoyé une description à l’Académie des sciences à Paris mais dont aucun prototype n’avait été construit, faute d’avoir pu réunir les fonds nécessaires. Le paléophone ainsi relégué dans l’ombre puis dans l’oubli, le phonographe et ses avatars successifs, de plus en plus maniables et perfectionnés, connaîtront un succès planétaire, du gramophone au lecteur numérique en passant par le tourne-disque.
1877
La France récupère l’île de St Barthélemy, qui appartenait à la Suède depuis 1784. Fondation de la Société des architectes diplômés du gouvernement. Implantation de la Société alsacienne de constructions mécaniques à Belfort ; la première locomotive sortira en 1881. Elle s’associera en 1928 avec la Compagnie Française Thomson Houston pour devenir l’Alsthom [2].
Ferdinand Carré invente le froid industriel : machine frigorifique à compression en 1857, machine à absorption à marche en continu en 1860, utilisation d’ammoniac comme fluide frigorigène et l’eau comme absorbant : il commence à importer de la viande d’Argentine : le succès n’est pas au rendez-vous : la congélation n’est pas en cause, mais la saveur de la viande. L’achèvement à Porto du viaduc ferroviaire Maria Pia sur le Douro consacre la réputation internationale de Gustave Eiffel.

Et, pendant que l’on est à Porto, allons donc faire un tour à la très belle gare de chemin de fer, c’est à deux pas :


Azulejos de la gare de São Bento : Henri le Navigateur à la conquête de Ceuta.
Thomas Edison et Charles Cros inventent le téléphone. Nikolaus August Otto invente le 1° moteur à combustion interne à 4 temps.
Constantin Fahlberg, [1850-1910] chimiste russe-allemand, analyse les composés chimiques du goudron de houille pour le professeur Ira Remsen (1846-1927) à l’université John Hopkins de Baltimore de Baltimore. Un soir où, retardé par ses travaux, il est passé à table sans même prendre la précaution de se laver les mains, il s’aperçoit que le pain lui paraît sucré, le vin idem et même ses doigts : au cours de ses expériences il a synthétisé par inadvertance l’acide anhydroorthosulphaminebenzoique, un corps chimique auquel il donnera ultérieurement le nom commercial de saccharine, le tout premier des édulcorants.
Le phare d’Eddystone, dans la Manche, à la limite territoriale entre la Cornouaille et le Devon, au sud-sud-ouest de Plymouth par 50°10’48″ N, 4°15’54″O, construit sur le sommet d’une chaîne de granite sous-marine, est démonté pour être remonté sur la côte : les tempêtes le faisaient osciller de façon si importante qu’on commençait à craindre qu’il ne s’effondra un jour où l’autre. C’est un Monsieur Smeaton qui avait pris l’initiative de sa construction : Pour donner une idée des obstacles qui s’opposaient à l’entreprise de Smeaton en 1756, il suffira de dire que dans les mois les plus calmes de l’année dans les périodes les plus importantes du travail dans lesquelles les matelots et les ouvriers étaient pressés d’aborder par le puissant motif d’un paiement à tant par heure, M Smeaton et tout son monde sont souvent demeurés huit jours, quelquefois dix ou quatorze et une fois dix-huit jours consécutifs à l’ancre devant le rocher sans pouvoir en tenter l’abordage quoique la mer ne fût point fortement agitée. Il prenait la suite de deux autres phares ; les travaux du premier avaient commencé en 1696 pour être opérationnel en 1698 : c’était une structure octogonale en bois qui résista le premier hiver mais eut ensuite besoin de réparations et fut remplacé par une structure dodécagonale – 12 faces – en bois avec un parement de pierre et une lanterne octogonale au sommet : la tempête du 27 novembre 1703 aura eu raison de tout cela. Le second fut construit par John Rudyard : un cœur en pierre et briques entouré d’un revêtement conique en bois. Opérationnel en 1705, il résista aux assauts de la mer pendant 50 ans, mais le 2 décembre 1755, le haut de la lanterne prit feu ! et on s’estimera heureux d’avoir pu récupérer vivants les gardiens. Le troisième, celui de Smeaton, sera construit en blocs de granite avec assemblage en queue d’aronde et en utilisant pour la première fois la chaux hydraulique, une sorte de béton qui durcit sous l’eau. Il mesurait 18 mètres de haut. Mais les plus grosses mers le faisaient osciller sur sa base et on le démonta en 1877 pour le reconstituer sur la côte. Un quatrième phare, construit par James Douglass, sera opérationnel en 1888 : 49 mètres de haut, en pierre de taille – gneiss du précambrien -. Équipé ultérieurement d’une plate-forme pour hélicoptère, il sera automatisé en 1982.
Parution du Tour de France par deux enfants, de G. Bruno, livre de lecture des enfants de l’école primaire, depuis 1877, vendu à 55 000 exemplaires en 1877, 136 000 en 1878, à peu près 550 000 par an entre 1879 et 1910, à l’heure actuelle pas loin de 9 millions au total, représentant 30 millions de lecteurs. Ce livre a été LE best-seller de la fin du XIX° siècle, d’un moralisme asphyxiant, jouant très habilement d’une apparente neutralité en matière de religion. G. Bruno était le pseudonyme de Madame Alfred Fouillée, née Augustine Tuillerie, femme d’un recteur d’Académie, philosophe à ses heures perdues, qui ne cachait pas ses sympathies pour certains anthropologistes dénonçant la dégénérescence de la race aryenne. (Revue des Deux Mondes 1895) : Seules les races européennes sont capables du plus haut développement intellectuel et social …/… en raison de la loi de régression, les croisements entre races très différentes ont pour conséquence de ramener à la surface les traits inférieurs souvent disparus. Alfred Fouillée s’est gagné à cette époque aux yeux de quelques gens qui comptent le rôle de Parrain intellectuel de la III° République. Mazette !
Il n’est pas impossible que Madame Fouillée ait pris le principe de son livre… en Allemagne, où Guillaume de Humboldt, ministre de l’enseignement en Prusse dans les années 1830, avait mis en place l’enseignement de la géographie en publiant des livres scolaires qui reproduisaient les paysages d’Allemagne.
Sans l’immense battage scolaire en cours – à croire que l’école n’avait été fondée que pour fomenter la revanche ! – le deuil de 1870 aurait été à peu près accompli. Pour les garçons de moins de trente ans, qui avaient appris à la fois la lecture et le français dans Le tour de France par deux enfants, l’école avait entretenu le flambeau de la haine nationale. Ce livre culte racontait dans une langue insipide les tribulations de deux frères alsaciens chassés de leur chère patrie par les odieux envahisseurs. La conscription obligatoire en avait avivé la flamme dans l’horreur du Teuton.
Claude Duneton. Le Monument Balland 2003

Cette haine du boche se développe aussi dans la chanson, dont certaines rencontrent un grand succès :
Le fils de l’Allemand.
Paroles de Gaston Villemer et Lucien Delormel. Musique de Paul Blétry.
Près de la nouvelle frontière
Un officier s’est arrêté,
À la porte d’une chaumière
Il frappe avec anxiété.
Une femme, dont la mamelle
Allaite un gentil chérubin,
Ouvre en demandant : Qui m’appelle ?
Et voit l’uniforme prussien.
Femme – dit l’officier – écoute ma prière,
Pour lui donner ton lait, je t’apporte un enfant.
Dis-moi si tu consens à lui servir de mère ;
Moi, je suis un soldat du pays allemand.
Ce fils, sur la terre lointaine,
M’est né d’hier et, sans compter,
Je paierai tes soins et ta peine,
Car je suis tout seul à l’aimer.
Vois, sa figure est rose et blonde,
Tu peux le sauver du trépas ;
Sa mère, en le mettant au monde,
Vient de mourir entre mes bras.
J’avais un fils – dit la Lorraine –
Blond chérubin comme le tien,
Mon homme et moi tenions la plaine
Devant un régiment prussien ;
Quand tes soldats saouls de carnage
Mirent le feu à mon hameau
Et, sans pitié pour son jeune âge,
Tuèrent l’enfant au berceau !
Passe ton chemin, ma mamelle est française,
N’entre pas sous mon toit, emporte ton enfant !
Mes garçons chanteront plus tard La Marseillaise,
Je ne vends pas mon lait au fils d’un Allemand.
Et encore une autre, de Paul Déroulède :
Le Clairon
Créée par Amiati à l’Eldorado, vers 1873. Paroles de Paul Déroulède, musique d’Émile André.
L’air est pur, la route est large,
Le Clairon sonne la charge,
Les Zouaves vont chantant,
Et là-haut sur la colline,
Dans la forêt qui domine,
Le Prussien les attend – Variante : « On les guette, on les attends. »
Le Clairon est un vieux brave,
Et lorsque la lutte est grave,
C’est un rude compagnon ;
Il a vu mainte bataille
Et porte plus d’une entaille,
Depuis les pieds jusqu’au front.
C’est lui qui guide la fête
Jamais sa fière trompette
N’eut un accent plus vainqueur ;
Et de son souffle de flamme,
L’espérance vient à l’âme,
Le courage monte au cœur.
On grimpe, on court, on arrive,
Et la fusillade est vive,
Et les Prussiens sont adroits – Variante : « Et les autres sont adroits. »
Quand enfin le cri se jette:
» En marche! À la baïonnette ! »
Et l’on entre sous le bois.
À la première décharge,
Le Clairon sonnant la charge
Tombe frappé sans recours ;
Mais, par un effort suprême,
Menant le combat quand même,
Le Clairon sonne toujours.
Et cependant le sang coule,
Mais sa main, qui le refoule,
Suspend un instant la mort,
Et de sa note affolée
Précipitant la mêlée,
Le vieux Clairon sonne encor.
Il est là, couché sur l’herbe,
Dédaignant, blessé superbe,
Tout espoir et tout secours ;
Et sur sa lèvre sanglante,
Gardant sa trompette ardente,
Il sonne, il sonne toujours.
Puis, dans la forêt pressée,
Voyant la charge lancée,
Et les Zouaves bondir,
Alors le clairon s’arrête,
Sa dernière tâche est faite,
Il achève de mourir.
Les enfants nés à la fin du second empire ont été nourris de cette culture de haine. Adulte, on n’oublie pas l’affectif de son enfance. Ils auront à peu près cinquante ans à la première guerre mondiale… Cinquante ans, c’est l’âge où, dans l’armée, les officiers ont un grade de commandement, de commandant à général. Ce sont ces gens-là qui enverront au massacre des milliers de fantassins, sans aucune considération pour le prix de la vie humaine, très souvent en pure inutilité, pour gagner quelques tranchées, parfois rien du tout, faisant vivre à ces hommes un enfer dont nul n’a plus idée aujourd’hui. Alphonse Boudard persiflera : Verdun leur manquait comme la Villa Médicis aux artistes.
On ne saurait parler du Tour de France de deux enfants, bréviaire laïque à usage familial, sans parler des manuels Lavisse à usage scolaire. Ernest Lavisse, [1842-1922] tête pensante de l’Histoire de France, directeur de l’École Normale Supérieure, avait écrit une Histoire de la France depuis les origines jusqu’à la Révolution, publiée en 1901, et une Histoire de la France contemporaine depuis la Révolution jusqu’à la paix de 1919, publiée en 1920-1922. On peut considérer comme des versions simplifiées ses manuels scolaires qui régnèrent sur l’enseignement de l’Histoire en France de 1876 à 1946. On y trouve une France réconciliée avec elle-même, reconnaissance étant faite aux Rois de leurs mérites, mais étant entendu que le début de l’âge adulte de la France ne commençait qu’avec la Révolution Française. L’homme et son œuvre y gagneront les surnoms plutôt gentils d’Instituteur nationale et de Bréviaire civique.
Des témoins viendront confirmer cette amère tristesse de la France : l’Écossais Robert Louis Stevenson qui fait les rivières et canaux du nord de la France en canoë en 1878 : Il y a quelque chose de bien pathétique dans l’amour des gens de France, depuis la guerre, pour les sombres chants patriotiques mis en musique. J’ai observé un garde forestier originaire de l’Alsace, pendant que quelqu’un chantait Les malheurs de la France, à une réunion de baptême aux environs de Fontainebleau. Il se leva de table et, prenant son fils à part, auprès de l’endroit où j’étais moi-même: Écoute, écoute, dit-il, posant sa main sur l’épaule du garçon, et souviens-toi de ceci, mon fils ! L’instant d’après, il sortit brusquement dans le jardin, et je pus l’entendre sangloter dans l’obscurité.
L’humiliation de ses armes et la perte de l’Alsace et de la Lorraine ont porté un coup cruel à l’endurance de ce peuple sensitif. Et les Français ont encore le cœur enflammé de colère, non point tant contre l’Allemagne que contre l’Empire. En quel autre pays verrait-on une chanson patriotique amener tout le monde dans la rue ? mais l’affliction exalte l’amour et nous ne sentirons bien que nous sommes Anglais que si nous perdions les Indes. L’Amérique indépendante reste toujours le point crucial de mon existence Je ne puis songer au fermier Georges (Washington ndlr) sans aversion. Et l’ardeur de mes sentiments à l’égard de la patrie n’est jamais mieux réchauffée qu’à l’aspect de la bannière aux bandes étoilées et quand je me rappelle ce qu’aurait pu être notre empire.
Le petit recueil du marchand ambulant, que j’ai acheté, formait un curieux mélange. Côte à côte avec de lestes et immodestes inepties de cafés concerts parisiens, se trouvaient maintes pièces pastorales non dépourvues, à mon sens, d’une teinte de poésie et l’instinct de cette noble indépendance qui caractérise les classes des plus humbles des Français. Vous y pouviez lire à quel point le bûcheron est fier de sa cognée, et comme le jardiner dédaigne d’avoir honte de sa bêche. Elle n’était pas très bien écrite cette poésie du travail, mais la cordialité du sentiment compensait la faiblesse et la prolixité de l’expression. D’autre part, les morceaux guerriers et patriotiques étaient tous, sans exception, des productions trémulantes et larmoyantes. Le poète avait passé sous les fourches caudines, il chantait pour une armée qui, la fortune contraire, pèlerinait au tombeau de son antique renommée, il ne chantait pas la victoire mais la mort. Dans le cahier de l’ambulant, il y avait un numéro intitulé Conscrits français qui peut prendre rang parmi le lyrisme de guerre le plus démoralisant dont on ait gardé la mémoire. N’importe quel homme en un pareil état d’esprit serait dans l’impossibilité absolue de se battre. Le plus brave conscrit pâlirait, si l’on entonnait à ses côtés de tels couplets au milieu de la bataille. Des régiments entiers mettraient bas les armes, rien que d’en entendre l’air.
Si Fletcher de Saloun (jurisconsulte écossais ndlr) a raison, quand il insiste sur l’influence exercée par les chants nationaux, on en doit conclure que la France se trouvait dans une triste impasse. Mais du mal sortira le remède opportun : des gens au cœur sain et vaillant se fatiguent à la longue de geindre sur leurs désastres. Déjà Paul Déroulède a écrit quelques virils poèmes militaires . Ils ne contiennent peut-être pas beaucoup de ces vibrations qui émeuvent l’intime du cœur humain : l’élévation lyrique leur fait défaut ; leur mouvement manque d’allégresse, mais ils sont écrits dans un grave, honnête et stoïque esprit qui pourrait exalter des soldats d’une bonne cause. On a l’impression qu’on se fierait volontiers à Déroulède. Ce serait un bonheur, s’il réussissait à persuader ses compatriotes qu’ils ont en main leur propre avenir. Et, en attendant, son œuvre contient un antidote à Conscrits français et à d’autres moroses versifications.
Robert Louis Stevenson. En canoë sur les rivières du Nord. 1878
37 millions d’habitants, (dont 2 à Paris) ; la natalité est de 22 ‰ (33 en Allemagne et Angleterre), la mortalité de 18 ‰. Les idées de planning familial et contraception commencent à faire leur chemin.
C’est une crise qui angoisse les gouvernants de la Troisième République. Non seulement on fait de moins en moins de bébés dans l’Hexagone, mais en plus, on en fait moins que nos voisins. Assimilée à une forme de décadence morale, cette dépopulation est très sensible au long du XIX° siècle, puisque la poussée démographique n’est que de 23% en France entre 1820 et 1870, contre 48% en Grande-Bretagne et 57% en Allemagne.
Résultat: la France ne compte que 39 millions d’habitants en 1900, ce qui est loin de rivaliser avec l’Allemagne (56 millions) et la Russie (126 millions). Pourquoi cet essoufflement? Plusieurs hypothèses sont avancées: forte mortalité infantile, épidémies et insalubrité liées à l’industrialisation récente, alcoolisme, malnutrition, impact de la guerre de 1870, etc.
Mais les politiciens ne s’intéressent pas tant aux causes de la crise démographique qu’à ses conséquences : une natalité plus faible que celle des voisins européens pourrait avoir de graves répercussions. Elle pénaliserait la croissance démographique à moyen terme et enrayerait donc l’essor de la production industrielle et agricole.
En outre, elle affaiblirait les effectifs de l’armée – une perspective dangereuse dans un contexte de rivalité franco-allemande avivée par la guerre de 1870 -. Nos armées ne rassemblent plus les soldats indispensables à la sécurité du pays, s’alarme un journaliste en 1913. Nous sommes menacés d’une définitive submersion dans le flot des nations voisines, trop prolifiques.
Si la proposition trouve un écho bienvenu dans les cercles natalistes, elle provoque aussi l’indignation d’une partie de la population – y compris des vieux garçons qui siègent à l’Assemblée -.
Comment résoudre ce problème ? Plusieurs projets de lois et pétitions atterrissent périodiquement à la Chambre des députés entre 1871 et 1914. Leur point commun : elles concernent un impôt sur les célibataires, mesure qui permettrait de renflouer les caisses de l’État tout en condamnant un célibat jugé égoïste et assimilé à une maladie honteuse.
Il faut bien comprendre qu’à l’époque, le célibat est fortement stigmatisé. Le célibat est un mal individuel, relève la revue Le Français en 1875. La statistique prouve que les célibataires […] vivent moins ; qu’ils se suicident dans de plus larges proportions ; qu’ils commettent plus de crimes et fournissent un contingent plus fort à l’aliénation mentale.
Il faut donc le punir ou – mieux – en tirer un bénéfice quelconque. Pourquoi ne pas le taxer? Après tout, l’impôt a souvent été mobilisé comme une politique coercitive ou incitative. Dès 403 av. J.-C., une série de taxes conjugales sur les célibataires font leur apparition dans le droit romain. S’appuyant sur cet exemple pionnier, plusieurs députés tricolores proposent de lever une taxe de 20%sur tous les célibataires français âgés de 30 ans ou plus.
Si la proposition trouve un écho bienvenu dans les cercles natalistes, elle provoque aussi l’indignation d’une partie de la population – y compris des vieux garçons qui siègent à l’Assemblée. Faut-il, par ce seul fait que l’on est privé des soins et de l’affection d’une épouse tendre et pure, être frappé d’une sorte de réprobation sociale ?, s’interroge un député en 1871. Pour certains commentateurs, cet impôt discriminatoire ne serait qu’un moyen de gonfler les recettes fiscales sous couvert d’utilité sociale.
Famine en Inde, dans le Deccan : El Niño en est le premier responsable ; lord Lytton alors vice-roi des Indes proclama que rien ne devait empêcher les exportations vers l’Angleterre ; l’Inde affichait alors un excédent net en riz et en blé : sur 1877 et 1878, les négociants exportèrent le chiffre record de 6,4 millions de quintaux de blé. Les paysans mourraient de faim et les autorités reçurent l’ordre de décourager par tous les moyens l’aide aux victimes. La loi contre les contributions caritatives de 1877 interdisait sous peine d’emprisonnement les dons privés susceptibles d’interférer avec le cours des céréales fixé par le marché. Les seules formes d’aide autorisées furent les camps de travail, accessibles seulement aux personnes susceptibles de pouvoir travailler et elles recevaient alors moins que ce qu’un déporté recevra à Buchenwald. La mortalité y était de 94 ‰ !
Les grandes fortunes américaines se consolident, et cela se fait bien souvent sur le dos des ouvriers : depuis la guerre de Sécession, les conflits n’ont pas manqué, mais en cette année 1877, ils atteignent un sommet avec la grève des chemins de fer, déclenchée après des annonces de réduction de salaire : 100 000 grévistes, 120 000 km de voies – la moitié du réseau -, neutralisés ; la répression va faire une centaine de morts et en envoyer un millier en prison.
C’est seulement autour de Saint Louis que la grève des cheminots fut si systématiquement organisée et entraîna un arrêt si complet de l’activité industrielle que le terme de grève générale était parfaitement justifié. Et c’est également là que les socialistes ont joué un rôle prépondérant et indiscutable.[…] Aucune autre ville américaine n’a jamais été aussi près d’être dirigée par un soviet ouvrier, comme on appellerait cela de nos jours, que Saint Louis (Missouri), en 1877.
David Burbank. Reign of the Rabble
14 02 1878
Pour le lancement de sa campagne d’abonnement, le William Turf, un journal de course français – comme son nom ne l’indique pas – propose un prix de 2 000 francs au premier lecteur capable de trouver les trois premiers du Jockey Club dans l’ordre exact d’arrivée ; c’est, à l’époque moderne, le premier tiercé… à l’époque moderne, car, lors des Jeux Olympiques, les Grecs classaient déjà les trois premiers d’une course.
03 1878
Des mineurs du charbonnage de Bernissart [Belgique], exploitent une veine de charbon à 322 m dans la Fosse Sainte-Barbe : ils rencontrent une vaste poche d’argile, un cran, c’est à dire une faille de charriage qui coupe le bassin houiller du nord. Ordre fut donné de creuser une galerie de recherche à travers ce cran, afin de retrouver la veine de charbon de l’autre côté. Les mineurs rencontrèrent rapidement des objets sombres et friables qu’ils prirent pour des morceaux de bois. La quantité des cristaux de pyrite à l’intérieur de ces objets était si importante que les mineurs crurent avoir découvert des troncs d’arbre rempli d’or. Le 2 avril 1878, le porion [contremaître] Mortuelle amena une partie de ces étranges trouvailles au Café Dubruille, où le médecin du charbonnage, le Docteur Lhoir, démontra que c’était bien à des ossements, et non à du bois, qu’ils avaient affaire : la trouvaille était de taille : 29 squelettes d’iguanodons, dont certains complets.

1 05 1878
La 4° Exposition universelle se tient à Paris. On a construit pour l’occasion le Palais du Trocadéro. L’Allemand Otto présente un moteur à gaz fixe à 4 temps tournant à 180 tours par minute. Il le modifiera 6 ans plus tard en moteur à essence et concevra un dispositif d’allumage inspiré des bobines d’allumage que les sapeurs de l’armée utilisent pour provoquer des explosions. Robert Bosch va améliorer le procédé et les vitesses de rotation des moteurs vont pouvoir dépasser les 1 000 tours/minute, permettant des puissances accrues pour des moteurs moins encombrants et plus légers. La cristallerie Baccarat a réalisé un kiosque tout en cristal : 4,70 m de haut, 5,25 m de diamètre, pour abriter en son centre une statue de Mercure en bronze argenté, copie de celui sculpté par Jean de Bologne pour les Médicis vers 1550. Le Temple de Mercure fait un triomphe : il est récompensé par le grand prix de l’exposition. Une fois celle-ci terminée, il est entreposé dans le magasin de la manufacture de la rue Paradis, à Paris, d’où il disparaît, sans laisser aucune trace… Il aurait peut-être été acheté en 1892, (promesse d’achat plutôt qu’achat, bien probablement) par le roi du Portugal dont la fortune aurait mal tournée dans les années qui suivirent… toujours est-il qu’il faudra attendre février 2005 pour le retrouver, bien atteint par les injures du temps, au milieu d’une pièce d’eau dans le parc d’une grande propriété catalane, après que le propriétaire ait contacté la maison Baccarat pour lui refaire une jeunesse. Et, le 30 juin, grande fête pour célébrer la paix et le travail ainsi que la clôture de l’exposition : Claude Monnet passait par là qui laissera à la postérité La Rue Montorgueil, aujourd’hui au musée d’Orsay.

J’aimais les drapeaux. La première fête nationale du 30 juin, je me promenais rue Montorgueil avec mes instruments de travail ; la rue était très pavoisée avec un monde fou. J’avise un balcon, je monte et demande la permission de peindre, elle m’est accordée. Puis je redescends incognito. Claude Monnet

La Rue Mosnier aux drapeaux. Edouard Manet 1878. J.P. Getty Museum. La rue Mosnier est aujourd’hui la Rue de Berne.
14 07 1878
Le traité de San Stefano, par le poids qu’il donne à la Russie est resté en travers de la gorge de la Grande Bretagne qui se démène pour le retoquer par le Congrès de Berlin : c’est la fin de la Grande Bulgarie, Thrace et Macédoine repartent sous le giron ottoman, l’Autriche Hongrie met la main sur la Bosnie Herzégovine. Chypre est attribué à la Grande Bretagne, qui devient aussi protectrice des Juifs de l’empire ottoman. La France devient protectrice des Chrétiens maronites et catholiques de l’empire ottoman ; elle occupe la Tunisie, et l’Italie protège les chrétiens et les juifs de Tunisie et de la Tripolitaine. Les Arméniens demandent des réformes qui leur accorderaient une certaine émancipation : ils commencent ainsi à être perçus par les Turcs comme ennemis de l’intérieur. Sous l’influence étrangère commence à prendre corps le mythe d’une pureté ottomane reposant à la fois sur l’ethnie – turque- et la religion – l’Islam-. À l’est de l’empire, une seconde question macédonienne risquerait de fragmenter encore l’empire. La grande faiblesse des Arméniens est de ne pas avoir d’État protecteur.
08 1878
L’Égypte s’est laissé prendre dans les mailles serrées de la finance internationale. L’affaire a commencé 27 ans plus tôt : Abbas I°, khédive – vice-roi- d’Égypte -, pour entreprendre des grands travaux : chemin de fer Alexandrie – Le Caire, plusieurs canaux etc… avait dû emprunter de l’argent pour le principal à la France et à l’Angleterre, à des taux prohibitif de 12 à 13 %, au lieu des 5 à 6 % habituels, avec des commissions extravagantes des intermédiaires etc… Dès 1875, le pays n’était plus à même de rembourser ses créanciers. L’Angleterre, tenue à l’écart du chantier du canal de Suez, saisit l’occasion pour en faire partie en rachetant le 24 novembre 1875 à l’Égypte la totalité de ses parts. Mais ce n’était pas suffisant pour remettre le pays à flots et, en mai 1876, les créanciers avaient imposé au Khédive deux contrôleurs généraux des finances, un Français et un Anglais et une Caisse de la dette, de composition internationale. La mainmise de l’étranger sur le pays ne fit que s’aggraver puisque maintenant, c’est tout un gouvernement d’experts européens qui est imposé au Khédive Ismaïl. On ne peut pas inventer mieux que ce genre de situation pour susciter le nationalisme qui parvient à contraindre le khédive à refuser cette mainmise de l’étranger sur le pays. Mais le khédive n’est que vice-roi, et l’Angleterre et la France en référèrent au sultan ottoman qui, ne pouvant pas leur refuser cette demande, contraint le khédive à l’abdication. Ce qui ne calmera en rien l’agitation nationaliste qui culminera avec Urabi Pacha en 1881. Le 11 juillet 1882, la navy bombardera Alexandrie, les troupes anglaises débarqueront le 2 août et le 13 septembre les Anglais infligeront une rude défaite aux Égyptiens à Tel el-Kébir. Arabi Pacha, sera exilé à Ceylan (Sri Lanka) : l’Égypte devenait un protectorat anglais. Moyennant un feu vert sur la Tunisie, la France se retirera du jeu.
1 09 1878
Ataï, grand chef kanak est tué au combat par un guerrier kanak enrôlé dans les troupes françaises. Auparavant, face au gouverneur devant lequel il protestait de la spoliation de leurs terres par l’administration coloniale, il avait déversé un sac de terre, puis un sac de pierres : Voilà ce que nous avions, voici ce que tu nous laisses. 24 ans plus tard, le pasteur Maurice Leenhardt, qui deviendra leur premier grand défenseur, sera accueilli en ces termes par le maire de Nouméa : Pourquoi vous intéressez-vous aux Kanak ? Dans dix ans, il n’y en aura plus un seul. Après le combat, sa tête et sa main avaient été coupées – c’était un trophée militaire – puis conservées dans du phénol et confiée aux anatomistes de la Société Française d’anthropologie, et rangée, oubliée dans un placard. En 2011 Didier Daeninckx sortit le personnage de l’oubli en 2001 avec Le retour d’Ataï, roman prémonitoire. En 2011, un étudiant du musée de l’Homme lui apprend que l’on a retrouvé le crâne d’Ataï. [Michel Rocard avait demandé son retour en Nouvelle Calédonie mais alors on ne l’avait pas trouvé.] Dans les années 1960, Appolinaire Ataba, consacrera un chapitre à l’épopée du grand chef dans un manuscrit non publié… sur lequel tombera Jean-Marie Tjibaou, jeune étudiant en ethnologie qui va se charger de sortir Ataï de l’oubli.
Ataï lui-même fut frappé par un traître. Que partout les traîtres soient maudits ! Suivant la loi canaque, un chef ne peut être frappé que par un chef ou par procuration. Nondo, chef vendu aux blancs, donna sa procuration à Segou, en lui remettant les armes qui devaient frapper Ataï. Entre les cases nègres et Amboa, Ataï, avec quelques-uns des siens, regagnait son campement, quand, se détachant des colonnes des blancs, Segou indiqua le grand chef, reconnaissable à la blancheur de neige de ses cheveux. Sa fronde roulée autour de sa tête, tenant de la main droite un sabre de gendarmerie, de la gauche un tomahawk, ayant autour de lui ses trois fils et le barde Andja, qui se servait d’une sagaie comme d’une lance, Ataï fit face à la colonne des blancs. Il aperçut Segou. Ah ! dit-il, te voilà ! Le traître chancela un instant sous le regard du vieux chef ; mais, voulant en finir, il lui lance une sagaie qui lui traverse le bras droit. Ataï, alors, lève le tomahawk qu’il tenait du bras gauche ; ses fils tombent, l’un mort, les autres blessés ; Andja s’élance, criant : tango ! tango ! (maudit ! maudit !) et tombe frappé à mort. Alors, à coups de hache, comme on abat un arbre, Segou frappe Ataï ; il porte la main à sa tête à demi détachée et ce n’est qu’après plusieurs coups encore qu’Ataï est mort. Le cri de mort fut alors poussé par les Canaques, allant comme un écho par les montagnes. […] Que sur leur mémoire tombe ce chant d’Andja : Le Takata, dans la forêt, a cueilli l’adouéke, l’herbe bouclier, au clair de lune, l’adouéke, l’herbe de guerre, la plante des spectres. Les guerriers se partagent l’adouéke qui rend terrible et charme les blessures. Les esprits soufflent la tempête, les esprits des pères ; ils attendent les braves ; amis ou ennemis, les braves sont les bienvenus par delà [sic] la vie. Que ceux qui veulent vivre s’en aillent. Voilà la guerre ; le sang va couler comme l’eau sur la terre ; il faut que l’adouéke soit aussi de sang.
Louise Michel Mémoires
6 11 1878
Charles de Freycinet est ministre des Travaux publics depuis le 13 décembre précédent. Cela lui a laissé le temps de se faire une notoriété… qu’il faut ma foi, entretenir. Sous la haute supervision de sa femme il offre un dîner :
- Purée d’Asperge comtesse. Consommé à la Deslignac.
- Crépinettes de Lapereaux au Truffes. Niokys au parmesan.
- Carpes du Rhin à la Chambord. Selles de Chevreuil à l’Anglaise.
- Poulardes à la Maréchale. Turban de Cailles aux Laitues. Escalopes de Foie gras Toulouse. Filet de Sole sauce Ravigotte.
- Punch à la Romaine. Sorbets aux mandarines.
- Dindes truffées à la Périgueux. Galantines de Bartavelle à la Gelée.
- Salade parisienne aux Truffes. Cèpes à l’Italienne. Croustade d’Ananas Pompadour.
- Glaces havanaises. Favorites glacées. Gâteau grec.
- Dessert.
1878
D.E. Hughes invente le microphone. Drame sur la Tamise : 623 passagers du Princess Alice, un bateau à aubes qui coule, meurent asphyxiés et noyés de la seule odeur pestilentielle : la Tamise était devenu une fosse septique à ciel ouvert. Louis Pasteur produit un vaccin contre le choléra des poules :

En Nouvelle Calédonie, révolte de Kanaks : plus de mille morts. La femme finlandaise acquiert le droit de vote aux élections municipales. Battus en Bosnie, les Turcs abandonnent Chypre, point stratégique de la Méditerranée, à l’Angleterre. Le grenoblois Henri Duhamel (1853 – 1917) achète une paire de ski à Paris, mais ce n’est pas encore au point. L’Écossais Robert Louis Stevenson fait les rivières et canaux du Nord de la France en canoë, témoignant que le savoir-vivre à la française n’est en aucune façon un cliché éculé : Et, alors que nous quittions le café, quelqu’un nous courut après et nous rejoignît à la porte de l’hôtel. Ce n’était rien de moins que le juge de paix, un fonctionnaire qui, autant que j’ai pu l’établir, a les prérogatives d’un substitut de shérif en Écosse. Il nous remit sa carte et nous pria, à brûle-pourpoint, de souper en sa compagnie. Avec cette grâce engageante et cette politesse exquise que les Français savent apporter en ces matières délicates. C’était à l’honneur de Landrecies, expliqua-t-il. Et quoique sachant fort bien quel modeste honneur nous pouvions faire à la ville, nous aurions été de grossiers personnages si nous avions décliné une invitation aussi joliment formulée. […] Les vins étaient de qualité. Quand nous complimentions le juge de paix sur une bouteille : Je ne vous offre pas cela comme ce que j’ai de plus mauvais, disait-il. Je me demande quand les Anglais apprendront ces grâces de l’hospitalité. Elles valent qu’on en soit instruit. Elles rehaussent l’existence et agrémentent les heures médiocres. […] À mesure que s’avançait la soirée, le vin devenait plus à mon goût : les alcools s’avéraient meilleurs que le vin, la société était fort gaie. Ce fut le plus haut étiage de la faveur publique à notre égard durant toute notre croisière. Somme toute, comme nous nous trouvions chez un juge de paix, n’y avait-il pas quelque chose de semi-officiel dans le crédit qu’il nous conférait ? Aussi, au souvenir de la grandeur de ce pays qu’est la France nous rendions pleinement justice à notre réception.
[quelques jours plus tard] Tout cela, ruminé dans ma tête, me fit désirer de me rendre à bord d’une de ces maisons idéales [une péniche. ndlr] de la flânerie. J’avais surabondance de choix, tandis que je les côtoyais l’une après l’autre et que les chiens m’aboyaient aux chausses, me prenant pour un vagabond. À la fin, j’aperçu un brave vieux et sa femme qui me regardaient avec intérêt. je leur souhaitai le bonjour et m’arrêtai à côté de leur bateau. Je commençai par une remarque sur leur chien, qui avait une vague ressemblance avec un pointer. De là, je glissai sur un compliment sur les fleurs de madame et de là un propos élogieux sur leur genre de vie.
Qui tenterait pareille expérience en Angleterre recevrait d’emblée un fier camouflet. On vous représenterait pareille existence comme méprisable non sans allusion sournoise à votre meilleur sort. Or, ce que j’aime tant chez les Français, c’est la netteté et la fermeté de chacun à reconnaître sa chance particulière. Ils savent tous de quel côté leur tartine est beurrée et ils prennent à montrer ce côté-là à autrui. Voilà à coup sûr la meilleure part de leur foi. Ils dédaignent de faire la petite bouche sur leur pauvreté, ce que je considère comme le meilleur d’une mâle dignité. Or, les Français sont pleins de cet esprit d’indépendance. Sans doute est-ce le résultat des institutions républicaines, comme ils les appellent. Bien plus probablement est-ce parce qu’il y a si peu de gens réellement pauvres, que ceux qui se lamentent ne sont pas assez nombreux pour se venir en aide les uns aux autres ?
Les bonnes gens du bateau étaient ravis de m’entendre admirer leur condition. Ils comprenaient parfaitement , me dirent-ils, comment monsieur enviait leur sort. Sand doute monsieur était-il bien renté et, dans ce cas, il lui était possible de rendre un chaland aussi beau qu’une maison de campagne – joli comme un château –. Et, ce disant, ils m’invitèrent à monter à bord de leur château flottant. Ils s’excusèrent pour l’aménagement de leur cabine. Ils n’avaient pas été assez riches pour en faire ce qu’elle aurait pu être. Le poêle aurait du être ici, de ce côté, expliquait le mari. Alors, on aurait pu avoir un secrétaire au milieu, des livres, et tout (en bloc) et tout. Ça serait on ne peut plus gentil. Ça serait tout à fait coquet. Et il regardait autour de lui comme si les améliorations avaient déjà été effectuées. Ce n’était évidemment pas la première fois qu’il avait ainsi embelli sa cabine en imagination. Et à la première bonne affaire réalisée, on peut s’attendre à voir le secrétaire au milieu.
[…] Comme je continuais d’admirer, les excuses cessèrent et ces braves gens se mirent à vanter leur chaland et leur heureux état de vie, comme s’ils avaient été empereur et impératrice des Indes. Ce fut, comme on dit en Écosse, une bonne audience et qui me mit de parfaite humeur pour courir le monde. Si l’on savait comme il est encourageant d’entendre quelqu’un être fier de son sort aussi longtemps qu’il se fait gloire de ce qu’il possède en réalité, je crois qu’on le ferait plus librement et de meilleure grâce.
Les vieux se mirent à poser des questions sur notre voyage. Il vous aurait fallu voir combien ils avaient pour nous de sympathie. Ils avaient presque l’air d’être prêt à abandonner leur péniche pour nous suivre. Mais ces mariniers du canal ne sont que des nomades à demi-domestiqués. La semi-domestication se manifesta sous une forme assez agréable. Tout à coup, le front de madame s’assombrit. Cependant commença-t-elle, et elle s’arrêta net. Puis, se reprenant, elle me demanda si je n’était pas marié.
- Non, répondis-je
- Et votre ami qui vient justement de passer ?
- Lui non plus n’est pas marié
Oh ! alors – tout était bien. Elle ne pouvait pas comprendre qu’on laissa des femmes seules à la maison. Mais, puisqu’il n’y avait pas de femme dans l’histoire, nous agissions au mieux.
Robert Louis Stevenson. En canoë sur les rivières du Nord. 1878
Les frères Péreire, banquiers, achètent le Tombeau des Rois à Jérusalem, un ensemble de tombes juives monumentales de Jérusalem, taillées dans le roc et datant de la période du second temple. Il est situé au 46 rue Saladin (Salah Ad-din), à 820 m au nord des murs de la vieille ville, près de la porte de Damas dans le quartier de Cheikh Jarrah. Ils le donneront à la France en 1886, ce site rejoignant dès lors le domaine national français en Terre Sainte, avec statut d’extra-territorialité.

14 02 1879
Les forces armées chiliennes débarquent dans le port d’Antofagasta, port bolivien par où est exporté le guano et le salpêtre, venus du désert d’Atacama. Antofagasta compte 5 000 Chiliens sur ses 6 000 habitants. Ce désert, en territoire bolivien, est devenu un enjeu économique important depuis que ces deux denrées ont pris de la valeur : le guano est le dernier engrais naturel avant l’invention des engrais chimiques et est très demandé par l’Europe pour une agriculture avide d’améliorer ses rendements et le salpêtre, ça sert à faire de la poudre, et ça, on en a toujours besoin. La Bolivie qui a concédé à des investisseurs Chiliens l’exploitation de ces richesses, veut maintenant augmenter la taxe sur l’exportation de ces matières premières ; le Chili refuse et choisit de faire parler la poudre : c’est la guerre du salpêtre, dite encore guerre du Pacifique : inférieur en nombre face à la Bolivie et à son allié le Pérou, il bénéficie d’un armement de meilleure qualité parce que plus moderne. Le Chili vient donc à bout des forces navales du Pérou et des forces terrestres des deux pays. Les liaisons sont à tel point obsolètes en Bolivie que la nouvelle ne sera connue à La Paz, la capitale que le 25 février ! La Bolivie se retire du conflit et les troupes chiliennes vont tout de même mettre plus d’un an pour prendre Lima, la capitale du Pérou, en 1881. Albert Bergasse Dupetit Thouars, amiral français de retour d’une mission de pacification aux Marquises, était à Lima juste avant l’entrée des troupes chiliennes : il se démènera pour que la ville ne soit pas mise à sac. La guerre prendra fin le 20 octobre 1883 avec le traité d’Ancón : la province de Tarapaca passait sous souveraineté chilienne. Les villes d’Arica et Tacna passaient provisoirement sous le contrôle chilien, lequel provisoire ne le sera pas du tout. Cela représentait 200 000 km² de gagnés par le Chili – 125 000 km² sur la Bolivie et 75 000 km² sur le Pérou -. Finalement, Herbert C. Hoover, le président des États-Unis interviendra en 1929 pour que Tacna soit rendue au Pérou, tandis qu’Arica restait au Chili. Bolivar était parvenu à donner une façade maritime à son pays : elle était désormais perdue.
28 02 1879
Les guerres civiles ne sont finies qu’apaisées. En politique, oublier, c’est la grande loi. (…) La guerre civile est une faute. Qui l’a commise ? Tout le monde et personne. L’amnistie, c’est l’oubli. […] Il est bon qu’après tant de luttes, d’angoisses et de travaux, une puissante nation sache prouver au monde qu’elle répond par la grandeur de ses actes à la grandeur des institutions.
Victor Hugo au Sénat
24 03 1879
Les premières endives – witloof en flamand, chicon en wallon – arrivent de Belgique aux Halles de Paris.
16 04 1879
Ernest Renan a été reçu à l’Académie française ; un passage de son discours a froissé un ami allemand. Il lui répond :
Mon cher ami,
Vous m’apprenez qu’un passage de mon discours de réception a été accueilli parmi vous comme la voix d’un ennemi. Relisez ce que j’ai dit, et vous verrez combien ce jugement est superficiel. J’ai défendu notre vieil esprit français contre d’injustes reproches, qui viennent presque aussi souvent de chez nous que de chez vous. J’ai soutenu contre des novateurs, qui sont loin d’être tous Allemands, que notre tradition intellectuelle est grande et bonne, qu’il faut l’appliquer à des ordres de connaissances sans cesse élargis, mais non pas la changer. J’ai exprimé des doutes sur la possibilité pour une dynastie de jouer dans le monde un rôle universel sans bienveillance, sans générosité, sans éclat. J’ai pu aller à l’encontre de certaines opinions des militaires et des hommes d’État de Berlin ; je n’ai pas dit un mot contre l’Allemagne et son génie. Plus que jamais je pense que, si nous avons besoin de vous, vous aussi, à quelques égards, avez besoin de nous. La collaboration de la France et de l’Allemagne, ma plus vieille illusion de jeunesse, redevient la conviction de mon âge mûr, et mon espérance est que, si nous arrivons à la vieillesse, si nous survivons à cette génération d’hommes de fer, dédaigneux de tout ce qui n’est pas la force, auxquels vous avez confié vos destinées, nous verrons ce que nous avons rêvé autrefois, la réconciliation des deux moitiés de l’esprit humain. Oui, sans nous, vous serez solitaires et vous aurez les défauts de l’homme solitaire ; le monde n’appréciera parfaitement de vous que ce que nous lui aurons fait comprendre. Je me hâte d’ajouter que sans vous notre œuvre serait maigre, insuffisante. Voilà ce que j’ai toujours dit. Je n’ai nullement changé ; ce sont les événements qui ont si complètement interverti les rôles, que nous avons peine à nous reconnaître dans nos affections et dans nos souvenirs.
Personne n’a aimé ni admiré plus que moi votre grande Allemagne, l’Allemagne d’il y a cinquante et soixante ans, personnifiée dans le génie de Goethe, représentée aux yeux du monde par cette merveilleuse réunion de poètes, de philosophes, d’historiens, de critiques, de penseurs, qui a vraiment ajouté un domaine nouveau aux richesses de l’esprit humain. Tous tant que nous sommes, nous lui devons beaucoup, à cette Allemagne large, intelligente et profonde, qui nous enseignait l’idéalisme par Fichte, la foi dans l’humanité par Herder, la poésie du sens moral par Schiller, le devoir abstrait par Kant. Loin que ces acquisitions nouvelles nous parussent la contradiction de l’ancienne discipline française, elles nous en semblaient la continuation. Nous prenions au sérieux vos grands esprits quand ils reconnaissaient ce qu’ils devaient à notre dix-huitième siècle ; nous admettions avec Goethe que la France, que Paris étaient des organes essentiels du génie moderne et de la conscience européenne. Nous travaillions de toutes nos forces à bannir de la science et de la philosophie ces mesquines idées de rivalité nationale qui sont le pire obstacle aux progrès de l’esprit humain.
Depuis 1848, époque où les questions commencèrent à se poser avec netteté, nous avons toujours admis que l’unité politique de l’Allemagne se ferait, que c’était là une révolution juste et nécessaire. Nous concevions l’Allemagne devenue nation comme un élément capital de l’harmonie du monde. Voyez notre naïveté ! Cette nation allemande que nous désirions voir entrer comme une individualité nouvelle dans le concert des peuples, nous l’imaginions sur le modèle de ce que nous avions lu, d’après les principes tracés par Fichte ou Kant. Nous formions les plus belles espérances pour le jour ou prendrait place dans la grande confédération européenne un peuple philosophe, rationnel, ami de toutes les libertés, ennemi des vieilles superstitions, ayant pour symbole la justice et l’idéal. Que de rêves nous faisions ! Un protestantisme rationaliste s’épurant toujours entre vos mains et s’absorbant en la philosophie, – un haut sentiment d’humanité s’introduisant avec vous dans la conduite du monde, – un élément de raison plus mûre se mêlant au mouvement général de l’Europe et préparant des bandages à plusieurs des plaies que notre grande, mais terrible révolution avait laissées saignantes ! Vos admirables aptitudes scientifiques sortaient d’une obscurité imméritée, devenaient un rouage essentiel de la civilisation, et ainsi, grâce à vous et un peu grâce à nous, un pas considérable s’accomplissait dans l’histoire du progrès.
Les choses humaines ne se passent jamais comme le veulent les sages. Aussi les esprits éclairés parmi nous ne furent-ils pas trop surpris de voir proclamer à Versailles, sur les ruines de la France vaincue, cette unité allemande qu’ils s’étaient représentée comme une œuvre sympathique à la France. Grande fut leur douleur en voyant l’apparition nationale qu’ils avaient appelée de leurs vœux indissolublement liée aux désastres de leur pays. Ils se consolaient au moins par la pensée que l’Allemagne, devenue toute-puissante en Europe, allait planter haut et ferme le drapeau d’une civilisation qu’elle nous avait appris à concevoir d’une façon si élevée.
La grandeur oblige, en effet. Une nation a d’ordinaire le droit de se renfermer dans le soin de ses intérêts particuliers et de récuser la gloire périlleuse des rôles humanitaires. Mais la modestie n’est pas permise à tous. Vos publicistes, interprètes d’un instinct profond, ont pu être moins discrets à cet égard que vos hommes d’État et proclamer tout haut que l’ère de l’Allemagne commençait dans l’histoire. La fatalité vous traînait. Il n’est pas permis, quand on est tout-puissant, de ne rien faire. La victoire défère au victorieux, qu’il le veuille ou non, l’hégémonie du monde.
Tour à tour la fortune élève sur le pavois une nation, une dynastie. Jusqu’à ce que l’humanité soit devenue bien différente de ce qu’elle est, toutes les fois qu’elle verra passer un char de triomphe, elle saluera, et, les yeux fixés sur le héros du jour, elle lui dira : Parle, tu es notre chef, sois notre prophète. La solution des grandes questions pendantes à un moment donné (et Dieu sait si le moment présent se voit obsédé de problèmes impérieux !) est dévolue à celui que les destins désignent. Alexandre, Auguste, Charles-Quint, Napoléon n’avaient pas le droit de se désintéresser des choses humaines ; sur aucune question, ils ne pouvaient dire : Cela ne me regarde pas ! Chaque âge a son président responsable, chargé de frapper, d’étonner, d’éblouir, de consoler l’humanité. Autant le rôle du vaincu, obligé de s’abstenir en tout, est facile, autant la victoire impose de devoirs. Il ne sert de rien de prétendre qu’on a le droit d’abdiquer une mission qu’on n’a pas voulue. Le devoir devant lequel on recule vous prend à la gorge, vous tue ; la grandeur est un sort implacable auquel on ne peut se soustraire. Celui qui manque à sa vocation providentielle est puni par ce qu’il n’a pas fait, par les exigences qu’il n’a pas contentées, par les espérances qu’il n’a pas remplies, et surtout par l’épuisement qui résulte d’une force non employée, d’une tension sans résultat.
Faire de grandes choses dans le sens marqué par le génie de l’Allemagne, tel était donc le devoir de la Prusse quand le sort des armes eut mis les destinées de l’Allemagne entre ses mains. Elle pouvait tout pour le bien ; car la condition pour réaliser le bien, c’est d’être fort. Qu’y avait-il à faire ? Qu’a-t-elle fait ? Huit ans, plus de la moitié de ce que Tacite appelle grande mortalis ævi spatium, se sont écoulés depuis qu’elle jouit en Europe d’une supériorité incontestée. Par quels progrès en Allemagne et dans le monde cette période historique aura-t-elle été marquée ?
Et d’abord, après la victoire, la nation victorieuse a bien le droit de trouver chez elle les récompenses de ses héroïques efforts, le bien-être, la richesse, le contentement, l’estime réciproque des classes, la joie d’une patrie glorieuse et pacifiée. En politique, elle a droit surtout au premier des biens, à la première des récompenses, je veux dire à ces libertés fondamentales de la parole, de la pensée, de la presse, de la tribune, toutes choses dangereuses dans un État faible ou vaincu, possibles seulement dans un État fort. Ces grandes questions sociales qui agitent notre siècle ne peuvent être résolues que par un victorieux, se servant du prestige de la gloire pour imposer des concessions, des sacrifices, l’amnistie, à tous les partis. Donner la paix, autant que la paix est de ce monde, et la liberté, aussi large qu’il est possible, à cette Europe continentale qui n’a pas encore trouvé son équilibre, fonder définitivement le gouvernement représentatif, aborder franchement les problèmes sociaux, élever les classes abaissées sans leur inspirer la jalousie des supériorités nécessaires, diminuer la somme des souffrances, supprimer la misère imméritée, résoudre la délicate question de la situation économique de la femme, montrer par un grand exemple la possibilité de faire face en même temps aux nécessités politiques opposées que l’Angleterre a conciliées, parce que le problème se posait pour elle d’une manière relativement facile : voilà ce qui eût justifié la victoire, voilà ce qui l’eût maintenue. La victoire, en effet, a toujours besoin d’être légitimée par des bienfaits. La force qu’on a déchaînée devient impérieuse à son tour. Dès qu’il a reçu la première salutation impériale, le César appartient à la fatalité jusqu’à sa mort.
De ce programme que la force des choses semblait vous imposer, qu’avez-vous réalisé ? Votre peuple est-il devenu plus heureux, plus moral, plus satisfait de son sort ? Il est clair que non ; des symptômes comme on n’en a jamais vu après la victoire se sont manifestés parmi vous. La gloire est le foin avec lequel on nourrit la bête humaine ; votre peuple en a été saturé, et il regimbe !… Napoléon I°, en 1805-1806, avait imposé silence par l’admiration à toute voix opposante ; une centaine de personnes tout au plus murmuraient ; l’idée d’un attentat contre sa personne eût paru un non-sens. Comment se fait-il qu’au lendemain de triomphes comme on n’en avait pas vu depuis soixante ans, votre gouvernement se soit trouvé en présence d’un mécontentement profond ? Pourquoi est-il toujours préoccupé de mesures restrictives de la liberté ? D’ordinaire, on n’a pas à réprimer après la victoire ; la répression est le propre des faibles. Ce qui se passe chez vous, n’importe comment on l’explique, renferme un blâme contre vos hommes d’État. Si votre peuple est aussi mauvais qu’ils le disent, c’est leur condamnation. Âpres et durs, comprenant l’État comme une chaîne et non comme quelque chose de bienveillant, ils croient connaître la nature allemande et ne connaissent pas la nature humaine. Ils ont trop compté sur la vertu germanique, ils en verront le bout. On a fait de vous une nation organisée pour la guerre ; comme ces chevaliers du XVI° siècle, bardés de fer, vous êtes écrasés par votre armement. S’imaginer qu’en continuant de subir un pareil fardeau sans en retirer aucun avantage, votre peuple aura la souplesse nécessaire pour les arts de la paix, c’est trop espérer. Ces sacrifices militaires vous mettent dans la nécessité ou de faire la guerre indéfiniment, – et vous avez trop de bon sens pour ne pas voir que ces parties à la Napoléon I° mènent aux abîmes, – ou d’avoir une place désavantageuse dans la lutte pacifique de la civilisation. Les agitations socialistes sont, comme la fièvre, à la fois une maladie et un symptôme ; on doit en tenir compte ; il ne suffit pas de les étouffer, il faut en voir la cause et à quelques égards y donner satisfaction. Les erreurs populaires s’affaiblissent par la publicité ; on les fortifie en essayant de ramener le peuple à des croyances devenues sans efficacité. Vos maîtres d’école auront beau revenir au pur catéchisme, cela n’y fera rien. Les lois répressives n’y peuvent pas davantage ; on ne tue pas des mouches à coups de canon.
Et dans l’ordre politique, dans la réalisation de cet idéal du gouvernement constitutionnel qui nous est si cher à tous et où l’Europe continentale n’a pas encore réussi, quel progrès avez-vous accompli ? En quoi votre vie parlementaire a-t-elle été plus brillante, plus libre, plus féconde que celle des autres peuples ? Je n’arrive pas à le voir, et ici encore, au lieu de cette largeur libérale qui est le propre des forts, je trouve vos hommes d’État surtout préoccupés de restrictions, de répressions, de règlements coercitifs. Non, je le répète, ce n’est pas par ces moyens-là que vous séduirez le monde. La répression est chose toute négative. Et si, pendant que vos hommes d’État sont plongés dans cette ingrate besogne, le paysan français, avec son gros bon sens, sa politique peu raffinée, son travail et ses économies, réussissait à fonder une République régulière et durable ! Ce serait plaisant. L’entreprise est trop difficile et trop périlleuse pour qu’il soit permis d’en escompter le succès ; mais ce qui est incroyable est souvent ce qui arrive. Les soldats écervelés du général Custine, les grenadiers héroïques et burlesques qui semèrent à tous les vents les idées de la Révolution, ont réussi à leur manière.
La gloire nationale est une grande excitation pour le génie national. Vous avez eu quatre-vingts ans d’un admirable mouvement littéraire, durant lesquels on a vu fleurir chez vous des écrivains comparables aux plus grands des autres nations. Comment se fait-il que cette veine soit comme tarie ? Après notre âge littéraire classique du XVII° siècle, nous avons eu le XVIII° siècle, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, d’Alembert, Diderot, Turgot, Condorcet. Où est votre continuation de Goethe, de Schiller, de Heine ? Le talent ne vous manque certes pas ; mais il y a, selon moi, deux causes qui nuisent à votre production littéraire : d’abord, vos charges militaires exagérées, et en second lieu, votre état social. Supposez Goethe obligé de faire son apprentissage militaire, exposé aux gros mots de vos sergents instructeurs, croyez-vous qu’il ne perdrait pas à cet exercice sa fleur d’élégance et de liberté ? L’homme qui a obéi est à jamais perdu pour certaines délicatesses de la vie ; il est diminué intellectuellement. Votre service militaire est une école de respect exagéré. Si Molière et Voltaire eussent traversé cette éducation-là, ils y auraient perdu leur fin sourire, leur malignité parfois irrévérencieuse. L’état de conscrit est funeste au génie. Vous me direz que ce régime, nous l’avons adopté de notre côté. Ce n’est peut-être pas ce que nous avons fait de mieux ; en tous cas, on ne voit guère encore venir le jour où nous serons malades par exagération du respect.
Votre état social me paraît aussi très peu favorable à la grande littérature. La littérature suppose une société gaie, brillante, facile, disposée à rire d’elle-même, où l’inégalité peut être aussi forte que l’on voudra, mais où les classes se mêlent, où tous vivent de la même vie. On me dit que vous avez fait depuis dix ans de grands progrès vers cette unité de la vie sociale ; cependant, je n’en vois pas encore le principal fruit, qui est une littérature commune, exprimant avec talent ou avec génie toutes les faces de l’esprit national, une littérature aimée, admirée, acceptée, discutée par tous. Je n’ignore pas les noms très honorables que vous allez me citer ; je ne peux trouver néanmoins que votre nouvel empire ait réalisé ce qu’on devait attendre d’un gouvernement concentrant en lui toutes les forces du génie allemand. C’était à vous de faire sonner bien haut le clairon de la pensée ; ces accents nouveaux qui devaient faire battre tous les cœurs, nous les attendons, et nous ne voyons pas bien comment, de l’état moral que certains faits récents nous ont révélé, sortirait un mouvement de libre expansion et de chaude générosité.
Vous étiez forts, et vous n’avez pas fait la liberté ! Votre campagne contre l’ultramontanisme, légitime quand elle s’est bornée à réprimer l’intolérance catholique, n’a pas fait avancer d’un pas la grande question de la séparation de l’Église et de l’État. Vos ministres sont toujours restés dans le vieux système où l’État confère à l’Église des privilèges et a pour elle des exigences, sans voir que ces exigences, qui ont une apparence tyrannique, sont loin d’égaler les privilèges qu’on lui accorde d’une autre main. Certes, vous n’irez pas à Canossa. Léon XIII n’est pas Grégoire VII ; c’est lui qui viendra où vous voudrez. Mais ici encore nous attendions du grand et du neuf, et nous ne le voyons pas venir.
Je ferais sourire vos hommes d’État si je disais que votre empire, dans ses premières années qui sont toujours les plus fécondes, n’a pas non plus rempli ses devoirs envers l’humanité, et que l’avenir lui demandera compte de beaucoup de questions auxquelles il a tourné le dos comme à des rêves d’idéologues. Nos habitudes d’esprit et notre histoire nous donnent peut-être des idées fausses en ce qui concerne l’idéal d’une grande hégémonie nationale et dynastique. Nous pensons toujours à Auguste, à Louis XIV ; nous ne comprenons pas qu’on règne sur le monde sans grandeur, sans éclat, sans rechercher l’amour du monde et forcer sa reconnaissance. Une nation ou une dynastie dirigeante nous apparaît comme quelque chose de noble, de sympathique, comme une force chargée de patronner tout ce qui est beau, de favoriser le progrès de la civilisation sous toutes ses formes. Éclat, générosité, bienveillance nous semblent des conditions nécessaires de ces grands règnes momentanés qui sont tour à tour dévolus à chaque nation. Louis XIV n’entendait pas parler d’un homme de mérite, de quelque pays qu’il fût, sans se demander : Ne pourrais-je pas lui faire une pension ? Il se croyait le dieu bienfaisant du monde ; l’Europe a vécu pendant cent ans de son soleil en cuivre doré. Vanité des vanités ! L’humanité est quelque chose d’assez frivole ; il faut le savoir si l’on aspire à la gagner ou à la gouverner.
Pour la gagner, il faut lui plaire ; pour lui plaire, il faut être aimable. Or vos hommes d’État prussiens ont tous les dons, excepté celui-là. Force de volonté, application, génie contenu et obstiné, ils ne se sont montrés inférieurs pour les qualités solides à aucun des grands génies politiques du passé. Mais ils se sont trompés en se figurant qu’avec cela on peut se dispenser de plaire au monde, de le gagner par des bienfaits. Erreur ! On ne s’impose à l’humanité que par l’amour de l’humanité, par un sentiment large, libéral, sympathique, dont vos nouveaux maîtres se raillent hautement, qu’ils traitent de chimère sentimentale et prétentieuse. On ne discute pas contre des poses, contre des modes passagères ; mais il est bien permis de dire qu’une ostentation d’égoïsme et de froid calcul n’a jamais été le ton des grands hommes qui méritent de figurer éternellement au Panthéon de l’humanité.
Traitez-moi d’arriéré, mais je ne reconnaîtrai jamais comme ayant réalisé l’ancien idéal allemand ces hommes durs, étroits, détracteurs de la gloire, affectant un terre-à-terre vulgaire et positif, prétextant un dédain de la postérité qu’au fond ils n’ont pas. Dans le passage de mon discours de réception qui vous a blessés, je n’ai pas voulu dire autre chose. Le génie de l’Allemagne est grand et puissant ; il reste un des organes principaux de l’esprit humain ; mais vous l’avez mis dans un étau où il souffre. Vous êtes égarés par une école sèche et froide, qui écrase plus qu’elle ne développe. Nous sommes sûrs que vous vous retrouverez vous-mêmes, et qu’un jour nous serons de nouveau collaborateurs dans la recherche de tout ce qui peut donner de la grâce, de la gaieté, du bonheur à la vie.
Ernest Renan Lettre à un ami d’Allemagne. Journal des Débats. 16 avril 1879
La belle harmonie intellectuelle et littéraire que veut voir Ernest Renan dans l’Allemagne du XIX° siècle n’est pas partagée par tout le monde, entre autres par Stefan Zweig qui ne trouve pas de mots assez durs pour fustiger Kant : La première chose que fait Hypérion [personnage d’Hölderlin] lorsqu’il se décide à vivre libre est de penser à ce qu’il y a d’héroïque dans la vie, c’est la volonté de chercher la grandeur. Cependant, avant d’oser la découvrir dans sa propre poitrine, il désire voir les grands esprits, les poètes, la sphère sacrée. Ce n’est pas précisément le hasard qui le conduit à Weimar, c’est là que sont Goethe et Schiller et Fichte, avec, à côté d’eux – comme de lumineux satellites autour du soleil -, Wieland, Herder, Jean-Paul, les frères Schlegel, toutes les constellations du ciel intellectuel de l’Allemagne. Respirer cette atmosphère supérieure, c’est l’aspiration de son être, qui hait, pour ainsi dire, tout ce qui n’est pas poétique : c’est là qu’il espère s’abreuver, comme d’un nectar, de l’esprit antique, afin d’essayer sa propre force sur cette Agora, dans ce Colisée de la lutte poétique. Mais il veut d’abord se préparer à ce combat, car le jeune Hölderlin ne se sent pas digne, intellectuellement, au point de vue de la pensée et de la culture, de prendre place à côté de Goethe, dont le regard embrasse l’univers, ou à côté de Schiller, dont l’esprit colosse se meut dans de formidables abstractions. C’est pourquoi – éternelle erreur des fils de l’Allemagne – il croit devoir se cultiver systématiquement et suivre, comme un étudiant, des cours de philosophie. Ainsi que Kleist, il fait violence à sa nature essentiellement spontanée et exaltée, en se contraignant à chercher une explication métaphysique de ce ciel qui remplit si heureusement son âme et à justifier ses projets poétiques par des doctrines philosophiques. Je crains bien qu’on n’ait encore jamais exprimé avec la franchise nécessaire combien fut alors fatale, non seulement pour Hölderlin, mais pour toute la productivité poétique de l’Allemagne, la rencontre avec Kant, l’étude de la métaphysique.
Et l’histoire traditionnelle de la littérature a beau continuer à voir un magnifique apogée dans le fait que les poètes allemands s’empressèrent alors d’accueillir les idées de Kant dans leurs royaumes poétiques, un esprit libre doit enfin oser constater les dommages qu’a fait subir à la poésie cette invasion du dogmatisme ratiocinant. Kant – j’exprime ici une conviction strictement personnelle – a infiniment entravé la pure productivité de l’époque classique, qui s’est laissé dominer par la maîtrise constructive de ses pensées; il a fait un tort infini à tous les artistes en leur ôtant une partie de leurs qualités concrètes, de leur allégresse naturelle, de leur libre imagination, pour les détourner stérilement vers un criticisme esthétique. Il a stérilisé d’une manière permanente les facultés purement poétiques de tout poète qui s’est donné à lui. Et comment donc quelqu’un qui n’était que cerveau, qui n’était qu’intellect, comment un si gigantesque bloc de glaciale pensée aurait-il pu jamais féconder véritablement la faune et la flore de l’imagination ? Comment cet homme, qui ne toucha jamais à une femme, qui ne dépassa jamais le cercle de sa ville provinciale, qui fit marcher automatiquement à la même heure du jour la plus petite dent des rouages de son mécanisme quotidien, et cela pendant cinquante ans, que dis-je ? pendant soixante-dix ans, comment, je vous le demande, une pareille anti-nature, un esprit si dépourvu de spontanéité, devenu lui-même un système rigide (et précisément son génie consiste dans cette constructivité fanatique) – comment aurait-il pu jamais être utile au poète, lui qui vit par les sens, lui qui est emporté dans les airs par le hasard sacré de l’inspiration, lui qui est constamment poussé par la passion dans l’inconscient ?
L’influence de Kant détourna les classiques de leur passion la plus magnifique, la plus poétique, qui avait la force et la couleur de la Renaissance, pour les rejeter insensiblement dans un nouvel humanisme, dans une poésie érudite. Ou bien, en dernière analyse, la poésie allemande n’a-t-elle pas éprouvé une infinie perte de sang lorsque Schiller, le créateur des figures les plus plastiques du génie allemand, se torture sérieusement, par un jeu de l’esprit, pour diviser la poésie en catégories, la poésie naïve et la poésie sentimentale, et lorsque Goethe disserte avec les frères Schlegel sur les classiques et les romantiques ? Sans le savoir, les poètes se stérilisent à la clarté outrée du philosophe, à la lumière froidement rationaliste émanant de cet esprit systématique qui ne connaît que des lois aussi strictes que celles régissant le phénomène physique de la cristallisation : précisément, quand Hölderlin arrive à Weimar, Schiller a déjà perdu la force impétueuse de sa première inspiration, où s’agite le Démon, et Goethe (dont la saine nature a réagi toujours activement, avec un instinct primitif d’hostilité contre toute métaphysique systématique) a tourné le principal de son intérêt vers la science. Dans quelles sphères rationalistes se mouvaient leurs pensées, c’est ce que nous dit encore aujourd’hui la correspondance de Goethe et de Schiller, ce magnifique document d’une géniale conception de l’univers, mais qui est infiniment plus la correspondance de philosophes ou d’esthéticiens qu’une confession poétique : au moment où Hölderlin s’approche des Dioscures, la poésie, sous la constellation magnétique de Kant, a quitté le centre de leur personnalité pour être reléguée à la périphérie. Une époque d’humanisme classique a commencé. Seulement, par un fatal contraste avec l’Italie, les plus puissants esprits de l’époque n’ont pas cherché, comme Dante, Pétrarque et Boccace, un refuge dans le domaine de la poésie, en quittant le monde glacé de l’érudition; au contraire, Goethe et Schiller sont sortis pour des années – qui, hélas ! ne reviendront pas de leur sphère divinement créatrice pour aborder la froideur de l’esthétique et de la science.
C’est ainsi également que chez tous les disciples qui regardent vers eux comme vers leurs maîtres prend naissance la funeste erreur de croire qu’ils doivent se cultiver, qu’ils doivent avoir une éducation philosophique. Novalis, cet esprit angéliquement abstrait, Kleist, cet homme aux impulsions transcendantes, tous deux natures auxquelles la froideur de l’esprit positif de Kant et de tous les philosophes qui l’ont suivi était absolument opposée, se jettent, par un sentiment d’incertitude, qui est tout le contraire d’un instinct, dans l’élément hostile. Et Hölderlin aussi, cet esprit essentiellement inspiré et illogique, dont la nature rejetait tout systématisme, cet homme en qui tout était sentiment et qui n’avait rien d’intellectuel, ni de volontaire, se ratatine dans l’étau des concepts abstraits, des analyses philosophiques : il se croit obligé d’employer le jargon esthético-philosophique de l’époque, et toutes les lettres qui datent de son séjour à Iéna sont remplies de plates ratiocinations, d’efforts aussi touchants que puérils pour philosopher, ce qui était si contraire à son être le plus profond, à sa sensibilité, qui allait jusqu’à l’infini. Car Hölderlin est, pour ainsi dire, le type d’un esprit anti-intellectuel ; ses pensées, qui souvent jaillissent grandiosement, comme des éclairs, de quelque ciel où réside le génie, restent absolument incapables de s’accoupler; leur chaos magique résiste à toute combinaison et à toute texture. Ce qu’il dit de l’esprit créateur : Je ne reconnais que ce qui fleurit naturellement. Ce qu’il médite, je ne le reconnais pas, marque parfaitement ses limites : il ne peut exprimer que le sentiment du devenir, il est incapable d’élaborer les schémas, les concepts de l’être. Les idées d’Hölderlin sont des météores, des pierres tombées du ciel et non pas des blocs issus de quelque carrière terrestre, aux faces bien polies et se superposant en un mur rigide (car chaque système est semblable à un mur). Elles sont librement disposées en lui telles qu’elles lui arrivent, sans qu’il ait besoin ni de les élaborer ni de les polir. Et ce que Goethe dit un jour de Byron est mille fois plus vrai encore d’Hölderlin : Il n’est grand que quand il fait acte de poète. Lorsqu’il réfléchit, il n’est qu’un enfant. Or, cet enfant, à Weimar, se met à l’école de Fichte et de Kant et il s’efforce si désespérément de se nourrir de leurs doctrines que Schiller lui-même se croit obligé de l’avertir : Fuyez autant que possible les sujets philosophiques, ce sont les plus ingrats… restez près du monde sensible, ainsi vous risquerez moins de perdre l’enthousiasme dans l’abstraction.
Et il faut du temps pour qu’Hölderlin reconnaisse le danger de l’abstraction précisément dans le labyrinthe de la logique : le plus fin baromètre – la diminution de sa production – finit cependant par lui montrer que lui, l’homme aérien, est venu échouer dans une atmosphère qui pèse sur sa sensibilité. C’est alors seulement qu’il rejette violemment loin de lui la philosophie systématique :
J’ai ignoré pendant longtemps pourquoi l’étude de la philosophie, qui d’habitude récompense, par le repos de l’âme, l’application acharnée qu’elle exige, pourquoi, dis-je, plus je m’abandonnais à elle sans réserve, et plus elle me rendait inquiet et même passionné. Et je me l’explique, maintenant, c’était parce que je m’éloignais plus que je ne le devais de ma propre nature. Pour la première fois, il reconnaît la puissance jalouse de sa vocation poétique, qui permet à l’éternel illuminé de s’abandonner aussi peu à l’esprit pur qu’à la vie matérielle. Son être exigeait un balancement entre l’élément supérieur et l’élément inférieur. Ni dans l’abstrait, ni dans la réalité concrète, son sens créateur ne pouvait trouver de repos.
Ainsi la philosophie trompe l’esprit d’Hölderlin, humblement en quête de recherches : elle donne à son âme oscillante de nouveaux doutes, au lieu d’un accroissement de certitude. Mais la seconde désillusion, la plus dangereuse, vient des poètes. De loin, ils lui étaient apparus comme des messagers du surnaturel, comme des prêtres qui élevaient vers Dieu le cœur des mortels ; il attendait d’eux l’exaltation de son enthousiasme – de Goethe et en particulier de Schiller, qu’il avait lu pendant des nuits entières à l’institut théologique de Tubingue et dont le Don Carlos avait été la nue enchanteresse de sa jeunesse. Il attend d’eux, lui qui est toujours dans l’incertitude, ce qui uniquement transfigure la vie, l’essor dans l’infini, une flamme toujours plus haute. Mais ici commence l’éternelle erreur de la seconde et de la troisième génération qui consiste à suivre les maîtres : elles oublient que les œuvres restent éternellement jeunes, et que le temps coule sur ce qui est parfait, comme l’eau sur le marbre, sans faire injure à sa beauté, mais que les hommes, même quand ils sont poètes, vieillissent fatalement. Schiller est devenu conseiller aulique, Goethe conseiller intime, Herder conseiller de consistoire, Fichte professeur d’université. Leurs intérêts ne sont plus maintenant ceux de la production poétique, ils concernent uniquement les problèmes que pose la poésie ; la différence est tout à fait nette. Tous sont déjà cristallisés dans leur œuvre ; ils sont ancrés dans la vie et rien n’est peut-être aussi étranger que sa propre jeunesse à l’être oublieux qu’est l’homme. Ainsi le malentendu qu’il y a entre eux est conditionné déjà par la différence des années : Hôlderlin attend d’eux de l’exaltation et ils lui enseignent la modération ; il brûle de trouver auprès d’eux une flamme plus forte et voilà qu’ils répriment son ardeur et ne lui permettent qu’une lumière tempérée. Il attend d’eux la liberté, l’existence spirituelle, et voilà qu’ils ne s’occupent que de lui procurer une position bourgeoise. Il veut se risquer à entreprendre la lutte terrible à laquelle l’appelle son destin, et voilà qu’ils lui conseillent, en croyant agir au mieux de ses intérêts, de conclure une paix honorable. Il veut brûler d’ardeur et, eux, lui recommandent le sang-froid : c’est ainsi que, malgré toutes les affinités intellectuelles et la sympathie particulière qui existent entre eux, la chaleur du sang qu’il y a dans les veines d’Hölderlin, en face de leur sang refroidi, aboutit forcément à une incompréhension.
Déjà la première rencontre d’Hölderlin avec Goethe est symbolique. Hölderlin fait une visite à Schiller, il trouve chez celui-ci un vieux monsieur qui lui pose froidement une question, à laquelle il répond avec indifférence, et c’est seulement dans la soirée qu’il apprend avec effroi que cette personne-là, c’était Goethe. Il n’a véritablement pas reconnu Goethe, ni cette fois-là, ni, intellectuellement parlant, aucune autre fois ; et Goethe, lui non plus, n’a jamais su voir ce qu’il y avait en Hôlderlin : exception faite de sa correspondance avec Schiller, Goethe ne le cite jamais, pas même dans une seule ligne, pendant une période de presque quarante ans. Et Hôlderlin, en revanche, était attiré vers Schiller, autant que Kleist vers Goethe : tous deux ne s’attachent, de tout leur amour, qu’à un seul des Dioscures, et avec l’injustice qui est innée chez la jeunesse, ils oublient totalement l’autre génie.
De son côté, Goethe ne méconnaît pas moins Hölderlin lorsqu’il écrit que les poésies de celui-ci expriment un paisible effort qui aboutit au contentement de soi-même, et il se méprend complètement sur la passion si profonde d’Hölderlin – lui qui n’est jamais satisfait – quand il vante en celui-ci un certain agrément, une certaine intimité et une certaine mesure et quand il l’engage – lui, le créateur de l’hymne en Allemagne, – à faire particulièrement de petites poésies. Le flair remarquable qu’a d’ordinaire Goethe pour découvrir la trace du démon lui fait ici absolument défaut ; c’est pourquoi il ne montre pas à l’égard d’Hölderlin cette attitude de réserve et de défensive qui lui est habituelle : il n’a pour lui qu’une douce bonhomie faite d’indifférence, et il se contente de l’effleurer d’un regard superficiel, sans aucune profondeur, ce dont fut tellement blessé Hölderlin que, bien longtemps après que celui-ci eut vu sa raison s’obscurcir (même dans cet égarement, il distinguait encore vaguement ses inclinations et ses antipathies d’antan), il se détournait avec colère quand un visiteur prononçait devant lui le nom de Goethe. Il avait eu la même déception que tous les poètes allemands de l’époque, cette déception que Grillparzer, plus froid de sensibilité et plus habitué à cacher ses sentiments, exprima enfin avec netteté : Goethe s’est tourné vers la science et, dans une sorte de quiétisme grandiose, il ne réclamait que de la modération et de la passivité, tandis qu’en moi brûlaient toutes les torches incendiaires de l’imagination. Même le plus sage des hommes n’était pas assez sage pour comprendre, devenu vieux, que la jeunesse n’est qu’un synonyme d’exaltation.
Stefan Zweig. Le combat avec le démon. Belfond 1983
8 07 1879
Charles de Saulses de Freycinet est ministre des travaux publics : il a programmé la mise en chantier de 3 000 kilomètres de lignes et répond à ses détracteurs qui ne pensent que bénéfices : Un tel raisonnement est un raisonnement privé, un raisonnement de négociant, mais ce n’est pas un raisonnement d’homme d’État… Dans les chemins de fer que vous établissez, il y a ce que vous voyez, c’est-à-dire le phénomène direct, immédiat, ressortant en quelque sorte de la proportion qui existe entre les dépenses et les recettes, entre la mise de fonds et le revenu que ces chemins de fer sont susceptibles de lui procurer… Mais il y a aussi ce qu’on ne voit pas et qui ne touche pas ce négociant, cette société, mais qui doit toucher l’État, placé à un autre point de vue. Il y a une économie énorme réalisée par le public sur ses transports.
17 07 1879
Adoption du plan Freycinet qui prévoit un programme de travaux destiné à porter le réseau ferré d’intérêt général de 29 600 kilomètres environ, dont 21 300 en exploitation, à 38 300, en y incorporant 8 800 km de lignes nouvelles à construire, incluant 2 500 km de lignes d’intérêt local déjà concédées. Ce plan qui permettait de desservir toutes les sous-préfectures sera quasiment achevé en 1914. Il sera très critiqué, tant dans sa conception que dans son exécution : Jusqu’aux vallées les plus reculées, les paysages de France sont striés de lignes de chemin de fer désaffectées que d’audacieux ouvrages d’art ponctuent. Ces improbables infrastructures sont les témoins de l’échec retentissant d’une politique volontariste de grands travaux. Le plan Freycinet a couvert la France d’un réseau de chemin de fer inutile et a contrarié la seconde révolution industrielle.
Charles de Saulces de Freycinet (1828-1923), polytechnicien, ministre des travaux publics de décembre 1877 à décembre 1879, puis président du Conseil et ministre des affaires étrangères, finit sa carrière politique en 1915-1916 après avoir été plusieurs fois ministre et ministre d’État. En 1878, il présente un ambitieux plan de modernisation des infrastructures. Outre des travaux sur les canaux et les ports, son but principal est d’étendre les chemins de fer par un dense réseau secondaire qui devait apporter la modernité et la République à une France rurale souvent hostile au nouveau régime.
Lors de la discussion du plan, les parlementaires se livrent à une incroyable démagogie ferroviaire sous prétexte d’établir une sorte d’égalité de tous les Français devant le chemin de fer. Chaque élu pense qu’une gare dans sa circonscription lui garantit la réélection : il est décidé que toutes les sous-préfectures auront leur gare.
À l’époque, ce sont des compagnies privées qui construisent et gèrent les chemins de fer. En 1883, l’État leur impose la réalisation du plan : 11 000 km de lignes nouvelles, soit une augmentation de 40 % du réseau. L’investissement total en chemins de fer jusqu’en 1914 représentera plus de 7 milliards de francs, soit deux fois le budget de l’État pour l’année 1883.
Les études de l’époque prévoient d’importants déficits pour ce réseau y compris de fonctionnement. L’État organise donc un complexe système de subventions et de garanties pour compenser les pertes des compagnies. Pour l’administration, ces lignes sont d’intérêt général, car sources d’économies. Le fret de marchandise coûte 30 centimes (la tonne par kilomètre) par route, contre 6 centimes par chemin de fer. Cette différence de 24 centimes constitue l’enrichissement permis par les nouvelles lignes. Les ingénieurs oubliaient que ce qui compte n’est pas l’économie réalisée mais son coût, car il existe des économies qui coûtent cher !
En 1900, l’économiste Paul Leroy-Beaulieu [3] parle de la folie Freycinet (…), débauche de travaux publics mal étudiés, mal dirigés, mal utilisés, qui a sévi partout depuis quinze ans. (…) Il leur semblait que tout travail public dût être nécessairement productif. Mais le plan sera mené quasiment à terme. Seules les insolubles difficultés budgétaires empêcheront de terminer certaines lignes dans les années 1920.
Au final, trois sous-préfectures seulement n’ont jamais eu de gare : Sartène, Barcelonnette et Castellane. Quant à Florac, Puget-Théniers et Yssingeaux, elles ont dû se contenter de chemins de fer à voie étroite. Ces derniers ont été réalisés par des départements en complément du plan Freycinet pour desservir leurs chefs-lieux de canton. Ils sont souvent construits sur les bas-côtés des routes, et l’écartement de leurs rails ne dépassait pas 1 mètre.
À cause de ce réseau Freycinet, les compagnies supportent un déficit moyen de 2,6 % par an entre 1883 et 1913. Mais les subventions publiques compensent ces pertes assurant des profits aux compagnies. Ainsi, malgré les déficits, la part des actions de chemins de fer dans la capitalisation boursière française, en déclin depuis 1850, remonte, passant de 41 %, en 1883, à 55 % en 1898.
Les déficits de ce réseau, la concurrence de l’automobile, l’inflation et les conditions sociales avantageuses de leurs salariés conduisent les compagnies à une quasi-faillite lorsqu’elles sont nationalisées par le Front populaire pour créer la Société nationale des chemins de fer français (SNCF). Elles ne pèsent plus alors que 6 % de la capitalisation boursière. Libérée des obligations des compagnies, la société publique entreprend très vite la fermeture des lignes les plus déficitaires.
Dès 1938, 4 500 km sont supprimés. Dans l’après-guerre, les chemins de fer électoraux sont massivement démantelés. Ils n’ont parfois fonctionné qu’une poignée d’années. Aujourd’hui, la presque totalité du réseau secondaire a été désaffecté. Le réseau actuel est quasiment revenu à celui de 1875 quand les compagnies pensaient, comme la SNCF aujourd’hui, que des lignes supplémentaires ne seraient pas rentables.
Paradoxalement, cette débauche d’investissement en infrastructures est accompagnée d’une longue stagnation économique. Le produit intérieur brut français de 1896 est égal à celui de 1882 alors que la population a légèrement augmenté. À cette époque, la France se fait rattraper puis distancer par les États-Unis et l’Allemagne. Lors de la seconde révolution industrielle, la France est en avance dans l’automobile, mais rate le démarrage de la chimie et de l’électrotechnique. En 1914, la Société centrale de dynamite, plus grosse entreprise chimique française, n’arrive qu’au 46° rang des sociétés cotées. Dans l’électrotechnique, Thomson-Houston est la 33° valeur et la Compagnie générale d’électricité (ancêtre d’Alcatel) occupe la 81°e place. Cette dernière cherche à concurrencer AEG et Siemens, mais elle dispose d’un capital social vingt fois inférieur.
Ce manque de capitaux surprend, car le commerce extérieur est excédentaire, les comptes publics équilibrés et l’épargne des Français abondante. Mais ils investissent au loin en achetant des titres étrangers. Très peu dans les colonies mais plutôt en Amérique et surtout en Europe centrale. C’est la grande épopée des emprunts russes que les banques revendent jusque dans les plus petits villages de France. Les capitaux auraient donc manqué en France, car ils étaient investis à l’étranger.
Cette critique est ancienne. Dès 1856, François Ponsard, un auteur dramatique alors en vogue, fait dire à l’un de ses personnages :
Ah ! Oui ! Le capital à nos champs infidèles
S’envole vers la Bourse où la prime l’appelle.
Et chez les étrangers fait pleuvoir les milliards
Sans qu’il en tombe un sou parmi nos campagnards.
En 1910, Keynes la reformule avec moins de faconde : Placer nos ressources à la disposition des économies étrangères puisse revenir à renforcer ceux qui, en définitive, pourraient nous surpasser et exporter nos capitaux, puisse à aboutir à un appauvrissement de nos concitoyens.
Mais le plan Freycinet fut tout aussi néfaste en immobilisant d’immenses capitaux dans des projets, certes français, mais inutiles et structurellement déficitaires. Avec le réseau secondaire, les capitaux manquent pour financer la seconde révolution industrielle. D’abord l’épargne, ressource rare, qui est investie dans les chemins de fer n’est plus disponible pour d’autres projets.
Ensuite, l’impôt prélève annuellement une partie des revenus des Français pour verser aux compagnies les subventions compensant leurs pertes d’exploitation. Les titres étrangers avaient au moins le mérite de verser des revenus encaissés en France.
En 2008, alors que le monde s’enfonçait dans la crise, une relance par les grands travaux fut envisagée avant que les contraintes d’endettement ne freinent les ambitions. Le jour où cette idée reviendra, il faudra garder à l’esprit que toutes les infrastructures ne sont pas bonnes par nature. Et se souvenir qu’avec les grands travaux du plan Freycinet, les Français se sont rapprochés de la gare, mais éloignés de l’avenir.
David Le Bris, enseignant-chercheur à Kedge Business School. Le Monde 12 juillet 2014
20 07 1879
Le baron suédois (né en Finlande) Adolf Erik Nordenskjöld, membre de l’Académie des Sciences de Stockholm, franchit le détroit de Béring en venant de l’océan arctique. Il avait appareillé le 4 juillet 1878 de Göteborg à la tête de deux vapeurs – la Vega, et la Lena -. Le 27 août, il laissait la Léna remonter le cours du fleuve éponyme jusqu’à Iakoutsk ; plus loin, il avait découvert sur les îles de la Nouvelle Sibérie l’habitat insolite de certains Toungouses, qui logeaient tout simplement dans les cages thoraciques de mammouths congelés ! Contraint le 27 septembre à un hivernage dans la baie de Kolioutchin à deux jours de navigation du détroit de Béring, les glaces ne libérèrent la Vega que le 18 juillet 1879 : le passage du Nord Est était forcé, et c’était un fantastique exploit. Il aura mis à profit l’hivernage – 294 jours – pour effectuer un remarquable travail d’ethnologie sur les Tschuktschis, leurs voisins pendant toute cette période, qui avaient pris l’habitude de fréquenter assidûment le pont de la Vega.
Et, ne serait-ce que pour savoir comment on parvient à éviter les drames, il faut bien parler de temps à autre des trains qui arrivent à l’heure : Le succès de Nordenskjöld tient avant tout à l’expérience qu’il a tiré de ses expéditions antérieures dans l’Arctique : il avait observé que dans la dernière quinzaine d’août, le réchauffement – tout relatif – des eaux des fleuves sibériens entraînait celui des eaux de la côte et qu’il existait en conséquence ce que l’on appelle aujourd’hui une niche climatique d’une quinzaine de jours, pendant lesquels la navigation ne devait pas poser de problèmes, c’est à dire ne connaître que des eaux libres : il s’en fallu de quelques jours pour qu’il ait vu juste sur toute la ligne et qu’il parvienne à forcer le passage du Nord Est sans avoir à effectuer un seul hivernage.
La préparation matérielle avait elle aussi été très soignée : tous les hommes restèrent en bonne santé : aucun cas de scorbut, cela étant probablement en grande partie dû au remède souverain qu’est la confiture de multer, la baie jaune des marais, ou ronce faux mûrier – Rubus chamæmoreus -, fruit que l’on trouve sous les hautes latitudes de Scandinavie : la récolte n’avait pas été abondante et ils n’avaient pu en prendre autant qu’ils l’auraient voulu, le remplaçant à la fin par du jus de canneberge. Ils avaient pris soin aussi d’emporter des pommes de terre fraîches [4], des animaux vivants : les deux cochons du bord furent sacrifiés pour Noël.
Les expéditions organisées par des Scandinaves ne furent pas toutes couronnées de succès ; ils eurent parfois des morts, mais jamais ils ne connurent les épouvantables et fréquents drames des autres, longs calvaires avant que d’arriver à l’issue fatale, la mort ; logistique impeccable, longue et méthodique préparation, absence d’à priori dangereux et observation des us et coutumes des populations vivant au quotidien dans ces conditions extrêmes pour les faire leur : presque toujours, c’est un modèle de méthode et de pragmatisme.
Nordenskjöld avait considéré que les conditions tout de même très difficiles, dues essentiellement à la glace dans la partie orientale de la route ne permettait pas son exploitation. Mais, un bon siècle plus tard, les choses auront changé, et, réchauffement climatique aidant, – tout revers de médaille a son endroit – le passage du nord-est deviendra accessible à des navires marchands, l’intérêt de ce trajet résidant avant tout dans les réduction des distances qu’il permet : de Busan au sud-Japon ou Yosu, tout proche en Corée du sud, à Mourmansk, dans la mer de Barents : 9 812 km en 18 jours, contre, via le canal de Suez, 19 470 km en 37 jours. Si l’on veut calculer le bénéfice final de l’affaire, on ne peut se contenter d’une équation aussi simple :
Pour aller d’Europe en Chine, mettons qu’il faille vingt-cinq jours et 625 tonnes de fioul par la RNE – Route du Nord-Est – contre trente-cinq jours et 875 tonnes de fioul par le canal de Suez. Entre 2004 et 2011, la tonne de fioul est passée de 200 à 700 $. Avec 10 jours de navigation gagnés, l’économie sur le fioul est de 175 000 $, sans parler des salaires. Dès lors, la location obligatoire d’un brise-glace russe n’est plus un problème. La traversée du canal de Suez coûte 140 000 $. Si vous avez un navire de 25 000 tonnes, le coût revient à 5.60 $ la tonne. D’où le tarif mis en place par Rosatomflot d’environ 5 $ la tonne pour la location du brise-glace.
Yakov Antonov, directeur commercial Mourmansk Shipping Company qui gère les brise-glace atomiques russes.
La location d’un brise-glace russe [à même de tracer une voie à une vitesse de 4 nœuds, en brisant une glace de 2.30 mètres d’épaisseur !] coûte entre 300 000 et 400 000 $, auxquels il faut ajouter une assurance spéciale et les cartes de navigation à acheter aux Russes. Mais si je gagne vingt jours de transport, j’économise 15 000 à 20 000 $ de carburant par jour. Et je n’ai pas à payer d’assurance en cas d’attaque par des pirates au large de la Somalie, ni à engager des gardes armés sur mon navire, ni à payer la traversée du canal de Suez.
Patrick Mossberg, de Marinvest, compagnie maritime suédoise basée à Göteborg.
Au sein des grandes compagnies maritimes, les calculettes doivent faire des heures supplémentaires. Les paramètres évoqués ne sont pas exhaustifs … Il faut encore y ajouter par exemple l’obligation pour fréquenter ces eaux glacées de navires à double coque, bien évidemment plus chers à la construction que les navires à coque simple, amortis depuis des décennies, et assez souvent pourris.
Cette route, nouvelle commercialement parlant, vient évidemment concurrencer directement les routes traditionnelles via le canal de Suez ou de Panama, mais aussi l’autre route nouvelle : le passage du nord-ouest. Sur le plan environnemental, les données sont sensiblement identiques, mais cette route du nord-est dispose de deux atouts politiques considérables qui lui donnent une bonne longueur d’avance : elle est bordée par un seul État, la Russie, qui maîtrise l’ensemble de la côte, quel que soit la réalité de l’indépendance des nouvelles républiques, et en plus c’est un État qui n’a que les apparences d’une démocratie, c’est-à-dire que les décideurs peuvent encore décider vite sans rendre de comptes à personne. De l’autre coté de l’Atlantique, il faut commencer par négocier : négocier entre plusieurs États, le Canada évidemment, mais encore les États-Unis, le Danemark qui a encore un droit de regard sur les côtes du Groenland, et il faut négocier aussi avec de nombreux partenaires, dont les écologistes qu’effraie à juste titre une possibilité de marée noire dans ces endroits-là… tout cela n’est pas source de rapidité dans la décision.
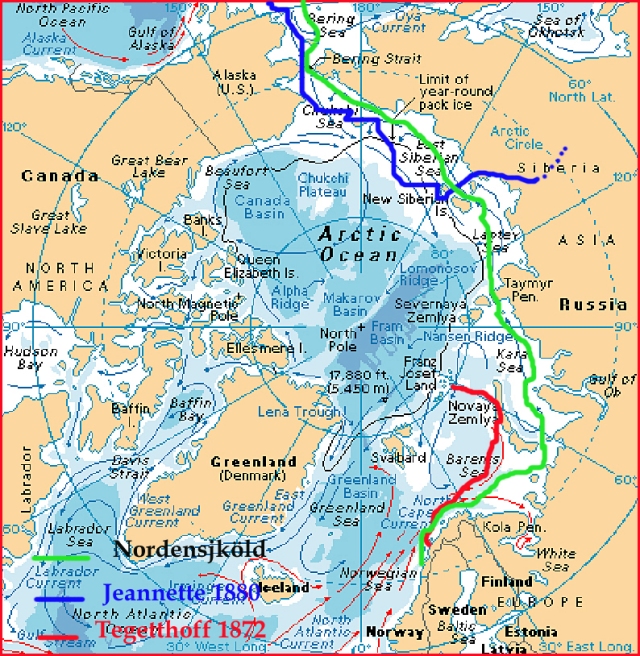

Nordenskjölds et la Vega
07 1879
Paris se dote du premier réseau téléphonique du monde. Mulhouse en fera autant un an plus tard.
4 08 1879
L’Alsace Lorraine obtient une administration et une représentation régionales, sous le contrôle d’un gouverneur : Statthalter.
Automne 1879
Le capitaine anglais Charles Cunningham Boycott a quitté l’armée pour se faire gentleman farmer en Irlande, où il administre les terres – 15 000 ha – de John Crichton, troisième comte Erne. À l’appel du dirigeant de la Ligue Agraire (Land League), Charles Stewart Parnell et face à de mauvaises récoltes, les fermiers s’étaient coordonnés afin de demander au comte Erne une réduction de 25 % de leurs loyers. Celui-ci s’en tenait à un 10 %, inacceptable pour les fermiers : il avait refusé et avait envoyé le capitaine Boycott expulser les mauvais payeurs : trois familles sont chassées. Mais c’est un blocus qui l’attend et les fermiers iront jusqu’à sacrifier toute une récolte. Cet isolement extrême force Boycott à faire appel à des ouvriers d’Irlande du Nord pour sauver ses récoltes. Mais leur venue, sous escorte militaire, coûte une fortune : près de 10 000 livres sterling pour sauver une moisson d’une valeur de seulement 350 livres. Qui plus est, ils arriveront trop tard. Cette tentative ruine Boycott, qui finit par quitter l’Irlande en disgrâce. Charles Cunningham Boycott sortira de cette affaire ruiné, sans même avoir la consolation de savoir qu’il allait laisser son nom à la postérité.

Agitation agraire en Irlande. Des fermiers d’Ulster escortés par des soldats se rendent à la ferme du capitaine Charles Boycott pour y travailler. © www.alamy.com / Alamy Stock Photo / Abaca

Charles Cunningham Boycott.© www.alamy.com / Alamy Stock Photo / Abaca
18 12 1879
L’Anglais Joseph W. Swan invente la lampe sous vide à filament de carbone. Mais il se fera piquer la notoriété de l’invention par Thomas Edison. Obligé par décision de justice de s’associer avec Swann pour produire les lampes Ediswann, Edison obtiendra gain de cause sur un point dix ans plus tard, la justice lui reconnaissant l’invention du filament de carbone de haute résistance, sans savoir qu’il avait arraché des pages prouvant qu’il n’avait fait qu’améliorer les procédés mis au point par Swann.
L’éclat nouveau de l’électricité, comparable à celui du soleil, ne pouvait être supporté ; et l’effet de prodige l’emportant trop sur celui de familiarité, la lampe à arc, n’éclaboussait guère la gloire tranquille du gaz. Comme on le sait, l’obstacle fût levé grâce à l’invention par Edison de la lampe à incandescence et à filament en 1879 : désormais, la lumière électrique devenait divisible en de multiples foyers d’intensité moyenne, et entrait ainsi en concurrence directe avec l’éclairage public au gaz, auquel elle allait pouvoir opposer un confort visuel comparable, une sûreté accrue et une plus grande propreté. L’électricité n’était plus réservée à une illumination puissante, mais se révélait également capable d’éclairer avec mesure. La révélation de ces aptitudes et de cette souplesse nouvelles fut faite aux Parisiens lors de l’Exposition internationale d’électricité qui eut lieu pendant l’été 1881 au Palais de l’Industrie. Le processus de vulgarisation se poursuivit jusqu’à l’Exposition universelle de 1889, restée dans les mémoires comme une grande fête électrique.
Simone Delattre Les douze heures noires. La nuit à Paris au XIX° siècle
Hiver 1879 – 1880
On passe la Loire avec des chars à bœufs : pour en arriver là, il a fallu que la température descende pendant plusieurs jours en-dessous de – 20°.
1879
La Marseillaise devient hymne national. La Seine gèle à Paris.
Paul Bert estime que les Jésuites sont aussi nuisibles que le phylloxera, et Jules Ferry que l’horreur des Jésuites est un sentiment national en France
Pasteur découvre le principe du vaccin ; il avait aussi découvert la pasteurisation, qui s’appliquait tout d’abord au vin – 57° -, à la bière, cidre vinaigre et lait – 63° -. L’institut Pasteur sera fondé le 14 11 1888.
Pierre Victor Galtier est professeur de pathologie des maladies infectieuses à l’École Vétérinaire de Lyon. Il a déjà recommandé depuis longtemps la stérilisation du lait par chauffage pour éviter la transmission du bacille de Koch, la bactérie responsable de la tuberculose :
En 1879, Pierre Victor Galtier débute ses travaux sur la rage et fait une première observation majeure: le virus de la rage, injecté dans le sang des moutons, ne provoque pas la maladie, mais au contraire, les rend insensibles à celle-ci. Il vient de démontrer qu’il est possible d’obtenir une réaction immunitaire protectrice contre le virus de la rage.
Le 1° août 1881, il fait une communication de ses résultats à l’Académie des sciences. Il vient d’ouvrir la route au vaccin, mais sait aussi que la route sera encore longue. Pierre Victor est conscient que Benjamin Jesty a traité ses enfants avant qu’ils ne contractent la variole, de même, ses moutons ont été vaccinés avant qu’on leur inocule le virus de la rage.
Dans la vie réelle, ce n’est pas comme cela que les choses se passent : comment guérir des animaux qui ont déjà contracté la maladie? Un vaccin peut-il agir sur des personnes déjà infectées ? Il observe alors que chez le chien, principal vecteur de la maladie, la durée d’incubation est très longue, il faut parfois plus d’un an avant que n’apparaissent les premiers symptômes. Peut-être qu’une préparation vaccinale, même inoculée après la morsure, aurait suffisamment de temps pour induire une réaction immunologique efficace. Pour poursuivre ses recherches il faut à Pierre Victor un modèle animal plus simple que le chien, animal dangereux, long à déclencher la maladie.
Il fait alors sa deuxième observation majeure : le lapin, inoculé par la salive d’un chien enragé, développe rapidement la maladie et peut être un modèle expérimental adéquat pour des observations rapides et sans danger.
Louis Pasteur a connaissance de ces données et s’y engouffre. Mais à ses yeux, il n’y a pas de place pour deux découvreurs et plutôt que de rendre justice aux travaux de Pierre Victor, il s’efforce de dénigrer ses observations en mettant en avant quelques observations inexactes du Lozérien. Ainsi, Pierre Victor pense que le virus ne siège que dans les glandes linguales et dans la muqueuse bucco-pharingienne du chien. Pasteur montre qu’il se développe principalement dans les centres nerveux, avant de se propager aux glandes salivaires par le système nerveux sensoriel et autonome.
Mais le futur illustre savant ne peut s’échapper de la route ouverte par Pierre Victor Galtier. Travaillant sur le lapin, Louis Pasteur revendique la mise au point des méthodes d’atténuation du virus par la soude caustique ou la dessiccation. En fait, il a tellement peu de considération pour les autres qu’il s’accapare sans vergogne la paternité des travaux de ses propres collaborateurs, tant et si bien qu’on ne sait plus très bien aujourd’hui si c’est lui, ou son collaborateur Emile Roux, qui parvient à l’inactivation du virus de la rage.
Louis Pasteur n’en était pas à son coup d’essai en la matière : en 1881, il avait déjà fait état à l’Académie de Médecine d’une méthode d’inactivation du virus du charbon, le fameux Anthrax, par l’oxygène. Pour montrer l’efficacité de son procédé, il avait proposé de traiter vingt-cinq moutons. Expérience faite, les moutons vaccinés étaient bien devenus résistants au virus du charbon, mais Louis Pasteur avait oublié de mentionner que le virus utilisé dans cette expérience avait été atténué, non par l’oxygène, procédé qui ne fonctionnait pas, mais par le bichromate de potassium, processus mis au point par ses collaborateurs Charles Chamberland et Emile Roux. Pasteur avait oublié de mentionner qu’il les avait obligés à ne pas publier leurs données ! En 1938, André Loir, neveu de Pasteur révéla la vilaine histoire.
Mais évaluer la vaccination chez l’homme, c’est une autre histoire. En 1883, Pierre Victor Galtier considère que les études ne sont pas assez avancées pour tenter l’expérience, trop risquée. Le gouvernement anglais lui propose néanmoins d’expérimenter sur des condamnés à mort, mais il refuse, car ses préparations doivent faire l’objet d’une caractérisation plus poussée. Louis Pasteur, quant à lui, ne s’embrasse pas d’autant de scrupules et propose à l’empereur du Brésil de tester ses préparations sur des détenus condamnés à la peine capitale, mais ce dernier refuse.
[…] En 1907, l’Institut royal de Stockholm proposera de décerner son prix Nobel de médecine à celui qui avait principalement contribué à la découverte du vaccin contre la rage. Louis Pasteur ? Non, c’est Pierre Victor Galtier qui est inscrit sur les tablettes. Malheureusement, le sort va encore une fois en décider autrement, car l’intéressé décède le 24 avril 1908, quelques semaines seulement avant que le jury Nobel ne délibère !
Bernard Bourrié. Passeurs d’Histoire(s) Mille ans en Languedoc et en Roussillon. Le Papillon rouge éditeur 2016
Pauline Kergomard devient déléguée générale de l’inspection des salles d’asile. Nommée par le directeur de l’instruction publique Ferdinand Buisson, homme politique et philosophe et protestant libéral comme elle, Pauline Kergomard est chargée de veiller au bon fonctionnement de ces établissements qui accueillent alors près de 700 000 enfants âgés de 3 à 6 ans. Sous son impulsion, le décret du 2 août 1881 transforme les salles d’asile en écoles maternelles. Ce n’est pas juste un changement de terminologie, précise Catherine Valenti. Il n’est plus question de garderies, mais de véritables écoles où sera dispensé un enseignement spécifique, destiné à éveiller le corps et l’esprit des très jeunes enfants.
En 1856, Pauline Kergomard avait 18 ans quand elle décrocha brillamment le brevet supérieur, la voilà institutrice !Marquée par les valeurs protestantes, faites de tolérance et d’attachement à la liberté, mais aussi par les engagements politiques de sa famille, Pauline refuse de prêter serment à l’empereur Napoléon III, explique l’historienne Catherine Valenti, autrice d’une biographie sur le personnage (éditions Memoring, 2024). Plutôt que d’enseigner dans une école publique, elle s’emploie comme préceptrice pour les rejetons des familles protestantes aisées de Bordeaux. Cinq ans plus tard, elle s’était installée à Paris et avait épousé, en 1863, le poète et journaliste Jules Duplessis-Kergomard, rencontré dans les milieux anarcho-républicains.
Dans la capitale, Pauline Kergomard repris bientôt son travail d’institutrice et était devenue directrice d’une école privée, tout en publiant ses premiers textes sur la pédagogie. Contredisant les méthodes appliquées à l’époque basées uniquement sur la mémorisation, elle misait quant à elle sur un apprentissage axé sur le jeu et la pratique. Elle s’opposait également aux devoirs à faire le soir à la maison pour les élèves de primaire : Un devoir du soir à des enfants de 6 ou 7 ans, qui devraient être au lit à la nuit tombante, écrivait l’intéressée en 1877. Et dans quelles conditions aggravantes ! Tout le monde connaît les installations des ménages d’ouvriers : la place est exiguë, la table et les chaises sont à hauteur d’homme et non à hauteur d’enfant, l’éclairage est défectueux. L’enfant non surveillé ou mal surveillé prend des attitudes funestes, il se gâte la vue, il dort sur son cahier. De sorte que cette chose insensée : faire travailler un enfant le soir devient une chose coupable.
C’est à cette période que l’institutrice commence à s’intéresser plus spécifiquement à la petite enfance. À l’époque, si l’école primaire accueille les enfants à partir de 7 ans, les enfants plus jeunes sont eux envoyés dans des salles d’asile. Ces garderies mises en place dans la première moitié du XIXe siècle évitent ainsi aux enfants dont les parents travaillent à l’usine d’être abandonnés à la rue. Les salles d’asile ont plus une volonté sociale qu’éducative, précise Catherine Valenti. Mais progressivement, les pédagogues commencent à se dire qu’on ne peut pas se contenter simplement de garder ces enfants, il faut leur dispenser une éducation conforme à leur âge ; que c’est important de ne pas laisser leur esprit en friche.
L’inspectrice met un point d’honneur à transformer ces lieux d’accueil à connotation charitable et donc excluant toute mixité sociale, en des espaces d’apprentissage permettant à toutes les catégories sociales de se côtoyer. L’enfant se façonne avec une facilité merveilleuse, d’après le milieu dans lequel il vit ; voulez-vous qu’un enfant soit musicien, faites-lui un milieu musical…, explique-t-elle, convaincue que le seul déterminisme existant est bien social, non génétique. Pour cela, elle prône une école accordant liberté et respect à l’enfant qui la fréquente. L’enfant […] était regardé comme un être destiné à recevoir autoritairement, en masse, sans tempérament ni nuances, une certaine quantité de notions intellectuelles et une non moins lourde quantité de notions morales ; quant à préparer le terrain avant de le soumettre à cet ensemencement inconsidéré, on n’y avait point songé…, poursuit Pauline Kergomard, pour qui le petit enfant est une personne à part entière. Ce qui n’est pas forcément évident à l’époque, rappelle Catherine Valenti : Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, on considère que les enfants de moins de 7 ans – l’âge de raison – ne sont pas des personnes très intéressantes. Pauline Kergomard est à l’origine de la notion d’éveil des plus petits ; la leçon de chose est vraiment au centre de sa pédagogie pour les classes maternelles. Elle part du quotidien des enfants, de leur univers sensible, et, à partir de là, elle va les éveiller au monde qui les entoure.
Dans son ouvrage L’éducation maternelle dans l’école, Pauline Kergomard explicite sa pédagogie : L’enfant prend des leçons de choses dès le berceau. Grâce à la curiosité de ses yeux avides de voir, de ses doigts avides de toucher, de ses narines avides de sentir, de ses oreilles avides d’entendre, de son palais avide de goûter, les leçons se succèdent, se multiplient, se lient entre elles et se confondent. […] La leçon que l’enfant a provoquée est, pour lui, la meilleure ; essayons de la lui faire provoquer. En tout cas, amenons-le à la désirer. Rien de plus facile à l’école. Si, en effet, l’école maternelle est ce que nous la rêvons, si l’enfant a été autorisé à y apporter le matin l’objet qui l’intéresse, s’il est libre de ses mouvements au lieu d’être assis, s’il est dans le jardin au lieu d’être dans le préau, et, par conséquent, dans des conditions favorables aux découvertes, la directrice doit s’attendre à une infinité de questions. Inspectrice générale des écoles maternelles à partir des années 1880, elle va sillonner la France pendant près de trente ans pour dispenser ses conseils aux institutrices, jusqu’à sa retraite en 1917. Un véritable sacerdoce, au point d’être qualifiée de sainte laïque par le journal La Lanterne en 1886.
Plus de 100 après, les principes pédagogiques de Pauline Kergomard sont encore d’actualité, reconnaît Catherine Valenti : Si on regarde encore aujourd’hui les directives qui sont données pour les écoles maternelles par l’Éducation nationale, on retrouve les principes qu’elle a instaurés : l’idée d’éveiller les enfants, d’être attentifs à leurs besoins, de se mettre à leur hauteur… Elle reste une référence encore aujourd’hui. Et on doit aussi à la Bordelaise d’autres créations, comme Mon Journal, le premier magazine destiné aux enfants qui apprennent à lire. Une manière selon elle d’exciter leur curiosité : Cette publication mensuelle renferme des récits, des historiettes, des anecdotes instructives et amusantes, des leçons de choses, des jeux, de petits modèles de travaux manuels et, par-dessus tout, des devinettes qui ont le don de piquer l’émulation des petits lecteurs, d’autant plus que les gagnants ont droit a une récompense… Pauline Kergomard est aussi l’instigatrice de la Société du sauvetage de l’enfance, une institution qui a pour but de lutter contre les violences et les abus faits aux enfants. Cette initiative privée est en quelque sorte les prémices de l’Aide sociale à l’enfance, puisque l’idée sera reprise par les pouvoirs publics à la fin du XIX° siècle.
Cent ans après sa mort, l’héritage de Pauline Kergomard est encore bien présent. On lui doit une structure éducative éminemment moderne, socle de l’apprentissage en France encore aujourd’hui. Et si une centaine écoles maternelles portent son nom dans l’Hexagone, son nom reste méconnu du grand public, contrairement à d’autres figures de la pédagogie du XX° siècle comme Maria Montessori ou Élise et Celestin Freinet.
Gautier Demouveaux Ouest France L’édition du soir. 12 février 2025
H.J. Lawson invente la transmission par chaîne sur la roue arrière des vélos : mais la mode est encore au grand bi, et la nouveauté va rester dans l’ombre plusieurs années.
Ferdinand de Lesseps et son fils Charles lancent à Paris la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama, qui émet des actions, et surtout, en quelques semestres, des obligations, pour le total énorme de 850 millions de francs or.
Des projets de percement d’un canal, il y en avait déjà eu, dès la conquête des Amériques, mais Philippe II avait coupé coup d’un royal et péremptoire : l’Homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Dès 1855, une société américaine avait équipé l’isthme d’une voie ferrée. Deux ans plus tôt, un lieutenant de vaisseau français, Lucien Napoléon Bonaparte-Wyse (1845-1909, petit-fils de Lucien, frère de l’empereur), avait exploré l’isthme, avec le géographe Armand Reclus (1843-1927) et négocié avec la Colombie une concession classique, purement technique et financière, dès 1878, concession que de Lesseps père et fils rachèteront à Lucien Napoléon Bonaparte-Wyse pour 93 millions de francs. Un congrès de scientifiques, qui s’est tenu à Paris quelques mois plus tôt, a approuvé le projet de canal de 72 km entre Limon Bay et Colon (côté océan Atlantique) et Panama Bay (côté océan Pacifique) de Lesseps. De chaque côté, près de 1 800 mètres avaient été creusés.
Émile Justin Menier – les chocolats Menier – avait acheté en 1862, 1 500 hectares au Nicaragua, puis, en 1865 avait fait défricher 6000 hectares à une quinzaine de kilomètres du bord du Lac Nicaragua, où 25 000 plants de cacao étaient irrigués, sur un site qui tentait de concurrencer le projet du Canal de Panama, estimé à un milliard de francs quand celui du Nicaragua n’était que de 700 millions. Malgré ce coût supérieur de 47 %, c’est le projet De Lesseps qui l’emportera. Mais l’idée ne sera jamais abandonnée et le premier coup de pioche du canal du Nicaragua sera donné en décembre 2014.
Deux ans plus tard, on trouvera dans l’équipe des ingénieurs chargés du tracé un certain Robert E. Peary, âgé de 25 ans qui découvre en tremblant le récit par le baron Adolf Erik Nordenskjöld de sa traversée du nord-est. C’est pour lui la voie menant au plus convoité des trophées d’exploration, le pôle nord géographique. Je ne serai satisfait de mes efforts que lorsque mon nom sera connu d’un bout à l’autre de la terre, écrit-il à sa mère. Ses premières expéditions en arctique commenceront dix ans plus tard, avec deux ans au Groenland en 1891 et 1892.

1° Convention internationale pour les brevets.
Johann Georg Halske et Werner von Siemens, ingénieurs allemands, réalisent le première locomotive électrique. On doit encore à Siemens le tramway avec deux rails conducteurs, le principe de la dynamo en 1866, les premières grandes lignes télégraphiques entre Berlin et Francfort en 1849, encore des lignes télégraphiques entre l’Inde et l’Europe de 1868 à 1870, plusieurs câbles transatlantiques à partir de 1874.
Lorient lance le plus grand cuirassé français, de 9 660 tonneaux : La Dévastation. L’Anglais Dugald Clerk conçoit le moteur à deux temps ; le Français Thiers le réalisera en 1910.
Jean Estéril Charlet-Straton, Prosper Payot et Frédéric Folliguet, tous guides de Chamonix, escaladent le Petit Dru, 3 733 m., à coté de l’Aiguille Verte.
En Norvège, le ski devient jeu, puis sport rapidement gagné à la compétition : Ce fût seulement en 1879, lorsqu’un fils des paysans de télémark, un jeune cordonnier, passa d’un saut vigoureux et élégant, le tremplin du Iver Slökken, puis de Christiania, que commença l’ère nationale du ski norvégien : ainsi qu’un météore, le jeune homme tomba au milieu de la foule ébahie qui se tenait là comme ensorcelée…
Les habitants de Télémark furent invités et vinrent aux courses de Christiania, les hourras montèrent aux cieux, l’air en trembla et les vieux astres qui entourent Husby Hugel en tressaillirent.
Huitfeld
Ceci n’empêchant pas que des gravures rupestres norvégiennes et des skis fossiles suédois font remonter les origines du ski à 2 500 ans avant J.C. Jordanès et Procope, des historiens byzantins du VI° siècle, en énumérant les noms des peuples septentrionaux, parlent des Skrithiphinoi, les Finnois qui vont sur des skis, c’est à dire les Lapons.
Adolf Erik Nordenskjöld, rapporte : Comme moyen de transport en usage chez les Tschuktschis, il faut encore citer la raquette, dont la forme diffère beaucoup de celle employée par les Lapons. En hiver, les naturels se servent constamment de ces patins et ne comprennent pas qu’on puisse marcher sans en être muni. Un jour, ils s’apitoyèrent longtemps sur la fatigue qu’un matelot de la Vega avait dû éprouver en faisant un trajet de trois kilomètres sans avoir les pieds garnis de ces appendices. Les Tschuktschis emploient en fait deux espèces de ces patins : la plus petite est la plus commune, la seconde, de forme allongée, est au contraire assez rare. M. Nordenskjöld ne vit qu’un seul Tschuktschis muni de cet espèce de ski, et ne comprit son utilité que lorsqu’il trouva dans un livre japonais une vignette représentant un naturel qui s’en servait pour glisser sur la neige… tiré par un renne !
Charles Rabot et Charles Lallemand, résumé des notes de Nordenskjöld.
Plus à l’est, dans l’extrême nord du Canada, ce sont des traîneaux que font glisser les Eskimos : Un traîneau eskimo varie entre douze et dix-huit pieds de long, alors que la hauteur de ses patins ne dépasse guère dix centimètres. Les patins sont d’acier ; mais l’acier ne glisse pas sur la neige, l’acier colle. La neige s’y plaque en mottes et empêche la traîneau de glisser. Pour y remédier, les Eskimos ont un moyen à eux. Pendant l’été, ils ramassent de la boue au fond des lacs, en font des tas. Quand l’hiver arrive, ils prennent cette boue gelée, la font bouillir dans un grand pot sur la lampe à huile, puis l’étalent tout bouillante sur le patin en une couche informe qui gèle instantanément. Ils prennent alors un rabot – emprunté au Blanc, s’il y en a un dans les parages – ou une vieille lime, et façonnent la couche de boue de façon à lui donner une forme parfaite (elle se rabote aussi facilement qu’une planche). L’opération suivante se fait avec un pot d’eau et un carré de peau d’ours : nanurak. L’Eskimo prend dans sa bouche une grande gorgée d’eau froide (ce qui la réchauffe un peu), en crache une partie sur le carré de peau et l’étale d’un bout à l’autre du patin, en courant le long du traîneau. Cette course aller-retour est comique, mais elle a pour résultat, l’eau gelant tout de suite, d’enduire le patin d’une couche de glace très égale et très fine. Une fois fait, vous pouvez remuer le traîneau avec le petit doigt tellement il glisse bien. L’opération du glaçage a lieu avant chaque départ et se répète souvent en route, des parties de l’enduit s’étant cassées et détachées.
Gontrand de Poncins. Kablouna. Stock 1947
Dans l’empire ottoman, l’heure n’est pas aux périphrases pour dire tout le mal que l’on pense des Arméniens, et c’est le grand vizir en personne qui parle : Aujourd’hui, même l’intérêt de l’Angleterre exige que notre pays soit à l’abri de toute intervention étrangère et que tout prétexte à cette intervention soit éliminé. Nous, Turcs et Anglais, non seulement nous méconnaissons le mot Arménie, mais encore nous briserons la mâchoire de ceux qui prononceront ce nom. Aussi, pour assurer l’avenir, dans ce but sacré, la raison d’état exige que tous les éléments suspects disparaissent.
Nous supprimerons donc et ferons disparaître à jamais le peuple arménien. Pour y parvenir rien ne nous manque : nous avons à notre disposition les Kurdes, les Tcherkesses, les gouverneurs de province, les percepteurs, les agents de police, en un mot tous ceux qui font la guerre sainte à un peuple qui n’a ni armes ni moyens de défense. Nous, au contraire, nous avons une armée et des armes, et la protectrice de nos possessions en Asie Mineure est la plus grande et la plus riche des puissances du monde.
Un prêtre catholique allemand, Schleyer, crée une langue universelle : le volapük : malgré le soutien du Vatican, cette langue, trop proche de l’anglais, trop compliquée, fût rapidement supplantée par l’espéranto, création du Dr Lejzer Zamenhof, oculiste polonais et juif ; on parlait couramment cinq langues à Bialystok, sa ville de naissance, en Lituanie, devenue prussienne en 1795, russe en 1807, polonaise en 1921, soviétique en 1939, allemande en 1941 et polonaise depuis 1945… L’espéranto séduisit une bonne brochette d’intellectuels par sa simplicité, commença à être utilisée au sein du mouvement international ouvrier, mais ne survécut pas à la grande guerre. Là encore, il n’avait pas voulu réaliser qu’une langue est un truc aussi compliqué et mystérieux qu’un être humain ; et de fait, cela ne marcha jamais : on compte un siècle plus tard au plus cent mille personnes le parlant, dispersées sur quatre vingt trois pays.
De Gaulle, bien conscient qu’une langue a une âme, des parents, un environnement spécifique de naissance, leur brossera une courte épitaphe en 1961 : Dante, Goethe, Chateaubriand, n’auraient pas beaucoup servi l’Europe s’ils avaient été des apatrides et s’ils avaient pensé, écrit en quelque espéranto ou volapük intégrés.
*****
La République s’ancre de plus en plus, avec pour ciment politique l’anticléricalisme, dans un pays qui compte 95 % de catholiques. Son arme de prédilection : l’Instruction Publique. Jusqu’en 1914, aucun ministre catholique ne sera admis au gouvernement.
De 1879 à 1914 s’effectue la plus vaste épuration administrative de toute l’histoire de la France : juges, bâtonniers, avocats se voient privés de leurs emplois ou mis à la retraite d’office par décision du Parlement et du gouvernement, rompant avec le libéralisme affiché. De haut en bas, du Conseil d’État aux corps préfectoraux, jusqu’aux plus modestes catégories de fonctionnaires, une épuration clientéliste et colonisatrice cherche à imposer l’idéologie dominante. Bien que le parti monarchiste ne fomente aucun complot, Freycinet déclare les membres des anciennes familles régnantes hors la loi par leur naissance, et fait promulguer la Loi d’exil du 22 juin 1886, en vigueur jusqu’en 1950. Ces entorses aux libertés publiques témoignent inversement de la peur ou de la fragilité de la nouvelle République, solitaire dans une Europe composée d’empires et de royaumes.
Stéphane Giocanti. Maurras, le chaos et l’ordre. Flammarion 2006
Robert Louis Stevenson traverse les Cévennes en compagnie de son ânesse Modestine : L’auberge du Bouchet Saint Nicolas était des moins prétentieuses que j’aie jamais visité, mais j’en vis beaucoup plus de ce genre durant mon voyage. Elle était, en effet, typique de ces montagnes françaises. Qu’on imagine une maison campagnarde à deux étages avec un banc devant la porte, la cuisine et l’étable contigües, de sorte que Modestine et moi pouvions nous entendre dîner réciproquement. Ameublement des plus sommaires, sol de terre battue, un dortoir unique pour les voyageurs et sans autre commodité que des lits. Dans la cuisine, cuisson et manger vont de pair et la famille y dort la nuit. Quiconque a la fantaisie de faire sa toilette doit y procéder en public à la table commune. La nourriture est parfois frugale : du poisson sec et une omelette ont constitué en plus d’un cas mon menu. Le vin y est des plus médiocres, l’eau-de-vie abominable. Et la visite d’une énorme truie grognant sous la table et se frottant à vos jambes n’est pas un impossible accompagnement du repas.
Mais les gens de l’auberge, neuf fois sur dix, se montrent cordiaux et empressés. Aussitôt que vous avez passé le seuil, vous cessez d’être un étranger et, quoique ces paysans soient rudes et peu expansifs sur la grand-route, ils témoignent d’une notion de gentil savoir-vivre dès que vous partagez leur foyer. Au Bouchet, par exemple, j’ai débouché ma bouteille de beaujolais et j’ai invité l’hôte à se joindre à moi. Il n’en voulut prendre qu’un rien.
Je suis amateur de vin comme ça, voyez-vous, dit-il, et je suis capable de ne point vous en laisser à suffisance.
Dans ces auberges de peu, le voyageur s’attend à manger à la pointe de son couteau. À moins qu’il n’en réclame un, nul autre ne lui sera fourni. Avec un verre, un chanteau de pain, une fourchette de fer, la table est complètement dressée. Mon couteau fut copieusement admiré par le propriétaire du Bouchet et le ressort le remplit d’étonnement.
[…] Au matin, m’annonça le mari, je vous fabriquerai quelque chose de meilleur que votre bâton pour faire avancer votre âne. Des bêtes comme ça, ça ne sent rien ; le proverbe le dit : dur comme un âne. Vous pourriez assommer votre baudet avec un gourdin et pourtant n’en point venir à bout.
Quelque chose de meilleur ! J’ignorais ce qu’il m’offrirait.
Le dortoir était meublé de deux lits. J’en obtins un et je dois convenir que je fus un peu ahuri de trouver un jeune homme, sa femme et leur gosse en train de monter dans l’autre. C’était ma première expérience de l’espèce et si je suis toujours d’un sentimentalisme également innocent et distrait, je prie Dieu que ce soit d’ailleurs la dernière. J’ai gardé mes yeux pour moi et n’ai rien su de la jeune femme, sinon qu’elle avait de beaux bras et ne semblait pas embarrassée le moins du monde par ma présence.
[vers six heures du matin] Et où, dis-je, est monsieur ?
Le patron est au grenier, répondit-elle. Il vous fabriquer un aiguillon.
Béni soit l’homme qui inventa les aiguillons ! Béni soit l’aubergiste du Bouchet Saint Nicolas qui m’en montra le maniement ! Cette simple gaule, pointue d’un huitième de pouce, était en vérité un sceptre, lorsqu’il me la remit entre les mains. À partir de ce moment là, Modestine devint mon esclave. Une piqûre, et elle passait outre aux seuils d’étable les plus engageants. Une piqûre et elle partait d’un joli petit trottinement qui dévorait les kilomètres. Ce n’était point, à tout prendre, une vitesse remarquable et il nous fallait quatre heures pour couvrir dix milles au mieux. Mais quel changement angélique depuis la veille ! Plus de manipulation du brutal gourdin ! Plus de fouettage d’un bras endolori ! Plus d’exercice de lutte, mais une escrime discrète et aristocratique ! Et qu’importait, si de temps à autre, une goutte de sang apparaissait, telle une cale, sur la croupe couleur de souris de Modestine ? J’eusse préféré autrement, certes, mais les exploits d’hier avaient purgé mon cœur de toute humanité. Le petit démon pervers qu’on n’avait pu mater par la bonté, devait obéir quand même à la piqûre.
Robert Louis Stevenson. Voyage avec un âne dans les Cévennes. 1879
1870 à 1900
La France se donne un empire de 11 M de km² et de 40 M d’habitants. France seule : 536 408 km², Alsace-Lorraine non comprise.


Il faut faire connaître toutes ces colonies au bon peuple de France… les congés payés n’existent pas encore… l’avion encore moins…. donc puisqu’ils ne peuvent aller voir toutes ces nouveautés sur place, on va faire venir des échantillons en France : Albert Geoffroy Saint Hilaire dirige le Jardin d’Acclimatation, qui est à reconstituer entièrement après la Commune ; et il s’aperçoit rapidement que les indigènes qui accompagnent les animaux rencontrent beaucoup plus de succès que les animaux eux-mêmes. Il a lui-même commencé avec des Eskimos, puis s’est fourni auprès de Carl Hagenbeck, qui a découvert le filon en 1874, et ainsi, de 1877 à 1893, une vingtaine de Troupes se succéderont au Jardin d’acclimatation, venues des marches les plus proches aux plus lointaines de l’empire : Ashantis, Dahoméens, Gallas etc… Ils satisferont à bon compte – quelque nourriture et verroterie jetées au-dessus des barrières – le voyeurisme du public et l’appétit d’anthropologie physique des savants, le tout pour se conforter dans la certitude de la supériorité de l’homme blanc. En 1877, la fréquentation du Jardin d’Acclimatation aura doublé, atteignant un million d’entrées. La France n’aura pas le monopole de ce mépris aux angles arrondis par le paternalisme : l’Angleterre et l’Allemagne s’y mettront aussi, faisant venir qui des Lapons, qui des Zoulous. C’est la Grande guerre qui, paradoxalement mettra pratiquement fin à ces procédés… paradoxalement car cette grande pourvoyeuse de cimetières aura bien mis à jour le sidérant mépris de la vie humaine chez les décideurs… mais le discours politique, à la sortie de cette immense boucherie, ne pouvait se permettre de dire de ces millions de morts qu’ils n’avaient été que de pauvres poires que l’on enivrait avant l’assaut… il fallait qu’ils deviennent des héros… et dès lors… les noirs de l’empire qui étaient tombés aux cotés des paysans bretons, des ouvriers chti etc… devaient devenir comme eux des héros. C’est bien la grande tartuferie des discours récupérateurs qui donna une dignité politique aux coloniaux. Mais la pratique ne mourut que de mort lente : en 1931, le grand père canaque du footballeur Karembeu fut encore montré au Jardin d’acclimatation.
Ces attractions scabreuses proposées aux Européens pendant plusieurs décennies ont produit les stéréotypes, les clichés et les théories raciales qui marquent toujours notre rapport aux autres, en particulier aux Africains.
Pascal Blanchard
… l’intérêt dénué de critique portée à l’attraction proposée, pour choquant qu’elle soit, n’est sans doute pas si éloignée du voyeurisme de certaines pratiques touristiques contemporaines dans les pays du Tiers monde.
Benoît Coutancier, Christine Barthe.
Il faut dire quelle était alors la toile de fond, sur laquelle se manifestait cet inconscient peut-être, mais bien réel mépris de la personne humaine. Voilà près d’un demi-siècle qu’avait été proclamée l’abolition de l’esclavage et on aurait pu penser que c’en était fini de la servitude. En fait, la légalisation de la suppression de l’esclavage avait eu pour premier avantage pour les occidentaux de pouvoir se draper dans un voile de bonne conscience. Mais le voile était suffisamment transparent pour permettre la vue de la réalité : cette abolition avait crée surtout dans les îles Caraïbes une pénurie de main d’œuvre quand les plantations continuaient leur activité, et par ailleurs la révolution industrielle demandait des matières premières dans les pays où la main d’œuvre était rare ou inadaptée : ces deux phénomènes avaient crée les conditions pour provoquer de très importants mouvements de populations : et ce furent les grandes émigrations des coolies. Le coolie est un homme de peine d’origine asiatique qui travaille dans une colonie européenne, s’engageant par l’intermédiaire d’un contrat qui le lie à son employeur pour une durée de trois à huit ans. Ces émigrations se localisèrent là où il y avait surpopulation, pas assez de terre pour tout le monde, ou bien lorsque des conflits et/ou des catastrophes poussaient à émigrer : révolte des cipayes en Inde, en 1857-1858, famine du Bihar en 1865-1866, déplacement des Rohingyas du Bengale en Birmanie pour travailler les plantation anglaises de thé.
On estime que, durant la seconde moitié du XIX° siècle, et les premières décennies du XX° siècle, 7 millions de Chinois et 6 millions d’Indiens quittent leur patrie. La très grande majorité gagne l’Asie du Sud-Est (Birmanie, Malaisie, Thaïlande, Indochine, Philippines, Indonésie), mais, à l’exception de l’Europe, tous les continents sont concernés.
Si les migrants indiens ont tendance à partir vers les possessions de l’immense empire britannique, les Chinois, très majoritairement issus des provinces méridionales (le Guandong et le Fujian), gagnent une plus grande variété de destinations, par exemple les Indes néerlandaises et l’Amérique latine. Entre 1847 et 1874, 125 000 Chinois débarquent à Cuba, 110 000 au Pérou. L’Afrique, quoique plus marginale, ne fait pas exception : dans la seconde moitié des années 1900, 63 000 Chinois sont recrutés pour les mines d’Afrique du Sud.
Xavier Paulès. L’Histoire n° 01242. Mars 2014
Il ressort des dépositions et pétitions que les huit dixièmes du nombre total des travailleurs chinois ont déclaré qu’ils avaient été enlevés de vive force ou amenés par la ruse, que pendant la traversée, la mortalité provenant soit de blessures causées par des coups soit de maladie ou de suicide a atteint plus de 10 %, qu’à l’arrivée à la Havane on les vendait en esclavage […] que le travail est par trop pénible et la nourriture trop insuffisante, que les heures de travail sont trop prolongées et que les verges, le fouet, les chaînes, les bâtons et autres châtiments occasionnent toutes sortes de souffrances et de blessures […] Nous avons pu voir nous-mêmes un assez grand nombre de Chinois avec les bras ou les jambes cassées, les yeux aveuglés, la tête couverte de plaies et d’autres à qui on avait cassé les dents, mutilé les oreilles, lacéré la peau et la chair, preuves évidentes de cruauté que tous pouvaient voir.
Extraits du rapport de la Commission d’enquête sur les conditions des travailleurs chinois à Cuba.1876
Ainsi se perpétuait l’esclavage, même si sa réalité juridique avait disparu : de fait nombre de ces coolies, même s’ils touchaient un salaire de misère, menaient la même vie que les esclaves du sud des États-Unis. Fatta la legge, trovato l’inganno, – dès que la loi entre en vigueur, on trouve le moyen de la contourner – disent les Italiens, experts. En l’occurrence les experts étaient les puissances coloniales. Et ne nous voilons pas la face en pensant que le phénomène en ce début du XXI° siècle a disparu : les petro-dollars des Émirats Arabes Unis, les Dubaï, Abu Dhabi et consorts ont permis de faire sortir des sables leurs mégalopoles avec une main d’œuvre venue du Népal, du Bengladesh, d’Inde, qui connaît le même sort que les coolies du XIX° siècle : passeport confisqué à l’entrée dans le pays, salaire de misère, logement dans les cabanes de chantier à la périphérie, hors de la vue des nationaux etc… L’homme continue à exploiter l’homme.
3 01 1880
Trois semaines de grands froids ont gelé la Seine sur 50 cm ; on a enregistré – 24° à Paris le 10 12 1879. La débâcle arrive avec le redoux et les eaux montent de près de deux mètres en moins de trois heures.
29 03 1880
La loi présentée à la Chambre par Jules Ferry sur l’interdiction faite aux Congrégations non autorisées d’enseigner a été repoussée : son article 7 disait : Nul n’est admis à participer à l’enseignement public ou libre, ni à diriger un établissement d’enseignement de quelques ordre que ce soit, s’il appartient à une congrégation religieuse non autorisée. [Sur les 141 congrégations enseignantes, cinq seulement étaient autorisées : Les Frères des Écoles Chrétiennes, les Lazaristes, les Sulpiciens, les pères du Saint Esprit et les Missions Étrangères. L’effectif des 29 collèges tenus par les Jésuites représentait 55 % des élèves du secondaire privé].
Qu’à cela ne tienne, il la fait passer par décret : Un délai de trois mois est accordé à la congrégation ou association non autorisée, dite de Jésus, pour se dissoudre et évacuer les établissements qu’elle occupe sur le territoire de la République.
04 1880
Autorisation sans plafond de l’ajout de sucre dans les moûts de raisin, avant fermentation. Cela va ouvrir la porte à tous les abus dès que la crise du phylloxéra viendra rendre l’offre insuffisante par rapport à la demande. Les mauvaises habitudes seront très vite prises : elles seront très longues à pouvoir être éradiquées. Les degrés supplémentaires facilement obtenus incitent au mouillage qui multiplie les hectolitres à la vente. Et le vin confectionné avec sucre de betterave, colorants, raisins secs, acides tartrique, citrique et sulfurique, et même parfois du plâtre, eh oui ! fait une entrée fracassante sur le marché.
1 05 1880
Des ouvriers américains se mettent en grève pour des revendications concernant les horaires de travail : la Fête du travail est née.
30 06 1880
Les Jésuites, dissous en mars, sont expulsés. Les Pères sortent un à un de leur centre de la rue de Sèvres, au bras d’un député ou d’un sénateur. Chaque fois qu’il en paraît un à la porte du couvent, la foule massée dans la rue ou sur le square crie à tue-tête : Vivent les Jésuites ! Vive la liberté ! À bas la canaille ! À bas les décrets ! … Un manifestant dit à l’un des agents : Les Jésuites sont plus faciles à arrêter que les Communards ! [qui venaient d’être amnistiés]
R. P. de Rochemonteix. SJ
Spectacle douloureux et humiliant pour ceux qui avaient la responsabilité de l’exécution. Il fallait pousser à la rue des prêtres sans défense. Leur attitude de prière, leurs physionomies méditatives et résignées, et jusqu’à la bénédiction donnée en sortant aux fidèles agenouillés, contrastaient péniblement avec l’emploi de la force publique. Il n’était pas nécessaire d’avoir la foi catholique pour éprouver l’impression que je décris ; et, quelles que fussent leurs croyances particulières, ce n’était pas pour de pareilles besognes que tant de vieux soldats avaient revêtu l’uniforme des gardiens de la paix.
Andrieux, préfet de police
6 07 1880
On se remet à commémorer la prise de la Bastille comme fête nationale : on avait oublié de le faire depuis 1802. Mais ce 14 juillet pourrait tout aussi bien être l’anniversaire de la Fête de la Fédération, en 1790… cela n’est pas précisé.
11 07 1880
Amnistie totale de tous les Communards déportés, emprisonnée, proscrits : ils sont des milliers à pouvoir retrouver une vie normale… pour autant que cela soit possible. Louise Michel (1830-1905), revient de Nouvelle Calédonie : anarchiste au grand cœur et au courage indomptable : Je suis de celles qu’on tue, non de celles que l’on salit, elle s’était constituée prisonnière à la fin de la Commune pour libérer sa mère arrêtée à sa place : elle aura passé 13 ans de sa vie en prison et déportation. Même après les tempêtes de la Commune, elle conservera intactes son exaltation : sur le bateau qui l’emmenait en Nouvelle Calédonie, les tempêtes la mettaient en transe. Sur place, elle court au devant des typhons.
Libertaire, plus qu’anarchiste, elle n’a ni Dieu ni maître. Elle prône une émancipation entière et absolue du moi. Libre de tous préjugés, elle a, pour son époque, une incroyable ouverture aux autres, à tous les êtres souffrants, bêtes comprises. Prostituées, fous, délinquants, elle est seule à les entendre et à les défendre. Alors que les communards en exil font de très bons colons, elle prend le parti des Canaques, apprend leur langue et les pousse à la révolte. Une fois encore, elle fait sienne le credo romantique : Tout ce qui a vie a droit.
Christophe Boltanski Le Nouvel Observateur Décembre 2007
Exaltée ? Certainement… comme l’étaient probablement Saint Augustin, Hildegarde von Bingen, Sainte Thérèse d’Avila, sainte Thérèse de l’Enfant Jésus etc… Yolande Moreau sera Louise Michel au cinéma en 2009, avec son talent criant de vérité.
Il faut… que vous mettiez la pierre tumulaire de l’oubli sur tous les crimes et tous les vestiges de la Commune, et que vous disiez à tous… qu’il n’y a qu’une France et qu’une République !
Léon Gambetta
13 09 1880
Dans le Gaulois, Guy de Maupassant donne raison au libertinage : […] Le mariage et l’amour n’ont rien à voir ensemble. On se marie pour fonder une famille et on forme une famille pour constituer la société. La société ne peut pas de passer du mariage. Si la société est une chaîne, chaque famille en est un anneau.
Pour souder ces anneaux-là, on cherche toujours les métaux pareils. Quand on se marie, il faut unir les convenances, combiner les fortunes, joindre les races semblables, travailler pour l’intérêt commun qui est la richesse et les enfants. On ne se marie qu’une fois, fillette, et parce que le monde l’exige ; mais on peut aimer vingt fois dans sa vie, parce que la nature nous a fait ainsi. Le mariage : c’est une loi, vois-tu, et l’amour, c’est un instinct qui nous pousse tantôt à droite, tantôt à gauche. On a fait des lois qui combattent nos instincts, il le fallait ; mais les instincts sont toujours les plus forts, et on a tort de leur résister, puisqu’ils viennent de Dieu, tandis que les lois ne viennent que des hommes.
Si on ne poudrait pas la vie avec de l’amour, le plus d’amour possible, mignonne, comme on met du sucre dans les drogues pour les enfants, personne ne voudrait la prendre telle qu’elle est.
[…] Depuis le Révolution, le monde n’est plus reconnaissable. Vous avez mis de grands mots partout : vous croyez à l’égalité et à la passion éternelle. Des gens ont fait des vers pour vous dire qu’on mourait d’amour. De mon temps, on faisait des vers pour vous apprendre à aimer beaucoup. Quand un gentilhomme nous plaisait, fillette, on lui envoyait un page. Et quand il nous venait au cœur un nouveau caprice, on congédiait son dernier amant, à moins qu’on ne les garda tous les deux.
- Alors, les femmes n’avaient pas d’honneur ?
- […] Pas d’honneur ! parce qu’on aimait, qu’on osait le dire et même s’en vanter ? Mais fillette, si une de nous, parmi les plus grandes dames de France, était demeurée sans amant, toute la cour en aurait ri. Et vous vous imaginez que vos maris n’aimeront que vous toute leur vie ? Comme si ça se pouvait, vraiment !
Je te dis, moi, que le mariage est une chose nécessaire pour que la société vive, mais qu’il n’est pas dans la nature de notre race, entends-tu bien ? Il n’y a dans la vie qu’une bonne chose, c’est l’amour et on veut nous en priver. On vous dit maintenant : il ne faut aimer qu’un homme, comme si on voulait me forcer à ne manger toute ma vie que du dindon. Et cet homme-là aura autant de maîtresses qu’il y a de mois dans l’année !
Jadis
Il dira ailleurs avec la plus grande concision le peu de cas qu’il faisait du mariage : le jour, c’est pour les mauvaises humeurs, la nuit, pour les mauvaises odeurs.
14 11 1880
Scission de la Fédération des travailleurs socialistes de France – le Parti ouvrier -, crée deux ans plus tôt, au congrès du Havre : minoritaires, Jules Guesde et les marxistes créent le Parti ouvrier socialiste.
11 1880
L’application du décret sur les congrégations non autorisées demande 2 000 hommes pour que les 37 moines Prémontrés de Saint Michel de Frigollet (entre Avignon et Tarascon) se rendent.
Rodin sculpte le Penseur. Suppression de l’obligation du repos dominical. Triomphe d’Henriette Rosine Bernard, alias Sarah Bernhard, aux États-Unis, malgré ou à cause ( ?) de ses caprices : elle voyageait dans un train spécial, luxueusement aménagé : salon, salle à manger, cuisine, chambre… et 45 malles de costumes. Il s’arrête un jour dans la baie de Saint Louis devant un pont qui menace de s’écrouler après une semaine de pluies non-stop. Le mécanicien décide de faire un long détour pour rejoindre la ville où Sarah doit jouer le soir même. L’actrice s’y refuse : le mécanicien finit par accepter à condition que l’on fasse parvenir par télégramme à sa jeune épouse 2 500 $, s’engageant à les restituer si le train passe. Il s’engage en poussant la machine à fond… ça passe, puis un énorme vacarme retentit, une fois de l’autre coté : le pont s’écroulait ! Ça, c’est baraka !
10 12 1880
Création de la Société – privée – générale du téléphone. L’administration verra cela d’un mauvais œil, jusqu’à obtenir le monopole le 16 juillet 1889.
1880
Alphonse Laveran, médecin militaire, découvre l’hématozoaire du paludisme, ce qui lui vaudra le prix Nobel de médecine… en 1907. Auguste Lumière commence à fabriquer à Lyon des plaques photographiques au gélatino-bromure : cinq ans plus tard, son usine fabriquait 110 000 douzaines de plaques par an ; en 1905, il emploiera près de mille personnes. Pierre et Jacques Curie découvrent la piézoélectricité, et le pharmacien toulousain Léon Lajaunie le cachou.
Le Certificat d’Études Primaires devient un examen national auquel peuvent se présenter tous les enfants dès l’âge de onze ans. L’écrit vient sanctionner par la dictée, la rédaction et l’arithmétique le triptyque lire-écrire-compter. L’oral porte surtout sur l’histoire et la géographie. Il ne vivra pas moins de 90 ans ! 50 % des élèves le réussiront en 1936.
On estime à 12 000 le nombre de juifs formant la première alya – émigration -, surtout russes, mais aussi roumains, en Palestine ottomane : les Hovevei Tsion, (les amants de Sion, fondés en 1181 par Léon Pinsker, médecin à Odessa après une série de pogroms), rapidement encadrés de très près par les Rothschild pour museler les intellectuels anarchisants.
Le socialisme se prépare en silence à son règne de terreur.
Nietzsche
La Polynésie est annexée à la France
Début des travaux du tunnel du Saint Gothard : Louis Fabre, d’origine genevoise, est devenu entrepreneur de travaux publics en France : il soumet une offre très basse pour la réalisation de ce tunnel de 15 km et obtient le marché en ayant pris des risques insensés : 199 ouvriers mourront pendant les dix ans de travaux, de 1872 à 1882, sur un chantier qui emploiera 2 000 hommes. Louis Fabre lui-même, mourra d’apoplexie dans le tunnel en 1879. Cette nouvelle voie nord-sud permettait de délaisser la Via Mala voisine, sur le cours du Rhin postérieur, de sinistre réputation.
Mise en service d’une prise d’eau du Drac, (qui coule vers Grenoble) au bénéfice de Gap, à 1 160 mètres d’altitude, dans une zone où le torrent a collecté les pluies sur 200 km². L’altitude permet à l’eau de s’écouler ensuite, par simple gravité, sans pompage, en empruntant un tunnel creusé dans la roche sous le col de Manse – 1 269 m. – , voisin du col Bayard, pour rejoindre une réserve artificielle à 1 134 mètres d’altitude, au-dessus de Gap, dans une autre vallée, un autre bassin-versant. Depuis que Napoléon III a signé un décret attribuant des droits d’eau au Canal de Gap, l’établissement public chargé de distribuer l’eau potable dans le Gapençais, en 1863, des millions de mètres cubes s’écoulent ainsi, chaque année, sur une pente douce, entre la vallée du Champsaur et la préfecture des Hautes-Alpes, ville sans sources ni rivières suffisantes pour alimenter 50 000 habitants (en 2022) et des milliers d’hectares de terrains agricoles. Quand, dans les années 2020, l’eau se fera plus rare, les vieilles querelles ainsi crées reprendront de la vigueur : traditionnellement les eaux d’un bassin versant ne bénéficient qu’aux seuls habitants de ce bassin.
__________________________________________________________________________________________________
[1] Qui avait commencé par être vendeur ambulant dans les trains…
[2] Sous la direction d’Auguste Detoeuf, auparavant directeur du port de Strasbourg, puis directeur général de Thomson-Houston et, de 1928 à 1940, premier président d’Alsthom. Il publiera en 1937 Propos d’O.L. Barenton, confiseur, ancien élève de l’École polytechnique, plusieurs fois réédité, dans lequel il attribue, – manière d’avancer masqué – à un Rothschild : Il y a trois manières de faire faillite : le jeu, les femmes et les ingénieurs. La première est la plus rapide, la deuxième est la plus agréable mais la troisième … est la plus sûre.
[3] Adversaires sur le terrain politique – Leroy-Beaulieu et Vigné d’Octon ne cesseront de s’opposer dans des élections locales – députation, cantonales, communales – dans le département de l’Hérault, ils s’opposeront aussi sur la colonisation, le premier se faisant son chantre libéral, le second son dénonciateur radical.
[4] On peut en trouver, ainsi que des radis et d’autres légumes – pas chaque année, cela dépend de la durée de l’été – dans une île aussi septentrionale que celle d’Ingö, au nord de la Norvège, à l’O-SO du cap Nord, par 70°5′ !





Laisser un commentaire