| Publié par (l.peltier) le 28 septembre 2008 | En savoir plus |
3 06 1900
À Chalon sur Saône, gendarmes et soldats escortent deux ouvriers non grévistes à leur travail : lapidés par les grévistes, ils ouvrent le feu : trois grévistes sont tués. Trois gendarmes traduits devant le Conseil de guerre seront acquittés.
10 06 1900
En Chine, la vieille impératrice douairière Cixi déclare au Grand Conseil que les étrangers doivent être supprimés. La domination croissante des puissances occidentales en Chine, – dite encore bataille des concessions – peut ainsi avoir lieu : va s’en charger le mouvement des Yi-He-Quan – les Poings de la Justice et de l’Harmonie – adeptes d’une boxe sacrée. Leur mot d’ordre : Soutenons les Qing ! Anéantissons l’étranger ! La transformation d’un seul caractère permet des changer les Poings de la Justice et de l’Harmonie en milices du même nom : Yi-He-Quan devient Yi-He-Tuan : les Boxers. Les hostilités débuteront le 21 juin. Au départ, les Boxers étaient soutenus par 5 à 6 000 impériaux ; face à eux, une poignée d’étrangers rejoints par 3 000 Chinois chrétiens.
Les femmes avaient un rôle bien spécifique au sein des Boxers :
Les femmes dans la rébellion boxer étaient organisées en différents groupes selon leur âge. Les Lanternes rouges (Hongdeng zhao) regroupaient les jeunes femmes entre 12 et 18 ans, vierges et aux pieds non bandés. Les Lanternes bleues (Landeng zhao) regroupaient les femmes d’âge moyen, les Lanternes noires ( Heideng zhao) les femmes âgées et les Lanternes vertes, les veuves. Un témoin de l’époque, dont les souvenirs furent recueillis dans les années 60 par des universitaires chinois du Shandong, décrit l’allure de ces Lanternes rouges : Toutes ces grandes filles étaient habillées de rouge de pied en cap. Leurs parures de pieds étaient rouges, leurs chaussettes étaient rouges, leurs chaussures étaient rouges, leurs pantalons étaient rouges, leurs chemises étaient rouges et elles portaient des chignons rouges. Elles portaient également des lanternes rouges et des éventails rouges. Parfois elles s’entrainaient la journée, parfois la nuit. C’étaient toutes des filles de familles pauvres. Certaines n’avaient pas de quoi s’acheter des vêtements rouges, donc elles déchiraient des franges de draps et les teignaient pour faire leurs costumes. L’entrainement suivi semble avoir été intensif : Chaque jour les jeunes femmes s’entrainaient avec des sabres et éventails. Tous les dix jours, elles formaient des bandes et tournaient dans les villages, courant et brandissant leurs sabres comme une forme d’avertissement démonstratif. Elles appelaient cela marcher dans la ville (caicheng), c’était un procédé similaire à la marche dans les rues des boxers. (Ono Kazuko Chinese Women in a Century of Revolution)
Les sources concernant les Lanternes rouges étant très rares, ainsi la plupart des récits de la rébellion ne les mentionne même pas, on est en réduit en général à quelques bribes de poèmes ( Toutes habillées de rouge, portant une petite lanterne rouge, hop avec un coup d’éventail, elles s’envolent vers le ciel ) et à une série de légendes concernant leurs pouvoirs magiques, quoiqu’on ignore si elles ont effectivement participé aux combats. Ces légendes sont notamment résumées par Paul A. Cohen : Ces filles et jeunes femmes étaient capables de protéger les boxers pendant le combat. Elles pouvaient envoyer des sabres dans les airs et couper les têtes des ennemis à distance. Elles étaient aussi capables de lancer des boulons en feu et grâce à leur pouvoir magique, de défaire ainsi les vis et écrous de l’artillerie des occidentaux. Quand les lanternes rouges se tenaient droites et sans bouger, leurs âmes les quittaient et s’engageaient dans la bataille. Elles n’étaient impressionnées par aucunes armes. Les armes étrangères étaient paralysées en leur présence. Elles avaient également de formidables pouvoirs pour soigner et amener un prompt rétablissement aux combattants blessés. Une ancienne lanterne rouge de la région de Tianjin se souvenait qu’une dirigeante des lanternes rouges quand elle se mettait en transe n’avait qu’à frapper ses deux mains en direction d’une personne malade pour que celle-ci soit soignée. ( China Unbound. Evolving Perspectives on the Chinese Past)
On évoque aussi leur capacité à voler, à contrôler les vents grâce à leurs éventails et donc à déclencher et attiser des incendies, ainsi dans cet épisode relayé par la légende : À Tianjin, se trouvaient des bâtiments étrangers bien fortifiés que même les armées Qing désespéraient de pouvoir faire tomber un jour. Les Lanternes rouges, toutes de rouge vêtues, apparurent près de ces bâtiments, chacune portant leurs précieux éventails de la main droite et une corbeille de fleurs dans la main gauche. Les rumeurs disaient qu’avec les corbeilles de fleurs les femmes attrapaient les balles des fusils des étrangers et qu’avec le mouvement de leurs éventails elles pouvaient déclencher des incendies. Les soldats français et les japonais tremblaient dans leur petite enclave, tandis que les lanternes rouges se rassemblaient toujours plus nombreuses. Brûle, brûle criaient-elles d’une voix tonitruante. De chaque endroit que les lanternes rouges traversaient s’élevaient immédiatement des flammes. ( Ono Kazuko op.cit.)

Siège de la cathédrale de Pékin, la Lanterne rouge située à gauche ( elle tient une lanterne à la main) a jeté une corde magique entre les deux camps pour protéger les combattants chinois pris entre deux-feux.
Ces pouvoirs magiques attribués aux Lanternes rouges reflétait la puissance des sentiments millénaristes qui animaient les Boxers : Du point de vue des Boxers, la lutte dans laquelle ils étaient engagés à l’été 1900, ne pouvait pas se comprendre comme un conflit militaire au sens conventionnel du terme. Beaucoup plus fondamentalement, cette lutte était conçue comme la compétition pour déterminer qui auraient les pouvoirs magiques – et par extension, quel Dieu ou dieux- les plus puissants. (Paul A. Cohen). Or, paradoxalement, si l’on prêtait donc beaucoup de ces pouvoirs aux Lanternes rouges, les boxers avaient tendance dans le même temps à expliquer leurs échecs militaires par la perturbation polluante induite par la présence de femmes, alors qu’à l’image des Taipings, ils appliquaient une ségrégation stricte des sexes. Plusieurs défaites cuisantes furent notamment expliquées par l’apparition, sous diverses formes, de femmes nues sur les murailles de villes assiégées. En conséquence, les boxers interdirent, sous peine de mort, aux femmes de Tianjin de sortir de chez elles pendant toute la durée des combats, afin qu’elles ne risquent pas de les priver de leurs pouvoirs magiques.
Comme le rappelle Emily M. Ahern dans son article The Power and Pollution of Chinese Women : Dans la société chinoise, les femmes étaient regardés à la fois comme rituellement impures et dangereusement puissantes et on leur interdisait d’exercer certaines activités du fait du tort qu’elles pourraient causer aux autres. Ainsi, on considérait généralement que la présence d’une femme polluée ( c’est à dire ayant ses règles ou ayant accouchée depuis moins d’un mois) empêchait de rentrer en contact avec les dieux, voire risquait de provoquer leur courroux et de nombreux rituels étaient observés pour conjurer les effets éventuels de cette pollution sur la maisonnée. Dans le même temps, Ahern souligne bien que toute ce discours sur la pollution était indissociable d’un système de parenté centré sur le lignage masculin où la femme était tout à la fois un acteur central et une intrus. Les craintes des Boxers reflétaient donc les angoisses courantes de la société traditionnelle de l’époque. Précisons que si les lanternes rouges étaient composées majoritairement de jeunes filles pauvres et étaient dirigées par une ancienne prostituée, Lotus jaune, de son vrai nom Lin Heier, qu’on disait dotée d’un pouvoir de guérison exceptionnel, il n’y a rien qui semble indiquer qu’elles se soient d’une manière ou d’une autre révoltées contre l’ordre confucéen.
Néanmoins, quand, après un long oubli, les Lanternes rouges furent remises à l’honneur pendant la révolution culturelle par la femme de Mao, Jian Qing ( ainsi que plus anecdotiquement par le groupe de radicaux américains d’origine asiatique I Wor Kuen au début des années 70) elles furent présentées comme des modèles de combattantes rebelles, anti-impérialistes ( voir l’illustration ci jointe), refusant d’être subordonnées aux hommes.

Site : nannii. Femmes et féminisme en Chine
Les manifestations les plus évidentes du progrès technique furent les cibles favorites des Boxers : câbles électriques, écoles, voies de chemin de fer, produits d’importation… Leur xénophobie exacerbée prit pour cible en priorité les victimes les plus faciles à combattre : les missionnaires sur lesquels les supplices chinois donneront toute leur mesure, avec, au premier chef, le démembrement. Français aussi bien qu’Anglais se chargeront de faire la publicité de l’affaire : depuis quelques années, les appareils de photo se fabriquaient en grande série et nombre d’étrangers des concessions en possédaient… ces supplices se faisaient sans aucun cérémonial et donc les suppliciés pouvaient être approchés sans difficulté… on verra publiées des séries de cartes postales sur ce seul thème, avec au verso le très rituel bon souvenir de Shangaï ! Le démembrement sera aboli le 24 avril 1905.
Les Boxers ne seront arrêtés que deux mois plus tard par une armée occidentale, commandée par le feld-maréchal allemand Albert von Waldersee [1]. Les Russes se livreront à un massacre sur les Chinois de Blagovechtchensk, où 3 000 d’entre eux furent noyés dans l’Amour. Le bataillon indien de l’armée anglaise ne fut pas tendre non plus. La cour s’était enfuie au Chen-si, Cixi déguisée en paysanne. La défaite sera concrétisée par le protocole des Boxers, ou traité de Xinchou le 7 septembre 1901, au terme duquel la Chine, représentée par Li Hung Chang, devait payer une indemnité de 450 millions de thalers [335 millions $-or, soit 6.653 milliards $ américains actuels, 5 869 milliards d’€, 12 fois le revenu annuel de l’Empire ; la Chine paya cette indemnité en or par annuités croissantes, à raison d’un taux d’intérêt de 4 %, jusqu’à ce que le montant prévu soit intégralement payé, le ] ; les meneurs seront autorisés à se suicider, les subalternes exécutés.
Trois ans plus tard, Cixi rentrait à Pékin, remerciant les étrangers qui lui avaient épargné des humiliations et permis de revenir d’une tournée d’inspection. Empressée, diserte, enjôleuse, charmante, habile, elle confirmait ou entreprenait ce qu’elle avait condamné trois ans plus tôt.
À l’occasion de son soixante-dixième anniversaire (21 juin 1904), elle amnistiait et rétablissait dans leurs grades tous les réformistes, sauf K’ang Yeou-wei, Lean K’i-tch’ao et le Cantonnais Sun Yat-sen.
Roger Levy. Histoire Universelle. La Pléiade 1986
Mais c’est aller trop vite en besogne que de faire de Cixi un parangon du passéisme et de l’obscurantisme : elle fit appel à des étrangers pour la conseiller, diriger des administrations essentielles comme les douanes, importante source de revenus, voire construire une flotte moderne. Le premier ambassadeur de la Chine aux États-Unis fut un ancien diplomate américain. Elle écrivait : Rendre la Chine forte reste l’unique moyen de nous assurer que des pays étrangers n’entreront pas en guerre contre nous et ne nous traiteront pas avec mépris.
En matière de supplice, les Chinois étaient loin de détenir un monopole… nos rois, nos églises, nos maîtres d’esclaves y avaient eux aussi apporté un perfectionnement certain. Les Marocains semblent tout de même être parvenus sur une sorte de lugubre sommet : C’est le barbier du sultan qui est chargé du supplice du sel, de tradition fort ancienne. Dans un lieu public, sur la place du marché de préférence, on lui amène le coupable, garrotté solidement. Avec un rasoir, il lui taille à l’intérieur de chaque main, dans le sens de la longueur, quatre fentes jusqu’à l’os. En étendant la paume, il fait ensuite bailler le plus possible les lèvres de ces coupures saignantes, et les remplit de sel. Puis il referme la main ainsi déchiquetée, introduit le bout de chaque doigt replié dans chacune des fentes, et pour que cet arrangement atroce dure jusqu’à la mort, coud par-dessus le tout une sorte de gant bien serré, en peau de bœuf mouillée qui se rétrécira encore en séchant. La couture achevée, on ramène le supplicié dans son cachot, où, par exception, on lui donne à manger, pour que cela dure. Dès le premier moment, en plus de la souffrance sans nom, il a cette angoisse de se dire que ce gant horrible ne sera jamais retiré, que ses doigts engourdis dans la plaie vive n’en sortiront jamais, que personne au monde n’aura pitié de lui, que ni jour ni nuit il n’y aura trêve à ses crispations, ni à ses hurlements de douleur. Mais le plus effroyable, à ce qu’il paraît, ne survient que quelques jours plus tard, quand les ongles, poussant au travers de la main, entrent toujours plus avant dans cette chair fendue… Alors, la fin est proche : les uns meurent du tétanos, les autres parviennent à se briser la tête contre les murs…
Pierre Loti. Au Maroc 1889
13 06 1900
À Pékin, massacre de chrétiens, étrangers et chinois.
20 06 1900
Le baron von Ketteler, ministre de l’Allemagne est tué et les légations de Pékin attaquées, en état de siège, sans communication avec l’extérieur.
22 06 1900
Wang Yuanlu, ancien soldat reconverti en prêtre taoïste assure le gardiennage des grottes des Mille Bouddhas à Dunhuang, à l’est de Koucha, 2 000 km à l’ouest de Pékin sur les anciennes routes de la soie. Les vicissitudes de la Chine au cours des derniers siècles ont laissé quelque peu à l’abandon ce site et Wang Yuanlu découvre au fond d’une niche un amoncellement de manuscrits dont le déchiffrement et l’analyse permettront un approfondissement important de la connaissance de la Chine ancienne et médiévale: Bouddhisme, médecine, littérature, économie, circulation des savoirs entre l’Inde, la Chine, l’Asie centrale et l’Asie intérieure.

Wang Yuanlu



29 06 1900
Création de la Fondation Nobel, qui attribuera un prix à des personnes qui ont rendu de grands services à l’humanité, permettant une amélioration ou un progrès considérable dans le domaine des savoirs et de la culture dans cinq disciplines différentes : paix ou diplomatie, littérature, chimie, physiologie ou médecine et physique.
Alfred Nobel
Il inventa un explosif plus puissant que tout et, pour calmer sa conscience, il créa les prix Nobel
Albert Einstein, en 1945
La cérémonie de remise des prix aura lieu le 10 décembre, jour anniversaire de sa mort ; la première aura lieu le
14 07 1900
Le métropolitain aurait dû être inauguré en même temps que l’Exposition, mais cela prendra 3 mois de plus : 18 stations de la Porte de Vincennes à la Porte Maillot : 10.6 km, suivies par : Étoile-Porte Dauphine, Étoile-Trocadéro, Étoile-Nation. Le père se nomme Fulgence Bienvenüe, ingénieur breton, qui dût faire preuve d’une immense patience pour supporter les innombrables retards dus aux querelles entre la ville et l’État sur le tracé. New York, Londres, Budapest et Berlin avaient le leur depuis longtemps.
29 07 1900
Les anarchistes italiens émigrés aux États-Unis n’ont pas oublié les morts de Milan, deux ans plus tôt : ils ont tiré au sort l’un des leurs, Gaetano Presci pour assassiner le roi Humbert I°, ce qu’il fait à Monza, de trois coups de revolver. Condamné aux travaux forcés à perpétuité au pénitencier de San Stefano, il sera retrouvé pendu dans sa cellule le 22 mai 1901, probablement assassiné. C’est Victor Emmanuel III qui succède à Humbert I° : il a 31 ans.
5 08 1900
Les troupes alliées, cantonnées à Tien-sin sur des informations erronées les assurant que le personnel des légations avait été massacré, fortes de 20 000 hommes, se remettent à marcher sur Pékin, lorsqu’il s’avérera que le personnel des légations, vivant, soutenait un siège infernal.
Pendant deux mois, les rages de destruction, les frénésies de meurtre se sont acharnées sur cette malheureuse ville de Tong-Tchéou, – la ville de la Pureté céleste – envahie par les troupes de huit ou dix nations diverses. Elle a subi les premiers chocs de toutes les haines héréditaires. Les Boxers d’abord y ont passé. Les Japonais y sont venus, héroïques petits soldats dont je ne voudrais pas médire, mais qui détruisent et tuent comme autrefois les armées barbares. Encore moins voudrais-je médire de nos amis les Russes ; mais ils ont envoyé ici des cosaques voisins de la Tartarie, des Sibériens à demi mongols, tous gens admirables au feu mais entendant encore les batailles à la façon asiatique. Il y est venu de cruels cavaliers de l’Inde, délégués par la Grande-Bretagne. L’Amérique y a lâché ses mercenaires. Et il n’y restait déjà plus rien d’intact quand sont arrivés, dans la première excitation de vengeance contre les atrocités chinoises, les Italiens, les Allemands, les Autrichiens, les Français.
[… ] Mgr Favier, chef des missions françaises, habitant Pékin depuis quarante années, ayant longtemps joui de la faveur des souverains, avait été le premier à prévoir et à dénoncer le péril boxer. Malgré l’effondrement momentané de son œuvre, il est encore une puissance en Chine, où un décret impérial lui a jadis conféré le rang de vice-roi.
La salle où il me reçoit, aux murs blancs, avec un trou d’obus récemment bouché, contient de précieux bibelots chinois, dont la présence dans ce presbytère étonne tout d’abord. Il les collectionnait autrefois, et il les revend aujourd’hui pour pouvoir secourir les quelques milliers d’affamés que la guerre vient de laisser dans son église.
L’évêque est un homme de haute taille, de beau visage régulier, avec des yeux de finesse et d’énergie. Ils devaient lui ressembler, par l’allure aussi bien que par l’opiniâtre volonté, ces évêques du Moyen Age qui suivaient les croisades en Terre sainte. C’est seulement depuis le début des hostilités contre les chrétiens qu’il a repris la soutane des prêtres français et coupé sa longue tresse à la chinoise. (On sait que le port de la queue et du costume mandarin était une des plus énormes et subversives faveurs accordées aux lazaristes par les empereurs célestes.)
Il veut bien me retenir une heure auprès de lui et, tandis qu’un Chinois soyeux nous sert le thé, il me redit la grande tragédie qui vient de finir ici même ; cette défense de quatorze cents mètres de murs, organisée avec rien par un jeune enseigne et trente matelots ; cette résistance de plus de deux mois contre des milliers de tortionnaires qui déliraient de fureur, au milieu de l’énorme ville en feu. Bien qu’il conte tout cela à voix très basse, dans la salle blanche un peu religieuse, sa parole devient de plus en plus chaude, vibrante en sourdine, avec une certaine rudesse de soldat, et, de temps à autre, une émotion qui lui étrangle la gorge, surtout lorsqu’il est question de l’enseigne Henry.
L’enseigne Henry, qui mourut traversé de deux balles, sur la fin du dernier grand combat ! Ses trente matelots, qui eurent tant de tués et qui furent blessés presque tous !… Il faudrait graver quelque part en lettres d’or leur histoire d’un été, de peur qu’on ne l’oublie trop vite, et la faire certifier telle, parce que bientôt on n’y croirait plus.
Et ces matelots-là, commandés par leur officier tout jeune, on ne les avait pas choisis ; ils étaient les premiers venus, pris en hâte et au hasard à bord de nos navires. Quelques prêtres admirables partageaient leurs veilles, quelques braves séminaristes faisaient le coup de feu sous leurs ordres, et aussi une horde de Chinois armés de vieux fusils pitoyables. Mais c’était eux l’âme de la défense obstinée, et, devant la mort, qui était tout le temps présente dans la diversité de ses formes les plus atroces, pas un n’a faibli ni murmuré.
Un officier et dix matelots italiens, que le sort avait jetés là, s’étaient jusqu’à la fin battus héroïquement, laissant six des leurs parmi les morts.
Oh ! l’héroïsme enfin, le plus humble héroïsme de ces pauvres chrétiens chinois, catholiques ou protestants, réfugiés pêle-mêle à l’évêché, qui savaient qu’un seul mot d’abjuration, qu’une seule révérence à une image bouddhique leur garantirait la vie, mais qui restaient là tout de même, fidèles, malgré la faim torturante aux entrailles et le martyre presque certain ! En même temps, du reste, en dehors de ces murs qui les protégeaient un peu, quinze mille environ de leurs frères étaient brûlés, dépecés vifs, jetés en morceaux dans le fleuve, pour la nouvelle foi qu’ils ne voulaient point renier.
Il se passait des choses inouïes, pendant ce siège : un évêque- Mgr Jardin, coadjuteur de Mgr Favier -, la tête éraflée par les balles, allait, suivi d’un enseigne de vaisseau et de quatre marins, arracher un canon à l’ennemi ; des séminaristes fabriquaient de la poudre, avec les branches carbonisées des arbres de leur préau et avec du salpêtre qu’ils dérobaient la nuit, en escaladant les murs, dans un arsenal chinois.
On vivait dans un continuel fracas, dans un continuel éclaboussement de pierres ou de mitraille ; tous les clochetons en marbre de la cathédrale, criblés d’obus, chancelaient, tombaient par morceaux sur les têtes. A toute heure sans trêve, les boulets pleuvaient dans les cours, enfonçaient les toits, crevaient les murs. Mais c’était la nuit surtout que les balles s’abattaient comme grêle, et qu’on entendait sonner les trompes des Boxers ou battre les affreux gongs. Et leurs cris de mort, tout le temps, à plein gosier : Cha ! cha ! (Tuons ! tuons !), ou : Chao ! Chao ! (Brûlons ! brûlons !), emplissaient la ville comme la clameur d’ensemble d’une immense meute en chasse.
On était en juillet, en août, sous un ciel étouffant, et on vivait dans le feu : des incendiaires arrosaient de pétrole les portes ou les toits avec des jets de pompe, et lançaient dessus des étoupes allumées ; il fallait, d’un côté ou d’un autre, courir, apporter des échelles, grimper avec des couvertures mouillées pour étouffer ces flammes. Courir, il fallait tout le temps courir, quand on était si épuisé, avec la tête si lourde, les jambes si faibles, de n’avoir pas mangé à sa faim.
Courir !… Il y avait une sorte de course lamentable, que les bonnes sœurs avaient charge d’organiser, celle des femmes et des petits enfants, hébétés par la souffrance et la peur. C‘étaient elles, les sublimes filles, qui décidaient quand il y avait lieu de changer de place suivant la direction des obus, et qui choisissaient la minute la moins dangereuse pour prendre son élan, traverser une cour tête baissée, aller s’abriter autre part. Un millier de femmes, maintenant sans volonté et sans idées, ayant au cou de pauvres bébés mourants, les suivaient alors comme un remous humain, avançaient ou reculaient, se poussant pour ne pas perdre de vue les blanches cornettes protectrices…
Courir, quand on ne tenait plus debout faute de vivres et qu’une lassitude suprême vous poussait à vous coucher par terre pour attendre de mourir ! Les détonations qui ne cessaient pas, le perpétuel bruit, la mitraille, la dégringolade des pierres, on s’habituait encore à cela, et à voir à chaque instant quelqu’un s’affaisser dans son sang. Mais la faim était un mal plus intolérable que tout. On faisait des bouillies avec les feuilles et les jeunes pousses des arbres, avec les racines des dahlias du jardin et les oignons des lis. De pauvres Chinois venaient humblement dire :
Il faut garder le peu qui reste de millet pour les matelots qui nous défendent et qui ont plus besoin de force que nous.
L’évêque voyait se traîner à ses pieds une femme accouchée de la veille, qui suppliait :
Évêque ! évêque ! fais-moi donner seulement une poignée de grain, pour qu’il me vienne du lait et que mon petit ne meure pas !
On entendait toute la nuit dans l’église les petites voix de deux ou trois cents enfants qui gémissaient pour avoir à manger. Suivant l’expression de Mgr Favier, c’étaient comme les bêlements d’une troupe d’agnelets destinés au sacrifice. Leurs cris d’ailleurs allaient en diminuant, car on en enterrait une quinzaine par jour.
On savait que non loin de là, aux légations européennes, un drame pareil devait se jouer, mais, il va sans dire, toute communication était coupée, et quand quelque jeune chrétien chinois se dévouait pour essayer d’aller y porter un mot de l’évêque, demandant des secours ou au moins des nouvelles, on voyait bientôt sa tête, avec le billet épingle à la joue, reparaître au-dessus du mur, au bout d’une perche enguirlandée de ses entrailles.
Tout était plein de sang, de cervelle jaillie des crânes brisés. Non seulement des boulets tombaient par centaines chaque jour, mais les Boxers dans leurs canons mettaient aussi des cailloux, des briques, des morceaux de fer, des cassons de marmite, ce qui tombait sous leurs mains forcenées. On n’avait pas de médecins, on pansait comme on pouvait, et sans espoir, les grandes blessures horribles, les grands trous dans les poitrines. Les bras des fossoyeurs volontaires s’épuisaient à creuser le sol pour enfouir des morts ou des débris de morts. Et toujours les cris de la meute enragée : Cha ! cha ! (Tuons ! tuons !), et toujours les gongs avec leur bruit de sinistre ferraille, et toujours le beuglement des trompes…
Des mines sautaient de différents côtés, engloutissant du monde et des pans de mur. Dans le gouffre que fit l’une d’elles, disparurent les cinquante petits bébés de la crèche, dont les souffrances au moins furent finies. Et, chaque fois, c’était une nouvelle grande brèche ouverte pour les Boxers qui se précipitaient, c’était une entrée béante pour la torture et la mort…
Mais l’enseigne Henry accourait là toujours ; avec ce qui lui restait de matelots, on le voyait surgir à la place qu’il fallait, au point précis d’où l’on pouvait tirer le mieux, sur un toit, sur une crête de muraille, et ils tuaient, ils tuaient, sans perdre une balle de leurs fusils rapides, chaque coup donnant la mort. Par terre, ils en couchaient cinquante, cent, en monceaux, et fiévreusement les prêtres, les Chinois, les Chinoises apportaient des pierres, des briques, des marbres de la cathédrale, n’importe quoi, avec du mortier tout prêt, et on refermait la brèche, et on était sauvés encore jusqu’à la mine prochaine !
Mais on n’en pouvait plus ; la maigre ration de bouillie diminuait trop, on n’avait plus de force…
Ces cadavres de Boxers, qui s’entassaient tout le long du vaste pourtour désespérément défendu, emplissaient l’air d’une odeur de peste; ils attiraient les chiens qui, dans les moments d’accalmie, s’assemblaient pour leur manger le ventre; alors, les derniers temps, on tuait ces chiens du haut du mur, on les péchait avec un croc au bout d’une corde, et c’était une viande réservée aux malades et aux mères qui allaitaient.
Le jour enfin où nos soldats entrèrent dans la place, guidés par l’évêque à cheveux bancs qui, debout sur le mur, agitait le drapeau français, le jour où l’on se jeta dans les bras les uns des autres avec des larmes de joie, il restait tout juste de quoi faire, en y mettant beaucoup de feuilles d’arbres, un seul et dernier repas.
Il semblait, dit Mgr Favier, que la Providence eût compté nos grains de riz !
Et puis il me reparle encore de l’enseigne Henry :
La seule fois, dit-il, pendant tout le siège, la seule fois que nous ayons pleuré, c’est à l’instant de sa mort. Il était resté debout longtemps, avec ses dix blessures mortelles, commandant toujours, rectifiant le tir de ses hommes. À la fin du combat, il est descendu lentement de la brèche, et il est venu s’affaisser entre les bras de deux de nos prêtres ; alors nous pleurions tous et, avec nous, tous ses matelots qui s’étaient approchés et qui l’entouraient. C’est qu’aussi il était charmant, simple, bon, doux avec les plus petits… Être un soldat pareil, et se faire aimer comme un enfant, n’est-ce pas, il n’y a rien de plus beau ?
Pierre Loti. Les derniers jours de Pékin. Voyages 1872-1943 Bouquins Robert Laffont 1991
14 08 1900
Les 55 jours de Pékin prennent fin avec la libération des légations. L’impératrice est en fuite. Les effectifs des troupes étrangères vont monter en puissance, jusqu’à 100 000 hommes, se livrant à de nombreux massacres sur les Boxers et autres Chinois suspects de sympathie. On aura vu l’empereur d’Allemagne recommander au chef de son corps expéditionnaire de tuer sans répit le maximum de Chinois pour que les générations futures sachent ce qu’il en coûte de s’attaquer à l’Occident. Les expéditions punitives du contingent allemand dans l’arrière pays seront nombreuses durant l’automne 1900 et le printemps 1901. Pierre Loti exonère les troupes françaises de ce genre de forfait, et assure même que le simple mot Français était un sésame dans les provinces chinoises : Et vraiment il semble, quand on y réfléchit, que certains de nos alliés aient été imprudents de semer ici tant de germes de haine et tant de besoins de vengeance.
22 09 1900
Émile Loubet, qui a pris la suite de Félix Faure à la présidence de la République offre un banquet aux maires de France dans le jardin des Tuileries, 22 695 d’entre eux [2] ont fait le déplacement (quelque maires de villes coloniales inclus) ! C’est la maison Potel et Chabot qui s’est chargée du travail : darnes de saumon glacées à la parisienne, filet de bœuf en Bellevue, pain de cannetons de Rouen, ballottine de faisans Saint Hubert, glaces succès.
Directeur de Potel en 1900, M. Legrand avait calculé que 11 cuisines dirigées par 11 chefs gros bonnets seraient nécessaires dans les jardins des Tuileries pour servir les 700 tables de 10 mètres, accueillant chacune 36 couverts, alignées sous les immenses tentes s’étendant parallèlement à la rue de Rivoli. Chacun de ces 11 chefs a alors sous ses ordres une vingtaine de chefs de partie et des commis (soit environ 400 cuisiniers), devant se synchroniser avec plus de 2 000 maîtres d’hôtel en habit et gants blancs. À l’entrée de chaque cuisine est affichée une couleur ou une lettre, portée aussi à la boutonnière des maîtres d’hôtel qui y sont affectés. Tous retrouvant ainsi facilement le chemin de leur service.
Des tombereaux de victuailles ont auparavant été livrés chez Potel, rue de Chaillot, où les cuisines travaillent jour et nuit. Si les chiffres varient un peu selon les sources, l’énumération des vivres est toujours gargantuesque : près de 2 tonnes de saumon, 3 tonnes de bœuf, 2 430 faisans, 3 500 poulardes, 2 500 canetons, des dizaines de milliers de fruits… 1 200 litres de mayonnaise Les terrines que sont les pains de caneton et les ballottines de faisan Saint Hubert – où le gibier, désossé, est reconstitué avec une farce garnie entre autres, selon Jean-Pierre Biffi, d’un peu de foie gras et de fruits – sont les premiers mets préparés. Ensuite, le saumon est poché, les poulardes et les filets de bœuf sont rôtis à l’avance, puis convoyés rue de Rivoli par des fourgons à deux chevaux, dans des malles en osier refroidies par des pains de glace. Le tout sera découpé, paré, dressé et lustré de gelée aux Tuileries, où se monteront aussi les accompagnements du saumon à la parisienne, avec les 1 200 litres de mayonnaise devant garnir œufs et tomates. Véritable général de ces brigades en campagne, M. Legrand impose une rigueur quasi militaire dans un petit vademecum distribué plusieurs jours avant l’événement. Il y détaille le rôle de chacun et le compte à rebours. Le jeudi, triage du matériel : soit 125 000 assiettes, 55 000 fourchettes, 55 000 cuillères, 60 000 couteaux, 125 000 verres, 26 000 tasses à café, 3 500 salières, 2 800 compotiers, 700 pots de moutarde… Vendredi : sur les tables garnies de molleton par la maison Belloir, dressage au cordeau des verres et assiettes (par peur des vols, l’argenterie attendra le lendemain). Le samedi 22 septembre, dès 5 heures du matin, les équipes sont à l’œuvre pour finir le dressage, préparer vins ordinaires (preignac et saint julien en carafe), puis vins fins (bouteilles de haut sauternes, margaux Jean Calvet 1887, champagne Montebello, mais aussi fine champagne). À 11 heures, insiste Legrand, tout devra être prêt. Et tout doit être bouclé en une heure et demie. Tout en laissant aux invités le temps voulu pour bien déjeuner, on ira le plus vite possible, insiste le directeur, qui recommande néanmoins de ne rien refuser, de repasser les plats et même de forcer sur le vin. Il faut dire que le programme des maires est chargé : concerts et danses (barbares, grecques …) dans la salle des fêtes, spectacle nautique le long de la Seine, réception (étalée sur deux jours) à l’Élysée… À l’heure dite, cette assemblée uniquement masculine (les femmes attendront encore quarante-cinq ans pour pouvoir voter et être élues) se dirige vers les tables selon les départements, classés par ordre alphabétique. Après La Marseillaise et le discours présidentiel tenu depuis la tribune d’honneur, le top départ est donné par la sonnerie électrique de M. Legrand, qui dirige la manœuvre depuis une petite De Dion 4 chevaux conduite entre les tentes. Six bicyclistes pédalant par ailleurs pour transmettre ses ordres. Le lendemain, la presse, qui couvre largement l’événement, vantera la convivialité du moment et rapportera quelques bons mots. Se penchant vers son voisin, à la table des journalistes, Alfred Capus, du Figaro, lui confiait ainsi à voix basse : Avez–vous remarqué que, chaque fois que nous sommes 23 000 à table, il en meurt un dans l’année ? Une référence à l’assassinat, le 24 juin 1894, à Lyon, du président Sadi Carnot, mortellement poignardé par l’anarchiste italien Caserio à la sortie d’un banquet ? Emile Loubet, lui, paradera sans encombres de la Concorde à la rue des Tuileries. Salué, le long des tentes, par la garde républicaine et les rangs de maires repus, ceints de l’écharpe tricolore.
stéphane davet. Le Monde du 19 08 2020



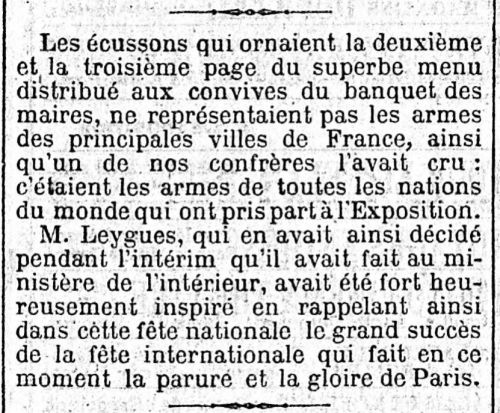


28 et 29 09 1900
En moins de dix heures, 950 mm d’eau s’abattent sur l’Aigoual. En bas, dans la vallée, le village de Valleraugue est ravagé. Tout le monde s’accorde à dire qu’on n’aurait pas connu cela si l’Aigoual était resté boisé, comme c’était le cas, quelques décennies plus tôt. Il y avait déjà eu une bonne alerte dix ans plus tôt.
3 10 1900
Parti de Cherbourg le 2 août, le cuirassé français Redoutable mouille dans la baie de Petchili, au large de Pékin, trop tard pour s’engager dans un conflit terminé. Pierre Loti est à bord, aide de camp du vice-amiral Pottier. Il sera en mission à Pékin du 18 au 30 octobre.
À LA LÉGATION DE FRANCE
Après quelques centaines de mètres, nous entrons dans la rue de ces légations qui viennent de fixer, durant des mois, l’anxieuse attention du monde entier.
Tout y est en ruine, il va sans dire ; mais des pavillons européens flottent sur les moindres pans de mur, et nous retrouvons soudainement ici, au sortir de ruelles solitaires, une animation comme à Tien-Tsin, un continuel va-et-vient d’officiers et de soldats, une étonnante bigarrure d’uniformes.
Déployé sur le ciel d’hiver, un grand pavillon de France marque l’entrée de ce qui fut notre légation ; deux monstres en marbre blanc, ainsi qu’il est d’étiquette devant tous les palais de la Chine, sont accroupis au seuil, et des soldats de chez nous gardent cette porte – que je franchis avec recueillement au souvenir des héroïsmes qui l’ont défendue.
Nous mettons enfin pied à terre parmi des monceaux de débris, sur une sorte de petite place intérieure où les rafales s’engouffrent, près d’une chapelle et à l’entrée d’un jardin dont les arbres s’effeuillent au vent glacé. Les murs autour de nous sont tellement percés de balles que l’on dirait presque un amusement, une gageure : ils ressemblent à des cribles. Là-bas, sur notre droite, ce tumulus de décombres, c’est la légation proprement dite, anéantie par l’explosion d’une mine chinoise. Et à notre gauche, il y a la maison du chancelier, où s’étaient réfugiés pendant le liège les braves défenseurs du lieu, parce qu’elle semblait moins exposée ; c’est là qu’on m’a offert de me recueillir ; elle n’est pas détruite, mais tout y est sens dessus dessous, bien entendu, comme un lendemain de bataille ; et, dans la chambre où je coucherai, les plâtriers travaillent encore à refaire les murs, qui ne seront finis que ce soir.
Maintenant on me conduit, en pèlerinage d’arrivée, dans le jardin où dorment, ensevelis à la hâte, sous des grêles de balles, ceux de nos matelots qui tombèrent à ce champ d’honneur. Point de verdures ici, ni de plantes fleuries ; un sol grisâtre, piétiné par les combattants, émietté par la sécheresse et le froid. Des arbres sans feuilles, dont la mitraille a déchiqueté les branches. Et, sur tout cela un ciel bas et lugubre, où des flocons de neige passent en cinglant.
Il faut se découvrir dès l’entrée de ce jardin, car on ne sait pas sur qui l’on marche ; les places, qui seront marquées bientôt, je n’en doute pas, n’ont pu l’être encore, et on n’est pas sûr, lorsqu’on se promène, de n’avoir pas sous les pieds quelqu’un de ces morts qui mériteraient tant de couronnes.
Dans cette maison du chancelier, épargnée un peu par miracle, les assiégés habitaient pêle-mêle, et dormaient par terre, diminués de jour en jour par les balles, vivant sous la menace pressante de la mort.
Au début – mais leur nombre, hélas ! diminua vite -, ils étaient là une soixantaine de matelots français et une vingtaine de matelots autrichiens, se faisant tuer côte à côte et d’une allure également magnifique. À eux s’étaient joints quelques volontaires français, qui faisaient le coup de feu dans leurs rangs, sur les barricades ou sur les toits, et deux étrangers, M. et Mme de Rosthorn, de la légation d’Autriche. Les officiers de chez nous qui commandaient la défense étaient le lieutenant de vaisseau Darcy et l’aspirant Herber, qui dort aujourd’hui dans la terre du jardin, frappé d’une balle en plein front.
L’horreur de ce siège, c’est qu’il n’y avait à attendre des assiégeants aucune pitié ; si, à bout de forces et à bout de vivres, on venait à se rendre, c’était la mort, et la mort avec d’atroces raffinements chinois pour prolonger des paroxysmes de souffrance.
Aucun espoir non plus de s’évader par quelque sortie suprême : on était au milieu du grouillement d’une ville ; on était enclavé dans un dédale de petites bâtisses sournoises abritant une fourmilière d’ennemis, et, pour emprisonner plus encore, on sentait autour de soi, emmurant le tout, le colossal rempart noir de Pékin.
C’était pendant la période torride de l’été chinois ; le plus souvent, il fallait se battre quand on mourait de soif, quand on était aveuglé de poussière, sous un soleil aussi destructeur que les balles, et dans l’incessante et fade infection des cadavres.
Cependant une femme était là avec eux, charmante et jeune, cette Autrichienne, à qui il faudrait donner une de nos plus belles croix françaises. Seule au milieu de ces hommes en détresse, elle gardait son inaltérable gaieté de bon aloi ; elle soignait les blessés, préparait de ses propres mains le repas des matelots malades, et puis s’en allait charrier des briques et du sable pour les barricades, ou bien faire le guet du haut des toits.
Autour des assiégés, le cercle se resserrait de jour en jour, à mesure que leurs rangs s’éclaircissaient et que la terre du jardin s’emplissait de morts ; ils perdaient du terrain pied à pied, disputant à l’ennemi, qui était légion, le moindre pan de mur, le moindre tas de briques.
Et quand on les voit, leurs petites barricades de rien du tout, faites en hâte la nuit, et que cinq ou six matelots réussissaient à défendre (cinq ou six, vers la fin c’était le plus qu’on pouvait fournir), il semble vraiment qu’à tout cela un peu de surnaturel se soit mêlé. Quand, avec l’un des défenseurs du lieu, je me promène dans ce jardin, sous le ciel sombre, et qu’il me dit : Là, au pied de ce petit mur, nous les avons tenus tant de jours… Là, devant cette petite barricade, nous avons résisté une semaine, cela paraît un conte héroïque et merveilleux. Oh ! leur dernier retranchement ! C’est tout à côté de la maison, un fossé creusé fiévreusement à tâtons dans l’espace d’une nuit, et, sur la berge, quelques pauvres sacs pleins de terre et de sable : tout ce qu’ils avaient pour barrer le passage aux tortionnaires, qui leur grimaçaient la mort, à six mètres à peine, au-dessus d’un pan de mur.
Ensuite vient le cimetière, c’est-à-dire le coin de jardin qu’ils avaient adopté pour y grouper leurs morts, avant les jours plus affreux où il fallait les enfouir çà ou là, en cachant bien la place, de peur qu’on ne vint les violer, comme c’est ici l’atroce coutume. Un lamentable petit cimetière, au sol foulé et écrasé dans les combats à bout portant, aux arbustes fracassés, hachés par la mitraille. On y enterrait sous le feu des Chinois, et un vieux prêtre à barbe blanche – devenu depuis un martyr dont la tête fut traînée dans les ruisseaux – y disait tranquillement les prières devant les fosses, malgré tout ce qui sifflait dans l’air autour de lui, tout ce qui fouettait et cassait les branches.
Vers les derniers jours, leur cimetière, tant ils avaient perdu de terrain peu à peu, était devenu la zone contestée, et ils tremblaient pour leurs morts ; les ennemis s’étaient avancés jusqu’à la bordure ; on se regardait et on se tuait de tout près, par-dessus le sommeil de ces braves, si définitivement couchés dans la terre. S’ils avaient franchi ce cimetière, les Chinois, et escaladé le frêle petit retranchement suprême, en sacs de sable, en gravier dans des rideaux cousus, alors, pour ceux qui restaient là, c’était l’horrible torture au milieu des musiques et des rires, l’horrible dépeçage, les ongles d’abord arrachés, les pieds tenaillés, les entrailles mises dehors, et la tête ensuite, au bout d‘un bâton, promenée par les rues.
On les attaquait de tous les côtés et par tous les moyens, souvent aux heures les plus imprévues de la nuit. Et c’était presque toujours avec des cris, avec des fracas soudains de trompes et de tam-tams. Autour d’eux, des milliers d’hommes à la fois venaient hurler à la mort – et il faut avoir entendu des hurlements de Chinois pour imaginer ces voix-là, dont le timbre seul vous glace. Ou bien des gongs assemblés sous les murs leur faisaient un vacarme de grand orage.
Parfois, d’un trou subitement ouvert dans une maison voisine, sortait sans bruit et s’allongeait, comme une chose de mauvais-rêve, une perche de vingt ou trente pieds, avec du feu au bout, de l’étoupe et du pétrole enflammés, et cela venait s’appuyer contre les charpentes de leurs toits, pour sournoisement les incendier. C’est ainsi du reste qu’une nuit furent brûlées les écuries de la légation.
On les attaquait aussi par en dessous ; ils entendaient des coups sourds frappés dans la terre et comprenaient qu’on les minait, que les tortionnaires allaient surgir du sol, ou bien encore les faire sauter. Et il fallait, coûte que coûte, creuser aussi, tenter d’établir des contremines pour conjurer ce péril souterrain. Un jour cependant, vers midi, en deux terribles détonations qui soulevèrent des trombes de plâtras et de poussière, la légation de France sauta, ensevelissant à demi sous les décombres le lieutenant de vaisseau qui commandait la défense et un groupe de ses marins. Mais ce ne fut point la fin encore ; ils sortirent de cette cendre et de ces pierres qui les couvraient jusqu’aux épaules, ils sortirent excepté deux, deux braves matelots qui ne reparurent plus, et la lutte fut continuée, presque désespérément, dans des conditions toujours plus effroyables.
Elle restait là quand même, la gentille étrangère, qui aurait si bien pu s’abriter ailleurs, à la légation d’Angleterre par exemple, où s’étaient réfugiés la plupart des ministres avec leurs familles ; au moins les balles n’y arrivaient pas, on y était au centre même du quartier défendu par quelques poignées de braves et on s’y sentait en sécurité tant que les barricades tiendraient encore. Mais non, elle restait là, et continuait son rôle admirable, en ce point brûlant qu’était la légation de France – point qui représentait d’ailleurs la clef, la pierre d’angle de tout le quadrilatère européen, et dont la perte eût amené le désastre général.
Une fois, ils virent, avec leurs longues-vues, afficher un édit de l’Impératrice, en grandes lettres sur papier rouge, ordonnant de cesser le feu contre les étrangers. (Ce qu’ils ne virent pas, c’est que les hommes chargés de l’affichage étaient écharpés par la foule.) Une sorte d’accalmie, d’armistice s’ensuivit quand même, on les attaqua avec moins de violence.
Ils voyaient aussi des incendies partout, ils entendaient des fusillades entre Chinois, des canonnades et de longs cris ; des quartiers entiers flambaient ; on s’entre-tuait autour d’eux dans la ville fermée ; des rages y fermentaient comme en un pandémonium, et on suffoquait à présent, on étouffait à respirer l’odeur des cadavres.
Des espions venaient parfois leur vendre des renseignements, toujours faux d’ailleurs et contradictoires, sur cette armée de secours, qu’ils attendaient d’heure en heure avec une croissante angoisse. On leur disait : Elle est ici, elle est là, elle avance. Ou bien : Elle a été battue et elle recule. Et toujours elle persistait à ne point paraître.
Que faisait donc l’Europe ? Est-ce qu’on les abandonnait ? Ils continuaient de se défendre, presque sans espérance, si diminués maintenant, et dans un espace si restreint ! Ils se sentaient comme enserrés chaque jour davantage par la torture chinoise et l’horrible mort.
Les choses essentielles commençaient à manquer. Il fallait économiser sur tout, en particulier sur les balles ; d’ailleurs, on devenait des sauvages, et, quand on capturait des Boxers, des incendiaires, au lieu de les fusiller, on leur fracassait le crâne à bout portant avec un revolver.
Un jour, enfin, leurs oreilles, toujours tendues au bruit des batailles extérieures, perçurent une canonnade continue, sourde et profonde, en dehors de ces grands remparts noirs dont ils apercevaient au loin les créneaux, au-dessus de tout, et qui les enfermaient comme dans un cercle dantesque : on bombardait Pékin !… Ce ne pouvaient être que les armées d’Europe, venues à leur secours !
Cependant une dernière épouvante troublait encore leur joie. Est-ce qu’on n’allait pas tenter contre eux un suprême assaut pour les anéantir avant l’entrée des troupes alliées ? –
En effet, on les attaqua furieusement, et cette journée finale, cette veille de la délivrance coûta encore la vie à un de nos officiers, le capitaine Labrousse, qui alla rejoindre le commandant de nos amis autrichiens dans le glorieux petit cimetière de la légation. Mais ils résistèrent… Et, tout à coup, plus personne autour d’eux, plus une tête de Chinois sur les barricades ennemies ; le vide et le silence dans leurs abords dévastés : les Boxers étaient en fuite, et les alliés entraient dans la ville !…
DANS LA VILLE IMPÉRIALE
Samedi 20 octobre 1900.
[…] Enfin la première enceinte de la Ville jaune ou Ville impériale m’est annoncée par l’interprète de la légation de France, qui a bien voulu m’offrir d’être mon guide et de partager ma charrette aux soies funéraires. Alors je regarde, dans le vent qui brûle mes yeux.
Ce sont de grands remparts couleur de sang à travers lesquels nous passons, avec d’épouvantables cahots, non par une porte, mais par une brèche que les cavaliers indiens de l’Angleterre ont ouverte à coups de mine dans l’épaisseur des ouvrages.
Pékin, de l’autre côté de ce mur, est un peu moins détruit. Les maisons, dans quelques rues, ont conservé leur revêtement de bois doré, leurs rangées de chimères au rebord des toits – tout cela, il est vrai, croulant, vermoulu, ou bien léché par la flamme, criblé de mitraille ; et, par endroits, une populace de mauvaise mine grouille encore là-dedans, vêtue de peaux de mouton et de loques en coton bleu. Ensuite reviennent des terrains vagues, cendres et détritus, où l’on voit errer, ainsi que des bandes de loups, les affreux chiens engraissés à la chair humaine qui, depuis cet été, ne suffisent plus à manger les morts.
Un autre rempart, du même rouge sanglant, et une grande porte, ornée de faïences, par où nous allons passer : cette fois, la porte de la Ville impériale proprement dite, la porte de la région où l’on n’était jamais entré, et c’est comme si l’on m’annonçait la porte de l’enchantement et du mystère…
Nous entrons, et ma surprise est grande, car ce n’est pas une ville, mais un bois. C’est un bois sombre, infesté de corbeaux qui croassent partout dans les ramures grises. Les mêmes essences qu’au temple du Ciel, des cèdres, des thuyas, des saules ; arbres centenaires, tous, ayant des poses contournées, des formes inconnues à nos pays. Le grésil et la neige fouettent dans leurs vieilles branches, et l’inévitable poussière noire s’engouffre dans les allées, avec le vent.
Il y a aussi des collines boisées, où s’échelonnent, parmi les cèdres, des kiosques de faïence, et il est visible, malgré leur grande hauteur, qu’elles sont factices, tant le dessin en est de convention chinoise. Et, dans les lointains, obscurcis de neige et de poussière, on distingue qu’il y a sous bois, çà et là, de vieux palais farouches, aux toits d’émail, gardés par d’horribles monstres en marbre accroupis devant les seuils. Tout ce lieu cependant est d’une incontestable beauté ; mais combien en même temps il est funèbre, hostile, inquiétant sous le ciel sombre !
Maintenant, voici quelque chose d’immense, que nous allons un moment longer : une forteresse, une prison, ou quoi de plus lugubre encore ? Des doubles remparts que l’on ne voit pas finir, d’un rouge de sang comme toujours, avec des donjons à meurtrière et des fossés en ceinture, des fossés de trente mètres de large remplis de nénuphars et de roseaux mourants. Ceci, c’est la Ville violette, enfermée au sein de l’impénétrable Ville impériale où nous sommes, et plus impénétrable encore ; c’est la résidence de l’Invisible, du Fils du Ciel… Mon Dieu, comme tout ce lieu est funèbre, hostile, féroce sous le ciel sombre !
Entre les vieux arbres, nous continuons d’avancer dans une absolue solitude, et on dirait le parc de la mort.
Ces palais muets et fermés, aperçus de côté et d’autre dans le bois, s’appellent temple du dieu des Nuages, temple de la Longévité impériale, ou temple de la Bénédiction des montagnes sacrées… Et leurs noms de rêve asiatique, inconcevables pour nous, les rendent encore plus lointains.
Toutefois, cette Ville jaune, m’affirme mon compagnon de route, ne persistera pas à se montrer aussi effroyable, car il fait aujourd’hui un temps d’exception, très rare pendant l’automne chinois, qui est au contraire magnifiquement lumineux. Et il me promet que j’aurai encore des après-midi de chaud soleil, dans ce bois unique au monde où je vais sans doute résider quelques jours.
Maintenant, me dit-il, regardez. Voici le lac des Lotus et voici le pont de Marbre !
Le lac des Lotus et le pont de Marbre ! Ces deux noms m’étaient connus depuis longtemps, noms de féerie, désignant des choses qui ne pouvaient pas être vues, mais des choses dont la renommée pourtant avait traversé les infranchissables murs. Ils évoquaient pour moi des images de lumière et d’ardente couleur, et ils me surprennent, prononcés ici dans ce morne désert, sous ce vent glacé.
Le lac des Lotus !… Je me représentais, comme les poètes chinois l’avaient chanté, une limpidité exquise, avec de grands calices ouverts à profusion sur l’eau, une sorte de plaine aquatique garnie de fleurs roses, une étendue toute rose. Et c’est ça ! C’est cette vase et ce triste marais, que recouvrent des feuilles mortes, roussies par les gelées ! Il est du reste infiniment plus grand que je ne pensais, ce lac creusé de main d’homme, et il s’en va là-bas, là-bas, vers de nostalgiques rivages, où d’antiques pagodes apparaissent parmi de vieux arbres, sous le ciel gris.
Le pont de Marbre ! … Oui, ce long arceau blanc supporté par une série de piliers blancs, cette courbure gracieusement excessive, ces rangées de balustres à tête de monstre, cela répond à l’idée que je m’en faisais ; c’est très somptueux et c’est très chinois. Je n’avais cependant pas prévu les deux cadavres, en pleine pourriture sous leurs robes, qui, à l’entrée de ce pont, gisent parmi les roseaux.
Toutes ces larges feuilles mortes, sur le lac, ce sont bien des feuilles de lotus ; de près, maintenant, je les reconnais, je me souviens d’avoir jadis beaucoup fréquenté leurs pareilles – mais si vertes et si fraîches ! – sur les étangs de Nagasaki ou de Yeddo. Et il devait y avoir là en effet une nappe ininterrompue de fleurs roses ; leurs tiges fanées se dressent encore par milliers au-dessus de la vase.
Mais ils vont sans doute mourir, ces champs de lotus, qui charmaient depuis des siècles les yeux des empereurs, car leur lac est presque vide, et ce sont les alliés qui en ont déversé les eaux dans le canal de communication entre Pékin et le fleuve, afin de rétablir cette voie, que les Chinois avaient desséchée par crainte qu’elle ne servît aux envahisseurs.
Le pont de Marbre, tout blanc et solitaire, nous mène sur l’autre rive du lac, très rétréci en cet endroit, et c’est là que je dois trouver ce palais du Nord où sera ma résidence. Je n’aperçois d’abord que des enceintes s’enfermant les unes les autres, de grands portiques brisés, des ruines, encore des ruines et des décombres. Et, sur ces choses, une lumière morte tombe d’un ciel d’hiver, à travers l’opacité des nuages pleins de neige.
Au milieu d’un mur gris, une brèche où un chasseur d’Afrique monte la faction ; d’un côté, il y a un chien mort, de l’autre un amas de loques et de détritus répandant une odeur de cadavre. Et c’est, paraît-il, l’entrée de mon palais.
Nous sommes noirs de poussière, saupoudrés de neige, nos dents claquent de froid, quand nous descendons enfin de nos charrettes, dans une cour encombrée de débris, où mon camarade l’aide de camp, le capitaine C…, vient à ma rencontre. Et vraiment on se demanderait, à de tels abords, si le palais promis n’était pas chimérique.
Au fond de cette cour, cependant, une première apparition de magnificence. Il y a là une longue galerie vitrée, élégante, légère – intacte, à ce qu’il semble, parmi tant de destructions. À travers les glaces, on voit étinceler des ors, des porcelaines, des soies impériales traversées de dragons et de nuages… Et c’est bien un coin de palais, très caché, que rien ne décelait aux alentours.
Oh ! notre repas du soir d’arrivée, au milieu des étrangetés de ce logis ! C’est presque dans les ténèbres. Nous sommes assis, mon camarade et moi, à une table d’ébène, enveloppés dans nos capotes militaires au collet remonté, grelottant de froid, servis par nos ordonnances qui tremblent de tous leurs membres. Une pauvre petite bougie chinoise en cire rouge, fichée sur une bouteille – bougie ramassée par là, dans les débris de quelque autel d’ancêtres -, nous éclaire à grand-peine, tourmentée par le vent. Nos assiettes, nos plats sont des porcelaines inestimables, jaune impérial, marquées au chiffre d’un fastueux empereur, qui fut contemporain de Louis XV. Mais notre vin de ration, notre eau trouble – bouillie et rebouillie, par peur des cadavres qui empoisonnent tous les puits – occupent d’affreuses bouteilles qui ont pour bouchons des morceaux de pomme de terre crue taillés au couteau par nos soldats.
La galerie où la scène se passe est très longue, avec des lointains qui vont se perdre en pleine obscurité et où s’esquissent vaguement des splendeurs de conte asiatique ; elle est partout vitrée jusqu’à hauteur d’homme, et cette frêle muraille de verre nous sépare seule du grand noir sinistre, plein de ruines et de cadavres, qui nous environne : on a le sentiment que les formes errantes du dehors, les fantômes qu’intéresse notre petite lumière, peuvent de loin nous voir attablés, et cela inquiète… Au-dessus des glaces, c’est, suivant l’usage chinois, une série de châssis légers, en papier de riz, montant jusqu’au plafond – d’où retombent ici, comme des dentelles, de merveilleuses sculptures d’ébène ; mais ce papier de riz est déchiré, crevé de toutes parts, laissant passer sur nous les souffles mortellement froids de la nuit. Nos pieds gelés posent sur des tapis impériaux, jaunes, à haute laine, où s’enroulent des dragons à cinq griffes. À côté de nous brillent doucement, à la lueur de notre bout de bougie qui va finir, des brûle-parfums gigantesques, en cloisonné d’un bleu inimitable d’autrefois, montés sur des éléphants d’or ; des écrans d’une fantaisie extravagante et magnifique ; des phénix d’émail éployant leurs longues ailes ; des trônes, des monstres, des choses sans âge et sans prix. Et nous sommes là, nous, inélégants, pleins de poussière, traînés, salis, l’air de grossiers barbares, installés en intrus chez des fées.
Ce que devait être cette galerie, il y a trois mois à peine ! Quand, au lieu du silence et de la mort, c’était la vie, les musiques et les fleurs ; quand la foule des gens de cour ou des domestiques en robe de soie peuplait ces abords aujourd’hui vides et dévastés ; quand l’Impératrice, suivie de ses dames du palais, passait dans ses atours de déesse !…
Ayant fini notre souper, qui se composait de la modeste ration de campagne, ayant fini de boire notre thé dans des porcelaines de musée, nous n’avons pas le courage de prolonger, pour l’heure des cigarettes et de la causerie. Non, ça a beau être amusant de se voir ici, ça a beau être imprévu et aux trois quarts fantastique, il fait trop froid, ce vent nous glace jusqu’à l’âme. Nous ne jouissons plus de rien. Nous préférons nous en aller et essayer de dormir.
Mon camarade, le capitaine C…, qui a pris possession en titre de ce lieu, me mène, avec un fanal et un petit cortège, dans l’appartement qu’il me destine. C’est au rez-de-chaussée, bien entendu, puisque les constructions chinoises n’ont jamais d’étage. Comme dans la galerie d’où nous venons, je n’ai là, pour me séparer de la nuit extérieure, que des panneaux de verre, de très légers stores en soie blanche et des châssis en papier de riz, crevés de toutes parts. Quant à ma porte, qui est faite d’une seule grande glace, je l’attacherai avec une ficelle, car elle n’a plus de loquet.
J’ai par terre d’admirables tapis jaunes, épais comme des coussins. J’ai un grand lit impérial en ébène sculptée, et mon matelas, mes oreillers sont en soie précieuse, lamée d’or ; pas de draps, et une couverture de soldat en laine grise.
Demain, me dit mon camarade, je pourrai aller choisir, dans les réserves de Sa Majesté, de quoi changer à mon caprice la décoration de cette chambre ; ça ne fera tort à personne de déplacer quelques objets.
Sur ce, il me confirme que les portes de l’enceinte extérieure et la brèche par où je suis entré sont surveillées par des factionnaires, et il se retire dans son logis, sous la garde de ses ordonnances, à l’autre bout du palais.
Tout habillé et tout botté, comme dans la jonque, je m’étends sur les belles soies dorées, ajoutant à ma couverture grise une vieille peau de mouton, deux ou trois robes impériales brodées de chimères d’or, tout ce qui me tombe sous la main. Mes deux serviteurs, par terre, s’arrangent dans le même style. Et, avant de souffler ma bougie rouge d’autel d’ancêtres, je suis forcé de convenir, en mon for intérieur, que notre air barbare d’Occident a plutôt empiré depuis le souper.
Le vent, dans l’obscurité, tourmente et déchire ce qui reste de papier de riz à mes carreaux ; c’est, au-dessus de ma tête, comme un bruit continu d’ailes d’oiseaux nocturnes, de vols de chauves-souris. Et, en demi-sommeil, je distingue aussi de temps à autre une courte fusillade, ou un grand cri isolé, dans le lointain lugubre.
Dimanche 21 octobre.
Le froid, les ténèbres, la mort, tout ce qui nous oppressait hier au soir s’évanouit dans le matin qui se lève. Le soleil rayonne, chauffe comme un soleil d‘été. Autour de nous cette magnificence chinoise, un peu bouleversée, s’éclaire d’une lumière d’Orient.
Et c’est amusant d’aller à la découverte, dans le palais presque caché, qui se dissimule en un lieu bas, derrière des murs, sous des arbres, qui n’a l’air de rien quand on arrive, et qui, avec ses dépendances, est presque grand comme une ville.
Il est composé de longues galeries, vitrées sur toutes leurs faces, et dont les boisures légères, les vérandas, les colonnettes sont peintes extérieurement d’un vert bronze semé de nénuphars roses.
On sent qu’il a été construit pour les fantaisies d’une femme ; on dirait même que la vieille Impératrice galante y a laissé, avec ses bibelots, un peu de sa grâce surannée et encore charmeuse.
Elles se coupent à angle droit, les galeries, formant entre elles des cours, des espèces de petits cloîtres. Elles sont remplies, comme des garde-meubles, d’objets d’art entassés, que l’on peut aussi bien regarder du dehors, car tout ce palais est transparent ; d’un bout à l’autre, on voit au travers. Et il n’y a rien pour défendre ces glaces, même la nuit ; le lieu était entouré de tant de remparts, semblait si inviolable, qu’on n’avait songé à prendre aucune précaution.
Au-dedans, le luxe architectural de ces galeries consiste surtout en des arceaux de bois précieux, qui les traversent de proche en proche ; ils sont faits de poutres énormes, mais tellement sculptées, fouillées, ajourées, qu’on dirait des dentelles, ou plutôt des charmilles de feuillages noirs se succédant en perspective comme aux allées des vieux parcs.
L’aile que nous habitons devait être l’aile d’honneur. Plus on s’en éloigne, en allant vers le bois où le palais finit, plus la décoration se simplifie. Et on tombe en dernier lieu dans des logements de mandarins, d’intendants, de jardiniers, de domestiques, tout cela abandonné à la hâte et plein d’objets inconnus, d’ustensiles de culte ou de ménage, de chapeaux de cérémonie, de livrées de cour.
Vient ensuite un jardin clos, où l’on entre par une porte en marbre surchargée de sculptures, et où l’on trouve des petits bassins, de prétentieuses et bizarres rocailles, des alignements de vases en faïence contenant des plantes mortes de sécheresse ou de gelée. Il y a aussi plus loin des jardins fruitiers, où l’on cultivait des kakis, des raisins, des aubergines, des citrouilles et des gourdes – des gourdes surtout, car c’est ici un emblème de bonheur, et l’Impératrice avait coutume d’en offrir une de ses blanches mains, en échange de présents magnifiques, à tous les grands dignitaires qui venaient lui faire leur cour. Il y a des petits pavillons pour l’élevage des vers à soie et des petits kiosques pour emmagasiner les graines potagères – chaque espèce de semence gardée dans une jarre de porcelaine avec dragons impériaux qui serait une pièce de musée.
Et les sentiers de cette paysannerie artificielle finissent par se perdre dans la brousse, sous les arbres effeuillés du bois où les corbeaux et les pies se promènent aujourd’hui par bandes, au beau soleil d’automne. Il semble que l’Impératrice en quittant la régence – et on sait par quelle manœuvre d’audace elle parvint si vite à la reprendre – ait eu le caprice de s’organiser ici une façon de campagne, en plein Pékin, au centre même de l’immense fourmilière humaine
Le plus imprévu, dans cet ensemble, c’est une église gothique avec ses deux clochers de granit, un presbytère et une école – toutes choses bâties jadis par les missionnaires dans des proportions très vastes. Pour créer ce palais, on s’était vu obligé de reculer la limite de la Ville impériale et d’englober le petit territoire chrétien ; aussi l’Impératrice avait-elle échangé cela aux pères lazaristes contre un emplacement plus large et une plus belle église, édifiée ailleurs à ses frais (contre ce nouveau Peï-Tang où les missionnaires et quelques milliers de convertis ont enduré, cet été, les horreurs d’un siège de quatre mois). Et, en femme d’ordre, Sa Majesté avait utilisé ensuite cette église et ses dépendances pour y remiser, dans d’innombrables caisses, ses réserves de toute sorte. Or, on n’imagine pas, sans l’avoir vu, ce qu’il peut y avoir d’étrangetés, de saugrenuités et de merveilles dans les réserves de bibelots d’une impératrice de Chine !
Les Japonais les premiers sont fourragé là-dedans ; ensuite sont venus les cosaques, et en dernier lieu les Allemands, qui nous ont cédé la place. À présent, c’est par toute l’église un indescriptible désarroi ; les caisses ouvertes ou éventrées ; leur contenu précieux déversé dehors, en monceaux de débris, en ruissellements de cassons, en cascades d’émail, d’ivoire et de porcelaine.
Du reste, dans les longues galeries vitrées du palais, la déroute est pareille. Et mon camarade, chargé de débrouiller ce chaos et de dresser des inventaires, me rappelle ce personnage qu’un méchant génie avait enfermé dans une chambre remplie de plumes de tous les oiseaux des bois, en le condamnant à les trier par espèces : ensemble celles des pinsons, ensemble celles des linots, ensemble celles des bouvreuils… Cependant, il s’est déjà mis à l’étonnante besogne, et des équipes de portefaix chinois, conduits par quelques hommes de l’infanterie de marine, par quelques chasseurs d’Afrique, ont commencé le déblayage.
À cinq cents mètres d’ici, sur l’autre rive du lac des Lotus, en rebroussant mon chemin d’hier soir, on trouve un second palais de l’Impératrice qui nous appartient aussi. Dans ce palais-là, que personne pour le moment ne doit habiter, je suis autorisé à faire, pendant ces linéiques jours, mon cabinet de travail, au milieu du recueillement et du silence, et je vais en prendre possession ce matin.
Cela s’appelle le palais de la Rotonde. Juste en face du pont de Marbre, cela ressemble à une forteresse circulaire, sur laquelle on aurait posé des petits miradors, des petits châteaux de faïence pour les fées, et l’unique porte basse en est gardée nuit et jour par des soldats d’infanterie de marine, qui ont la consigne de ne l’ouvrir pour aucun visiteur.
Quand on l’a franchie, cette porte de citadelle, et que les fonctionnaires l’ont refermée sur vous, on pénètre dans une solitude exquise. Un plan incliné vous mène, en pente rapide, à une vaste esplanade d’une douzaine de mètres de hauteur, qui supporte les miradors, les kiosques aperçus d’en bas, plus un jardin aux arbres centenaires, des rocailles arrangées en labyrinthe, et une grande pagode étincelante d’émail et d’or.
De partout ici, l’on a vue plongeante sur les palais et sur le parc. D’un côté, c’est le déploiement du lac des Lotus. De l’autre, c’est la Ville violette aperçue un peu comme à vol d’oiseau, c’est la suite presque infinie des hautes toitures impériales : tout un monde, ces toitures-là, un monde d’émail jaune luisant au soleil, un monde de cornes et de griffes, des milliers de monstres dressés sur les pignons ou en arrêt sur les tuiles…
À l’ombre des vieux arbres, je me promène dans la solitude de ce lieu surélevé, pour y prendre connaissance des êtres et y choisir un logis à ma fantaisie.
Au centre de l’esplanade, la pagode magnifique où des obus sont venus éclater est encore dans un désarroi de bataille. Et la divinité de céans – une déesse blanche qui était un peu le palladium [statue de la déesse Pallas, dotée de propriétés magiques] de l’Empire chinois, une déesse d’albâtre en robe d’or brodée de pierreries – médite les yeux baissés, calme, souriante et douce, au milieu des mille débris de ses vases sacrés, de ses brûle-parfums et de ses fleurs.
Ailleurs, une grande salle sombre a gardé ses meubles intacts : un admirable trône d’ébène, des écrans, des sièges de toute forme et des coussins en lourde soie impériale, jaune d’or, brochée de nuages.
De tant de kiosques silencieux, celui qui fixe mon choix est posé au bord même de l’esplanade, sur la crête du rempart d’enceinte, dominant le lac des Lotus et le pont de Marbre, avec vue sur l’ensemble de ce paysage factice – composé jadis à coups de lingots d’or et de vies humaines pour les yeux las des empereurs.
À peine est-il plus grand qu’une cabine de navire ; mais, sous son toit de faïence, il est vitré de tous côtés ; j’y recevrai donc jusqu’au soir, pour me chauffer, ce soleil des automnes chinois, qui, paraît-il, ne se voile presque jamais. J’y fais apporter, de la salle sombre, une table, deux chaises d’ébène avec leurs soieries jaunes et, l’installation ainsi terminée, je redescends vers le pont de Marbre, afin de regagner le palais du Nord, où m’attend pour déjeuner le capitaine C…, qui est en ce moment mon camarade de rêve chinois.
Et j’arrive à temps là pour voir, avant leur destruction par la flamme, les singulières trouvailles qu’on y a faites ce matin : les décors, les emblèmes et les accessoires du théâtre impérial. Toutes choses légères, encombrantes, destinées sans doute à ne servir qu’un ou deux soirs, et ensuite oubliées depuis un temps indéterminé dans une salle jamais ouverte, qu’il s’agit maintenant de vider, d’assainir pour y loger nos blessés et nos malades. Ce théâtre évidemment devait jouer surtout des féeries mythologiques, se passant aux enfers, ou chez les dieux, dans des nuages : ce qu’il y a là de monstres, de chimères, de bêtes, de diables, en carton ou en papier, montés sur des carcasses de bambou ou de baleine, le tout fabriqué avec un supérieur génie de l’horrible, avec une imagination qui recule les limites extrêmes du cauchemar !…
Les rats, l’humidité, les termites y ont fait d’ailleurs des dégâts irrémédiables, aussi est-il décidé qu’elles périront par le feu, ces figures qui servirent à amuser ou à troubler la rêverie du jeune empereur débauché, somnolent et débile…[l’empereur Guangxu n’avait que cinq ans à la mort de Xianfeng : sa tante T’seu-hi avait alors pris la régence et ne lui avait jamais remis le pouvoir, pas plus à sa majorité que plus tard, allant jusqu’à l’emprisonner en 1898]
Il faut voir alors l’empressement de nos soldats à charrier tout cela dehors, dans la joie et les rires. Au beau soleil de onze heures, voici pêle-mêle, au milieu d’une cour, les bêtes d’apocalypse, les éléphants grands comme nature, qui ont des écailles et des cornes, et qui ne pèsent pour ainsi dire pas, qu’un seul homme promène et fait courir. Et ils les brisent à coups de botte, nos chasseurs d’Afrique ; ils sautent dessus, ils sautent dedans, passent au travers, les réduisent à rien, puis, finalement, allument la gaie flambée, qui les consume en un clin d’œil.
Les braves soldats ont en outre travaillé toute la matinée à recoller du papier de riz sur les châssis de notre palais, où le vent bientôt n’entrera plus. Quant au chauffage, suivant la mode chinoise, il s’opère par en dessous, au moyen de fours souterrains qui sont disposés tout le long des salles et que nous allumerons ce soir, dès que tombera la nuit glacée. Pour le moment, le soleil splendide nous suffit ; tous ces vitrages, dans la galerie où brillent les soies, les émaux et les ors, nous donnent une chaleur de serre, et, servis toujours dans de la vaisselle d’empereur, nous prenons cette fois notre petit repas de campagne en nous faisant des illusions d’été.
Mais ce ciel de Pékin a des variations excessives et soudaines, dont rien ne peut donner l’idée chez nous, dans nos climats si réguliers. Vers le milieu du jour, quand je me retrouve dehors, sous les cèdres de la Ville jaune, le soleil a brusquement disparu derrière des nuages couleur de plomb, qui semblent lourds de neige ; le vent de Mongolie recommence de souffler comme hier, âpre et glacial, et c’est l’hiver du Nord, succédant sans transition à quelques heures d’un temps radieux du Midi.
J’ai rendez-vous par là, dans le bois, avec les membres de la légation de France, pour pénétrer avec eux dans cette sépulcrale Ville violette, qui est le centre, le cœur et le mystère de la Chine, le véritable repaire des Fils du Ciel, la citadelle énorme et sardanapalesque, auprès de quoi tous ces petits palais modernes, que nous habitons, en pleine Ville impériale, ne semblent être que jouets d’enfant.
Même depuis la déroute, n’entre pas qui veut dans la Ville violette aux grandes toitures d’émail jaune. Derrière les doubles remparts, des mandarins, des Mimiques habitent encore ce lieu d’oppression et de magnificence ; on dit qu’il y est resté aussi des femmes, des princesses cachées, des trésors. Et les deux portes en sont défendues par des consignes sévères, celle du Nord sous la garde des Japonais, et celle du Sud sous la garde des Américains.
C’est par la première de ces deux entrées que nous sommes autorisés à passer aujourd’hui, et nous trouvons là un groupe de petits soldats du Japon, qui nous sourient pour la bienvenue ; mais la porte farouche, sombrement rouge avec des ferrures dorées représentant des têtes de monstre, est fermée en dedans et résiste à leurs efforts. Comme l’usure des siècles en a disjoint les battants énormes, on aperçoit, en regardant par les fentes, des madriers arc-boutés derrière pour empêcher d’ouvrir, et des personnages, accourus de l’intérieur au fracas des coups de crosse, répondent avec des voix flûtées qu’ils n’ont pas d’ordre.
Alors nous menaçons d’incendier cette porte, d’escalader, de tirer des coups de revolver par les fentes, etc., toutes choses que nous ne ferons pas, bien entendu, mais qui épouvantent les eunuques et les mettent en fuite.
Plus personne même pour nous répondre. Que devenir ? On gèle au pied de cette sinistre muraille, dans l’humidité des fossés d’enceinte pleins de roseaux morts, et sous ce vent de neige qui souffle toujours.
Les bons petits Japonais, cependant, imaginent d’envoyer le plus râblé des leurs – qui part à toutes jambes – faire le tour par l’autre porte (quatre kilomètres environ). Et en attendant, ils allument pour nous par terre un feu de branches de cèdre et de boiseries peintes, où nous venons à tour de rôle chauffer nos mains dans une fumée épaisse ; nous amusant aussi à ramasser, de-ci de-là, aux alentours, les vieilles flèches empennées que jadis les princes ou les empereurs lançaient du haut des remparts.
Nous avons patienté là une heure, quand enfin du bruit et des cris se font entendre derrière la porte silencieuse : c’est notre envoyé qui est dans la place et bouscule à coups de poing les eunuques qu’il a pris à revers.
Tout aussitôt, avec un grondement sourd, tombent les madriers, et s’ouvrent devant nous les deux battants terribles.
LA CHAMBRE ABANDONNÉE
Une discrète odeur de thé, dans la chambre très obscure, une odeur de je ne sais quoi d’autre encore, de fleur séchée et de vieille soierie.
Elle ne peut s’éclairer davantage, la chambre étrange, qui n’ouvre que dans une grande salle sombre et dont les fenêtres scellées prennent demi-jour par des carreaux en papier de riz, sur quelque petit préau funèbre, sans doute muré de triples murs. Le lit-alcôve, large et bas, qui semble creusé dans la profondeur d’une paroi épaisse comme un rempart, a des rideaux et une couverture en soie d’un bleu couleur de nuit. Point de sièges, d’ailleurs il y en aurait à peine la place ; point de livres non plus, et on y verrait à peine pour lire. Sur des coffres en bois noir, qui servent de tables, posent des bibelots mélancoliques, enfermés dans des guérites de verre : petits vases en bronze ou en jade, contenant des bouquets artificiels très rigides, aux pétales de nacre et d’ivoire. Et une couche de poussière, sur toutes ces choses, témoigne que l’on n’habite plus.
Au premier aspect rien ne précise un lieu ni une époque – à moins que peut-être, au-dessus des rideaux de ce lit mystérieux et quasi funéraire, dans le couronnement d’ébène, la finesse merveilleuse des sculptures ne révèle des patiences chinoises. Ailleurs cependant tout est sobre, morne, conçu en lignes droites et austères.
Où donc sommes-nous, dans quelle demeure lointaine, fermée, clandestine ?
Est-ce de nos jours que quelqu’un vivait ici, ou bien était-ce dans le recul des temps ? Depuis combien d’heures – ou combien de siècles – est-il parti, et qui pouvait-il bien être, l’hôte de la chambre abandonnée ?…
Quelque rêveur très triste évidemment, pour avoir choisi ce recoin d’ombre, et très raffiné aussi, pour avoir laissé derrière lui cette senteur distinguée, et très las, pour s’être complu dans cette terne simplicité et ce crépuscule éternel.
Vraiment on se sent étouffé par ces trop petites fenêtres, aux carreaux voilés de papier soyeux, qui n’ont pu jamais s’ouvrir pour le soleil ni pour l’air, puisqu’elles sont partout scellées dans le mur. Et puis, on repense à tout ce qu’il a fallu faire de chemin et rencontrer d’obstacles, avant d’arriver ici, et cela inquiète.
D’abord, la grande muraille noire, la muraille babylonienne, les remparts surhumains d’une ville de plus de dix lieues de tour, aujourd’hui en ruine et en décombres, à moitié vidée et semée de cadavres. Ensuite une seconde muraille, peinte en rouge sombre de sang, qui forme une autre ville forte, enfermée dans la première. Ensuite une troisième muraille, plus magnifique, mais de la même couleur sanglante – muraille du grand mystère celle-ci, et que jamais, avant ces jours de guerre et d’effondrement, jamais aucun Européen n’avait franchie ; nous avons dû aujourd’hui nous arrêter plus d’une heure, malgré les permis signés et contre-signés ; à travers les serrures d’une porte farouche, qu’un piquet de soldats entourait et que des madriers barricadaient par-derrière comme en temps de siège, il a fallu menacer, parlementer longuement, avec des gardiens intérieurs qui voulaient se dérober et fuir. Une fois ouverts les battants lourds, bardés de ferrures, une autre muraille encore est apparue, séparée de la précédente par un chemin de ronde, où gisaient des lambeaux de vêtements et où des chiens tramaient des os de mort – nouvelle muraille toujours du même rouge, mais encore plus somptueuse, couronnée, sur toute sa longueur infinie, par des ornements cornus et des monstres en faïence jaune d’or. Et enfin, ce dernier rempart traversé, des vieux personnages imberbes et singuliers, venus à notre rencontre avec des saluts méfiants, nous ont guidés à travers un dédale de petites cours, de petits jardins murés et remurés, où végétaient, entre des rocailles et des potiches, des arbres centenaires ; tout cela séparé, caché, angoissant, tout cela protégé et hanté par un peuple de monstres, de chimères en bronze ou en marbre, par mille figures grimaçant la férocité et la haine, par mille symboles inconnus. Et toujours, dans les murailles rouges au faîte de faïence jaune, les portes derrière nous se refermaient : c’était comme dans ces mauvais rêves où des séries de couloirs se suivent et se resserrent, pour ne vous laisser sortir jamais plus.
Maintenant, après la longue course de cauchemar, on a le sentiment, rien qu’à contempler le groupe anxieux des personnages qui nous ont amenés, trottinant sans bruit sur leurs semelles de papier, le sentiment de quelque profanation suprême et inouïe, que l’on a dû commettre à leurs yeux en pénétrant dans cette modeste chambre close ils sont là, dans l’embrasure de la porte, épiant d’un regard oblique le moindre de nos gestes, les cauteleux eunuques en robe de soie, et les maigres mandarins qui portent au bouton rouge de leur coiffure la triste plume de corbeau. Obligés pourtant de céder, ils ne voulaient pas ; ils cherchaient, avec des ruses, à nous entraîner ailleurs, dans l‘immense labyrinthe de ce palais d’Héliogabale, à nous intéresser aux grandes salles sombrement luxueuses qui sont plus loin, aux grandes cours, là bas, et aux grandes rampes de marbre où nous irons plus tard ; à tout un Versailles colossal et lointain, envahi par une herbe de cimetière et où l’on n’entend plus que les corbeaux chanter…
Ils ne voulaient absolument pas, et c’est en observant le jeu de leurs prunelles effarées que nous avons deviné où il fallait venir.
Qui donc habitait là, séquestré derrière tant de murs, tant de murs plus effroyables mille fois que ceux de toutes nos prisons d‘Occident ? Qui pouvait-il bien être, l’homme qui dormait dans ce lit, sous ces soies d’un bleuâtre nocturne, et, qui, pendant ses rêveries, à la tombée des soirs, ou bien à l’aube des jours glacés d’hiver pendant l’oppression de ses réveils, contemplait ces pensifs petits bouquets sous globe, rangés en symétrie sur les coffres noirs ?…
C’était lui, l’invisible empereur Fils du Ciel, l’étiolé et l’enfantin, dont l’empire est plus vaste que notre Europe, et qui règne comme un vague fantôme sur quatre ou cinq cents millions de sujets.
De même que s’épuise dans ses veines la sève des ancêtres presque déifiés, qui s’immobilisèrent trop longtemps au fond de palais plus sacrés que des temples, de même se rapetisse, dégénère et s’enveloppe de crépuscule le lieu où il se complaît à vivre. Le cadre immense des empereurs d’autrefois l’épouvante, et il laisse à l’abandon tout cela ; l’herbe pousse et les broussailles sauvages, sur les majestueuses rampes de marbre, dans les grandioses cours ; les corbeaux et les pigeons nichent par centaine aux voûtes dorées des salles de trône, couvrant de terre et de fiente les tapis somptueusement étranges qu’on y laisse pourrir. Cet inviolable palais, d’une lieue de tour, qu’on n’avait jamais vu, dont on ne pourra rien savoir, rien deviner, réservait aux Européens, qui viennent d’y entrer pour la première fois, la surprise d’un délabrement funèbre et d’un silence de nécropole.
Il n’allait jamais par là, le pâle empereur. Non, ce qui lui seyait lui, c’était le quartier des jardinets et des préaux sans vue, le quartier mièvre par où les eunuques regrettaient de nous avoir fait passer. Et, c’était, dans un renfoncement craintif, le lit-alcôve, aux rideaux bleu nuit.
De petits appartements privés, derrière la chambre morose, se prolongent avec des airs de souterrains dans la pénombre plus épaisse ; l’ébène y domine ; tout y est volontairement sans éclat, même les tristes bouquets momifiés sous leurs globes. On y trouve un piano aux notes très douces, que le jeune empereur apprenait à toucher, malgré ses ongles longs et frêles ; un harmonium ; une grande boîte à musique jouant des airs de nostalgie chinoise, avec des sons que l’on dirait éteints sous les eaux d’un lac.
Et enfin, voici le retiro sans doute le plus cher, étroit et bas comme une cabine de bord, où s’exagère la fine senteur de thé et de rose séchée.
Là, devant un soupirail voilé de papier de riz qui tamise des petites lueurs mortes, un matelas en soie impériale jaune d’or semble garder l’empreinte d’un corps, habituellement étendu. Il y traîne quelques livres, quelques papiers intimes. Plaquées au mur, il y a deux ou trois images de rien, pas même encadrées, représentant des roses incolores, et, écrite en chinois, la dernière ordonnance du médecin pour ce continuel malade.
Qu‘était-ce, au fond, que ce rêveur, qui le dira jamais ? Quelle vision déformée lui avait-on léguée des choses de la terre, et des choses d’au-delà, que figurent ici pour lui tant d’épouvantables symboles ? Les empereurs demi-dieux dont il descend faisaient trembler la vieille Asie, et, devant leur trône, les souverains tributaires venaient de loin se prosterner, emplissant ce lieu de cortèges et d’étendards dont nous n’imaginons plus la magnificence ; lui, le séquestré et le solitaire, entre ces mêmes murailles aujourd’hui silencieuses, comment et sous quels aspects de fantasmagorie qui s’efface gardait-il en soi-même l’empreinte des passés prodigieux ?
Et quel désarroi sans doute, dans l’insondable petit cerveau, depuis que vient de s’accomplir le forfait sans précédent, que ses plus folles terreurs n’auraient jamais su prévoir : le palais aux triples murs, violé jusqu’en ses recoins les plus secrets ; lui, Fils du Ciel, arraché à la demeure où vingt générations d’ancêtres avaient vécu inaccessibles ; lui, obligé de fuir, et dans sa fuite, de se laisser regarder, d’agir à la lumière du soleil comme les autres hommes, peut-être même d’implorer et d’attendre !…
Lundi 22 octobre.
Des équipes de Chinois – parmi lesquels ou nous a prévenus qu’il y a des espions et des Boxers – entretenant dans notre palais le feu de deux fours souterrains, nous ont chauffés toute la nuit par en dessous, plutôt trop. À notre réveil d’ailleurs, c’est comme hier une illusion d’été, sous nos légères vérandas, aux colonnettes vertes peinturlurées de lotus roses. Et un soleil tout de suite brûlant monte et rayonne sur le pèlerinage presque macabre que je vais faire à cheval, vers l’ouest, en dehors de la Ville tartare, à travers le silence de faubourgs détruits, parmi des ruines et de la cendre.
De ce côté, dans la poussiéreuse campagne, étaient des cimetières chrétiens qui, même en 1860, n‘avaient pas été violés par la populace jaune. Mais cette fois, on s’est acharné contre ces morts, et c’est là partout le chaos et l’abomination ; les plus vieux ossements, les restes des missionnaires qui dormaient depuis trois siècles, ont été déterrés, concassés, pillés avec rage, et puis jetés au feu afin d’anéantir, suivant la croyance chinoise, ce qui pouvait encore y rester d’âme. Et il faut être un peu au courant des idées de ce pays pour comprendre l’énormité de cette suprême insulte, faite du même coup à toutes nos races occidentales.
Il était singulièrement somptueux, ce cimetière des pères jésuites, qui furent jadis si puissants auprès des empereurs célestes, et qui empruntaient pour leurs propres tombes les emblèmes funéraires des princes de la Chine. La terre est jonchée à présent de leurs grands dragons de marbre, de leurs grandes tortues de marbre, de leurs hautes stèles enroulées de chimères ; on a renversé, brisé toutes ces sculptures, brisé aussi les lourdes pierres des caveaux, et profondément retourné le sol.
Un plus modeste enclos, près de celui-là, recevait depuis de longues années les morts des légations européennes. Il a subi la même injure que le beau cimetière des jésuites : on a fouillé toutes les fosses, broyé tous les cadavres, violé même de petits cercueils d’enfant. Quelques débris humains, quelques morceaux de crâne ou de mâchoires traînent encore par terre, avec les croix renversées. Et c’est une des plus poignantes désolations qui se soient jamais étalées devant mes yeux au soleil d’un radieux matin.
Tout à côté demeuraient des bonnes sœurs, qui tenaient une école de petites Chinoises : il ne reste plus de leurs modestes maisons qu’un amas de briques et de cendres ; on a même arraché les arbres de leurs jardins pour les repiquer la tête en bas, par ironie.
Et voici à peu près leur histoire.
Elles étaient seules, la nuit où un millier de Boxers vinrent hurler à la mort sous leurs murs, en jouant du gong ; alors elles se mirent en prière dans leur chapelle pour attendre le martyre. Cependant les clameurs s’apaisèrent, et quand le jour se leva, les alentours étaient vides ; elles purent se sauver à Pékin et s’abriter dans l’enclos de l’évêché, emmenant le troupeau épouvanté de leurs petites élèves. Lorsqu’on demanda par la suite aux Boxers : Comment n’êtes-vous pas entrés pour les tuer ? Ils répondirent : C’est que nous avons vu tous les murs du couvent se garnir de têtes de soldats et de canons de fusil. Elles ne durent la vie qu’à cette hallucination des tortionnaires.
Les puits de leurs jardins dévastés remplissent aujourd’hui le voisinage d’une odeur de mort. C’étaient trois grands puits ouverts, larges comme des citernes, fournissant une eau si pure qu’on l’envoyait de loin chercher pour le service des légations. Les Boxers les ont comblés jusqu’à la margelle avec les corps mutilés des petits garçons de l’école des frères et des familles chrétiennes d’alentour. Les chiens tout de suite sont venus manger à même l’horrible tas, qui montait au niveau du sol ; mais il y en avait trop ; aussi beaucoup de cette chair est-elle restée, se conservant dans la sécheresse et dans le froid, et montrant encore des stigmates de supplice. Telle pauvre cuisse a été zébrée de coupures, comme ces entailles faites sur les miches de pain [3] par les boulangers. Telle pauvre main n’a plus d’ongles. Et voici une femme à qui l’on a tranché, avec quelque coutelas, une partie intime de son corps pour la lui mettre dans la bouche, où les chiens l’ont laissée entre les mâchoires béantes… On dirait du sel, sur ces cadavres, et c’est de la gelée blanche qui n’a pas fondu dans les affreux replis d’ombre. Le soleil cependant, l’implacable et clair soleil, détaille les maigreurs, les saillies d’os, exagère l’horreur des bouches ouvertes, la rigidité des poses d’angoisse et des contournements d’agonie.
Pierre Loti. Les derniers jours de Pékin. Voyages 1872-1943 Bouquins Robert Laffont 1991
Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint le récit des faits qui se sont produits à Pékin du 20 juin au 15 août. J’y joins la correspondance échangée, entre ces deux dates, avec le Tsungli Yamen par le corps diplomatique ou par moi, et le texte des télégrammes que je vous ai envoyés directement ou par l’intermédiaire du gouvernement chinois. Il me semblerait superflu d’ajouter de longues considérations à l’historique, déjà suffisamment détaillé, des événements que je rapporte, et aux documents qui l’accompagnent. Du 20 juin au 14 août, les légations ont été assiégées par les troupes impériales. Elles ont eu à lutter contre l’incendie, les fusillades, la canonnade et les mines. Les escortes qui les défendaient se composaient (officiers compris) de 409 hommes, auxquels on peut ajouter 80 volontaires, armés de carabines de divers modèles ou de fusils de chasse. Elles possédaient un canon italien de 37 mm, un canon Maxim, une mitrailleuse autrichienne et une mitrailleuse américaine. Les détachements italien, japonais et russe, n’avaient – les deux premiers surtout – que très peu de munitions.
[…] On peut se demander comment les assiégés ont résisté et ont été sauvés. Il a fallu, pour empêcher le massacre général, auquel tout semblait les condamner, une série d’événements extraordinaires, dont l’origine tient peut-être moins à la volonté des hommes qu’à un concours de circonstances échappant à toutes les prévisions.
Si, le 20 juin, le corps diplomatique était allé au Tsungli Yamen comme il en avait manifesté l’intention, aucun des membres n’aurait échappé à la mort ou pour le moins à la fusillade des soldats chinois. Le hasard a voulu que, seul, le ministre d’Allemagne se rendît à l’audience qu’il avait demandée : il a été assassiné.
Si le 22 juin, l’évacuation des légations de France, d’Allemagne, d’Amérique et de Russie avait été maintenue, ou si elle avait eu lieu quelques jours plus tard, comme il en était sérieusement question, la légation d’Angleterre aurait succombé en moins d’une quinzaine. Si, dès le commencement du siège, nous n’avions pas découvert dans des maisons abandonnées assez de riz et de blé pour nourrir 900 réfugiés et 2 400 chrétiens indigènes pendant plus de deux mois, nous aurions été pris par la famine.
Si nos agresseurs, au lieu d’envoyer la plupart de leurs artilleurs à T’ien-tsin, avaient conservé quelques bons pointeurs à Pékin, nous aurions été hors d’état de nous protéger contre leurs canons. Si, d’ailleurs, les Chinois avaient eu quelque courage, et tenté l’assaut de nos murs et de nos barricades, nous aurions été écrasés par la supériorité numérique qu’ils pouvaient nous opposer.
Si, à partir du 17 juillet, nous n’avions profité d’une sorte d’armistice intermittent dont il est difficile de démêler toutes les causes, les pertes que nous aurions subies – en les évaluant suivant les mêmes proportions que celles qui nous avaient été infligées jusqu’à la suspension partielle du feu – nous auraient réduits à l’impuissance. En outre, nos munitions auraient été absorbées complètement avant la possibilité de notre libération.
Si l’armée internationale, arrivée le 14 août dans la capitale chinoise, avait ajourné de 24 heures son entrée, il est probable qu’elle ne nous aurait plus trouvés vivants. Les Chinois avaient creusé sous la légation d’Angleterre une mine de 54 mètres de long, qui, en éclatant, aurait pu tuer 100 personnes et aurait ouvert aux assaillants le refuge des femmes et des enfants. Ils avaient effectué sur la muraille un travail de même nature qui aurait fait sauter la barricade russo-américaine, et ils étaient près d’aboutir au même résultat à la légation de France. Notre salut tient donc à un ensemble d’événements inattendus qui ne peuvent s’expliquer par un raisonnement logique et par un enchaînement de considérations rationnelles. J’ajoute que la saison, qui risquait de créer de sérieux obstacles aux mouvements de l’armée envoyée à notre secours, nous a été particulièrement clémente. Au lieu des pluies habituelles du mois de juillet, nous avons eu, sauf quelques orages rafraîchissants et bienfaisants, une température sèche et peu élevée. Tout rendait possible et pratique, même à une date plus rapprochée que celle qui a été choisie, un coup de main sur Pékin, d’où les Chinois se seraient enfuis – comme ils l’ont fait du reste – à l’approche de notre artillerie. […] Il est assez curieux à ce propos, de faire la comparaison des pertes subies par chaque détachement : sur 82 hommes (officiers compris) les Anglais ont eu 3 tués, 10 blessés. Sur 81 hommes (officiers compris), les Russes ont eu 4 tués, 19 blessés ; sur 58 hommes les Américains 7 tués 10 blessés sur 51 hommes les Allemands 12 tués 15 blessés sur 48 hommes les Français 11 tués 22 blessés sur 35 hommes les Autrichiens 4 tués 11 blessés sur 29 hommes les Italiens 7 tués 12 blessés sur 25 hommes les Japonais 5 tués 20 blessés. À ce total de 53 tués et 119 blessés, il faut ajouter 12 tués et 23 blessés parmi les volontaires, ce qui fait, pour moins de 500 hommes – 65 tués et 142 blessés. Les 35 volontaires tués ou blessés sont pour la plupart des Japonais, des Anglais ou des Russes. Nous avons eu toutefois à déplorer la mort de trois Français […]. Le moment n’est pas venu de fixer les responsabilités engagées dans ce drame horrible que couvrent encore trop d’obscurités. Ce qu’on peut dire dès maintenant, c’est que le rôle principal y a été joué par trois personnages dont les noms sont à retenir, et dont le châtiment, quel qu’il soit, ne saurait être trop sévère : le prince Toan, père de l’héritier présomptif du trône ; le général Tung-fou-siang, commandant des troupes du Kan-Sou, connu pour une hostilité de sauvage contre tout homme civilisé, et le grand secrétaire d’État Kang-I. En dehors de ces meneurs de haute marque, il y a eu des comparses d’un rang moins élevé, et d’une influence moins grande, comme Li-ping-Heng, ancien gouverneur du Chantoung, révoqué sous la pression allemande lors de la prise de Kiao-Tcheou ; le prince Lan, frère de Toan, et le prince Tchouang, qui avait été désigné pour enrôler et diriger les Boxers. L’action du triumvirat formé par Toan, Tung-fou-siang et Kang-I, s’est exercée dictatorialement sur l’impératrice, dont je suis loin d’excuser ou d’atténuer les criminelles entreprises, mais qui n’a été, sous ses allures autoritaires, qu’un instrument à la disposition de ces fanatiques imbéciles. On peut dire que, du 20 juin au 15 août, Pékin a été gouverné officiellement par les Boxers, qui s’y sont livrés aux pires brigandages, volant, pillant, assassinant les chrétiens ou les habitants paisibles qui refusaient de prendre part ou de payer tribut à leurs orgies. Ces actes se sont accomplis au milieu d’une anarchie sans pareille, les pillards tirant les uns sur les autres, et les soldats se combattant réciproquement pour se disputer les meilleures proies.
Les leçons infligées par les victoires européennes (la prise de T’ien-tsin surtout) et par l’approche de l’armée internationale ont, par intervalles, jeté le trouble et le désarroi dans l’entourage de la souveraine. La stupide infatuation des mandarins qui s’étaient crus de taille à faire la guerre au monde, a reçu le contrecoup de nos succès, et s’en est plusieurs fois ressentie. L’élément modéré, personnifié par le prince Tching, et le Tiers-Parti, dont Jong lou semble avoir été l’incarnation a essayé de réagir contre les odieuses folies qui conduisaient l’empire aux catastrophes. Mais le courage n’est pas ce qui distingue les hauts mandarins chinois, et ceux-là mêmes qui comprenaient le péril n’osèrent pas faire ce qu’il fallait pour le conjurer. Ils s’arrêtèrent à mi-route, préférant avoir les mains ensanglantées, et laisser les légations sous la menace des mines et des barricades, plutôt que de s’exposer personnellement à la vengeance des fous furieux auxquels l’impératrice obéissait. Ils avaient, d’ailleurs, sous les yeux, des exemples faits pour entretenir cette lâcheté : quatre membres du Tsungli Yamen, et un ministre de la maison impériale, furent exécutés peu de jours avant l’entrée de nos troupes à l’endroit où l’on coupe la tête aux criminels de droit commun. Parmi les victimes de ce supplice que le raffinement barbare de ses auteurs avait rendu plus infamant qu’aucun autre, deux (Hin-Tching-Tcheng, ancien ministre à Pétersbourg et à Paris, et Sin-Yong-Yi) étaient principalement coupables d’avoir fait acheter un cercueil pour le ministre d’Allemagne, assassiné sur l’ordre exprès de Tung-fou-siang. Les trois autres (Yuan-Tch’ang, Lien-Yuang et Li-chan) étaient accusés de tiédeur dans les tentatives de massacre dont les étrangers étaient l’objet.
La docilité avec laquelle l’impératrice se prêtait à ces représailles impressionnait ceux qui redoutaient d’en être victimes à leur tour. De là le caractère instable et équivoque de l’armistice qui nous a néanmoins permis d’atteindre vivants le terme de nos épreuves. De là de sourdes luttes entre les divers partis représentés au pouvoir, lutte dont nous pouvions constater les effets par le degré de violence des attaques que nous avions à repousser. Suivant que le prince Toan et ses acolytes étaient plus ou moins confiants dans leur dictature, ou que le prince Tching et (à un degré moindre) Jong-lou, se sentaient ou non rassurés, nous étions plus ou moins en butte à la fusillade ennemie. Ce sont ces alternatives de persévérance ou de défaillance dans le mal qui ont contribué à l’échec de l’attentat organisé par un gouvernement qui prenait sur lui d’ordonner le massacre général des étrangers vivant dans sa capitale, et qui s’efforçait en particulier d’assassiner tous les membres du corps diplomatique sans excepter les femmes et les enfants. En même temps, il répandait partout au-dehors, avec une maestria de mensonge et de perfidie dont on chercherait vainement un autre exemple, le bruit qu’il prenait les mesures de protection les plus efficaces en faveur de ceux qu’il faisait mitrailler jour et nuit. Aucune peuplade d’anthropophages peut-elle se vanter d’avoir travaillé mieux que cela ?
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.
Stephen Pichon, ministre plénipotentiaire de France en Chine. Dépêche du 28 août 1900. (MAE, NS Chine, vol. 106, f »s 64 et suiv.)
http://www.google.fr/search?q=cit%C3%A9+interdite+chine&hl=fr&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=
La Chine ? Un pays où quelques centaines de millions de Chinois vivants sont dominés et terrorisés par quelques milliards de Chinois morts.
Anonyme
9 10 1900
Mise en service d’un four à arc électrique qui, à partir de l’invention de Paul-Louis Heroult, permet d’obtenir des aciers de qualité supérieure.
_____________________________________________________________________________________________
[1] … auquel le Kaiser avait demandé que le nom des Allemands acquière en Chine la même réputation que celui des Huns
[2] La France comptait en 1901 36 192 communes : ce sont donc près de 15 000 maires qui ne purent – ou ne voulurent – se rendre à l’invitation. En 2023, on en compte 34 945, dont 34 816 en métropole, Corse incluse, et 129 outre-mer.
[3] C’est quelques années plus tard que va apparaître la baguette. En ce temps là le français mangeait à peu près 1 kg de pain par jour… 100 grammes aujourd’hui
Laisser un commentaire