| Publié par (l.peltier) le 25 septembre 2008 | En savoir plus |
15 02 1902
La loi de protection de la santé publique rend obligatoire la vaccination antivariolique pour les bébés avant un an révolu.
4 03 1902
Création du Parti Socialiste lors du Congrès de Tours.
11 04 1902
Premier enregistrement sur gramophone : cela se passe dans la chambre d’un hôtel de Milan, et, à tout seigneur, tout honneur, c’est Enrico Caruso le grand ténor natif de Naples, qui est enregistré.
Derrière les grésillements s’élèvent les voix puissantes de l’Italien Enrico Caruso (1873-1921) ou du Russe Fédor Chaliapine (1873-1938).Gravées sur des 78 tours fabriqués à base de gomme laque, résine naturelle, (le vinyle viendra bien plus tard), les œuvres de ces ténors mythiques provoquent toujours des frissons. Le 78 tours, géniale invention due à l’Allemand Emil Berliner (1851-1929), a permis au grand public d’accéder à la musique. Et durant près de soixante ans, le 78 tours, support exceptionnel, régnera sur le monde. […] Comme le résume le compositeur contemporain britannique Aleks Kolkowski. Même si la qualité d’enregistrement est largement inférieure aux normes actuelles, le son du 78 tours possède une présence qui crée une relation très intime entre l’auditeur et l’interprète. Inventeur de génie mais aussi homme d’affaires redoutable, Emil Berliner ne cessera d’améliorer ses inventions sonores et saura vendre son 78 tours à travers le monde, alors que l’Américain Thomas Edison (1847-1931), qui avait pris de l’avance avec son gramophone à cylindre de cire, abandonnera la course musicale pour se consacrer à l’électricité. Dès 1887, Berliner fait breveter son disque plat dans l’empire allemand, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. De par leur composition, ces disques peuvent être fabriqués en grande quantité. Onéreux à ses débuts, le 78 tours est adopté au début du XX° siècle par les foyers aisés et les restaurateurs. En trois ans, l’inventeur allemand a fondé la Berliner Gramophone à Philadelphie (1895), la Gramophone UK (1897) puis la Deutsche Grammophon (1898). Rien ne lui résiste. Ses collaborateurs sillonnent la planète à la recherche des voix de l’avenir. En Inde, au Japon, en Azerbaïdjan, ils enregistrent tout, découvrent des talents. À partir de 1904, le 78 tours, produit à 25 000 exemplaires par jour, s’impose dans les foyers. Les disques sont de moins en moins chers, les gramophones aussi. Période bénie pour le 78 tours, les années 1920-1930 feront triompher le jazz et le swing. Une belle époque.
alain constant. La Révolution du 78 tours, de Dagmar Brendecke (All., 2019, 52 min).Le Monde du 4 01 2020
7 05 1902
À Tit, 50 km au nord-ouest de Tamanrasset, le lieutenant Coutenest, à la tête de 90 méharistes formés de l’ensemble des tribus touaregs ralliées à la France, renforcé de quarante moghaznis, des arabes Chambâas d’Ouargla, est attaqué par les Kel Ahaggar, les Touaregs du Hoggar, qui vont connaître une sanglante défaite : 93 d’entre eux sont tués, leur chef compris. Le lieutenant Coutenest compte 3 morts et une dizaine de blessés. Sévèrement défaits, les Touaregs vont changer de stratégie, se dispersant dans d’autres massifs montagneux. Émergera de cette résistance la figure de Kaosen, de la tribu des Igerzawen, appartenant à la puissante confédération des Ikazkazen de l’Aïr. Il lui faudra 14 ans pour se trouver à la tête d’une armée équipés et organisée pour la guerre moderne.
8 05 1902
Éruption du volcan de la Montagne Pelée, dans le nord de la Martinique : gaz et cendres sont propulsés à l’horizontale à près de 550° à une vitesse de 130 à 150 m/s, provoquant la mort de 28 000 personnes en quelques secondes. Les ponts des bateaux ancrés dans le port de St Pierre, s’embrasent, et le Belem ne doit de rester intact qu’au fait d’avoir été contraint à mouiller beaucoup plus loin, faute de place dans le port de Saint Pierre [1]. Il reste deux survivants, un prisonnier sauvé par sa geôle, et un cordonnier, réfugié sous une table de sa maison, elle-même à l’abri du souffle. Pourtant, la Montagne Pelée n’avait pas été avare de signes avant-coureurs : premières fumerolles en 1889 et 1901, séisme le 22 avril, explosion le 24, séismes à nouveau les 29 et 30, explosions le 2 mai, pluie de cendres le 7. Mais des élections étaient prévues pour le dimanche 11 mai, et les autorités avaient convaincu les habitants de rester chez eux. De plus, tout cela se passait à une époque où les connaissances en vulcanologie étaient très embryonnaires : on ne savait donc pas discerner la gravité des signes avant-coureurs. La grand-mère d’Alexis Saint Léger – alias Saint John Perse – créole de vieille souche, d’une île proche de la Guadeloupe, parlait un jour à son petit fils de cette catastrophe où il était mort sept mille personnes ; il corrigea le chiffre en disant qu’il y en avait eu quatre fois plus ; elle rétorqua : ah, mais bien sur, si tu comptes les gens de couleur !
La nuée ardente dévala les pentes de la montagne à plus de 600 km/h et dégagea des températures supérieures à 800°C. La coulée pyroclastique fut sans pitié, la végétation pétrifiée, les métaux et les verres torturés, fondus. En moins de deux minutes, Saint Pierre fut totalement dévasté et toute vie effacée. Plus de 28 000 personnes périrent, éviscérées, démembrées, déchiquetées, carbonisées.
Aujourd’hui d’aucuns peuvent, à la lueur des événements, imputer aux politiques locaux et autres responsables de l’époque le lourd fardeau du désastre.
Mais ce serait oublier qu’au début du siècle, les volcans et leurs coulées pyroclastiques représentaient encore bien des mystères, et qu’il faudra attendre l’année 1912, avec la théorie de la tectonique des plaques d’Alfred Wegener, pour qu’une infime partie des mécanismes géologiques soit comprise.
Jean Yves Delitte. Belem. Enfer en Martinique. BD. Glénat Chasse-marée.2008


20 05 1902
Indépendance formelle de Cuba : en fait les États-Unis, outre qu’ils conservent certaines bases militaires, dont Guantanamo, vont continuer à garder la main haute sur le pays, nommant des gouvernants qui seront à leur solde, pillant les richesses du pays à leur profit. Plantations, canne à sucre, minerais, chemins de fer, banques etc… seront sous contrôle américain. Moins de trente ans plus tard, Paul Morand en témoignera : Molle Havane, créole indolente, où sont tes vieux planteurs du temps d’Isabelle, en pantalon de nankin, à barbe double, auréolés de médailles d’or sur fond de palmiers, comme à l’intérieur des boîtes de cigares ? Faut-il que les États-Unis soient un enfer pour que ceux qui en arrivent (par les nouveaux trains de cette année, qui mettent La Havane à quarante-sept heures de New York) voient en toi l’oasis de repos et de tiédeur que tu n’es plus ?
Dure et riche, polie dans tous ses matériaux, propre comme un transatlantique, asphaltée, sans une ombre, sans un arbre, La Havane ne connaît plus ces désordres politiques ou militaires, ces embarras de voitures ou d’argent, toute cette anarchie latine qu’on se prend à regretter dès qu’elle est à jamais perdue. Des autos américaines, aux nickels hurlants, la déchirent en tous sens. Quartiers nègres, rues chinoises, ne sont même plus les refuges du romantisme. Ici, la respiration, c’est le cours des sucres ; ses écarts – il a passé de deux sous à trente, depuis la fin de la guerre, pour redescendre à trois – ruinent ou enrichissent, rapides comme des cyclones. C’est le sucre qui suffit à toute cette dépense, à ce luxe épouvantable, où la vanité a la plus grande part. Bonbonnières de cocottes, hôtels particuliers en blanc d’œuf, mansions Tudor imitées des Américains, petits Trianons en beurre, croquignoles et friandises à l’italienne. Le goût vient rarement tempérer ces excès. Toute la ville est en marbre et tout ce marbre vient d’Italie. Les nouvelles routes sont en granit. Un burg rhénan a des plafonds en nacre. De ces demeures, les dernières ne sont pas les moins belles. J’ai traversé en auto, à toute allure, le cimetière de Colomb où chaque défunt a droit à une villa de marbre, à un chalet à perpétuité, avec vitraux et gargouilles de céramique, sorte de Viroflay funéraire. Le nouvel hôpital a soixante-cinq pavillons, grands comme un de nos hôpitaux ; dans chacun, l’on soigne un type différent de maladies ; si l’on arrivait avec une de ces belles lèpres inconnues d’Asie centrale, on aurait droit à un soixante-sixième pavillon que l’on vous construirait dans la nuit. Ici, l’on compte par millions de dollars. Que ne pourrait-on faire avec tant d’argent ! Il faut dire que les dernières constructions témoignent d’un meilleur goût. L’influence de notre exposition des Arts décoratifs se fait sentir ; Lalique décore de ses verres exquis plusieurs demeures ; la Renaissance espagnole et jésuite réveille l’art local ; enfin, après un détour par Montparnasse, les jeunes artistes cubains demandent à l’artisanat et au folklore nègres des Antilles une inspiration très heureuse.
Si l’on peut dire qu’à Cuba les États-Unis sont partout, – mainmise sur les terrains, sur les sucres, trust du tabac, industrie, tourisme, – il faut avouer que Cuba a, par ailleurs, sa revanche. En ce Monte-Carlo tropical, l’on trouve à jouer tous les jeux défendus, jusqu’au matin; plus de cinquante restaurants de nuit ; quatre mille bars et cafés, pour une ville qui ne dépasse guère le demi-million d’habitants. Quarante-cinq jours de carnaval et, chaque dimanche, toute la ville masquée. Le plus beau golf ; un yacht-club, d’ailleurs sans yachts. Enfin, il n’est pas besoin de le dire, tous les alcools du monde, tout ce que, depuis la Sibérie jusqu’à l’Australie, les hommes ont imaginé de faire fermenter et mis en bouteilles. Voici le patio de l’hôtel Sevilla, à l’heure du cocktail. Cette cour intérieure espagnole, aux piliers revêtus de faïences, d’azulejos, au carrelage grenadin, décorée de fougères tropicales et de cages où les oiseaux des îles font plus de bruit que des Américaines, on y boit, entre midi et une heure, plus que dans toute la France. C’est une telle inflation de beautés que les cours s’en effondrent. Les bouches remuent, les yeux glissent, les rires éclatent. Atmosphère de bonnes fortunes, d’amours de hasard, de rendez-vous furtifs, de ruptures de ban, de divorces en puissance, d’ivresse, de frivolité, de reportage scandaleux et de chantage, sur laquelle plane cette honte dont les Anglo-Saxons n’arrivent jamais à se défaire, surtout lorsqu’ils prennent leurs plaisirs en commun. Tout se calme à l’heure de la sieste et reprend vers le soir, après une journée passée dans ces grands clubs hispano-américains des environs. Dîner sur les toits, tandis que, la nuit, ce luxe des tropiques est annulé par tant de constellations commerciales. Le style des visiteurs, à vrai dire, laisse à désirer. Hollywood, les dactylographes trop blondes, aux bas roulés, en fuite avec leur patron, les vedettes de music-hall, les boucaniers et pirates du whisky dominent. La bonne société américaine est en Floride ou au Cap-d’Ail ; les Cubains de qualité sont invisibles et murés, sauf les jours de gala, de moda au Country-Club.
Paul Morand. Hiver Caraïbe. 1929
31 05 1902
La paix généreuse de Vereeniging marque la fin de la guerre des Boers : les Anglais n’exercent pas de représailles et consentent à d’importants dédommagements pour que les Boers puissent reconstituer fermes et troupeaux.
27 06 1902
La durée du temps de travail par jour passe à 10 h 30, limitée à 9 heures pour les mineurs.
1 07 1902
Un décret ordonne la fermeture systématique des 125 écoles catholiques dites non autorisées, car créées après la promulgation de la loi du 1° juillet 1901, et même de celles qui, appartenant à des congrégations autorisées, croyaient ne pas avoir besoin d’autorisation. Waldeck Rousseau avait pris prétexte des vœux de pauvreté et d’obéissance demandés aux religieux pour les exclure du bénéfice des droits des citoyens, puisque ces éléments venaient contribuer à l’enrichissement des congrégations.
14 07 1902
À Venise, le campanile de la Place Saint Marc s’écroule : Nos yeux viennent de voir un des plus grands désastres historiques et artistiques que l’on puisse imaginer : l’écroulement de la tour Saint-Marc ! Ma main tremble en essayant de vous transmettre la nouvelle de cette catastrophe indicible et inoubliable, qui rassemble en ce moment sur la piazzetta voisine de la lagune et sur la piazza qu’entourent le palais royal et les Procurati, toute Venise affolée. Les étrangers pleurent avec nous, dans une fraternelle douleur, car ce qui a disparu était l’un des charmes de cette cité, l’une des protections de nos demeures, et nous nous demandons tous si ce n’est pas l’annonce des plus grands malheurs.
Depuis deux jours, une fêlure s’était montrée dans cette tour que tout le monde connaît, car tout le monde en a fait l’ascension par la rampe en spirale qui conduisait aux loges des cloches et permettait, au coucher du soleil, d’avoir le plus émouvant et le plus grandiose des panoramas à vos pieds : la ville avec ses coupoles aux mille couleurs, les palais, les lagunes ; au loin, la verte Adriatique, puis les Alpes neigeuses, les monts Enganéens, près de Padoue, et, au-delà du Lido, les montagnes bleues de l’Istrie.
Cette lézarde, que je vous ai signalée dans ma dépêche d’avant-hier, ne présentait, d’après les architectes, aucun danger. Elle montait depuis la loggetta jusqu’à la cinquième fenêtre, elle avait donc une vingtaine de mètres de hauteur, tout au plus, du côté de la tour de l’Horloge que surmontent les deux Vulcains de bronze annonçant les heures depuis tant de siècles.
Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, informé par le préfet de Venise, avait ordonné à l’architecte Roito Calderini et au directeur général des antiquités du ministère à Rome de partir immédiatement afin de prendre les mesures nécessaires, en leur donnant les plus amples pouvoirs pour toutes les mesures d’urgence. Mais on ne croyait à aucun danger d’effondrement, on en excluait même l’idée.
Cependant, dimanche 13 juillet 1902, on avait, par prudence, interdit la musique qui se réunit sur la place Saint-Marc, devant la fameuse loggetta qui servait, au seizième siècle, aux procurateurs pendant les séances du Grand Conseil.
Malgré cette assurance réconfortante des hommes de l’art, les promeneurs étaient anxieux ; et ce matin, dès six heures, il y avait déjà une foule nombreuse pour suivre les progrès de la fêlure et se rendre compte de l’étendue du danger. J’y étais avec mon frère l’ingénieur Marcotti. Je lui fis remarquer que la crevasse avait, pendant la nuit, toute la hauteur de la tour et avait lézardé les marbres des fenêtres, qui sont cependant très étroites, éclairant l’escalier intérieur. Un peu plus tard arriva un colonel du génie de l’armée du Roi. Il nous déclara, dès la première inspection de la tour, que le mal était irréparable et que l’effondrement était prochain.
Alors, sur l’ordre de la police, on fit dégager toute la partie de la place qui va de la gare au palais des Doges et de la loggetta, c’est-à-dire du pied de la tour, à l’église Saint-Marc. On déserta aussi, par prudence, les Procurati, c’est-à-dire les galeries qui forment la place Saint-Marc aux pavés de marbre, cette place légendaire qui est le rendez-vous du Tout Venise, le seul endroit où Vénitiens et Vénitiennes aiment à se montrer en public parmi le vol charmeur des pigeons qui fourmillent. Il n’était que temps !
À peine avait-on évacué une partie de la place, un peu après neuf heures et demie, que je vis sortir de la crevasse, à mi-hauteur de la tour, c’est-à-dire à 45 mètres de hauteur environ, un filet de poussière, et instantanément toute la masse de la tour s’abattit sur ses fondations, dans un amoncellement de décombres qui fumaient.
L’impression est impossible à décrire !
Une immense clameur s’éleva de toutes les poitrines; les assistants étaient à moitié suffoqués par le plâtre qui se répandait dans toute l’atmosphère. À ce grondement de ruines énormes succéda un nuage blanc qui envahit toute la place, et se répandit même dans la rue de la Merceria, par le porche de l’Horloge. Les coupoles dorées de l’église Saint-Marc étaient toutes saupoudrées de blanc ! Les assistants s’enfuirent de tous côtés, croyant à d’autres effondrements.
Cette émotion est inoubliable.
Par bonheur, l’église Saint-Marc est intacte sous sa couche blanche, mais l’angle du palais royal, du côté de la lagune, et les deux premières arcades des Procurati, qui vont vers le café Florian, sont gravement endommagées.
Quand le vent eut dissipé le nuage de poussière qui nous enveloppait, nous laissant craindre bien d’autres catastrophes, entre autres l’effondrement du délicieux palais des Doges, en face de la tour, nous pûmes constater que l’emplacement de la tour était transformé en une immense pyramide de ruines informes, ayant peut-être quinze mètres de hauteur, avec une base énorme de moellons et de pierres bouleversées qui avaient détruit la logetta et les statuts de bronze de la Paix, d’Apollon, de Mercure et de Pallas, les bas-reliefs fameux de Sansovino, et les portes de bronze, et la Vierge dorée du dix-septième siècle qui faisaient notre admiration et qui étaient notre amour !… L’ange de cinq mètres de hauteur qui surmontait la flèche de la tour là-haut, à 88 mètres au-dessus de nous était venu s’arrêter précisément au seuil de la porte du milieu de l’église, comme pour y chercher asile. Quant à l’église elle a été miraculeusement préservée : les blocs de la tour sont venus tomber, à l’angle de la basilique et du palais des Doges, sur des colonnes de porphyre qui ont amorti le coup et ont fait, par leur résistance, dévier l’éboulement.
Parmi les blancheurs des décombres amoncelés émergent les bronzes des cloches qui tintaient depuis dix siècles, les cuivres tordus de la flèche, les marbres colorés des sculptures du treizième siècle, les ferrures délicieuses forgées par le génie de Sansovino pour la loggetta du Grand Conseil. Tout cela est tordu, morcelé, écrasé ! L’horloge de la tour des Maures, à l’extrémité des anciennes procuraties, du côté de la rue Merceria, s’est arrêtée à onze heures une heure et demie après la catastrophe la poussière ayant envahi les aiguilles et le mécanisme.
Quant à nos pigeons si populaires, si choyés, ils ont pris leur vol on ne sait où, ne reconnaissant plus leur place tranquille où les graines étaient semées pour eux, jour et nuit, de tous temps, sur le marbre impassible de ce parvis. À l’heure où je vous télégraphie, deux heures après la catastrophe, la population est encore affolée : les femmes pleurent, les hommes discutent, avec autant d’ignorance que de passion, les causes de cet événement qui, bien qu’il n’ait fait aucune victime, est un véritable deuil pour Venise désormais privée d’un de ses joyaux, pour ainsi dire mutilée !
On va jusqu’à rechercher les responsabilités de ceux qui firent les fondations, comme si l’architecte de l’an 888 était là. C’est la folie de la tristesse !
Ce qu’il vaut mieux dire, c’est que l’œuvre de l’homme est périssable, et l’œuvre qui vient de périr était son chef- d’œuvre !
Marcotti. Le Figaro du 15 07 1902
Les travaux entrepris pour la reconstruction du campanile donneront accès aux piliers de bois qui le supportaient, tous en excellent état, près de 1 000 ans après leur mise en place, et qui seront d’ailleurs réutilisés, sur une base élargie.
Le 14 juillet 1902, vers 10 heures, le Campanile s’écroule, sans faire de dégâts ni de victimes (miracle). On décide aussitôt de le reconstruire à l’identique, ce que les Américains n’ont pas osé faire pour ce chef d’œuvre de l’architecture qu’étaient les Twuin Towers (à tort, selon moi). Quand on croit à sa civilisation, on l’affirme contre les barbares. Après tout, le diable était derrière l’effondrement du Campanile et c’est bien le diable lui-même, au nom de Dieu, qui est venu s’écraser à New-York. Le Dieu américain est-il le vrai ? Il est permis d’en douter. In dollar we trust. Ce n’est pas assez.
Philippe Sollers. Dictionnaire amoureux de Venise. Plon 2004
15 07 1902
Une circulaire demande la fermeture de 2 500 écoles tenues par des religieux et religieuses, en situation administrative irrégulière. Cela va entraîner des troubles dans toute la France, particulièrement en Bretagne.
2 08 1902
Nouveau décret demandant la fermeture de 324 écoles religieuses.
15 08 1902
Le commandant Barthélémy Le Roy Ladurie, grand-père d’Emmanuel, l’historien, reçoit l’ordre de procéder à la fermeture des écoles catholiques de Douarnenez et Audierne : il ne peut s’y résoudre et donc refuse d’exécuter l’ordre. Traduit en conseil de guerre, la sanction tombe : destitution pour désobéissance à un ordre militaire, en vue du maintien de la discipline. Il sera réintégré en 1914, bien noté, décoré de la croix de guerre, mais ne sera jamais nommé colonel. Son petit-fils Emmanuel publiera en 2014 chez Taillandier Une vie avec l’Histoire dans lequel il parle longuement de sa famille, et, curieusement cette affaire y bénéficiera du plus grand silence ; pas un mot là-dessus : ça fait drôle !
De façon générale, c’est toute la Bretagne qui se montra particulièrement rétive à l’application de ces lois laïques : à Lannion et dans ses environs ; à Ploemeur Baudou, on montera des échafaudages devant les portes de l’église, à Ploubezre, c’est 1 200 personnes qui attendront le sous-préfet devant l’église le 12 mars 1906 ; Buhulien, Servel, Tregrom, Pluzunet, Pleumeur-Gautier, Coatascorn, Mantallot… autant de villages qui manifestent leur opposition. Le 27 février 1906, l’évêque refusera de signer un procès-verbal de notification de l’inventaire du petit séminaire de Tréguier ; quatre gendarmes vont venir, puis trois sapeurs feront sauter la porte du petit séminaire.
Le gouvernement a fait procéder cette semaine aux inventaires qui n’avaient pas été précédemment effectués. Il a su prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher toute résistance des énergumènes du parti clérical. Malgré les récits publiés par les feuilles réactionnaires, tout s’est bien passé, sans occasionner nulle part aucun incident notable, au grand désespoir des organisateurs de troubles.
Le Lannionnais du 25 novembre 1906
29 09 1902
Émile Zola meurt asphyxié par les fumées de sa cheminée… qui était bouchée. Sa femme Alexandrine, gênée par ces émanations, s’était levée et avait du inspirer moins de gaz que lui – les gaz toxiques de fumée de charbon sont plus lourds que l’air – : elle devra être hospitalisée mais s’en sortira. Pour le cinquantenaire de sa mort, Libération publiera en 1953 des aveux faits en 1925 d’Henri Buronfosse, ramoneur à l’époque, qui aurait obstrué la cheminée de Zola en travaillant sur celle d’un voisin et l’aurait débouché le lendemain de sa mort ! Allez savoir ! Mais la chose a quelques chances d’être vraie quand on apprend qu’Henri Buronfosse avait été cadre de la Ligue des Patriotes fondée par Paul Déroulède, et ne pouvait donc nourrir qu’une forte antipathie pour le dreyfusard Zola. De l’antipathie à l’assassinat, à cette époque, le chemin était souvent assez court !
Devant rappeler la lutte entreprise par Zola pour la justice et la vérité, m’est-il possible de garder le silence sur ces hommes acharnés à la ruine d’un innocent et qui, se sentant perdus s’il était sauvé, l’accablaient avec l’audace désespérée de la peur ?
Comment les écarter de votre vue, alors que je dois vous montrer Zola se dressant, faible et désarmé devant eux ?
Puis-je taire leurs mensonges ? Ce serait taire sa droiture héroïque.
Puis-je taire leurs crimes ? Ce serait taire sa vertu.
Puis-je taire les outrages et les calomnies dont ils l’ont poursuivi ? Ce serait taire sa récompense et ses honneurs.
Puis-je taire leur honte ? Ce serait taire sa gloire.
Non, je parlerai.
Envions-le : il a honoré sa patrie et le monde par une œuvre immense et un grand acte.
Envions-le, sa destinée et son cœur lui firent le sort le plus grand.
Il fut un moment de la conscience humaine.
Anatole France, aux obsèques d’Emile Zola.
16 10 1902
Alphonse Bertillon effectue la première empreinte digitale pour identifier un criminel.
29 12 1902
Avant de partir d’Ushuaia, d’où l’on peut communiquer avec la capitale, à la rencontre de ses compagnons, le capitaine Larsen commandant de l’Antarctic qui avait laissé Nordenskjöld et ses quatre compagnons sur Snow Hill Island, en Antarctique, avait laissé les instructions nécessaires pour une opération de survie, qui devrait être organisée s’il n’était pas de retour en avril 1903. Il connaît le coin et prend donc la précaution supplémentaire de débarquer trois hommes – Andersson, Duse et Grunden – avec mission de rejoindre Snow Hill Island par voie de terre. Ils n’y parviennent pas, et, pensant que leur navire, lui, y est parvenu, appliquent le plan conçu pour cette option : rejoindre la baie Hope ou l’Antarctic devrait se trouver entre le 25 février et le 10 mars 1903. Ne voyant rien venir, ils se décident à construire une petite cabane en pierre et à y passer un hiver, qui va être un interminable calvaire : viande de phoque et de manchots, poissons pêchés dans un trou de banquise, graisse de phoque pour s’éclairer et se chauffer. Chaque soir, chacun s’astreint à raconter une blague pour faire rire les 2 autres : et c’est peut-être bien cela qui les a sauvé. En septembre, ils n’ont pas d’autre choix que de quitter les lieux : la base de Nordenskjöld est à plus de 300 km !
1902
L’Académie Goncourt est créée par Edmond Goncourt, sur une idée que son frère Jules avait mis sur testament : le chagrin de la perte de ce frère avec lequel il partageait tout : encrier, fureurs, passions, migraines et maîtresses, lui commandait de donner forme aux désirs de son frère. Observateurs attentifs de leur temps, ils écrivirent un Journal où le pire voisine avec le meilleur… le charnier de la vérité, selon leurs propres mots.
Déjà, les prix littéraires remuent leurs grandes oreilles et nous nous sentons pressés chaque jour davantage par ce mauvais moment à passer. Dans l’âpre foire aux vanités des jours d’automne, les auteurs n’ont pas le plus beau rôle. […] Aujourd’hui, à travers toute la France, il y a des gens qui barbouillent du papier dans le seul espoir d’obtenir une récompense. Deux cents romans paraissent ainsi en quelques semaines. Il est impossible d’en lire plus de vingt. Cent quatre-vingt romanciers se condamnent, par avidité et par bêtise, aux mélancolies du néant.
Tous ces romans qui se ressemblent, tous ces écrivains sans style, persuadés qu’ils ont composé une œuvre unique, plats, ennuyeux, corrects comme le square de Charleville où passait Arthur Rimbaud.
Kleber Haedens. L’air du pays. 1963
Fermeture des écoles appartenant aux congrégations qui ne sont pas autorisées. Fondation des établissements Carnaud et Forges de Basse-Indre, dans la Loire inférieure.
De 1902 à 1905, les Anglais W.M. Bayliss et E.H. Starling établissent le rôle des hormones : c’est le début de l’endocrinologie.
L’Espagne envoie des navires de guerre devant Tanger, et la régente Marie Christine cède le pouvoir à Alphonse XIII. Le roi du Rwanda, Youhi V Musinga fait appel aux forces allemandes pour mater une révolte armée entre ethnies. Joseph Conrad publie Au cœur des ténèbres, virulente dénonciation des exactions belges commises au Congo, propriété personnelle du roi des Belges, Léopold II.
Albert I° de Monaco se plaint vivement du bruit et de la poussière engendrés par le passage des automobiles sur la corniche ; il s’en ouvre au docteur suisse Ernest Guglielminetti qui fait déverser du goudron sur l’avenue Saint Martin.
À Titel, ville de Voïvodine, dans l’empire austro-hongrois – l’actuelle Serbie – nait Lieserl, fille de Mileva Marić, 27 ans, étudiante en physique à l’Institut Polytechnique de Zûrich, [qui deviendra en 1907 l’EPFZ – Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich]. Le père n’est autre qu’Albert Einstein, 23 ans, qui suit le même cursus que Mileva, qu’il va épouser l’année suivante, en 1903. En 1897, Mileva avait passé une année d’études à Heidelberg, en Allemagne. De retour à Zürich en 1898, elle était devenue collaboratrice d’Albert Einstein, de Marcel Grossmann et de Michele Bosso, élaborant les débuts de la théorie de la relativité. Enceinte en 1901, Mileva avait quitté l’EPFZ sans en être diplômée et avait interrompu ses études. Deux autres enfants naîtront, Hans Albert en 1904 et, en 1910, Eduard Tete qui deviendra schizophrène. La vie privée d’Albert Einstein sera pour le moins chaotique. On ne saura jamais rien de Lieserl, sinon qu’elle sera confiée aux parents de Mileva dès sa naissance et qu’elle mourra à dix-huit mois d’une scarlatine :
Quand Einstein étudiait à Zurich, il est tombé amoureux d’une étudiante serbe très douée qui s’appelait Mileva. Ils n’avaient pas un sou : ils partageaient un minuscule appartement et résolvaient des problèmes de physique – et très vite elle s’est retrouvée enceinte. Tu sais comment c’était à l’époque : Einstein, redoutant un scandale qui pouvait nuire à sa carrière, a renvoyé Mileva dans les Balkans. Après son départ, bien sûr, il a trouvé un emploi au Bureau suisse de la propriété intellectuelle et sa vie s’est transformée.
Mileva accoucha d’une petite fille, qu’elle appela Lieserl. Einstein était ravi d’être père, mais il ne pouvait en parler à personne. Lorsque Mileva revint à Zurich, elle dut laisser leur fille sur place.
Et depuis, personne n’a plus jamais eu de nouvelles de Lieserl. Ça te paraît possible, Ulrich ? Personne ne sait ce qui lui est arrivé, ni même si elle a survécu. Einstein entamait alors la phase la plus importante de ses recherches, et il était déterminé à garder l’existence de sa fille secrète. Il y est parvenu. La seule trace qu’elle a laissée, c’est la mélancolie qu’elle a engendrée chez Mileva, qui disait souvent à ses amis à quel point elle souffrait de ne pas avoir de fille.
[…] Après leur mariage, Einstein et Mileva ont eu deux fils mais avec le temps leur amour a tourné au vinaigre, et lorsqu’il a quitté Zurich pour Berlin ils se sont séparés. [Berlin, où il va épouser Elsa Löwenthal, une lointaine cousine le 2 juin 1919] Quand toi et moi étions à Berlin, c’était le savant le plus célèbre du monde, mais la peur irrationnelle que Mileva ne détruise sa réputation le possédait. En règlement de leur divorce, il avait accepté de lui remettre l’argent de son prix Nobel, mais il ne le lui a jamais donné. Il a tout perdu dans le krach de Wall Street, et Mileva a terminé ses jours dans la misère.
Cette pauvre Mileva devait s’occuper de leur fils Eduard, le musicien, qui était schizophrène. Il a fallu l’hospitaliser et elle n’avait pas les moyens de payer. Einstein n’a rendu visite à son fils qu’une seule fois, et le spectacle l’a horrifié. Il ne voulait pas que cela entache son héritage scientifique. Il racontait à tout le monde que Mileva était issue d’une souche abâtardie, et qu’elle seule était responsable de cette maladie mentale. Einstein ne voulait rien avoir à faire avec Eduard, il refusait de répondre à ses lettres.
Eduard a été traité à l’insuline et par des électrochocs; il a fait plusieurs tentatives de suicide. Quand sa mère est morte, [en 1948] l’argent qui subvenait à ses besoins s’est tari et on l’a mis dans une cellule pour indigents. Lorsque des visiteurs venaient le voir, il disait qu’il aimerait jouer du piano, mais qu’on lui objectait que cela dérangerait les autres malades. Il disait qu’il avait envie de sombrer dans un sommeil absolu, mais les médecins lui répondaient que ça n’était pas raisonnable.
Rana Dasgupta. Solo. Gallimard 2009
Rana Dasgupta a pris ses informations sur Einstein essentiellement dans Das Verschmahte Genie : Albert Einstein und die Schweiz, d’Alexis Schwarzenbach (Deutsche Verlags-Anstalt, 2005). Il y aura discussion assez rapidement après la mort d’Einstein sur la nature de la collaboration scientifique entre Albert et Mileva. Tout cela sans guère de preuves ; puis, dans les années 1980 sortiront des courriers entre Mileva et Albert de 1897 à 1903, c’est à dire incluant l’année que Mileva passa à Heidelberg en 1897 ; ces courriers abordent souvent des thèmes scientifiques ; mais, si les lettres d’Albert sont tout à fait lisibles, celles de Mileva le sont beaucoup plus difficilement. Donc, encore aujourd’hui, il en est pour dire qu’elle était aussi géniale que lui et qu’auraient dû figurer au bas des fameux textes de 1905 leurs deux signatures car tous deux étaient les parents de la théorie de la relativité, et que Mileva s’est vue imposer par son mari de ne pas avoir son nom au bas des documents ; et il en est d’autres pour dire que si Albert a beaucoup publié tout au long de sa vie, Mileva n’a plus rien publié au-delà de leur séparation, en 1914.

A l’initiative du capitaine Clerc, introduction des skis au 15° régiment d’infanterie alpine de Briançon. Paul Payot, médecin à Chamonix, se fait envoyer des skis, et monte au col de Balme en compagnie du guide Joseph Ducroz. Six hommes, dont un anglais, Eckenstein, atteignent l’altitude de 6 600 m sur les pentes du K2, 8611 m.
Abd al-Aziz III, qui va devenir Ibn Seoud, a 21 ans : à la tête de 40 hommes, il prend Riyad aux Turcs ; onze ans plus tard, en 1913, il les expulsera du Hasa, prendra en 1920 la moitié du territoire attribué à l’émir du Koweit.
Jourdain construit la Samaritaine, en fer et céramique.
Un siècle plus tard, la modernité dont avait fait preuve Jourdain sera retoquée par des juges frileux et imbéciles lorsqu’il s’agira de la rénover : Le feu couve, en France, dans l’univers du patrimoine. Une combustion lente et sans grands éclats, nourrie de colères et de recours juridiques, de part et d’autre d’une frontière difficile à cerner. La ligne qui sépare le patrimoine de la modernité ou même de la création contemporaine est devenue floue, le maquis juridique de plus en plus dense. Et les batailles de plus en plus acharnées, notamment à Paris, capitale vitrine sur laquelle veillent des associations de défense du patrimoine particulièrement sourcilleuses qui, pour huit d’entre elles, se sont regroupées au sein d’un nouveau G8.
Affaire emblématique s’il en est de cette bataille : le chantier de la Samaritaine. Le jugement du tribunal administratif de Paris, rendu le 13 mai [2014], a fait l’effet d’une bombe. Ce jour-là, le projet de restructuration du célèbre grand magasin du bord de Seine qui jouxte le Pont-Neuf, soutenu par le groupe LVMH et la Ville de Paris, a été retoqué. L’aménagement de ce vaste ensemble de 70 000 m², qui devait accueillir un hôtel de luxe, des commerces, des logements sociaux et même une crèche, n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges.
La décision a provoqué la satisfaction des pourfendeurs du projet, la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF) et l’association SOS Paris. Pour eux, le projet des architectes japonais de l’agence Sanaa Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa est inconciliable avec la supposée régularité de la rue de Rivoli. Indépendamment des qualités spatiales de l’ensemble, la façade de l’édifice, habillée de verre sérigraphié ondulé, ne serait pas en harmonie avec la continuité haussmannienne qui caractériserait ce quartier de Paris. Autant d’arguments que les juges ont repris à leur compte.
Le magasin lui-même, construit en plusieurs phases, n’est pourtant pas homogène. Sont concernés par le permis trois ensembles : le magasin 2, élément central, construit par Frantz Jourdain en 1910 et prolongé côté Seine par l’extension d’Henri Sauvage, achevée en 1928 ; le magasin 4, qui longe la rue de Rivoli, élément composite qui avait tant bien que mal conservé ses façades mais non les espaces intérieurs ; enfin, un ensemble d’immeubles plus anciens, composé de logements à l’angle de la rue de l’Arbre-Sec et de la rue de Rivoli. Ce dernier bloc doit être rénové en l’état.
Le jugement a, en revanche, consterné unanimement les architectes, comme en témoigne la réaction de Christian de Portzamparc, publiée dans Le Monde, le lendemain (Le Monde du 14 mai). Nous ne pouvons respecter le passé qu’en le rendant vivant et pour cela en l’adaptant ici et là à notre vie. C’est ce qu’ont fait toutes les époques, conclut le lauréat français du prix Pritzker. L’interdire aujourd’hui ferait de Paris un triste et sombre musée et ne démontrerait rien d’autre qu’une volonté forcenée d’entrer en décadence.
Plus surprenant, l’Académie d’architecture, ordinairement silencieuse, est sortie de sa réserve par la voix de son président, Thierry Van de Wyngaert : Une telle conception des règles d’urbanisme, qui autorise à fonder un jugement sur des critères esthétiques et subjectifs pour justifier de la pertinence d’un recours, est incompatible avec une vision contemporaine de la ville, et n’aurait pas permis à certains bâtiments les plus emblématiques de notre histoire de voir le jour.
Longtemps, l’architecture Art nouveau de Frantz Jourdain, qui a conçu l’élément central de l’édifice, a d’ailleurs été regardée d’un mauvais œil. C’est ce qui, après 1922, conduisit l’architecte, qui dirigeait les travaux depuis 1903, à faire appel à Henri Sauvage pour la suite des opérations – une extension face à la Seine, dans un style Art déco. Si l’on considère les critères évoqués par la SPPEF, et repris par le tribunal, il est fort probable que l’ensemble aujourd’hui vénéré n’aurait pas pu voir le jour. Il n’a d’ailleurs été classé que récemment, en 1990.
Le tribunal administratif de Paris dit appliquer la loi. Pourtant, dans l’affaire Samaritaine, il livre un jugement subjectif, riche en partis pris esthétiques à peine mis en retrait par des précautions oratoires, et déconnecté de la réalité visuelle de cette portion de la rue de Rivoli, assez hétéroclite.
Prenant au pied de la lettre le descriptif du maître d’œuvre, le jugement note : Le choix d’une façade ondulante exclusivement réalisée en verre compromet l’insertion de la construction nouvelle dans une artère représentative de l’urbanisme du XIX° siècle bordée d’immeubles de pierre où la notion classique de façade n’a pas été abolie, et ne contribue guère à mettre en valeur les édifices environnants (…) ; la juxtaposition de cette ample façade (…), quasiment dépourvue d’ouvertures, sans autre élément décoratif que les ondulations verticales du verre sérigraphié, et d’immeubles parisiens en pierre, variés mais traditionnels, apparaît dissonante. Que dire alors de l’Institut du monde arabe ou, plus près, des vastes baies du magasin C& A, 126, rue de Rivoli, dont la façade n’est pas précisément opaque ?
Puisque les travaux ont commencé dans les intervalles laissés par la justice, il en résulte une énorme dent creuse, à l’emplacement du magasin 4, appelée à durer en l’état. Même si l’appel interjeté par LVMH infirmait le jugement du 13 mai, le temps de la justice est souvent plus long que celui des travaux. Surtout, un projet architectural remarquable se trouve, de fait, congelé.
Derrière la remise en cause du projet de Sanaa, est-ce la destruction d’éléments haussmanniens d’importance mineure qui agite les opposants, ou le rejet viscéral de l’architecture contemporaine, si diaphane soit-elle ? Dans leur bouche, on voit souvent éclore, en guise d’argument esthétique, un vocabulaire qui utilise des termes comme furoncle, verrue, cloporte, abcès, scandale, trahison, etc. Il est vrai qu’en face la langue est aussi convenue : résolument moderne (ou contemporain), geste audacieux, et autres éloges d’un futurisme pourtant bien de notre temps.
Comment en est-on arrivé à des positions aussi crispées ? Le XIX° siècle avait été celui de l’invention des monuments historiques, partagés et révérés par une mémoire collective. Après 1887, année charnière par la loi de protection des monuments historiques, le XX° siècle élabore un cadre de plus en plus sophistiqué et contraignant, empilant des textes complexes : loi de 1930 sur les sites, loi sur les abords de 1943, loi Malraux de 1962 sur les secteurs sauvegardés, enfin loi de 1983, complétée en 1993, instituant les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Conséquence : cet arsenal de textes favorise une judiciarisation croissante.
De ce point de vue, le dernier épisode comparable à l’affaire Samaritaine est celui de la restauration, en 1997, du château de Falaise, dit château Guillaume-le-Conquérant, dans le Calvados, par l’architecte des monuments historiques Bruno Decaris. Celui-ci, certes, n’y était pas allé de main morte, avec ses adjonctions légères, presque immatérielles et aisément identifiables, selon lui, entrechoquant ruines médiévales et architecture contemporaine radicale. Attaqué par trois associations, Bruno Decaris fut condamné à une amende pour des raisons techniques (absence de certaines autorisations administratives). Mais il était clair que le fond du jugement relevait de critères esthétiques… rien moins qu’évidents.
Au cœur du débat : la définition même du patrimoine et ses mutations contemporaines. Naguère, l’ennemi était celui qui portait atteinte à des éléments clairement reconnus comme historiques par le plus grand nombre. Le patrimoine, c’était ce qui est vieux, beau, émouvant et usé par les ans. Or ce temps de l’évidence est bel et bien terminé. Que doit-on désormais appeler patrimoine, alors qu’on classe des éléments de plus en plus récents, encore peu ou pas porteurs d’enseignement, défendus par une minorité de professionnels éclairés ou qui se voient comme tels ?
Certains édifices du monde de l’après-guerre sont ainsi sacralisés, sans que cette vénération fasse l’objet d’un véritable consensus ni d’explications minimales. On peut citer les ensembles de Jean Dubuisson (La Caravelle, 1967, à Villeneuve-la-Garenne, Hauts-de-Seine), le siège de Sanofi, construit en 1968 par Bernard Zehrfuss à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), avec le concours de Jean Prouvé ; ou encore, à Paris, le campus de Jussieu, d’Edouard Albert (1958-1968), et la tour Croulebarbe, du même Albert (1960). Le campus de Jussieu a ainsi survécu aux menaces de démolition, quitte à engendrer des dépenses monstres. Mis en chantier pour désamiantage dès 1996, il est toujours en travaux, en 2014.
Autre cas de sacralisation discutable : l’ensemble de logements construits par Paul Chemetov à Courcouronnes (Essonne), promis à la démolition en 2013, est aujourd’hui défendu par son avocat au titre d’un droit d’auteur dont on a du mal à voir les limites dans le temps. La valeur patrimoniale autrefois attribuée aux édifices par les marques du temps cède désormais le pas à une valeur absolue, indépendante de l’Histoire, fondée sur une sorte d’estime esthétique et sur un droit moral, accordés à tel ou tel bâtiment. Telle est la grande rupture du XXI° siècle dans ce domaine. Voici donc, dans un même moule patrimonial, l’ancien et le nouveau. Un vaste fourre-tout qui comprend des édifices construits en série au XIX° siècle, comme les églises néogothiques, même si les passants innocents leur prêtent un âge canonique. On comprend que les associations de défense du patrimoine ne sachent plus où donner de la tête !
La Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France est présidée par Alexandre Gady, universitaire réputé, combatif, mais qui se défend des commentaires le classant parmi les pleureuses du patrimoine. Dans les cinq dernières années, il est monté au créneau pour défendre, dans la catégorie XX° siècle, la Halle Freyssinet (1929), dans le 13° arrondissement de Paris – aujourd’hui classée -, mais aussi le siège de Sanofi à Rueil et la Halle Esquillan à Fontainebleau (1941), deux bâtiments qui ont finalement été détruits. Il s’attaque aux menaces que ferait peser sur les serres d’Auteuil l’extension de Roland-Garros, prévue pour 2018, dont il dit par ailleurs estimer l’architecte, Marc Mimram.
Il ne décolère pas contre la destruction des églises néogothiques du XIX° siècle comme celle d’Abbeville, dans la Somme. C’est difficile d’accepter la mutation d’une église, mais il faut réfléchir à leur transformation en lieux commerciaux, en lieux de rencontres, en médiathèques, comme cela se fait à l’étranger, en Angleterre ou en Hollande par exemple. C’est la meilleure manière de les sauver… Revenant à La Samaritaine, il commente : L’État est fort avec les faibles et faible avec les forts. Regardez La Samaritaine et le comportement de la Ville ou de l’État face à Bernard Arnault, le PDG de LVMH. De fait, il est souvent reproché aux architectes des Bâtiments de France d’être difficiles à convaincre lorsqu’il s’agit d’accepter une petite entorse au patrimoine, alors qu’ils savent tolérer des dérogations majeures pour certains chantiers bien soutenus politiquement.
Alexandre Gady n’est pas du genre à faire dans la demi-mesure. Parmi ses griefs, il y a la question de l’environnement, qui constitue un paramètre de plus en plus important dans le débat sur le patrimoine et ajoute à la confusion sur le sujet. La bataille sur les éoliennes, par exemple, qui oppose les défenseurs du patrimoine, en lutte contre leur dissémination dans le paysage, aux écologistes, favorables à cette nouvelle source d’énergie. Aujourd’hui, on est en plein brouillard, affirme Alexandre Gady. En matière d’écologie et d’énergie, la politique de l’État, droite et gauche réunies, a dressé les défenseurs de l’environnement et du patrimoine les uns contre les autres. Pour le seul patrimoine, elle conduit à affaiblir les systèmes juridiques de sa préservation.
Tour à tour convaincant et injuste, le cas échéant excessif, l’universitaire se trouve parfois en contradiction avec d’autres associations, comme Paris Historique, dont un des porte-parole, Jean-François Cabestan, est un défenseur convaincu du projet de La Samaritaine. La France et ses décideurs ne sont toujours pas entrés dans le XX° siècle. Ils ne s’intéressent pas à l’architecture, affirme-t-il. Si Gady campe dans le rôle de l’expert ès réglementations, Cabestan, architecte lui-même, se pose plutôt en technicien, éventuellement iconoclaste. Sur Roland-Garros et les serres d’Auteuil, il juge absurdes les contre-projets, portés par la SPPEF et Vieilles Maisons françaises, proposant notamment de couvrir le périphérique. Mieux vaudrait démolir carrément les serres, qui ne sont pas d’une rareté exemplaire. Ou les démonter et les transporter ailleurs. Mais c’est une position impensable dans le monde du patrimoine, dont l’idée la plus partagée est de ne toucher à rien de l’architecture du passé. Il faut pourtant garder à l’esprit que les immeubles étaient construits pour durer cent ou deux cents ans au plus.
En passionné des techniques architecturales, Cabestan prend pour cible un autre type d’enjeu patrimonial, où la logique de transformation est à l’œuvre : le projet de rénovation de la poste du Louvre, vaste bâtiment parisien construit de 1880 à 1888 par Julien Guadet en lisière du quartier des Halles, d’une architecture très homogène. Le programme, conduit par Dominique Perrault, auteur de la Bibliothèque nationale de France, prévoit, outre le maintien revisité de la poste – les syndicats y ont encore plus qu’un pied -, un hôtel, des commerces, des bureaux et des logements. Les travaux consistent à retirer les ajouts et modifications intervenus depuis l’ouverture du centre, à ouvrir les façades en maintenant la double hauteur du premier niveau, à modifier la toiture (qui avait brûlé en 1975), enfin à créer des patios, en maintenant les structures métalliques existantes.
Une opération réversible, dans l’hypothèse où l’avenir voudrait restituer les vastes planchers d’origine. Mais c’est essentiellement là le casus belli, tant pour Jean-François Cabestan – quitte à se trouver en contradiction avec ses positions sur La Samaritaine – que pour SOS Paris, qui n’acceptent aucune transformation, quels que soient les inconvénients de l’état actuel. Ici, cependant, pas de procès, mais une demande, non acceptée par le ministère, de classement de l’édifice. De son côté, Dominique Perrault, aussi passionné par le bâtiment de La Poste, se trouve conforté par un cercle de compétence créé ad hoc, qui comprend l’historien Jacques Lucan, l’Américain Barry Bergdoll, directeur du département d’architecture du Museum of Modern Art de New York (MoMA), l’architecte des Bâtiments de France Jean-Marc Blanchecotte, l’architecte Philippe Prost, spécialiste des interventions sur le patrimoine. Dire que la poste du Louvre est en péril, cela a éberlué Barry Bergdoll, affirme Dominique Perrault. Il n’imaginait pas qu’il puisse y avoir une telle contestation.
Car il y a des situations où l’impératif patrimonial doit cohabiter avec une nécessaire modernisation. Mais quelle est la marge de manœuvre de l’architecte, restaurateur ou rénovateur, adaptateur ou inventeur ? Philippe Belaval, président du Centre des monuments nationaux, qui a sur les bras quelques travaux monumentaux, comme la restauration du Panthéon, insiste sur un autre aspect : Ce qui devrait primer, c’est l’entretien régulier du patrimoine, notamment des toitures. Attendre que les édifices soient en ruine est une politique désastreuse et terriblement coûteuse.
Alors, comment lire la période actuelle ? Parallèlement à la croissance démographique, le développement du domaine bâti est devenu de plus en plus considérable au cours du XX° siècle. Et donc considérable aussi la part des constructions théoriquement susceptibles d’entrer sur une des listes définissant le patrimoine de valeur. L’État se trouve confronté à des besoins financiers sans cesse croissants. Simultanément, on assiste à une dilution des critères (que faut-il protéger et jusqu’à quel point ?), alors que les textes, les structures de l’État et les représentants de la société civile semblent figés dans une forme d’archaïsme. L’interprétation des textes de loi et des obligations au niveau local (communes, départements) favorise par ailleurs la perte de repères communs et la dilution de l’intérêt public au profit d’intérêts privés ou politiques qui n’ont pas forcément pour les monuments les yeux que Rodrigue avait pour Chimène.
Faut-il se satisfaire des joutes esthétiques, dans une période inquiétée par de plus graves préoccupations environnementales ? À l’instar de Philippe Bélaval, tous nos interlocuteurs disent souhaiter, en France, une meilleure formation aux questions architecturales et patrimoniales – au moins pour les décideurs. Certains, y compris ceux qui sont engagés dans les procédures les plus agressives, regrettent la faiblesse numérique des associations et leur manque de fonds. Mais le fait d’être plus fortes les rendrait-il plus clairvoyantes ?
Peu d’entre eux, curieusement, s’interrogent sur l’hypothèse de nouvelles structures d’arbitrage ou de concertation. Mais ils sont aussi rares à avoir fait connaissance sur le terrain, comme Dominique Perrault, avec les mécanismes de discussion à l’œuvre hors de France. C’est le cas du Stadt Forum de Berlin (Forum de la ville), où se réunissent tous les acteurs de la cité. Ce sont des instances véritablement efficaces, dit Perrault, on peut vraiment y échanger les points de vue sur les projets, quitte à s’engueuler sévèrement. Mais on arrive toujours à un accord. S’il existe bien une Commission du vieux Paris, elle réunit des personnalités nommées par la Ville ou le maire. Sa compétence, généralement reconnue, comme son indépendance, n’en fait pourtant pas un lieu de discussion démocratique et ouvert, à l’instar des Stadt Forum allemands. Si bien qu’au lieu de s’imposer comme une assemblée de sages, ce qu’elle a pu être à ses heures, elle apparaît comme une instance de plus dans le capharnaüm des instances patrimoniales françaises.
Frédéric Edelmann. Le Monde du 31 mai 2014
Mais Bernard Arnault et la Mairie de Paris ne baisseront pas les bras facilement : ils auront recours au Conseil d’État, qui, le 19 juin 2015, cassera les décisions de la Cour d’Appel de Paris au motif qu’elle s’était fondée sur une interprétation inexacte du plan local d’urbanisme (PLU)… et ce faisant – avait – commis une erreur de droit. En décortiquant les dispositions du PLU (article UG11), le Conseil d’État rappelle que cet article permet à l’autorité administrative de délivrer des autorisations pour la construction de projets d’architecture contemporaine pouvant déroger aux registres dominants de l’architecture parisienne et pouvant retenir des matériaux ou des teintes innovants.
Donc le rideau de douche dénoncé par ses détracteurs se fera. Ce coup-ci, la raison a fini par avoir raison de l’obscurantisme.
16 01 1903
Joseph Ravanel, guide de Chamonix s’engage avec Joseph Couttet, Alfred Simon et le docteur Michel Payot dans la traversée à ski de Chamonix à Zermatt. Le docteur Payot porte un appareil de photo de 19 kilos ! Orsières, le premier jour par la fenêtre de Saleina, puis la cabane de Chanrion, pour deux jours car le mauvais temps les contraint à un demi-tour. Le lendemain, le soleil ne manque pas, mais les vivres si. On descend à Martigny pour se ravitailler. Remontée du Val d’Herens depuis Sion, nuit à Evolène et col d’Hérens par le glacier de Ferpècle. Puis longue descente sur Zermatt où ils arrivent le 22 janvier.
On peut se demander pourquoi Joseph Ravanel a choisi une date aussi précoce dans l’hiver : les chutes de neige sont abondantes en janvier, donc les jours de beau temps sont comptés ; la neige fraîche, poudreuse le plus souvent est fatigante à brasser. La meilleure période pour la randonnée est à partir du 15 mars : la neige est alors transformée – c’est à dire pratiquement tassée – dure le matin, molle l’après-midi, moins fatigante à la montée. Il se pourrait bien qu’il faille aller voir du côté des carres, alors inexistants – ils n’apparaîtront que vingt ans plus tard -: l’absence de carres se fait sentir surtout sur la neige dure, un peu à la montée, beaucoup à la descente, et l’on devait redouter les descentes sur neige dure, avec tous les risques d’une chute de ski en haute montagne ; en partant en janvier, ils étaient surs d’avoir une neige profonde, sur laquelle l’absence de carre prend beaucoup moins d’importance. C’était sans doute plus de fatigue, mais aussi plus de sécurité.


Photos Marc Kiffer
29 01 1903
Afin de soutenir l’industrie sucrière, contre la concurrence du sucre de canne, la taxe sur le sucre passe de 60 à 25 francs par quintal. Le privilège des bouilleurs de cru sera supprimé en mars : les viticulteurs ne pourront plus recycler leur alcool en excédent. En fait ce privilège n’était qu’une détaxation sur les 10 premiers litres d’alcool pur produits, soit 20 litres d’eau de vie à 50°, et n’importe quel propriétaire de vergers pourra toujours distiller : il suffit de payer à l’État 7 € dès le premier litre. Cela, c’est pour contenter les betteraviers. La consommation de sucre en France augmente de 50 % de 1903 à 1904, pour le principal du fait des négociants fraudeurs, installés quai de Bercy en bordure du réseau ferré PLM, qui mettent ainsi sur le marché un vin de fabrication industrielle : 3 millions d’hectolitres de vins de raisins secs de Grèce et de Turquie deviennent ainsi par la grâce de sucre, d’eau, d’acide tartrique, de tanin, etc… 12 à 15 millions de d’hectolitres de vin. Le sucrage est réglementé tant en première qu’en deuxième cuvée ; le sucre est autorisé à la vendange, à raison de 10 kilogrammes pour 3 hectolitres, et cela c’est pour contenter les viticulteurs. Les cours remontent, accordant un répit aux viticulteurs, mais aucune de ces mesures n’apaise les esprits.
12 02 1903
Les tentatives pour gagner Snow Hill Island n’ont pas réussi : l’Antarctic, pris et broyé lentement mais surement par les glaces dès janvier 1903, coule. L’équipage se réfugie sur l’île Paulet où ils vont passer l’hiver dans une hutte de pierre. Personne ne venant les chercher et constatant que l’eau libre gagnait tous les jours, les hommes mettront un canot à la mer pour tenter de rejoindre le rendez-vous de la baie Hope.
19 04 1903
Le délai accordé aux congrégations non autorisées expire : les incidents sont sérieux à Nantes, à Saint Nicolas du Port, en Meurthe et Moselle, à la Roche sur Foron, en Haute Savoie et dans l’Isère. À Paris, on se battra en mai : le préfet Lépine sera frappé à coups de bouteille.
21 04 1903
Pogrom contre les juifs, qui représentent 45 % de la population de Kichinev, capitale de la Moldavie, en Russie : 40 morts, 315 blessés. En 3 ans, 3 000 entreprises ont fermé… la crise est sévère et les Russes vont au plus facile : c’est le juif qui sera le bouc émissaire : le journaliste Kroutchevan se chargera de la besogne, distribuant sa prose aux cabaretiers qui seront contraints à le diffuser, sous peine de voir leur établissement saccagé : Le Parti des ouvriers, des chrétiens authentiques évoque notre Sauveur torturé à mort par les Juifs, les buveurs de sang avides qu’il aurait fallu depuis longtemps chasser de Russie, ennemis de notre Petit Père le tzar […] Qui sait quel peuple vil, rusé, menteur et avide d’argent ils forment.
*****
Partout dans les rues sont éparpillés des débris de meubles, de glaces, des samovars et des lampes tordues, des pièces de linge et de vêtements, des matelas et des édredons éventrés. Les rues sont comme enneigées, car elles sont couvertes de duvet, de même que les arbres.
Procès verbal de constat des déprédations
28 04 1903
Le cargo mixte Guadalquivir qui appareillait de Salonique pour Constantinople est victime d’un attentat à la dynamite :
De graves événements se sont produits à Salonique.
Ils sont l’œuvre du Comité révolutionnaire macédonien qui s’est donné pour mission de conquérir l’indépendance de la Macédoine.
Le principal chef de ce Comité, nommé Deltcheff maître d’école avait réuni le 13 avril dernier tous ses adhérents, et c’est à ce moment sans doute que l’insurrection fut décidée.
Le plan des insurgés est d’exaspérer par des attentats le gouvernement Turc et de l’amener à exercer des répressions sanglantes : et ils comptent que des répressions forceront l’Europe à intervenir et à prendre des mesures en faveur de la Macédoine.
Le premier acte des révolutionnaires a été l’attentat contre le steamer Guadalquivir de la Compagnie des Messageries maritimes à bord duquel une bombe de dynamite a éclaté.
Voici, d’après l’équipage du navire, le récit détaillé des faits :
L’explosion s’est produite exactement à onze heures vingt. Au moment où le navire quittait le port de Salonique. Les machines venaient de prendre la libre route. La bombe éclata au centre même du navire, dans la batterie des officiers, qui se trouvaient en ce moment à table, loin heureusement de leurs cabines.
Par la force de l’explosion, un tuyau de vapeur fut rompu, blessant cinq des chauffeurs, grâce à la présence d’esprit et au courage du mécanicien Le Galit, les malheureux purent être dégagés avant l’asphyxie complète.
Le navire prit feu avec une telle rapidité que les hommes de l’équipage et même les officiers n’hésitent pas à dire que des substances inflammables avaient été répandues sur le navire et dans les cales ; on voyait les flammes courir sur le pont.
Au milieu des cris des passagers, le commandant Combes, tout en ordonnant des mesures pour combattre l’incendie, fit mettre à l’eau les canots de sauvetage de l’arrière, les autres étant déjà devenus la proie des flammes ; les passagers, au nombre d’une vingtaine, s’y entassèrent.
Pendant ce temps, tous les efforts pour conjurer l’incendie restaient vains ; le feu faisait des progrès effrayants .
Le Commandant Combes quitta la passerelle, qui s’effondra aussitôt, sapée par les flammes. Des embarcations de toute sorte vinrent pour porter secours.
Le feu, à ce moment, dévorait le navire tout entier : officiers et équipage n’eurent que le temps d’embarquer sur les navires sauveteurs.
Le Commandant Combes, dont la conduite au dire de tous, fut digne des plus grands éloges, quitta le dernier le Guadalquivir.
Le Guadalquivir fut pris en remorque par le vapeur Pénélope qui le conduisit à l’entrée du port de Salonique, mais toute tentative d’extinction était dès lors inutile. Le fléau avait accompli son œuvre, le navire était entièrement perdu.
Par les soins du consul de France à Salonique, les hommes de l’équipage furent dirigés sur l’hôpital de la ville, pendant que les officiers et les passagers recevaient, dans les hôtels, les soins que nécessitait leur état.
L’auteur présumé de l’attentat, nommé Yorghi Minof, qui était vêtu avec une certaine élégance était venu à bord avec un billet de quatrième classe. Il avait mis une grande insistance à échanger son billet de quatrième Classe contre un billet de première, ce qui devait lui permettre de pénétrer dans le centre du navire et de la batterie des officiers, où il parvint à déposer sa bombe.
Il paraît certain que les dynamiteurs voulaient, par cette explosion à bord du Guadalquivir, amener toutes les autorités et de nombreuses forces de police sur les quais. Pendant ce temps, ils auraient continué leur œuvre de destruction dans la ville. Ce qui est établi, c’est que d’autres bombes éclatèrent en plusieurs points. La Banque ottomane, voisine de l’hôpital, était incendiée. Pendant toute la nuit, des détonations se succédèrent, des cris d’épouvante retentissaient de toutes parts. L’affolement règne encore à Salonique, où l’on craint de nouveaux attentats
Le Petit Parisien. Dimanche 3 mai 1903, n°747
[Dans l’entre deux guerres, le Petit Parisien, quotidien, aura le plus gros tirage du monde ! jusqu’à 2 millions d’exemplaires ! ]
29 04 1903
L’évacuation par les dragons et l’infanterie des bénédictins de la Grande Chartreuse, au bord du lac du Bourget, entraîne une émeute : le colonel de Coubertin démissionne. Ils partiront avec le secret de fabrication de la précieuse liqueur [mélange de 130 espèces de fleurs et de plantes, auxquels on ajoute du sucre et de l’alcool], leurs alambics, à Tarragone, reviendront en 1922… pour en repartir en 1992, déménageant à Ganagobie, au-dessus de la Durance, près de Manosque : l’affluence des touristes (environ 300 000 par an) n’était plus compatible avec la vie monastique… Mais le remède Ganagobie s’avéra être aussi nocif sinon pire que le mal : les touristes se mirent à leur gâter la vie, tout comme à Hautecombe. Le problème n’avait été que déplacé. D’autres Chartreux expulsés, réfugiés à Pignerole en Italie, avaient proposé deux millions de francs à Émile Combes pour qu’il les autorise à rester : ce dernier sera lavé de tout soupçon de corruption le 12 07 1904, mais les Chartreux, en cela fidèles à leurs habitudes, ne diront rien. De mars à juin, plus de 400 congrégations sont interdites.


Genève garde toute sa force d’attraction pour les Savoyards : La dangereuse promiscuité des populations de la zone (de la Haute Savoie) avec l’étranger est démontrée par de nombreux faits… Il y a à Genève 35 000 Français, 23 % de la population, dont le plus grand nombre appartiennent à la Haute Savoie : ils sont très attachés à la mère patrie ; mais il est fort à craindre qu’après avoir fêté l’Escalade (fête nationale genevoise) avec les Genevois pendant plusieurs années, ils ne s’imprègnent d’idées genevoises et que, joints aux zoniens naturalisés genevois, ils ne forment le trait d’union entre la Savoie du Nord et Genève, lorsque la Suisse jugera les circonstances propices à l’annexion qu’elle n’a pu réaliser en 1860.
Léon Duparc
1 05 1903
Édouard VII, roi d’Angleterre est en visite à Paris : son intelligence, sa civilité et son humour viendront à bout, presse bienveillante aidant, de l’anglophobie manifestée tout au long des Champs Élysées : Vive Fachoda ! Vive les Boers ! Vive Jeanne d’Arc ! Un officier de sa suite lui dit : Les Français ne nous aiment pas. Et le roi de lui répondre : Et pourquoi donc voudriez-vous qu’ils nous aiment ? Il a été couronné en 1902, filmé par Georges Méliès :
19 05 1903
Mary Mackenzie, 20 ans, est venue d’Ecosse il y a peu à Pékin pour y épouser Richard Collinsgsworth, attaché militaire à l’ambassade de Grande Bretagne. Longues lettres à sa mère pour lutter contre un ennui mortel quand soudain, coup de tonnerre ! une invitation lui parvient ainsi qu’à trois autres jeunes femmes européennes de l’impératrice Tseu Hsi pour venir prendre le thé au palais d’Été. Ah, quelle affaire, mon cher !
Très chère maman,
J’ai des nouvelles très excitantes à vous donner ou qui le sont en tout cas pour moi ! Richard qui s’était absenté de Pékin pour raison militaire était revenu depuis peu quand il est rentré un soir à la maison en m’annonçant que l’impératrice douairière Tseu Hsi (cela se prononce en mettant le bout de la langue presque tout contre les dents du haut) avait transmis aux légations son désir de rencontrer quelques-unes des épouses étrangères les plus jeunes. Cela fait déjà quelques temps à présent que Sa Majesté reçoit des femmes de diplomates européens pour le thé, afin d’effacer les mauvais souvenirs de la révolte des Boxers, mais il ne s’agissait jusqu’alors que de personnes de haut rang, comme les épouses des ambassadeurs ou des premiers secrétaires. Le nombre en était immuable, comme si quelques étrangères seulement pouvaient pénétrer sans risques au Palais d’Hiver au même moment. Une demi-douzaine de dames se rendait habituellement à cette invitation, ce qui n’allait pas sans causer quelque ressentiment parmi les autres, qui pouvaient avoir la désagréable impression qu’il s’agissait là d’un privilège réservé aux couches les plus hautes de la société. L’impératrice de toute la Chine – qui règne réellement sur le pays puisque l’empereur n’est rien du tout – est peut-être lassée de voir toujours les mêmes têtes à ses réceptions, car si elle ne mentionnait pas nommément, sa dernière invitation disait qu’elle avait entendu parler d’un mariage célébré récemment dans le quartier des légations et qu’elle aurait souhaité voir la mariée, ainsi que tout autre dame du même âge. Il y a une certaine pénurie de dames de mon âge ! Il y a bien à la légation d’Allemagne une épouse de vingt-six ans et une autre de vingt-sept à la légation d’Italie, mais c’est bien tout. Edith Harding, l’amie chez qui j’ai habité à mon arrivée, a donc fait partie de la légation, bien qu’elle ait trente-trois ou trente-quatre ans et deux fils en pension en Angleterre. Mon amie française Marie, qui est en fait assez jeune, s’est déjà débrouillée pour se faire inviter à l’un de ses thés, c’est pourquoi elle ne pouvait prétendre y aller cette fois-ci et l’on a finalement décidé de n’envoyer que nous quatre au Palais, au lieu des six habituelles.
Le grand jour est fixé à demain. L’audience n’aura pas lieu au palais d’Hiver, à l’intérieur des murailles de la cité, mais au palais d’Été qui est situé à quelque distance de là, et que l’impératrice elle-même a fait construire il y a une quinzaine d’années à très grand prix, en utilisant selon certaines rumeurs l’argent destiné à renflouer la flotte chinoise. On raconte que lorsque sir Robert Hart, le contrôleur britannique des douanes chinoises, a demandé à Sa Majesté quels nouveaux bateaux avaient été construits avec l’argent levé, l’impératrice avait pointé du doigt vers un bateau de marbre au bord d’un lac artificiel et lui avait demandé s’il ne trouvait pas que c’était là un beau bateau de guerre.
Cette dame Tseu-Hsi est certainement un souverain peu ordinaire. Ne la soupçonne-t-on pas entre autres d’user sans scrupules du poison pour consolider sa position quand elle le juge nécessaire ? La première épouse du précédent empereur, qui était corégente est morte subitement en laissant tout le pouvoir aux mains de Tseu-Hsi, qui garde, paraît-il, son propre fils virtuellement prisonnier. Elle était aussi à l’origine du projet des Boxers d’exterminer tous les étrangers en Chine, il n’y a pas l’ombre d’un doute là-dessus ! Je me souviens que lorsque nous avons étudié la Grande Catherine en histoire à l’école, j’avais cru que c’était la femme la plus impitoyable de tous les temps, mais je me demande si ce titre ne revient pas de droit à la dame avec qui je dois prendre le thé – du thé vert, probablement – demain. Aucune de nous deux n’aurait pu prévoir, même avec une imagination débordante, quand vous m’avez acheté cette robe bleue à Edimbourg, que je la mettrais pour une telle occasion !
Elle est sûrement trop habillée pour le thé, mais il semble que la coutume soit de mettre une tenue de soirée pour ces audiences, car Sa Majesté aime voir ses hôtes européens parés le plus richement possible ! Elle sera probablement assez désappointée à cet égard en ce qui me concerne…
Nous allons quitter le quartier des légations toutes les quatre à deux heures dans la voiture de l’ambassadeur. Nous serons escortés jusqu’à la porte Hatamen par les gardes de la légation, et au-delà par une troupe de la cavalerie impériale. Vous pouvez vous douter de mon état d’excitation ! C’est probablement la seule occasion que j’aurai dans la vie d’approcher des têtes couronnées de si près, à moins que Richard ne soit un jour anobli à Buckingham mais j’ai un pressentiment qu’il n’en sera rien.
Le 20 mai
J’étais si exténuée hier soir en rentrant que je n’ai même pas dîné, je n’en avais pas la force, et encore moins celle de vous écrire, maman, mais le souvenir est très vivace aujourd’hui et je vais essayer de vous raconter le plus exactement possible ce qui s’est passé.
Il y a d’abord eu un peu de flottement. La garde des légations jusqu’à la porte Hatamen n’était composée que de deux soldats qui se tenaient derrière nous comme des postillons, et qui croyaient apparemment que tout ce qu’ils disaient et le langage qu’ils employaient était inintelligibles pour les dames assises devant eux, ce qui n’était malheureusement pas le cas. Puis, quand nous avons atteint Hatamen et franchi la massive voûte de pierre, nous avons trouvé la garde impériale, que je me représentais avec des costumes somptueux et des bannières flottantes accrochées à leurs lances, mais ce n’était que deux hommes plutôt âgés sur des chevaux aux regards tristes. C’est souvent comme cela en Chine, on espère de grandes pompes et de belles manifestations pour n’en trouver aucune, et quand on s’y attend le moins, il y a un déploiement de magnificence qui semble disproportionné avec l’occasion. Par exemple pour les funérailles, il n’y a aucune dignité dans ces cérémonies, mais de grands étalages de vulgarité, comme si l’important était de bien montrer toute la richesse du défunt, à grand renfort de clinquant, de dorures et de douzaines de pleureurs que l’on a engagé pour hurler leur douleur moyennent finances.
Le trajet s’est effectué sur des routes terriblement cahoteuses, et nous avons bien failli toutes les quatre nous cogner la tête en étant projetées les unes contre les autres, ce qui aurait été un désastre pour nos chapeaux ! L’étiquette réclame en effet d’une façon bien curieuse, que nous portions nos chapeaux avec un robe du soir, et j’avais mis celui que vous aviez trouvé trop effronté dans la boutique et auriez préféré que je n’achète pas, mais s’il faut absolument porter un chapeau avec une robe du soir, il paraît sensé qu’il soit le plus petit possible.
Les autres dames n’avaient pas eu cette impression, car Madame Harding arborait toute une plate-bande sur son chapeau et les deux autres en face de nous étaient en grandes capelines à bord très lâches, qui se transforment en voilures incontrôlables dès que surgit une forte brise.
Après les premiers kilomètres, nous avons dû faire arrêter la voiture de l’ambassadeur pour en relever la capote, ce qui nous a valu d’étouffer pendant le restant du chemin et nous a empêchées d’apprécier le paysage, que l’on apercevait à peine à travers deux minuscules fenêtres à demi-obstruées.
Ne pas pouvoir jouir de la vue ne me dérangeait pas outre mesure, car d’après ce que j’ai pu en juger les alentours de Pékin sont plutôt mornes et tout ce qui pourrait ressembler à un arbre a été coupé ou dégarni pour le bois de chauffage en hiver.
Nous n’avions aucune consigne quant à l’étiquette qu’il convenait d’observer à la cour impériale en Chine, et tout ce que nous savions c’est qu’il fallait suivre les instructions du prince Tai, un chambellan de la cour, qui est allé deux fois en Europe sur mission de l’impératrice, avant la Révolte des Boxers, à laquelle il était fortement opposé, ce qui a failli lui coûter la tête. Heureusement pour l’impératrice qu’elle n’a pas signé le décret pour le faire décapiter, car il a été par la suite l’intermédiaire principal dans les négociations avec les Alliés après la prise de Pékin. Cette idée de convier les épouses à des thés pour améliorer les relations avec les étrangers serait apparemment la sienne.
Nous étions les premières à être invitées pour le thé au palais d’Été, les autres réceptions ayant eu lieu dans les appartements d’hiver de l’impératrice, à l’intérieur de la Cité, et j’ai eu le sentiment pendant le trajet que ceux qui avaient arrangé cette affaire avaient été quelques peu insouciants. Le chemin passait en effet par une zone infestée de bandits et de bandes de Boxers que l’on signale de temps à autre, et je n’avais pas vraiment l’impression que notre escorte âgée avec ses fusils en bandoulière serait d’une quelconque utilité en cas d’attaque. Je n’ai bien sûr pas fait état de mes préoccupations aux autres, mais je pense qu’Edith Harding devait avoir les mêmes soucis car elle se pressait de temps en temps sur les lèvres un mouchoir fortement parfumé à l’eau de Cologne.
Toujours est-il que nous sommes arrivées saines et sauves en passant en dessous de ce qui ressemblait à un arc de triomphe, une sorte d’arche qui n’était reliée à aucun mur, mais érigée isolément, avec un lac gorgé de lotus qui n’avaient pas encore fleuri. Ce que j’ai tout de suite remarqué en descendant de voiture, c’est la parfaite symétrie du paysage : au premier un bateau en marbre blanc, aux courbes douces, puis des marches de marbre menant à une autre porte aux tuiles du jaune impérial, et, le toit de la seconde porte se profilant au-delà de la première. Une pagode de cinq étages sur une large dalle de pierre surplombait le tout, d’une colline, flanquée de deux petits pavillons chacun sur son tertre et tout à fait identiques, qui ressemblait à deux kiosques fantastiques. Tout allait par paire de cette façon, les arbres de chaque côté de l’allée qui menait au bateau en marbre, des pins de taille et de forme parfaitement semblables. Le soleil brillait et tout était coloré, non pas à cause de massifs de fleurs mais des toits et des colonnes, en une sorte de gaîté sauvage à laquelle l’équilibre qui se dégageait de l’ensemble maintenait cependant une certaine dignité.
On a vraiment l’impression qu’un millier d’artistes a été réuni pour réaliser, au moyen d’une discipline très sévère, un miracle d’harmonie.
Quand on parle d’un palais, on pense aussitôt à un bâtiment, mais là, il s’agit d’une cité entière au bord d’un lac et à flanc de colline, qui comprend tout un ensemble de pagodes, de temples, de forêts qui vont parfaitement les unes avec les autres, si bien que rien ne vient heurter la vue.
Je n’ai pu m’empêcher de ressentir, malgré ma nervosité, une sorte de ravissement total devant tant de charme, en posant le pied sur ce pont brillant qui semblait d’albâtre.
Peut-être l’impératrice aurait-elle mieux fait avec cet argent-là de faire construire à Glasgow des navires pour sa flotte, mais, – et quel que soit l’opinion de Richard qui me désapprouverait forcément – je ne puis m’empêcher de me demander si elle n’a pas eu raison de dilapider de telles sommes pour tant de beauté. Des navires sont tôt ou tard hors d’usage et mis au rancart, mais un palais d’Été flottant sur sa colline va durer éternellement.
En vérité, maman, je voudrais être poète pour chanter cet endroit, car je reste sur cette impression en évoquant ce souvenir et je suis persuadée que ce sera toujours le cas dans quarante ans si je suis toujours en vie. La musique le décrirait peut-être mieux ? Haendel que vous aimez tant a une façon – vous en souvenez-vous – de prolonger le thème avec des phrases qu’il répète sans cesse et qui sont si bien reprises des précédentes que l’on sait pratiquement ce qui va suivre, ou que l’on croit savoir, ce qui fait que l’on ressent une sorte de satisfaction quand cela se produit, puisque l’on a à moitié reconnu le thème musical, même s’il reste une part de découverte qui vous transporte. Eh bien le palais d’Été donne la même impression. On n’est jamais tout à fait surpris, une fois que l’on en a bien compris la conception, car lorsqu’on tourne la tête, on est à la fois saisi par l’étonnement tout en étant quand même en terrain connu. Je m’exprime bien mal, mais j’ai tout à coup réalisé sur ce pont comment certaines personnes pouvaient être gagnées par une espèce de folie de la Chine qui leur rend par la suite intolérable le fait d’en être éloigné.
La pauvreté est effrayante, et la souffrance qu’il m’arrive de rencontrer, même dans cette existence si protégée qui est la mienne, est inimaginable. Richard dit que je ne dois pas penser à des choses pareilles, mais je ne peux pas m’en empêcher et la vue d’un mendiant aux membres rongés et couvert de haillons, qui marmonne sans que les passants indifférents n’accordent la moindre attention à sa rengaine, me transperce le cœur. La toux de mon tireur de pousse m’inquiète tout autant quand il m’attend quelque part et je me demande s’il mange jamais çà sa faim ou s’il a assez chaud l’hiver. Ce ne sont que deux exemples des misères qui m’entourent. Et pourtant, malgré cela il semble qu’il y ait des moments privilégiés, pas seulement lorsqu’il s’agit de quelques chose d’aussi extraordinaire que le palais d’Été, ou tout ce qui vous entoure paraît soudain parfait, comme un tableau dont chaque détail serait exquis, mais à la différence que ce tableau-là est vivant, animé et accompagné d’une sorte d’étrange musique. Vous allez penser que je suis en proie à une regrettable fantaisie et vous devez vous demander ce qui a bien pu arriver à votre fille, mais je n’en suis pas bien sur moi-même, si ce n’est que je suis peut-être tout bonnement en train d’aimer ce pays, même après si peu de temps. J’ai hâte d’être capable de pouvoir m’entretenir avec ses habitants et d’apprendre avec un professeur à parler leur langue, mais Richard dit que c’est tout à fait inutile pour moi et refuse d’en entendre parler. Je suis sûr que vous êtes agacée par ma lenteur à parler de l’impératrice, mais nous avons effectivement mis un certain temps pour parvenir jusqu’à elle depuis le pont d’albâtre.
Quatre dames se sont avancées, escortées par quatre Chinois en longues robes de soie, qui pouvaient être des fonctionnaires impériaux de bas rang ou encore des serviteurs haut-placés. Ils ne se parlaient pas entre eux et ne nous ont pas non plus adressé la parole, et j’ai eu l’impression qu’ils n’appréciaient guère la tâche qui leur avait été confiée.
Ils portaient tous une petite calotte noire sur la tête et deux d’entre eux seulement avaient une natte, symbole passé de la Chine ancienne, peut-être parce que la plupart des têtes tranchées pendant le Révolte des Boxers et exhibées avaient des nattes. Notre escorte nous menait plus qu’elle ne nous guidait, et j’ai remarqué que les autres dames en étaient un peu énervées. Pour ma part, j’étais bien loin de faire attention à mes nerfs, captivée par la scène que j’apercevais à chaque tournant : une autre vue sur un jardin avec un pavillon dans un angle, une porte en forme de lune ou encore une longue galerie aux colonnades peintes, avec de fines sculptures au haut des piliers, sans aucun ornement par contre sur le bas. Dans les cours et parfois dans les jardins se trouvaient d’énormes animaux en bronze, des lampes, et ce qui m’a semblé de gigantesques brûle-parfums.
Le prince Tai nous attendait sur une petite esplanade devant un bâtiment aux toits impressionnants, comme si toutes ces tuiles étaient sur le point de l’écraser sous leur poids. De toute l’enceinte du Palais, c’était la seule chose qui n’avait l’air ni gaie ni légère. Je pensais que le prince porterait une robe chinoise magnifique, mais il était en costume occidental, probablement en notre honneur. C’est un homme assez petit, avec des jambes très courtes, dont Richard n’aurait surement pas loué le tailleur. Il s’exprimait dans un anglais parfait, mais avec un débit très lent, ce qui est étrange pour un Chinois car on a toujours l’impression qu’ils jacassent dans leur langue à la vitesse d’un tramway électrique. Il nous a dit que Sa Majesté nous attendait et que nous devions le suivre, mais sans nous donner le moindre détail quant au protocole à observer sans doute parce qu’il n’y a pas d’instructions précises pour un cas aussi saugrenu que des dames étrangères sur le point d’approcher le trône sacré des Mandchous. Il a ouvert lui-même un des battants d’une immense porte laquée, au-delà de laquelle je supposais qu’il y avait une autre antichambre et que cela continuait ainsi, mais non, nous nous sommes retrouvées dans la salle d’audience proprement dite.
C’était une pièce tout en longueur. Je ne suis pas très forte en mesures, mais cela devait être à peu près aussi long que notre église à Morningside, avec des ailes sur le côté de la même façon, derrière des colonnes en bois laqué d’un rouge vif. La partie centrale du hall n’était pas meublée du tout, et se résumait à une grande étendue de parquet de bois ciré avec un dais élevé à l’extrémité que surmontait le trône du dragon, ou l’un d’eux. En l’occurrence, il s’agissait d’un fauteuil noir en ébène sculpté. La seule silhouette assise était entourée d’une quinzaine au moins de dames de cour vêtues de tuniques chatoyantes, qui se tenaient toutes debout, parfaitement immobiles. Le personnage sur le fauteuil, qui portait des vêtements plus sombres, ne bougeait pas plus.
À mesure que nous approchions, des lattes craquaient sous nos pas. On dit qu’elles sont destinées à prévenir de l’approche d’éventuels assassins, et le bruit en était certainement assez fort, le seul que l’on entendit jusqu’au moment où un bruit plus fort a résonné, venant d’un orchestre de flûtes, de violons et de claquettes en bois, à demi-caché dans une des ailes, sur le côté. Quatre fauteuils en rotin de Hong-Kong avaient été disposés, à deux mètres environ de l’estrade et en demi-cercle, chacun avec une petite table à côté, sur laquelle se trouvaient gâteaux et friandises. Les fauteuils me rappelaient la palmeraie à Peebles Hydro où nous avons passé nos vacances il y a trois ans. Les tables étaient également mises pour le thé et les mêmes fauteuils attendaient, avec de la musique qui s’échappait derrière un écran de verdure. Il y avait cette dame prussienne et aristocratique, la baronne von quelque chose, qui se comportait avec une hauteur toute princière, des sièges réservés pour son entourage et elle-même, et tout le monde lui faisait des courbettes à chaque fois qu’elle s’approchait de son trône. Voilà, bizarrement, ce qui me traversait l’esprit alors que j’allais approcher une impératrice, et contrairement à mon attente, je ne me suis pas trouvée toute tremblante d’émotion devant elle.
Edith Harding a dû remarquer un signal du prince Tai que je n’ai pas aperçu juste avant que nous n’atteignons ces fauteuils car elle a plongé dans une révérence très profonde aussitôt imitée par les deux autres, tandis que la mienne suivait avec un peu de retard. Personne n’a bougé sur l’estrade, comme si tout le monde faisait partie d’un tableau vivant et attendait que le rideau tombe pour reprendre une respiration normale, à la seule différence qu’il n’y avait pas de rideau. Au milieu de toute cette immobilité figée, le geste de Sa Majesté nous a fait sursauter, une main levée de ses genoux.
Ce n’était pas une main ordinaire, mais un éblouissement de griffes en or. J’avais entendu parler de ces étuis à ongle mais les voir pour la première fois m’a quand même donné un choc. Ils avaient au moins trente centimètres de long, sinon lus, sur les doigts principaux, et même si l’or en était aussi fin que possible, ces étuis protégeant des ongles qui n’ont jamais été coupés devaient être affreusement lourds. L’impératrice ne peut rien faire toute seule à cause d’eux. Elle doit être nourrie, habillée, servie en tout et en permanence par les dames de cour ; elle doit même se coucher sans ôter ses étuis à ongles. Je suis restée une minute ou deux à me poser des questions à leur propos, les yeux rivés sur ces mains qui reposaient à nouveau sur ses genoux, comme les nervures repliées d’un éventail. Chacune des bouchées qu’elle avale doit être mise dans sa bouche par quelqu’un, et l’impératrice qui règne sur le plus grand nombre de sujets sur terre après le roi Edouard est aussi dépendante qu’un infirme sans bras. Il ne faut donc sans doute pas s’étonner qu’elle se conduise de temps à autre comme une démente.
L’orchestre qui s’était mis à jouer si brusquement s’est arrêté tout aussi soudainement, et le prince Tai nous a ordonné de nous asseoir. Les quatre dames européennes se sont assises sur des fauteuils qui craquaient presque autant que venaient de le faire les lattes du plancher. Nous n’avions pas été averties qu’il ne convenait pas de dévisager l’impératrice Tseu-Hsi, je l’ai donc fait, et j’en ai retiré l’impression d’un corps très frêle engoncé dans des robes couvertes de broderies. Son visage était très blanc, vraisemblablement à cause du maquillage, et il se dégageait de cette pâleur extrême, où même les lèvres semblaient grises, quelque chose de surnaturel. Ses cheveux noirs, qui semblaient fins, étaient ramenés en un chignon sur la nuque, découvrant des oreilles plutôt grandes pour une tête aussi petite, avec des boucles qui m’ont paru en opale. Je n’ai jamais vu de dames chinoises portant des diamants, peut-être parce qu’on n’en trouve pas dans ce pays.
Il a été rapidement manifeste que l’une des choses que l’on ne sait pas faire à la cour impériale est de se conduire simplement et sans faire de cérémonies. Tout est réglementé dans le moindre détail dans leur vie, mais cette réception sortait tout à fait de leurs usages habituels et de ces règles protocolaires qu’on leur a serinées, et je suppose que s’ils restaient aussi compassés, c’était tout bonnement parce qu’ils étaient terrifiés à l’idée de faire quoi que ce soit.
De même, un petit manquement à l’étiquette ou une entorse dans le déroulement du programme, qui serait négligé ou ne donnerait lieu qu’à une faible réprimande dans notre famille royale, pourrait donner lieu en Chine à un bannissement de la cour et à la disgrâce complète pour la famille de la dame de cour concernée. Une tasse de thé empoisonnée pourrait bien surgir aussi, avec la réputation de Tseu-Hsi !
J’aurais pensé que la cérémonie se déroulerait dans tous les cas en commençant par un discours du prince Tai et vous pouvez imaginer ma surprise quand ont retenti au milieu du silence une série de couinements comme pourrait en faire une grosse souris. L’impératrice parlait sur le trône du dragon, mais si je voyais remuer ses lèvres grises, j’avais cependant presque l’impression que le son provenait de quelques part sur le côté. Son message était assez long et nous l’avons écouté sans en comprendre un traître mot puis, aussi abruptement qu’ils avaient commencé, les couinements ont cessé. Le prince Tai qui se tenait sur le côté pendant ce temps-là avec la contenance d’un ordonnateur de pompes funèbres, a fait un pas en avant et s’est mis à traduire. Il a dit que l’impératrice nous souhaitait la bienvenue de tout son cœur et qu’elle n’éprouvait que de bons sentiments envers nos pays et les gens qui en venaient pour vivre dans la capitale céleste. Le vœu impérial était que nous vivions éternellement en parfaite harmonie et en grande affection avec ses sujets et que les erreurs du passé soient effacées.
Sa Majesté impériale ayant fait placarder aux quatre coins de l’empire des édits signifiant au peuple qu’il devait désormais éprouver ces sentiments.
Il y en eut assez long sur ce ton, puis le prince a annoncé que le thé allait être servi, et qu’une discussion informelle suivrait. Le thé a consisté en ce que toute la cour nous regarde siroter avec des tasses trop grandes et sans anses. Il est sûr qu’avec ses étuis à ongles l’impératrice ne pourrait jamais prendre un quelconque rafraîchissement en public, ses dames de cour ne sont donc probablement pas autorisées non plus à le faire. J’étais vraiment désolé pour toutes ces dames qui étaient transformées en autant de statues vivantes dans ce groupe composé avec soin autour du fauteuil d’une vieille dame. Le prince Tai non plus n’a pas eu de thé, ni de siège.
La discussion informelle n’a pas très bien commencé, une des raisons étant que l’épouse allemande parle un tout petit peu anglais, et l’italienne pas du tout, et quand le prince Tai a essayé de leur parler en français, elles se sont inclinées toutes les deux sur leurs sièges comme si elles avaient affectivement compris, mais aucune des deux n’a prononcé le moindre mot. Edith Harding qui domine généralement très bien la situation, n’était pas très bavarde non plus et semblait avoir du mal à trouver d’autre sujet de conversation que le temps, ce qui n’avait rien de bien intéressant. Tout cela m’avait ôté tous mes moyens à peu près autant qu’Edith mais tout à coup mon ange gardien, si j’en ai un, est venu à mon secours avec un sujet qui devait intéresser quelqu’un qui y avait mis autant d’argent : le palais d’Été. J’avais été tellement impressionné que j’ai dû paraître très convaincante, et tandis que la traduction du prince Tai s’acheminait vers le trône du dragon, j’ai pu sentir très distinctement l’œil de Tseu-Hsi fixé sur moi, même si sa tête n’avait pas bougé.
Quand j’ai eu fini avec la beauté de sa résidence et que le prince Tai eut terminé sa traduction, la voix de souris a retenti à nouveau, mais cette fois-ci les mots crépitaient, des ordres manifestement. Il fallait que je monte sur l’estrade et m’approche de Sa Majesté impériale, ce que j’ai fait, assez peu à mon aise tout à coup, au moyen de trois marches sur le côté, et avec le prince Tai comme escorte. Sans que l’on m’en ait donné l’ordre, j’ai fait cette révérence très profonde qui demande en réalité un entraînement particulier que je n’ai pas eu, mais je ne sais pourquoi je n’avais pas envie de m’incliner, surtout de cette inclinaison qui aurait été ici de circonstance et qui vous fait courber pratiquement jusqu’au sol. Quand je me suis redressée je suis restée là où j’étais, à moins de deux mètres du trône et dans une position qui a forcé l’impératrice à tourner la tête pour me regarder, ce qu’elle a fait. Moi, j’ai regardé ses mains. L’un des étuis à ongles a bougé, comme si le propriétaire de cet éventail avait été sur le point de l‘ouvrir mais s’était subitement ravisé.
Le prince Tai a dit que Sa Majesté avait un cadeau pour moi, et un serviteur a apporté un écrin d’une quinzaine de centimètres de long recouvert de soie noire molletonnée. Le prince m’a dit de l’ouvrir, sans doute parce que Tseu-Hsi souhaitait voir ma réaction devant son cadeau, c’est pourquoi j’ai soulevé le couvercle. Sur un lit de soie également molletonnée, reposait une paire de boucles d’oreilles d’or et de jade. Le jade est apparemment de la meilleure qualité, en longs pendants, d’une forme très semblable à ces breloques que tante Elsie porte toujours pour aller avec ses robes à haut col baleiné, et qui auraient l’air plus laides encore sur moi. J’ai fait de mon mieux pour avoir l’air ravie et j’ai dit que ces boucles seraient un trésor dans ma famille pour toujours, et l’impératrice me fixait pendant que je disais tout cela.
Je pense qu’elle a de l’émail sur la figure qui tend ses rides et la laisse sans aucune expression, et que ses yeux paraissent terriblement vivants dans ce masque, des yeux qui n’ont rien de vieux mais qui sont pleins d’une sorte d’énergie terrible et d’arrière-pensées. C’est peut-être ridicule, mais j’ai eu l’impression qu’elle me regardait avec une telle avidité parce que je suis jeune et qu’elle se disait qu’elle pourrait faire tant de choses si elle avait ma jeunesse ; et qu’elle était fâchée parce qu’il n’y a aucun moyen, même pour une impératrice, qu’elle puisse me dérober à son propre usage les années que j’ai en face de moi. Je pense que je commence à comprendre pourquoi elle garde l’empereur prisonnier et en fait un pantin, c’est parce qu’il est jeune, lui aussi. Elle ne supporte pas l’idée d’un monde dont la mort l’aurait chassée.
[…] Votre fille affectionnée
Mary
Oswald Wynd. Une odeur de gingembre. Quai Voltaire 1977

Européennes reçues par l’impératrice Tseu-Hsi en 1903


Ancien palais d’été

Ancien palais d’été, édifié aux XVII° et XVIII° siècle par les empereurs mandchous Yongzheng et Quianlong, détruit en 1860 par les troupes britanniques et françaises lors de la seconde guerre de l’opium.

Nouveau palais d’été, construit par l’impératrice Tseu-Hsi à partir de 1886.

Le bateau de marbre

Nouveau palais d’été
24 05 1903
224 voitures de course s’élancent de Versailles pour Madrid : 3 jours avaient été prévus. Mais la première étape Versailles-Bordeaux vira rapidement au jeu de massacre, les pilotes se tuant par accident, tuant des spectateurs, ou des personnes passant par là sans identifier le risque, à tel point que le soir même le président de la République annulera purement et simplement la course : on avait décompté 11 morts pour cette seule journée ! Ces engins tapaient du 140 km/h !
Ils étaient des millions ceux accourus pour voir, agglutinés sur le bord des routes comme des mouches sur un sillage de sucre, goutte étirée qui s’écoule à travers les champs de France.
Le premier à s’arrêter fût Vanderbilt, un cylindre fendillé dans le cœur de sa Mors, au profil de torpille. On le vit se ranger le long d’un canal.
Le baron de Caters dépassa les trois hameaux de la Ronde, en saluant de la main, puis attaqua Jarault et Renault, sur les interminables lignes droites qui longeaient le fleuve. À un endroit où se trouvait une courbe cachée, il déporta trop largement sa Mercedes et termina dans un coup de frein contre un marronnier. Le bois avait des siècles d’âge, il déchira l’acier.
Une femme, à Ablis, depuis une demi-heure qu’elle entendait tout ce vacarme, sortit de chez elle pour aller voir. Elle ne posa même pas les œufs, deux œufs qu’elle avait à la main, pour faire sa cuisine. Au milieu de la route, elle attendit le prochain nuage de poussière, pour comprendre. Il arriva à une vitesse que la femme ne connaissait pas. La femme s’écarta avec une lenteur que le pilote avait oubliée. La main se referma sur les œufs. Le craquement des coquilles un dieu l’entendit, peut-être, au moment où la Panhard-Levassor de Maurice Farman balayait la vie de cette femme, l’envoyant rebondir à quelques mètres de là, où elle souffrit, puis mourut, d’une mort théoriquement hors de sa portée.
Les premières nouvelles parlaient de Marcel Renault, un accident, mais rien de plus. On pouvait penser à une avarie. Puis le sillage de la course fût remonté par l’image d’un Marcel Renault couché par terre, sur le bord de la route, et d’un curé penché sur lui, tandis qu’à toute vitesse les autres passaient, suivant l’ordre de la course, couvrant de poussière l’extrême-onction. Quelque chose l’avait projeté au loin, dirent-ils plus tard, et les quatre roues sans contrôle s’en étaient allées vers le ventre noir de la foule. Nul ne pouvait dire pour quoi ça n’avait pas été un massacre. Marcel Renault, lui, était resté avec quelque chose de cassé à l’intérieur. À dire vrai, il était mort.
Alessandro Baricco. Cette histoire-là. NRF Gallimard 2007

October 1907 – Coupe des Voiturettes, Rambouillet (photos Bibliothèque Nationale/Paris, collection Rol).
1 06 1903
Le Sillon de Marc Sangnier tient son premier congrès à Belfort : il marque le début du catholicisme social.
11 06 1903
Le roi de Serbie Alexandre I°, sa seconde épouse, la reine Draga, haïe de son peuple et le premier ministre sont assassinés par un terroriste sur les marches de leur palais de Belgrade. Dans la poche du premier ministre, on retrouvera une lettre non décachetée l’avertissant de l’attentat. Le pouvoir revient à l’ancienne dynastie des Karadjorgevitch, avec Pierre I°, ancien élève de Saint Cyr. Toute la bande des assassins va se retrouver aux premières loges du nouveau pouvoir, et ils n’en seront pas délogés avant longtemps. L’alliance franco russe de 1893 l’incite à renverser les siennes : il abandonne la protection de l’Autriche pour se mettre sous celle de la Russie, et de la France.
16 06 1903
Roald Amundsen, 30 ans, n’est pas encore assez connu pour avoir l’argent dont il a besoin, et c’est pour fuir un créancier qu’il appareille précipitamment sur son Gjøa, un bateau de pêche de 47 tonneaux, 22 mètres de long, qu’il a équipé d’un moteur pour partir à la conquête du très convoité passage du Nord-Ouest. Il a un équipage de 6 hommes. Son bateau est pris par les glaces le 3 octobre et il passe 2 hivers sur la côte sud de l’île du roi Guillaume, sort de l’archipel des îles arctiques canadiennes le 17 août 1905 ; quelques jours plus tard, il croise un baleinier venu de San Francisco : il sait ainsi que la voie est libre ; il passe le détroit de Behring le 31 août 1906, ayant dû hiverner une troisième fois avant la mer de Beaufort. Il parcourt 800 kilomètres à ski pour rejoindre la ville d’Eagle d’où il peut télégraphier la nouvelle. Il aura passé ces trois hivers à se familiariser avec les us sinon coutumes des Inuit. Libéré par la banquise en juillet 1906, le Gjøa parviendra le 31 août à Nome sur la côte pacifique de l’Alaska. Avec son très faible tirant d’eau, il pouvait naviguer fréquemment sur des hauts fonds : aussi son itinéraire ne peut-il être celui des bateaux de commerce.

26 06 1903
Refus d’autorisation législative à 81 écoles, collèges, tenus par des Congrégations religieuses : elles doivent fermer.
06 1903
Des rumeurs d’ambassade font état de cession par la Chine du Tibet à la Russie. Aussi Lord Curzon, vice-roi des Indes propose-t-il au gouvernement chinois la tenue de négociations à Khampa Dzong, petit village tibétain au nord de l’État indien du Sikkim, en vue d’établir des accords de non-agression et de commerce. Le lieutenant-colonel Francis Younghusband traverse le col de Nathu La avec cinq officiers et 500 soldats, pour les conduire jusqu’à Khampa Dzong. Les Chinois y sont disposés et ordonnent au 13° Dalaï-lama d’y assister. Cependant Thubten Gyatso refuse et ne fournit pas de moyen de transport à Youtai, le commissaire impérial, ou amban, à Lhassa, pour s’y rendre. Les responsables n’étant pas arrivés, la petite troupe est rappelée au bout de cinq mois.

La forteresse de Khampa Dzong, photographiée par John C. White
1 07 1903
Soixante cyclistes prennent le départ du premier Tour de France devant l’auberge Le Réveil matin, à Montgeron, au sud-est d’Orly : 19 jours plus tard, ils ne sont plus que 20 à l’arrivée et c’est Maurice Garin, né au Val d’Aoste et naturalisé français, qui l’emporte, après avoir fait 2 428 km, à plus de 25 km/h de moyenne. Sa bicyclette est de la marque Française Diamant : elle pèse 16 kg. Le climat politique, avec son nationalisme exacerbé, a poussé à la constitution d’équipes nationales. Ce nom avait été choisi par le journaliste Léo Lefèvre, employé par le journal sportif d’Henri Desgranges dans la foulée du Tour de France par deux enfants, de G. Bruno. Henri Desgranges a crée L’Auto Vélo en 1900 à l’initiative d’anciens annonceurs d’un autre journal, plus ancien : Le Vélo, fondé et dirigé par Pierre Giffard, créateur de la course Paris-Brest-Paris. Ce dernier s’était affiché ouvertement dreyfusard dans les colonnes de son journal, au fur et à mesure des rebondissements de l’affaire, ce qui avait profondément déplu aux annonceurs, dont le principal était Albert de Dion. Ce dernier fonda donc un journal concurrent, qui devint L’Auto en 1903, et L’Équipe en 1946. Le Vélo ne put résister au succès de L’Auto – passé de 30 000 à 95 000 exemplaires au soir de la première étape – et disparu en 1904.
Au geste large et puissant que Zola, dans La Terre, donne à son laboureur, l’Auto, journal d’actions et d’idées, va lancer à travers la France, aujourd’hui, les inconscients et rudes semeurs d’énergie que sont nos grands routiers professionnels. De Paris aux flots bleus de la Méditerranée, de Marseille à Bordeaux, en passant par toutes les villes roses et rêveuses qu’endort le soleil, à travers le calme des campagnes vendéennes, tout le long de la Loire qui coule lente et silencieuse, ces hommes vont s’enfuir éperdument (…)
Le trait épique du journaliste ne doit pas faire oublier ce qu’auront été pour ces coureurs les premières années du Tour de France : une épreuve d’une incroyable ingratitude et dureté : des départs au petit matin blafard, sans personne pour vous encourager, des étapes à n’en plus finir – jusqu’à 400 kilomètres – pour arriver dans les vingt heures dans des villes où personne ne vous attendait. Un règlement d’une rigidité toute militaire : un cadre cassé ? le coureur devra effectuer lui-même la soudure pour réparer ; le dérailleur ? pas question de l’autoriser [il ne le sera qu’en 1937 !] : au nom de quoi rendre les côtes plus faciles à grimper ?
En 1910, sur un Tour qui comptait 4 735 km avalés à la moyenne de 29.2 km/h, à l’issue de l’étape Bagnères de Luchon – Bayonne, après 17 heures de lacets dans le Tourmalet, Octave Lapize, dit Le Frisé, double vainqueur du Paris-Roubaix, lancera aux officiels : Assassins, vous êtes des assassins ! Ces officiels étaient du même tabac que les officiers qui enverront 15 ans plus tard les soldats à la mort, et c’est avec ces hommes durs à la peine que le pays pourra encaisser la guerre atroce qui se dessinait.
30 07 1903
Dans l’enceinte du lycée Lapérouse, dont il a été l’élève, Jean Jaurès,1859-1914, s’adresse aux lycéens d’Albi. Après avoir été convaincu de la culpabilité du capitaine Dreyfus, il en est devenu un ardent défenseur. Deux ans plus tôt, il a participé à la fondation du Parti Socialiste. Un an plus tard, il fondera le journal L’Humanité, qu’il dirigera jusqu’à sa mort.
C’est une grande joie pour moi de me retrouver en ce lycée d’Albi et d’y reprendre un instant la parole. Grande joie nuancée d’un peu de mélancolie ; car lorsqu’on revient à de longs intervalles, on mesure soudain ce que l’insensible fuite des jours a ôté de nous pour le donner au passé. Le temps nous avait dérobés à nous mêmes, parcelle à parcelle, et tout à coup c’est un gros bloc de notre vie que nous voyons loin de nous. La longue fourmilière des minutes emportant chacune un grain chemine silencieusement, et un beau soir le grenier est vide.
Mais qu’importe que le temps nous retire notre force peu à peu, s’il l’utilise obscurément pour des œuvres vastes en qui survit quelque chose de nous ? Il y a vingt deux ans, c’est moi qui prononçais ici le discours d’usage. Je me souviens (et peut-être quelqu’un de mes collègues d’alors s’en souvient-il aussi) que j’avais choisi comme thème : les Jugements humains. Je demandais à ceux qui m’écoutaient de juger les hommes avec bienveillance, c’est-à-dire avec, équité, d’être attentifs dans les consciences les plus médiocres et les existences les plus dénuées, aux traits de lumière, aux fugitives étincelles de beauté morale par où se révèle la vocation de grandeur de la nature humaine. Je les priais d’interpréter avec
indulgence le tâtonnant effort de l’humanité incertaine. Peut-être dans les années de lutte qui ont suivi, ai-je manqué plus d’une fois envers des adversaires à ces conseils de généreuse équité. Ce qui me rassure un peu, c’est que j’imagine qu’on a dû y manquer aussi parfois à mon égard, et cela rétablit l’équilibre. Ce qui reste vrai, à travers toutes nos misères, à travers toutes les injustices commises ou subies, c’est qu’il faut faire un large crédit à la nature humaine ; c’est qu’on se condamne soi-même à ne pas comprendre l’humanité, si on n’a pas le sens de sa grandeur et le pressentiment de ses destinées incomparables. Cette confiance n’est ni sotte, ni aveugle, ni frivole. Elle n’ignore pas les vices, les crimes, les erreurs, les préjugés, les égoïsmes de tout ordre, égoïsme des individus, égoïsme des castes, égoïsme des partis, égoïsme des classes, qui appesantissent la marche de l’homme, et absorbent souvent le cours du fleuve en un tourbillon trouble et sanglant. Elle sait que les forces bonnes, les forces de sagesse, de lumière, de justice, ne peuvent se passer du secours du temps, et que la nuit de la servitude et de l’ignorance n’est pas dissipée par une illumination soudaine et totale, mais atténuée seulement par une lente série d’aurores incertaines. Oui, les hommes qui ont confiance en l’homme savent cela. Ils sont résignés d’avance à ne voir qu’une réalisation incomplète de leur vaste idéal, qui lui-même sera dépassé ; ou plutôt ils se félicitent que toutes les possibilités humaines ne se manifestent point dans les limites étroites de leur vie. Ils sont pleins d’une sympathie déférente, et douloureuse pour ceux qui ayant été brutalisés par l’expérience immédiate ont conçu des pensées amères, pour ceux dont la vie a coïncidé avec des époques de servitude, d’abaissement et de réaction, et qui, sous le noir nuage immobile, ont pu croire que le jour ne se lèverait plus ; mais eux-mêmes se gardent bien d’inscrire définitivement au passif de l’humanité qui dure les mécomptes des générations qui passent. Et ils affirment avec une certitude qui ne fléchit pas, qu’il vaut la peine de penser et d’agir, que l’effort humain vers la clarté et le droit n’est jamais perdu. L’histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l’invincible espoir. Dans notre France moderne, qu’est-ce donc que la République ? C’est un grand acte de confiance. Instituer la République, c’est proclamer que des millions d’hommes sauront tracer eux-mêmes la règle commune de leur action ; qu’ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l’ordre ; qu’ils sauront se combattre sans se déchirer ; que leurs divisions n’iront pas jusqu’à une fureur chronique de guerre civile, et qu’ils ne chercheront jamais dans une dictature passagère une trêve funeste et un lâche repos. Instituer la République, c’est proclamer que les citoyens des grandes nations modernes, obligés de suffire par un travail constant aux nécessités de la vie privée et domestique, auront cependant assez de temps et de liberté d’esprit pour s’occuper de la chose commune. Et si cette République surgit dans un monde monarchique encore, c’est assurer qu’elle s’adaptera aux conditions compliquées de la vie internationale, sans entreprendre sur l’évolution plus lente des autres peuples, mais sans rien abandonner de sa fierté juste et, sans atténuer l’éclat de son principe. Oui, la République est un grand acte de confiance et un grand acte d’audace. L’invention en était si audacieuse, si paradoxale, que même les hommes hardis qui, il y a cent dix ans, ont révolutionné le monde, en écartèrent d’abord l’idée. Les constituants de 1789 et de 1791, même les législateurs de 1792 croyaient que la monarchie traditionnelle était l’enveloppe nécessaire de la société nouvelle. Ils ne renoncèrent à cet abri que sous les coups répétés de la trahison royale. Et quand enfin ils eurent déraciné la royauté, la République leur apparut moins comme un système prédestiné que comme le seul moyen de combler le vide laissé par la monarchie. Bientôt cependant, et après quelques heures d’étonnement et presque d’inquiétude, ils l’adoptèrent de toute leur pensée et de tout leur cœur. Ils résumèrent, ils confondirent en elle toute la Révolution. Et ils ne cherchèrent point à se donner le change. Ils ne cherchèrent point à se rassurer par l’exemple des républiques antiques ou des républiques helvétiques et italiennes. Ils virent bien qu’ils créaient une œuvre, nouvelle, audacieuse et sans précédent. Ce n’était point l’oligarchique liberté des républiques de la Grèce, morcelées, minuscules et appuyées sur le travail servile. Ce n’était point le privilège superbe de servir la république romaine, haute citadelle d’où une aristocratie conquérante dominait le monde, communiquant avec lui par une hiérarchie de droits incomplets et décroissants qui descendait jusqu’au néant du droit, par un escalier aux marches toujours plus dégradées et plus sombres, qui se perdait enfin dans l’abjection de l’esclavage, limite obscure de la vie touchant à la nuit souterraine. Ce n’était pas le patriciat marchand de Venise et de Gênes. Non c’était la République d’un grand peuple où il n’y avait que des citoyens et où tous les citoyens étaient égaux. C’était la République de la démocratie et du suffrage universel. C’était une nouveauté magnifique et émouvante. Les hommes de la Révolution en avaient conscience. Et lorsque dans la fête du 10 août 1793, ils célébrèrent cette Constitution, qui pour la première fois depuis l’origine de l’histoire organisait la souveraineté nationale et la souveraineté de tous, lorsque artisans et ouvriers, forgerons, menuisiers, travailleurs des champs défilèrent dans le cortège, mêlés aux magistrats du peuple et ayant pour enseignes leurs outils, le président de la Convention put dire que c’était un jour qui ne ressemblait à aucun autre jour, le plus beau depuis que le soleil était suspendu dans l’immensité de l’espace. Toutes les volontés se haussaient pour être à la mesure de cette nouveauté héroïque. C’est pour elle que ces hommes combattirent et moururent. C’est en son nom qu’ils refoulèrent les rois de l’Europe.
C’est en son nom qu’ils se décimèrent. Et ils concentrèrent en elle une vie si ardente et si terrible, ils produisirent par elle tant d’actes et tant de pensées, qu’on put croire que cette République toute neuve, sans modèle comme sans traditions, avait acquis en quelques années la force et la substance des siècles. Et pourtant que de vicissitudes et d’épreuves avant que cette République que les hommes de la Révolution avaient crue impérissable soit fondée enfin sur notre sol. Non seulement après quelques années d’orage elle est vaincue, mais il semble qu’elle s’efface à jamais et de l’histoire et de la mémoire même des hommes. Elle est bafouée, outragée ; plus que cela, elle est oubliée. Pendant un demi-siècle, sauf quelques cœurs profonds qui gardaient le souvenir et l’espérance , les hommes, la renient ou même l’ignorent. Les tenants de l’ancien régime ne parlent d’elle que pour en faire honte à la Révolution : Voilà où a conduit le délire révolutionnaire. Et parmi ceux qui font profession de défendre le monde moderne, de continuer la tradition de la Révolution, la plupart désavouent la République et la démocratie. On dirait qu’ils ne se souviennent même plus. Guizot s’écrie : Le suffrage universel n’aura jamais son jour. Comme s’il n’avait pas eu déjà ses grands jours d’histoire, comme si la Convention n’était pas sortie de lui. Thiers, quand il raconte la révolution du 10 août , néglige de dire qu’elle proclama le suffrage universel, comme si c’était là un accident sans importance et une bizarrerie d’un jour. République, suffrage universel, démocratie, ce fut, à en croire les sages, le songe fiévreux des hommes de la Révolution. Leur œuvre est restée, mais leur fièvre est éteinte et le monde moderne qu’ils ont fondé, s’il est tenu de continuer leur œuvre, n’est pas tenu de continuer leur délire. Et la brusque résurrection de la République, reparaissant en 1848 pour s’évanouir en 1851, semblait en effet la brève rechute dans un cauchemar bientôt dissipé.
Et voici maintenant que cette République qui dépassait de si haut l’expérience séculaire des hommes et le niveau commun de la pensée que quand elle tomba, ses ruines mêmes périrent et son souvenir s’effrita, voici que cette République de démocratie, de suffrage universel et d’universelle dignité humaine, qui n’avait pas eu de modèle et qui semblait destinée à n’avoir pas de lendemain, est devenu la loi durable de la nation, la forme définitive de la vie française, le type vers lequel évoluent lentement toutes les démocraties du monde. Or, et c’est là surtout ce que je signale à vos esprits, l’audace même de la tentative a contribué au succès. L’idée d’un grand peuple se gouvernant lui-même était si noble qu’aux heures de difficulté et de crise elle s’offrait à la conscience de la nation. Une première fois en 1793 le peuple de France avait gravi cette cime, et il y avait goûté un si haut orgueil, que toujours sous l’apparent oubli et l’apparente indifférence, le besoin subsistait de retrouver cette émotion extraordinaire. Ce qui faisait la force invincible de la République, c’est qu’elle n’apparaissait pas seulement de période en période, dans le désastre ou le désarroi des autres régimes, comme l’expédient nécessaire et la solution forcée. Elle était une consolation et une fierté. Elle seule avait assez de noblesse morale pour donner à la nation la force d’oublier les mécomptes et de dominer les désastres. C’est pourquoi elle devait avoir le dernier mot. Nombreux sont les glissements et nombreuses les chutes sur les escarpements qui mènent aux cimes ; mais les sommets ont une force attirante. La République a vaincu parce qu’elle est dans la direction des hauteurs, et que l’homme ne peut s’élever sans monter vers elle. La loi de la pesanteur n’agit pas souverainement sur les sociétés humaines ; et ce n’est pas dans les lieux bas qu’elles trouvent leur équilibre. Ceux qui, depuis un siècle, ont mis très haut leur idéal ont été justifiés par l’histoire. Et ceux-là aussi seront justifiés qui le placent plus haut encore. Car le prolétariat dans son ensemble commence à affirmer que ce n’est pas seulement dans les relations politiques des hommes, c’est aussi dans leurs relations économiques et sociales qu’il faut faire entrer la liberté vraie, l’égalité, la justice. Ce n’est pas seulement la cité, c’est l’atelier, c’est le travail, c’est la production, c’est la propriété qu’il veut organiser selon le type républicain. À un système qui divise et qui opprime, il entend substituer une vaste coopération sociale où tous les travailleurs de tout ordre, travailleurs de la main et travailleurs du cerveau, sous la direction de chefs librement élus par eux, administreront la production enfin organisée. Messieurs, je n’oublie pas que j’ai seul la parole et que ce privilège m’impose beaucoup de réserve. Je n’en abuserai point pour dresser dans cette fête une idée autour de laquelle se livrent et se livreront encore d’âpres combats. Mais comment m’était-il possible de parler devant cette jeunesse qui est l’avenir, sans laisser échapper ma pensée d’avenir Je vous aurais offensés par trop de prudence ; car quel que soit votre sentiment sur le fond des choses, vous êtes tous des esprits trop libres pour me faire grief d’avoir affirmé ici cette haute espérance socialiste, qui est la lumière de ma vie. Je veux seulement dire deux choses, parce qu’elles touchent non au fond du problème, mais à la méthode de l’esprit et à la conduite de la pensée. D’abord, envers une idée audacieuse qui doit ébranler tant d’intérêts et tant d’habitudes et qui prétend renouveler le fond même de la vie, vous avez le droit d’être exigeants. Vous avez le droit de lui demander de faire ses preuves, c’est-à-dire d’établir avec précision comment elle se rattache à toute l’évolution politique et sociale, et comment elle peut s’y insérer. Vous avez le droit de lui demander par quelle série de formes juridiques et économiques elle assurera le passage de l’ordre existant à l’ordre nouveau. Vous avez le droit d’exiger d’elle que les premières applications qui en peuvent être faites ajoutent à la vitalité économique et morale de la nation. Et il faut qu’elle prouve, en se montrant capable de défendre ce qu’il y a déjà de noble et de bon dans le patrimoine humain, qu’elle ne vient pas le gaspiller, mais l’agrandir. Elle aurait bien peu de foi en elle-même si elle n’acceptait pas ces conditions. En revanche, vous, vous lui devez de l’étudier d’un esprit libre, qui ne se laisse troubler par aucun intérêt de classe. Vous lui devez de ne pas lui opposer ces railleries frivoles, ces affolements aveugles ou prémédités et ce parti pris de négation ironique ou brutale que si souvent, depuis, un siècle même, les sages opposèrent à la République, maintenant acceptée de tous, au moins en sa forme. Et si vous êtes tentés de dire encore qu’il ne faut pas s’attarder à examiner ou à discuter des songes, regardez en un de vos faubourgs. Que de railleries, que de prophéties sinistres sur l’œuvre qui est là ! Que de lugubres pronostics opposés aux ouvriers qui prétendaient se diriger eux-mêmes, essayer dans une grande industrie la forme de la propriété collective et la vertu de la libre discipline. L’œuvre a duré pourtant ; elle a grandi : elle permet d’entrevoir ce que peut donner la coopération collectiviste. Humble bourgeon à coup sûr mais qui atteste le travail de la sève, la lente montée des idées nouvelles la puissance de transformation de la vie. Rien n’est plus menteur que le vieil adage pessimiste et réactionnaire de l’Ecclésiaste désabusé : II n’y a rien de nouveau sous le soleil. Le soleil lui, même a été jadis une nouveauté, et la terre fut une nouveauté, et l’homme fut une nouveauté. L’histoire humaine n’est qu’un effort incessant d’invention, et la perpétuelle évolution est une perpétuelle création. C’est donc d’un esprit libre aussi, que vous accueillerez cette autre grande nouveauté qui s’annonce par des symptôme multipliés : la paix durable entre les nations, la paix définitive. Il ne s’agit point de déshonorer la guerre dans le passé. Elle a été une partie de la grande action humaine, et l’homme l’a ennoblie par la pensée et le courage, par l’héroïsme exalté, par le magnanime mépris de la mort. Elle a été sans doute et longtemps, dans le chaos de l’humanité désordonnée et saturée d’instincts brutaux, le seul moyen de résoudre les conflits ; elle a été aussi la dure force qui, en mettant aux prises les tribus, les peuples, les races, a mêlé les éléments humains et préparé les groupements vastes. Mais un jour vient, et tout nous signifie qu’il est proche, où l’humanité est assez organisée, assez maîtresse d’elle-même pour pouvoir résoudre par la raison, la négociation et le droit les conflits de ses groupements et de ses forces. Et la guerre, détestable et grande tant qu’elle était nécessaire, est atroce et scélérate quand elle commence à paraître inutile. Je ne vous propose pas un rêve idyllique et vain. Trop longtemps les idées de paix et d’unité humaines n’ont été qu’une haute clarté illusoire qui éclairait ironiquement les tueries continuées.
Vous souvenez-vous de l’admirable tableau que nous a laissé Virgile de la chute de Troie ? C’est la nuit : la cité surprise est envahie par le fer et le feu, par le meurtre, l’incendie et le désespoir. Le palais de Priam est forcé et les portes abattues laissent apparaître la longue suite des appartements et des galeries. De chambre en chambre, les torches et les glaives poursuivent les vaincus ; enfants, femmes, vieillards se réfugient en vain auprès de l’autel domestique que le laurier sacré ne protège plus contre la mort et contre l’outrage, le sang coule à flots, et toutes les bouches crient de terreur, de douleur, d’insulte et de haine. Mais par dessus la demeure bouleversée et hurlante, les cours intérieures, les toits effondrés laissent apercevoir le grand ciel serein et paisible, et toute la clameur humaine de violence et d’agonie monte vers les étoiles d’or : Ferit aurea sidera clamor – le cri frappe les étoiles dorées -.
De même, depuis vingt siècles, et de période en période, toutes les fois qu’une étoile d’unité et de paix s’est levée sur les hommes, la terre déchirée et sombre a répondu par des clameurs de guerre. C’était d’abord l’astre impérieux de Rome conquérante qui croyait avoir absorbé tous les conflits dans le rayonnement universel de sa force. L’empire s’effondre sous le choc des barbares, et un effroyable tumulte répond à la prétention superbe de la paix romaine. Puis ce fut l’étoile chrétienne qui enveloppa la terre d’une lueur de tendresse et d’une promesse de paix. Mais atténuée et douce aux horizons galiléens, elle se leva dominatrice et âpre sur l’Europe féodale. La prétention de la papauté à apaiser le monde sous sa loi et au nom de l’unité catholique ne fit qu’ajouter aux troubles et aux conflits de l’humanité misérable. Les convulsions et les meurtres des nations du moyen âge, les chocs sanglants des nations modernes, furent la dérisoire réplique à la grande promesse de paix chrétienne. La Révolution à son tour lève un haut signal de paix universelle par l’universelle liberté. Et voilà que de la lutte même de la Révolution contre les forces du vieux monde, se développent des guerre formidables.
Quoi donc ? La paix nous fuira-t-elle toujours ? Et la clameur des hommes, toujours forcenés et toujours déçus, continuera-t-elle à monter vers les étoiles d’or, des capitales modernes incendiées par les obus, comme de l’antique palais de Priam incendié par les torches Non ! non ! et malgré les conseils de prudence que nous donnent ces grandioses déceptions, j’ose dire, avec des millions d’hommes, que maintenant la grande paix humaine est possible, et si nous le voulons, elle est prochaine. Des forces neuves travaillent : la démocratie, la science méthodique, l’universel prolétariat solidaire. La guerre devient plus difficile, parce qu’avec les gouvernements libres des démocraties modernes, elle devient à la fois le péril de tous par le service universel, le crime de tous par le suffrage universel. La guerre devient plus difficile parce que la science enveloppe tous les peuples dans un réseau multiplié, dans un tissu plus serré tous les jours de relations, d’échanges, de conventions ; et si le premier effet des découvertes qui abolissent les distances est parfois d’aggraver les froissements, elles créent à la longue une solidarité, une familiarité humaine qui font de la guerre un attentat monstrueux et une sorte de suicide collectif.
Enfin, le commun idéal qui exalte et unit les prolétaires de tous les pays les rend plus réfractaires tous les jours à l’ivresse guerrière, aux haines et aux rivalités de nations et de races. Oui, comme l’histoire a donné le dernier mot à la République si souvent bafouée et piétinée, elle donnera le
dernier mot à la paix, si souvent raillée par les hommes et les choses, si souvent piétinée par la fureur des événements et des passions. Je ne vous dis pas : c’est une certitude toute faite. Il n’y a pas de certitude toute faite en histoire. Je sais combien sont nombreux encore aux jointures des nations les points malades d’où peut naître soudain une passagère inflammation générale. Mais je sais aussi qu’il y a vers la paix des tendances si fortes, si profondes, si essentielles, qu’il dépend de vous, par une volonté consciente délibérée, infatigable, de systématiser ces tendances et de réaliser enfin le paradoxe de la grande paix humaine, comme vos pères ont réalisé le paradoxe de la grande liberté républicaine. Œuvre difficile, mais non plus œuvre impossible.
Apaisement des préjugés et des haines, alliances et fédérations toujours plus vastes, conventions internationales d’ordre économique et social, arbitrage international et désarmement simultané, union des hommes dans le travail et dans la lumière : ce sera, jeunes gens, le plus haut effort et la plus haute gloire de la génération qui se lève. Non, je ne vous propose pas un rêve décevant ; je ne vous propose pas non plus un rêve affaiblissant. Que nul de vous ne croie que dans la période encore difficile et incertaine qui précédera l’accord définitif des nations, nous voulons remettre au hasard de nos espérances la moindre parcelle de la sécurité, de la dignité, de la fierté de la France. Contre toute menace et toute humiliation, il faudrait la défendre ; elle est deux fois sacrée pour nous, parce qu’elle est la France, et parce qu’elle est humaine. Même l’accord des nations dans la paix définitive n’effacera pas les patries, qui garderont leur profonde originalité historique, leur fonction propre dans l’œuvre commune de l’humanité réconciliée. Et si nous ne voulons pas attendre, pour fermer le livre de la guerre, que la force ait redressé toutes les iniquités commises par la force, si nous ne concevons pas les réparations comme des revanches, nous savons bien que l’Europe, pénétrée enfin de la vertu de la démocratie et de l’esprit de paix, saura trouver les formules de conciliation qui libéreront tous les vaincus des servitudes et des douleur qui s’attachent à la conquête. Mais d’abord, mais avant tout, il faut rompre le cercle de fatalité, le cercle de fer, le cercle de haine où les revendications mêmes justes provoquent des représailles qui se flattent de l’être, où la guerre tourne après la guerre en un mouvement sans issue et sans fin où le droit et la violence, sous la même livrée sanglante, ne se discerneront presque plus l’un de l’autre, et où l’humanité déchirée pleure de la victoire de la justice presque autant que sa défaite. Surtout, qu’on ne nous accuse point d’abaisser, ou d’énerver les courages. L’humanité est maudite, si pour faire preuve de courage elle est condamnée à tuer éternellement. Le courage, aujourd’hui, ce n’est pas de maintenir sur le monde la nuée de la Guerre, nuée terrible, mais dormante dont on peut toujours se flatter qu’elle éclatera sur d’autres. Le courage, ce n’est pas de laisser aux mains de la force la solution des conflits que la raison peut résoudre ; car le courage est l’exaltation de l’homme, et ceci en est l’abdication. Le courage pour vous tous, courage de toutes les heures, c’est de supporter sans fléchir les épreuves de tout ordre, physiques et morales, que prodigue la vie. Le courage, c’est de ne pas livrer sa volonté au hasard des impressions et des forces ; c’est de garder dans les lassitudes inévitables l’habitude du travail et de l’action. Le courage dans le désordre infini de la vie qui nous sollicite de toutes parts, c’est de choisir un métier et de le bien faire, quel qu’il soit : c’est de ne pas se rebuter du détail minutieux ou monotone ; (…) Le courage, c’est d’être tout ensemble et quel que soit le métier, un praticien et un philosophe. Le courage, c’est de comprendre sa propre vie, de la préciser, de l’approfondir, de l’établir et de la coordonner cependant à la vie générale. (…) Le courage, c’est de dominer ses propres fautes, d’en souffrir, mais de n’en pas être accablé et de continuer son chemin. Le courage, c’est d’aimer la vie et de regarder la mort d’un regard tranquille ; c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel ; c’est d’agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l’univers profond, ni s’il lui réserve une récompense. Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire ; c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques.
Ah ! vraiment, comme notre conception de la vie est pauvre, comme notre science de vivre est courte, si nous croyons que, la guerre abolie, les occasions manqueront aux hommes d’exercer et d’éprouver leur courage, et qu’il faut prolonger les roulements de tambours qui dans les lycées du premier Empire faisaient sauter les cœurs ! Ils sonnaient alors un son héroïque ; dans notre vingtième siècle, ils sonneraient creux. Et vous, jeunes gens, vous voulez que votre vie soit vivante, sincère et pleine. C’est pourquoi je vous ai dit, comme à des hommes, quelques-unes des choses que je portais en moi.
Jean Jaurès, Discours à la Jeunesse, Albi, 1903
07 1903
Paul Claudel, tombé fou amoureux de Rosalie Vetch rencontrée en 1901 sur le paquebot Ernest Simons qui l’emmenait de Marseille à Saïgon est consul de France à Fuzhou, capitale de la province de Fujian, une région côtière située en face de Taïwan. Francis Vetch, son mari consentant essaie de faire des affaires loin de là. Sa conversion a déjà perdu un peu de sa fraîcheur, et le cher homme est encore puceau : il a donc un sacré retard à rattraper. Philippe Berthelot, secrétaire d’ambassade lui rend visite avec sa compagne Hélène… et en route pour les parties fines ; de l’illumination christique de Notre Dame de Paris quinze ans plus tôt aux bacchanales de la Rome antique : quel rétropédalage !
Ce pétulant quatuor ne s’ennuya guère : ne poussa-t-on point la plaisanterie, lors d’un repas très symboliste, jusqu’à présenter en guise d’entrée, sur un plateau d’argent porté par d’obligeants serviteurs la blonde Hélène, en sa gracieuse nudité parée de fleurs.
Gérald Antoine, biographe de Claudel
J’avais alors 32 ans, l’âge vraiment critique et les deux premiers actes du Partage de Midi, ne sont qu’une relation exacte de l’aventure horrible où je faillis laisser mon âme et ma vie, après dix ans de vie chrétienne et de chasteté absolue.
Paul Claudel. Lettre à Louis Massignon
10 08 1903
Accident de métro à la station Couronne : 84 morts par asphyxie.
3 09 1903
Victor Segalen, médecin de la marine a été affecté sur La Durance, qui pour l’heure a son port d’attache à Tahiti. Lors d’une mission à Atuona, sur l’île Hiva Oa, aux îles Marquises qui devait ramener à Tahiti les bagages de Paul Gauguin décédé trois mois plus tôt et inhumé au cimetière du Calvaire, il achète aux enchères des bois sculptés, la palette du peintre et ses derniers croquis qui, sinon, auraient été jetés. C’est ainsi qu’il pourra rapporter en France le Village breton sous la neige. Je n’aurais pas pu comprendre cette terre sans être confronté aux croquis de Gauguin. Il le confie au peintre George Daniel de Monfreid, ami de Gauguin, pour terminer les angles laissés inachevés.
11 et 14 09 1903
Encore un pogrom en Biélorussie, à Gomel ; mais cette fois-ci, les juifs ont décidé de se défendre… jusqu’à faire assassiner 8 mois plus tard le ministre Plehvé qui avait commandité l’affaire.
08 10 1903
En Argentine, on avait commencé dès avril à se préoccuper du sort de l’expédition suédoise et de l’Antarctic et on avait décidé d’envoyer à leur recherche la corvette A.R.A Uruguay, commandant Julian Irizar, qu’il fallut entièrement transformer pour affronter les conditions exceptionnelles de l’Antarctique. L’équipage se composait de 8 officiers et 19 marins, tous choisis avec soin. L’Uruguay quittera Ushuaia dans les premiers jours de novembre, croisera au large de l’île Paulet sans savoir que quelques naufragés de l‘Antarctic y étaient encore.
12 10 1903
Nordenskjöld et ses compagnons, partis cinq jours plus tôt rencontrent Andersson, Duse et Grunden qui sont partis eux depuis le 29 septembre. Le bonheur des retrouvailles est de courte durée, car très vite, chacun se demande : qu’en est-il de l’Antarctic ?
1 11 1903
À Nantes on inaugure un pont transbordeur sur le bras de la Madeleine, à hauteur de l’actuel pont Anne de Bretagne . On le doit à Ferdinand Arnodin, qui a déjà à son actif le Pont de Biscaye à Bilbao en 1893 et celui de Rouen en 1898. Il restera en activité jusqu’au 1° janvier 1955 et sera démonté en 1958.

4 11 1903
Sous le parrainage des États-Unis, proclamation de l’indépendance du Panama. C’est la conséquence de la fin d’une guerre de trois ans en Colombie entre libéraux et conservateurs – guerra de los Mil Dias -, le Panama n’ayant été jusqu’alors qu’une province colombienne. Parrainage…, car les États-Unis se sont réservés la concession à perpétuité d’une zone de 16 km de large de part et d’autre du futur canal, dont les travaux vont reprendre en 1905, moyennant le versement de 25 millions $ à la Colombie – ce qui sera fait en 1921 -.
8 11 1903
L’Uruguay touche Snow Hill, retrouvant Nordenskjöld, ses compagnons, – il y avait plus d’un an qu’ils attendaient l’Antarctic -, le trio Andersson, Duse et Grunden, et le même jour arrivent certains rescapés de l’Antarctic… rescapés, car d’autres sont restés sur l’île Paulet, qui embarqueront au retour ; mais l’épreuve a été trop dure pour quelques uns qui y ont laissé la vie. L’Argentine va faire un triomphe aux membres de l’Uruguay et aux rescapés de l’expédition, laquelle permit de rapporter de précieux spécimens géologiques et de la faune marine, aura exploré la côte est de la terre de Graham, dont le cap Longing, l’île James Ross, les archipels Joinville et Palmer. Nordenskjöld connaîtra la gloire mais aussi d’innombrables dettes.
11 1903
L’empereur d’Allemagne Guillaume II rencontre le tzar Nicolas II à Wiesbaden : il s’agit pour l’Allemagne d’essayer de rompre l’alliance entre la France et la Russie qui l’enserre telle une tenaille :
Le rencontre entre le Kaiser et le tsar en 1903 est abondamment reproduite dans la presse internationale , pour inquiéter la France, alliée de la Russie. Cette alliance, l’empereur Guillaume voudrait bien la rompre, car elle lui semble dangereuse : Guillaume, ayant cassé le système de Bismarck, se retrouve avec deux puissances considérables, aux deux extrémités de son Empire, qui le prennent à revers et qui, en cas de conflit pourraient s’unir contre lui. Donc, guillaume diffuse largement les informations sur la rencontre de Wiesbaden avec le tsar. Il insiste sur ses bonnes relations avec son cher cousin Nicky dont, par ailleurs, il se gausse à Berlin en se moquant de son côté provincial. Il dira de lui, plus tard, qu’il était juste un brave petit hobereau à peine capable de cultiver un champ de navets, ce qui en dit long sur la sincérité de son affection pour son cher cousin.
Or les Français sont aux abois, parce qu’ils n’ont personne d’autre que les Russes à qui faire partager l’inquiétude que leur inspire l’Allemagne. Il faut se reporter à ce qu’était l’opinion française au début du siècle. La France a perdu deux provinces dans la guerre de 1870 avec l’Allemagne. Elle vit dans un régime républicain méprisé par les monarchies d’Europe et subit la puissance allemande comme une fatalité détestée. Les Français ont beau éviter tout risque de confrontation avec les Allemands, ils ressentent une crainte révérencielle à leur égard. L’alliance avec la Russie est la première lueur qui leur permettre de sortir d’un isolement, dû à leur infériorité démographique, économique, militaire. Les autres alliances leur sont interdites, et notamment, celle de l’Angleterre avec laquelle ils sont constamment en rivalité sur le plan colonial. 1900, c’est la période de Fachoda au Soudan où les Français reculent car les Anglais sont plus puissants. Or, à cause de cette entrevue entre le kaiser et le tsar, l’alliance entre la France et la Russie entre dans une période de malentendus avec une pointe d’acrimonie réciproque ; les Français s’en émeuvent alors que ce sont les Russes qui y perdent le plus, puisqu’ils se laissent encore plus facilement emporter par le rêve extrême-oriental qui tournera au cauchemar. Et les Français ne peuvent les aider à éviter ce dérapage et toutes ses conséquences terribles, car la folie de l’entreprise les dépasse.
De leur côté, les Russes n’ont plus pleinement confiance dans les Français. Ils savent qu’une partie de la gauche républicaine ameute l’opinion française contre le régime tsariste. Les députés et les ministres de gauche peuvent aller à Saint Pétersbourg pour rencontrer leurs homologues russes, les officiers mener des manœuvres communes, il n’en reste pas moins que les électeurs radicaux-socialistes de base ne sont pas enthousiasmés par une alliance avec l’autocratie russe même s’ils reconnaissent que le pragmatisme l’impose. Cependant, ce qui marche tout à fait, ce sont les emprunts russes. Les bourgeois et les rentiers versent massivement leurs économies aux banques qui émettent des emprunts, lesquels permettent à la Russie de s’équiper. L’achèvement du transsibérien et des lignes qui desservent la frontière allemande, bien utiles pour d’éventuels transports militaires, les travaux d’infrastructure, la progression de l’influence russe en Asie centrale, les armements, tous passe par ces fameux emprunts dont la République vient seulement d’obtenir le remboursement dans des conditions inespérées pour les héritiers des porteurs, qui reviennent de loin mais réclament encore… Mais là aussi, à cause des considérables sommes investies, courent toutes sortes de rumeurs et de critiques. Il est vrai que le gouvernement russe corrompt certains hommes politiques français et la presse de droite pour donner l’impression que la Russie vit une période d’euphorie politique et de stabilité. Les socialistes, la presse de gauche, dénoncent ces pratiques, à coup d’articles et de caricatures cruelles, et ce brouhaha revient aux oreilles des Russes qui poussent à leur tour des cris indignés en se drapant dans la défroque de la vertu outragée. En fait, on se trouve dans un cas de figure très actuel : celui des puissances occidentales prêtant de l’argent et entretenant de bonnes relations avec des gouvernements qui ne respectent pas un ensemble de droits élémentaires, au nom de raisons économiques et politiques supérieures. Ainsi tous les défauts du régime impérial sont mis sur la place publique en France et prennent beaucoup d’importance à cause de l’opacité de la politique russe et de l’utilisation ambivalente des informations par la presse et les politiques en France. En somme Nicolas II est l’objet de polémiques nombreuses parmi l’opinion, dans le pays même où l’on sollicite son alliance.
Frédéric Mitterrand. Les aigles foudroyés. La fin des Romanov, des Habsbourg et des Hohenzollern. Robert Laffont 1997
Franklin Cowdery, alias Samuel Franklin Cody, américain de Davenport, dans l’Iowa, s’est entiché de cerfs volants qu’il met en scène dans des spectacles. Il en adapte un à un canot de sauvetage et traverse ainsi la Manche. En 2012, Yves Parlier reprendra l’idée pour tenter de l’adapter aux gros navires et leur permettre ainsi d’économiser du carburant.
10 12 1903
Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie obtiennent le Nobel de physique. De la notoriété, Pierre et Marie Curie passent à la gloire : c’est une femme qui a découvert ce produit miraculeux : le radium, à même de guérir le cancer, et dans un hangar qui tient plus de l’écurie que du laboratoire ! Tous deux auront bien du mal à s’en accommoder, Pierre plus que Marie. Pierre et Marie ne sont pas présents à la cérémonie de remise des prix : Marie est malade puis enceinte d’Ève : ils n’iront à Stockholm qu’en juin 1905. Une querelle se révéla à cette occasion : quel classement donner aux nouveaux radioéléments : est-ce de la physique ou bien de la chimie ? Les Suédois voulaient ménager leur grand chimiste Svante Arrhénius, aussi le comité de chimie céda Henri Becquerel et les Curie au comité de physique, à la condition en plus qu’il ne soit pas fait mention dans l’attribution du prix de la découverte du polonium et du radium. Ma foi, la combinazione peut bien prendre le goût du large et se faire septentrionale !
Les quatre savants français pressentis pour proposer des candidats de leur pays s’étaient prononcés pour Henri Becquerel et Pierre Curie seulement. Ce dernier, connaissant le poids d’Henri Poincaré sur les autres savants français, lui avait écrit pour le prier de faire ajouter le nom de sa femme parmi les nominés : J’ai appris qu’il était question de nous proposer M. Becquerel et moi pour le prix Nobel pour l’ensemble des recherches sur la radioactivité. […] Ce serait pour moi un très grand honneur, toutefois je désirerai beaucoup partager cet honneur avec Madame Curie et que nous soyons considérés comme solidaires, de même que nous l’avons été dans nos travaux. Madame Curie a étudié les propriétés actives des sels d’uranium et de thorium et des minéraux radioactifs. […] Il me semble que si nous n’étions pas considérés comme solidaires dans le cas actuel, ce serait déclarer en quelques sorte qu’elle a seulement rempli le rôle de préparateur, ce qui serait inexact. Veuillez, je vous prie, m’excuser pour l’incorrection de cette lettre, car je n’ai aucunement le droit d’émettre un avis et je devrais même ignorer de quoi il est question.
La démarche sera couronnée de succès, et Marie associée aux travaux de Pierre. Si Albert Einstein avait eu vis à vis de sa femme Mileva l’honnêteté et l’élégance que Pierre Curie a eu pour Marie, le monde s’en serait trouvé mieux.
Le bouleversement de notre isolement volontaire fût pour nous une cause de réelles souffrances et eût tous les effets d’un désastre.
Marie Curie
Si on veut être gentil, on en sourit, sinon, on ricane : dès 1908, on utilisera le radium pour soigner de nombreuses affections, notamment les affections cutanées. Tout au long des années vingt, les médecins rédigeront à la chaîne des ordonnances de radium pour l’arthrite, la goutte, l’hypertension, la sciatique, le lumbago et le diabète. Sa renommée était telle que les marques d’eaux minérales en faisaient un argument commercial : tapez donc sur votre moteur de recherche : eaux minérales radioactives et vous serez étonnés du nombre de marques qui se valorisaient en mentionnant la présence de radioactivité sur leur étiquette !
12 12 1903
Les troupes anglaises du vice-roi des Indes sous les ordres du Brigadier-General James R. L. Macdonald et du Major Francis Younghusband se livrent à un massacre, fauchant à la mitrailleuse Maxim des soldats tibétains en fuite à Chumik Shenko. Il y aura près de 700 victimes. Les Anglais soigneront 148 blessés tibétains. Ils prendront la forteresse de Gyantsé le 6 juillet 1904 et entreront à Lhassa le 3 août. Thubten Gyatso, le 13° Dalaï-lama, avait quitté une retraite de trois ans, le 30 juillet 1904, nommant Lobsang Gyaltsen régent du Tibet et lui donnant son sceau avant de fuir, déguisé sous la robe cramoisie d’un simple moine. Il gagnera tout d’abord un monastère à 20 lieues de Lhassa puis le monastère de Gandan à Ourga, [Oulan Bator] en Mongolie Extérieure, où il espèrera obtenir l’appui du Tsar mais celui-ci, en guerre contre le Japon, ne pourra intervenir au Tibet.

Dzong de Gyantsé
17 12 1903
Sur la plage de Kitty Hawk, en Caroline du Nord, Wilbur et Orville Wright volent pendant douze secondes sur 36.5 m. avec Flyer 1, biplan à moteur à essence Wright-Taylor de 63 kg. Ils recommencent quatre fois et finissent par un vol de 284 mètres en 59 secondes. C’est le premier vol d’un engin plus lourd que l’air, motorisé et piloté.
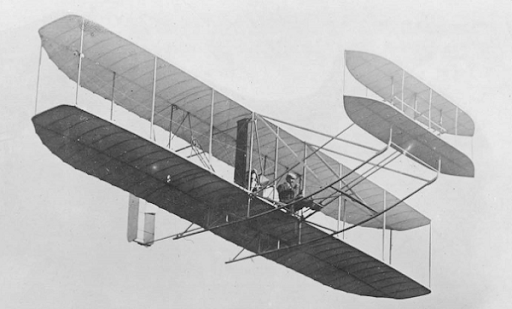
1903
Les premières lignes de tramway apparaissent à Tokyo : 2 ans plus tard, les tireurs de pousse-pousse mettront à profit les grandes manifestations nationalistes de septembre 1905, pour détruire plusieurs dizaines de voitures et incendier les bureaux de la Compagnie d’électricité.
Le deuxième congrès du P.O.S.D.R : Parti Ouvrier Social-Démocrate de Russie, fondé en 1898, voit s’affronter deux stratégies différentes : celle de Lénine, partisan d’une élite militante autour d’une ligne politique unique, qui va donner naissance aux bolcheviques – majoritaires – et celle de Martov et de Plekhanov, qui préfèrent la création d’un grand parti de masse, intégrant divers courants : ils seront les mencheviks – minoritaires -. Nicolas II renvoie Sergueï Witte, son ministre des finances, principal artisan de l’essor extraordinaire du pays : il le rappellera en pleine crise en 1905 pour le renvoyer à nouveau en 1906.
Le russe Tsiolkovski énonce les lois du mouvement d’une fusée.
Le hollandais Einthoven enregistre l’activité électrique du cœur : c’est la naissance de l’électrocardiographie.
L’anglais Rutherford décrit la structure de l’atome : un noyau et un électron chargé négativement.
Chamberlain propose le territoire de l’Ouganda à Théodore Herzl, qui mourra l’année suivante, à 44 ans ; mais les assises d’une nation nouvelle avaient été jetées.
Le rêve et la faim poussaient vers le sionisme les hommes et les oboles par dizaines de milliers. Le mouvement devenait une force, mais cette force nouvelle s’appuyait sur la tradition, c’est à dire, sur le retour à la terre des Hébreux. Un État juif, certes, mais en Palestine seulement.
On le vit bien lorsque, dans les premières années du siècle, le gouvernement britannique offrit à Herzl et ses compagnons le territoire fertile et alors presque inhabité de l’Ouganda. Herzl, lui, juif occidentalisé, était d’avis d’accepter le don. Il le dit au congrès annuel. Alors il y eut un véritable délire de désespoir. Un membre de ce congrès m’a raconté qu’il a vu des délégués sanglotant, suppliant, saisis par la fièvre des prophètes et criant que, hors de Jérusalem, et de ses collines, il n’y avait point de terre juive. Ainsi fut refusée l’offre d’un pays immédiatement accessible au profit d’un sol aride et dont la possession semblait alors aussi nébuleuse que la venue du Messie.
Cela semblait, cela était de la folie.
Pourtant, les événements donnèrent raison aux fous.
Joseph Kessel. L’élan vers la Terre promise.1926
40 000 grévistes dans les textiles du Nord. Révolte en Kabylie. Première Ford de série. Charles Heudebert invente la biscotte industrielle ; le produit nous vient d’Italie, quand un boulanger commit l’erreur de cuire deux fois une pâte : bis cotte : cuite deux fois.
Louis Perrier, médecin et propriétaire de la Société des eaux minérales de Vergèze, dans le Gard, vend son entreprise à l’Anglais John Harmsworth, qui donne le nom du vendeur à la source, invente la petite bouteille verte, laquelle s’en va conquérir l’empire britannique, et même le monde. Cent ans plus tard, les baroudeurs du monde entier s’étonneront toujours du nombre incroyable de boutiques, toutes plus perdues les unes que les autres où on peut trouver du Perrier.
Frédéric Boudou est agriculteur à Durenque, au sud de Rodez, en Aveyron. Ses 50 ans ne l’empêchent pas de rester insatisfait de sa dure vie : il s’embarque avec son épouse Eugénie Vernhes et ses 7 enfants pour l’Argentine, où, ma foi, après avoir rejoint les premiers aveyronnais installés à Pigüe 20 ans plus tôt, les choses durent se passer plutôt bien, puisque, plus de 100 ans plus tard, un des ses arrière petit-fils, Amado Boudou deviendra vice-président de l’Argentine, assurant en 2012 la fonction de président le temps pour la présidente Cristina Kirchner de se faire opérer d’un cancer de la thyroïde.
Au Gabon, de 5 000 tonnes par an, l’exploitation de l’okoumé passera à 380 000 tonnes, 30 ans plus tard. Un très bon roman, autobiographique sur le sujet : Don Fernando par Fernand Fournier-Aubry. Chez Robert Laffont 1972
En Amazonie, dans le haut bassin de l’Amazone et du Putumayo, en territoire péruvien, la société caoutchoutière Casa Arana & Hernanos rafle les Indiens Witotos, Mirañas, Ocainas, Andokes, Nonuyas, Muinanes et Boras pour les emmener sur ses gigantesques exploitations de caoutchouc, La Chorera et El Encanto ; au bout de dix jours, les Indiens devaient revenir aux baraquements avec 14 kilos de latex : si les 14 kilos n’étaient pas atteints, c’était le fouet et les tendons coupés. Walter Hardenburg, un ingénieur américain parlera plus tard devant la justice anglaise (la société était devenue anglaise) de ce qu’il avait vu en matière de torture : mutilation des oreilles, des jambes, des doigts, des bras. Et cela dura plusieurs décennies et les responsables finirent paisiblement leurs jours. On comptera 6 000 Indiens ayant survécu à ce régime, emmenés par leurs anciens tortionnaires à la fin de l’époque du caoutchouc.
L’intolérance religieuse et politique bat son plein : Etiennette Loustau, institutrice ayant débuté dans les années 20 rapporte les difficultés de son beau-père, lui aussi instituteur : Anselme, le père de Gaston, a été déplacé cinq fois. Motif ? Idées trop républicaines. Sa femme Henriette, surprise un dimanche matin par une royaliste avec des boutons de manchette à l’effigie de Gambetta, a été dénoncée au maire, puis à l’administration, et expédiée ailleurs avec son mari.
Etiennette Loustau, institutrice en retraite Télérama N° 2482. 6 Août 1997.
Un député d’Annecy, un brin provocateur, dépose un projet de loi pour la suppression des zones franches : tout aussitôt, les 207 communes zoniennes protestèrent au nom des droits que leur avait conférés le plébiscite de 1860 et leurs représentants demandèrent que rien ne fût changé au régime établi. Exploitation hydraulique, par conduite forcée, du lac naturel [un verrou glaciaire] de la Girotte dans le Beaufortin, à 1 720 m. pour les papeteries Aubry d’Albertville.
L’hôtel du Panorama à Megève dispose d’une voiture, ce qui lui permet d’aller chercher ses clients à Sallanches, où le train arrive depuis juin 1898. On compte alors trois hôtels : Le Panorama – 40 chambres -, le Mont-Blanc de François Morand Périnet – 18 chambres, et le Soleil d’Or de Mlle Adélaïde Conseil, qui aura 35 chambres en 1910. Il faut ajouter à cette capacité d’accueil 7 villas louées en meublé. En 1902, 300 estivants feront un séjour à Megève.
Hilaire Feige parle ainsi de Megève dans un guide du tourisme : Rien ne repose la vue et ne charme l’imagination comme ce val formé, dans la plaine et sur les coteaux, de terres labourables ou de belles prairies aux flancs des montagnes, de vastes forêts de sapins, coupées de charmantes oasis de verdure et, sur les sommets les plus élevés, de rocs grisâtres au duvet de frêles herbes ou tapissées de genévriers ou de rhododendrons…
L’air pur et embaumé de parfums de la montagne y promet aux tempéraments délabrés une prompte convalescence et bientôt une parfaite santé. Aussi le val de Megève est-il conseillé par les sommités médicales qui l’ont étudié comme une excellente station d’air, où les malades n’auront pas à souffrir de variations brusques de température si préjudiciables, même aux santés les plus solides.
début 1904
Publication en Angleterre du rapport Casement. Nombreux étaient alors les échos parvenant à Londres sur les atrocités devenues courantes au Congo, alors propriété privée du roi Léopold II de Belgique : exactions en tous genres commises sur les populations locales, allant souvent jusqu’à la mort. Le gouvernement anglais veut en avoir le cœur net et pour ce faire, a envoyé Robert Casement, haut-fonctionnaire d’origine irlandaise, au sein de l’ambassade d’Angleterre pour trois mois au Congo, de juin à septembre 1903 ; ce rapport fait grand bruit… dans le monde de la presse, alors en plein essor ; mais le Congo n’est pas anglais, et le rapport n’intimide guère Léopold II qui continuera à poursuivre son œuvre de barbare, même si l’opinion publique n’est plus de son côté, jusqu’à refiler en 1908 le gros bébé, couvert de dettes au gouvernement belge.

22 01 1904
Premier raid à ski Briançon – Lautaret, 56 km A R , par les Chasseurs Alpins.
8 02 1904
Le Japon a proposé à la Russie une zone de partages d’influence en Extrême Orient : le Japon garderait sa domination sur la Corée et la Russie sa position prépondérante en Mandchourie : les Russes ont refusé ; le Japon déclare alors la guerre à la Russie : une escadre japonaise torpille trois vaisseaux russes en rade de Port Arthur et attaque la forteresse, entre Pékin et Pyong-Yang, en Corée, aujourd’hui Anshan. La flotte russe finira par se saborder. Mais les Russes parviendront à effacer ce revers et à prendre le dessus sur le Japon qui ne parviendra à renverser la situation en sa faveur qu’avec les secours financiers d’un Juif : L’histoire remonte à 1900, à la guerre russo-japonaise. L’empereur avait dépêché son messager Yakahashi à Londres pour emprunter de l’argent afin de financer la poursuite de la guerre que les Japonais étaient en train de perdre. Les banquiers ont refusé, certains que les Japonais ne s’en sortiraient pas. Par chance, Yakahashi a rencontré Jacob Shiff, un banquier américain de la Kuhn Loeb Cie, qui, connaissant l’existence des pogroms en Russie, effectuera un don de 200 millions $, expliquant à Yakahashi qu’il lui donnait cet argent parce qu’il était Juif et qu’il voulait lutter contre les pogroms en Russie. Et c’est ainsi que les Japonais finiront par gagner la guerre.
Éliette Abécassis. La dernière tribu. 2004
Quelque quarante ans plus tard, allié des Allemands nazis, les Japonais n’auront pas la mémoire courte et refuseront de céder aux demandes allemandes d’exterminer les Juifs – la communauté juive du Japon était assez importante, les premiers éléments remontant au début de l’ère Meiji -.
______________________________________________________________________________
[1] Celui qui, au XXI° siècle, est le dernier trois-mâts barque français, – 1 200 m² de voilure, un grand mât de 34 m, 51 m de long et 531 tonneaux, coque en métal riveté – aura eu la baraka tout au long de sa vie. Terminé en 1896, il échappa donc à cette éruption, puis pendant la deuxième guerre mondiale, aux bombardements allemands sur l’île de Wight, et en 1980 à la décrépitude dans la lagune de Venise par le mécénat de la Caisse d’Epargne, qui injectera 900 000 € de travaux pour lui insuffler une nouvelle jeunesse : il accueille aujourd’hui des stagiaires à raison de 130/140 € par jour. Si l’Hermione avait pu avoir la même chance, elle n’en serait pas là.


Laisser un commentaire