| Publié par (l.peltier) le 23 septembre 2008 | En savoir plus |
1 01 1912
Le chèque barré est juridiquement reconnu.
Sun Yat Sen a débarqué à Chang-haï depuis un mois ; le Kouo-min-tang, son parti est déjà bien implanté : il proclame la république à Nankin. La réalisation majeure du Kouo-min-tang sera sans doute l’unification de la langue parlée en Chine : c’est la langue parlée à Pékin qui va être enseignée dans les écoles.
17 01 1912
Le capitaine anglais Robert Falcon Scott arrive au pôle sud avec Edgar Evans, John Oates, Henry Bowers et Edward Wilson, tirant eux-mêmes leur traîneau, c’est à dire, sans chiens. Il avait emporté trois traîneaux de Dion Bouton à moteur et à chenilles, essayés quatre ans plus tôt en compagnie du commandant Charcot au col du Lautaret. Il avait quitté l’Angleterre le 15 juin 1910. Le 12 octobre, un télégramme de Roald Amundsen l’attend à Melbourne : I’m going south. Il hiverna sur l’île de Ross (l’expédition avait surtout un caractère scientifique, mais pas trop spartiate : une cabane de 26 m sur 7.60 m avec piano dans le mess des officiers, carré des marins et salle de bains) qu’il quitta le 1° novembre 1911.
Il prit des poneys et des chiens pour la première partie de l’expédition, mais les derniers poneys furent abattus et mangés dès le 9 décembre. La sensibilité anglaise lui faisait refuser l’usage alors commun des chiens : on s’en sert tant que cela est nécessaire pour tirer des traîneaux lourds, et, sur le retour, on les sacrifie et on les mange dès que diminue le poids à transporter. Curieusement, Scott se refusait à l’usage généralisé des chiens pour une expédition mais n’hésita pas à sacrifier et manger les poneys. Ses premières tentatives remontent au début du siècle. Arrivés à 43 km du pôle, les 5 hommes aperçoivent des traces dans la neige. Scott notera sur son journal : Le pire est arrivé. Un simple coup d’œil nous révèle tout. Les Norvégiens nous ont devancé… Demain, nous irons jusqu’au pôle, puis nous rentrerons le plus vite possible.
Le 17 janvier, ils atteignent le pôle et trouvent une lettre sous la tente surmontée du drapeau norvégien et du pavillon du Fram : Cher commandant Scott, comme vous serez probablement le premier à arriver ici après nous, puis-je vous demander d’envoyer la lettre jointe au roi Haakon VII ? Si les équipements laissés dans la tente peuvent vous être de quelque utilité, n’hésitez pas à les prendre. Avec mes meilleurs vœux, je vous souhaite un bon retour. Sincèrement vôtre.
Roald Amundsen
Cet échec tournera au drame : 1 300 kilomètres les séparent du Terra Nova. Le blizzard ne cesse de souffler. Il faut tirer le traîneau. Le 7 février, – ils ont fait 500 kilomètres -, Edgar Evans fait une mauvaise chute : il y perd la raison. Dix jours plus tard, il meurt d’épuisement après une dernière chute. Au milieu des bourrasques, les quatre survivants poursuivent leur route dans un horrible labyrinthe de crevasses. La nuit, la température chute jusqu’à – 44 °C. Le 16 mars, une vieille blessure de guerre d’Oates se réveille. Il ralentit l’expédition qui n’avance plus que de 5 kilomètres par jour. Nous savions que sa fin était proche. Mais il ne se plaignait pas. Il se coucha, espérant ne pas se réveiller, mais il se réveilla pourtant. L’ouragan soufflait. Oates nous dit : Je sors, il se peut que je reste absent longtemps. Nous ne devions plus le revoir. Nous savions qu’il marchait vers la mort, mais bien que nous eussions essayé de le retenir, nous savions qu’il agissait en homme brave et en gentleman anglais. Le lendemain et le surlendemain, Scott, Henry Bowers et Edward Wilson parviennent encore à faire 35 kilomètres. Ils montent une dernière fois la tente le 19 mars. Le blizzard souffle trop fort pour continuer. Le One ton depot n’est plus qu’à 18 kilomètres. Les trois hommes attendent désespérément la fin de la tempête dans leurs sacs de couchage. Ils n’ont plus rien à manger, plus de combustible. C’est la fin. Le 25 mars, Scott a encore la force d’écrire quelques lettres pour sa mère, son épouse, pour les mères de Bowers et de Wilson, et encore quelques autres. Il rédige encore un Message pour le public : Nous avons couru des risques. Nous savions que nous les courions. Les choses ont tourné contre nous, nous n’avons pas à nous plaindre. Mais à nous incliner devant la décision de la Providence, déterminés à faire de notre mieux jusqu’à la fin. Mais si nous avons volontairement donné nos vies dans cette entreprise, c’est pour l’honneur de notre pays. J’en appelle à mes concitoyens pour leur demander de veiller à ce que ceux qui dépendent de nous ne soient pas abandonnés […]. Ces notes grossières et nos cadavres raconteront notre histoire, mais je suis sûr qu’un grand et riche pays comme le nôtre aura le souci de ceux que nous laissons derrière nous.
Ils seront retrouvés sept mois plus tard, le 12 novembre par Silas Wright, jeune glaciologue canadien, qui aperçoit leur tente, premier d’une colonne de secours de 8 hommes commandée par le médecin Edward Atkinson, du Terra Nova. Le journal de Scott était ouvert au mardi 29 mars 1912 – date supposée de leur mort – :
Depuis le 21, tempête constante de l’ouest sud-ouest et du sud-ouest. Le 20, nous avions du combustible pour faire deux tasses de thé chacun et de la nourriture pour deux jours. Tout le temps, nous nous sommes tenus prêts à partir pour le dépôt distant de 20 km. Mais toujours d’épais tourbillons de neige chassés par la tempête. Maintenant, tout espoir doit être abandonné. Nous tiendrons jusqu’à la fin, mais nous nous affaiblissons graduellement. La mort ne peut plus être loin.
C’est épouvantable. Je ne puis en écrire plus long.
Pour l’amour de Dieu, prenez soin des nôtres.
Les sauveteurs prendront les journaux des trois hommes, les lettres, les pellicules photographiques et la quinzaine de kilos d’échantillons rocheux qu’ils ont prélevés en cours de route. De retour en Angleterre, ces roches, par leurs fossiles permettront d’éclaircir l’origine du continent antarctique.
De nombreux mémoriaux à la gloire de Scott seront érigés dans tout le pays. Une collecte rapportera 75 000 livres à partager entre les familles des six héros morts. Le fronton du Scott Polar Research Institute de Cambridge porte l’inscription, en latin :
Quaesivit arcana polo. Videt Dei.
( He sought the secret of the pole, but found the hidden face of God.
Il a recherché le secret du pôle, et c’est la face cachée de Dieu qu’il a trouvée. )

Roald Amundsen

Capitaine Robert Falcon Scott


12 02 1912
Le dernier empereur de Chine, Pu-yi, 6 ans, abdique : la monarchie n’est pas renversée, elle tombe. Sun Yat Sen a conscience de la faiblesse de son pouvoir : reçu à Pékin, il accepte que Yuan Shikai, dernier régent, assume la présidence de la république. La rupture entre les deux hommes interviendra rapidement. Yuan Shikai s’apprêtera à réduire la Chine à un protectorat japonais, et aussi, sur les pressions de son entourage à être proclamé empereur, redeviendra président le 22 mars 1916 et mourra d’une crise d’urémie le 6 juin 1916. Le Japon cherchait à pousser ses pions en envoyant à Yuan Shikai un ultimatum : 21 demandes, qui va déclencher un vif mouvement antijaponais. Sun Yat Sen trouvera asile au Japon, où il va épouser sa troisième femme, Ching-ling, sœur de May-ling Soong qu’il s’était vue refuser par M. Soong, méthodiste qui avait fait fortune, dit-on, en vendant des Bibles. Vont s’ensuivre 15 ans d’anarchie, jusqu’en 1927 :
À Pékin siégeait le gouvernement central. Le pouvoir réel appartenait aux gouverneurs militaires des provinces, tou-kiun, qui se combattaient, s’alliaient, se trahissaient à l’envi. De temps à autre, l’un d’eux parvenait à l’emporter et installait à Pékin un ministère à sa dévotion. Les Puissances misaient sur tel ou tel général regardé, suivant l’heure, comme l’homme fort capable de réussir. Aux luttes de militaires se superposaient les intrigues des factions et les débats intermittents d’un parlement caricature.
Jean Escarra
Durant la décennie des seigneurs de la guerre (1916-1926), les masses rurales ont plus souffert des raids de bandits, des pillages, des exactions d’administrateurs corrompus que de l’exploitation sociale dénoncée par les communistes.
Lucien Bianco L’Histoire Juillet Août 2005
Cette quasi vacance du pouvoir n’empêchera pas – peut-être même la favorisera-t-il – une croissance économique soutenue : de 1912 à 1929, la production industrielle chinoise augmentera de 13 % par an ! Comme j’ai aimé la Chine ! Il y a ainsi des pays que l’on accepte, que l’on épouse, que l’on adopte d’un seul coup comme une femme […] ! Cette Chine à l’état de friture perpétuelle, grouillante, désordonnée, anarchique, avec sa saleté épique, ses mendiants, ses lépreux, toutes ses tripes à l’air, mais aussi avec cet enthousiasme de vie et de mouvement, je l’ai absorbée d’un seul coup, je m’y suis plongé avec délices, avec émerveillement […] ! Je m’y sentais comme un poisson dans l’eau !
Paul Claudel. Choses de Chine
14 02 1912
Le baron de Rio Branco, ministre brésilien des Affaires étrangères, est mort 3 jours plus tôt. En 1910 il avait été l’un des premiers hommes d’État à reconnaître la République portugaise. Le 13 février, la séance du Parlement portugais avait été suspendue une demi-heure, comme il était d’usage ; mais le lendemain, les sénateurs restèrent à leurs sièges pour observer dix minutes de silence… qui devinrent cinq, puis une : la minute de silence était née, qui avait le grand avantage d’être parfaitement neutre et pouvait donc être observée dans toutes les religions du monde, d’autant qu’elles professent toutes le plus grand respect pour le silence. On devrait d’ailleurs la restaurer à l’original : 10 minutes ! Ça serait un bon début pour repartir du bon pied.
Yuan Shikai est élu président provisoire de la République de Chine.
22 02 1912
François Joseph Fournier, belge de 55 ans, qui a fait fortune dans les mines d’or au Mexique, achète l’île de Porquerolles, 12.54 km², à 2.8 km au sud de la Tour Fondue extrémité sud de la presqu’île de Giens, pour 1. 001 million de francs. Il obtiendra la nationalité française le 28 juin 1914. Il la met en valeur avec le modèle qu’il avait utilisé à la Colonizadora au Mexique : développement des cultures viticole et fruitière, création d’une coopérative, mise en place d’une flottille de bateaux assurant la liaison avec la Tour Fondue sur la presqu’île de Giens. Il avait épousé sa troisième femme Sylvia Frances Antonia Johnston Lavis le à Paris, une anglaise qui lui donnera sept enfants, tous nés à Porquerolles : six filles, dont Lelia Hortense (16 décembre 1921) et un garçon Benedic François Joseph (). En 1971, l’État confiera au Parc national de Port-Cros la gestion et la mise en valeur des 1000 hectares de l’ancien Domaine Fournier qu’il venait d’acquérir sur l’île de Porquerolles, sur proposition en conseil des ministres d’André Bettencourt. Le Parc deviendra propriétaire par dotation de l’État en 1985 de cette surface qui représente 80 % de l’île. Aujourd’hui, le vélo y est roi, son électrification, pratiquement généralisée assurant son succès ; 50 € la journée en location.
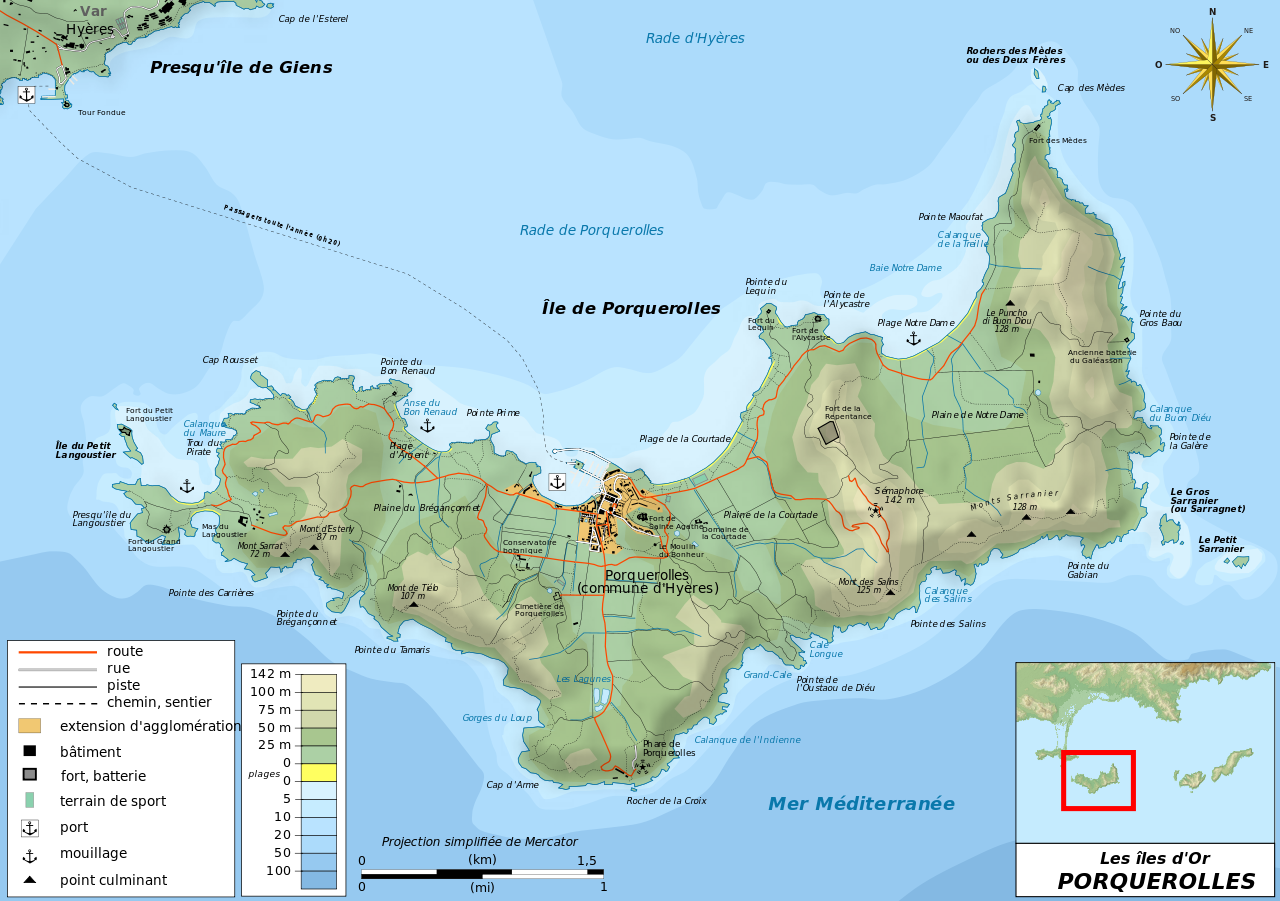

Plage de Notre Dame
02 1912
Le dirigeable italien P3 bombarde les troupes ottomanes qui se retirent de l’oasis de Zanzur vers Gargaresch, au SE de Tripoli, transformant leur retraite en déroute. Un dirigeable peu emporter jusqu’à 250 bombes. Les avions se mettent aussi à emporter des bombes mais, c’est encore extrêmement artisanal : le pilote doit de débrouiller pour piloter d’une main tout en insérant de l’autre le détonateur dans l’obus qu’il tient, coincé entre les genoux, avant de la lancer à la main sur les troupes au sol. Autre arme redoutable : les projecteurs électriques embarqués sur les navires, qui empêchent les forces ottomanes de monter des attaques nocturnes, ou au moins de leur occasionner de lourdes pertes.
Le spectacle de ces malheureux soldats arabes pris dans la lumière électrique me remplit de tristesse : projecteurs, mitrailleuses Maxim, batteries, navires de guerre, aéroplanes – ils avaient si peu de chances de s’en sortir !
Ernest Bennett, observateur anglais.
03 1912
Raymond Poincaré resserre les nœuds qui nous lient à la Russie, rapprochant ainsi la France de la guerre.
Pendant l’été 1912, il reste loin d’être évident que la France soit prête à soutenir la Russie dans un conflit purement balkanique. Les termes de la Convention militaire franco-russe de 1893-1894 sont ambigus sur ce point. L’article 2 stipule qu’en cas de mobilisation générale dans l’un des pays de la Triple-Alliance, la France et la Russie mobiliseraient simultanément et immédiatement la totalité de leurs forces et les déploieraient aussi rapidement que possible à leurs frontières, sans qu’un accord préalable ne soit nécessaire. Cela semble impliquer qu’une crise balkanique suffisamment sévère pour déclencher la mobilisation de l’Autriche peut, sous certaines circonstances, entraîner une contre-mobilisation conjointe en Russie et en France, ce qui provoquerait à coup sûr une contre mobilisation de l’Allemagne, puisque les articles 1 et 2 de la Double-Alliance austro-allemande de 1879 exigent que les signataires s’assistent mutuellement au cas où l’un d’entre eux serait attaqué par la Russie, ou par un pays allié de la Russie. Tel est donc le mécanisme apparemment susceptible de faire dégénérer une crise dans les Balkans en guerre continentale, d’autant plus qu’il ne distingue pas entre mobilisation partielle ou mobilisation générale dans le cas de l’Autriche.
La confusion provient de l’article 1 de la Convention militaire franco-russe qui envisage une obligation d’intervention seulement dans les circonstances suivantes :
- si la France est attaquée par l’Allemagne ou
- si la Russie est attaquée par l’Allemagne, ou par l’Autriche-Hongrie avec le soutien de l’Allemagne.
Ce qui place la barre pour une intervention militaire de la France plus haut que ne le fait l’article 2. Cette dissonance dans le texte provient du fait que les deux pays signataires avaient des exigences de sécurité différentes. Pour la France, l’Alliance franco-russe et la Convention militaire qui y était adossée étaient le moyen de contrer et de contenir l’Allemagne. Pour la Russie, le problème central était l’Autriche-Hongrie. Malgré tous leurs efforts, les négociateurs français n’avaient pas pu persuader leurs homologues russes de renoncer à lier, dans l’article 2, mobilisation autrichienne et mobilisation générale en France. Ce qui revenait à placer le détonateur dans les mains de la Russie : elle avait désormais – sur le papier du moins – la possibilité de déclencher à sa guise une guerre continentale pour soutenir ses objectifs dans les Balkans.
Mais on ne peut guère se fier à la lettre des traités ou des alliances -pas plus qu’aux constitutions d’ailleurs – pour comprendre les réalités politiques. Les décideurs parisiens, conscients des risques créés par l’article 2, ont été prompts à donner une interprétation restrictive des obligations françaises. En 1897 par exemple, pendant la guerre de Trente Jours entre la Grèce et l’Empire ottoman, le ministre des Affaires étrangères Gabriel Hanotaux a informé Saint-Pétersbourg que la France ne considérerait pas une intervention austro-hongroise comme un casus fœderis (un événement entraînant une obligation d’assistance) . Et nous avons vu combien la France a été réticente à se laisser entraîner dans la crise de l’annexion bosniaque en 1908-1909, refusant de considérer qu’elle constituait une menace réelle contre les intérêts vitaux de la France ou de la Russie. En 1911, à la demande des Français, les termes de la Convention militaire ont été modifiés. L’obligation d’assistance mutuelle ne demeure qu’en cas de mobilisation générale en Allemagne ; mais en cas de mobilisation générale ou partielle en Autriche, il est décidé que la France et la Russie devront se consulter avant d’engager une action commune.
Or, en 1912, la France adopte une position diamétralement opposée, ce qui constitue l’un des ajustements politiques les plus importants de l’avant-guerre. Après avoir cherché pendant des années à isoler la France des conséquences des soubresauts balkaniques, le gouvernement français va étendre les engagements de la France pour y inclure la possibilité d’une intervention armée dans une crise purement balkanique. Le principal responsable de ce changement est Raymond Poincaré, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères du 14 janvier 1912 au 21 janvier 1913, puis président de la République. Au lendemain de sa nomination, Poincaré déclare publiquement qu’il maintiendra avec la Russie les relations les plus loyales et conduira la politique étrangère de la France en complet accord avec son alliée. Or il est très inhabituel qu’un ministre des Affaires étrangères français inaugure son mandat par des déclarations programmatiques telles que celle-ci. Au cours d’une série de conversations avec Alexandre Izvolski à Paris, Poincaré réaffirme aux Russes qu’ils peuvent compter sur le soutien de la France en cas de guerre déclenchée par une querelle austro-serbe. Le gouvernement russe, répète-t-il à Izvolski en novembre 1912, n’a aucune raison de craindre que les Français ne le soutiennent pas.
Il n’est pas facile de retracer l’origine de cette évolution de pensée. L’un des principaux facteurs en est sans doute la menace allemande, préoccupation viscérale de Poincaré. Il avait dix ans lorsque les Allemands ont envahi sa Lorraine natale, forçant sa famille à fuir. Sa ville d’origine, Bar-le-Duc, a été occupée pendant trois ans avant d’être libérée à la suite du paiement des indemnités de guerre. Cela ne signifie pas que Poincaré soit un revanchard du même acabit que Boulanger, mais il se méfie profondément des Allemands, ne voyant dans leurs tentatives d’établir un climat de détente avec la Russie ou la France que pièges et illusions. Poincaré est convaincu que le salut réside dans le renforcement de l’Alliance franco-russe, clé de voûte de la sécurité française. Il veut également éviter de retomber dans le chaos de la crise d’Agadir, où des stratégies diplomatiques parallèles ont créé une grande confusion. Il faut également tenir compte de sa personnalité : Poincaré, qui aime les situations claires, agit avec une cohérence remarquable. Ses adversaires voient dans la détermination avec laquelle il poursuit des objectifs précisément définis la preuve d’un manque regrettable de flexibilité. La raideur de Poincaré, prétend Paul Cambon, reflète son inexpérience diplomatique et sa structure intellectuelle d’homme de loi. Son frère Jules parle d’un esprit qui naturellement numérote, classe et enregistre tout comme dans un dossier.
Mais Poincaré n’est pas le seul à vouloir donner une orientation plus agressive à la politique de sécurité française. Son arrivée au pouvoir coïncide avec un changement de tonalité dans la vie politique française à la suite de la crise d’Agadir – ce que les historiens ont appelé le renouveau nationaliste. Après l’affaire Dreyfus, les hommes politiques républicains avaient eu tendance à adopter une approche défensive en matière de politique étrangère, donnant la priorité aux fortifications à la frontière, à l’artillerie lourde et à de brèves périodes de formation militaire, l’armée étant considérée comme la nation en armes. Par contraste, après la crise d’Agadir, la France adopte une politique qui prend en compte les intérêts professionnels des militaires, acceptant la nécessité de périodes de formation plus longues et d’une structure de commandement plus concentrée et efficace, envisageant explicitement une approche offensive de la prochaine guerre. Dans le même temps, le sentiment populaire pacifiste et antimilitariste qui avait dominé en 1905 cède la place à une attitude plus belliqueuse. Non que la France tout entière soit balayée par cette vague de nationalisme : ce sont surtout de jeunes Parisiens instruits qui embrassent ce nouveau bellicisme. Mais la restauration de la puissance militaire devient l’un des slogans qui revitalise l’idéal politique républicain.
Ce sont probablement l’attaque de la Libye par l’Italie et le début de l’effondrement du pouvoir ottoman qui poussent Raymond Poincaré à incorporer les Balkans dans sa vision stratégique. Dès mars 1912, il a dit à Izvolski que la distinction traditionnelle entre crise balkanique localisée et problèmes de plus grande ampleur géopolitique n’était plus pertinente. Étant donné le système d’alliances européennes alors en place, il était difficile d’imaginer qu’un événement dans les Balkans reste sans effet sur l’équilibre général de l’Europe. Toute confrontation armée entre l’Autriche-Hongrie et la Russie découlant de problèmes dans les Balkans constituerait un casus fœderis pour l’alliance austro-allemande, ce qui à son tour activerait l’Alliance franco-russe.
Poincaré est-il conscient des risques qu’il y a à soutenir la stratégie des Russes dans les Balkans ? Une conversation entre le président du Conseil français et le ministre des Affaires étrangères russe au cours d’une visite à Saint-Pétersbourg en août 1912 nous éclaire sur ce point. Poincaré sait que les Serbes et les Bulgares ont signé un traité car Izvolski l’en a informé en avril, mais n’a aucune idée de son contenu Il a demandé des clarifications à Saint-Pétersbourg sans obtenir la moindre réponse (Sazonov déclarera plus tard qu’il avait différé la transmission du texte à Poincaré de peur que certaines parties ne soient divulguées dans la presse française). À Saint-Pétersbourg, en août, il pose donc à nouveau la question. Sazonov sort alors le texte en russe et le lui traduit. Le président du Conseil français est stupéfait de ce qu’il apprend, en particulier des articles stipulant des mobilisations simultanées serbo-bulgares contre la Turquie et, si nécessaire, contre l’Autriche, sans même parler de la référence à la partition de territoires encore profondément enclavés en Macédoine ottomane ni du rôle d’arbitre donné à la Russie dans toutes les disputes – ce dernier point, le plus perturbant, apparaît, d’ailleurs, à chaque ligne de la convention note Poincaré. Le compte rendu qu’il rédige à l’issue de cette réunion reflète sa déconfiture :
Le Traité contient donc en germe, non seulement une guerre contre la Turquie, mais une guerre contre l’Autriche. Il établit, en outre, l’hégémonie de la Russie sur les deux royaumes slaves des Balkans, puisque la Russie est nommée comme arbitre dans toutes les questions. Je fais remarquer à M. Sazonoff que cette convention ne répond aucunement à la définition qui m’en avait été donné, qu’elle est, à vrai dire, une convention de guerre et que non seulement, elle révèle des arrière-pensées chez les Serbes et les Bulgares, mais qu’il est à craindre que leurs espérances ne paraissent encouragées par la Russie.
Poincaré n’est pas le seul à s’effrayer de l’ampleur des engagements russes dans les Balkans. Jean Doulcet, conseiller à l’ambassade française de Saint-Pétersbourg, note également à la même époque que les accords balkaniques sont en fait des traités de partage. Le soutien que Saint-Pétersbourg apporte au Traité serbo-bulgare suggère que les Russes sont prêts à ne tenir aucun compte de l’Autriche, et à procéder à la liquidation de la Turquie sans se soucier des intérêts [autrichiens].
À ce stade, on pourrait s’attendre à ce que Poincaré, découvrant à quel point les Russes sont impliqués dans les affaires balkaniques, ait des doutes quant à la sagesse de soutenir leur stratégie. Or cette découverte semble avoir l’effet inverse. Peut-être ne s’agit-il pour lui que de reconnaître que, dans le contexte général de la stratégie russe, la survenue d’un conflit dans les Balkans n’est plus seulement probable, mais quasiment certaine, et qu’il faut donc intégrer cette donnée dans les scénarios de l’Alliance franco-russe. Un autre facteur entre également en ligne de compte : le sentiment – partagé par une partie de l’armée française – qu’une guerre d’origine balkanique est le scénario le plus susceptible de pousser les Russes à participer pleinement à une campagne conjointe contre l’Allemagne. Comme le lui disent ses conseillers militaires, une guerre austro-serbe engagerait la moitié ou les deux tiers des forces autrichiennes, permettant ainsi aux Russes de disposer de davantage de régiments contre l’Allemagne, forçant donc cette dernière à déployer plus de troupes à l’est, relâchant de ce fait la pression sur l’armée française à l’ouest.
Quelles que soient les raisons de ce changement de stratégie, à l’automne 1912, Poincaré est désormais prêt à soutenir une éventuelle intervention militaire russe dans les Balkans. Au cours d’une conversation avec Izvolski pendant la deuxième semaine de septembre (alors que la première guerre des Balkans se profile mais n’a pas encore éclaté), Poincaré informe l’ambassadeur que si la Turquie vainquait la Bulgarie, ou si l’Autriche-Hongrie attaquait la Serbie, la Russie pourrait être contrainte d’abandonner sa passivité. S’il devenait nécessaire que la Russie monte une attaque contre l’Autriche-Hongrie et que cela déclenche l’intervention de l’Allemagne (conséquence inévitable, selon les termes de la Double-Alliance), alors le gouvernement français reconnaissait par avance que cela constituait un casus fœderis et il n’hésiterait pas un instant à remplir ses obligations vis-à-vis de la Russie. Six semaines plus tard, alors que la guerre fait rage, Izvolski rapporte à Sazonov que Poincaré ne craint pas l’idée qu’il puisse devenir nécessaire de déclencher une guerre sous certaines circonstances, certain qu’il est de la victoire des États de la Triple-Entente. Cette confiance, ajoute l’ambassadeur russe, se fonde sur une note de l’état-major français récemment transmise au bureau du président du Conseil.
De fait, Poincaré devance ses obligations avec tant d’énergie qu’il semble par moments brûler les étapes. Le 4 novembre 1912, un mois après le début de la première guerre des Balkans, il écrit à Sazonov pour lui proposer que la Russie se joigne à la France et à la Grande-Bretagne afin de prévenir une intervention autrichienne dans le conflit. Cette ouverture est si inattendue qu’Izvolski doit écrire à son ministre pour la lui expliquer : jusqu’à une période récente, le gouvernement français refusait de se laisser entraîner dans ce qu’il considérait comme des problèmes purement balkaniques, mais il a depuis peu changé d’opinion. Paris reconnaît désormais que toute conquête territoriale effectuée par l’Autriche-Hongrie romprait l’équilibre européen et affecterait les intérêts vitaux de la France. (Ceci constitue une inversion complète des arguments précédemment utilisés par les Français pour justifier leur manque d’intérêt dans la crise de l’annexion bosniaque.) L’approche volontariste de Poincaré, conclue Izvolski, signifie qu’un nouvel état d’esprit règne au Quai d’Orsay. Il conseille donc à Sazonov d’en profiter sans tarder pour obtenir le soutien de la France et de la Grande-Bretagne pour l’avenir .
À la mi-novembre, Sazonov, qui s’attend à une possible attaque autrichienne sur la Serbie (ou du moins sur les troupes serbes stationnées en Albanie), désire savoir comment Paris et Londres réagiraient en cas d’intervention militaire russe. Sans surprise, Grey reste évasif : la question étant purement académique, l’on ne pouvait se prononcer sur un cas de figure hypothétique qui ne se posait pas encore. À l’inverse, Poincaré réagit en demandant des précisions à Sazonov : quelles étaient les intentions précises du gouvernement russe ? Elles devaient être clairement formulées sinon le gouvernement français risquait de rester en deçà ou au contraire d’aller au-delà des attentes de son allié. Les Russes ne devaient pas un instant douter du soutien de la France en cas de crise dans les Balkans : Si la Russie entre en guerre, la France fera de même, parce que nous savons que le cas échéant, l’Allemagne soutiendra l’Autriche. Au cours d’une conversation avec l’ambassadeur italien à Paris quelques jours plus tard, Poincaré confirme que si la querelle austro-serbe devait dégénérer en conflit généralisé, la Russie pouvait compter sur le soutien militaire de la France.
Dans ses Mémoires, Poincaré nie vigoureusement avoir tenu de tels propos, et il faut reconnaître qu’Izvolski n’est pas un témoin totalement impartial – lui, dont la carrière à Saint-Pétersbourg a été brisée par sa mauvaise gestion de l’annexion bosniaque, diplomate tombé en disgrâce qui a dû quitter ses hautes responsabilités et demeurera toujours obsédé par la soi-disant perfidie d’Aehrenthal et de l’Autriche. Se peut-il qu’il ait menti afin de renforcer la résolution de son collègue (et ancien subordonné) Sazonov ? Ou qu’il ait exagéré les engagements du président du Conseil français – comme ce dernier lui-même le suggérera plus tard – afin de faire valoir son rôle dans la consolidation de l’Alliance ?
Ce sont des suppositions plausibles, mais les preuves semblent indiquer qu’elles ne sont pas exactes. Par exemple le 12 septembre, Izvolski écrit que, lors d’un entretien avec Poincaré, ce dernier lui a affirmé que les Français sont confiants de remporter la victoire en cas d’escalade continentale d’un conflit balkanique. Cet optimisme est corroboré par un mémorandum triomphaliste de l’état-major français, en date du 2 septembre, un document dont Izvolski ne peut pas avoir eu connaissance ; ce qui suggère, à tout le moins, que la conversation a bien eu lieu. L’inquiétude de Poincaré quant au risque de brûler les étapes paraît authentique – il exprimera des doutes identiques dans son journal intime pendant la crise de juillet 1914. Et il y a d’autres témoins, tel l’ancien président du Conseil et ministre des Affaires étrangères Alexandre Ribot, juriste brillant et spécialiste de science politique, qui rencontre Poincaré plusieurs fois à l’automne 1912. Dans une note privée datée du 31 octobre 1912, Ribot écrit : Poincaré ne pense pas que la Serbie évacuera Üsküb, et si l’Autriche intervient, la Russie ne pourra pas ne pas intervenir. L’Allemagne et la France seront obligées, par les traités qu’elles ont signés, d’entrer en scène. Le Conseil des ministres en a délibéré et a décidé que la France devait remplir ses engagements.
Le changement de stratégie de Poincaré suscite des réactions mitigées parmi les principaux hommes politiques et hauts fonctionnaires. Sa méfiance à l’égard de l’Allemagne et son interprétation élargie du casus fœderis trouvent un écho favorable chez ceux des fonctionnaires influents du Quai d’Orsay qui partagent la même culture acquise à Sciences-po et pour qui sympathie proslave et hostilité anti-allemande sont des principes de base. Il a également le soutien de la plupart du haut commandement de l’armée. Dans son mémorandum du 2 septembre 1912 (celui-là même que Poincaré cite dans ses conversations avec Izvolski), le colonel Vignal du deuxième bureau de l’état-major général démontre au président du Conseil qu’une guerre commencée dans les Balkans mettrait les pays de l’Entente dans les meilleures conditions pour l’emporter. Puisque les Autrichiens seraient engagés sur le théâtre balkanique, l’Allemagne serait obligée de redéployer une partie substantielle de ses forces pour défendre son front oriental contre la Russie, affaiblissant ainsi ses capacités offensives à l’ouest. Dans ces circonstances, ce serait la Triple-Entente qui aurait les chances de succès les meilleures et pourrait parvenir à une victoire lui permettant de redessiner la carte de l’Europe, en dépit de quelques succès autrichiens dans les Balkans.
D’autres, en revanche, se montrent plus critiques. L’ambassadeur à Londres, Paul Cambon, est consterné par l’attitude de provocation adoptée par Poincaré contre l’Autriche-Hongrie au début de la première guerre des Balkans. Le 5 novembre 1912, au cours d’un séjour à Paris, Paul écrit à son frère Jules pour déplorer que Le Temps ait publié un article ostensiblement inspiré par Poincaré, qui défie ouvertement Vienne sans aucune nuance, aucune patience, aucune précaution. Il rapporte également une conversation avec Poincaré au soir du samedi 2 novembre. Cambon a osé suggérer que la France puisse envisager d’autoriser l’Autriche à s’emparer d’une partie du sandjak de Novi Pazar, ce tas de cailloux, en échange de l’assurance que cette dernière renonce à tout autre territoire dans les Balkans. La réponse du président du Conseil l’a stupéfait : Il était impossible de laisser une puissance [l’Autriche] qui n’avait pas fait la guerre, qui n’avait aucun droit, etc. obtenir un avantage ; cela soulèverait l’opinion en France et constituerait un échec pour la Triple-Entente ! La France, avait poursuivi Poincaré, qui avait tant fait depuis le commencement de la guerre – ici Cambon insère un point d’exclamation entre parenthèse – serait obligée de demander aussi des avantages, une île dans la mer Egée par exemple. Le lendemain matin, dimanche 3 novembre, Cambon, qui n’en a visiblement pas dormi de la nuit, retourne voir Poincaré afin de lui faire part de ses objections. Le sandjak ne mérite pas un conflit armé, et une île en mer Egée causera plus de problèmes qu’elle n’en vaut la peine. Cambon ne croit pas non plus que Poincaré, comme il le prétend, ait agi sous la pression de l’opinion. Au contraire, l’opinion est indifférente à de telles questions — il est important que le gouvernement ne crée pas lui-même un courant d’opinion qui rendrait la solution impossible, avertit Cambon. Mais Poincaré ne veut rien entendre et met fin à la discussion :
J’ai soumis mes vues au gouvernement en conseil, m’a-t-il dit sèchement, il les a approuvées, il y a une décision du cabinet, on ne peut y revenir.
Comment on ne peut y revenir ? ai-je répondu ; sauf deux ou trois ministres, les membres du cabinet ne connaissent rien de la politique étrangère, et la conversation peut toujours rester ouverte sur les questions de ce genre
Il y a une décision du gouvernement, a-t-il répliqué très sèchement, il est inutile d’insister.
Ce qui est intéressant dans cet échange, ce n’est pas son sujet, puisque loin de s’emparer ou de réclamer une partie du sandjak, l’Autriche retire ses troupes de la zone et l’abandonne aux États voisins, Serbie et Montenegro. L’affaire est réglée puis oubliée. Ce qui est bien plus significatif, c’est le sentiment que la France est désormais directement et profondément concernée par les conflits balkaniques – ce que laissent entendre les remarques du Président du Conseil, en particulier la notion étrange que l’abandon du sandjak aux Autrichiens obligerait Paris à réclamer une île de la Mer Égée en échange. Plus inquiétant encore pour l’avenir, la lettre de Cambon – tout comme la note de Ribot – donne le sentiment que la politique française dans les Balkans ne consiste plus à improviser des réactions en fonction de situations nouvelles, mais qu’elle est désormais gravée dans le marbre, qu’elle consiste en une série de décisions sur lesquelles on ne peut revenir.
Christopher Clark. Les somnambules. Flammarion 2013
15 04 1912
Le Titanic, transatlantique de la White Star Line britannique, 269 m de long, 46 000 tonneaux, 300 000 tonnes, coule à 2 h 30’ du matin, au sud de Terre Neuve, par 41°43’ N et 49°56’ O, après avoir heurté un iceberg à 23 h 40’ par 41° 46′ N et 50° 14′ O : c’était le voyage inaugural du plus grand, du plus puissant, du plus beau paquebot du monde. Piscine, tennis, salle de squash, gymnase avec machine à ramer, équipements d’équitation mécanique, 3 ascenseurs pour les ponts de première classe, salons, bibliothèque, fumoir, salle à manger de 35 mètres de long pouvant recevoir 550 passagers, tout cela dans tous les styles : Louis XVI, Empire, Renaissance italienne, Géorgien britannique. Au départ anglaise, la White Star Line, une des plus grandes compagnies maritimes, était devenue américaine depuis le début du XIX°; la banque Morgan était partie prenante.
La réalisation – 4 500 ouvriers pendant trois ans – avait été confiée au plus grand chantier naval du monde, à même de mener de front la construction de huit navires : la Harland § Wolff de Queen Island, près de Belfast. En parallèle, étaient construits deux autres paquebots identiques au premier : l’Olympique, qui naviguera 24 ans jusqu’à la retraite, et le Britannic, qui coulera en 1916 après avoir heurté une mine.
Dès les jours précédant l’appareillage de Southampton, le 10 avril, les incidents n’avaient pas manqué, dont un incendie dans la soute à charbon n° 10 dès le 3 avril, sur lequel le commandant Smith avait ordonné le silence au chef mécanicien Bell, car le départ aurait alors été retardé de quatre jours, temps nécessaire pour changer les tôles endommagées : l’incendie ne sera maîtrisé – ce qui ne signifie pas éteint – que le 12 avril ! non sans avoir fragilisé l’acier de la coque qui aurait chauffé jusqu’à 1 100° !
Ce même jour, le commandant Smith déclare : Ce qui m’inquiète, ce ne sont pas les icebergs et les épaves à demi immergées que l’on voit de loin, mais les épaves qui flottent au ras de l’eau : le vrai piège.
À 19 h 45’, le paquebot français Touraine signale deux champs de glace et deux icebergs.
Le 14 avril, à 10 h 30’, nouveau message signalant icebergs, champs de glace et growlers : consigne du commandant Smith au lieutenant Murdoch : Information périmée… Faites doubler les vigies si la visibilité diminue.
Les messages d’alerte se multiplient à la radio ; celui de 13 h 45 n’est même pas transmis à la passerelle. Celui venant du Baltic est remis par Smith au président de la compagnie, Bruce Ismay, qui le met en poche, sans même le lire.
Les innovations techniques étaient telles qu’il pouvait affronter n’importe quelle tempête, naviguer dans les zones les plus risquées.
Sa fiche technique est impressionnante : Avec sa double coque en plaque d’acier riveté et ses 16 compartiments séparés par 15 cloisons étanches, le Titanic offrait une sécurité maximale. Si jamais un des compartiments était touché, on pouvait fermer les cloisons depuis la passerelle à l’aide d’une commande électrique. En cas d’entrée d’eau massive, on pouvait également les fermer manuellement ou automatiquement par l’intermédiaire de flotteurs de sécurité.
Le transatlantique était aussi muni de huit pompes offrant une capacité d’évacuation de 400 tonnes d’eau à l’heure. Avec un tel système, le Titanic était pratiquement insubmersible. Deux compartiments pouvaient en effet être inondés sans que le navire soit en danger, les autres assurant sa flottabilité.
En outre, le Titanic était doté d’un système de navigation à la fine pointe de la technologie, pour l’époque. Ses dimensions colossales le mettaient également à l’abri des tempêtes les plus violentes. Le paquebot disposait aussi de détecteurs de fumée dans les endroits névralgiques. La sonnerie d’alarme assurait une intervention rapide des employés en cas d’incendie. Pour clore le tout, un appareil de détection acoustique permettait de repérer des obstacles immergés.
D’autres innovations techniques faisaient du Titanic une véritable réussite. Contrairement aux autres paquebots, il disposait de deux machines à vapeur classiques de 15 000 chevaux et d’une turbine à basse pression de 16 000 chevaux. La puissance totale transmissible aux trois hélices en bronze, de 38 tonnes au total, 7 mètres Ø, était de 46 000 chevaux. La vapeur était produite par 29 chaudières consommant 544 tonnes de charbon par jour et 159 foyers.
L’énergie électrique, qui était nécessaire à l’éclairage (10 000 ampoules) des lieux et au fonctionnement des divers appareils (pour la cuisson, le chauffage, la réfrigération et l’aération), était assurée par quatre dynamos d’une puissance de 400 kilowatts.
Le Titanic disposait aussi d’un système téléphonique très avant-gardiste pour l’époque. Il s’agissait d’une installation double composée d’un central réservé à la navigation et d’un système interne. Le premier reliait entre eux la passerelle de commandement, la plage avant, le nid-de-pie, la salle des machines et le compartiment arrière. Le second, d’une capacité de 50 lignes, permettait aux clients occupant les cabines de luxe de communiquer avec les différents services (bar, restaurant, etc.). Le Titanic possédait de plus une installation T. S. F. (téléphone sans fil) de type Marconi, d’une grande puissance, qui permettait d’émettre et de recevoir des messages télégraphiques.
Mais rien de tout cela ne pourra empêcher le naufrage : 1 492 personnes y laissent la vie, sur les 2 205 passagers/hommes d’équipage [1316 passagers, 889 équipages], le poids du portefeuille ayant à cette occasion les vertus d’une bouée. Il y avait 325 personnes en 1° classe – coût du billet : 4 000 $ – 285 en 2° classe – coût du billet : 65 $ – et 706 en 3° classe, dans des cabines de 4 à 6 couchettes pour 45 $. Les 3° classe n’avaient pas d’accès direct aux embarcations de sauvetage : seulement 25 % d’entre eux seront sauvés quand le pourcentage sera de 62 % pour les première et 41 % pour les seconde. Pas de porte feuille… touché, coulé. Une des deux dernières chaloupes était occupée par 20 femmes ; quand elle fût retrouvée… elle était occupée par 32 hommes ! Mais globalement les femmes et les enfants d’abord fut respecté : on comptera 25 % des femmes dans les victimes, mais 82 % d’hommes. Un steward, alcoolique et galant homme se jeta à l’eau en s’accompagnant d’une bonbonne de whisky qu’il assécha, ce qui lui valut de rester en vie jusqu’à l’arrivée des sauveteurs. Les plus pauvres sont les plus touchés : si les Noirs avaient été interdits du voyage, 113 Irlandais avaient embarqué en 3° classe lors de sa dernière escale avant la traversée, installés à l’entrepont, empêchés par des gardes d’aller se mêler aux riches des ponts supérieurs.
Il y avait seulement 20 canots de sauvetage : 14 de 65 personnes chacun, 2 de 40, 4 pliables de 47 soit au total de la place pour 1 178 passagers ; 64 embarcations avaient été prévues au départ, mais on en avait supprimé 44 pour faire de la place sur les ponts de promenade. Sur un navire qui pouvait emmener 2 200 personnes – passagers et équipage -, on ne disposait en places sur les canots de sauvetage que de 1178 places, c’est-à-dire que 1 000 personnes n’avaient pas de place de secours ! La carence, l’incompétence, l’irresponsabilité des officiers furent telles que, sur ces 1 178 places, seulement 711 furent prises : près de 500 morts parce que l’évacuation se fit dans la pagaille !
Margaret Tobin, née près du trottoir, était devenue la richissime Molly Brown, en épousant Joseph Brown : jetée au pied de son lit par le choc, elle se prépare au pire, enfile six paires de chaussettes, une bonne veste de laine, un manteau en peau de phoque et, munie de 500 $, elle rameute d’autres femmes pour embarquer dans un canot de sauvetage que le timonier Hichens fait mettre à l’eau avant qu’il n’ait embarqué les 65 personnes prévues : elles ne sont que 24 ! Molly demande à Hichens de ramer en direction des passagers qui se sont jetés à l’eau, faute de place sur les canots : il refuse, par crainte d’être aspiré par le navire qui va sombrer. Molly va le faire taire et prendre le commandement de son canot. On retrouvera cette maîtresse femme en France en septembre 1914, pour y organiser des convois d’ambulances.
Mais la diversité règne aussi chez les femmes : lady Duff Gordon et son mari s’éloignent dans un canot aux ¾ vide : dans sa grande générosité, elle donnera aux 7 hommes d’équipage 25 $ chacun pour les dédommager de la perte de leurs affaires mais de grâce éloignons-nous vite de cet endroit maudit.
Très proche des lieux du drame – à peu près 20 miles – croisait un cargo mixte, le Californian, arrêté par un champ de glace. L’opérateur radio était aux abonnés absents et donc n’entendit pas les appels. Un homme d’équipage dira par contre avoir vu les fusées tirées depuis le Titanic. Depuis les canots plusieurs passagers affirmeront avoir vu un navire s’éloigner sans jamais se détourner…
Le SOS émis depuis le navire par radio permit de sauver les 705 passagers en vie sur les canots : le paquebot Carpathia, le plus proche du lieu du drame après le Californian, – à 58 miles – a capté le SOS de 1 h 20’ et s’est détourné, mais il lui aura fallu tout de même trois heures pour arriver sur place… trois heures, c’est suffisant pour que des rescapées meurent de froid dans les chaloupes. À 2 h 18’, le Titanic se couche à 45° sur tribord, et à 2 h 30’, s’enfonce à jamais dans les flots, emportant des centaines de passagers, son commandant, son architecte …
Le Mackay Benett et le Minia, navire spécialisé dans la réparation des câbles transatlantiques, seront affrétés par la White Star Line pour ramener les quelques 300 dépouilles que recueilleront pendant des semaines les marins.
Bruce Ismay, patron de la White Star Line, sera longuement interrogé par la commission d’enquête, que sa morgue avait passablement énervé : il lui sera essentiellement reproché d’avoir poussé le commandant à augmenter la vitesse du navire quand la prudence aurait au contraire demandé de ralentir, ceci pour tenter de décrocher un record de vitesse de la traversée.
On se mit à lancer l’idée que l’acier de la coque, de fabrication nouvelle, se serait révélé entaché d’impuretés qui l’auraient rendu cassant à basse température, d’où l’importance des déchirures de celle-ci. Mais ces déchirures sont une erreur d’interprétation, ce que la plongée de 1996 mettra en évidence [la découverte de l’épave par 3 800 mètres de fond date de 1985], car on verra alors six entailles étroites où les plaques métalliques semblent s’être écartées, les rivets ayant sauté le long des soudures.
Selon deux chercheurs américains – MsCarty et Foecke, qui publient en 2008 What really sank the Titanic : New Forensic discoveries, Editions Citadel -, serait essentiellement en cause la qualité des rivets. On en compte à peu près 3 millions sur un tel navire.
Deux types de rivets étaient alors utilisés, en acier ou en fer ; Harland § Wolff utilisa des rivets d’acier, posés à la machine, sur la partie centrale de la coque, là où les contraintes sont les plus importantes, mais la proue – c’est la partie que heurta l’iceberg – et la poupe furent équipés de rivets de fer, posés à la main par une main d’œuvre normalement très spécialisée.
Le fer utilisé pour les rivets contient des impuretés, ce qui est normal et nécessaire pour rigidifier ce métal, trop ductile à l’état pur. Le pourcentage de ces impuretés déterminait plusieurs qualités de fer, et ce n’est pas la meilleure qualité qui avait été retenue. Il y avait aussi pénurie de riveteurs, et donc recours à des sous-traitants : le rivetage à la main était affaire délicate… un travail mal fait pouvait cacher des imperfections. Les 48 rivets de fer recueillis sur l’épave présentent pour la plupart de fortes concentrations de scories, qui peuvent les rendre cassants.
La catastrophe induira le développement de la recherche pour détecter les icebergs : Langevin découvrira le sonar, mais qui fonctionne bien lorsque la surface réfléchissante est régulière, ce qui n’est pas le cas d’un iceberg.
Faute de sonar, on utilisait encore les jumelles du nid de pie ; mais la clef du coffre où elles se trouvaient était restée par inattention dans la poche de Blair l’officier en second de 37 ans, débarqué juste avant l’appareillage et remplacé au pied levé par Charles Lightoller, plus expérimenté. Ces jumelles auraient-elles permis de voir l’iceberg plus tôt, à minuit moins le quart ? Frederick Fleet l’affirmât : c’est lui qui donna l’alerte depuis le nid de pie – 10 mètres au-dessus du pont, sur le mât – à 23 h 39’, en sonnant par trois fois la cloche et en téléphonant à la passerelle, quand le navire était à 400 mètres de l’iceberg, filant 22.5 nœuds. Le lieutenant Murdoch ordonne alors au timonier Hichens : Tribord toutes, puis, Bâbord toutes. Trop tard : 37 secondes plus tard, c’était le choc : le flanc tribord racle la glace, provoquant un choc suffisant pour que sautent les rivets de liaison entre les tôles. Murdoch actionne quand même la fermeture électrique des portes étanches. Le commandant Smith envoie Thomas Andrews, l’architecte du navire, présent à bord, inspecter les fonds ; il remonte : cinq compartiments étanches sont inondés, la flottabilité n’est plus assurée, le navire est perdu. Une heure et demie maximum. Cette manœuvre – tribord toute, puis bâbord toute, préconisée par Smith, n’était pas la bonne ; il aurait été plus judicieux de faire arrière toute : cela aurait suffisamment ralenti le navire [il lui faut alors 1 500 mètres pour s’arrêter] pour que la puissance du choc ne soit pas telle qu’elle perce cinq compartiments. Le SOS lancé alors par le navire à 23 h 50’ donne 41°46 N et 50° 14’ O.
Frederick Fleet va devenir un paria au sein de la White Star Line : il la quittera avant la fin de l’année, mènera une vie de plus de plus instable pour finir par se suicider en 1964, à 77 ans.
Toutes ces explications mettant sur le devant de la scène la qualité des rivets vaudront jusqu’au début des année 2 000 ; car, dès 2004, on verra Robert Essenhigh, ingénieur de la Geological Society of America et de l’Université d’État de l’Ohio remettre sur le haut de la pile des causes l’incendie qui se serait déclaré dans une soute sur tribord dix jours avant l’appareillage, fragilisant ainsi l’acier, simplement parce qu’il avait été chauffé. En 2008, Ray Boston, après vingt ans d’étude sur ce naufrage, affirme dans The Independant que l’incendie dans une soute s’est probablement déclaré une dizaine de jours avant l’appareillage pour New-York, lors de tests de rapidité. Mais surtout, fin 2017, Sonan Monoly, journaliste irlandais qui a travaillé trente ans sur ce naufrage, vient avec ce qui peut passer pour une preuve, des photos du flanc tribord du Titanic, avant d’appareiller, montrant une tâche sur la coque, plus noire que l’ensemble de la coque, qui serait due à la chaleur subie alors par l’acier lors de l’incendie dans la soute qui correspond à l’emplacement de cette tâche.
Il faut tout de même savoir que les incendies à bord de ces navires fonctionnant au charbon étaient alors chose plutôt fréquente. Néanmoins, cela faisait désordre que d’en informer les passagers d’un paquebot, surtout quand ils ont pognon sur rue. Aussi Ismay donna-t-il les instructions pour qu’ils n’en sachent rien. Cherchent-ils à savoir pourquoi des drôles d’odeurs ? On leur répond : ce n’est rien, ce n’est rien ! On verra tout de même John Pierpont Mogan, directeur de la banque éponyme et donc, propriétaire du navire, annuler son billet la veille du départ et faire mettre les bagages dans sa Rolls, à quai.
Que faire avec cet incendie ? les marins et les pompiers prélevaient ce charbon déjà en partie consumé et l’enfournaient dans la chaudière, ce qui faisait tourner les machines en surrégime et c’est ainsi que lors de la collision, le Titanic, filait ses 22.5 nœuds… trop vite pour effectuer une manœuvre avec rapidité et efficacité. Mais surtout, l’acier de la coque, chauffé jusqu’à des températures proches de 1 100°, était ainsi énormément fragilisé, sa résistance diminuant de 75 % ! Et c’est précisément au niveau de la tâche sur tribord avant que se fit la déchirure sur 6 caissons, par où l’eau s’engouffra !
Commission d’enquête il y aura, évidemment, composée pour le principal de membres de la White Star Line, qui mettra tout en œuvre pour que le témoignage de Fred Barret, chef soutier rescapé, ne soit pas enregistré.

http://didiertougard.blogspot.fr/2012/04/le-naufrage-du-titanic-du-14-au-15.html



![RIP Titanic [1912-1912]](https://www.les-crises.fr/images/images-diverses/2012/titanic/t22.jpg)

Hall d’entrée des premières classes






Trois photos prises par Louis Ogden, passager du Carpathia



on retrouvera aussi des bouteilles de champagne entières, mais sans bouchon qui, comprimé par la pression avait été avalé par la bouteille qui, de ce fait s’était aussitôt mise en équipression.
Video prise en juillet 1986 depuis le sous-marin Alvin.
Presque en même temps était lancé le France, surnommé Le Versailles des mers : 220 mètres de long.
Son surnom de Versailles des mers lui vient des aménagements de la 1° classe tirés du vocabulaire décoratif grand siècle : volutes et rinceaux de la rampe du grand escalier du hall de réception, flambeaux, torches, cuirasses, carquois et harpons de la frise décorative à la base de sa coupole, copie du portrait en pied de Louis XIV par Rigaud dans le salon de conversation et farandoles d’amours inspirées du salon de la Guerre du Château de Versailles, à la voussure de sa verrière. Les lambris de la bibliothèque et du fumoir évoquent le décor plus intimiste et gracieux de Trianon. La salle de bains d’un appartement de grand luxe est décorée de médaillons copies de boiseries commandées par Louis XV à Antoine Rousseau en 1771 pour son cabinet des Bains.
Ce raffinement s’accompagne de nombreuses commodités: eau chaude et froide dans les salles de bain des cabines de 1° classe, ventilation et électricité dans tout le navire, deux ascenseurs, une salle de cinéma, une salle de mécanothérapie [l’ancêtre de nos salles de gymnastique et de musculation. ndlr] poste de télégraphe sans fil, des chambres froides…
Dany Savelli. Les Carnets de Versailles. Octobre 2019-mars 2020



28 04 1912
Jules Bonnot, natif de Bellegarde dans l’Ain, anarchiste et pilote automobile hors pair, – il a été entre autre chauffeur de Sir Arthur Conan Doyle – a pris la relève des attaques de diligence en utilisant au mieux les capacités de la puissante De Dion Bouton, qu’il a volée, pour délester les convois de fonds ; le premier hold-up datait du 21 décembre 1911, quand il avait braqué le garçon de course de la Société Générale, le blessant par balles. Recherché par toutes les polices de France, il est repéré à 6 heures du matin dans sa cache, chez Jules Dubois, un autre anarchiste, à Choisy le Roi : police, gendarmes, des centaines d’hommes en armes sont là, qui mitraillent à l’envie la maisonnette, pour finalement avoir recours par trois fois, aux explosifs, devant vingt mille spectateurs et c’est le préfet Lépine en personne qui met fin à son aventure, en tirant lui-même la balle du coup de grâce, pendant son transport à l’Hôtel Dieu : c’était la onzième !
On retrouvera son dernier message : Je suis incompris dans la société. J’ai le droit de vivre, et puisque votre société imbécile et criminelle prétend me l’interdire, tant pis pour vous.
Grinçant, Jean Galtier Boissière écrit : C’est la première victoire de l’armée française depuis Sedan.
Ses derniers complices en fuite, Garnier et Valet, seront tués le 14 mai, après un siège de 9 heures de leur maison de Nogent sur Marne. Les autres comparses seront jugés en février 1913, pour une trentaine de vols aggravés et de crimes, qui ont fait 7 morts et 12 blessés. Caillemin, dit Raymond la Science, Elie Monnier et André Soudy seront guillotinés ; Eugène Dieudonné, gracié par Poincaré, sera condamné aux travaux forcés à perpétuité, comme Carouy, qui se suicidera le soir même, avec du cyanure.

04 1912
Pose de la première pierre de l’Institut pour les études techniques à Haïfa, en Palestine : l’idée avait vu le jour au V° congrès sioniste de Bâle en 1901. Cet institut va devenir le Technion, institut israélien de technologie, aujourd’hui leader de la Silicon Valley d’Israël, pépinière de talents scientifiques mondialement reconnus, de start-up etc…
26 05 1912
Mort du Père Maurice Touchaux, à Lima, Pérou. Son oraison funèbre, d’auteur inconnu, (sans doute un membre de sa communauté religieuse au Pérou) mérite d’être citée ; c’est un modèle du genre : C’est un bon et digne Français que nous venons d’accompagner à sa demeure dernière, après une vie trop courte pour le but généreux auquel elle y était consacrée. Épris de tout ce qui est beau, apôtre de tout ce qui est bien, entraîné vers tout ce qui est grand et noble, âme d’élite heureuse de se prodiguer, de se livrer tout entière, le Père Maurice a passé sur la terre, simplement, pieusement. Volontairement exilé de son pays qui lui était si cher, afin de le mieux servir en une croisade lointaine, modeste, pendant laquelle inlassablement il a semé des germes de paix, de civilisation, de charité, de foi, avec d’autant plus d’ardeur et d’élan que la terre était plus aride et inculte. Pour ce chevalier du Devoir, la devise fût Sacrifice, le cri d’armes fût Bonté. Le connaître, c’était l’aimer. Aussi le pleurons-nous comme un des nôtres, ce soldat de France qui fût soldat du Christ, tombé glorieusement sur le perpétuel champ de bataille dont il avait voulu que sa vie fût faite.
Adieu, Père Maurice ; bientôt nous irons dans votre pays dire à celle que vous et votre frère y avez laissé avec un rayon d’espérance quelle fût votre dernière pensée. Nous essaierons de la consoler, en lui disant ce que vous fûtes.
Reposez en paix, dans l’éternité des élus, où ceux qui croient ne peuvent que se grandir en aspirant à vous rejoindre un jour à la place que Dieu vous a marquée.
29 05 1912
Serge Diaghilev a su réunir autour de lui tout ce que la France compte de talents en matière artistique : – musique, peinture, théâtre – ; il donne au Théâtre du Châtelet L’après-midi d’un faune – poème de Stéphane Mallarmé, musique de Claude Debussy – et c’est le scandale, déclenché par la nouveauté de la chorégraphie et plus précisément par le génie, la virtuosité du danseur étoile des Ballets Russes : Vaslav Nijinsky, dont la sensualité choque les belles âmes.
05 1912
En Russie, création de La Pravda, qui reprend le même titre que le journal dont Trotski est le rédacteur en chef depuis 1908. Tout est bon pour attiser les haines internes.
22 06 1912
24 ans après l’expédition de Fridjof Nansen, Alfred de Quervain, suisse dont les ancêtres bretons ont fui la France après la révocation de l’édit de Nantes en 1684, entreprend une traversée de Groenland d’ouest en est, avec 3 compagnons, 3 traîneaux munis de voiles carrées pour les allures portantes, et 30 chiens. Ils sont arrivés sur la côte sud-ouest sur leur navire Fox, fifty-fifty de 2 mâts. Ils vont faire 600 km, en montant jusqu’à 2 150 m, avant de trouver la côte est le 1 août 1912. Scientifique rigoureux, travailleur infatigable, organisateur hors-pair, il dressera un profil ouest-est du Groenland, et sera salué à l’unanimité par la communauté scientifique.
6 07 1912
Charles Maurras invente le nationalisme intégral, dont les parents se nomment nationalisme et royalisme. Il écrit dans l’Action Française : Il s’agit de savoir si nous sommes chez nous en France ou si nous n’y sommes plus ; […] Il est parfaitement clair que nous n’existerons bientôt plus si nous continuons d’aller de ce train. […] Ce pays n’est pas un terrain vague. Nous ne sommes pas des bohémiens nés par hasard au bord d’un chemin. Notre sol est approprié depuis vingt siècles par les races dont le sang coule dans nos veines. […] Les quatre États confédérés – les ennemis de l’intérieur – sont : le juif, le protestant, le maçon, le métèque.
14 07 1912
Shizō Kanakuri, 21 ans, étudiant à l’École normale supérieure de Tokyo, a été sélectionné pour représenter le Japon au marathon des Jeux Olympiques de Stockholm ; pour autant, le gouvernement japonais ne lui offre pas le voyage et il doit constituer une cagnotte pour cela. Fatigué par le voyage, victime de troubles gastriques causés par une alimentation nouvelle, bien différente de la cuisine japonaise, les dernières semaines de préparation sont loin d’être optimales. Qu’importe. Le 14 juillet 1912, Shizō Kanakuri foule la piste du stade olympique de Stockholm, prêt à se frotter à la quarantaine de kilomètres du marathon, en dépit d’une canicule difficilement supportable. Avant même le départ, les absents sont nombreux : un tiers des 95 coureurs engagés ne se présente pas.
Tout au long du parcours, les coureurs tombent comme des mouches. Derrière le peloton, le cortège d’ambulances et de médecins ramasse à la pelle des athlètes déshydratés. L’un d’entre eux ne se relèvera jamais. Porte-drapeau de la délégation portugaise, Francisco Lazaro est retrouvé à l’agonie au 30° kilomètre puis emmené en urgence à l’hôpital le plus proche, victime d’une méningite provoquée par la chaleur. Le lendemain matin, sa mort est annoncée. Francisco Lazaro devient officiellement le premier athlète à mourir aux Jeux olympiques.
C’est le Sud-Africain Ken MacArthur qui franchit la ligne d’arrivée en vainqueur en 2h. 36’, signant un nouveau record olympique. Des 68 coureurs engagés, seuls 35 terminent l’épreuve. 32 abandons ont été recensés, mais un coureur manque à l’appel : Shizō Kanakuri. Dans tous les journaux de Suède, la rubrique faits divers ne parle que de cette mystérieuse disparition. Le marathonien japonais s’est volatilisé, a trompé la vigilance des commissaires de course ; mais il n’est pas mort : aux Jeux d’Anvers de 1920, Shizō Kanakuri franchira la ligne d’arrivée, à une honorable 16° place. Mais personne n’aura alors la curiosité de lui demander ce qui lui était est arrivé à Stockholm huit ans plus tôt. Il faudra attendre 1962, soit le 50° anniversaire des Jeux de Stockholm pour qu’un journaliste suédois plus obstiné que les autres veuille le savoir. Et il le retrouvera, devenu professeur de géographie respecté, travaillant à quelques kilomètres seulement de son village natal. Marié, il a six enfants et dix petits-enfants. Dans un entretien accordé au journaliste suédois, il se livrera : Comme la moitié des concurrents, j’ai, moi aussi été victime d’une défaillance. Aux alentours du trentième kilomètre, je me suis arrêté devant une maison pour demander à boire et l’habitant a fait preuve d’une immense compassion, car, en m’apportant de l’eau, il m’a proposé un lit pour me reposer. J’ai accepté volontiers, et me suis allongé pour une simple sieste de quelques minutes, mais … elle a duré jusqu’au petit matin. Je me suis alors réveillé couvert de honte, peiné d’avoir déshonoré mon pays en ne réussissant pas à terminer l’épreuve. Par peur de devoir expliquer publiquement mon abandon, j’ai décidé de rentrer incognito au Japon en prenant le premier bateau à destination du continent asiatique, priant pour que ma mésaventure ne soit jamais révélée.
Lorsqu’elle le sera, un demi-siècle plus tard, l’histoire déclenchera une vive émotion en Suède, et en 1967, le Comité olympique suédois invitera Shizõ Kanakuri à Stockholm afin qu’il termine le marathon de 1912. Âgé de 76 ans, il réalisera la fin du parcours en courant et pénètrera dans le stade olympique les bras levés vers le ciel, sous l’ovation des spectateurs venus en nombre.
07 1912
Publication en Angleterre du Livre Bleu, rapport établi par Robert Casement sur les innombrables exactions commises par la Péruvian Amazon Company au Putamayo, au nord-ouest d’Iquitos, à El Encanto et La Chorrera, dans le bassin supérieur de l’Amazone. La configuration politico-économique n’est pas la même qu’au Congo, puisque la Peruvian Amazon Company est en fait une société anglaise, dirigée localement par Julio C. Arana. La publication de ce rapport va entrainer la chute de la société, dont les actions en bourse vont dégringoler, jusqu’à entrainer purement et simplement l’arrêt de l’exploitation du caoutchouc dans la région.
Aux États-Unis, la vie de Margaret Sanger, une infirmière, bascule au moment où l’une de ses patientes, Sadie Sachs, jeune mère de trois enfants, meurt en tentant de mettre fin à une nouvelle grossesse. Profondément bouleversée, Margaret Sanger se trouve désemparée devant les conséquences dramatiques des avortements clandestins et son incapacité à venir en aide à ces femmes en quête d’une solution pour contrôler leur fécondité. Impuissante à répondre aux attentes désespérées des femmes pour limiter la taille de leur famille, Margaret est néanmoins décidée à s’engager pour les libérer du carcan des grossesses non désirées : Je ne pouvais en supporter davantage. […] Je savais que je ne pourrais plus me contenter de ma tâche d’assistance aux mourants. […] J’étais résolue à chercher la racine du mal, à agir pour changer le destin de ces mères dont la misère était aussi immense que le ciel. Elle consacrera toute sa vie à cette cause, contribuant en première ligne à l’acceptation légale de la contraception, ce qui était loin d’être gagné dans un pays aux prises avec une forte dénatalité.
17 08 1912
Dans les Pyrénées, inauguration du train à crémaillère de Bagnères de Luchon à Superbagnères, 1 800 m d’altitude, soit 1 167 m. de dénivelé ; il sera à même de transporter 80 000 passagers par an. À ses débuts, il servira surtout à acheminer le matériel de construction du Grand Hôtel, un palace de 130 chambres dont la construction, décidée en 1909, à l’initiative de Ludovic Dardenne, pharmacien subira du retard à cause de la guerre et ne sera achevé qu’en 1922.
28 08 1912
Un vieux loup de mer, le capitaine Voss, lève l’ancre en compagnie de deux jeunes et costauds gaillards, dans les eaux du Pacifique, proches de Yokohama, au Japon. Ils sont heureux de cette croisière et ne se doutent pas encore qu’ils vont essuyer un typhon comme jamais. Le bateau : le Sea Queen, un petit yawl de 7.8 m de long, 5.8 m à la flottaison, un bau de 2.5 m, un tirant d’eau de 1.1 m et une surface de voilure de 37 m², inscrit au Yokohama Yacht Club.
Le 28 août, à midi, nous étions par 32° 40′ de Latitude Nord, et 145° 05′ de Longitude Est. Cette journée débuta par une très grosse brise de Sud-Est, accompagnée de violents grains de pluie et d’une forte houle de la même direction. Vers midi, le temps s’éclaircit un peu et le vent mollit, mais la houle augmentait toujours. L’état du temps et cette houle de Sud-Est me donna à réfléchir. Je ne serais pas surpris d’un changement de temps… et ce pourrait être de mal en pis… car tous les signes annonçaient l’approche d’un typhon. Néanmoins, je gardai mes réflexions pour moi jusqu’au lendemain, 29 août, qui s’annonça par un ciel clair et une brise d’Est modérée. Apparemment, le Père Neptune faisait de son mieux pour faciliter les choses à l’équipage de Sea-Queen ; mais la grosse houle de Sud-Est persistait, et vers 9 heures, il se forma autour du soleil un halo flamboyant et multicolore. L’atmosphère devint lourde et étouffante, et l’apparition, à l’horizon, d’un nuage épais d’apparence menaçante, me convainquit que le redoutable visiteur était maintenant tout proche, et que j’allais être appelé à soutenir la thèse que je défendais depuis si longtemps : à la mer, dans une tempête, un petit bateau est aussi sûr qu’un grand.
C’est alors que je parlai du typhon à mes deux compagnons. Le grand halo solaire persista jusqu’à 4 heures de l’après-midi ; puis le soleil disparut derrière la panne de nuages. Entre le coucher du soleil et la nuit noire, les nuages couvrant le ciel prirent des teintes de feu. Pendant la nuit, le temps fut chaud et agréable, et celui qui ignore les signes avant-coureurs d’un ouragan n’aurait certainement jamais pu croire que trente-deux heures plus tard, Sea-Queen se trouverait au centre d’un des plus violents typhons qui aient jamais balayé le Pacifique Nord. La nuit tombée, les nuages menaçants disparus dans l’obscurité, la seule indication de l’approche du typhon était la houle de Sud-Est, et aussi le baromètre, qui cependant n’était pas encore très bas. À 8 heures, il était à 757 mm, mais il baissait rapidement ; et à ce signe, et aussi devant l’augmentation de la houle, qui commençait même à briser, je fus convaincu que l’ouragan n’était plus très loin de nous.
Le 30 août se leva sur un ciel sombre et couvert, avec vent léger, variant de l’Est au Sud. A 6 heures, le vent vint du Sud-Est en forçant, apportant quelques gros grains de pluie. À midi, Port Llyod, du groupe des Bonin, se trouvait, par rapport à nous, à 245 milles dans le Sud-Sud-Ouest-1/2-Sud (nous nous trouvions à 245 milles dans le N.-N.-E.-1/2-N. de Port-Lloyd, du groupe des Bonin). Une heure plus tard, le vent forçant toujours et les grains se faisant de plus en plus violents, je pris la cape sous le tape-cul avec un ris et le tourmentin ; mais à 2 heures, il fallut filer l’ancre flottante et établir la voile de cape. Le baromètre était à 748 mm, et continuait de baisser.
Pendant l’après-midi et la soirée, le vent augmenta constamment de violence, avec des grains de pluie et de grosses lames brisantes. À 2 heures du matin, il ventait en furie, et comme les lames brisaient dangereusement, nous disposâmes deux sacs à huile le long du bord, les changeant toutes les heures. Notre brave Sea-Queen se soulageait sur les énormes lames ; de temps à autre, l’une d’elles brisait près de nous, et notre bateau l’accusait en donnant un coup de roulis. À 8 heures, le vent était si violent que je ne croyais pas possible de le voir augmenter encore, ainsi que la mer ; et voyant que le bateau se maintenait debout au vent, sur son ancre flottante, le tape-cul bien bordé au-dessus du tableau, étalant parfaitement malgré les lames énormes, j’assurai à mes compagnons que notre petit bateau résisterait au typhon sans aucun dommage ; et je suis certain qu’il l’aurait fait, si nos apparaux avaient été plus solides.
Après mes croisières à bord de Xora et de Tilikum, je croyais connaître de la mer tout ce que l’on en peut savoir, et aussi tout ce qu’il fallait pour manœuvrer un petit bateau dans un gros coup de vent. En ce qui concerne les tempêtes, je suis absolument certain que je savais m’y prendre ; mais j’acquis ce matin-là la conviction qu’il me restait encore quelque chose à apprendre relativement aux typhons. À 9 heures, le vent soufflait avec une telle violence qu’il était impossible de se tenir debout sur le pont, et que nous devions rester couchés dans le cockpit, nous cramponnant de toutes nos forces. Et cependant notre brave petit bateau affrontait vaillamment la tempête, et c’était un spectacle magnifique que de le voir passer sur la crête des lames monstrueuses. Pendant un certain temps, les sacs d’huile avaient fort bien rempli leur office, en empêchant les lames de déferler ; mais depuis une heure, l’huile semblait faire moins d’effet, et je n’en pouvais déceler nulle trace sur l’eau. Néanmoins, mes deux compagnons, à l’intérieur de la cabine, s’occupaient à garnir les sacs, pendant que je les disposais à l’extérieur, pensant que si l’huile ne faisait pas de bien, elle ne ferait toujours pas de mal. L’eau et l’embrun volaient alors au-dessus du bateau avec la force d’une tempête de neige, et il était impossible de regarder vers l’avant ; par bonheur, aucune grosse lame n’embarqua à bord, et nous n’étions nullement en danger de sombrer. De temps en temps, Vincent et Stone entr’ouvraient le capot de la cabine pour demander comment cela allait. Et je répondais invariablement : tout va bien !
Peu après 9 heures, alors que je remarquais que le bateau se mettait en travers, l’écoute de tape-cul se rompit. Je criai aussitôt : Tout le monde sur le pont ! En une seconde, mes deux compagnons étaient près de moi. Tous trois, nous rampâmes sur le pont jusqu’au tableau, et sous les lames qui se déversaient sur nos têtes, nous réussîmes à amener le tape-cul et à sauver la voile. C’est alors que je découvris que notre ancre flottante était perdue ! – Stone réussit à aller sur l’avant et à haler le câble à bord, pendant qu’avec Vincent je me hâtais de fabriquer une ancre flottante de fortune, au moyen de l’échelle de la cabine et d’une de nos ancres. Tout cela devait être fait couchés à plat pont. Ayant frappé le câble sur cette nouvelle ancre flottante, je la filai par-dessus bord ; et comme il ne nous était pas possible de rehisser le tape-cul, il fallut laisser le bateau capeyer tel que. Mais comme cette ancre flottante n’étalait guère, et qu’aucune voile de cape ne lui venait en aide, elle ne fit que peu d’effet. Un peu avant 11 heures, cette ancre flottante de fortune partit à son tour, et le bateau tomba en travers à la lame. Jusque-là, la barre avait été amarrée au milieu, mais comme le bateau était maintenant en travers, je larguai les rabans de barre, afin de permettre au gouvernail de jouer librement, et de ne pas s’opposer à notre dérive.
Mes deux compagnons étaient redescendus dans la cabine, et j’étais resté étendu dans le cockpit, me cramponnant d’une main, et de l’autre remettant les sacs à huile dans l’eau, lorsqu’une grosse lame frappa le bateau et le coucha complètement sur le côté – position qu’il garda une seconde ou deux je me demandai ce qui allait se produire : allait-il se redresser, ou chavirer ? Je n’eus pas à attendre longtemps… Je perçus une petite secousse, et je compris que le bateau se retournait, quille en l’air ; et pour éviter qu’il ne vienne se capeler sur moi, je lâchai prise…; le moment qui suivit, j’étais dans l’eau, certain que nous étions tous perdus ; j’avalai deux grandes gorgées d’eau de mer souhaitant couler rapidement, et en finir au plus vite. Lorsqu’on se trouve dans une pareille situation, plusieurs idées nous viennent à l’esprit ; et après avoir dit adieu au monde et absorbé mon lest liquide, ma pensée alla vers mes deux jeunes camarades, enfermés dans le bateau, incapables d’en sortir – et je désirais les revoir encore une fois, pour un dernier adieu. À ce moment, j’étais resté sous l’eau assez longtemps pour me noyer, mais n’étais pas encore mort. Je fis alors surface sur l’arrière du bateau, et vis Sea-Queen devant moi, sa quille pointant vers le ciel. Je donnai un coup de pied, et empoignai l’arrière, puis résolus de monter sur la carène et de tenter de faire quelque chose pour le redresser.
J’ai entendu dire que tant qu’il y a de la vie il y a de l’espoir, et que là ou il y a une volonté, il y a un moyen. À ce moment, j’étais encore en vie, avec encore quelque volonté, mais je pensais que les espoirs et les moyens étaient bien faibles… Cependant, utilisant ce qui pouvait me rester d’esprit de décision, je me hissai sur la coque par l’arrière. Juste au moment où j’atteignais la carène, j’aperçus une énorme lame déferlante s’avançant vers nous ; je me cramponnai à la quille, à y incruster mes ongles, afin de ne pas être enlevé à nouveau. En une seconde, la lame frappa le bateau et heurta rudement sa quille, mais je réussis à me maintenir. Cette même lame fit s’incliner le bateau, et le lest en fer de la quille, par son poids, le redressa, lentement, mais sûrement… ; pendant qu’il tournait, j’escaladai le plat bord ; et lorsque le petit bateau se retrouva à flot, ayant fait le tour, j’étais dans le cockpit… Tout de suite après, je vis le capot de la cabine s’ouvrir, et j’entendis Vincent crier de toutes ses forces : Êtes-vous là, Capitaine ? et mes deux camarades jaillirent de la cabine.
Sans doute certains de mes lecteurs ont-ils déjà vu deux marsouins sauter hors de l’eau, l’un après l’autre. C’est exactement l’impression que j’eus alors. Et bien que nous trouvant dans un petit bateau, en travers à la lame, au milieu de la plus violente tempête et des plus monstrueuses lames que j’aie jamais rencontrées pendant toutes mes années de mer ; bien que couchés tous trois dans le cockpit, nous cramponnant désespérément, notre rencontre, après l’incident fut tout à fait joyeuse ; si le bateau devait être fracassé par la force du typhon, nous aurions au moins pu nous dire adieu auparavant !
Le typhon était à son paroxysme, et la force du vent égale à celle de plusieurs tempêtes réunies. D’énormes lames nous tombaient dessus, se succédant rapidement. En raison du vent, de la pluie épaisse et des embruns, il nous était absolument impossible d’ouvrir les yeux en regardant au vent ; et la vue ne portait pas à plus d’une trentaine de mètres sous le vent. À des intervalles de quelques minutes, le petit bateau était couché à plat, son mât trempant dans l’eau. À ce moment, la coque et le gréement étaient toujours en bon état, et rien ne s’était trouvé perdu ni brisé. Mais lorsque le bateau avait fait le tour, il avait embarqué une grande quantité d’eau. Le vent et les lames nous frappaient par tribord ; et comme le capot de la cabine se trouvait à bâbord, il plongeait dans la mer chaque fois que le bateau se couchait, si bien que l’eau cascadait en abondance à l’intérieur. Comme il était impossible d’ouvrir la porte de la cabine tant que nous étions ainsi tribord amures, nous ne pouvions donc pas vider l’eau qui le remplissait. En même temps, j’étais certain que si nous restions dans la même situation encore vingt minutes, le yacht allait se remplir et couler. La seule chose à faire était de tenter de venir bâbord amures, et en raison des circonstances, de le faire le plus tôt possible. En conséquence, je commençai par recommander à mes compagnons de se tenir ferme, afin de ne pas être enlevés pendant la manœuvre. Je mis alors la barre au vent pour donner de l’erre au bateau ; et afin qu’il prenne assez de vitesse pour gouverner, je choquai l’écoute de grand’ voile. Aussitôt, le petit bateau prit de l’erre, et en quelques secondes nous avions changé d’amures. Tout avait merveilleusement bien marché jusqu’ici ; mais comme le bateau se retrouvait en travers, avec encore un peu de vitesse en avant, une lame nous déferla dessus, et vint briser le gui. C’était, à l’exception de la perte de l’ancre flottante, notre première avarie.
La première chose à faire était de vider l’eau se trouvant dans le bateau. Stone et Vincent savaient ce que c’était que d’être dans la cabine au moment où le bateau faisait le tour…; aussi, étant tous deux excellents nageurs, ils choisirent de courir leur chance sur le pont ; quant à moi, très mauvais nageur, je préférai risquer la mienne à l’intérieur ; il fut donc convenu que Vincent et Stone s’occuperaient du capot, parés à l’ouvrir chaque fois que l’occasion s’en présenterait, et que je descendrais dans la cabine pour vider l’eau. Nous avions décidé aussi que si le bateau chavirait à nouveau quille en l’air, mes deux fidèles et athlétiques camarades se porteraient sous le veut, et tenteraient de le redresser en s’aidant de l’effet des grosses lames.
Le capot fut alors ouvert, et je sautai dans la cabine. J’étais à peine arrivé en bas que le capot se referma, et que le bateau se coucha à plat. Cette fois, j’eus la certitude qu’il allait chavirer une deuxième fois ; et avec toute l’eau qu’il avait à l’intérieur, c’en était fait de nous. Mais à ma grande surprise, il se redressa à un angle de 45°, ce qui fit émerger le capot, de sorte que mes compagnons purent l’entr’ouvrir immédiatement. Je n’oublierai jamais le spectacle que m’offrit alors l’intérieur de la cabine. À côté de l’excellente opinion que j’avais relativement à mes aptitudes à manœuvrer un bateau au large, je croyais ne rien ignorer de l’art d’arrimer et de saisir les objets à bord, afin que rien n’aille au roulis, quel que soit le temps. Là aussi, je fus rudement désillusionné, et en arrivai à conclure que ce typhon augmentait mon expérience de plus d’une façon…
Le bateau était rempli d’eau au tiers ; et sur cette eau flottaient des morceaux de notre gramophone, avec quelques disques, dont Life on the Océan Wave. Notre appareil photographique, les boîtes de conserves, la literie, les couvertures, les livres, les vêtements, des montres d’argent, des chaînes d’or, les instruments de navigation, baignaient dans une mixture d’huile de poisson, réservée au filage de l’huile et qui s’était répandue à l’intérieur. Or, l’odeur de l’huile de poisson est certainement le parfum le moins délicat que je connaisse. Cette odeur, le roulis du bateau, ce matériel baignant dans l’eau huileuse et oscillant d’un bord à l’autre de la cabine, et moi-même au milieu de tout cela… j’en eus presque le mal de mer ! Mais je fis comprendre à mon estomac que ce n’était pas le moment de faire le délicat, car il fallait me mettre au travail pour vider le bateau. En guise d’écope, je pris une boîte en fer-blanc ayant contenu cinq livres de sucre. Et chaque fois que mes camarades entr’ouvraient le capot de façon suffisante, je vidais un peu d’eau dehors.
C’était un travail pénible, car presque à chaque minute le bateau se couchait, et le capot devait être refermé jusqu’au moment où il se redressait. Et dès que le capot était ouvert, je devais vider mon seau improvisé le plus vite possible.
Depuis une heure que nous opérions ainsi, l’eau ne semblait pas baisser dans la cabine, et je commençais à croire qu’une voie d’eau s’était déclarée ; mais comme c’était une question de vie ou de mort, nous poursuivîmes notre travail. Un peu plus tard, Vincent entr’ouvrit le capot pour me crier : Stone est pardessus bord ! puis le referma vivement pour ne pas que l’eau se déverse dans la cabine, car le bateau se couchait à nouveau. Quand il se redressa, le capot se rouvrit et Vincent cria : Il est revenu à bord ! Naturellement, j’étais certain qu’aucun de mes camarades ne quitterait le yacht tant qu’il serait à flot !
Nous avions travaillé dur pendant trois heures, et bien que le yacht ait été couché plusieurs fois, il ne chavira pas ; de plus, nous avions réussi à vider presque complètement l’eau qu’il contenait. Vincent ouvrit le capot et me dit : Capitaine, je crois que nous sommes au centre du typhon ! – Non, pas encore, lui répondis-je, mais je crois que nous y serons bientôt. Et le plus tôt sera le mieux ! Je savais qu’en dépit des formidables dimensions des lames brisantes, elles ne pourraient pas endommager notre petit bateau ; c’était la prodigieuse force du vent qui l’avait fait chavirer une fois, et qui le couchait à intervalles réguliers. Je savais aussi qu’au centre du typhon il n’y avait pas de vent, et que nous serions mieux.
Stone fut enlevé une seconde fois ; mes deux compagnons commençaient à être épuisés par la tension nerveuse qu’ils subissaient ; aussi, comme le bateau ne contenait plus d’eau et qu’il n’y avait plus rien à faire sur le pont, je leur conseillai de venir dans la cabine. Le capot et la porte furent alors fermés le plus hermétiquement possible, et nous attendîmes les événements.
Nos montres étant toutes hors de service, nous ignorions l’heure exacte ; mais je crois que le baromètre marqua 717 mm entre deux et trois heures de l’après-midi ; nous étions restés assis quelque temps, nous attendant, à chaque seconde, à voir le bateau chavirer à nouveau, lorsqu’à notre grande surprise, il se redressa soudain complètement. J’ouvris le capot immédiatement et vis tout de suite que le vent était complètement tombé, et que les deux mâts et tout le gréement étaient le long du bord. Nous ne perdîmes pas un instant pour récupérer les espars brisés, ainsi que le gréement et les voiles. Nous étions alors au centre du typhon.
J’ai entendu des Capitaines dire que si un navire est entraîné au centre d’un typhon, il n’en sortira pas vivant. D’après mon expérience personnelle, je suis entièrement d’accord en ce qui concerne un grand navire ; car dans cette mer formidable, et sans un souffle de vent pour s’appuyer, il se mettra à rouler de façon telle qu’il se brisera tôt ou tard. Mais Sea Queen n’en souffrait absolument pas : il se contentait de faire bouchon sur les lames lorsqu’elles se présentaient. Je n’avais jamais eu meilleure occasion de vérifier mes assertions, tant pendant que le typhon soufflait que lorsque nous fûmes au centre : dans une tempête, la lame n’a aucun pouvoir contre un bateau, grand ou petit, qui se laisse naturellement dériver sous l’effet du vent et de la mer ; et si un grand navire embarque dans ces conditions, le bateau n’en souffre pas.
Notre gréement ramené à bord et solidement saisi sur le pont, il fallut nettoyer la cabine. Naturellement, tout était imprégné d’eau de mer et d’huile de poisson. On parle de l’odeur des œufs pourris : cela ne se compare pas avec l’huile de poisson ! Toute notre literie en était saturée, et il fallut la transporter sur le pont, et nous en passer. Seules, à bord de tout le bateau, nos allumettes étaient sèches, car nous les conservions dans des bouteilles bien bouchées. Notre poêle était semblable à celui que j’avais à bord de Tilikum et, comme l’ancre flottante, il n’avait jamais failli à sa tâche. Il est vrai que dans le cas présent, l’ancre flottante avait manqué à son devoir ; mais le poêle, bien qu’ayant été culbuté et roulé, dans la cabine, était là, fidèle au poste, si bien qu’en très peu de temps nous pûmes faire bouillir de l’eau et nous préparer une bonne tasse de café, qui nous remit tous trois d’excellente humeur.
C’était la première fois, au cours de ma navigation à bord de petits bateaux, que j’étais forcé, par le mauvais temps, à ne pas suivre mon horaire régulier des repas.
Le baromètre restant stationnaire, nous étions certains que la renverse n’était pas loin. Nous ne nous trompions pas, car en moins d’une demi-heure, nous étions dans la deuxième phase. Pendant quatre heures, le vent souffla très violemment de l’Ouest, mais maintenant qu’il était démâté, notre petit bateau prenait cela comme une partie de plaisir. Peu de temps après la renverse, le baromètre commençait à remonter, et à minuit il avait atteint 725 mm. Pendant les 24 heures qui suivirent, le temps s’éclaircit graduellement, mais comme la mer et le gros vent d’Ouest ne mollissaient pas, il nous fut impossible d’entreprendre la moindre réparation.
Le 2 septembre débuta avec brise modérée et grosse houle d’Ouest ; notre bateau roulait et tanguait toujours, ce qui nous empêchait de réparer le grand mât ; mais ayant relié par une rousture un morceau du mât de tape-cul et le tangon du spinnaker, nous réussîmes, non sans difficultés, à le mettre en place dans l’emplanture du grand mât. En raison de son peu de solidité, ce mât de fortune ne pouvait guère permettre d’établir que le tourmentin. Pendant ce jour-là et la nuit suivante, nous eûmes brise fraîche du Sud-Ouest, et notre petite voilure nous permit de marcher dans le Nord-Nord-Ouest à la vitesse de 1 mille et demi à l’heure. Nous étions alors à trois cent cinquante milles de Yokohama.
Le 3 septembre, il soufflait petite brise de Sud-Ouest. À l’aube, elle mollit encore, et comme la mer était plate, nous entreprîmes immédiatement d’évaluer les avaries, et de les réparer dans toute la mesure de nos moyens. Notre inspection nous révéla que le grand mât avait été brisé au ras du pont, et à un mètre environ au-dessous du capelage ; le gui de grand’voile était cassé à 1 m. 20 de l’amure ; le mât de tape-cul, à 1 m. 50 au-dessus du pont, et juste sous le capelage. Le gréement et les lattes de haubans étaient en bon état : les deux mâts avaient été brisés et emportés par la seule force du vent. La mèche du gouvernail était cassée à hauteur de la partie supérieure du safran. Quant à la coque, elle était intacte.
Les dimensions du grand mât étaient : longueur du pont au capelage : 6 m. 65 ; diamètre à la cassure inférieure : 12 cm ; diamètre à la cassure supérieure : 11 cm. Longueur du mât de tape-cul, du pont au capelage : 4 m. 57 ; diamètre à la cassure inférieure : 10 cm.; diamètre à la cassure supérieure : 10 cm.; diamètre au capelage : 76 mm.
Les deux mâts étaient en pin du Japon, et au moment où ils furent brisés, le bateau était en travers au vent et à la mer, avec une gîte d’environ 45°. J’aimerais maintenant savoir quelle pouvait être la force du vent au moment où les mâts se rompirent !
Ayant ensuite dégagé le pont du gréement, des manœuvres et des voiles qui l’encombraient, je présentai bout à bout les deux morceaux du grand mât, puis je me fis apporter quelques planches de pin d’un demi pouce d’épaisseur, prélevées sur le vaigrage Je les débitai en lames étroites, longues d’un mètre environ, et les clouai côte à côte autour du mât, puis les consolidai par cinq amarrages, bien souques, disposés à égales distances. C’est ce que l’on appelle jumeler un mât, et lorsque l’opération est bien faite, le mât doit être aussi solide qu’auparavant – ce qui fut alors le cas pour nous. Comme la cassure inférieure était très proche du pont, il n’était pas possible de la jumeler convenablement sans agrandir considérablement l’étambrai – ce que nous ne voulions pas faire -, je façonnai un tenon sur la partie inférieure du mât, ce qui, naturellement, le raccourcit de façon considérable. À 11 heures, nous avions fini, et le grand mât était paré à être mâté.
Depuis la fin du typhon, il n’avait été question, à bord de Sea-Queen, que de la remise en place du grand mât ; et nous avions éprouvé de telles difficultés à installer notre mât de fortune que mes deux jeunes camarades semblaient près d’y renoncer. Et lorsque je leur répétais que pour un équipage solide et entraîné comme nous étions, rien n’était plus facile, ils répliquaient que je me vantais, comme lorsque j’avais promis de manger leur poisson tout cru…
Le grand mât était sur le pont, avec son gréement en place, les poulies maillées, manœuvres passées, prêt à être guindé ; et nous procédâmes comme suit. Le mât de fortune fut d’abord enlevé, afin de disposer une bigue au moyen du grand gui et du tangon de spinnaker qui le composaient. Je réunis les deux espars, à leur partie supérieure, par un solide amarrage en portugaise ; puis j’aiguilletai le palan destiné à soulager le mât, ainsi que deux étais, à l’avant et à l’arrière. Les espars étant en place, j’envoyai un étai à l’extrémité du beaupré, et l’autre au bout de la queue de malet. Les pieds des espars furent solidement amarrés aux lattes de haubans. Notre bigue était alors si bien tenue qu’un typhon n’aurait pu la déplacer. La poulie inférieure du palan fut alors crochée au mât, à 2 m. 50 environ de son extrémité inférieure ; tout étant alors paré, le retour de Sea-Queen et de son équipage vers notre Mère la Terre s’annonçant favorablement, je m’adressai en ces termes à Mr Stone :
Dites-moi, Mr Stone, avant d’installer notre mât, j’aimerais avoir confirmation de votre promesse de l’autre jour. Vous vous rappelez sans doute qu’au moment où les mâts ont été emportés, dans le typhon, vous avez parlé d’offrir un dîner au Champagne à l’équipage si jamais nous revenions à terre. Je serais heureux de savoir si cette promesse est toujours valable.
Soyez certain que je tiendrai parole, affirma-t-il.
Mr Vincent, dis-je, vous avez bien entendu?
Oui, dit Vincent, et je veillerai à ce qu’il s’exécute!
Hissez, main sur main ! criai-je alors, et le mât se mit à monter.
Les deux espars composant la bigue étaient trop courts pour que l’on puisse tenir le mât suspendu en équilibre, et nous avions dû disposer le palan de façon telle que l’extrémité inférieure du mât vienne juste à toucher le pont lorsqu’il serait hissé. De sorte que lorsque le palan fut pesé à bloc, la pomme du mât reposait sur l’arrière du bateau, tandis que sa partie inférieure dominait l’étrave. À ce moment précis, le bateau se mit en travers à la houle, et commença de rouler, ce qui ne simplifiait pas la manœuvre ; aussi, au moyen de nos avirons, fallut-il d’abord nous mettre debout à la lame ; puis, à l’aide d’un filin amarré à l’extrémité inférieure du mât et que l’on embraqua à la demande, le mât se trouva en place en moins de temps que je n’ai mis à l’écrire. Ce fut un grand soulagement pour l’équipage du petit bateau, que de le voir mâté à nouveau. Naturellement, ce mât était raccourci d’un bon mètre, et le jumelage, sous le capelage, lui donnait l’aspect d’une jambe de cheval maintenue par des attelles. C’était un mât, cependant ; assez grand et assez solide pour nous ramener à terre.
Il y avait encore du brandy dans notre coffre à médicaments, et nous aurions certainement arrosé l’événement ; mais il restait encore beaucoup à faire avant de pouvoir établir une voilure, et nous nous contentâmes d’un casse-croûte, sur le pouce.
Il fallut raccourcir le gréement dormant, puis le raidir ; il fallut jumeler le grand gui, réparer la grand’voile, qui avait été déchirée, ainsi que le foc. Pour remettre le gouvernail en état, je passai deux filins sur l’arrière du safran, chacun d’eux faisant retour en abord et venant s’amarrer sur la barre. Le mât de tape-cul, étant brisé en quatre endroits, n’était pas réparable ; à 4 h. 1/2, notre travail terminé, Sea-Queen était paré à faire voile à nouveau. Vincent, qui s’était consacré à la cuisine toute la journée, et nous donnait de temps à autre un coup de main quand nous avions besoin de lui, nous appela alors :
Ho! les matelots! descendez donc par ici, une tasse de café numéro un vous attend !
Comme le temps était beau et calme, nous rejoignîmes le maître-coq dans la cabine ; et tout en buvant une tasse d’excellent café et en fumant nos pipes, on décida de revenir à Yokohama, distant d’environ trois cent vingt milles.
Une demi-heure plus tard, une légère brise se leva du Sud-Ouest, accompagnée de bruine, de sorte que je pus faire établir le foc et la grand-voile avec un ris. Sous cette voilure, par brise modérée, Sea-Queen taillait sa route comme si rien ne s’était passé… Le gouvernail, lui aussi, fonctionna aussi bien qu’auparavant. Le seul inconvénient était le persistant parfum d’huile de poisson qui imprégnait la literie et nos vêtements, car tout était saturé, imbibé de cette huile horrible ; et comme il n’y avait aucun moyen d’éliminer cette odeur, il nous fallut tout jeter par-dessus bord. Il ne nous resta que deux couvertures pour le couchage de l’équipage ; et elles dégageaient un tel fumet que nous les tenions à bonne distance. Pour essayer de les nettoyer un peu, je les amarrai à un filin et les mis à la traîne derrière le bateau. Dans la soirée, comme il faisait froid, Stone s’étendit sur les planches nues d’une des couchettes, affirmant qu’il lui serait égal de coucher sur la dure s’il avait seulement de quoi se couvrir. Il y a une poêle à frire près du fourneau, suggéra Vincent, pourquoi ne pas l’essayer ?
Les couvertures trempèrent ainsi dans le sillage pendant vingt-quatre heures ; mais comme leur puanteur ne diminuait pas, nous considérâmes le cas comme incurable, et je coupai le filin.
Le 4 septembre, nous eûmes brise de Sud-Ouest modérée, avec pluie et temps couvert. Le ciel se dégagea pendant la matinée, et à midi, ayant pris la hauteur du soleil, je calculai que nous étions à 240 milles au Sud de Yokohama. Comme notre chronomètre avait été mis hors d’usage pendant le typhon, et qu’un fort courant portait au Nord-Est, je n’étais pas sûr de notre longitude ; aussi le vent venant du Sud-Ouest, je conservai le cap au Nord-Ouest, pour faire route vers la terre. Les deux jours suivants, le temps resta sensiblement le même, et nous fîmes route au Nord sous voilure réduite, priant Dieu de nous envoyer du beau temps.
Jusqu’au milieu du lendemain, un vent violent de Sud-Ouest s’accompagna de grosses lames et de gros grains de pluie. Je pris la cape avec deux ris dans la grand-voile et le tourmentin traversé au vent ; sous cette voilure, notre petit bateau se soulageait sur les grosses lames comme une mouette. Dans l’après-midi, le vent mollit et le temps se leva. Il était à peu près trois heures, et je venais de larguer les ris de la grand-voile ; par bonne brise d’Ouest, le bateau courait vers la terre ; j’étais assis dans le cockpit, à la barre, lorsque, tournant la tête du bord du vent, je crus sentir la terre.
Terre ! criai-je aussitôt. Et mes deux compagnons, qui étaient étendus sur les planches des couchettes, bondirent dans le cockpit, très excités, demandant :
Où est-elle ?
Je ne la vois pas encore, mais je la sens ! leur affirmai-je. Mes deux amis ayant, l’un comme l’autre, été largement servis lors de la distribution de l’appendice nasal, pointèrent leur nez dans le vent. Après avoir reniflé quelques minutes, Vincent, d’un ton désappointé, me dit :
Je ne sens rien du tout.
Moi non plus, ajouta Stone.
Oui, reprit le premier. Et je veux bien manger mon chapeau si qui que ce soit est capable de sentir la terre d’ici.
Là-dessus, ils disparurent tous deux dans la cabine.
Le temps était parfaitement clair, aucune terre n’était en vue, et je commençais à douter de mon olfaction. Vingt minutes plus tard, cependant, je vis une libellule voler autour du bateau, cherchant à se poser. La présence de ces insectes est un signe infaillible que la terre n’est pas loin. Et comme si cette preuve ne suffisait pas j’aperçus un peu plus tard un oiseau terrestre, ce qui me rassura complètement.
N’ayant pas vu le soleil depuis le 4 septembre, il était bien difficile de calculer notre position à moins de cent milles près. D’après notre estime, nous devions nous trouver dans le voisinage de l’île d’Oshima. C’est une terre très haute, visible à cinquante milles. Cependant, malgré le temps bien clair, aucune terre n’était en vue, ce qui m’intrigua beaucoup. Néanmoins, je gardai le cap au Nord-Ouest.
Peu après le coucher du soleil, le vent d’Ouest se mit à forcer, le temps prit mauvaise apparence, si bien que, la nuit étant très noire, je mis à la cape jusqu’au lendemain matin. L’état du temps nous menaçait d’une nouvelle tempête ; à minuit, le vent força encore, accompagné de pluie violente ; cependant, une demi-heure plus tard, le vent mollissait, et le ciel s’éclaircit. À 1 heure, il faisait calme plat, et à part une brume dense à l’horizon, le ciel était clair. Pendant mon quart, je crus entendre un léger grondement. Je tendis l’oreille, mais, par l’effet du roulis, les voiles battaient, et leur bruit m’empêcha d’entendre. J’amenai immédiatement la voilure, et en appliquant mon oreille contre le pont, je pus distinguer nettement que ce sourd grondement était produit par des brisants, et en conclus que nous n’étions pas à plus de cinq milles de terre.
Le reste de la nuit fut beau et calme ; Stone prit le quart à 4 heures. À 5 heures, le jour commença à poindre, et presque immédiatement, d’une voix qui fit trembler le petit bateau de l’étrave et l’étambot, il hurla :- Terre !
En montant sur le pont, je vis, dans l’Ouest, le sommet d’une haute montagne émergeant d’une brume épaisse. Ce n’était qu’un petit coin de terre, mais après toutes nos vicissitudes, c’était un spectacle très réconfortant, et pour témoigner notre gratitude nous nous inclinâmes tous trois, en disant :
Bonjour, notre Mère la Terre… Nous sommes vraiment très heureux de vous revoir !
Le calme se maintint jusqu’à sept heures ; une légère brise vint alors du Sud, la brume se leva, et je reconnus l’île Oshima, qui se trouve à soixante milles de Yokohama. Je fis donc route sur la baie de Tokyo, et comme le vent se mit à forcer, je me sentis certain d’arriver à Yokohama dans la nuit. Le temps restait clair et beau, comme pendant l’après-midi précédent, et l’on aurait pu croire que par une telle journée les montagnes seraient visibles d’au moins 50 milles ; mais nous n’étions pas à 12 milles que l’île s’enveloppa à nouveau de la même brume que la veille. Lorsque j’avais vu la libellule et l’oiseau, nous n’étions pas à plus de 15 milles de l’île. Naviguant avec brise fraîche du Sud, nous aurions dû, à midi, nous trouver près de la côte de Boshu ; mais, à notre grande surprise, une haute montagne s’éleva hors de la brume, à six milles environ par notre travers, à bâbord ; et, cette fois, c’était Oshima ; ce que nous avions aperçu le matin était, l’île Miyake. Cependant nous étions maintenant dans la bonne route, et comme le vent venait du Sud, nous serions certainement à Yokohama dans le courant de la nuit. À trois heures, Oshima étant à 12 milles sur notre hanche bâbord, et la côte de Boshu commençant d’apparaître par notre bossoir tribord, la brise mollit, et sauta au Nord-Est – ce qui n’allait pas du tout avec les désirs de l’équipage de Sea-Queen. Plus tard dans l’après-midi, le temps prit mauvaise apparence, le vent forçant à mesure, et je fis route sur le port de Habu, dans l’île Oshima. L’entrée de ce port est très étroite, et la nuit étant tombée avant que nous n’ayons atteint la terre, je pris la cape sous voiles pour la nuit. Le lendemain matin à l’aube, par fort vent de Nord-Est, je gouvernai sur le port de Habu. En approchant de terre, le vent mollit, et un fort courant portant au Sud-Ouest nous emmena jusqu’à l’île Toshima, à 10 milles dans le Sud-Ouest de Habu. Pendant toute cette journée et toute la nuit suivante, nous eûmes temps bouché, avec grains de pluie. Le courant était maintenant contre nous ; mais en profitant des grains violents qui nous tombaient dessus de temps à autre, et venaient des quatre coins du compas, nous arrivâmes à approcher de l’entrée du port de Habu, où nous nous trouvions le lendemain 10 septembre, à 10 heures du matin ; une heure après, nous étions mouillés en toute sécurité.
Le village avait été balayé par le typhon que nous avions traversé, et les plus vieux habitants nous assurèrent que c’était le plus violent qu’ils aient jamais vu. Il avait non seulement ravagé la ville, pais aussi déraciné des arbres, et coulé un vapeur de 2 400 tonnes, avec ses 40 hommes d’équipage ; et cependant Sea-Queen était passé dans le centre du typhon, et ramenait son équipage à terre, sain et sauf.
Après toutes les misères que nous avions supportées, quel était notre état physique ? Vincent était en excellente santé ; quant à moi, je m’étais fait, pendant le typhon, une profonde entaille à la jambe gauche, et n’ayant pu la soigner convenablement, la blessure avait mauvais aspect lors de notre arrivée à Habu ; mais ensuite elle se guérit rapidement. Stone était le plus malade. Lorsque le bateau chavira, il se trouvait à l’avant de la cabine, là où étaient placés notre gramophone ainsi qu’une lourde boîte contenant notre attirail de photographie ; et lorsque le bateau se retourna, tous ces objets se mélangèrent intimement avec le malheureux Stone, pendant que Sea-Queen faisait le tour. Stone me dit ensuite qu’à ce moment, il régnait dans la cabine une obscurité totale ; le gramophone et la boîte voltigeaient dans toutes les directions, attaquant Stone avec leurs angles et leurs arêtes aiguës, meurtrissant ses côtes et toute son anatomie. Ses blessures, comme la mienne, n’ayant pas été soignées, s’étaient encore aggravées lors de notre arrivée à Habu. Nous commencions à considérer le cas de Stone comme désespéré ; aussi, lorsque le médecin japonais de Habu nous apprit qu’il valait encore la réparation, l’équipage accueillit-il cette nouvelle avec joie.
Après quelques jours passés à Habu, nous fîmes route, sous notre voilure de fortune, sur Yokohama, où nous arrivâmes sans encombre. Et Stone remplit ponctuellement sa promesse : la croisière de Sea-Queen fut célébrée par un mémorable dîner au Champagne.
Capitaine Voss. Aventures de mer. Sea Queen et le typhon. Traduction de Paul Budker. Éditions maritimes et coloniales Paris 1953
18 09 1912
Belgrade sent la guerre : Sur le pont de Belgrade, je vis les longues files de réservistes et de civils portant les brassards de la Croix-Rouge et j’entendis, de la bouche même des députés, journalistes, paysans et ouvriers, qu’aucun retour en arrière n’était possible et que la guerre éclaterait bientôt, que ce n’était plus qu’une question de jours. Je reconnus plusieurs personnes dont le visage m’était familier – hommes politiques, rédacteurs en chef, lecteurs – et qui se trouvaient déjà au front, en armes, sachant qu’il leur faudrait tuer et mourir. Alors la guerre, cette abstraction que j’avais imaginée en pensée et dans mes articles, me parut invraisemblable et impossible.
Léon Trotski, correspondant de guerre pour Kievskaïa Mysl
8 10 1912
La volonté de libération des Slaves balkaniques – dits encore Slaves du sud – est de plus en plus manifeste : des traités d’alliance ont été signés entre la Bulgarie, la Serbie, la Grèce et le Monténégro. La proie est la Macédoine ou Turquie d’Europe, peuplée de Bulgares, de Serbes et de Grecs. Le Monténégro déclare la guerre à la Turquie.
17 10 1912
La Turquie attaque la Bulgarie, la Serbie et le Monténégro.
24 10 1912
Les Serbes écrasent les Turcs à Koumanovo, puis à Monastir le 18 novembre, tandis que les Grecs s’emparent de Salonique le 8 novembre. De leur coté, les Bulgares remportent les plus grandes victoires, d’abord à Kirk-Kilissé, en Thrace orientale, le 24 octobre, puis à Lüleburgaz, près d’Andrinople, le 2 novembre, et enfin à Andrinople qui sera prise le 24 mars au bout de quatre mois de siège.
Après avoir séparé les vivants des morts, on tria les blessés. Les cas graves furent laissés non loin des champs de bataille de Kirkilios, Yambol et Filippopol, tandis qu’on transportait les blessés légers, ici, à Sofia, où nous n’avons quasiment que des blessures bénignes : jambes, bras, épaules.
Mais ces soldats n’ont pas le sentiment d’avoir été légèrement atteints. Encore sous le coup des explosions et de la fumée des combats qui les ont estropiés, ils ont l’air de sortir d’un autre monde, mystérieux et terrible. Ils ont perdu les pensées et les sentiments qui les auraient portés au-delà de la bataille qu’ils viennent de vivre. Ils en parlent et en rêvent pendant leur sommeil.
Léon Trotski, correspondant de guerre pour Kievskaïa Mysl, 31 10 1912
28 11 1912
Ismail Qemali proclame l’indépendance de l’Albanie ; il en sera le premier ministre jusqu’en 1914.
11 1912
Alexis Carrel, chirurgien et biologiste, reçoit le prix Nobel de physiologie et médecine. Ses sympathies de l’entre deux guerres iront plutôt vers Philippe Pétain, Charles Lindbergh, que vers Jean Jaurès ou Léon Blum, et il tiendra quelques propos prônant l’eugénisme qu’auraient approuvé en totalité les nazis. L’Homme, cet inconnu, sorti en 1935, connaîtra un immense succès.
3 12 1912
Des pertes très lourdes chez les Bulgares, auxquelles s’ajoutent le typhus et le choléra, conduisent à un premier armistice conclu sans les Grecs. Le bilan de ces guerres balkaniques est très lourd pour l’empire ottoman, qui perd Salonique, Edirne [l’ancienne Andrinople], l’Albanie, l’Épire, la Macédoine et presque toute la Thrace.
La surface du royaume de Serbie passe de 48 300 km² à 87 780 km² et sa population augmente de plus d’un million et demi d’habitants. La conquête du Kosovo, territoire mythique de la poésie nationale serbe, donne lieu à de grandes réjouissances, et comme l’ouest de la Serbie a désormais une frontière commune avec le Monténégro ; la perspective d’obtenir un accès permanent à la côte adriatique en contractant une union politique avec ce voisin se rapproche. De plus, la façon dont la Serbie a conduit cette guerre semble prouver que des années d’investissements militaires, financés par des prêts français, n’ont pas été vaines [en septembre 1913, un nouveau prêt d’importance est consentie à la Serbie par un consortium de banques françaises]. Moins de trois semaines après le début de la mobilisation, trois cent mille soldats étaient opérationnels.
Christopher Clark. Les somnambules. Flammarion 2013
Et pourtant… les Albanais, ou descendants des Macédoniens, sont encore aujourd’hui les meilleurs soldats de l’empire ottoman, et leur courage ne le cède en rien à celui des plus braves soldats de l’Europe civilisée.
M.E. Jondot Tableau historique des nations. 1808
6 12 1912
Ludwig Borchardt découvre à Tell el Amarne, en moyenne Égypte, le buste de Néfertiti, qui part au Neues Museum de Berlin en 1913 muni de la bénédiction française du service des antiquités du Caire, alors dirigé par Gaston Maspero, directeur de l’Institut français d’archéologie orientale. Était alors en vigueur la pratique du partage à moitié exacte, instaurée par la précédente autorité britannique. Maspero avait grandement favorisé les fouilles intensives, et ses arguments ne manquaient pas de pertinence : La réforme introduite depuis 20 ans dans le système de l’irrigation a rendu à la culture des vastes étendues de terrain qui étaient arides depuis des siècles : l’eau y a été versée en abondance, imprégnant les objets qui y étaient enfermées, et les emplacements archéologiques ont été exploités avec tant d’ardeur qu’ils sont à la veille de disparaître. Si, dans le quart de siècle qui a commencé vers 1900, les sites antiques attaqués par l’industrie moderne n’ont pas été explorés à fond, je n’hésite pas à déclarer que leur contenu entier de papyrus, bronzes, statues en pierre ou en métal, terres cuites, étoffes, ustensiles, armes, outil, amulettes, sera perdu pour la science. Comme ils se comptent par centaines, ce ne serait pas trop d’une levée en masse des érudits pour venir à bout d’eux dans un espace de temps aussi restreint : nous avons donc sollicité la recherche, et je suis heureux de constater que notre intention a été comprise.
Et de fait, de 1900 à 1912, les campagnes de fouilles auront été multipliées par quatre.
Ludwig Borchardt avait fait preuve en l’occurrence d’un grand talent diplomatique : il était alors probablement le seul à avoir eu des yeux neufs pour Néfertiti – il écrivait dans son journal personnel : inutile de la décrire, il faut la voir. Mais dans ses rapports, il faisait preuve d’une prudence calculée : Aujourd’hui encore, il est impossible d’avoir une idée claire de l’importance et de la valeur des différentes pièces. De longues années d’étude seront encore nécessaires pour en juger correctement. Ce faisant il jouait sur du velours, car l’art de la période de la révolution armanienne – le passage au monothéisme voulu par Akhenaton, Armana étant son premier nom – était alors perçu comme barbare, rustique, sans finesse. On ne peut s’empêcher de penser au mot que Rabelais prête à Gargantua : Le temps était encore ténébreux et sentant la calamité des Goths. Maspero dut dire à Borchardt : vous voulez Néfertiti… prenez-là donc, j’en aurai d’autres, bien plus belles ! …
Mais la mariée pourrait bien être trop belle, et ce buste de Néfertiti être un faux : l’historien suisse Henri Stierlin a enquêté sur le sujet pendant plus de vingt ans et se demande comment le buste d’Akhenaton découvert en même temps, peut avoir été totalement défiguré par le temps quand celui de Néfertiti serait resté intact ? Pourquoi encore Ludwig Borchardt refusa systématiquement de le montrer au public pendant 12 ans, et pourquoi encore fréquentait-il donc assidûment un faussaire ?
vrai ? faux ? faux ? vrai ?


1912
Ferdinand Cheval, facteur de son état, termine son Palais Idéal, à Hauterives, Isère : commencé en 1879, il lui a fallu 10 000 journées pour le terminer. Il se reposera un peu puis s’attellera à un autre chantier, pendant huit ans : son tombeau. C’était un jour du mois d’avril, en 1879, en faisant ma tournée de facteur rural, à un quart de lieue avant d’arriver à Tersanne. Je marchais très vite, lorsque mon pied accrocha quelque chose qui m’envoya rouler quelques mètres plus loin. Je voulus en connaître la chose. Je fus très surpris de voir que j’avais fait sortir de terre une espèce de pierre à la forme si bizarre, à la fois si pittoresque que je regardais autour de moi. Je vis qu’elle n’était pas seule. Je la pris et l’enveloppais dans mon mouchoir de poche et je l’apportais soigneusement avec moi, me promettant bien de profiter des moments que mon service me laisserait libre pour en faire une provision. À partir de ce moment là, je n’eus plus de repos matin et soir…
En 1921, 3 ans avant sa mort, – il a 83 ans -, il déclare : Rien ne me fait plus plaisir de savoir que j’ai pu vivre jusqu’à l’achèvement de mon travail. Je n’ai jamais eu un jour de maladie grave de ma vie. Il est vrai que j’ai toujours été un travailleur acharné vivant très sobrement. J’ai consommé peu de viande, par plus de deux fois par semaine en moyenne, mais des quantités de pommes de terre, de haricots et de verdure. Pas un jour ne se passe sans que j’ajoute un oignon ou un peu d’ail à ma nourriture. Je mange beaucoup de pain. Quant à la boisson, un petit peu de vin rouge mélangé à un verre d’eau m’a toujours maintenu en bonne santé.
Quand un visiteur lui demande où il a pris l’idée de mettre des tiges de fer au cœur des fragiles et nombreuses tourelles pour les consolider, il répond simplement : j’ai réfléchi. Le palais du facteur Cheval sera classé Monument Historique [1] par André Malraux en 1969, – surtout pour que puissent être débloqués les fonds qui permettront de le consolider -, comme étant le seul exemple en architecture de l’Art naïf, non sans quelques violentes oppositions au sein de la commission chargée d’instruire le dossier : Le tout est absolument hideux, affligeant ramassis d’insanités, qui se brouillaient dans une cervelle de rustre. Mieux vaut ne pas parler d’art. Mais c’est la réflexion d’un touriste américain qui emportera la décision : maintenant que nous avons vu le palais du facteur Cheval, allons voir Versailles !
À sa mort, on retrouvera une lettre post-mortem à Alice, sa fille chérie morte à 15 ans :
Alice, ma fille chérie,
Il faut encore que je passes quelques bons moments avec toi.
Tiens, aujourd’hui, je vais te parler de mes cailloux, car je sais bien qu’un jour ou l’autre, si tu étais restée plus longtemps avec nous, tu m’aurais posé la question : dis papa, pourquoi les cailloux que tu rapportes sont-ils presque tous lisses et d’une forme arrondie ? Quelquefois seulement, on dirait des gâteaux avec des couches de différentes couleurs.
Quand j’ai commencé à ramasser ces cailloux, je ne savais rien de leur histoire. Et puis un jour, un monsieur de Grenoble est passé par là, voir le chantier de ton palais, et m’a dit qu’il était géologue ; j’ai arrêté le travail et lui ai demandé de me raconter cette histoire, sans trop entrer dans les détails.
Elle est très vieille, cette histoire, de plusieurs milliards d’années. Comme c’est difficile de s’imaginer des milliards d’années, on va prendre une image en disant qu’elle tient dans la durée d’une année. Le 1° janvier c’est la formation du système solaire, – le soleil et ses planètes : tu les as déjà vus ou bien je t’en ai déjà parlé. Les premières bactéries – les bactéries sont la première manifestation de la vie – apparaissent le 23 mars. Les premiers êtres multicellulaires, c’est-à-dire regroupant plusieurs cellules, le 15 novembre. Et notre ancêtre, juste avant que l’on devienne des hommes, – elle s’appelle Lucy -, arrive seulement le 31 décembre, en début de soirée. Et pour revenir à nos cailloux, ils commencent à avoir une histoire seulement vers le 20 novembre.
Tu sais lire car tu as appris que le rangement dans un certain ordre des lettres de l’alphabet donnait des mots, qui ont une signification et qui, eux-mêmes rangés dans un ordre dont les règles sont données par la grammaire, donnait des phrases – on appelle cela le langage – permettant d’exprimer une pensée. Eh bien, j’aimerais bien que tu apprennes à lire aussi un paysage, car là aussi, il y a une certain type de rangement qui permet d’expliquer pourquoi il est comme ça et pas autrement : c’est ce que l’on appelle la géomorphologie.
Tous les paysages sont le résultat de deux types de forces : les forces qui construisent et les forces qui détruisent. Les premières sont nommées orogénèse, quand la rencontre des plaques crée une surrection – élévation – ou une subduction – enfoncement – ; le volcanisme, les failles font aussi partie de l’orogénèse. Le deuxième type de forces, celle qui détruisent se nomme l’érosion, c’est-à-dire l’usure, qui a en gros, trois origines : le vent, l’eau des mers et des rivières, et les glaciers, qui sont de l’eau gelée qui avance aussi, quand il est sur une pente, mais à une vitesse beaucoup moins élevée que l’eau des fleuves et des rivières. Pendant les périodes de glaciation, ils recouvraient des surfaces incroyablement plus étendues qu’aujourd’hui.
Pour revenir à l’histoire des cailloux, il faut commencer par deux ou trois choses avant tout. La terre est une grosse boule, et plus tu vas vers l’intérieur plus il fait chaud, à tel point que même les cailloux n’y ont pas du tout l’aspect que tu leur connais car ils sont complètement fondus par des températures que tu ne peux pas imaginer : c’est le magma.
Donc, vers le 20 novembre, les continents n’avaient pas du tout la forme qu’ils ont aujourd’hui, c’était une seule masse et avec de l’eau tout autour. Mais de l’intérieur de la terre venaient des coups terribles qui ont fracturé ce continent en plusieurs morceaux, et cela a duré des millions d’années. Parfois même, quand la croûte de la surface était fragile, le magma perçait directement, et la lave sortait à l’air libre : on appelle cela les volcans : il y en a eu dès le début de l’histoire de la terre. Quand ces morceaux se rencontraient, ils se heurtaient de front et cela faisait surgir des montagnes. Les premières sont la chaîne hercynienne : il y en a quelques restes chez nous, en Bretagne, mais il y en a aussi en Amérique et en Sibérie… Beaucoup plus tard, vers le 10 décembre, sont sorties nos montagnes actuelles, l’Himalaya, au nord des Indes, les Alpes, les Pyrénées. D’autres fois, ces morceaux – c’est le mot plaque qui est le terme précis – se montaient les uns sur les autres, un dessus et l’autre dessous, et cela créait des failles, c’est-à-dire des ruptures dans la continuité, comme si tu coupais un gâteau et que tu mettais les tranches n’importe comment ; d’autre fois encore, cela entraînait un plissement de la partie supérieure de l’écorce terrestre et cela donne ces formes plissées que l’on appelle anticlinal et synclinal, comme un tapis dont on repousse les deux extrémités l’une vers l’autre.
Mais dans tout cela, ce qui occupait le plus de place, c’est l’eau, les océans dans lesquels vivaient des quantités fantastiques de mollusques (ammonites etc ) qui transportaient leur maison toujours avec eux ; ces maisons, c’était leur coquille et quand ils mouraient, leur coquille restait sur le fond des océans, en formant un tapis de plus en plus épais, au fur et à mesure du temps qui passe. Ce tapis se détruisait en devenant un limon, et, quand la mer s’est retirée, ce limon est devenu une roche sédimentaire, le calcaire dont est faite la montagne que tu vois d’ici, au sud-est : le Vercors. C’est aujourd’hui une montagne, parce que les forces qui s’opposent entre les plaques l’ont fait surgir, mais auparavant c’a été le fond d’un océan. La formation de ce calcaire n’est évidemment pas rapide : en moyenne 2 millimètres par siècle !
Pour revenir à notre histoire, il faut parler aussi du climat dont les variations ont été très très grandes. Il y a eu des périodes où tout n’était que glace, des périodes où il faisait chaud presque partout. Et puis, le plus grand continent des débuts, n’était pas du tout là où il est aujourd’hui : le sud de l’Algérie était au pôle sud : tu t’imagines ! Et après le surgissement des montagnes au bord desquelles on se trouve, c’était vers le 10 décembre, sont arrivées cinq périodes glaciaires qui ont vu alterner donc des périodes de grand froid avec des intercalaires de réchauffement. La commune où nous habitons a été entièrement recouverte de glace et cela s’est terminé le 31 décembre vers 21 heures. Tu vois que c’est tout près de notre présent. Au nord du Vercors, il y a la ville de Grenoble, et encore au nord, c’est la vallée du Grésivaudan : en bas, la vallée de l’Isère, bien plate, et de chaque côté, deux énormes marches d’escalier : la plus haute marche a été creusée par le glacier le plus ancien, puis il y a eu un réchauffement, et la vallée s’est installée dans son lit, très large. Puis il y a eu une autre glaciation, avec un glacier moins important qui a creusé une autre marche : et voilà le résultat !
Que se passait-il pendant ces périodes de réchauffement : les glaciers fondaient, les rivières étaient en crue et les deux transportaient beaucoup de cailloux, arrachés sur leurs rives. Ces cailloux étaient roulés les uns sur les autres et donc les arêtes vives disparaissaient pour prendre une forme arrondie ; on arrive à distinguer les galets transportés par des rivières de ceux transportés par les glaciers, car ces derniers ont des rayures dues aux frottements des cailloux les uns sur les autres ou sur le fond du glacier que l’on ne retrouve pas sur les galets de rivière. Quelquefois, je trouve aussi des cailloux calcaire, donc d’origine sédimentaire, mais c’est plus rare – c’est quand même en me cassant la figure sur un caillou calcaire que m’est venue l’idée de construire ton palais -. Le plus souvent ces cailloux sont en granit, venus de dessous l’écorce terrestre quand les Alpes centrales sont apparues. Ce granit, c’est la roche dont est constitué pour le plus gros le massif du Mont-Blanc, à plus de 200 km au nord-est.




sa tombe
Début 2019 sortira sur les écrans L’incroyable histoire du facteur cheval de Nils Tavernier, fils de Bertrand. Le facteur Cheval, c’est Jacques Gamblin, qui se livre là à un époustouflant numéro d’acteur : il s’est pénétré de la personnalité de ce personnage autiste, habité par une passion, en symbiose permanente avec l’univers : pas une seule fausse note. Jacques Gamblin a si bien compris le facteur Cheval qu’il a très bien restitué sa façon de marcher : il marche vite, très vite même, car il est pressé : sa tournée est longue – plus de 30 km – et plus tôt c’en sera fini, plus tôt il sera chez lui. En même temps, sa marche n’a rien à voir avec celle des coureurs d’aujourd’hui qui, eux, ne s’arrêtent jamais, car le facteur Cheval, qui sent à chaque instant qu’il est partie de l’univers, s’arrête de temps à autre pour jouir, se pénétrer de toute cette beauté. Marcheur mais aussi contemplatif, en communion naturelle avec la nature, les animaux, avec les hommes aussi, mais là, il ne sait pas leur dire.
Mme Jacquemart-André donne à l’Institut son palais musée du boulevard Haussmann et le domaine de Chalis, près d’Ermenonville : Je lègue à l’Institut de France mon domaine de Chalis avec ses bois, ses eaux, ses ruines, son château et sa chapelle afin de préserver pour tous les Français un lieu de beauté. Je défends de vendre, sous quelque prétexte que ce soit, aucune parcelle du domaine. Qu’il reste à jamais un des plus admirables paysages de France, à l’abri de la spéculation et de la prétendue civilisation moderne, qui souille, déshonore, détruit tout.
Née Cornelia Jacquemart en 1841 – elle n’aimait pas son prénom, qu’elle simplifia en Nélie – elle fut longtemps peintre portraitiste ; c’est en lui faisant précisément le portrait qu’elle fit la connaissance de son futur mari, Édouard André, très riche banquier protestant, originaire de Nîmes. De 1868 à 1875, Édouard André se fit construire un palais-musée, dont il confia les travaux à l’architecte Henri Parent. Rival de Charles Garnier qui l’avait emporté pour la construction de l’Opéra, il se trouva devant la situation rêvée pour tout architecte : de l’argent en veux-tu en voilà, une demande de magnificence et de grandiose. Et cela donne un palais splendide où le talent – un double escalier de toute beauté -, voisine partout avec l’ostentation, mélange plutôt rare chez les protestants, en principe plus portés sur l’austérité. On peut y voir de grandes pièces contiguës, dont les portes peuvent s’escamoter soit dans les cloisons qui les encadrent, soit dans le plafond, libérant ainsi un espace d’environ 1 000 m² pour les réceptions : on se rapproche de la machinerie d’un opéra. Un des plus manifestes déploiements de l’art du second empire. Le domaine de Chalis comme le palais du boulevard Hausmann sont aujourd’hui tous deux des musées André Jacquemart.
Aux Jeux olympiques de Stockholm, l’Américain Jim Thorpe, né dans une réserve d’Indiens Algonquins de l’Oklahoma, est salué par le roi de Suède comme le plus grand athlète du monde : il a remporté avec des performances stupéfiantes le décathlon et le triathlon ; c’est aussi un bien fameux footballeur. Accusé un peu plus tard de professionnalisme, il dût rendre ses médailles.

Calouste Gulbenkian, homme d’affaire arménien, a remis au sultan un rapport confirmant le potentiel pétrolier de la région : il parvient à associer l’Anglo-Persian Company, la Deutsche Bank et la Royal Dutch Shell dans la création de la TPC – Turkish Petroleum Company – qui se fait attribuer tous les droits pétroliers de part et d’autre de la voie ferrée Constantinople-Bagdad. Avec ses 5 % des bénéfices, il bâtira une fortune qu’il utilisera pour partie à créer la belle fondation Gulbenkian à Lisbonne.
En Suisse, au-dessus de la station de Wengen, mise en service du [petit] train le plus haut d’Europe, le Jungfraubahn, qui atteint 3 454 m à la Jungfraujoch. C’est 1893 qu’Adolf Guyer-Zeller, industriel zurichois, en a eu l’idée : le train existait alors, mais s’arrêtait à Kleine Scheidegg, à 2 061m. Les travaux débuteront en 1896. Le principal du parcours se fait en tunnel, avec un arrêt à Eigerwand, 2 865 m, et un autre à Eismeer, 3 160 m.



Niels Bohr, jeune physicien danois installé à Manchester pose les premières assises de la théorie des atomes, qu’il finalisera l’année suivante. Le modèle de Bohr, qui remplace celui de Rutherford, comprend un noyau pourvu d’une charge positive, entouré d’électrons tournant autour de lui. Les électrons en relation ne peuvent se déplacer que sur certaines orbites spécifiques, tout comme les planètes ne peuvent se mouvoir que sur des orbites précises autour du soleil. Lorsque l’atome reçoit de l’énergie, lorsqu’il est chauffé ou lorsqu’il reçoit des radiations électromagnétiques, l’énergie se concentre dans un de ses électrons ou se répartit entre plusieurs, provoquant leur saut immédiat sur d’autres orbites fixes plus éloignées du noyau. Après une infime fraction de seconde, ces électrons perturbés retombent sur leurs orbites d’origine ce qui provoque l’émission de radiations électromagnétiques. La longueur d’onde de cette énergie dépend de deux facteurs : le nombre d’orbites que sautent les électrons et la distance qui sépare ces orbites du noyau. Ainsi, la longueur d’onde peut se situer n’importe où à l’intérieur du spectre du rayonnement électromagnétique, entre les rayons Gamma et les rayons X, du coté des longueurs d’onde très courtes, jusqu’aux rayons infra rouges et aux ondes radio, du coté des très grandes longueurs d’onde en passant par le spectre de la lumière visible. Et comme les orbites occupent des positions bien définies, chaque atome possédera ses propres longueurs d’onde caractéristiques.
[…] La théorie de l’atome de Bohr permit également d’interpréter théoriquement la classification périodique des éléments chimiques, formulée pour la première fois par le chimiste russe Dimitri Mendeleïev. Cette classification présente les éléments chimiques disposés en fonction de leur poids atomique et range en colonnes verticales ceux dont les propriétés chimiques sont semblables. La modèle de l’atome de Bohr expliquait, pour la plupart d’entre eux, pourquoi ils devaient être disposés ainsi : les propriétés chimiques étaient dues au nombre d’électrons en orbite, lui-même lié à la charge électrique du noyau
Colin Ronan Histoire mondiale des sciences Seuil 1988
Aux États-Unis, le physicien d’origine autrichienne V. Hess mesure l’ionisation de l’air en altitude et met ainsi en évidence l’existence d’un rayonnement cosmique. Toujours aux É-U, E.V. Mc Collum et T.B. Osborn et découvrent la vitamine A. En France C. Fabry découvre l’existence dans la haute atmosphère d’une couche d’ozone protectrice des nuisances du rayonnement solaire.
Raymond Poincaré est président du Conseil, ce qui ne l’empêche pas de lancer son propre journal La Politique étrangère, pour éclairer les élites politiques françaises. De façon générale, et ce dans toute l’Europe, les rapports entre presse et politique sont tels que nombre de nos promiscuités malsaines, voire de nos scandales contemporains semblent des histoires d’enfants de chœur par rapport aux habitudes alors en vigueur.
La plupart des hommes politiques font une analyse pertinente et nuancée du rôle de la presse. Ils ont compris que la presse est volatile, sujette à des turbulences de courte durée et à des accès de frénésie soudaine. Ils voient que l’opinion publique est mue par des impulsions contradictoires, que ce qu’elle exige du gouvernement est rarement réaliste, qu’elle est, pour paraphraser Théodore Roosevelt, toujours prête à s’exprimer sans être prête à agir. Frénétique, l’opinion publique cède facilement à la panique, mais elle est également extrêmement inconstante. Il n’y a qu’à voir la façon dont l’anglophobie profondément ancrée de la presse française a fondu comme neige au soleil pendant la visite d’Edouard VII à Paris en 1903. Après être arrivés à la gare de la porte Dauphine, le souverain et sa suite descendent les Champs-Elysées sous les hués des Parisiens criant Vive Fachoda ! Vivent les Boers ! Vive Jeanne d’Arc ! Les manchettes des journaux sont hostiles, les caricatures insultantes. Cependant, en l’espace de quelques jours, le roi va gagner la sympathie de ses hôtes par des discours engageants et des remarques charmantes, aussitôt repris par les principaux journaux. De même en Serbie en 1906, la vague de colère qui s’empare de la nation à la suite du veto opposé par l’Autriche-Hongrie à une union douanière avec la Bulgarie retombe bien vite, quand les Serbes prennent conscience que le traité commercial proposé par l’Autriche-Hongrie leur est bien plus favorable qu’une union douanière avec la Bulgarie. L’Allemagne connaît également de soudaines fluctuations du sentiment public pendant la crise d’Agadir de 1911. Début septembre, une manifestation pacifique rassemble cent mille personnes à Berlin. Cependant, à peine quelques semaines plus tard, l’atmosphère n’est plus à la conciliation : au congrès d’Iéna, le Parti social-démocrate rejette l’appel à la grève générale en cas de guerre. L’inconstance de l’opinion publique se manifeste encore au printemps et à l’été 1914 : l’ambassade de France à Berlin note de soudains revirements dans la façon dont la presse serbe couvre les relations avec l’Autriche-Hongrie. Alors qu’en mars et avril, il y a eu de vigoureuses campagnes de presse contre Vienne, la première semaine de juin semble marquée par une atmosphère de détente et de conciliation assez inattendue des deux côtés de la frontière.
[…] Il demeure très difficile d’établir le lien qui existe entre l’opinion publique, constituée des élites éduquées ayant directement accès à la presse, et l’attitude qui prévaut dans les masses plus populaires. Les psychoses de guerre et le chauvinisme fournissent certes de bons articles, mais touchent-ils vraiment toutes les couches de la société ? D’où la mise en garde du consul général d’Allemagne à Moscou en 1912 : présupposer que la germanophobie agressive du parti belliciste russe et de la presse slavophile reflète l’état d’esprit de l’ensemble de la population serait une grave erreur, car les milieux politiques et journalistiques n’ont que des liens très ténus avec les réalités de la vie en Russie. Il ajoute que les articles traitant de ces questions dans les journaux allemands sont le plus souvent écrits par des journalistes qui ne connaissent guère la Russie et n’ont que fort peu de contacts en dehors d’une toute petite élite sociale. En mai 1913, le baron Guillaume, ambassadeur de Belgique à Paris, reconnaît qu’un certain chauvinisme fait florès en France : on l’observe non seulement dans les journaux nationalistes mais dans les théâtres et les cabarets qui proposent de nombreuses pièces de nature à surexciter les esprits. Mais, ajoute-t-il, le vrai peuple français n’approuve pas ces manifestations.
Tous les gouvernements, à l’exception de la Grande-Bretagne, ont des bureaux de presse dont la mission est de surveiller et d’influencer- là où cela est possible – la façon dont les journaux traitent des questions de sécurité nationale et de politique étrangère. En Grande-Bretagne, où le secrétaire d’État au Foreign Office ne semble pas éprouver le besoin de convaincre le public ni même de l’informer des mérites de ses décisions, il n’existe pas de tentatives officielles d’influencer la presse. De nombreux grands journaux y reçoivent certes de substantielles sommes d’argent, mais elles proviennent de personnalités privées ou de partis politiques plutôt que du gouvernement. Ce qui bien entendu n’empêche pas le développement d’un réseau très dense de relations informelles entre les ministères et les journalistes les plus influents. La situation est assez différente en Italie où Giovanni Giolitti, Premier ministre de 1911 à 1914, fait des versements réguliers à une trentaine de journalistes pour qu’ils soutiennent sa politique. En 1906, le ministère des Affaires étrangères russe se dote d’un office de presse et, à partir de 1910, Sazonov organise régulièrement des réunions à l’heure du thé où sont conviés les rédacteurs en chef les plus influents et les leaders de la Douma. Les relations entre les diplomates russes et certains journaux triés sur le volet sont si étroites qu’en 1911 un journaliste ira jusqu’à qualifier le ministère des Affaires étrangères de simple annexe du Novoïe Vremia. Jegorov, – rédacteur en chef, est souvent aperçu dans le bureau de presse du ministre et Nelidov, chef du bureau de presse et ancien journaliste, fréquente assidûment les bureaux du journal. En France, les relations entre diplomates et journalistes sont particulièrement intimes. La moitié ou presque des ministres des Affaires étrangères de la Troisième République étant d’anciens écrivains ou d’anciens journalistes, les lignes de communication entre ministres et journalistes sont pratiquement toujours ouvertes. En décembre 1912, alors qu’il est président du Conseil, Raymond Poincaré lance même son propre journal, La Politique étrangère, pour promouvoir ses idées auprès de l’élite politique française. Ce contexte général n’empêchait pas certains hommes de premier plan – Jules Cambon en l’occurrence – de prendre un peu de hauteur par refus d’être pris dans la mêlée des va-t’en guerre : Je voudrais bien que les Français dont la profession est de créer ou de représenter l’opinion voulussent bien observer la même discipline […] et qu’on ne s’amusât pas à jouer avec le feu en parlant de guerre inévitable. Il n’y a rien d’inévitable en ce monde.
Il existe d’autres instruments familiers de la diplomatie continentale tels les journaux semi-officiels, ou les articles inspirés insérés dans les journaux afin de tester les réactions de l’opinion publique. Les articles inspirés se présentent comme l’expression d’opinions indépendantes rédigées par des journalistes indépendants, mais leur efficacité dépend précisément de ce que les lecteurs soupçonnent qu’ils émanent du pouvoir. Par exemple, il est de notoriété publique qu’en Serbie, le journal Samouprava exprime les positions gouvernementales. En Allemagne, le Norddeutsche Allgemeine Zeitung est considéré comme l’organe officiel de la Wilhelmstrafie. En Russie, le gouvernement fait connaître son opinion par le biais de Rossia, journal semi-officiel, tout en lançant des campagnes de presse dans d’autres journaux plus populaires tels que Novoïe Vremia. Le Quai d’Orsay, comme son homologue allemand, rémunère des journalistes sur fonds secrets et cultive des liens étroits avec Le Temps et l’agence Havas, tout en utilisant Le Matin, journal réputé moins austère, pour lancer des ballons d’essai.
De telles interventions sont risquées et peuvent déraper. Une fois que l’opinion publique sait que tel journal publie régulièrement des articles inspirés, il peut arriver qu’un papier irréfléchi, tendancieux ou erroné soit pris pour le signal intentionnel d’un gouvernement. C’est ce qui arrive en février 1913 lorsque Le Temps publie un article basé sur des fuites non autorisées transmises par une source anonyme, révélant certains détails des délibérations du gouvernement sur le réarmement français – article qui suscite de furieux démentis officiels. En 1908, Izvolski, alors ministre des Affaires étrangères, a beau tenter de préparer l’opinion publique et la presse à la nouvelle que la Russie a approuvé l’annexion de la Bosnie par l’Autriche-Hongrie, ses efforts se révèlent totalement insuffisants pour contrer la violence de leur réaction. En Russie toujours, Novoïe Vremia se retournera contre Sazonov, en dépit des relations étroites que ce dernier a longtemps entretenues avec la rédaction, lorsque, tombant sous l’influence du ministre de la Guerre, le journal l’accuse de faire preuve de timidité excessive dans la défense des intérêts de la Russie. En Autriche, le scandale Friedjung éclate en 1909 lorsqu’on apprend que le ministre des Affaires étrangères Aehrenthal a pesé de tout son poids dans une campagne de presse menée contre des hommes politiques serbes et basée sur de fausses accusations de trahison. Le gouvernement est contraint de faire tomber la tête du chef du bureau de presse du ministère, avant de devoir à nouveau renvoyer son successeur à la suite du scandale Prochaska – à l’hiver 1912, des allégations de mauvais traitements infligés par des Serbes à un employé consulaire autrichien se révèlent également fausses.
Ce genre de manipulations officielles de la presse par les autorités politiques a également lieu d’un pays à l’autre. Début 1905, les Russes distribuent environ l’équivalent de huit mille livres sterling par mois à la presse parisienne dans l’espoir de stimuler le soutien de l’opinion publique en faveur d’un prêt financier important. Le gouvernement français subventionne des journaux en Italie (et en Espagne pendant la conférence d’Algésiras). Au cours de la guerre russo-japonaise et des guerres des Balkans, les autorités russes font parvenir des pots-de-vin très élevés à des journalistes français. Les Allemands disposent d’un modeste fonds pour soutenir des journalistes à Saint-Pétersbourg, et subventionnent régulièrement et grassement des rédacteurs en chef londoniens dans l’espoir, le plus souvent déçu, d’obtenir un traitement journalistique plus bienveillant.
Christopher Clark. Les somnambules. Flammarion 2013
Vers 1910, 1920 Hans Gerhard Creutzfeldt (1885-1964) et Alfons Jakob (1884-1931) établissent que les personnes atteintes de la maladie qu’ils ont étudié et à laquelle ils ont donné leur nom, sont en général des personnes âgées de plus de 60 ans, et appartiennent en général à des familles à risques, avec des antécédents médicaux du même type. La maladie est mortelle. Elle touche moins d’un homme sur un million.
Michelin offre des bornes de signalisation routière, et pour que cela soit cohérent, obtient la numérotation des routes départementales.
Dans l’Ulster, le nord-est de l’Irlande, les descendants des colons anglo-écossais du XVII° siècle se mobilisent contre le nouveau et timide projet de Home Rule inspiré par le Premier ministre libéral Asquith. Ils pétitionnent, lèvent une Ulster Volunteer Force de plusieurs milliers d’hommes, équipés en armes par l’Allemagne. Ils vont même jusqu’à désigner un gouvernement provisoire : c’est presqu’un coup d’état face auquel le gouvernement recule et leur accorde le droit de se soustraire au Home Rule : ce sont les premiers germes de la partition de l’Irlande.
_______________________________________________________________________________________
[1] C’est peut-être bien le seul monument historique de France que l’on encourage à toucher.
Laisser un commentaire