| Publié par (l.peltier) le 20 septembre 2008 | En savoir plus |
13 07 1915
Pour galvaniser le patriotisme, on décide d’exhumer le cercueil de Rouget de Lisle, l’auteur de La Marseillaise, du cimetière de Choisy le Roi, où il était mort pauvre et oublié, pour le transférer le lendemain, 14 juillet, au Panthéon.
28 07 1915
Depuis 1911, six chefs d’État se sont succédé à la tête d’Haïti. La proximité de cette instabilité fait peur aux États Unis, qui occupent l’île, dont l’économie va être gérée par la New York City Bank. Mais les Noirs se révoltent : emmenés par Charlemagne Péralte, les Cacos se réfugient dans le nord du pays. L’armée américaine mettra 3 ans à avoir raison d’eux, faisant 15 000 morts dans leur rangs.
2° vague de déclarations de guerre, dans les Balkans :
| 23 05 1915 | Italie / Autriche |
| 20 08 1915 | Italie / Turquie |
| 14 10 1915 | Bulgarie / Serbie |
| 16 10 1915 | Angleterre / Bulgarie |
| 17 10 1915 | France / Bulgarie |
| 19 10 1915 | Italie / Russie, Bulgarie. |
L’Italie a longuement hésité à passer du coté de l’Entente – France, Angleterre, Russie – et ce n’est qu’après avoir obtenu l’assurance que ce renversement d’alliance lui rapporterait le sud Tyrol, – la région de Bolzano -, l’Istrie et Trieste, qu’elle se rangera du coté des Alliés. Mais cette déclaration de guerre se déroule dans une très grande improvisation, décision prise entre trois personnes : le roi, le président du conseil Salandra et le ministre des Affaires étrangères Sonnino, dans le plus grand secret, quand, en fait, aucune puissance étrangère ne les y obligeait. Le pays n’était en fait pas du tout prêt pour assumer pareil effort : il manque à peu près de tout : céréales et matières premières, charbon et fer, produits fabriqués et machines. S’ensuivra un endettement rapide de l‘État, une hausse vertigineuse des prix et donc une aggravation du climat social.
21 08 1915
Le tzar Nicolas II prend la place du grand duc Nicolas de Russie, son oncle à la mode de Bretagne, à la tête de l’armée russe. Cela l’éloigne de son épouse et laisse de la place pour Raspoutine.
6 09 1915
Pierre Delbet, chirurgien très attentif aux techniques de l’asepsie, présente à l’Académie des Sciences les conclusions de son expérience sur les blessés du front qui mettent essentiellement en valeur les fonctions antiseptiques du chlorure de magnésium par la stimulation locale des globules blancs. Les surveillantes et les infirmières de son service en prennent toutes, enchantées de la sensation d’euphorie, d’énergie et de résistance à la fatigue qu’elles éprouvent. Selon le cas, il l’utilise en application externe ou interne par voie orale. Un siècle plus tard, le produit se révélera très efficace dans la lutte contre le virus Ebola quand il commencera à ravager la Guinée et ses voisins le Liberia et la Sierra Leone. Mais le contexte économique aura bien changé et les laboratoires pharmaceutiques se seront habitués à ce que la santé soit un marché juteux : aussi ne sera-t-il pas question d’administrer aux malades ce chlorure de magnésium, un produit qui rapporte aussi peu, puisque directement issu de l’eau de mer.
5 au 8 09 1915
Lénine anime une conférence des opposants à la guerre à Zimmerwald, en Suisse, au-dessus de Berne.
Les délégués s’entassèrent dans quatre voitures et se mirent en route pour la montagne. Les passants regardaient passer ce cortège insolite avec curiosité, et les délégués eux-mêmes faisaient remarquer avec humour qu’un demi-siècle après la fondation de la Première Internationale, il était encore possible de regrouper tous les internationalistes dans quatre chars à bancs. Mais ces badinages étaient exempts de tout scepticisme. Souvent le fil de l’histoire se rompt et, dans ce cas, il faut y faire un nœud. C’est aussi ce que nous nous apprêtions à faire à Zimmerwald. […] Ce brave Suisse (le patron de l’hôtel) déclara à Grimm que la valeur de son bien en allait être considérablement augmentée, et qu’en conséquence, il était tout disposé à verser une certaine somme au fonds de la III° Internationale. Je pense toutefois qu’il a du bientôt se raviser.
Léon Trotski. Moya zhizn
Les socialistes ont pour devoir […] de chercher à transformer la guerre impérialiste entre les peuples en une guerre civile des classes opprimées contre leurs oppresseurs, en une guerre pour l’expropriation de la classe des capitalistes, pour la conquête du pouvoir politique par le prolétariat…
Lénine
Des millions de cadavres couvrent les champs de bataille. Des millions d’hommes seront, pour le reste de leurs jours, mutilés. L’Europe est devenue un gigantesque abattoir d’hommes.
[…] Une chose est certaine : la guerre qui a provoqué tout ce chaos est le fruit de l’impérialisme. La guerre révèle ainsi le caractère véritable du capitalisme moderne qui est incompatible, non seulement avec les intérêts des classes ouvrières et les exigences de l’évolution historique, mais aussi avec les conditions élémentaires d’existence de la communauté humaine.
[…] Le droit des peuples de disposer d’eux-mêmes doit être le fondement inébranlable dans l’ordre des rapports de nation à nation.
Trotski, rédacteur de l’Appel de Zimmerwald.
L’hôte, Robert Grimm, chef de la social-démocratie suisse, pour obtenir l’autorisation de la commune, avait raconté qu’il s’agissait d’un congrès d’ornithologie, car il croyait qu’une réunion de pacifistes ne pourrait être que paisible… mal lui en prit : ce ne fut guère plus qu’une empoignade verbale entre Lénine et Trotski … la guerre des pacifistes se termina sur un manifeste de l’irréductible lutte des classes. Le premier tenant d’un internationalisme révolutionnaire, le second d’un internationalisme libéral, wilsonien avant la lettre. 22 ans plus tard, on aura oublié la rudesse des échanges pour ne garder que l’exaltation :
Pionniers rouges, marchons en colonne
Nos pas martèlent le sol ;
Drapeaux rouges éclatant au soleil couchant
Émergeant de la houle des blés,
Nos pas sur le sol semblent dire en cadence :
Tu guideras nos pas, Zimmerwald.
Là-bas, émergeant de la plaine,
Paysan reprends haleine,
De la guerre a souffert bien qu’il n’ait pas de terre,
Aujourd’hui, c’est toujours la misère ;
On entend sa faux qui chante dans les blés :
Tu guideras nos pas, Zimmerwald.
La chanson de Zimmerwald. 1936


17 09 1915
Travaillant à la réfection des voûtes du bas-côté de la cathédrale Saint Jean de Lyon, des ouvriers mettent au jour plusieurs coffres d’archives : registres inventaires, documents originaux remontant au X° siècle : bulles pontificales, bulles d’or de l’empereur Frédéric I° Barberousse, chartes et privilèges du roi de France : une mine d’or. C’est l’archiviste du chapitre métropolitain en place sous la Révolution qui l’avait mis là, bien à l’abri des ravages des Fouché, Collot d’Herbois, Montaut.
30 09 1915
Blaise Cendrars, de nationalité suisse, s’est engagé volontairement dans l’armée française : cette guerre est une délivrance pour accoucher de la liberté. Cela me va comme un gant, écrit-il à un ami. Incorporé dans le 1° régiment de marche de la Légion Étrangère, il est envoyé sur le front de Champagne où son régiment a reçu mission de s’emparer du bois de la Crête : une rafale de mitraillette [1] lui fauche le bras droit. Il publiera en 1946 La Main coupée.
J’ai dû m’agiter sur mon brancard, gesticuler non seulement de ce bras gauche, dont je ne savais pas encore me servir, mais brandir aussi cette main droite, cette main que je venais de perdre, qu’on venait de me ravir en Champagne, que j’avais laissé derrière moi dans le charnier de Somme Py et dont l’étonnante présence se révélait, se manifestait, se faisait sentir dans les douleurs exorbitantes qui poussaient de mon moignon, grandissaient, se ramifiaient, me tiraillaient en tous sens, me faisant me tordre comme si j’avait été consumé dans un brasier intérieur, se généralisaient, mais restaient néanmoins très précises tout en se multipliant comme si l’on m’avait coupé, non pas un bras sur deux avec un bistouri, mais, avec une scie circulaire, comme à Bouddha, un éventail de bras sans cesse renaissants, sensation ahurissante qui me faisait sortir hors de moi, qui troublait mes réflexes les plus élémentaires, me désorientait, me déséquilibrait et me faisait perdre jusqu’à la notion exacte de ma dimension corporelle.
La fièvre, l’épuisement, la bouteille de cognac que j’avais absorbé d’un seul trait, les cahots de la route, l’horreur, l’épouvante des transbordements, les relents et les renvois du chloroforme ou de l’huile camphrée, la faim, la fatigue, la sensation de vertige et de tomber, les bombardements, les injures, les misères, la canonnade de l’attaque, les bombes, les explosions, les revenez y de la bataille, les tirs des mitrailleuses allemandes qui nous massacraient dans les barbelés, l’homme que j’avais cloué d’un coup de couteau, mon bras emporté, les cris des copains, cette envie de m’en tirer et de vivre, l’exaltation, les autres, les morts et les milliers, les milliers d’autres blessés, les chirurgiens au milieu desquels je m’étais débattu, le sang qui pissait, le froid qui me gagnait et la peur soudaine, la frousse intense de crever là, sur mon brancard, la trouille de m’endormir, de m’évanouir et de passer sans m’en apercevoir, la terreur d’être oublié, tout cela me donnait le délire, et j’ai dû hurler, appeler au secours, crier de toutes mes forces dans la riche et belle demeure ecclésiastique endormie, ou tout au moins je me l’imaginais. Mais peut-être que quand je m’imaginais crier de toutes mes forces, je devais à peine respirer ou faiblement geindre ou gémir, pouvant à peine respirer, car, en réalité, j’étais à bout. Quoi qu’il en soit, j’ai le souvenir d’avoir livré une lutte farouche, longue et sournoise mais aussi brutale que possible pour ne pas perdre entièrement conscience, pour ne pas me rendre, pour échapper au coma.
Je me souviens encore qu’à un moment donné une cloche me bourdonnait dans les oreilles ou alors, je crus me souvenir qu’en s’en allant, avant de me chiper sa couverture, le chauffeur qui m’avait abandonné dans ce hall somptueux avait tiré sur une cloche ou m’avait parlé d’une cloche à tirer pour faire venir du monde ; bref, je me souviens qu’à un moment donné, une cloche ou la notion d’une cloche me troublait la cervelle et que je fis des efforts désespérés pour me lever et aller tirer sur la corde de cette cloche qui devait pendouiller quelque part dans un coin du hall désert, et que cette cloche probablement fantomatique, je l’ai entendue, à plusieurs reprises, sonner à toute volée dans ma tête, et, chaque fois mon désespoir était infini de voir que cette cloche, qui me faisait mal, ne réveillait personne.
J’étais donc là, guettant l’ange de la mort qui s’apprêtait à me fondre dessus pour me prendre dans ses ailes molles et chaudes, et m’asphyxier la tête sous son aisselle, et je devinais déjà sa présence transparaître dans le décor qui devenait flou, quand je perçus, tout d’un coup, un frissoulis de robes, le tressaillement d’un chapelet et de menues médailles, et, comme un grignotement de souris dans le silence, un pas furtif qui glissait dans l’escalier. Et mon attention fut attirée par une main qui s’était posée là-haut, tout là-haut, sur la sombre rampe de l’escalier, et cette main blanche descendait lentement vers moi du sixième au cinquième, du quatrième au troisième, du deuxième au premier étage en suivant la noble spirale de la rampe de l’escalier, et du premier palier je vis grandir au fur et à mesure qu’elle descendait les dernières marches, une femme habillée de noir et coiffée des ailes tremblotantes d’une cornette, sœur Philomène, dont le pas hésitait plus elle se rapprochait de moi et qui se figea sur la pénultième marche, le temps de soupirer : Ô mon doux Jésus, un homme nu ! [2] de porter ses mains au cœur et de tomber tout d’une pièce en travers de mon brancard.
*****
Pauvre sœur Philomène, si douce, si pertinente, si entêtée dans les prières qu’elle venait par la suite réciter chaque nuit dans ma chambre de grand blessé comme on prie pour exorciser, je crois qu’elle n’a jamais pu vaincre la frayeur que ma vue lui avait causée la nuit de mon arrivée à l’hôpital. Rétrospectivement, elle devait avoir honte de sa faiblesse.
Ce n’est pas le sang dont vous étiez enduit, de la tête aux pieds, qui m’a fait peur, mon pauvre petit, mais votre abandon. Je n’ai pas vu l’homme, mais le mortel… le pêcheur mortel…
Vous avez raison, ma sœur, car j’ai tué. Aujourd’hui, nous sommes des millions d’hommes qui, les armes à la main …
Mais sœur Philomène ne venait pas prier dans ma chambre pour discuter avec moi. Elle possédait sa vérité. Aussi, dès que j’ouvrais la bouche, elle se retirait à reculons m’enveloppant des signes de croix.
[…] Si, la nuit, nous étions veillés par des sœurs, dans la journée, c’étaient des infirmières patentées de l’Association des femmes de France qui s’occupaient de nous.
L’étage supérieur de l’évêché avait été aménagé en lazaret de sang pour recevoir 150 à 200 grands blessés, mais au lendemain de cette malheureuse offensive de Champagne, nous y étions bien 500.
L’infirmière major, Madame Adrienne, qui avait la responsabilité de ces pitoyables victimes, fabriquées en série par les armes et la chirurgie de guerre automatique, était une femme de grand cœur.
Je suis resté près d’un mois à l’hôpital de Châlons sur Marne et j’ai eu le temps de constater que le dévouement de notre infirmière était incommensurable.
Madame Adrienne P… s’adonnait à sa terrible et souvent si répugnante tâche médicale avec un tel élan, un tel tact et tant de délicatesse dans son doigté et de minutie dans les soins qu’elle nous prodiguait avec une insistance faite d’autorité et de douceur persuasive – sans parler des cadeaux, des friandises, des attentions gentilles dont elle comblait ses chers blessés et qui devaient très sérieusement vider sa bourse – que de prime abord chacun de nous, échappé à grand peine de la tuerie et tout boueux encore des tranchées, avait l’impression, puis était rapidement convaincu qu’il était le préféré de cette femme jalouse de ses petits, tellement chacun se sentait gâté, choyé, dorloté, aimé et moralement soutenu et réconforté par cette infirmière bénévole dont l’activité charitable, malgré ses autres devoirs, allait jusqu’à servir de secrétaire pour correspondre avec les familles – et Dieu sait si ces lettres de poilus foudroyés en pleine jeunesse étaient de rudes confessions, chargées d’accusations impitoyables et d’épouvantables imprécations à l’adresse des parents, des maîtres, de la patrie ou de la femme aimée, des regrets, des considérations sur la vie, des désespoirs, des désirs bouleversants, des aveux enfantins et troublants, ou des mensonges dus à l’orgueil que l’infirmière perçait à jour, ce qui n’était pas pour faciliter la correspondance de ce témoin volontaire, lucide, attentif et courageux, mais sensible et surmené, qui devait transmettre, hélas ! souvent au lendemain des premières nouvelles d’une blessure grave, l’annonce d’une issue fatale et comme vœux de condoléance, les dernières volontés, c’est-à-dire neuf fois sur dix, la malédiction d’un soldat qui avait été sacrifié, mais qui s’était défendu, à l’heure de sa mort véhémente, d’avoir voulu être un héros.
À l’évêché, les blessés de l’étage avaient une telle dévotion pour leur infirmière que j’ai vu des trépanés sourire, des fous, des angoissés se calmer ou faire l’insouciant, des fiévreux se taire, des agités se dominer, des unijambistes courir trop tôt sur leurs béquilles, pour faire plaisir à Madame Adrienne, et pour la récompenser, j’ai vu jusqu’à des moribonds se dresser sur leur séant, crâner, saluer, faire des grâces, affirmer que maintenant ils étaient hors d’affaire, et mourir avec aisance. Mais j’ai également vu Madame Adrienne P… après sa journée d’épuisant labeur, passer des nuits blanches au chevet d’un de ces misérables amochés qu’on lui descendait tous les jours directement du front et dont on déposait la civière salie dans un petit réduit capitonné, parce que leur état était désespéré et parce que leurs hurlements égarés étaient plus ignobles que leurs chairs déchiquetées, j’ai vu notre infirmière implorer les chirurgiens de tenter l’impossible, lutter toute la nuit, la seringue à la main et dosant la morphine, pour soulager la douleur d’un martyr soldat et éclater en sanglots quand le cœur de l’homme flanchait et que cet inconnu, matriculé mais anonyme, passait de vie à trépas.
Son don d’elle même était entier, sans aucune restriction, sans arrière-pensée, absolu. Madame Adrienne P…, assistait chacun de ses blessés dans la salle d’opération, elle refaisait personnellement et inlassablement les pansements, les plus compliqués et les plus douloureux, de même qu’elle ne laissait à personne d’autre la corvée funèbre de faire la toilette d’un mort, qu’elle allait veiller le corps à la chapelle, qu’elle accompagnait la dépouille au cimetière, non plus en infirmière médaillée, mais, suprême hommage d’une femme, en grand deuil, et, chaque fois, elle revenait d’un enterrement, dolente, trébuchante, s’effondrant dans ses voiles, se laissant aller comme une mère qui vient de perdre son fils unique – et alors, si son service le lui permettait, elle venait se réfugier dans ma chambre et elle me parlait de son profond chagrin. Ces jours-là, et comme nous étions devenus vite, très vite, de très bons amis, cette vaillante, que tout l’hôpital admirait, m’avouait la lassitude mortelle, la neurasthénie, le dégoût qui la gagnaient secrètement et cette âme ardente n’avait pas honte de se trousser, et de se faire en ma présence, deux, trois piqûres de caféine pour se remonter, rester à la hauteur de la tâche qu’elle s’était imposée et ne pas sentir ses forces, ses nerfs, la trahir.
Car, n’est-ce pas, je suis femme, fille, petite-fille, arrière petite-fille d’officiers français, et je n’ai pas d’enfants, m’avait-elle dit un jour. Mon mari a eu le malheur de servir dans les bureaux de Paris. J’ai estimé que mon devoir était de venir sur la ligne de feu. Et que ne ferait-on pas pour sauver l’honneur et la France… n’est-ce pas, monsieur Cendrars ?
Si je ne méprise pas absolument les femmes, c’est que j’ai connu celle-là et rencontré deux, trois autres infirmières du même cran durant la guerre, qui toutes ont su payer de leur personne.
Blaise Cendras. La main coupée. J’ai saigné. Denoël 2013
09 1915
Clemenceau, 74 ans, effectue son premier déplacement sur le front ; il y en aura une cinquantaine d’autres, qui feront grincer les dents de bien des généraux.
Quand Clemenceau visitait le front au péril de sa vie, ce n’était pas seulement pour soutenir le moral des troupes. C’était aussi pour vérifier que l’intendance suivait.
William Dab, ancien directeur de la Santé. Le Monde avril 2020, sur le coronavirus
Et ce contrôle de l’armée par le politique n’était pas l’apanage de Clemenceau : le parlement lui aussi questionnait et demandait des comptes-rendus aux militaires d’état-major.


Horreur encore en Turquie : Il est impossible de donner une idée de l’impression d’horreur que m’a causée mon voyage à travers ces campements arméniens disséminés le long de l’Euphrate : ceux surtout de la rive droite du fleuve entre Maskene et Deir ez Zor. C’est à peine si l’on peut les appeler campements, car de fait, la plus grande partie de ces malheureux […] est parquée comme du bétail en plein air. […] Exposés à toutes les intempéries et à toutes les inclémences du temps, au soleil torride du désert en été, au vent, à la pluie, au froid en hiver, débilités déjà par les plus extrêmes privations et les longues marches épuisantes, les mauvais traitements, les plus cruelles tortures et les angoisses continuelles de la mort qui les menace, les moins faibles d’entre eux ont réussi à se creuser des trous pour s’y abriter sur les rives du fleuve. […] Heureux aussi ceux qui peuvent se procurer quelques melons d’eau des passants ou quelque mauvaise chèvre malade que les nomades leur vendent au poids de l’or. […] Dans les mesures prises pour transporter cette population à travers le désert n’a en aucune façon été comprise celle de les nourrir. Bien plus, il est évident que le gouvernement a poursuivi le but de les faire mourir de faim.
Un témoin oculaire anonyme, citoyen d’un pays neutre. Rapport transmis au Comité américain de secours aux Arméniens et aux Syriens.
12 10 1915
Edith Cavell, anglaise de 50 ans, est fusillée en Belgique par les Allemands. Elle était directrice d’une école d’infirmière à Ixelles. Dès le début de la guerre, elle était revenue sur Bruxelles pour y soigner les nombreux blessés, allemands comme alliés, en même temps qu’elle intégrait un réseau de résistance qui avait pour principale activité de faire passer des soldats alliés en zone neutre, – la Hollande – puisque la Belgique était alors sous commandement allemand. Rapidement dénoncée, comme de nombreux autres membres de ce réseau, elle avait reconnu les chefs d’accusation. Cinq autres seront aussi fusillés.
L’indignation sera grande, très grande en Angleterre, venant grandir encore celle provoquée par le torpillage, cinq mois plus tôt du Lusitania, dont les Anglais penseront très longtemps qu’il n’avait aucune activité liée à la guerre, quand en fait, il transportait bien des armes. Tout cela pèsera dans l’élaboration de la décision des États Unis de rejoindre ses alliés dans la guerre contre l’Allemagne.
16 10 1915
Réquisition des blés et des farines.
27 10 1915
En Antarctique, dans la mer de Wedell, l’équipage de l’Endurance doit abandonner le navire : Le 20 octobre, un fort vent sud ouest soufflait ; le pack travaillait. Bien que l’Endurance fût en sécurité dans son petit port, un changement pouvait survenir d’un moment à l’autre. Des guetteurs se relayèrent par bordées. Wild et Hudson, Greenstreet et Cheetham, Worsley et Crean prirent le quart sur le pont ; l’ingénieur chef et le second ingénieur avec trois hommes dans la chaufferie. Les autres, à l’exception du cuisinier, du charpentier et de son aide, prirent aussi le quart, quatre heures sur le pont et quatre heures dessous. Le charpentier travaillait à la construction d’un petit bateau plat qui pourrait être utile dans les chenaux. À 11 heures du matin, nous faisions une petite manœuvre pour éprouver les machines. Après huit mois d’inactivité, tout fonctionnait bien, sauf la pompe de la cale et le déchargeur, qui étaient gelés. Nous eûmes quelque difficulté à les réparer. Depuis l’allumage des feux, une tonne de charbon avait été consommée, avec de la cendre de bois et de la graisse. Le feu nécessaire à entretenir le bouilleur consumait environ un quintal et demi de charbon par jour. Il en restait cinquante tonnes dans la cale.
Les 21 et 22 octobre, température très basse ; les chenaux gelèrent. La glace travaillait ; de temps à autre nous parvenaient des grondements lointains. Nous attendions l’attaque des forces gigantesques dressées contre nous.
Le 23 amena un fort vent d’ouest. Le mouvement de pression s’accentua ; les barrières chaotiques que nous pouvions apercevoir se faisaient de plus en plus formidables. Le dimanche 24 octobre marqua pour l’Endurance le commencement de la fin. La méridienne donna la latitude 69°11′ S, longitude 51°05′ O. Nous avions maintenant vingt-deux heures et demie de jour. Nous les passions à surveiller la terrifiante avance des glaces. À 6 h 45 du soir, le bateau se trouvait dans une terrible situation.
[…] L’assaut fut terrible. À tribord, l’étambot fut tordu, le bordage arraché ; tout le bâtiment était ébranlé et gémissait sous la poussée qui s’exerçait depuis l’avant en même temps que latéralement. Le navire se tordait littéralement et commençait à faire eau dangereusement.
Je mis les pompes en action. À 8 heures du matin, la pression se relâcha un peu. Mais le bateau continuait de faire eau et le charpentier dut établir une digue à l’arrière des machines. Les hommes travaillèrent toute la nuit, veillant, pompant, aidant le charpentier, et au matin l’eau était évacuée. Le charpentier et ses aides calfatèrent la digue avec des bandes taillées dans des couvertures et bouchant les fentes du mieux qu’ils purent. Les grandes pompes et les pompes à main, gelées, ne pouvant être employées, Worsley, Greenstreet et Hudson durent descendre dans la cale afin de boucher les fissures.
Ce n’était pas une sinécure, écrivit Worsley. Il fallait colmater les brèches au milieu du charbon dans une obscurité presque complète. Les poutres et la charpente gémissaient autour de nous et craquaient à grands coups secs comme des coups de pistolet. Nous pataugions dans l’humidité avec des mains glacées, et il fallait empêcher le charbon de s’échapper par les fentes. Du pont, les hommes versaient des seaux d’eau bouillante dans les conduits pendant que nous martelions en bas. À la fin les pompes furent dégelées et les fissures suffisamment comblées pour que le charbon ne puisse s’en aller. Nous nous précipitâmes sur le pont, pleins de joie de nous retrouver sains et saufs à l’air libre.
Le lundi 25 octobre, aube nuageuse et brumeuse, température basse et forte brise sud est. Tous les hommes travaillèrent aux pompes et aidèrent le charpentier au barrage. Les voies d’eau furent assez facilement contenues. Le paysage alentour n’était pas fait pour nous rassurer : dans toutes les directions, de hautes arêtes se dressaient, et, bien que la pression sur le bateau ne fût pas très forte, je prévoyais que ce répit durerait peu ; dans notre champ de vision, le pack était soumis à d’énormes compressions, telles que peuvent en produire des vents cycloniques ou les courants les plus violemment opposés de l’Océan. Les arêtes massives et menaçantes que nous voyions s’élever en bordure des masses de glace prouvaient assez que les forces débordantes de la nature travaillaient. Des blocs de plusieurs tonnes s’élevaient, puis d’autres suivaient qui repoussaient de côté les précédents. Dans ce monde étrange, nous étions des intrus, tout à fait impuissants ; notre vie était le jouet de forces primitives et brutales qui se moquaient de nos faibles efforts. Déjà je n’osais presque plus espérer la survie de l’Endurance, et, pendant ce jour d’angoisse, je revis les plans – arrêtés depuis longtemps – du voyage en traîneaux qu’il fallait envisager. Nous étions parés à tout événement : provisions, chiens, traîneaux, équipements, tout était prêt à débarquer à la moindre alerte.
Le jour suivant, temps clair et ciel bleu avec un beau soleil encourageant. Des bruits de pression nous arrivaient toujours. Les principales zones de bouleversement s’approchaient du bateau, et des chocs se faisaient sentir par intermittence. À l’intérieur se faisaient entendre les craquements des charpentes, les coups de pistolet produits par la rupture du bordage ou des madriers, et par là-dessus le gémissement indéfinissable de notre bateau en détresse. Et le soleil brillait avec sérénité. Parfois des nuages floconneux passaient, fuyant devant la brise du sud. Les millions de facettes des blocs nouvellement soulevés brillaient et scintillaient. Le jour s’écoula lentement. À 7 heures du soir, des mouvements contrariés rejetaient le bateau d’avant en arrière. À tribord, les extrémités du bordage s’entrouvrirent de quatre à cinq pouces, tandis que le bâtiment tout entier se courbait comme un arc sous une pression titanesque. Tout comme une créature vivante, il résistait aux forces qui voulaient le broyer, mais le combat était inégal : des millions de tonnes de glace écrasaient inexorablement le petit navire qui avait osé affronter l’Antarctique. De nouveau nous faisions eau de toutes parts. À 9 heures du soir, j’ordonnai que les canots, provisions, équipements, traîneaux fussent descendus. La glace en se reformant colmatait tant soit peu les voies d’eau. Les hommes pompèrent toute la nuit. Par une singulière circonstance, huit pingouins empereurs, sortant d’une fissure de la glace à cent yards de là, apparurent soudain au moment où la pression était à son maximum. Ils s’avancèrent un peu, s’arrêtèrent et poussèrent quelques cris extraordinaires et sinistres qui résonnèrent comme un chant funèbre. Aucun de nous n’avait jamais entendu les pingouins crier ainsi ; l’effet était saisissant.
Alors se leva le jour fatal : mercredi 27 octobre. Nous étions à la latitude 69°05′ S, longitude 51°30′ O. Le thermomètre indiquait 22° au-dessous de zéro ; une légère brise du sud soufflait et le soleil brillait dans un ciel clair. Après ces longs mois d’efforts et d’anxiété, pendant lesquels notre espérance avait résisté à tout, l’Endurance agonisait. Nous étions contraints d’abandonner notre bateau broyé sans espoir ; mais nous restions vivants et bien portants, et nous avions provisions et équipement pour continuer la tâche qui s’offrait. Cette tâche désormais : atteindre une terre tous au complet, si possible sains et saufs. Il est difficile d’écrire ce que je ressentais. Pour un marin, le navire est plus qu’une maison flottante. Dans l’Endurance j’avais concentré ambitions, espoirs, désirs, et voilà que la carrière de notre pauvre bateau blessé et gémissant était finie, ses instants comptés ; il fallait l’abandonner, broyé, après deux cent quatre-vingt-un jours d’emprisonnement dans les glaces. La distance parcourue depuis le point où il avait été cerné jusqu’à la place où il gît maintenant dans les serres du pack était de cinq cent soixante-dix milles ; mais avec tous les détours notés, la dérive réelle atteignait les mille cent quatre-vingt-six milles, et avec les détours non notés, au moins quinze cents milles ! Nous sommes en ce moment à 346 milles de l’île Paulet, le plus proche point qui puisse nous offrir nourriture et abri. Une petite hutte, construite là par l’expédition suédoise en 1902, est remplie de provisions déposées par le bateau de secours de l’Argentine. J’étais renseigné sur ce dépôt, car j’avais acheté des provisions à Londres pour le compte du gouvernement argentin quand il m’avait demandé d’équiper l’expédition de secours. La plus proche barrière ouest est à environ 180 milles de nous. Si notre groupe s’y dirige, il n’y trouvera aucun moyen de subsistance et sera encore à 360 milles de l’île Paulet. Il nous était impossible d’emporter toute la nourriture nécessaire à un tel voyage.
Ce matin, le dernier passé sur le bateau, le temps était clair avec légère brise sud sud est à sud sud ouest. Du nid de pie, aucune apparence de terre. La pression augmentait progressivement. À 4 heures du soir, l’attaque de la glace atteignit son maximum. La poupe se soulevait ; le glaçon qui comprimait l’arrière, avançant latéralement, brisa le gouvernail, arrachant la barre et l’étambot. Puis la glace desserra un peu son étreinte, et l’Endurance s’enfonça légèrement. Les ponts se brisèrent enfin, l’eau entrait. À 5 heures, la pression redoubla et j’ordonnai que tous les hommes quittassent le bateau : les glaces encerclantes ne nous auraient pas ; elles ne broieraient que le bâtiment. C’était une impression navrante que de sentir le pont littéralement éclater sous nos pieds ; les grandes traverses s’arquaient, puis cassaient avec un bruit sec comme un coup de fusil. Les pompes étaient maintenant impuissantes devant l’abondance de l’eau et, pour éviter une explosion, je fis éteindre les feux. J’avais réglé à l’avance l’abandon du navire dans tous ses détails. Hommes et chiens descendirent sur la glace et s’installèrent à quelque distance sur une surface unie, relativement sûre. Avant de quitter le bord, je jetai un regard par la lucarne de la chambre aux machines ; ces dernières étaient renversées. Je ne peux pas décrire les sentiments que j’éprouvais devant l’inexorable destruction à laquelle j’assistais. Des forces brutales, pesant plusieurs millions de tonnes, anéantissaient notre bateau.
Les approvisionnements essentiels ayant été débarqués à une centaine de pas de l’Endurance, nous dressâmes là le camp pour la nuit. Mais vers 7 heures du soir notre glaçon entrait à son tour dans la région bouleversée et la glace commença à se fendre et à craquer sous nos pieds. Je déplaçai le campement à deux cents yards de là, sur un autre glaçon plus grand. Il fallait convoyer les canots, les approvisionnements, l’équipement à travers une arête chaotique en formation. Le mouvement des glaces était si lent, que ce n’était pas un danger ; mais le poids des amoncellements avait provoqué des enfoncements, et il fallait traverser des trous d’eau. Un groupe de pionniers armés de pelles et pioches dut bâtir un talus de neige pour que nous pussions procéder à notre installation. À 8 heures du soir, le camp était de nouveau dressé. Nous avions deux tentes pointues et trois tentes à cerceaux. J’avais pris la charge de la petite tente n° 1 avec Hudson, Hurley et James ; Wild, celle de la petite tente n° 2 avec Wordie, Me. Meish et Me. Ilroy. Celle-ci était très facile à dresser et à démonter. La grande tente n° 3 était transportée par huit hommes de l’équipage ; la quatrième, par Crean, Hussey, Marston et Cheetham, et la cinquième, par Worsley, Greenstreet, Lees, Clark, Kerr, Rickinson, Macklin et Blackborrow, dernier nommé, parce que le plus jeune de l’équipage.
Ernest Shackleton. L’odyssée de l’Endurance. Traduction de Marie Louise Landel
L’épave sera retrouvée le 5 mars 2022 par 3008 mètres de fond, en mer de Weddel par les rovers du brise-glace sud africain Agulhas II, dans le cadre d’une mission demandée par le Falkland Maritime Héritage Trust. Protégée par la traité de l’Antarctique, l’épave ne sera pas fouillée.







10 1915
Soucieuse d’isoler la Turquie, alliée de l’Allemagne, la Grande Bretagne informe le chérif hachémite Hussein de sa décision de reconnaître et soutenir l’indépendance des Arabes dans toutes les régions situées dans les limites qu’il revendique, ce qui inclut la Palestine, à l’exception des Lieux Saints. Un accord similaire est passé avec le wahhabite Ibn Séoud, maître du Nedj – le centre de l’Arabie Saoudite -.
Les Allemands s’emparent de la Serbie et de la Bulgarie.
11 11 1915
Ida Dalser, 35 ans, née à Sopramonte, près de Trente, donne naissance à Benito Albino. Le père n’est autre que Benito Mussolini. Elle l’a connu quelque huit ans plus tôt, lorsqu’il commençait à prendre ses distances avec le socialisme ; éperdument amoureuse, elle a vendu tous ses biens pour financer son journal Il populo d’Italia. Arrivé plus tard au pouvoir, le Duce la rejettera brutalement, lui enlèvera son fils et la fera interner en 1926. Elle mourra le 11 12 1937, et Benito Albino en 1942. Marco Bellochio en fera un film crépusculaire, en 2009 : Vincere.

19 11 1915
Joe Hill, connu aussi sous le nom de Joseph Hillström, membre du syndicat américain Industrial workers of the world – IWW -, auteur de quelques textes de chansons, est exécuté pour meurtre après un procès controversé ; il devient une figure des luttes sociales. Il est le sujet d’une célèbre folksong. Ne perdez pas de temps dans le deuil. Organisez-vous.
Le , John G. Morrison et son fils Arling sont tués dans leur boucherie de Salt Lake City par deux personnes masquées par des bandanas rouges. Rien n’ayant été volé, la police croit d’abord à une vengeance personnelle, peut-être due au fait que le père Morrison est un ancien officier de police. Le même soir, Joe Hill se présente chez un docteur local avec une blessure par balle, qu’il ne veut pas expliquer. On présume que c’est lié à une affaire de cœur. Hill est finalement accusé du meurtre des Morrison, bien que niant toute implication et refusant de témoigner lors de son procès. Il est condamné pour meurtre, et la Cour suprême de l’Utah rejette son appel. Dans une lettre aux magistrats, Joe Hill refuse tout droit à l’État de l’Utah de s’enquérir des origines de sa blessure, qu’il considère comme une affaire exclusivement personnelle.
L’affaire prend une ampleur nationale. Le président Woodrow Wilson, Helen Keller et la Suède demandent la clémence, tandis que dans le monde entier les syndicats prennent sa défense. Le procès est accusé d’avoir été injuste. Des années plus tard, l’État de l’Utah reconnaît que, avec les nouvelles lois entrées en vigueur, Joe Hill n’aurait jamais été exécuté sur le fondement de preuves si légères.
Wikipedia
|
|
Joe Hill par Paul Robeson
| I dreamed I saw Joe Hill last night Alive as you and me Says I « But Joe, you’re ten years dead » « I never died » says he « I never died » says he |
J’ai rêvé avoir vue Joe Hill la nuit dernière, Vivant comme vous et moi. J’ai dit » Mais Joe, tu es mort il y a dix ans » » Je ne suis jamais mort » a-t-il répondu |
|
| « In Salt Lake City, Joe, » says I, in standing by my bed « They framed you on a murder charge » Says Joe « But I ain’t dead » Says Joe « But I ain’t dead » |
À Salt Lake city, Joe, étant au lit Ils m’ont savonné la planche en m’accusant de meurtre Joe dit : « mais je ne suis pas mort » |
|
| « The Copper Bosses killed you Joe ; They shot you Joe » says I « Takes more than guns to kill a man » Says Joe « I didn’t die » Says Joe « I didn’t die » |
J’ai dit « Les Copper Bosses vous ont tué, Ils t’ont tiré dessus » ai-je dis « Il faut plus que des armes pour tuer un homme » Joe a dit » Je ne suis pas mort « |
|
| And standing there as big as life And smiling with his eyes Says Joe « What they could never kill Went on to organize Went on to organize » |
Se tenant là, comme plein de vie Et souriant avec ses yeux Joe a dit » ce qu’ils ne pourront jamais tuer C’est de continuer à s’organiser » |
|
| And standing there as big as life And smiling with his eyes Says Joe « What they could never kill Went on to organize Went on to organize » |
Debout, aussi fort que la vie Et les yeux souriant Joe dit : « ce qu’ils ne pourront jamais tuer C’est de continuer à s’organiser » |
|
| From San Diego up to Maine In every mine and mill Where workers defend their rights It’s there you find Joe Hill It’s there you find Joe Hill! |
De San Diego jusque dans le Maine Dans toutes les mines et les usines Ou des hommes travailleurs défendent leurs droits C’est là que vous trouverez Joe Hill |
17 12 1915
Benito Mussolini épouse Rachele Guidi, qui lui donnera 5 enfants, dont la première Edda, était née en 1910. Ils s’étaient connus sur les bancs de l’école ; elle lui restera fidèle, l’inverse n’étant pas vrai, puisqu’il y aura aussi Ida Dalser, Margherita Sarfatti et que c’est en compagnie d’une autre maîtresse, Clara Petacci qu’il sera tué le 28 avril 1945. Elle finira sa vie à Forli en tenant un restaurant, et y mourra le 30 octobre 1979.
11 12 1915
Vingt cinq wagons de chiens sont acheminées vers le front pour débarrasser des rats tranchées et cantonnements. On en fit venir d’Alaska !
25 12 1915
Claude Debussy, 1862 – 1918, atteint d’un cancer, compose ce Noël des enfants qui n’ont plus de maison à la veille d’une opération.

Portrait par Marcel Baschet (1884).
12 1915
Ottomans, Arméniens et Russes se battent à Sarikamis, au sud-ouest de Kars, en Turquie, tout près de l’actuelle frontière avec l’Arménie : beaucoup plus que les balles des fusils, c’est un froid polaire qui se charge de tuer les soldats, par dizaines de milliers.
1915
André Citroën s’est engagé envers le général Baquet, directeur de l’Artillerie, à fournir 20 000 obus par jour : il a agrandi et reconverti sa petite usine du quai de Javel et rapidement est parvenu à en fabriquer le double ; il est dès lors responsable de l’approvisionnement en charbon et en matières premières de toutes les usines travaillant pour la Défense Nationale : sur les 4 exploitations houillères du Pas de Calais : Marles, Bruay, Nœux et Béthune, seules les deux dernières sont exposées aux canons allemands : les 2 premières continuent à être exploitées… plus que jamais. La concession de Béthune est traversée par la ligne de front… on y travaillera quand même, mais seulement de nuit, sans éclairage aucun.
Les commandes d’armes et de matériels militaires bénéficient à de nombreuses entreprises et à leurs sous traitants, qui deviendront les moteurs de la forte croissance que connaîtra la France durant les années 1920.
Les bénéfices exceptionnels réalisés font l’objet d’un surcroît d’impôt qui s’élève à 2,4 milliards de francs au second semestre 1914 et en 1915, 4,2 milliards en 1916, 5,3 milliards en 1917 et 5,4 milliards en 1918. Ces profits s’expliquent par l’ampleur des contrats passés avec l’État, mais aussi par les prix élevés pratiqués par ces entreprises, que l’armée accepte pour les pousser à produire vite et dégager des marges permettant de financer leurs investissements.
Les profits semblent avoir augmenté moins vite que le chiffre d’affaires, et n’ont pas induit de hausse des dividendes distribués aux actionnaires. Mais les bénéfices de Saint Gobain, dont la production augmente de 70 %, passent de 3,4 millions de francs en 1914 à 22,7 millions en 1916 ; ceux de la Compagnie des forges et aciéries de la marine et d’Homécourt (locomotives et pièces d’artillerie lourde) passent de 6,8 millions en 1914 – 1915 à quelque 16 millions par an jusqu’en 1918. Durant le conflit, la capacité de production des aciéries du Creusot (Saône et Loire) double, de même que la production hydroélectrique.
Parmi les entreprises bénéficiant des commandes militaires, celles qui construisent des automobiles et des avions, et qui venaient tout juste de naître, vont connaître un développement spectaculaire durant la guerre. La paix revenue, elles prendront encore une autre dimension après une difficile reconversion, deviendront des industries phares de la seconde moitié du XX° siècle, et font, aujourd’hui, toujours partie des fleurons de l’industrie française.
C’est ainsi que Berliet (créé en 1901), qui fabrique des camions pour l’armée, construit une usine à Vénissieux (Rhône), investit dans de nouvelles machines et introduit le travail à la chaîne. En 1916, Berliet produit chaque jour 40 CBA, un camion de 5 tonnes qui alimente le front durant la bataille de Verdun. Berliet produit des obus et des chars d’assaut sous licence Renault, dont l’armée lui a commandé 1 000 exemplaires. En 1917, le chiffre d’affaires de l’entreprise, devenue la Société anonyme des automobiles Marius Berliet, a été multiplié par quatre par rapport à 1914.
Georges Latil, qui avait mis au point une voiture dotée de quatre roues motrices, construit lui aussi, dès 1914, des camions pour l’armée et des tracteurs pour l’artillerie lourde. Louis Renault, qui avait construit sa première automobile en 1898 et des camions en 1906, fabrique, pendant la guerre, 9 200 camions, des tracteurs, des obus, des moteurs d’avion et des avions de reconnaissance, etc. En 1917, il construit le premier char d’assaut français, le FT 17, qui jouera un rôle important lors des offensives finales de 1918.
Le chiffre d’affaires de l’entreprise passe de 88 millions de francs en 1914 à 378 millions en 1918. Pour faire face à ces commandes, Renault développe le travail à la chaîne et le taylorisme qu’il a découvert chez Ford avant guerre. Toutes ces entreprises bénéficient du travail féminin et du retour du front des ouvriers qualifiés, qui échapperont ainsi au massacre et permettront à l’industrie française de poursuivre son essor après la fin du conflit.
Dans l’aéronautique, plusieurs constructeurs, qui avaient permis à des pionniers comme Louis Blériot, Henri Farman, Roland Garros etc., de partir à la conquête du ciel au début du siècle, vont passer au stade industriel.
C’est d’abord le cas des frères Caudron, dont le Caudron G2 est commandé par l’armée en 1914, et dont plus de 1 400 exemplaires seront construits en France et des centaines dans les pays alliés.
C’est aussi celui de l’entreprise créée par Edouard Nieuport (record du monde de vitesse en 1911, il se tue en vol en 1913), reprise par son frère Charles, qui met au point en 1916 un chasseur capable de rivaliser avec le Fokker allemand. C’est aussi le cas de la société fondée en 1910 par Raymond Saulnier et par les frères Morane (les premiers à dépasser les 100 km/heure cette même année), ou encore de Pierre Georges Latécoère, qui ouvre des usines à Toulouse durant la guerre pour y fabriquer des obus et des cellules d’avions, avant de se spécialiser dans la construction d’hydravions.
Louis Breguet, qui avait fondé son entreprise en 1909 et battu le record de vitesse sur 10 km en 1911, effectue un premier vol à bord de son Breguet XIV, en novembre 1916. Son avion est aussitôt retenu par l’armée pour la reconnaissance (version A2) et le bombardement (A3). L’armée lui commande 150 A2 et 100 A3, les Américains 500. Au total, 5 500 Breguet XIV seront construits durant la guerre. Construit en aluminium, c’est alors le plus rapide des biplaces et le plus efficace des bombardiers moyens.
Parallèlement, la filiale française de la société espagnole Hispano Suiza, d’abord spécialisée dans la production d’automobile de luxe, se met à produire des moteurs d’avion : plus de 25 000 seront fabriqués durant les hostilités.
Ces sociétés profitent des innovations de jeunes ingénieurs, tel Marcel Dassault qui met au point une hélice performante et conçoit un avion dont l’armée lui commande 1 000 exemplaires (seuls 100 seront construits avant 1918). Louis Coroller, Henry Potez, etc., améliorent l’aérodynamisme, conçoivent des moteurs plus puissants, mettent au point des mitrailleuses tirant à travers l’hélice…
Après 1918, les entreprises aéronautiques souffriront de la fin des commandes militaires, mais certaines trouveront une nouvelle vie avec l’essor de l’Aéropostale durant l’entre deux guerres, puis, surtout après la seconde guerre mondiale, avec celui du transport de passagers (Breguet sera à l’origine de la création de la compagnie Air France). Les succès des Mirage, Concorde et Airbus n’auraient pas été possibles sans elles. Au-delà des destructions et des souffrances qu’elle a provoquées, la guerre de 14 – 18 aura contribué au développement industriel de la France, dont les effets se font toujours sentir.
Pierre Bezbakh. Le Monde 1° mars 2014
Mobilisation des hommes de 43 ans, et appel par anticipation de la classe 1917. La classe d’âge des 20 à 35 ans a perdu 30 % de ses effectifs. Louis Lumière, 51 ans, nommé responsable du service radio de l’Hôtel Dieu, met au point le tulle gras, et une prothèse de main métallique.
Trois jeunes pilotes américains obtiennent une permission pour passer Noël en famille : ils sont reçus comme des héros à New York. Le gouvernement français, avec en arrière pensée un engagement le plus rapide possible des États Unis dans la guerre, formera rapidement une escadrille de pilotes américains, auxquels on ne saura rien refuser : comme cuisinier, le saucier du Ritz de New York, et comme mascottes : Whisky et Soda, qui n’étaient autres que des lions. Les officiels allemands protestèrent de cette présence américaine : l’escadrille américaine sera alors débaptisée et rebaptisée Escadrille La Fayette, le 18 avril 1916
Les Anglais inventent le tank : le Mark
Le tank fût l’arme qui fit finalement sortir le Grande Guerre de l’impasse. L’idée en était venue presque simultanément aux Anglais et aux Français. Winston Churchill et le colonel Estienne pensèrent tous deux à mettre au point une machine blindée qui, grâce à des chenilles, pourrait se déplacer comme un tracteur sur toutes sortes de terrains, et détruire par son poids le fil de fer barbelé et les nids de mitrailleuse ennemis, protégeant ainsi l’avance de l’infanterie. Bien que lord Kitchener, commandant en chef de l’armée britannique, n’y ait vu qu’un joli jouet mécanique, les Anglais eurent tôt fait d’en commencer la production. On garda le secret grâce à une rumeur habilement propagée selon laquelle les plaques d’acier utilisées pour la fabrication étaient destinées à des réservoirs de pétrole : d’où le nom de tank.
Hugh Thomas. Histoire inachevée du monde Robert Laffont 1986


Tank Mark I (1916)

Mais la seule arme technique qui aura un effet majeur sera le sous marin, car les deux camps, incapables de vaincre les soldats du camp adverse, répliquèrent en affamant les civils. Comme la Grande Bretagne ne pouvait s’approvisionner que par la voie des mers, il semblait possible d’étrangler les îles britanniques en menant contre sa flotte une guerre sous marine de plus en plus implacable : la campagne fût tout près de réussir en 1917, avant qu’on ait trouvé les moyens efficaces de la contrer, mais elle contribua plus que tout autre chose à entraîner les États Unis dans la guerre.
Eric J. Hobsbawm. L’Âge des extrêmes
L’Allemand Wegener expose sa théorie de la dérive des continents, qui n’est pas exactement mère de la tectonique des plaques qui naîtra en 1967 – 1968 : leurs résultats ont quelque parenté, mais seulement en surface ; pour le fond, pour les causes, c’est très différent. Boussac augmente considérablement sa production de toile d’avion. 607 000 coloniaux de l’empire participent aux combats : 92 000 Indochinois, 170 000 d’Afrique Occidentale Française et 297 000 d’Afrique du Nord. Dans les rangs du contingent de l’AOF, on compte 12 % de tués, dont 30 000 Sénégalais et 26 000 Algériens contre 16 % en moyenne dans les régiments métropolitains, contrairement à une légende qui voudrait que les troupes de l’Empire aient eu une priorité pour aller au feu. Les survivants virent par contre leurs pensions gelées au moment des indépendances.
Les Anglais mirent dans la bataille plus de 621 000 soldats indiens, et 475 000 civils furent affectés à l’effort de guerre.
Sur le front, la fabrication des bagues à partir de métal récupéré sur les fusées d’obus allemands était, en effet, depuis l’automne, une grande occupation des poilus dans les tranchées de seconde ligne… ils fondaient l’aluminium des fusées coniques des obus de 77, moulaient le métal dans des moules en calcaire tendre – abondant en Champagne – ou dans des douilles de mitrailleuses… Ils gravaient au couteau, avec une allène, ou encore du matériel qu’ils fabriquaient ici et là. Ils ajustaient la décoration des chatons au goût du client, et vendaient les bagues pour quelques francs : le commerce était très actif…
Claude Duneton. Le Monument Balland 2003
L’inégalité de traitement entre autochtones et anciens esclaves récemment installés au Libéria provoque des rébellions que les États Unis vont réprimer pendant deux ans. Depuis 1909, les États Unis ont renforcé leur tutelle sur ce pays en y installant à demeure un financial adviser.
Au Mexique, les troupes fédérales du général Obregon, fortes d’une reconnaissance officielle et donc d’un financement des États Unis écrasent l’armée de Pancho Villa.
Sur le front de l’est, l’offensive des Allemands en Prusse orientale et en Pologne repousse les Russes sur une ligne Riga Dvinsk Pinsk Czernowitz.
La Syrie, partie intégrante de l’empire ottoman, manifeste des velléités d’indépendance : le gouverneur ottoman, Jamal Pacha, fait exécuter 23 militants de l’autonomie.
Les sauterelles s’abattent sur l’Algérie ; le fléau va durer trois ans : Un jour, le sirocco apporta les sauterelles.[…] J’ai assisté au cataclysme du brillant nuage métallique tournoyant au-dessus de la plaine, accompagné d’appels angoissés, de coups de fusil, de tambours nègres, qui s’abattait n’importe où et détruisait tout. J’ai vu la ruée compacte et fluide des insectes pèlerins recouvrant les troncs d’arbres, les rameaux, les feuilles, dévorant tout, se dévorant eux-mêmes parfois par mégarde, huitième plaie d’Égypte expédiée aux hommes pour les punir. De quoi ? Les chevaux glissaient sur cette couche gluante, cette grêle lourde aux pattes coupantes, et qui craquait sous les semelles quand on marchait dessus. L’oncle Jules était fou de rage, la grand-mère hagarde de désespoir, ma mère et Meftah s’acharnaient à défendre la maison à coups de balai, je poussais des cris d’horreur en découvrant des sauterelles dans mon lit.
À l’aube il n’y avait plus rien. Plus d’orangers, plus de vignes, plus de jardins, rien que les carcasses funèbres des cyprès et la puanteur des feux allumés partout. Nous étions nus, sans défense, devant le Créateur suprême que ma mère me faisait prier avant de m’endormir. Les sauterelles pondirent des œufs dans le sol et moururent, mais, deux semaines plus tard, naquirent les criquets qui dévorèrent à leur tour ce qui restait. Les colons qu’une force surhumaine paraissait pousser hors d’eux-mêmes et comme broyer, labourèrent la terre pour essayer de détruire les nouveaux œufs. Les criquets naissaient quand même. Les colons semèrent de nouveau.
Tout finit, même le malheur. Le fléau cessa par épuisement, la dévastation céda comme un incendie qui a tout brûlé ; la famine s’étendit chez les Arabes, des troupes misérables parcoururent la plaine, le gouvernement distribua de la semoule, les gendarmes rétablirent l’ordre, la terre réensemencée redonna du blé et de l’orge, la vigne se recouvrit de bourgeons, la métropole intervint par une loi, les mairies allouèrent quelques dédommagements, l’espoir brilla de nouveau. À présent, les sauterelles ont atteint les Antilles et la Sicile.
Jules Roy. Mémoires barbares. Albin Michel 1989
Il faudra attendre 1939 pour que le DDT – Dichlorodiphényltrichloroéthane – permette de venir à bout du fléau.
21 02 1916
Le général allemand Falkenhayn déclenche la bataille de Verdun. Nom de code : Gericht.
Les offensives françaises en Artois et en Champagne ont été de lourds échecs. Le front n’a pas été percé. Au 31 décembre 1915, l’armée française a perdu deux millions d’hommes dont six cent mille tués. Le renouvellement des effectifs se pose, et l’artillerie lourde reste très inférieure à la force de frappe allemande.
Pour en finir, le généralissime Joffre opte pour la guerre de mouvement, et prépare une offensive sur la Somme, en liaison avec les Britanniques. Malgré les avertissements de ses services de renseignements, il ne croit pas à une attaque sur Verdun ; aussi les canons des forts de Verdun sont-ils retirés en prévision de son offensive dans la Somme. Dans cette même perspective, le système de défense, dont les forts de Douaumont et de Vaux, est réduit.
Or le général allemand von Falkenhayn a bien choisi d’attaquer Verdun, saillant vulnérable des lignes françaises dans les lignes adverses. L’armée allemande construit des hôpitaux et des caves souterraines tout près du front, camoufle 1 250 pièces de tout calibre sur un front très réduit, et rassemble cent cinquante mille hommes dans des abris enterrés. L’objectif est de démontrer la suprématie de l’industrie allemande afin de décourager l’ennemi.
L’attaque a lieu le 21 février 1916 sur la rive droite de la Meuse, commandée par le kronprinz. Les forces françaises, avec 280 pièces pour trente mille hommes, sont écrasées sous une pluie d’acier. Les défenses sont broyées. Le fort de Douaumont défendu par quelques territoriaux est enlevé le 25 février. Mais les survivants français se battent avec acharnement et freinent l’avancée allemande.
Le 25 février, Joffre décide d’envoyer la 2° armée, et le général Pétain en devient le commandant en chef. Il réorganise la défense sur les deux rives de la Meuse. Il réarme les forts et, afin de ne pas épuiser les troupes, systématise leur rotation rapide (la logistique est assurée par la Voie sacrée où vont circuler 3 000 camions). Il a récupéré l’artillerie lourde et commence à se servir de l’aviation pour repérer les mouvements. Les Français résistent. Le 7 mars, les Allemands lancent une formidable offensive sur la rive droite à partir de Douaumont. C’est un massacre.
[…] Début avril, l’artillerie et les effectifs français ont été considérablement renforcés, l’ennemi est contenu. Joffre remplace Pétain par Nivelle, jugé plus offensif. Les Allemands, pour contrer les canons français, étendent les combats à la rive gauche de la Meuse. […] Cette guerre de matériel menée essentiellement par l’artillerie lourde jette les soldats dans une fournaise implacable, rendant illusoire toute manœuvre d’infanterie.
À partir du mois de juin, l’armée allemande prélève à Verdun des effectifs pour parer aux offensives alliées sur la Somme, ainsi qu’aux avancées des Russes sur le front oriental. Le 24 octobre, les Français reprendront Douaumont, et le 2 novembre le fort de Vaux. À la mi décembre les troupes allemandes sont revenues sur leurs positions de départ. La bataille de Verdun est terminée.
Martine Veillet, petite fille de Louis Maufrais, auteur de J’étais médecin dans les tranchées. Robert Laffont 2008
Le 21 février, la nouvelle tombait : les Allemands avaient attaqué le long du front de Verdun. Ce fut un coup de tonnerre. Sur le terrain, mais aussi dans le cœur de tous les Français, car Verdun était notre principale plate forme de défense, parmi les premières d’Europe.
[…] Ce serait une lutte à mort, j’en étais sûr. Les Allemands devaient obligatoirement obtenir la victoire, car le kronprinz lui-même commandait l’armée de Verdun. Un échec atteindrait le prestige de la dynastie. On ne lui marchanderait ni les hommes ni les munitions, ni le matériel.
Louis Maufrais. J’étais médecin dans les tranchées. Robert Laffont 2008
2 millions d’obus tirés en 2 jours : Pétain lance ils ne passeront pas et les quelques groupes de soldats français présents font preuve d’une résistance acharnée. Falkenhayn sera remplacé par Hindenburg et son adjoint Ludendorff en août 1916.
Le front va rapidement se monter à 300 000 hommes, 120 000 chevaux. Il n’est au départ relié à l’arrière que par une voie ferrée, à écartement métrique, quand le normal est à 1.44 m. et une route départementale. Cette dernière qui relie Bar le Duc à Verdun va être élargie à 7 m. : c’est la Voie Sacrée, – ainsi baptisée par Maurice Barrès [lui-même baptisé par Romain Rolland le rossignol du carnage] – sur laquelle s’applique un règlement draconien : aucun piéton ni attelage tiré par des chevaux n’est autorisé. Interdiction aux poids lourds de dépasser, de s’arrêter ou encore de stationner. Tout véhicule en panne est déplacé sur le bord de la route. L’entretien de la chaussée est assuré par 2 000 personnes qui l’approvisionnent en pierre depuis des carrières creusées à proximité. Pas de rouleau compresseur : les pneus pleins des camions roulant entre 15 et 20 km/h suffisent à assurer le damage. Les chauffeurs assurent 18 heures de conduite par jour pour transporter – par jour – 13 000 combattants, 6 400 tonnes de matériel et 1 500 tonnes de munitions. Les convois s’arrêtent à une dizaine de km au sud de Verdun, pour ne pas être atteints par le feu allemand.
La voie ferrée – le meusien – est exploitée au mieux : chaque jour 30 trains en convois de 20 wagons tirés par 2 locomotives : ils transportent les vivres, ils évacuent les blessés. On construira aussi pendant cette année 1916 une ligne de chemin de fer à voie normale appelée 6bis qui permettra d’alléger la charge de la plate forme de transbordement entre les deux écartements.
Les premiers jours sont d’une violence inouïe : face aux 1 400 pièces d’artillerie des Allemands, les 650 canons des Français ne font pas le poids. Jusqu’en juillet, les premiers garderont l’ascendant. À partir de cette date, l’offensive franco-anglaise déclenchée dans la Somme allège la pression allemande sur Verdun et permet aux Français de reprendre l’initiative. Quand la bataille s’achève, en décembre, la plupart des positions perdues au cours des dix mois qui ont précédé ont été réinvesties par l’armée française.
Comme l’écrivent les historiens Stéphane Audoin Rouzeau et Gerd Krumeich dans L’Encyclopédie de la Grande Guerre (Bayard, 2004), le seul vainqueur à Verdun fut la mort. Environ 300 000 tués au total (auxquels s’ajoutent un peu plus de 400 000 blessés). Mais ces chiffres colossaux n’expliquent pas à eux seuls pourquoi Verdun, parmi les grandes batailles de 1914 – 1918, occupe une place à part dans la mémoire nationale.
Deux autres facteurs, au-delà de l’événement, ont fait de Verdun un mythe. Le premier est lié à la nature même de la bataille, concentrée sur un territoire d’environ 5 kilomètres sur 10, qui, un siècle plus tard, porte encore les marques d’un déluge d’artillerie de près de trois cents jours. Avec ses reliefs bouleversés, ses dunes façonnées par les pluies d’obus et ses neuf villages rayés de la carte et jamais reconstruits, le champ de bataille de Verdun est le symbole d’une guerre à la fois totale et absurde, où deux armées s’épuisent dans des combats qui les font avancer au mieux de quelques kilomètres.
Si Verdun tient aujourd’hui du mythe, c’est aussi parce que la bataille fut, plus que toute autre, une expérience partagée. Avec la noria, ce système de rotation des troupes adossé à la fameuse voie sacrée et mis en place par le général Pétain, ce sont, au total, les deux tiers de l’armée française, soit environ 1 500 000 hommes, qui passeront par Verdun. Plus qu’aucune autre bataille, Verdun deviendra ainsi l’affaire de tous, comme le souligne l’historien Nicolas Offenstadt. D’où, sans doute, la résonance particulière de l’expression avoir fait Verdun, qui inscrira toute une génération d’anciens combattants dans une mémoire paradoxale, à la fois banale et unique, démocratique et héroïque.
Thomas Wieder. Le Monde du 21 02 2016
Un haut-lieu, c’est un arpent de géographie fécondé par les larmes de l’Histoire, un morceau de territoire sacralisé par une geste, maudit par une tragédie, un terrain, qui, par-delà les siècles, continue d’irradier l’écho des souffrances tues ou des gloires passées. C’est un paysage béni par les larmes et le sang. Tu te tiens devant et, soudain, tu éprouves une présence, un surgissement, la manifestation d’un je ne sais quoi. C’est l’écho de l’Histoire, le rayonnement fossile d’un rayonnement qui sourd du sol, comme une onde. Ici, il y a une telle intensité de tragédie en un si court épisode de temps que la géographie ne s’en est pas remise. Les arbres ont repoussé, mais la Terre, elle, continue à souffrir. Quand elle boit trop de sang, elle devient un haut lieu. Alors, il faut la regarder en silence car les fantômes la hantent.
Sylvain Tesson. Berezina. Éditions Guérin. Chamonix 2015.

25 02 1916
René Prieur était étudiant en médecine quand il a été mobilisé. Il était à Verdun depuis huit mois quand a commencé à s’abattre le déluge de feu. Après une pluie d’obus particulièrement intense, il reste dans la tranchée pour soigner et évacuer les blessés ; c’est alors que les Allemands le font prisonnier. Il continuera à soigner les blessés… mais allemands. Atteint d’une péritonite, il finira par être échangé contre un autre médecin allemand, prisonnier des Français.
À 10 heures, surgissant du petit bois qui surplombe Louvemont, c’est une patrouille allemande que j’aperçois. Mettant mon sac au dos, ma couverture en bandoulière, je me suis avancé tout seul, tendant en avant mon mouchoir blanc et par-dessus mon brassard de la Croix-Rouge, criant : Nous sommes prisonniers ! On me répond en français, tout en me mettant en joue à 10 mètres : Nous ne sommes pas des barbares, on ne vous fera pas de mal, combien d’hommes sont avec vous ?
Environ 25.
Dites-leur de sortir sans arme.
Et je crie : Allons mes amis, avancez sans arme, on ne vous fera pas de mal. Mes amis sortent et je préviens le caporal allemand qu’il reste des blessés. Il me dit : On va venir les chercher, ils seront soignés. Alors le caporal et quatre soldats du 8° nous ont menés à travers le bois des Fosses saccagé, détruit, défoncé, vers le sentier où il y a encore l’écriteau Herbebois Wavrille. Le 75 tire, et des Allemands tombent. Mes amis me suivent en ordre, sautant par-dessus les troncs d’arbre. Le caporal allemand me demande si j’ai faim. J’accepte un bout de pain noir mais je lui montre que j’ai encore des vivres dans ma musette. Vers le milieu du ravin de l’Herbebois, nous rencontrons un officier. Il nous fait arrêter. Il me dit de rester seul, que je serai conduit près du médecin plus tard. Mes amis me quittent et défilent devant moi en me serrant la main pendant que le 75 tire avec rage. Je leur dis : Au revoir et bon courage, ils ne sont pas à Verdun et nous les aurons quand même ! Alors l’officier dit : Français, braves, bons soldats.
Arrive maintenant la nuit. C’est alors que, près d’un immense trou d’obus, je tombe par hasard sur deux officiers allemands. La conversation s’engage. Très polis, ces officiers me parlent de la guerre. Ils m’annoncent la prise de Verdun pour le 27 février, le Kaiser à Verdun le 1° mars, me montrent des cartes, affirment que tout se déroule mathématiquement. Je réponds qu’ils ne passeront pas, parce que persuadé sincèrement que les Allemands pouvaient passer les deux premiers jours, qu’ils ont été retenus, et que maintenant les réserves françaises, nombreuses en hommes, artillerie, vivres, étaient là. D’ailleurs voici six jours que le bombardement ne cesse pas, voyez, j’ai encore pour trois jours de vivres dans ma musette. Nous avons tout de même des repas chauds ! Ils sourient, disent : Français, braves ! mais Verdun : bald kaput ! Et la conversation continue pendant que nos canons tirent toujours, mais avec moins d’intensité dans le ravin. Vers 7 heures, un blessé atteint à la cuisse me conduit vers le poste de secours en suivant un cordon blanc. Des brancardiers portent des blessés dans des toiles de tente et se guident avec de grandes cartes du bois des Fosses. Dans le poste, il y a deux médecins. L’un est officier et fume, l’autre, sous officier, fait des pansements, et j’aide à panser les blessés. On m’offre à boire du café, à manger du pâté de foie en conserve.
(…) En avant du poste, les Allemands creusent de petites tranchées individuelles, font du feu, installent chacun leur toile de tente, et le canon gronde toujours et les obus éclatent sinistrement, semant la mort. De nombreux blessés allemands arrivent au poste de secours. Un bon feu flambe dans un âtre où réchauffe du café dans de grandes marmites. Les infirmiers sont très occupés et travaillent sans arrêt, prenant pansements, morphine, iode dans de grands paniers. Je remarque qu’il y a très peu d’ouate et qu’on se sert de préférence d’un tissu qui y ressemble et se rapproche du papier. Exténué, je demande la permission de me reposer. On me prête une couverture. Je m’enroule dedans et, reposant la tête sur mon sac, je m’endors profondément jusqu’au matin à 10 heures ; j’ai dormi si profondément que je n’ai même pas bougé quand un 75 est tombé sur le poste de secours. Mais au réveil le poste est vide, les médecins allemands ont pu évacuer leurs blessés. Comme j’ai dormi tout de même, c’est la première fois que je dors vraiment depuis dix jours !
Nous les repousserons.
C’est sur ces mots, rédigés le 26 février 1916 au poste de secours allemand en avant du bois des Fosses, à droite de Louvemont, [à une dizaine de km au nord de Verdun] que s’achève le petit carnet de René Prieur.
02 1916
Nous sommes arrivés avec 30 000 déportés à Ras ulm Aym par longs convois ferroviaires, dans des wagons comprenant chacun 60 à 70 personnes. Il s’y trouvait déjà près de 10 000 tentes. Après notre arrivée, d’autres convois y sont parvenus par chemin de fer ou à pied. […] Les Tchétchènes ont entrepris d’accomplir la tâche qui leur avait été confiée. […] Chaque jour, de grands convois étaient mis en route pour être soi-disant expédiés vers Deir es Zor ou Ras ul Aym, alors que personne ne parvenait jusqu’à ces endroits. Par la suite, j’ai vu sur les rives du Djüdjüb el Hamari, un affluent du Khabour, lui-même affluent de la rive gauche de l’Euphrate, à quatre heures de Ras ul Aym, des quantités de puits remplis d’un nombre incalculable de cadavres. […] Le moindre signe de résistance avait pour réponse un coup de poignard. Ceux qui, affamés et assoiffés, n’étaient plus en état de marcher suppliaient une balle, une balle. Mais utiliser une balle pour un Arménien était considéré comme du gaspillage. Le poignard, toujours le poignard. Nous avons finalement marché une heure durant en laissant derrière nous nombre de gens qui furent égorgés.
Garabed Mouradian. L’extermination des déportés arméniens ottomans 13 12 1918
L’État major français a réalisé que les risques étaient importants à faire passer l’hiver aux troupes coloniales sur le front de l’est ou même sur ses arrières proches : on ne s’habitue pas aux rigueurs lorraines en quelques semaines. Aussi avait on envisagé de les envoyer dans le sud du pays, à Fréjus et à la Teste, où il y avait le camp militaire du Courneau tout proche de la dune du Pyla, près de Bordeaux. Mais à l’usage l’humidité de ce dernier s’était révélé très malsaine pour les Noirs et l’hiver avait été beaucoup plus rigoureux qu’habituellement ; le médecin du camp avait demandé que soit trouvé un autre lieu mais on s’était rabattu sur un autre choix : tester des vaccins de l’Institut Pasteur … il y avait 6 000 doses à écouler… vaccins qui s’étaient révélés parfaitement inopérants et pour finir, ce seront plus de 1 000 morts de maladies pulmonaires qui ravageront le camp sur les 27 000 soldats qui y transiteront ! Blaise Diagne, le seul député sénégalais, s’en émouvra à l’Assemblée nationale le 9 décembre 1916, sans grand résultat. L’expérience sera poursuivie jusqu’à l’été 1917. Au final, c’est la ville de Fréjus qui accueillit l’ensemble des troupes coloniales, avec un secteur hospitalier très développé, car c’était très souvent à cause de la maladie que les soldats étaient retirés du front, d’où une mortalité importante dans ces hôpitaux de Fréjus. Ce choix de Fréjus était au départ purement anecdotique, tout simplement parce que le général Gallieni avait épousé Marthe Savelli, native de Saint Raphael, et qu’il y avait une propriété.
2 03 1916
À Douaumont, le capitaine de Gaulle, à la tête de la 10° Cie du 33° régiment, est grièvement blessé d’un coup de baïonnette à la cuisse. Il l’avait déjà été le 15 août 1914, à Dinant, ville belge de la vallée de la Meuse. Il va rester prisonnier des Allemands pendant deux ans : d’abord à l’hôpital de Mayence, puis, dans plusieurs lieux de détention dont le fort d’Ingolstadt, en compagnie du futur général Catroux, de Roland Garros et du tout jeune lieutenant russe Toukhatchevski.
Être inutile aussi totalement qu’irrémédiablement que je le suis dans les heures que nous traversons quand on est de toutes pièces construit pour agir, et de l’être par surcroît dans la situation où je me trouve et qui pour un homme et un soldat, est la plus cruelle qu’on puisse imaginer …
Charles de Gaulle, 26 ans, à ses parents
… où l’on constate que le style, c’est comme le vin, ça se bonifie en vieillissant…
Quelques années plus tôt, un de ses supérieurs lui trouvait déjà une allure de grand connétable ; l’homme voyait juste : selon Jean Lacouture, pendant ces deux ans de détention, il fut le seul qu’aucun de ses camarades ne vit jamais nu sous la douche : le roi doit garder sa part de mystère… Aucune de ses cinq tentatives d’évasion ne réussira : pas facile de se faire tout petit quand on est aussi grand…
Le capitaine de Gaulle, commandant de compagnie, réputé pour sa haute valeur intellectuelle et morale. Alors que son bataillon, subissant un effroyable bombardement, était décimé et que les ennemis atteignaient la compagnie de tous côtés, a enlevé ses hommes dans un assaut furieux et un corps à corps farouche, seule solution qu’il jugeait compatible avec son sentiment de l’honneur militaire. Est tombé dans la mêlée. Officier hors de pair à tous égards.
Général Philippe Pétain
15 03 1916
Le caporal brancardier Pierre Teilhard de Chardin S.J. 35 ans, incorporé dans le 8° régiment de marche des Tirailleurs Marocains, écrit depuis le front à son ami Victor Fontoymont : […] l’objet, la matière même de nos passions humaines ne peuvent-ils pas se transfigurer, se muter en absolu, en définitif, en divin ? Je pense que oui. L’ivresse du panthéisme païen, je la détournerai à un usage chrétien, et reconnaissant l’action créatrice et formatrice de Dieu dans toutes les caresses et dans tous les heurts, dans toutes les passivités inévitables et irréductibles ; – la haute passion de la lutte pour savoir, pour dominer, pour organiser, je la déchaînerai sur ses objets naturels, mais avec l’arrière-pensée et le but ultime de poursuivre l’œuvre créatrice de Dieu, commencée par exemple, dans l’élaboration inconsciente du cerveau humain, mais destinée à produire des âmes de tonalités plus raffinées ou de nuances nouvelles grâce aux influences et aux organes d’une civilisation supérieure ; – l’amour naïf ou inquisiteur de la Terre mère, je la diviniserai, en songeant que de ce Tout Mystérieux qu’est la Matière, quelque chose doit passer, par la Résurrection, dans le Monde des cieux, – mes efforts pour le Progrès humain étant même peut-être la condition nécessaire pour que s’élabore la Terre nouvelle.
03 1916
Sir Roger Casement, né irlandais, haut fonctionnaire anglais, a démissionné en 1912 pour se consacrer à l’indépendance de son île. En novembre 1914, il est allé voir les Allemands pour leur demander de l’aide, laquelle arrive sous forme d’un cargo d’armes arraisonné par les Anglais. Il rentrera à Dublin, cherchant à persuader ses compagnons de ne pas déclencher l’insurrection : arrêté le 21 avril, il sera condamné pour trahison et pendu le 3 août 1916. Pour les Anglais, il s’agissait de décrédibiliser un personnage que ses deux rapports, sur le Congo et le Putamayo du Pérou, avaient porté au sommet de l’humanitarisme de cette époque. Ses carnets disaient son homosexualité et les Anglais se feront fort d’exploiter ce filon – la condamnation d’Oscar Wilde n’est pas si lointaine – pour faire oublier le personnage, et cela sera efficace… pendant quelques décennies.
Mario Vargas Llosa, sans prononcer le mot, écrira sa biographie : Le rêve du Celte. Gallimard 2010

I say that Roger Casement
Did what he had to do.
He died upon the gallows
But that is nothing new.
W.B. Yeats.
10 04 1916
Le 9 avril est une journée glorieuse pour nos armes. Les assauts furieux des soldats du Kronprinz ont été partout brisés : fantassins, artilleurs, sapeurs, aviateurs de la deuxième armée ont rivalisé d’héroïsme. Honneur à tous ! Les Allemands attaqueront sans doute encore ; que chacun travaille et veille pour obtenir le même résultat qu’hier. Courage… On les aura !
Général Philippe Pétain
23 au 29 04 1916
Semaine d’insurrection à Dublin que l’armée anglaise – 16 000 tommies – va écraser : 500 morts, 15 responsables sont fusillés, d’autres condamnées à perpétuité, dont Eamon de Valera, qui devra à sa nationalité américaine d’échapper à la mort. 2 486 prisonniers seront envoyés dans des camps, dont celui de Frongoch, au pays de Galles : les Anglais ne réalisaient pas que, ce faisant, ils permettaient à des Irlandais venus d’horizons différents de se rencontrer et donc de stimuler la volonté d’indépendance. Les femmes se mirent à exiger leur libération en fondant le Cuman na mBan, une organisation paramilitaire féminine qui jouera un grand rôle dans les luttes à venir.
L’engagement irlandais dans la guerre au sein de l’armée anglaise regroupait des soldats des deux camps : l’Irlande nationaliste de Dublin avait envoyé les 10° et 16° divisions, et l’Ulster, fierté de l’unionisme [partisan de l’intégration au sein du Royaume Uni] avait envoyé la 36° division, soit, au total 200 000 hommes qui se battront sur la Somme et aux Dardanelles ; 35 000 ne reviendront pas. Mais il s’agissait toujours de volontaires, qui fustigèrent unanimement l’insurrection. On pourra lire des lettres de soldats : Quel sacré réveil ! Des fusils tirent sur des gens de ma propre race, pointés par des soldats appartenant à l’armée dans laquelle je sers !
La grande affaire de cette insurrection était le refus de la conscription obligatoire, qui priverait l’Irlande d’hommes qui lui assuraient une prospérité certaine, dans les usines d’armement comme dans les champs. Au début de la guerre, Londres s’appuyait sur les militaires de métier, les réservistes et sur le volontariat. En janvier 1916, la Grande Bretagne, par le Military Service Act, avait réquisitionné tous les célibataires et les veufs sans enfants de 18 à 41 ans. Mais les députés nationalistes irlandais étaient parvenus à exclure l’Irlande de cette loi, avançant que cette décision provoquerait des émeutes dans toute l’île. En mars 1918, le traité de Brest Litovsk, ramènera sur le front ouest un million de soldats allemands qui se trouvaient jusqu’alors sur le front est. Il y avait donc urgence… Le 6 avril 1918, David Lloyd George déclarera aux Communes : Je ne trouve aucun argument moral selon lequel la conscription ne devrait pas s’appliquer à l’Irlande. Il serait intolérable d’appliquer des mesures drastiques à l’Angleterre, à l’Écosse et au pays de Galles sans introduire la conscription en Irlande. Le 18 avril, l’IPP – Parti Parlementaire Irlandais, fondé en 1874 – , le Sinn Fein et d’autres, rédigent un serment à signer le dimanche suivant à la sortie de la messe : Refusant au gouvernement britannique le droit d’imposer le service militaire obligatoire à ce pays, nous faisons le serment solennel que nous résisterons à la conscription par les moyens les plus efficaces à notre disposition. Le service militaire obligatoire sera finalement reporté pour l’Irlande.
24 04 1916
Ils ont vu couler leur beau navire martyrisé le 21 novembre, ils ont connu trois camps successifs sur la glace, ils ont pu mettre à l’eau leur canots le 9 avril pour aborder l’île de l’Éléphant, inhospitalière et déserte, entre Antarctique et cap Horn. Leur boss, Ernest Shackleton décide de regagner la Géorgie du Sud, 2 000 km au nord est, avec 5 hommes, sur une baleinière de 6 m de long. Ils y arriveront, à bout de forces, affamés, déshydratés, le 15 mai 1916 : il leur fallut encore 48 heures pour gagner Grytviken en passant plusieurs cols dépassant les 1 000 mètres ! Les 21 hommes restés sur l’île de l’Éléphant seront secourus le 30 août 1916 par le Yelcho, un navire prêté par le Chili.
24 au 30 04 1916
44 délégués socialistes participent à la conférence de Kiental [dans une vallée de l’Oberland bernois, donnant sur le lac de Thun, d’où l’on peut monter à Griesalp : dépaysement garanti… une merveille], conférence axée sur la nécessité de parvenir le plus vite possible à une paix blanche : sans indemnités ni annexions. Suisse, Allemagne, Italie, Pologne, Russie, avec, entre autres Lénine, Zinoviev, Serbie, Portugal y participent. Le gouvernement français avait refusé le passeport aux délégués français, mais trois députés SFIO parviendront tout de même à être présents, avec un statut d’observateurs : Alexandre Blanc, Jean-Pierre Raffin Dugens et Pierre Brizon, ce dernier rédigeant le manifeste final, à la demande de Lénine :
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !
Deux ans de guerre mondiale ! Deux ans de massacres ! Deux ans de réaction !
Qui donc est responsable ? Où sont donc – derrière ceux qui, au dernier moment ont allumé l’incendie – ceux-là qui l’ont voulu et préparé depuis un quart de siècle ?
Ils sont parmi les privilégiés !
Lorsqu’au mois de septembre 1915, au-dessus de la mêlée, des passions guerrières déchaînées, nous socialistes des pays belligérants et neutres, nous étions réunis fraternellement à Zimmerwald pour sauver l’honneur du socialisme et dégager sa responsabilité, nous disions déjà dans notre manifeste :
Les institutions du régime capitaliste qui disposent du sort de peuples, les gouvernements (monarchiques ou républicains), la diplomatie secrète, les puissantes organisations patronales, les partis bourgeois, la presse capitaliste, l’Église – sur elles repose toute la responsabilité de cette guerre, surgie d’un ordre social qui les nourrit.
C’est pourquoi chaque peuple, comme l’a dit Jaurès quelques jours avant sa mort, est apparu à travers les rues de l’Europe, avec sa petite torche à la main.
Après avoir couché dans la tombe des millions d’hommes, désolé des millions de familles, fait des millions de veuves et d’orphelins, après avoir accumulé ruines sur ruines, et détruit irrémédiablement une partie de la civilisation, cette guerre criminelle s’est immobilisée. Malgré les hécatombes sur tous les fronts, pas de résultats décisifs. Pour faire vaciller seulement ces fronts, il faudrait que les gouvernements sacrifient des millions d’hommes.
Ni vainqueurs ni vaincus, ou plutôt tous vaincus, c’est-à-dire tous saignés, tous épuisés : tel sera le bilan de cette folie guerrière. Les classes dirigeantes peuvent ainsi constater la vanité de leurs rêves de domination impérialiste.
Ainsi est-il de nouveau démontré que seuls ont bien servi leur pays ceux des socialistes qui, malgré les persécutions et les calomnies, se sont opposés, dans ces circonstances, au délire nationaliste en réclamant la paix immédiate et sans annexions.
Que vos voix nombreuses crient avec les nôtres : À bas la guerre ! Vive la paix !
Vos gouvernements, les cliques impérialistes et leurs journaux vous disent qu’il faut tenir jusqu’au bout pour libérer les peuples opprimés. C’est une des plus grandes fourberies imaginées par nos maîtres pour la guerre. Le vrai but de cette boucherie mondiale est, pour les uns de s’assurer la possession du butin qu’ils ont rassemblé pendant des siècles et au cours d’autres guerres ; pour les autres d’aboutir à un nouveau partage du monde, afin d’augmenter leur lot en annexant des territoires, en écartelant des peuples, en les rabaissant au niveau des parias.
Vos gouvernements vous disent qu’il faut continuer la guerre pour tuer le militarisme.
Ils vous trompent. Le militarisme d’un peuple ne peut être ruiné que par ce peuple lui-même. Et le militarisme devra être ruiné dans tous les pays. Vos gouvernements et vos journaux vous disent encore qu’il faut prolonger la guerre pour qu’elle soit la dernière guerre. Ils vous trompent toujours. Jamais la guerre n’a tué la guerre. Au contraire, en excitant les sentiments et les intérêts de revanche, la guerre prépare la guerre, la violence appelle la violence.
De sorte que vos maîtres, en vous sacrifiant, vous enferment dans un cercle infernal. De ce cercle seront impuissantes de vous tirer les illusions du pacifisme bourgeois.
Il n’y a qu’un moyen d’empêcher les guerres futures :
C’est la conquête du gouvernement et de la propriété capitaliste par les peuples eux-mêmes.
La paix durable sera le fruit du Socialisme triomphant.
Prolétaires !
Regardez autour de vous. Quels sont ceux qui parlent de prolonger la guerre jusqu’au bout, jusqu’à la victoire ? Ce sont les auteurs responsables, les journaux alimentés aux fonds secrets, les fournisseurs aux armées et tous les profiteurs de guerre, les social-nationalistes, les perroquets de formules guerrières gouvernementales, les réactionnaires qui se réjouissent en secret de voir tomber sur les champs de bataille ceux qui menaçaient hier leurs privilèges usurpés, c’est à dire les socialistes, les ouvriers syndicalistes et ces paysans qui semaient le blé rouge à travers les campagnes.
Voilà le parti des prolongeurs de la guerre.
À lui les forces gouvernementales, à lui les journaux menteurs, empoisonneurs des peuples, à lui la liberté de propagande pour la continuation des massacres et des ruines.
Et à vous, les victimes, le droit de vous taire et de souffrir l’état de siège, la censure, la prison, la menace, le bâillon.
Dans la tranchée, à la pointe des batailles, exposés à la mort, voilà les paysans et les salariés. À l’arrière, à l’abri, voici la plupart des riches et leurs valets embusqués.
Pour eux, la guerre, c’est la mort des autres.
Et ils en profitent pour continuer et même accentuer contre vous leur lutte de classe, tandis qu’à vous ils prêchent l’Union sacrée. Ils descendent même jusqu’à exploiter vos misères et vos souffrances pour essayer de vous faire trahir vos devoirs de classe et de tuer en vous l’espérance socialiste.
L’injustice sociale et le système des classes sont encore plus visibles dans la guerre que dans la paix.
Dans la paix, le régime capitaliste ne dérobe au travailleur que son bien être ; dans la guerre, il lui prend tout puisqu’il lui prend la vie. Assez de morts ! Assez de souffrances !
Assez de ruines aussi ! Car c’est sur vous, peuples travailleurs, que tombent et tomberont ces ruines. Aujourd’hui, des centaines de milliards sont jetés au gouffre de la guerre et perdus ainsi pour le bien-être des peuples, pour les œuvres de civilisation, pour les réformes sociales, qui auraient amélioré votre sort, favorisé l’instruction et atténué la misère. Demain de lourds impôts s’appesantiront sur vos épaules courbées.
Assez payé de votre travail, de votre argent, de votre existence !
Luttez pour imposer immédiatement la paix sans annexions !
Que dans tous les pays belligérants, les femmes et les hommes des usines et des champs se dressent contre la guerre et ses conséquences, contre la misère et les privations, contre le chômage et la cherté de la vie ! Qu’ils élèvent la voix pour le rétablissement des libertés confisquées, pour les lois ouvrières et les revendications agraires des travailleurs des champs.
Que les prolétaires des pays neutres viennent en aide aux socialistes des pays belligérants dans la lutte difficile qu’ils mènent contre la guerre ; qu’ils s’opposent de toutes leurs forces à l’extension de la guerre. Que les socialistes de tous les pays agissent conformément aux décisions des congrès socialistes internationaux d’après lesquels c’est le devoir des classes ouvrières de s’entremettre pour faire cesser promptement la guerre.
En conséquence, exercez contre la guerre le maximum de pression possible sur vos élus, sur vos parlementaires, et sur vos gouvernements !
Exigez la fin de la collaboration socialiste aux gouvernements capitalistes de guerre ! Exigez des parlementaires socialistes qu’ils votent désormais contre les crédits demandés pour prolonger la guerre.
Par tous les moyens en votre pouvoir, amenez la fin de la boucherie mondiale. Réclamez un armistice immédiat ! Peuples qu’on ruine et qu’on tue, debout contre la guerre ! Courage ! N’oubliez pas que, malgré tout, vous êtes encore le nombre et que vous pourriez être la force.
Que dans tous les pays, les gouvernements sentent grandir en vous la haine de la guerre et la volonté de revanches sociales, et l’heure de la paix sera avancée.
A bas la guerre !
Vive la paix ! – la paix immédiate et sans annexions.
Vive le socialisme international !

le site avait été bien choisi… difficile de trouver mieux pour inciter à la paix …
29 04 1916
En Mésopotamie, le général Townsend a subi une lourde défaite six mois plus tôt à Ctésiphon.
Épuisée et poursuivie par les forces ottomanes, la 6° division s’est retirée à Kut el Amara, où les Ottomans l’avaient encerclé. Au terme d’un siège de plus de quatre mois, à court de vivres et après que plusieurs colonnes de relève eurent subi de lourdes pertes en tentant de la rejoindre, elle est contrainte de se rendre : un coup très rude pour le prestige britannique : le général Townshend lui-même figurait parmi les prisonniers. [Les négociations avaient été menées par T.E. Lawrence, alias Lawrence d’Arabie. ndlr] Les Arabes qui avaient aidé les Britanniques furent impitoyablement châtiés. En s’emparant de Kut, les Ottomans firent 2 962 prisonniers britanniques européens, et environ 10 000 indiens. Lors de leur capture, la plupart de ces hommes souffraient déjà de malnutrition. Pendant le siège (…), nous vivions comme des rats dans le sol, écrira J. E. Sporle. Les Britanniques avaient dû se résoudre à manger les chevaux, mais nombreux étaient les Indiens à s’y être refusés, refus auquel Townshend devait plus tard, avec la plus parfaite mauvaise foi, imputer la défaite britannique, jetant par cette vilaine pirouette un voile sur ses propres erreurs. Le traitement des prisonniers par les Ottomans fut, au début, extrêmement dur : la plupart furent contraints de rejoindre à pied Ras el Aïn, au nord de la Mésopotamie, sous une chaleur écrasante, affaiblis par le manque de nourriture, battus s’ils refusaient d’avancer. Les morts seront nombreuses.
Les soldats capturés à Kut furent répartis en plusieurs groupes : les prisonniers indiens non musulmans – essentiellement des hindous, des sikhs et des chrétiens – furent gardés sur place pour travailler à la construction du chemin de fer Berlin Bagdad. Des civils arméniens déportés avaient transité par ce nœud ferroviaire, et certains prisonniers de Kut en découvrirent les cadavres dans des puits. Les Britanniques blancs et les Indiens musulmans furent conduits en train jusqu’à des camps d’internement en Anatolie, où leurs conditions de vie s’améliorèrent nettement. Les Ottomans cherchèrent parfois à favoriser les musulmans par rapport aux autres prisonniers pour saper l’autorité britannique, mais cette politique connut un succès mitigé. Si le général Townshend fut interné sur une île de la mer de Marmara dans des conditions très confortables, en revanche, sur les 2 962 Britanniques européens capturés à Kut, 1 782 succombèrent, tout comme 3 032 de leurs camarades indiens.
À Londres, l’humiliation de Kut el Amara obligea le gouvernement à constituer une commission d’enquête sur la Mésopotamie. La défaite entraîna aussi une augmentation des renforts envoyés sur ce front sous les ordres du général Stanley Maude. Dès la fin de l’année 1916, les Britanniques amorçaient à nouveau une progression rapide vers le nord à travers la Mésopotamie.
Heather Jones. Le Monde 9 09 2014
9 05 1916
Les Touaregs du Gourma, au sud ouest du Soudan [aujourd’hui au Burkina Faso, à l’est de Ouagadougou] se sont soulevés 5 mois plus tôt ; en février, c’est au tour des Iwellemmeden, les Touareg de l’est du Soudan, après l’évasion de Firhoun, leur chef, de la prison de Gao [aujourd’hui dans l’est du Mali] : ils sont sévèrement défaits à Andéramboukane, à l’est de Gao, sur la frontière actuelle Mali Niger, au nord de Niamey.
16 05 1916
Une convention secrète franco-britannique – les accords Sykes Picot – met en place les protectorats du Moyen Orient :
- Une région, dite zone bleue, de Tyr jusqu’à la Cilicie (Adana, Tarsus) était soumise à l’influence française.
- Une zone rouge, recouvrant en gros la Basse Mésopotamie, revenait à l’Angleterre.
- Une zone brune, la Palestine, devait être internationalisée et serait réservée à un home juif, dont la nature allait être précisée par la déclaration Balfour.
Il existe toute une légende noire sur l’action des Alliés pendant la première guerre mondiale, comme le général britannique Allenby entrant en croisé dans Jérusalem, ou le général français Gouraud, revanchard, devant le tombeau de Saladin. Même si ces événements n’ont pas eu lieu historiquement, ils ont alimenté vingt ans plus tard le discours revendicatif des nationalistes arabes et des islamistes. Evidemment, Sykes et Picot, deux diplomates négociant sur une carte l’avenir d’une région dans le secret d’un cabinet, c’est une image très symbolique. Mais ce n’était qu’une phase d’une négociation longue et complexe, qui a duré de 1914 à 1923.
Les Britanniques ne sont pas pour rien dans cette légende, selon laquelle ils étaient prêts à avoir une grande histoire avec les Arabes, que les Français auraient gâchée. Dès 1918, ils ont utilisé l’appellation Sykes Picot pour en diminuer la valeur juridique en rabaissant le niveau des négociateurs. Sykes Picot est une invention britannique : les accords de mai 1916 ont en fait été signés par Paul Cambon, ambassadeur de France à Londres, et par Edward Grey, secrétaire au Foreign Office, et s’appelaient donc Cambon Grey.
En réalité, les frontières du Proche-Orient ont été fixées entre les réunions à Versailles de décembre 1918 et la conférence de San Remo – avril 1920 – . Ces frontières répondaient à diverses contingences. Par exemple, les Français, ne voulant pas de colonies juives dans leur mandat, ont tracé le doigt de Galilée – aujourd’hui dans le nord de l’État d’Israël -. Autre exemple, le corridor qui va de Jordanie en Irak, isolant la Syrie de l’Arabie saoudite actuelle, correspond au tracé d’une ligne aérienne et d’un oléoduc que les Britanniques voulaient conserver sous leur contrôle. Quant à l’actuelle frontière nord de la Syrie, elle a été définie pas la ligne du chemin fer de Bagdad, à l’exception du sandjak d’Alexandrette.
Excepté le cas du Liban, les frontières étatiques ont été calquées sur les découpages administratifs ottomans. Si les Français et les Britanniques ont dessiné la carte, on peut dire que les Arabes l’ont coloriée. En effet, sous les mandats franco-britanniques ont émergé des pouvoirs centraux à Bagdad, à Damas, à Jérusalem, et ils se sont donné pour mission de prendre le contrôle des territoires et des populations qui leur avaient été dévolus par les puissances européennes. Même en Syrie, où la France avait divisé son mandat en État alaouite, État des Druzes et État d’Alep, les nationalistes arabes du Bloc national ont fini par imposer leurs vues centralisatrices.
On peut considérer qu’en 1920, toutes les élites arabes issues de l’Empire ottoman avaient à peu près les mêmes références et la même culture. Depuis, celles-ci n’ont cessé de diverger. Tout d’abord, les recensements ont servi à définir qui est national et qui ne l’est pas. Ensuite et surtout, l’arrivée des réfugiés palestiniens en 1949 a entraîné la fermeture des codes de nationalité. Le refus de les intégrer a entraîné une définition en creux de l’identité des nationaux libanais, syriens, irakiens ou égyptiens. Les identités se sont construites sur un mode beaucoup plus exclusif qu’en Europe, par exemple. Il est ainsi beaucoup plus difficile de devenir libanais, irakien ou égyptien que de devenir français, italien ou espagnol. En outre, les États ont construit des récits historiques en ancrant leur réalité contemporaine dans un passé millénaire. Regardez les billets de banques et les timbres : le Liban met en avant son passé phénicien ; la Syrie, les sites antiques de Bosra et Palmyre ; l’Irak, Babel et Assurbanipal, etc.
Le problème principal concernait la région de Mossoul qui, au départ, était rattachée au mandat français en Syrie. Les Français l’ont cédée aux Britanniques en échange de parts de compagnie pétrolière. L’espace qui va de la Djéziré syrienne à Mossoul est ce qu’on appelle la Badiyat Al Cham, c’est-à-dire l’arrière-pays bédouin de Damas. C’est là que se trouve l’État islamique – EI -, entre Rakka et Mossoul.
Cette frontière a mis beaucoup de temps à s’installer, parce que les Français et les Britanniques n’ont pris le contrôle complet de cette région qu’au début des années 1930. La frontière n’est vraiment devenue close qu’avec les régimes baasistes – en Irak et en Syrie -. Il y a toujours eu de la contrebande et des passages mais c’est le cas partout. La première chose qu’a faite l’État islamique a été d’imposer des taxes à ses frontières.
Erdogan oublie que l’Empire ottoman était multinational et non turc. La République de Turquie s’est construite sur une homogénéisation de l’Anatolie, épurée de ses éléments étrangers, qu’ils soient arméniens ou arabes. La Turquie moderne a un gros problème d’identité en termes de généalogie.
Dans le partage par les alliés de l’Empire ottoman, les Russes exigeaient Constantinople. Mais la révolution de 1917 a changé la donne, et Moscou a abandonné ses rêves d’expansion. Français et Britanniques se sont donc partagé le monde arabe, mais il restait l’Anatolie ! Elle était dévolue aux Italiens, qui n’en voulaient pas, puis aux Américains, qui se sont désistés, et enfin aux Grecs, ce qui provoqua la guerre d’indépendance de Mustafa Kemal Atatürk. Tout cela est réglé à Lausanne en 1923.
Mais les Russes n’ont jamais été absents de cette région. Ils y ont débarqué pour la première fois en 1770, à Beyrouth, bombardé par la flotte de Catherine II. Dans les années 1950 – 1960, la Russie comptait plusieurs milliers d’hommes – de conseillers, disait-on – en Égypte, en Syrie et en Irak. Ce qui se passe actuellement est le retour en force d’une armée après une éclipse d’une quarantaine d’années. Pour la Russie, cette région est l’étranger proche.
En Irak et en Syrie, les élites ont été complètement détruites par les guerres et les troubles. Tout ce qui était centralisateur a été détruit. Un processus interminable de séparations et de scissions peut se déclencher. En Syrie, le grand œuvre d’Hafez Al Assad a été d’avoir fait de son pays un acteur du Proche-Orient. Le problème de Bachar Al Assad, dont le régime n’existe plus si l’on enlève les armées et milices étrangères qu’il a invitées, est que la Syrie est redevenue un enjeu, un champ de batailles entre puissances.
Si on veut une vraie paix en Syrie, il faut faire comme au Kosovo : le déploiement international de 300 000 soldats bien armés pendant vingt ans. Mais qui peut les fournir ? En pleine guerre civile libanaise, on se demandait si l’on verrait un jour le bout de cette horreur. Cela s’est arrêté d’un coup. Les miliciens ont disparu des rues et se sont reconvertis dans la politique. Au bout d’un certain nombre d’années de guerre et de massacres, la lassitude l’emporte.
Les révolutions arabes de 2011 ont été les premières à se fonder sur une exigence de normalité : les gens voulaient élire leurs dirigeants, mener une vie normale et avoir des services sociaux. La logique est la même pour les migrants : je quitte mon pays, parce que je ne peux pas y mener une vie normale. Et à cet égard, il ne faudra pas sous-estimer le poids des diasporas : un million de Syriens en Allemagne, cela va peser sur l’avenir de la Syrie, et pas seulement de l’Allemagne.
Quant au Liban d’aujourd’hui, c’est une démocratie de zaïms, de boss locaux qui passent des marchandages pour se partager la rente. Quoi qu’on pense de ces zaïms, ils représentent politiquement les gens. Le problème, c’est plutôt l’absence de rente…
Au milieu des années 1970, dans les universités françaises, n’était étudié que le nationalisme arabe : on n’a pas vu venir les islamistes ! Il ne faut pas répéter cette erreur aujourd’hui avec les islamistes, en ne voyant qu’eux. Il existe encore une identité arabe politique sous-jacente. Par ailleurs, derrière la domination de l’islamisme, je vois monter dans cette région un sentiment areligieux ou antireligieux. On le perçoit à la multiplication des cas de blasphème et d’athéisme proclamé. C’est un phénomène souterrain.
Henry Laurens, professeur au Collège de France. Le Monde du 24 12 2016
Assourbanipal l’Assyrien, qui régnait 670 ans avant J.C., et qui détruisit Babylone et Thèbes, Nabuchodonosor, le néo-babylonien à la tête d’un immense empire et qui, déjà, 600 ans avant J.C., avait voulu exterminer les Juifs, Cyrus le Perse, 550 ans avant J.C. qui se tailla un immense empire des cités grecques d’Ionie à l’Afghanistan en incluant la Syrie et la Judée et qui autorisa le retour des Juifs à Jérusalem et la reconstruction du temple de Salomon, tous sont aussi importants pour comprendre le Proche Orient contemporain que les pauvres accord Sykes Picot de 1916 auxquels nous faisons semblant d’attribuer la responsabilité des malheurs présents alors qu’ils n’ont jamais été appliqués. S’attribuer la culpabilité de tout est une dernière forme d’orgueil européen qui ne sert qu’à brouiller les cartes et à donner raison à ceux qui n’ont rien oublié de leur histoire bien antérieure à la présence européenne. Or il y a une histoire en dehors de celle écrite par les Européens. Inutile de penser que nous sommes à l’origine de tout.
Philippe San Marco. Sortir de l’impasse coloniale. Mon petit éditeur 2016
31 05 1916
La bataille du Jutland, la plus grande bataille navale de la guerre met aux prises la Royal Navy commandée par l’amiral John Jellicoe à la Hochseeflotte de l’amiral Reinhard Scheer : plus de 250 navires au total, en mer du nord, au large des côtes danoises. À partir de 18 h 30, et en moins de 2 heures, 14 navires anglais et 11 allemands sont coulés. À la tombée de la nuit, l’amiral Jellicoe dispose ses navires de façon à empêcher les Allemands de s’échapper, pour reprendre le combat le lendemain, mais le lendemain, il sera trop tard : la flotte allemande était parvenue à se glisser entre les mailles du filet pour regagner sa base.
Parmi les blessés anglais, Walter Yeo : il va être le premier à bénéficier d’une opération de chirurgie plastique réalisé par Harold Delf Gillies. Né en Nouvelle Zélande, ce dernier avait découvert les possibilités de la chirurgie plastique auprès de Valadieux, dentiste français, qui expérimentait la chirurgie de la mâchoire. Affecté au Royal Army Medical Corps à Wimereux, près de Boulogne, il regagnera l’Angleterre pour y fonder un an plus tard le Queen’s Hospital, qui, avec 1 000 lits uniquement consacrés aux blessés devant subir une opération de chirurgie plastique, permit d’effectuer plus de 11 000 opérations sur 5 000 hommes.
Sir Harold Delf Gillies est aujourd’hui considéré comme le père de la chirurgie esthétique. En France, Suzanne Noël 1878 – 1954, reçue 4° à l’internat en 1913, fut elle aussi pionnière en la matière, travaillant dès le début de la grande guerre à l’Hôpital du Val de Grâce, dans le service du Professeur Morestin.

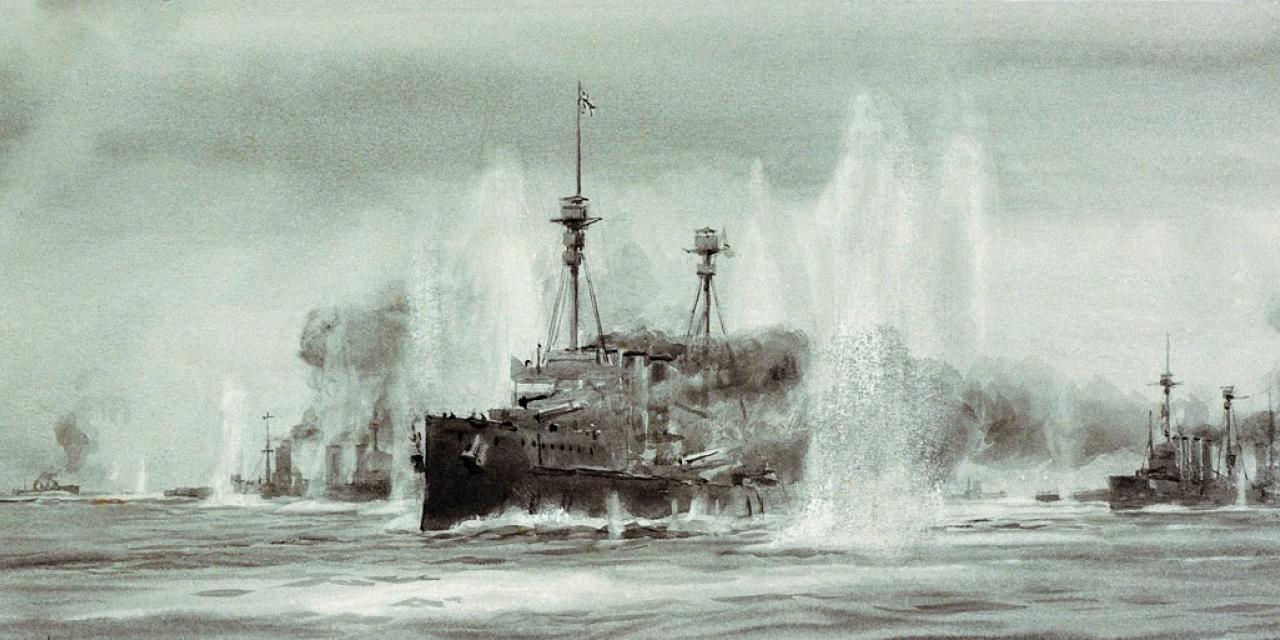
05 1916
La guerre engloutit les vies humaines par milliers, mais tout cela engloutit aussi des énergies, des biens de toutes sortes en quantité impossible à fournir par les seuls belligérants ; ainsi à l’autre bout du monde, sur la façade Pacifique, Guayaquil, grand port et première ville de l’Équateur, n’a pas le temps de dormir : Par-dessus l’épaule des Andes, au-delà des immenses forêts de l’Amazone, de l’autre côté de l’Atlantique, la guerre précipite les uns contre les autres presque tous les peuples de l’Europe. C’est une lutte farouche, par toutes les puissances du fer, du feu, de la chimie, de la mécanique. Il tombe chaque jour des milliers d’hommes. Des villes flambent. Les forêts ne sont plus que moignons sur un sol calciné. La terre est craquelée sur des provinces entières ; des millions de soldats vivent et meurent dans les fissures.
Toute cette épouvante n’est ici qu’un sujet de conversation et un jeu commercial. Deux fois par jour, La Prensa, La Libertad, El Comercio, La Union donnent en première page les communiqués, venus par câbles, de l’Angleterre, de l’Allemagne, de la France, de l’Autriche, de la Russie, de l’Italie ; et l’on compare avec amusement ces bulletins qui sont tous de victoire. On trouve un peu plus de certitude dans les télégrammes venus de Madrid, d’Amsterdam et de New York. C’est sur eux que la spéculation se base pour tenter de gros coups qui réussissent parfois, car la guerre est une source de richesse pour tous ceux qui n’en sont pas. Les mines de Zaruma, celles de Mazani, produisent à triple équipe ; les plantations donnent tout ce qu’elles peuvent ; on exploite sans pitié les vieilles forêts de l’est. En moins de deux ans, le mouvement du port a doublé. Il y a des fortunes subites, que l’on dissipe dans le plaisir, avec la certitude d’en faire de nouvelles. Dans le quartier de la noce, la Quinta Pareja, les boîtes de nuit et les dancings mènent grand tapage d’orchestres et d’enseignes lumineuses. Toutes les filles du pays se sont rabattues sur la ville. Dans les églises, c’est plein de cierges devant la Virgen et Antoine de Padoue, pour que la guerre d’Europe dure le plus longtemps possible.
Albert t’Serstevens. L’or du Cristobal. Albin Michel 1936
4 06 1916
Sur le front, le héros du jour est un pigeon : il a été emmené en cage au fort de Vaux le 31 mai et vient d’être relâché ; mais les gaz, les fumées, les poussières l’empêchent de se repérer et il revient au bercail. À nouveau renvoyé avec un dernier message, il bénéficie d’une éclaircie et vole droit sur Verdun où il arrive épuisé, intoxiqué par les gaz. Recueilli, chouchouté, soigné, guéri, il est cité à l’ordre de l’armée comme seul rescapé libre du fort de Vaux – la garnison se rendra avec les honneurs le 7 juin -, décoré de la légion d’honneur, on l’appellera désormais Vaillant. Il aura une plaque à son honneur au fort de Vaux en 1929 et attendra 1937 pour mourir. Mais on peut toujours le voir, empaillé au Musée militaire du Mont Valérien. Comme quoi, être pigeon peut parfois être gratifiant.
10 06 1916
Sur la foi de promesses franco-britanniques de leur constituer un royaume indépendant au Levant, Hussein, chérif hachémite de la Mecque, appuyé par Mac Mahon, haut commissaire anglais en Égypte, soutenu par le colonel Lawrence, proclame le soulèvement de tous les Arabes, contre la puissance occupante d’alors : la Turquie. Son troisième fils Fayçal va prendre la tête de ses troupes, aux cotés de Lawrence. Les troupes de Constantinople vont abandonner Bagdad aux Anglais en mars 1917 et Jérusalem en décembre 1917.
La grandeur de la révolte me frappe. Une population, nomade et semi nomade, de voleuse qu’elle était à l’occasion, soudain s’est transformée en mortels ennemis des Turcs. Ils les combattent, non point sans doute à notre guise, mais à la leur qui ne manque pas d’efficacité, et ce au nom d’une religion qui, tout récemment, prêchait contre nous la guerre sainte.
Thomas Edward Lawrence, colonel de l’armée britannique. Rapport à Londres du 30 10 1916
Les hommes qui rêvent la nuit, dans les recoins poussiéreux de leur esprit, découvrent au matin que tout n’était que vanité ; en revanche ceux qui rêvent durant le jour sont dangereux, car ils peuvent vivre leur rêve les yeux ouverts et le rendre possible. C’est ce que j’ai fait. J’ai voulu constituer une nation nouvelle, faire revivre une influence perdue, offrir à vingt millions de sémites les fondations sur lesquelles construire un palais de rêve né de leurs aspirations nationales. Un but aussi élevé faisait appel à la noblesse intrinsèque de leur âme, et les incita à jouer un rôle généreux dans les événements ; toutefois, lorsque nous l’eûmes emporté, il me fut reproché que les droits britanniques sur le pétrole de Mésopotamie étaient devenus discutables et que la politique coloniale française dans le Levant se trouvait mise à mal.
C’est bien, j’en ai peur, ce que j’espère. Cela nous a trop coûté, en honneur comme en vies innocentes. J’ai remonté le Tigre avec cent territoriaux volontaires du Devon, de jeunes types honnêtes et charmants, habités par la force du bonheur, le leur et celui qu’ils donnaient à leur femme et à leurs enfants. À leur contact, on ressentait vivement combien il était fabuleux de faire partie des leurs et d’être anglais. Et on les envoyait par milliers au feu, à la pire des morts, non pour gagner la guerre mais pour que le blé, le riz et le pétrole de Mésopotamie nous reviennent. Le seul impératif était de défaire nos ennemis (au nombre desquels les Turcs), ce qui arriva enfin grâce au discernement d’Allenby, avec moins de quatre cents morts, et en gagnant à notre cause les opprimés de Turquie. Je retire une grande fierté de mes trente combats où je n’ai pas versé une goutte de notre sang. À mes yeux, les provinces soumises à l’empire ne valaient pas qu’un jeune Anglais mourût pour elles. Si j’ai restitué au Moyen orient quelque amour propre, un but, des idéaux, si j’ai rendu plus exigeante la norme du gouvernement des Blancs sur les Rouges, j’ai préparé dans une certaine mesure ces peuples pour un nouvel empire où les races dominantes oublieront leurs exploits brutaux et où Blancs, Rouges, Jaunes et Noirs se mettront ensemble, sans se regarder de travers, au service du monde.
[…] L’homme qui se livre entre les mains d’étrangers mène une vie de Yahoo [3]– peuple brutal que Gulliver rencontre au cours de ses voyages -, car il vend son âme à une brute. Il n’est pas des leurs. Il lui est possible de s’opposer à eux, de se persuader qu’il est investi d’une mission et de se démener pour les changer en quelque chose que spontanément ils n’eussent pas été. Il se sert alors de son ancien cadre pour les forcer à sortir du leur. Ou bien il peut, comme je le fis, si bien les imiter qu’à leur tour eux-mêmes finissent par l’imiter. Alors il renonce à son milieu d’origine pour faire semblant d’appartenir au leur ; or ce n’est là que prétention, creuse et sans valeur. Ni dans un cas ni dans l’autre il ne fait grand-chose de sa personne. Le plus convenable est de rester soi-même sans idée de métamorphose et de les laisser face à cet exemple agir ou réagir comme il leur convient.
Dans mon cas, l’effort que je fis ces années-là pour endosser les habits des Arabes ou me couler dans leurs schèmes de pensée m’a fait abandonner mon moi anglais, m’a conduit à porter un regard nouveau sur l’Ouest et ses conventions, et l’a entièrement détruit à mes yeux. En même temps, je ne pus me glisser avec sincérité dans la peau d’un Arabe ; ce n’était qu’affectation. Si un homme se change aisément en infidèle, il a en revanche grand peine à se convertir à une autre foi. J’avais renoncé à une forme sans épouser l’autre et étais devenu semblable à notre légende du cercueil de Mahomet, (on dit qu’il demeurait suspendu entre ciel et terre dans une mosquée de La Mecque, dont la voûte, selon les rationalistes, faite en pierre d’aimant, exerçait une attraction magnétique) avec pour résultat un sentiment d’intense solitude doublée de dédain, non pas pour les autres mais pour leurs actes. Pareil détachement vint à un homme épuisé par un effort physique et un isolement prolongés. Son corps persévérait, machinalement, cependant que son esprit doué de raison le quittait pour, du dehors, poser sur lui un regard critique et se demander ce que ce pantin dérisoire faisait et à quelle fin. Parfois ces moi dissociés se mettaient à converser dans le vide ; alors, la folie était toute proche, comme, je crois, elle le serait d’un homme qui pourrait voir le monde à travers les voiles de deux coutumes, deux éducations, deux milieux.
T. E. Lawrence. Les sept piliers de la Sagesse. Traduction d’Éric Chédaille. Phébus 2009
______________________________________________________________________________
[1] Le terme est passé dans le langage courant, né … au cinéma, car techniquement on ne parle que de pistolet mitrailleur ou de pistolet automatique.
[2] Il peut tout de même paraître étonnant qu’en septembre 1915, soit treize mois après le début de la guerre, une religieuse infirmière voit un homme nu pour la première fois.
[3] Le rétroacronyme Yet Another Hierachical Officious Oracle, créé en est souvent cité comme signification, mais ses créateurs Jerry Yang et David Filo, qui devaient choisir un nom de projet commençant par un Y pour s’inscrire dans la nomenclature des projets informatiques de l’université Stanford, affirment avoir choisi le nom à cause des Yahoos, nom donné aux humains dans le dernier des Voyages de Gulliver de Jonathan Swift.
Wikipedia
Laisser un commentaire