| Publié par (l.peltier) le 5 septembre 2008 | En savoir plus |
2 12 1943
Bombardement allemand sur Bar Harbor, dans le port de Bari où mouillent des navires américains : 15 d’entre eux sont coulés, parmi lesquels le John E. Harvey, qui transportait 100 tonnes de phosgène – chlorure de carbonyle – à destination de l’Extrême Orient : il s’agit d’un dérivé du gaz moutarde, le fameux Ypérite de la première guerre mondiale. On sait que les Japonais firent grand usage des armes chimiques pendant cette guerre et que les Américains avaient donc au moins l’intention d’en faire autant : cela avait pour code Downfall. On sait depuis longtemps qu’il n’est jamais bon qu’il y ait de l’eau dans le gaz et les soldats qui y furent exposés présentèrent d’importants signes de toxicité sanguine, se traduisant principalement par un taux de leucocytes inférieur à la normale. Cet accident lança des recherches longtemps protégées par le secret défense aux États-Unis, qui aboutirent aux premiers essais de la moutarde à l’azote au cours de la maladie d’Hodgkin : c’était la naissance de la chimiothérapie, dont les détracteurs disent qu’elle revient à l’attitude de quelqu’un qui voudrait crever un ballon avec lequel jouent deux équipes de football au centre d’un stade rempli de spectateurs et qui, pour ce faire, utiliserait une bombe atomique.
5 12 1943
À Alger, le général de Gaulle reçoit François Mitterrand, un des dirigeants du RNPG – Rassemblement National des Prisonniers de guerre -. Comme les prisonniers ont été très nombreux, cela en fait un réseau puissant. De Gaulle obtiendra la fusion de l’ensemble des mouvements traitant l’aide aux prisonniers, mais Mitterrand gardera son indépendance. L’enjeu politique était de taille : il s’agissait de savoir si l’ensemble des mouvements rejetant le communisme allait accepter la tutelle d’une organisation les chapeautant tous, communistes compris.
19 12 1943
La Suisse, contrainte et forcée, signe un accord avec les Alliés par lequel elle accepte une très importante réduction de ses exportations d’armes, d’instruments d’optique, matériel de précision, matériel de fusées, vers l’Allemagne ; cela n’a pas été sans mal : Les initiateurs de cette guerre commerciale planétaire étaient la Grande-Bretagne et les États-Unis. Au premier chef, il s’agissait d’établir contre Hitler un blocus économique le plus hermétique possible et à l’échelle du globe. Hitler devait être coupé des marchés où il s’approvisionnait en matières premières. Ses industries d’armement devaient recevoir le minimum de matières stratégiques. Pour ses étuis d’obus, la Wehrmacht avait besoin de manganèse ; pour ses canons, de minerai de fer ; pour les appareils de visée optique de ses blindés, de tungstène ; pour les plaques de blindage et les canons de fusil, d’alliage au chrome. Tous ces métaux stratégiques, Hitler devait chaque mois en acheter en quantités massives, qu’il collectait au Portugal, en Turquie, en Suède et dans d’autres États qui n’étaient pas à sa portée immédiate.
Les ingénieux dirigeants de l’économie nazie avaient fondé quantité de sociétés prête-noms en Amérique latine, en Suisse, en Espagne, au Portugal et dans d’autres pays du globe. Ils avaient aussi, à l’étranger, repris légalement des entreprises établies de longue date et leur avaient donné de nouvelles activités. Dès les années vingt, de nombreuses entreprises allemandes, pour des raisons le plus souvent fiscales, avaient ouvert des filiales en Suisse. Beaucoup d’entre elles, à l’époque nazie, furent utilisées comme prête-noms.
Les Alliés dressèrent une liste noire de toutes ces firmes. Les entreprises travaillant avec les nazis ou pour eux dans des pays tiers – qu’il s’agît de banques, de compagnies d’assurances, d’entreprises industrielles ou commerciales – firent l’objet d’un boycott aussi rigoureux que possible. Seules furent mises sur cette liste noire les firmes dont le volume d’affaires avait augmenté pendant les années de guerre.
Lorsque j’évoque cette liste noire, j’entends celle du Trésor américain, qui était constamment tenue à jour. Pour les entreprises suisses, elle ne fut supprimée que le 30 juin 1946. Mais les Alliés tenaient encore d’autres listes. Le Ministry of Economie Warfare, à Londres, avait ainsi une Black List, une Suspect List et une Statutory List. Rien que sur cette dernière figurèrent par moments plus de 1 600 noms de personnes ou firmes suisses.
[…] Comment les Alliés purent-ils mesurer les variations du volume d’affaires de centaines de firmes, en particulier suisses ? Grâce à l’efficacité de l’espionnage économique organisé par le ministre des Finances américain Henry Morgenthau et ses agents.
En avril 1943, Washington exigea que la Suisse réduise les crédits qu’elle accordait au Reich, et brandit pour cela une arme de poids : si la Confédération n’obéissait pas, les Alliés dénonceraient tous les contrats concernant les livraisons de produits alimentaires. Arrêtez votre commerce avec les nazis ou vous mourrez de faim ! L’arme alliée était le navicert, le certificat de navigation. Le droit (concédé par Mussolini ou Pétain) de débarquer à Gênes et à Sète ne servait à rien si, en haute mer, le connaissement de la cargaison (par exemple, des céréales d’Argentine) n’était pas assorti de ce certificat, qui seul mettait à l’abri de la prise de guerre.
En 1943, les flottes anglaise et américaine contrôlent toutes les mers du globe, et la Suisse ne peut survivre sans ses importations de produits alimentaires d’outre-mer. Néanmoins, le gouvernement, et en particulier le ministre Walther Stampfli, résiste pied à pied. Il négocie, joue sur le temps et remporte une demi-victoire.
[…] Pour son alimentation, la Suisse dépendait et dépend aux deux tiers de l’étranger. Stampfli réussit à maintenir ouvertes les voies commerciales qui permirent à la Suisse de s’approvisionner pendant toute la durée du conflit. Mais Stampfli était aussi un aubergiste suisse ; il ne semblait pas comprendre que, dans cette guerre, c’était la civilisation qui affrontait la barbarie. En public, il disait avec colère : Vous vous rendez compte ! Les Alliés exigent que nous participions à la guerre contre l’Allemagne ! Jamais l’Allemagne n’a traité la Suisse aussi mal que le font aujourd’hui les Alliés.
Le 19 décembre 1943, la Suisse signe. Elle s’engage à réduire de 45 % (par rapport à 1942) ses livraisons d’armes et de munitions à Hitler, et de 60 % ses exportations d’instruments d’optique, d’éléments de fusées et de matériel de précision. Les crédits seront également réduits.
Jean Ziegler. La Suisse, l’or et les morts. Le Seuil 1997
20 12 1943
Charlie Brown, un américain de 21 ans, est aux commandes d’un B17 Flying Fortress, avec 9 hommes d’équipage pour bombarder Brême, mais sitôt larguées ses bombes, il est attaqué par la flak allemande qui l’endommage très sérieusement ; et la chasse se lance à sa poursuite : c’est Franz Stigler, aux commandes d’un Messerschmitt Bf 109 G-6 qui le rejoint finalement… pour réaliser rapidement que, dans cet état, criblé de balles, la forteresse volante ne représente plus aucun danger. Le mitrailleur de queue est mort, les autres comptent 9 blessures. Il cherche à communiquer avec Charlie Brown par gestes voulant lui faire comprendre qu’il n’a qu’à le suivre pour aller se poser en Allemagne et se constituer prisonnier, ou bien qu’il aille se poser en Suède. Il reste à ses côtés suffisamment longtemps pour qu’il soit à l’abri des tirs de la flak. Mais Charlie Brown préférera suivre son idée : atterrir en Angleterre, même avec un avion agonisant. Franz Stigler gardera l’épisode pour lui : raconter cela, c’était le peloton d’exécution ! Les deux hommes se retrouveront quelques cinquante ans plus tard.


22 12 1943
La Gestapo assassine René Gosse, doyen de la faculté des sciences de Grenoble, et son fils, tous deux membres du MUR : Mouvement Unifié de la Résistance.
Fort Barraux, à coté de Pontcharra, après avoir eu pendant des décennies une activité très réduite (quelques prisonniers célèbres : Barnave sous la révolution, le prince de Polignac sous l’empire, des officiers allemands pendant la première guerre mondiale), recevra tout au long de la guerre d’abord des réfugiés espagnols en 38/39, puis des prisonniers français de droit commun, et des résistants. À la fin de la guerre, ce seront des prisonniers allemands jusqu’en 1946.
31 12 1943
Le Maréchal Rommel a inspecté le mur de l’Atlantique : il envoie un rapport à Hitler disant son inquiétude en regard de toutes les faiblesses qu’il lui trouve.
Décembre 1943
Nous avons tous en tête la photo de Marylin Monroe, rabattant prestement le bas de sa robe qu’un vent sournois gonflait en parachute, pour mettre à l’abri des regards sa petite culotte… pour autant qu’elle en ait porté une ce jour-là. Contre un vent sournois, on peut donc se défendre, mais contre une tempête, il n’y a rien à faire : et c’est ainsi que fut mise à nu l’intimité de la Suisse devant Jean Ziegler, alors enfant. L’intimité de la Suisse, ce qu’il fallait à tout prix cacher sous des bâches, c’était les canons pour Hitler. Le récit de Jean Ziegler est savoureux. Quant à parler du secret des secrets, le secret bancaire, il est évident qu’une bonne tempête n’y suffirait pas, il faudrait au moins un tremblement de terre de magnitude 7 ou 8 sur l’échelle de Richter, et ça, c’est une autre histoire : il faudra attendre 70 ans pour entrevoir quelque ouverture.
Ma ville d’origine, Thun, se trouve à la lisière septentrionale des Alpes bernoises, sur une importante voie ferroviaire reliant Bâle à Domodossola par les tunnels du Lôtschberg et du Simplon, et possède une grande gare de triage. Durant les années 1941-1944, un bruit sourd en montait presque sans arrêt, toutes les nuits, jusqu’à notre maison. C’était celui des interminables trains de marchandises allemands roulant vers le sud, vers l’Italie, et des trains allemands et italiens qui allaient au nord, en Rhénanie.
Un grand mur du hall de la gare était orné de toutes sortes d’affiches officielles. L’une d’elles montrait un soldat suisse de profil, casqué et le fusil sur l’épaule, qui portait l’index à ses lèvres ; on lisait en dessous : Qui parle nuit à la patrie. Une autre affiche était un avis de recherche de la police concernant des, saboteurs allemands qui avaient pénétré en Suisse et tenté, à Dubendorf, de faire sauter des avions militaires. D’autres affiches, signées du commandant de la défense anti-aérienne, rappelaient l’obligation d’occulter portes et fenêtres à la tombée de la nuit.
L’un de ces placards m’est resté particulièrement en mémoire. Il expliquait à la population le contenu de la convention conclue entre la Suisse et le Reich sur le trafic civil de marchandises par les tunnels des Alpes. Le ton en était solennel et le texte était signé par le président de la Confédération. Conformément à sa politique de stricte neutralité, le gouvernement avait autorisé les trains de toutes les puissances belligérantes à traverser le territoire national, à condition qu’ils transportent exclusivement des marchandises civiles (vêtements, denrées alimentaires, médicaments, etc.).
Par une fin d’après-midi de décembre 1943, une tempête de neige d’une violence exceptionnelle s’abattit sur Thun. Soufflant du nord par la vallée de l’Aar, la tempête se déchaîna surtout sur la vieille ville, arrachant les tuiles et hurlant affreusement. Le vent était tellement fort qu’il déracina les platanes du quai et brisa la tige qui portait depuis des siècles le coq rouillé de l’église. Le ciel était noir comme de l’encre et l’air chargé des odeurs de plusieurs incendies. Des cygnes morts et des canards paralysés de peur étaient rejetés sur la berge du lac.
À la gare, pendant ce temps, c’était la catastrophe. Des douzaines de wagons frappés du sigle DRB (Deutsche Reichsbahn) et de l’aigle noir se couchaient sur le flanc. Des lambeaux de bâches vertes tourbillonnaient, un vantail du portail d’entrée était arraché de ses gonds, des locomotives sorties des rails. Alertés par le bruit, mon camarade Hans Berner et moi courûmes jusqu’à la gare en dépit de l’interdiction de ma mère. Le bruit ne nous avait pas trompés : tels des cadavres sur un champ de bataille, des canons antiaériens, des tourelles de char, des camions aux vitres brisées et des mitrailleuses lourdes gisaient en désordre sur les voies. Un char renversé dont le canon s’était tordu semblait un éléphant à l’agonie. Partout, des caisses métalliques éventrées. Des obus avaient roulé d’un wagon qui avait endommagé les rails en se renversant. La gare avait l’air d’un champ de bataille.
Vers le soir, des camions militaires vinrent se ranger devant la gare, escortés de limousines sombres portant des plaques diplomatiques, d’où descendirent des hommes en manteau de cuir et chapeau de feutre.
Un gendarme déclara que c’étaient des employés de la légation du Reich à Berne. Ces hommes en manteau de cuir aboyèrent des ordres aux soldats suisses et aux gendarmes de Thun, qui les exécutèrent aussitôt, pleins de respect pour ces étrangers. Plusieurs milliers de badauds s’étaient rassemblés tout près des voies. Sur l’ordre des Allemands, ils furent refoulés sans ménagements par les soldats suisses.
La tempête de neige se fit plus violente. J’étais debout dans la foule, muet, à côté de mon père. Il était président du tribunal de Thun et colonel dans l’armée suisse ; c’était un homme cultivé, intelligent et foncièrement honnête. Quand je lui demandai d’où pouvaient bien venir ces armes et à qui elles étaient destinées, il me répondit à voix basse, en hésitant : Lis l’affiche du gouvernement, dans le hall de la gare. Elle explique tout.
C’était la première fois que mon père ne me disait pas la vérité, et ce fut sans doute la seule. Ce fut ma première rencontre avec la mensongère neutralité helvétique, et c’est un traumatisme dont j’ai mis des années à me remettre.
Jean Ziegler. La Suisse, l’or et les morts. Le Seuil 1997
1943
Le Manhattan Project est lancé. Sous la direction du général Leslie Groves, le physicien Jacob R. Oppenheimer est chargé de superviser la construction puis le fonctionnement du laboratoire de Los Alamos, dans les montagnes du Sangre de Cristo, à plus de 2 000 mètres d’altitude, dans le désert du Nouveau Mexique, où doivent se poursuivre les recherches en vue de la fabrication de la bombe A [1]. C’est Oppenheimer qui a choisi cet endroit dont il gardait un bon souvenir pour l’avoir découvert en y campant quand il était jeune. Il va finaliser les recherches d’Otto Hahn – Nobel de chimie en 1944 – et de Lise Meitner, qui avaient théorisé la fission nucléaire. Lise Meitner était une juive autrichienne qui avait fui l’Allemagne en 1938, après l’Anschluss pour la Suède. Le machisme ambiant l’empêchera d’avoir le Nobel de physique. Sur sa tombe, son neveu Otto Frisch fera graver : Lise Meitner : a physicist who never lost her humanity – Lise Meitner, une physicienne qui n’a jamais perdu son humanité – [elle vivra en Angleterre de 1960 à sa mort en 1968], ce qui était une façon à peine déguisée de dire que nombreux étaient alors les physiciens à avoir perdu leur humanité. Contactée pour participer au projet Manhattan/Los Alamos, plutôt que d’accepter en répandant un peu partout ses états d’âme, elle avait tout simplement refusé : je ne veux rien avoir à faire avec une bombe. Même refus de la part d’Albert Baez, né au Mexique, PhD de Physique à Stranford, le co-inventeur du microscope à rayons X, auteur d’un manuel de physique couramment utilisé aux États-Unis, et surtout, surtout, surtout, père d’une petite fille de deux ans : Joan Baez.

Seated (left to right): Erwin Schrödinger, Irène Joliot-Curie, Niels Henrik David Bohr, Abram Ioffe, Marie Curie, Paul Langevin, Owen Willans Richardson, Lord Ernest Rutherford (* 30. August 1871 in Spring Grove bei Nelson; † 19. Oktober 1937 in Cambridge, Vereinigtes Königreich), Théophile de Donder, Maurice de Broglie, Louis de Broglie, Lise Meitner, James Chadwick. Standing (left to right) : Émtn8!^xcCR6eXREAd564p4iHrile Henriot, Francis Perrin, Frédéric Joliot-Curie, Werner Heisenberg, Hendrik Anthony Kramers, Ernst Stahel, Enrico Fermi, Ernest Walton, Paul Dirac, Peter Debye, Nevill Francis Mott, Blas Cabrera y Felipe, George Gamow, Walther Bothe, Patrick Blackett, M.S. Rosenblum, Jacques Errera, Ed. Bauer, Wolfgang Pauli, Jules-Émile Verschaffelt, Max Cosyns, E. Herzen, John Douglas Cockcroft, Charles Drummond Ellis, Rudolf Peierls, Auguste Piccard, Ernest O. Lawrence, Léon Rosenfeld. Absents: Albert Einstein (émigré aux USA) and Charles Eugène Guye
Everette Lee DeGolyer, géologue américain de grand talent revient d’une mission au Moyen Orient, plein d’enthousiasme quant aux perspectives pétrolières de la région. Le gouvernement américain par la voix de Harold Ickes, secrétaire d’État, annonce le changement dans sa politique énergétique, en publiant un article : Nous manquons de pétrole. Les États-Unis assurent encore les deux tiers de la production mondiale, l’ensemble du Moyen Orient seulement 5 %. Soucieux de ne pas voir tarir leur propre production, ils vont ainsi mettre en œuvre ce que l’on nommera la théorie de la conservation, qui va les amener à dénoncer l’accord avec les autres compagnies datant de 1928 pour faire cavalier seul en Iran puis Arabie saoudite.
Louis Leprince Ringuet construit le laboratoire des Cosmiques à 3 613 m. près du col du Midi, à coté de l’Aiguille du Midi, dans le Massif du Mont Blanc.

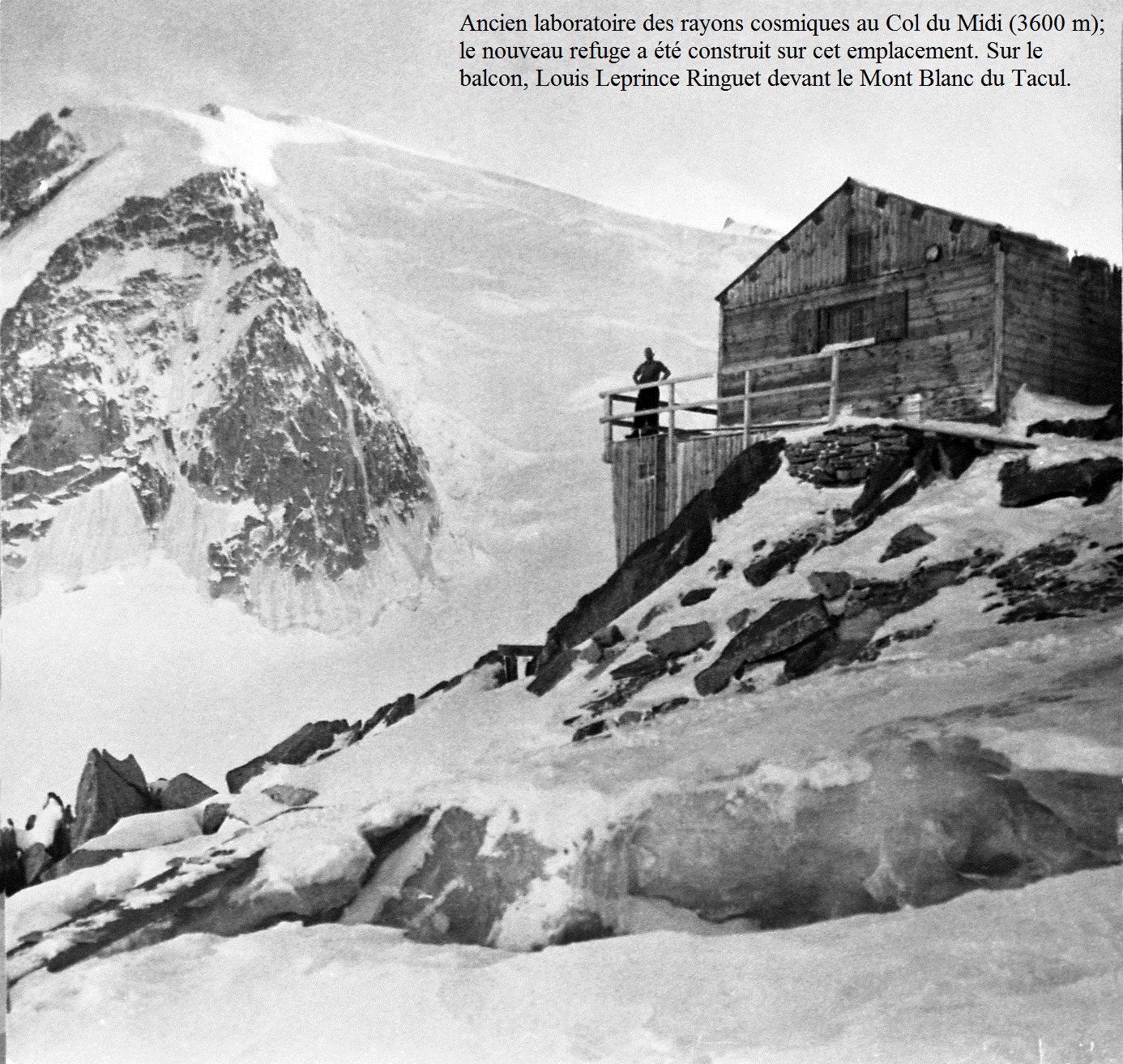


téléphérique de service entre le laboratoire des Cosmiques et le col du Midi

Au fond et au centre, les Grandes Jorasses et sur la droite, l’aiguille du Géant
La Civilian Corporation Corps, la Work Projects Administration et d’autres agences du New Deal sont supprimées. Dans le même temps, les dépenses budgétaires sont passées de 8 % en 1938 à 40 % en 1943, et il fallut attendre 1943 pour que le chômage tombe sous son niveau de 1929, à un moment où le New Deal n’était plus la priorité.
En Suède, Ingvar Kamprad, 17 ans, fonde Ikea. 70 ans plus tard, en 2012, Ikea fera un bénéfice de 3.2 milliards €. Contrairement aux autres grands distributeurs pour lesquels l’adaptation à la culture locale est prioritaire, Ikea se comportera en colonisateur, imposant des procédures suédoises, demandant quasiment à ses clients de penser suédois, avec l’arrogance discrète de celui qui ne peut se défaire de son complexe de supériorité. Dans le Midi, on dit : ils s’en croient. C’est probablement la même arrogance qui leur avait fait stériliser près de 30 000 femmes de 1934 à 1976 qu’ils estimaient indignes d’élever un enfant. Et c’est encore la même arrogance qui leur a fait surveiller la vie privée de leur personnel dans les magasins de France au point de se retrouver devant les tribunaux en 2013. Mais peut-être vont-ils demander le statut d’extraterritorialité comme ils l’ont fait pour la Villa San Michele d’Axel Munthe à Capri… ainsi ils pourront se livrer à toute leurs suédoiseries en toute impunité !
Reprise de la natalité.
L’interdiction des films américains stimulent le cinéma français : Premier de Cordée de Roger Frison Roche, Les Enfants du Paradis de Marcel Carné, le Corbeau de Clouzot. Ce dernier, produit par la Continental, qui est allemande, donnera lieu 4 ans plus tard à une belle empoignade mettant en balance l’indéniable qualité du film et l’inévitable compromission pour le réaliser. Dans l’immédiat, seuls les communistes, repris par L’Écran français, condamnent le film, qui va être interdit jusqu’en 1947.
La famine fait 1 500 000 morts en Russie.
Un amour parfaitement pur de la patrie a une affinité avec les sentiments qu’inspirent à un homme ses jeunes enfants, ses vieux parents, une femme aimée…Un tel amour peut avoir les yeux ouverts sur les injustices, les cruautés, les erreurs, les mensonges, les crimes, les hontes contenues dans le passé, le présent et les appétits du pays, sans dissimulation ni réticence, et sans être diminué, il est seulement rendu plus douloureux….
Comme il y a des milieux de cultures pour certains animaux microscopiques, des terrains indispensables pour certaines plantes, de même il y a une certaine partie de l’âme en chacun et certaines manières de penser et d’agir, circulant des uns aux autres, qui ne peuvent exister que dans le milieu national et disparaissent quand le pays est détruit.
Simone Weil. L’enracinement. Londres 1943.
Il y va du destin de l’espèce humaine. Car, de même que l’hitlérisation de l’Europe préparerait sans doute l’hitlérisation du globe terrestre, accomplie soit par les Allemands, soit par leurs imitateurs japonais – de même une américanisation de l’Europe, préparerait sans doute une américanisation du globe terrestre. Le second mal est moindre que le premier, mais il vient immédiatement après. Dans les deux cas, l’humanité entière perdrait son passé.
Simone Weil. Écrits historiques et politiques, 1943
Aux États-Unis, Ayn Rand, née Alisa Rosenbaum, juive d’origine russe dont les parents s’étaient vu confisquer par les soviets en 1917 appartement et pharmacie, publie Foutainhead – La Source vive – qui obtient un succès considérable particulièrement dans les milieux touchant à la création ; le livre va devenir la bible de bon nombre d’architectes – Ayn Rand était proche de Frank Lloyd Wright -. Elle publiera en 1957 Atlas Shrugged – La Grève -. Cumulés, ces deux romans tireront à 14 millions d’exemplaires. En 1949, King Vidor tournera Le Rebelle avec Gary Cooper, directement inspiré de Fountainhead : le film ne connaîtra pas le succès du roman. En 2014, Ivo Van Hove le mettra en scène en Avignon.
Howard Roark en est le personnage central : son intransigeance envers le respect dû à toute création l’a amené à des positions telles qu’il en vient à dynamiter un ensemble de logements sociaux construits sur ses plans mais avec de nombreuses entorses d’ordre décoratif aux plans d’origine. On lui fait bien sûr un procès, pour lequel il choisit d’assurer sa défense, dans une profession de foi qui ne manque pas de corps et de solidité, même si la nuance en est totalement absente : l’argument est brut de décoffrage, le béton est bien armé, le manichéisme y est sous-jacent et on flirte en permanence avec le mythe du surhomme. La charge est vigoureuse contre la charité mal ordonnée qui commence par les autres, même si Ayn Rand veut parer les contre attaques en nommant altruisme la charité et égotisme l’égoïsme.
Mais, par nos temps de confusion mentale mise en place par la toute puissance du marketing, il peut être salutaire de citer ceux qui, envers et contre tout, continuent à vouloir appeler un chat un chat, car ils placent au-dessus de tout ce qui donne un sens à la vie de l’homme :
Il y a des milliers d’années, un homme fit du feu pour la première fois. Il fût probablement brûlé vif sur le bûcher qu’il avait allumé de ses propres mains. Il fut considéré comme un malfaiteur qui avait dérobé à un démon un secret que l’humanité redoutait. Mais, grâce à lui, les hommes purent se chauffer, cuire leurs aliments, éclairer leurs cavernes. II leur laissa un don inestimable et chassa les ténèbres de la terre ; des siècles plus tard, un autre homme inventa la roue. Il fut probablement écartelé sur cette roue qu’il avait enseigné ses frères à construire. Il fut considéré comme un transgresseur qui s’aventurait dans un domaine interdit. Mais, grâce à lui les hommes purent voyager dans toutes les directions. Il leur laissait lui aussi, un don d’une valeur inestimable et avait ouvert pour eux les routes du monde.
Cet homme là, le pionnier, le précurseur, nous le retrouvons dans toutes les légendes que l’homme a imaginées pour expliquer le commencement de toutes choses. Prométhée fut enchaîné à un rocher et dépecé par des vautours parce qu’il avait dérobé le feu des dieux. Adam fut condamné à souffrir parce qu’il avait mangé du fruit de l’arbre de la connaissance. Quelle que soit la légende, l’humanité sait obscurément que c’est à ces héros obscurs qu’elle doit sa gloire et que chacun d’eux paya son courage de sa vie.
Et au cours des siècles il y eut ainsi des hommes qui s’élancèrent sur des voies nouvelles, guidés uniquement par leur vision intérieure. Leurs buts différaient, mais tous avaient ceci en commun : ils s’élançaient les premiers sur une route nouvelle, leur vision était originale et ils ne recevaient en retour que de la haine. Les grands créateurs, les penseurs, les artistes, les savants, les inventeurs, se sont toujours dressés, solitaires, contre les hommes de leur temps. Chaque grande pensée nouvelle ne rencontra qu’opposition ; chaque grande invention qu’incrédulité. Le premier moteur fut considéré comme une absurdité, l’avion comme une impossibilité, le métier mécanique comme une invention répréhensible, l’anesthésie comme un péché, mais les hommes qui avaient inventé tout cela continuèrent d’aller de l’avant. Ils luttèrent, ils souffrirent, mais ils remportèrent la victoire.
Aucun de ces créateurs n’était inspiré par le désir de servir l’humanité, car les hommes refusaient ce qu’il leur apportait, ayant horreur de tout ce qui pouvait changer leur routine paresseuse. Sa conviction intérieure était son ultime motif. Une œuvre à accomplir, conçue par lui, exécutée par lui. Que ce fût une symphonie, un livre, un moteur, un système philosophique, un avion ou un building… là était son but et le sens de sa vie, et non pas ceux qui entendraient, liraient ou se serviraient de ce qu’il créait. La création en elle-même et non celui à laquelle elle était destinée. L’œuvre et non pas les bienfaits qu’en retireraient d’autres hommes. Cette œuvre qui donnerait forme à sa vérité intérieure, cette vérité qui comptait pour lui plus que tout.
Sa vision intérieure, sa force, son courage, il les puisait en lui-même, dans cette entité qu’est la conscience de l’homme, car penser, sentir, juger, sont des fonctions du moi.
C’est pourquoi les créateurs ne sont jamais dépourvus d’égoïsme. C’est en cela que réside le secret de leur puissance ; ils trouvent en eux-mêmes leurs raisons de créer, leur source d’énergie, leur principe moteur. Le créateur ne sert rien ni personne. Il vit pour lui-même.
Et c’est uniquement en vivant pour lui-même que l’homme est capable de réaliser les œuvres qui sont l’honneur de l’humanité car telle est la loi même de la création.
L’homme ne peut se maintenir sur la terre que grâce à sa pensée. Il vient au monde désarmé. Son cerveau est sa seule arme. Les animaux se procurent leur nourriture par la force. L’homme n’a ni griffes, ni crocs, ni cornes, ni même une très grande force musculaire. Il lui faut cultiver les aliments qu’il absorbe ou se livrer à la chasse, à la pêche. Pour cela, il lui faut des armes ; et ces armes sont encore une création de son esprit. Des plus humbles nécessités aux abstractions religieuses les plus hautes, de la roue au gratte-ciel, tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons nous vient d’une fonction que seul l’homme possède… sa faculté de raisonner.
Mais l’esprit est un attribut individuel. Il n’existe rien de pareil à un cerveau collectif. Une décision prise par un groupe d’hommes n’est jamais qu’un compromis ou une moyenne de la pensée de plusieurs. C’est une conséquence secondaire. Mais l’acte premier, le processus du raisonnement, doit être accompli par un individu isolé. Nous pouvons partager un repas entre plusieurs personnes, mais ce repas ne peut être digéré que par un estomac collectif, et aucun homme ne peut, à l’aide de ses poumons, respirer pour un autre. Toutes les fonctions de notre corps et de notre esprit nous sont personnelles. Nous ne pouvons ni les partager, ni les transférer.
Nous héritons du produit de la pensée des hommes qui nous ont précédés. De la roue, nous faisons une charrette, puis une auto. Cette auto se transforme en avion. Mais en réalité tout cela n’est rien d’autre que la résultante d’une pensée. Or la faculté créatrice ne peut être ni donnée, ni reprise, ni partagée, ni empruntée, elle appartient en propre à un individu. L’œuvre qu’il crée appartient au créateur. Certes les hommes apprennent beaucoup les uns par les autres, mais ce qu’un homme ne peut donner à un autre, c’est la capacité de penser par lui-même.
Rien n’est donné à l’homme sur la terre. Tout ce qui lui est nécessaire, il lui faut le produire. Et c’est là que l’homme se trouve en face de cette alternative : ou vivre du travail indépendant de son propre esprit, ou n’être qu’un parasite nourri par l’esprit des autres. Le créateur s’exprime, le parasite emprunte. Le créateur affronte la vie directement, le parasite à l’aide d’intermédiaires.
Le but du créateur est la conquête des éléments ; le but du parasite est la conquête des autres hommes.
Le créateur vit pour son œuvre. Il n’a pas besoin des autres. Son véritable but est en lui-même. Le parasite vit par dépendance. Il a besoin des autres. Les autres hommes sont pour lui le principe moteur.
Le besoin le plus profond du créateur est l’indépendance. L’esprit humain ne peut travailler sous la contrainte. Il ne peut être plié, sacrifié ou subordonné à des considérations quelles qu’elles soient. Et c’est pourquoi ses relations avec les autres hommes sont, pour le créateur, secondaires.
Le besoin profond du parasite est d’assurer ses biens avec les autres hommes. Il met au-dessus de tout les relations. Il déclare à qui veut l’entendre que l’homme est fait pour servir l’homme. Il prêche l’altruisme.
L’altruisme est cette doctrine qui demande que l’homme vive pour les autres et qu’il place les autres au-dessus de lui-même.
Or aucun homme ne peut vivre pour un autre. Il ne peut pas davantage démembrer son cerveau qu’il ne peut démembrer son corps. Mais le parasite s’est fait de l’altruisme une arme pour exploiter l’humanité et détruire les bases mêmes des principes moraux de l’humanité. Tout ce qu’on a enseigné à l’homme détruisait en lui le créateur, car on lui a fait croire que la dépendance est une vertu. L’homme qui s’efforce de vivre pour les autres est un homme dépendant. Il est lui-même un parasite et transforme ceux qu’il sert en parasites. Rien ne peut résulter de cet échange qu’une mutuelle corruption. L’homme qui, dans la réalité, s’approche le plus de cette conception est l’esclave. Si l’esclavage par force est déjà une chose répugnante, que dire de l’esclavage spirituel. II reste dans l’homme asservi un vestige d’honneur, le mérite d’avoir résisté et le fait de considérer sa situation comme mauvaise. Mais l’homme qui se transforme en esclave volontaire au nom de l’amour est la créature la plus basse qui existe. Elle porte atteinte à la dignité de l’homme et à la conception même de l’amour. Et telle est cependant l’essence même de l’altruisme.
On a enseigné à l’homme que la plus haute vertu n’était pas de créer, mais de donner. Mais comment peut-on donner une chose avant de la créer ? La création vient avant le don, sans cela, il n’y aurait rien à donner ; la nécessité intérieure du créateur avant les besoins des bénéficiaires éventuels. Et cependant on nous a appris à admirer l’être de second plan qui dispense des dons qu’il n’a pas créés, en passant par-dessus celui qui a rendu ce don possible. Nous appelons cela un acte de charité, et nous l’admirons davantage qu’un acte de création.
Les hommes ont appris également que leur premier souci devait être de soulager les misères des autres hommes. Or la souffrance est une maladie. Si un homme se trouve en contact avec cette maladie, il est naturel qu’il cherche à donner au malade l’aide dont celui-ci a besoin, mais faire de cet acte la plus grande marque de vertu est faire de la souffrance la chose la plus importante de la vie. L’homme en arrive alors à souhaiter les souffrances des autres, afin de pouvoir faire montre de vertu. Telle est la nature même de l’altruisme. Le créateur lui, n’a pas pour intérêt premier la souffrance, mais la vie. Mais en réalité l’œuvre des créateurs a plus fait pour supprimer sur la terre toutes les formes de souffrance, aussi bien morales que physiques, que l’altruiste ne peut l’imaginer.
On a également enseigné à l’homme que faire chorus avec les autres est une vertu. Or le créateur est par essence même un homme qui s’oppose aux autres hommes. On a fait croire à l’homme que nager dans le courant est une vertu. Or le créateur est un homme qui nage contre le courant. Les hommes croient également que vivre en foule est une vertu. Or le créateur est un homme qui vit seul.
On a enseigné à l’homme que le moi est synonyme de mal et que l’oubli de soi-même est la plus haute des vertus. Mais le créateur est un égotiste dans le sens du mot le plus absolu, car l’homme dépourvu d’égotisme est celui qui ne pense, ne sent, ne juge ni n’agit, par lui-même.
Et c’est ici que l’échelle des valeurs a été le plus dangereusement faussée ; que toute liberté a été enlevée à l’homme. C’était ou l’égotisme ou l’altruisme ; l’égotisme étant considéré comme le fait de sacrifier les autres à soi-même, l’altruisme le fait de se sacrifier soi-même aux autres. Ceci liait irrévocablement l’homme à l’homme, ne lui laissant le choix qu’entre deux partis également pénibles, ou souffrir par les autres ou faire souffrir les autres. Et lorsque enfin, on eut persuadé l’homme qu’il trouverait ses plus grandes joies dans le sacrifice de lui-même, la trappe se referma. L’homme se vit forcé d’accepter le masochisme comme son idéal, puisque le sadisme était l’unique parti qui s’offrait à lui. Et ce fut là la plus grande tromperie qu’on eut jamais infligée à l’humanité.
Ce fut ainsi qu’on fit de la faiblesse et de la souffrance les bases mêmes de la vie.
Or, en réalité, ce n’est pas entre le sacrifice de soi et la domination des autres qu’il s’agit de choisir, mais entre l’indépendance et la dépendance. Entre le code, du créateur et celui du parasite. Le code du créateur est bâti sur les besoins d’un esprit indépendant, celui du parasite sur les besoins d’un esprit dépendant. Or tout ce que produit un esprit indépendant est juste et, tout ce qui provient d’un esprit dépendant est faux.
L’égotiste dans le sens absolu du terme n’est pas l’homme qui sacrifie les autres. C’est celui qui a renoncé à se servir des hommes de quelque façon que ce soit, qui ne vit pas en fonction d’eux, qui ne fait pas des autres le moteur initial de ses actes, de ses pensées, de ses désirs, qui ne puise pas en eux la source de son énergie. Il n’existe pas en fonction d’un autre, pas plus qu’il ne demande à un autre d’exister en fonction de lui. C’est là la seule forme de fraternité, basée sur un respect mutuel possible entre les hommes.
L’homme peut être plus un moins doué, mais un principe essentiel demeure : le degré d’indépendance à laquelle il est arrivé, son initiative personnelle et l’amour qu’il porte à son travail. C’est cela qui détermine sa capacité en tant que travailleur et sa valeur en tant qu’homme. L’indépendance est la seule jauge avec laquelle on puisse mesurer l’homme. Ce qu’un homme fait de lui-même et par lui-même et non ce qu’il fait ou ne fait pas pour les autres. Rien ne peut remplacer la dignité personnelle. Et il n’y a pas de dignité personnelle sans indépendance.
Dans les rapports humains tels qu’ils doivent être, il n’existe pas de notion de sacrifice. Un architecte ne peut pas vivre sans clients, mais cela ne veut pas dire qu’il doive subordonner son travail à leurs désirs. Ils ont besoin de lui, mais ils ne le chargent pas de leur construire une demeure simplement pour lui fournir du travail. Deux hommes échangent leur travail par un libre consentement mutuel, parce qu’ils y trouvent l’un et l’autre leur intérêt et que tous deux désirent cet échange. Sinon, rien ne les y oblige. C’est là la seule forme possible de relations entre égaux. Toute autre conception est celle de l’ esclave au maître ou de la victime à son bourreau.
Aucune œuvre digne de ce nom ne peut être accomplie collectivement, par la décision d’une majorité. Chaque création doit être conçue par un esprit original. Un architecte a besoin d’un grand nombre de corps de métiers pour construire le building qu’il a conçu, mais il ne leur demande pas d’approuver ses plans. Ils travaillent ensemble par consentement mutuel, chacun remplissant la fonction qui lui est propre. Un architecte se sert de l’acier, du verre, du béton que d’autres que lui ont préparés. Mais ces matériaux ne sont que des matériaux tant qu’il ne les a pas transformés en leur donnant une forme qui lui est personnelle. Voilà la seule forme possible de coopération entre les hommes.
Le premier droit de l’homme, c’est le droit d’être lui-même. Et le premier devoir de l’homme est son devoir envers lui-même. Et le principe moral le plus sacré est de ne jamais transposer dans d’autres êtres le but même de sa vie. L’obligation morale la plus importante pour l’homme est d’accomplir ce qu’il désire faire, à condition que ce désir ne dépende pas, avant tout, des autres. C’est uniquement selon un tel code que peut vivre, penser, créer le créateur. Mais ce n’est pas là la sphère du gangster, de l’altruiste ou du dictateur.
L’homme pense et travaille seul. Mais il ne peut pas piller, exploiter ou dominer… seul. Le pillage, l’exploitation de l’homme par l’homme et la dictature présupposent des victimes, donc des êtres dépendants. C’est le domaine du parasite.
Les conducteurs d’hommes ne sont pas des égotistes. Ils ne créent rien.
Ils existent uniquement en fonction des autres. Leur but est d’asservir des êtres. Ils sont aussi dépendants que le mendiant, le travailleur social , ou le bandit. La forme de dépendance importe peu.
Mais on enseigna aux hommes à considérer ces parasites, les tyrans, les empereurs, les dictateurs, comme les symboles même de l’égotisme. Et grâce à cette immense duperie, ceux-ci furent en mesure de détruire l’âme humaine, la leur aussi bien que celle des autres.
Depuis le début de l’ère historique, les deux antagonistes, le créateur et le parasite, s’affrontèrent. Et à la première invention du créateur, le parasite répondit en inventant l’altruisme
Le créateur… honni, persécuté, exploité, n’en allait pas moins de l’avant, emportant l’humanité dans le rythme de son énergie. Le parasite, lui, ne faisait rien d’autre que multiplier les obstacles. Cette lutte portait d’ailleurs un autre nom : celle de l’individu contre la collectivité.
Le bien commun de la collectivité en tant que race, que classe ou qu’État fut le but avoué, et la justification de toutes les tyrannies qui furent imposées à l’homme. Les pires horreurs furent accomplies au nom de l’altruisme. Est-il possible que n’importe quel acte accompli par égoïsme ait jamais atteint aux carnages perpétrés au nom de l’altruisme ? La faute en est-elle à l’hypocrisie ou aux principes faux qu’on a inculqués aux hommes ? Les pires bouchers furent les hommes les plus sincères. Ils croyaient atteindre à la société parfaite grâce à la guillotine et au peloton d’exécution. Personne ne leur demanda raison de leurs meurtres, puisqu’ils les accomplissaient par altruisme. Les acteurs changent, mais la tragédie reste la même. Un être soi-disant humanitaire commence par des déclarations d’amour pour l’humanité et finit par faire verser des marres de sang. Cela continue et cela continuera tant que l’on fera croire à l’homme qu’une action est bonne à condition de ne pas avoir été dictée par l’égoïsme. Cela autorise l’altruiste à agir et oblige ses victimes à tout supporter. Les chefs des mouvements collectivistes ne demandent jamais rien pour eux-mêmes, mais observez les résultats.
Prenez maintenant une société édifiée sur le principe de l’individualisme, ce pays, le nôtre. Le pays le plus noble dans toute l’histoire du monde. Le pays des entreprises les plus grandioses, de la plus grande prospérité, de la plus grande liberté. La société n’y avait pas été basée sur la servitude, le sacrifice, le renoncement et autres principes d’altruisme, mais sur le droit de l’homme d’aspirer au bonheur. À son bonheur et non à celui de quelqu’un d’autre. Un but privé, personnel, égoïste. Regardez donc les résultats, et faites un examen de conscience.
C’est un conflit vieux comme le monde. Les hommes se sont parfois approchés de la vérité, mais chaque fois ils ont échoué près du but et les civilisations ont disparu les unes après les autres. La civilisation n’est rien d’autre que le développement de la vie privée. L’existence tout entière du sauvage se déroule en public, commandée par les lois de la tribu. La civilisation n’a d’autre but que de libérer l’homme de l’homme.
Or dans notre pays, en ce moment, le collectivisme, la loi des êtres de seconde zone et de second ordre, a brisé ses entraves et se déchaîne. Il a amené l’homme à un état d’abaissement intellectuel jamais atteint sur la terre, aboutissant à des horreurs sans précédent. Il a empoisonné la plupart des esprits, avalé la plus grande partie de l’Europe, commence à gagner notre patrie.
Je suis architecte. Je sais ce à quoi nous sommes en droit de nous attendre, étant donné les principes sur lesquels le collectivisme est construit. Nous approchons d’un temps où il ne me sera plus permis de vivre.
Vous savez maintenant pourquoi j’ai détruit Cortland. Je l’ai conçu, je vous l’ai donné, je l’ai détruit.
Je l’ai détruit, car il ne m’était pas possible de le laisser debout. C’était deux fois un monstre, par la forme et par l’intention. Il m’a fallu détruire l’un et l’autre. La forme fut mutilée par deux de ces parasites qui s’étaient octroyé le droit d’améliorer une œuvre dont ils n’étaient pas les auteurs et qu’ils n’avaient pu égaler. Et on les laissa faire sous le prétexte que le but altruiste du bâtiment surpassait toutes autres considérations. Que pouvais-je opposer à cela ?
J’avais accepté de faire le projet de Cortland pour la joie de le voir bâtir tel que je l’avais conçu et pour aucune autre raison. C’était là le prix que j’avais demandé pour mon travail.
II ne me fut pas payé. ‘
Je ne jette pas le blâme sur Peter Keating. Il était sans défense. Il avait un contrat avec l’État, ce contrat fut ignoré.
II avait reçu la promesse que le building serait érigé selon les plans du projet, cette promesse fut brisée. L’amour d’un homme pour son travail et son droit à le protéger sont actuellement considérés comme des notions vagues et confuses, ainsi que vous l’a dit tout à l’heure Monsieur le Procureur. Et maintenant pour quelle raison le building dont je vous parle fut-il défiguré ?
Sans raison. De tels actes ne sont jamais motivés, excepté par la vanité de quelques parasites qui se sentent des droits sur la propriété des autres, qu’elle soit matérielle ou spirituelle. Et qui leur a permis d’agir ainsi ? Personne en particulier parmi les nombreuses autorités. Personne ne s’est donné la peine d’autoriser cela ou de l’empêcher. Personne n’est responsable.
Telle est la caractéristique de toute action de la collectivité.
Je n’ai pas reçu pour mon travail le paiement que j’avais demandé. Les propriétaires de Cortland, eux, avaient reçu de moi ce qu’ils demandaient. Ils voulaient un projet leur permettant de construire aussi bon marché que possible. Personne encore ne leur avait donné satisfaction. J’y parvins. Ils prirent ce que je leur donnais et ne voulurent rien me donner en retour.
Mais moi je ne suis pas un altruiste et je ne fais pas de dons de ce genre.
On a dit que j’avais détruit le futur home de déshérités, mais sans moi les déshérités n’auraient pas eu ce home-là. On a dit aussi que la pauvreté des futurs locataires leur donnait des droits sur mon travail. Que leurs besoins exigeaient de moi certaines concessions, qu’il était de mon devoir de contribuer à leur donner du bien-être. C’est là le credo des parasites qui actuellement régissent le monde.
Je tiens à déclarer que je ne reconnais à personne des droits sur une seule minute de ma vie, ni sur mon énergie, ni sur mes œuvres, quels que soient ceux qui se réclament de ce droit, si nombreux soient-ils, si grands soient leurs besoins.
Je tiens à déclarer ici que je ne suis pas un homme qui existe en fonction des autres.
C’est une chose qui devait être dite, car le monde périt d’une orgie de sacrifice de soi-même.
Je tiens à déclarer aussi que l’intégrité de l’œuvre d’un artiste est plus importante que son but charitable. Ceux d’entre vous qui ne comprennent pas cela font partie de cette humanité qui est en train de détruire le monde. Je suis heureux d’avoir pu déclarer ici mes principes. Je ne puis en accepter d’autres.
Je ne me reconnais envers les hommes aucune obligation autre que celle-ci : respecter leur indépendance comme j’exige qu’ils respectent la mienne, ne jouer aucun rôle dans une société d’esclaves. Et si je suis condamné, cela voudra dire que mon pays n’est plus ce qu’il était. Et c’est à lui que je dédierai les années que je passerai en prison. Je les lui offrirai en témoignage de gratitude et d’admiration pour ce qu’il a été. Et mon refus de vivre et de travailler dans le monde tel qu’il est sera de ma part un acte de loyalisme.
À l’issue de sa plaidoirie, Howard Roark sera tout de même déclaré non coupable par le jury.
La Source vive est un roman, certes, mais les arguments développés par Howard Roark n’ont rien d’irréel et de vaporeux : ils sont bien au cœur de la création artistique et de la propriété intellectuelle. En témoignent les démêlées de Jean Nouvel avec la Philharmonie de Paris en 2015 :
Bâtir, c’est s’inscrire dans un territoire et dans son histoire ; imaginez un bâtiment et mettez le ailleurs : si ça va, c’est qu’il n’a rien à faire là.
[…] L’architecte devrait être celui qui fait le choix esthétique, humaniste, historique et poétique, mais aujourd’hui, il est exclu de ces choix à l’échelle de la métropole. Ce sont des données triviales qui dirigent et décident des projets : c’est le promoteur, dont l’objectif est de dégager un maximum de profits, qui a le pouvoir. En France, on pense que l’architecte est responsable de tout ; or, il n’a plus l’œil sur ce qu’il construit, il n’ a plus le pouvoir de choisir les entreprises qui vont réaliser les travaux, ni celui de les contrôler. Qui, alors, sera l’avocat des gens qui vont vivre et travailler dans ces lieux ?
[…] J’ai été évincé du projet [de la Philharmonie] dans des conditions scandaleuses. On me dit capricieux : c’est hallucinant ! Qu’un architecte se batte pour que ses bâtiments se construisent correctement, ça me paraît normal !
Jean Nouvel, interview du Monde du 17 octobre 2015
Les deux films – Le Rebelle de King Vidor, et La vie est belle de Frank Capra – ont un point commun : ils racontent des tentatives de transformation du réel à partir non pas de croyances mais de convictions fondées sur l’action. Cela rejoint l’idée romantique. Mais il y a un autre dénominateur commun, un bémol à ces deux célèbres divertissements, les personnages : Howard Roark, joué par Gary Cooper, et George Bailey, par James Stewart, ont vraiment l’air trop tartes pour incarner des héros romantiques crédibles. Ce n’est pas possible d’être aussi couillon dans la vie. L’angélisme, l’innocence du génie aux prises avec un monde cruel, moteur de ces deux comédies humanistes, frôlent la farce. Certes, on peut les regarder avec un plaisir régressif. À la rigueur, le rêve social de Bailey, un toit pour tous, en lutte contre le capital sans pitié, peut se comprendre, mais c’était en 1946. Depuis, la crise des subprimes a calmé les ardeurs. La pitié du capital est restée très relative et les moutons ont tout de même été tondus. Contre les usages des comédies américaines, l’histoire n’est pas venue, hélas, au secours des spectateurs. Les gentils n’ont pas gagné et les méchants ne l’ont pas eu dans l’os. Il y a mieux comme projet romantique, je trouve. La comédie humaniste est encore une fois une invention américaine pour tuer la larme à l’œil aux bobos des beaux quartiers. Moi j’ai envie de mettre le poing américain et de taper dans le mur pour éviter de devenir con.
Dans le film de King Vidor, l’architecte rebelle, apparenté par la légende à Frank Lloyd Wright malgré les démentis de l’auteur [Ayn Rand] du livre [Fountainhead – La Source vive] à l’origine du récit, campe une vision tout aussi utopique de la lutte. L’affrontement à mort entre une architecture d’abrutis, pasticheurs des trésors du passé, et une vision de l’auteur, forcément tourné vers un avenir forcément merveilleux, est un peu trop impérieux pour faire sens. Le héros représente une idée de la modernité que je combats, adepte de la rupture, de l’amnésie et de la table rase. Gary Cooper ne revendique ni perspective historique ni continuité. Il est seul contre tous. C’est bien fait pour sa gueule. Je ne m’estime pas seul. À Jean-Bouin, l’aide de Marc Malinowsky, brillant ingénieur des charpentes métalliques, fut décisive. Tout comme celle de Romain Ricciotti pour la géométrie de l’enveloppe ou encore de Sébastien Carminati, qui inventa les bielles vérins pour adapter les triangles isostatiques sur les charpentes toutes différentes pour des milliers de panneaux béton tous différents. Voilà, un combat, ça se prépare, et un commando, ça se coopte. Une poignée d’hommes suffit pour faire sauter le pont.
Un récit architectural ne se construit pas dans une tour d’ivoire. L’architecte a besoin de la connaissance de ceux qui l’entourent. Et le travail des autres me fascine. Je m’en imprègne. Il y a porosité. Ce n’est pas un monologue habité de quelques révélations divines. Il a raison et vous avez tort. Je ne commets pas l’erreur de penser que le sens commun a toujours tort, et que j’ai toujours raison. Dans le creuset, avant que les carottes ne soient cuites par les habitudes, il y a foule. Le sens fourmille de raisons. Il suffit d’écouter. Je suis prêt à changer d’avis, en commun, si l’on me démontre le bénéfice d’une nouvelle approche technique de la métaphore. Ainsi, des secrets m’ont été transmis par des chefs de chantier ou par des artisans d’exception comme Quenel, ferronnier du musée Cocteau, puissant inventeur surnommé Vulcain. Chaque corps de métier a les siens. La synthèse des savoirs ne s’invente pas, elle se désire. Les difficultés de mise en œuvre comptent dessus pour se résoudre. C’est une construction bâtie sur l’expérience, qui tire tous les protagonistes vers le haut. La culture de l’effort œuvre sur le fil d’une complexité sans cesse remise en cause. C’est une complexité utile. J’ai découvert des tas de choses essentielles au contact des artisans du bâtiment, des ingénieurs, de leurs travaux. Je répète souvent que je les aime. En fait, je leur dois tout, contrairement aux écoles où je me suis formé. Là-bas, rien dont je ne puisse me passer ne me fut transmis. La pédagogie actuellement appliquée ignore les velléités romantiques. Les élèves doivent se tenir en rang, tous dans la même ornière. Les professeurs snobent les étudiants. Les étudiants snobent leurs études. Les professeurs couchent avec les étudiantes et les élèves les plus courageux se tapent les femmes de leurs professeurs pour les initier aux fantasmes. Mon Dieu mais que fait la police ? Les écoles assoient leur autorité sur un exercice abusif du langage. La bonne parole y est distribuée comme l’on distribue des décorations ou des bons points. Les expressions dissonantes ont un zéro de conduite. Confisquée, la responsabilité d’entreprendre est confiée aux étudiants méritants, conformes aux murs du catéchisme. Quant aux rebelles, ils sont mis au piquet ou fusillés. Ou exilés. L’apprenti architecte, déconnecté de tout réseau de compagnonnage, reste seul contre tous. Dès les bancs des amphithéâtres, la ségrégation est à l’œuvre. La tragédie se joue à guichets fermés. La parole critique ne jure plus que par les injures faite aux professionnels. Le champ de parole parque les candidats à l’architecture dans des cages à lapins. Ils se font les dents sur la notion de perfection. Regarde peut-être Gary Cooper se débattre au milieu du vide ? Les survivants, croyez-moi, n’oublieront pas la leçon. Ils auront bien mérité d’être absolument romantiques. Il en faudra des symboles et des idées pour contrer la dictature des raisonnements, distinguer les voies d’une architecture qui vienne proposer ce que le public croyait impossible : de nouvelles histoires. Heureusement, la colonisation de l’architecture par la morale n’aura pas lieu tant qu’il y aura de l’appétit et du pastis. À la bonne vôtre ! Et du blanc de Cassis ! Les circonstances sont autant d’occasion d’interpeller la réalité, d’en extraire de nouveaux motifs. N’importe quel prétexte peut servir à ancrer un récit, à filer la métaphore, les ombres de la culture balnéaire du musée Cocteau par exemple. La difficulté d’être de l’architecture ne doit pas empêcher les jeunes architectes d’exister. Mais pour être valable, un jugement ne doit pas être conforme aux intérêts des juges. Seuls, une croyance, une expression, un projet, une technique, évoquent le détail du prospectus d’un voyage sous neuroleptiques. La vision terminale d’un espace traité comme un sanatorium. Suivez la flèche et prenez vos cachets. La chose jugée, l’architecture, doit rester libre de ses mouvements pour innover. Que les architectes montent aux barricades et refusent de payer la taxe puritaine de la modernité. Les savoir-faire sont prêts à expérimenter les idées. Ils se moquent de l’inspiration et n’attendent que le signal des aspirants à l’architecture pour liquider les dealers d’une convivialité minimale contre l’écriture, les identités, l’aventure. Le minimalisme confit dans la rétention est un fruit sans goût. Il faut gracieusement inviter les étudiants à se débarrasser définitivement de ce fruit lyophilisé.
Les travaux achevés, l’architecte passe de suite la main à son bâtiment, qui détient dans ses structures les secrets de l’action qui l’a engendré. La forme devient alors la mémoire vivante d’un élan, la tentative fragile de l’architecte de transformer une réalité, qu’il laisse à l’appréciation des habitants. Ainsi les accusations de mégalomanie ne tiennent pas. Que l’architecture soit la pétrification du politique, de l’économie ou de la culture, quoi de nouveau depuis qu’elle existe ? Ce sont toujours des prétextes pour casser de l’architecte, plus facile à casser que des murs de béton. Je ne marche pas dans la combine de réduire le pouvoir de l’architecte en convoquant un tribunal d’exception composé de mamans aérobic, d’enseignants cools-cycliste-végétariens-non-fumeurs, et de groupes identitaires classés par catégories socioculturelles. Cette posture est dramatique. L’idée pessimiste qui consiste à dire que le métier n’existe plus, qu’il est perdu, m’inquiète pour ce qu’elle cache. Même au bistrot, accoudé au comptoir. Au premier canon, tu déclares le métier part en couille, au douzième y a plus de métier, au trentième, les lèvres anesthésiées, tu es tellement bourré que tu demandes si le métier a existé un jour. Le métier doit être défendu. Pied à pied. Je m’autorise à lever le doigt pour ne pas laisser le silence s’installer auprès d’un public ignorant des enjeux de cette profession. La réserve, le détachement, affecter une distance coûte très cher à nos libertés, ne crée aucune distinction. En démocratie, la disparition de la parole publique est malsaine. L’architecture n’a rien à gagner à se taire, malgré ce que peuvent croire les néopenseurs sur l’humilité, volant thermique maximum de la grâce architecturale. Je crois que les architectes sont plus psychopathes que mégalomanes. Leur angoisse existentielle est de ne pas se sentir capables de passer à l’acte, là est leur authentique sensibilité. Le plus difficile, ce n’est pas de devenir architecte, c’est de le rester.
D’un autre côté, je fais confiance aux architectes. Ils ne lésinent pas sur les moyens de sélectionner le meilleur pour leurs projets. Ils peuvent se tromper sur l’idée du mieux, mais ils sont tous inspirés par la même volonté de le choisir. En France, les professionnels de l’architecture ont acquis un niveau d’excellence peu égalé dans le monde. Leur principale qualité est de savoir construire au moindre coût dans une jungle juridique diabolique. Les confrères étrangers confrontés à la réalité française se sont vautrés et l’ont bien senti, ou plutôt ce sont les maîtres d’ouvrage qui l’ont bien ressenti. Il n’y a pas de corruption intellectuelle, juste un esprit de compétition exacerbé par l’anxiété et le droit au travail. Le paradoxe de la situation ? Le pilonnage ininterrompu des critiques, toujours sur les mêmes cibles. Ce sont les plus visibles qui prennent les coups, souvent à la place du travail d’architectes à faible médiatisation et au tiroir-caisse plein. Parce qu’il y a des architectes inconnus du public dont on supporte les réalisations dans toutes les villes. Ils sont les Crésus de la profession en travaillant pour les banques, les compagnies d’assurances, les marchands de biens. Pourquoi pas, s’ils mettent leur intelligence à créer une architecture respectueuse de la perspective historique, du bien commun ? Mais on leur doit trop souvent la reproduction de façades cache-misère de bâtiments montés à la chaîne, pour plus de rentabilité sur les marchés. Ils installent des centres commerciaux au gré des opérations, des supermarchés et des sièges de sociétés. Ce sont les rois de l’optimisation du rapport surface utile/coût de construction. Ils se moquent de l’architecture, mais pas de leur carnet de commandes. On ne les connaît pas. Ce sont des gendres idéals, avec résidence secondaire en Sologne. Ils habitent Paris, Lyon, Lille, Marseille, Bordeaux dans un cadre cossu et discrètement contemporain, vivent tous avec un chien et conduisent un 4×4. À l’heure du vélo électrique roi, ils conduiront des voiturettes avec intérieur cuir. Ils sont vraiment le gendre idéal.
[…] L’architecture est un vrai parcours du combattant. Près de 70 % des architectes inscrits à l’ordre ne réussissent pas à vivre de leur travail. 5 % des maisons individuelles sont signées par un architecte, les autres sont aux mains des opérateurs immobiliers. De même pour les rénovations des façades, a priori subalternes, en fait très importantes du point de vue du paysage urbain. Outre la maîtrise d’œuvre, il y a des pans entiers de la maîtrise d’ouvrage qui devraient être pris en main par les architectes. Une maîtrise très aléatoire dont l’absence d’expertise sur l’architecture, l’urbanisme, l’environnement, n’empêche pas de prendre des décisions sur ces sujets. Peut-on imaginer un programme d’aménagement de blocs opératoires mené par des commerçants hors de toutes compétences médicales ? Nombreux sont ceux qui aiment endosser l’habit d’architecte, en oubliant la plupart du temps le chapeau qui va avec. Bizarre, non ?
Portée par les systèmes de décisions, la médiocrité fait banquet. Dans le cadre de la maison individuelle, la loi autorise à se passer d’un architecte pour des constructions en dessous de 170 m², laissant le champ libre aux promoteurs et autres vendeurs de maisons qui font là où ils peuvent faire, c’est-à-dire partout, pourvu que le client ait de quoi s’offrir la même cabane que son voisin de terrain. De jolis ensembles dans le style normand ou provençal, une dalle, des murs, un toit, financés par des crédits bancaires à cheval sur une vie. Une vie pour se payer un rêve, ce n’est pas grand-chose… Une paille qui fait flamber les économies des ménages. En effet, les banques savent être compréhensives et ratissent large pour défendre leurs intérêts. La loi des séries est un carnage sauvage. Et ne comptez pas sur le promoteur pour changer d’architecture, il y perdrait le sommeil et sa marge bénéficiaire. Le résultat : après la destruction des identités régionales, ne restent que des signes pauvres répétés à l’infini, de quoi donner la nausée au plus inflexible des propriétaires. Ce sont les mécanismes de la mondialisation appliqués au régionalisme. Le matraquage en parpaing assomme l’autochtone, pris entre l’injonction pavillonnaire et l’acquisition du dernier home cinéma 3D. Siphonnée, la substance passe aux pertes et profits du bilan des territoires. Le reliquat termine au musée du coin ou anime les kermesses des supermarchés qui s’habillent aux couleurs locales le temps d’une opération spéciale jambon d’Aoste. Ce massacre mériterait d’organiser une partie de pelleteuses, sponsorisée par Caterpillar, mais cela ne suffirait pas. Le régionalisme est une autre version de la globalisation. Le champ de bataille s’est déplacé. La simple critique n’a plus de prise. Elle a dévissé depuis longtemps. On la cherche encore au fond du ravin. Il y a bien de rares défenseurs des régions qui s’en préoccupent encore avec assez de colère pour accoucher de quelques lignes en bas de page des grands quotidiens, mais ils sont relégués à la rubrique des chiens écrasés, et ne réussissent plus à mobiliser au-delà de la brève. Ces irréductibles restent isolés les uns des autres, vaguement regroupés au sein d’associations exsangues. Les Corses résistent toujours, mais les dérives mafieuses ont galvaudé en partie leur lutte. Trop de plastique tue le messager, le message et le crédit accordé aux actes. Au début de ma carrière, sudiste convaincu, je frappais d’anathème le régionalisme immobilier. J’imaginais des opérations coups de poing contre la prolifération des tuiles typiques, devenue en Méditerranée une allégorie de la colonisation des esprits. Vous habitez en Provence, vous habiterez avec des tuiles provençales et en supporterez toute votre vie ! Je suis même passé à l’acte, contre le permis de construire qu’un architecte des bâtiments de France (ABF) avait validé, pour la rénovation de la station-service de l’architecte Fernand Pouillon, à La Seyne-sur-Mer, le remplacement des voûtes en brique de la structure originale par des tuiles ! Encore et toujours cette même mer de tuiles, pâle métaphysique à la gloire de tous les renoncements. Ni plus ni moins une censure irréfléchie d’un morceau de l’histoire de l’architecture des Sablettes en bord de mer. De tuile en tuile, insidieusement, on façonne une banalité écrasante, un paysage de mauvais jeux de mots, de cabanes à frites surgelées à réchauffer au micro-ondes avant ingestion. Un oukase à l’image de ce que peut produire de pire l’administration française quand elle se mêle d’urbanisme pour niveler les différences. Avec l’aide d’un maçon, M. François Escoriza, j’ai conduit à titre gracieux la reconstitution des voûtes croisées en brique, à l’identique de l’édifice de Pouillon. Hold up à la station service ! C’était un acte de protection et de restitution contre la barbarie rénovatrice.
Et il y eut d’autres aventures, hélas plus malheureuses. Lorsque j’ai restauré une nef de l’église de Bandol, après décroûtage du crépi rustique- style pizzeria des années 1970, j’avais découvert une fresque datant du milieu du XVIII° siècle. J’avais missionné à mes frais un collaborateur, Pierre Abecassis pour prendre le rôle de restaurateur. Peu de temps après, à la demande du curé, la fresque historique était recouverte de peinture- synthétique couleur rose saumon. Amen !
[…] Le temps me fera forcément lâcher prise un jour. Pour l’instant, il use les architectes avec le quotidien. Ils sont nombreux à abandonner devant l’adversité, comme Aurelio Galfetti, plutôt que d’y laisser leur peau. Comme Jacques Hondelatte au palais de justice de Bordeaux ou Claude Vasconi avec l’hôpital de Monaco qui, eux, y ont laissé leur peau. [On peut ajouter Johann Otto von Spreckelsen, architecte danois de la Grande Arche]. L’enfer n’est pas de lui tenir tête, plutôt de ne pas céder à la barbarie avant le terme. Sur ce point, je ne lâcherai jamais. L’effort est mon affaire. Mais revenons aux affaires.
La pornographie d’une réglementation omniprésente fait plus de dégâts que tous les enterrements réunis d’architectes en activité. L’ambition de l’architecture est de combler les déficits, de réanimer au bouche-à-bouche les usages, et de recoudre les territoires. La formalisation d’un récit tridimensionnel engage. La mémoire se réveille si l’on prend soin d’elle. Il ne s’agit pas d’une architecture en hommage au passé, bien que l’on puisse se demander un jour : et pourquoi pas ? La continuité entre patrimoine et création est une clé de compréhension précieuse, l’histoire des gestes une perspective éclairante à l’image de l’architecture de terre en Afrique. L’intention est de pallier une absence, d’écrire à nouveau une histoire commune, contemporaine des contextes et des circonstances. La métaphore est à son service. Aucune emphase dans cette idée ? L’architecture révèle qui nous sommes. La beauté est incarnée par ce que l’on souhaite ne jamais voir détruit, et la laideur par ce qui est le fruit du marketing et de la com. Dans ce cadre, éprouver le besoin de violence esthétique pour contrer la voracité des règles de pensée fait sens. L’hédonisme doit être provocateur. Le beau et le laid ne sont pas finalités, ils activent des processus monopolisant les perceptions. Une erreur d’orientation vous condamne à l’enfer. Tant pis, il faut prendre le risque. Le rêve est de transformer le réel, de lui suggérer de nouvelles croyances, des histoires éloquentes.
Pour avancer, il faut ruser. Les requins rôdent. La réglementation élargit toujours au plus près des dernières tendances le champ de ses interventions. La manipulation politique s’empare de toutes les idéologies à disposition. Et le développement durable n’est pas la dernière. J’ai assisté à la naissance de la sensibilité environnementale et à sa capture définitive par les commissaires politiques d’une terreur verte, aveugles aux réels enjeux de l’écologie. À l’époque, il y a quelques années, j’avais exprimé des réserves dans mon pamphlet : HQE : les renards du temple, même si la prise de conscience citoyenne sur ces sujets me semblait prometteuse. Depuis, les Verts sont devenus des criminels de l’environnement. Leurs pratiques idéologiques justifient un consumérisme technologique aux coûts exorbitants en matière d’empreinte environnementale. En une génération, nous sommes passés de la fourrure verte à la terreur verte, une esthétique de la démagogie comparable aux effets d’une bombe à fragmentations. Tout le monde déguste ! C’est un vrai désastre. Elles ont du souci à se faire, les générations futures. Couplée au chaos provoqué par les prétentions urbanistiques, l’inexpertise des Verts constitués en lobby politique fait perdre aux architectes tout devoir critique. Sur la question de l’isolation thermique, la problématique est courte, ils ne se rendent pas compte de ce qu’ils sont en train de faire. Quel sujet désolant pour les confrères ayant peu de commandes. Un truc à se pendre dans la cuisine ! Au lieu de prôner une augmentation de l’isolation thermique, source de surchauffe, de surconsommation d’électricité pour ventiler, parce qu’il faut faire respirer les bâtiments, il serait plus utile d’attaquer la notion de température de confort en baissant les exigences, ce qui serait plus citoyen. Dans ce cas précis, les exigences de confort sont la clé de l’équation, pas celles des performances. Plus vous étoffez la réglementation en imposant dans les textes une isolation performante, plus vous stimulez une inflation des technologies, la mise en place de machines de plus en plus puissantes, de plus en plus sophistiquées, qui consomment à tout-va énergies et métaux rares pour se réguler. Plus, plus et encore plus. Ce sont les exigences de confort qu’il faut contester, la baisse des critères tous azimuts, pas l’isolation et son cortège de solutions dramatiques et amnésiques. Les règles en vigueur sont des sommations organisées autour d’une consommation des ressources accablante. Un dressage au développement durable comme l’on dresse les chiens à mordre, debout, couché ! Une fois encore l’arrogance occidentale se charge de donner la leçon au monde en bouffant l’empreinte environnementale d’un terrain de football pour faire un thermostat contre le mur relié à une pompe à chaleur de merde tout alu et inox. Pratiquer la désobéissance technologique est le dernier acte libertaire de l’architecte debout. Le politiquement correct et ses lettres de cachet atteignent ainsi l’acmé d’une dimension outrancière ne fabriquant aucun bénéfice économique ou social. Ce carnage s’ajoute aux importations des matériaux de la modernité, venus de lointains pays, surtout en voie de développement, pour ne pas salir nos chantiers des beaux quartiers. En revanche, nos déchets à l’autre bout de la planète ne dérangent personne. L’architecture de manufacture devient la couche-culotte d’une architecture du troisième âge, maniaque de la propreté. Avant la fermeture définitive de la raison, j’essaye de survivre et d’exercer mon métier. Je fais ce que je peux, pas ce que je veux. Contre cette réglementation assassine, je filoute, fais du slalom entre les bornes, pratiquant la résistance technologique pour ne pas dire politique ou idéologique. Sale ici et propre ailleurs est mieux que l’inverse. J’utilise le béton car il est une matière généreuse. Il me conforte dans l’idée d’une architecture gastronomique. Il génère une répartition territoriale des richesses, économise les ressources – l’énergie primaire, l’eau, les terres rares -, valorise les savoir-faire. Le béton défend une culture du travail territorialisé et résiste à la délocalisation des métiers. La résistance peut s’organiser en filtrant les choix des technologies au bénéfice de l’empreinte environnementale des matériaux les plus probants, en utilisant l’acier ou l’aluminium uniquement par défaut. Mais les sangsues de l’environnement ne chôment pas. Sous la dictée de l’hystérique gobeur consumériste, les écoquartiers poussent comme des orties. De préférence sur des territoires qui n’exploitent pas les infrastructures routières ou les réseaux installés. Les tartufes préfèrent partir de zéro, sans ingrédients pour cuisiner, et ne se risquer ni à la roquette sauvage ni même aux truffes, bien trop suspectes.
Érigés sur des friches industrielles rasées pour l’occasion, les écoquartiers sont les artefacts d’un projet instable, futures et immédiates friches à détruire tant la précarité des matériaux en est l’identité. Un peu de farine, un peu d’eau, beaucoup de sel, du sucre et du gras de palme pour faire passer le tout, c’est une très mauvaise pâte. Les valeurs du caractère réversible de ces constructions camouflent un déséquilibre lustré par une débauche d’énergie consumée, consommant une précarité durable, pour un résultat vraiment épatant ! Le troc d’un bénéfice de solidité contre une réversibilité douteuse amène à s’interroger très sérieusement sur la démarche. Les écoquartiers sont déjà les cités de demain. Construire un consumérisme ayant pour objet la précarité relève d’un cheminement maladif qui donne inévitablement envie de perfectionner le tir au canon pour tirer dans le tas. Décidément, cela devient une obsession. La maturité me rend nerveux et ultrasensible. J’ai pu apercevoir au ministère de la Ville la couverture d’un livre sur les écoquartiers : une ronde d’enfants sur la pelouse entourée de mamans aérobic aux sourires équivalents à celui de l’infirmière psychiatrique torturant Jack Nicholson dans Vol au-dessus d’un nid de coucou – peut-être celles du tribunal d’inspection des vertus de l’architecture, venues prêter main-forte à leurs collègues de l’environnement ? Demain peut-être une milice verte comme les Pasdaran qui en Iran contrôlent à domicile l’absence d’alcool ? Qui sait ? L’exhibition à l’excès du plaisir de vivre ensemble est une caricature d’une violence obscène. Zapping de l’année, seul, devant sa télé, un 31 décembre. L’horreur des écoquartiers renvoie au délitement d’un espace public emprisonnant les réalités de l’environnement dans des analyses absurdes de bonnes intentions manquées. Un silence coupable sur les réels enjeux de la situation. Un lieu de désunion. Les couples s’y feront tous cocus. Tous cocus ! Tous ensemble ! C’est le divorce assuré. Les retraités divorceront d’ailleurs en masse, des liens se créeront entre race bovine et race humaine et les dépressions seront en pandémie. De nouvelles maladies de peau seront transmises par les moutons à nos forces armées. Les suicides par pendaison suivront. Tu sens que c’est joué d’avance.
Rudy Ricciotti. L’architecture est un sport de combat. Textuel 2013
Il est difficile d’être un homme. Mais pas plus de le devenir en approfondissant sa communion qu’en cultivant sa différence, – et la première nourrit avec autant de force au moins que la seconde ce par quoi l’homme est homme, ce par quoi il se dépasse, crée, invente et se conçoit.
André Malraux. Préface. Le temps du mépris 1935
1943 – 1944
Les tempêtes endommagent les câbles de haute tension qui passent au col du midi et alimentent le laboratoire des Cosmiques, au pied de l’Aiguille du Midi, dans le Massif du Mont Blanc.
15 01 1944
La terre tremble à San Juan, en Argentine, tuant environ 10 000 personnes. Lors d’une représentation au bénéfice des victimes, Maria Eva Duarte, comédienne, présidente de syndicat, rencontrera Juan Péron, colonel et secrétaire d’État, qu’elle épousera l’année suivante, devenant Eva Péron.
17 01 1944
Un sous-marin anglais de poche approche les côtes normandes, avec pour mission d’y inspecter la nature du sol des plages ; le major Logan Scott Bouden, 23 ans et l’un de ses hommes partent à la nage pour prélever un échantillonnage de sable et de galets – ils sont sur la future Omaha Beach – et le rapporter à leurs supérieurs à Londres avec un avis défavorable : cette plage est très risquée ; je la déconseillerais…
27 01 1944
L’armée rouge entre à Leningrad : deux ans de siège auront fait plus d’un million de morts ! dont 700 000 de septembre 1941 et juillet 1942, quinze fois la mortalité habituelle ! près d’un habitant sur trois est mort. La supériorité numérique des Russes devient écrasante : ils ont pas loin de 6 millions d’hommes sous les armes, contre 2.8 pour la Wehrmacht, 10 000 avions contre 2 000 pour la Luftwaffe.
28 01 1944
Se battant au sein des troupes coloniales sous les ordres du général Juin, Alain Mimoun, algérien natif d’El-Telagh, est blessé à la jambe à la bataille de Monte Cassino, sur les pentes du Mont Arunchi ; il évite de justesse l’amputation. Les Allemands s’étaient très bien préparé à cette bataille et les importantes mésententes au sommet entre Anglais et Américains entraineront la défaite de la première phase. Les Alliés feront donner l’aviation : le monastère sera bombardé – 576 tonnes – , après que les Allemands aient assuré l’évacuation des moines et des biens de valeur ; dans la plaine, le village Cassino sera lui aussi rasé ; les alliés débarqueront au nord, à Anzio pour prendre les Allemands à revers, au nord de la ligne Gustav, en vain. Le général Alexander fera venir de la côte Adriatique 9 divisions pour préparer secrètement et minutieusement la dernière offensive, très étalée dans l’espace, le 11 mai 1944 : ce sera la bonne, menant à la reddition allemande ; mais le général Clark, américain, voudra marcher prématurément sur Rome, laissant libre la route aux troupes allemandes encore actives : il y triomphera le 4 juin, deux jours avant le débarquement en Normandie, front pour lequel Alexander devra donner plusieurs divisions, autant de moins pour poursuivre la guerre en Italie !
Monte Cassino. Une colline haute de cinq cent mètres qui domine la route menant de Rome à Naples, dans la région du Latium – celle-là même où Enée finit par arriver après tant d’errances – et au sommet de laquelle, au sixième siècle, Benoît de Nursie fonda une abbaye.
Monte Cassino. Un verrou de la ligne Gustave que les Alliés ont besoin de faire sauter pour continuer leur progression en Italie. Naïma a regardé plusieurs documentaires pour comprendre les mouvements militaires qui ont composé cette bataille (en réalité quatre batailles successives). Elle n’a toujours rien compris.
Monte Cassino. Les bombes lancées par des centaines de bombardiers qui pleuvent à verse et dessous, les bâtiments de l’abbaye déjà plusieurs fois détruits au fil des siècles qui meurent à nouveau, se mettent à pleuvoir eux aussi en gravats poudreux.
Monte Cassino. Parois inhospitalières, rochers debout dont on a éliminé la végétation pour mieux voir et qui n’offrent ni caches ni boucliers.
Monte Cassino où la bataille des phasmes, minces présences suspendues au roc et s’épuisant à se rendre invisibles. Une fois entamée l’escalade, les assaillants ne peuvent plus bouger, manger ni boire chaud car le moindre panache de fumée signale leur présence aux Allemands installés sur le mont. Mitraillettes et tirs de mortiers en grêlons.
Monte Cassino, le fleuve, tout en bas, sur lequel les Alliés tentent de construire des ponts. Souvent, il coule rouge.
Monte Cassino. Les gémissements dans six ou sept langues différentes. Tous les mêmes, pourtant : J’ai peur, j’ai peur, je ne voudrais pas mourir.
Durant les quatre batailles du Mont, les hommes des colonies ont été envoyés en première ligne : Marocains, Tunisiens et Algériens du côté français, Indiens et Néo-Zélandais du côté anglais. Ce sont eux qui fournissent les morts et les blessés qui permirent aux Alliés de perdre cinquante mille hommes sur un massif montagneux.
Je crois que le début du film Indigènes est supposé montrer la bataille de Monte Cassino. On y voit l’assaut difficile d’un mont. Mais comme c’est la début du film et que l’on ne peut pas sacrifier les personnages auxquels le spectateur vient tout juste de s’attacher, c’est une bataille qui, curieusement se passe mal sans qu’aucun gentil ne meure. Dans ma tête, Monte Cassino ressemble davantage à La Ligne rouge de Terrence Malick. C’est une longue boucherie lassante dans un lieu qu’aucune topographie ne peut rendre compréhensible.
Parmi les soldats de l’armée d’Afrique accrochés au flanc du mont, il y a Ali, mais aussi Ben Bella et Boudiaf, respectivement premier et quatrième présidents de la future Algérie indépendante. Ils ne se sont pas rencontrés. Peut-être cette histoire eut-elle été très différente s’ils en avaient eu l’occasion.
Alice Zeniter. L’art de perdre. Flammarion. 2017

Ce qu’il reste du monastère de Monte Cassino après la bataille de 1944

aujourd’hui
La bataille fait rage depuis presque deux mois et elle n’est pas terminée. L’État-major américain a ses obligations de protocole, entre mondanités et prises de contact. Ainsi le général Cork est-il amené à organiser une soirée dans un château pour recevoir Mrs Flat, générale en chef des Wacs – Women Army Corps. Mais il y a longtemps que l’Italie du Sud n’est plus à même de fournir les denrées nécessaires, aussi faut-il faire avec les rations de campagne : et là, la barbarie se révèle être du coté des vainqueurs, la civilisation du coté des vaincus, même s’ils viennent de devenir alliés :
Ici, interrompant le rire des convives, la porte s’ouvrit, et sur le seuil apparurent quelques valets en livrée, soulevant à deux mains d’immenses plateaux d’argent massif.
Après les carottes à la crème, assaisonnées de vitamines D et désinfectées dans une solution à 2 % de chlore, l’horrible spam arrivait sur la table, le pâté de viande de porc, gloire de Chicago, disposé en tranches couleur pourpre sur une épaisse couche de maïs bouilli. Je reconnus que les valets étaient Napolitains, moins à leur livrée bleue, aux revers rouges de la maison du duc de Tolède, qu’au masque d’épouvante et de dégoût imprimé sur leur visage.
Je n’ai jamais vu de visages plus méprisants que ceux-là. C’était le profond, l’antique, l’obséquieux, le libre mépris de la valetaille napolitaine pour tout maître étranger et rustre. Les peuples qui ont une antique et noble tradition d’esclavage et de faim, ne respectent que les maîtres qui ont des goûts raffinés et des grandes manières. Il n’est rien de plus humiliant, pour un peuple réduit à l’esclavage, qu’un maître aux manières frustes, aux goûts grossiers. Parmi ses nombreux maîtres étrangers, le peuple napolitain n’a conservé un bon souvenir que de deux Français, Robert d’Anjou et Joachim Murât : le premier savait choisir un vin et apprécier une sauce, et le second non seulement savait ce qu’est une selle anglaise, mais savait aussi tomber de cheval avec une suprême élégance. À quoi bon traverser la mer, envahir un pays, gagner une guerre, couronner son front du laurier des vainqueurs, si l’on ne sait pas se tenir à table ? Qu’étaient donc ces héros américains qui mangeaient du maïs comme les poules ?
Spam frit et maïs bouilli ! Les valets portaient les plateaux à deux mains, en détournant leur visage comme s’ils apportaient sur la table la tête de Méduse. Le rouge violacé du spam, qui, une fois frit, prend des tons noirâtres, de viande pourrie au soleil, et le jaune du maïs, tout veiné de blanc, qui à la cuisson se défait, jusqu’à ressembler au maïs dont est parfois gonflé le gésier d’une poule noyée, se reflétaient faiblement dans les grands miroirs de Murano embués, qui sur les murs de la salle alternaient avec d’anciennes tapisseries de Sicile.
Les meubles, les cadres dorés, les portraits des Grands d’Espagne, le Triomphe de Vénus peint au plafond par Luca Giordano, toute l’immense salle du palais du duc de Tolède, où le général Cork offrait ce soir-là un dîner en l’honneur de Mrs. Flat, générale en chef des Wacs [Women Army Corps. ndlr] de la Cinquième Armée américaine, se teignit peu à peu de la lueur violacée du spam et du pâle reflet lunaire du maïs. Les gloires des ducs de Tolède n’avaient jamais connu une aussi triste mortification. Cette salle qui avait accueilli les triomphes aragonais et angevins, les fêtes en l’honneur de Charles VIII de France et de Ferrant d’Aragon, les danses, les tournois d’amour de la brillante noblesse des Deux-Siciles, s’engloutit doucement dans une terne lumière d’aube mourante.
Les valets inclinèrent les plateaux devant les convives, et l’horrible repas commença. Je tenais mes yeux fixés sur les valets, absorbé par la contemplation de leur dégoût et de leur mépris. Ces valets portaient la livrée de la maison de Tolède, ils me reconnurent, me sourirent : j’étais le seul Italien qui participât à cet étrange banquet, j’étais le seul qui pût comprendre et partager leur humiliation. Spam frit et maïs bouilli ! En observant le dégoût qui raidissait leurs mains gantées de blanc, je découvris tout à coup, sur le bord de ces plateaux, une couronne : mais ce n’était pas la couronne des ducs de Tolède.
Je me demandais de quelle maison, et par quel mariage, par quel héritage, par quelle alliance, ces plats étaient venus jusqu’aux palais des ducs de Tolède, lorsque, baissant les yeux sur mon assiette, je crus la reconnaître. C’était une des assiettes du fameux service en porcelaine des princes de Gerace. Je pensai avec un sentiment de tristesse affectueuse à Jean Gerace, à son beau palais de Monte di Dio, éventré par les bombes, à ses trésors artistiques pillés et dispersés Dieu sait où. Je promenai mes yeux tout le long du bord de la table, et devant les convives je vis briller les célèbres porcelaines pompéiennes de Capodimonte, auxquelles sir William Hamilton, ambassadeur de Sa Majesté Britannique à la Cour de Naples, avait donné le nom d’Emma Hamilton : et c’est par le nom d’Emma, suprême et pathétique hommage à la malheureuse Muse d’Horace Nelson, qu’on désigne justement à Naples ce service de porcelaine que Capodimonte a reproduit d’après l’unique modèle retrouvé par sir William Hamilton dans les fouilles de Pompéi.
J’étais heureux et ému que ces porcelaines, de si ancienne et illustre origine, qui portaient un nom si cher, honorassent la table du brave général Cork. Et je souris de plaisir en pensant que Naples, vaincue, humiliée, détruite par les bombardements, meurtrie par l’angoisse et la faim, pût encore offrir à ses libérateurs un aussi aimable témoignage de sa gloire passée. Quelle ville courtoise, que Naples ! Quel noble pays, que l’Italie ! J’étais orgueilleux et ému de ce que les Grâces, les Muses, les Nymphes, les Vénus, les Amours, se poursuivant au bord de ces belles assiettes, confondissent le rose délicat de leurs chairs, le bleu subtil de leurs tuniques, l’or caressant de leurs cheveux, avec l’éclat vineux de l’affreux spam.
Ce spam venait d’Amérique, de Chicago. Qu’elle semblait loin de Naples, Chicago, pendant les années heureuses de la paix ! Et maintenant l’Amérique était là, dans cette salle, Chicago était là, dans ces porcelaines de Capodimonte consacrées au cher souvenir d’Emma Hamilton. Ah ! quel malheur d’être fait comme je suis fait ! Ce dîner dans cette salle, autour de cette table, devant ces assiettes, m’avait tout l’air d’un pique-nique sur une tombe.
J’étais sur le point de m’attendrir, quand j’entendis la voix du général Cork.
Croyez-vous qu’il existe, en Italie, un vin plus exquis que ce délicieux vin de Capri ?
Ce soir-là, en l’honneur de Mrs. Flat, à côté de l’inévitable lait en boîte, de l’inévitable café, de l’inévitable thé et de l’inévitable jus d’ananas, le vin avait fait son apparition sur notre table. Le général Cork nourrissait pour Capri une tendresse presque amoureuse, au point d’appeler a delicious Capri wine ce petit vin blanc d’Ischia, qui tire son nom de l’Epomeo, le grand volcan éteint qui se dresse au cœur de l’île.
Chaque fois que la situation sur le front de Cassino consentait une trêve à ses préoccupations, le général Cork m’appelait dans son bureau, et après m’avoir dit qu’il était fatigué, qu’il ne se sentait pas bien, qu’il avait besoin de deux ou trois jours de repos, il me demandait en souriant si je ne pensais pas que l’air de Capri lui ferait du bien. Je répondais :
Mais certainement! l’air de Capri est justement fait pour remettre d’aplomb les généraux américains !
Curzio Malaparte. La Peau. Denoël 1947

Capri remet aussi d’aplomb Malaparte lui-même, avec la Villa d’Adalberto Libera, dont le célèbre escalier sera souvent utilisé comme lieu de tournage.
Enlevez ses visiteurs à Naples, la ville reste telle quelle, sonore, grasse et sûre d’elle. Enlevez ses spectateurs, ses figurants à Venise, elle déprime et s’effondre en une semaine, perdant son texte, comme une vedette qu’on obligerait à jouer chaque soir devant un parterre vide.
Régis Debray
01 1944
Boris Cyrulnik, alors âgé de 7 ans, est pris dans une rafle de juifs à Bordeaux : emmené à la grande synagogue, il va trouver le moyen de se cacher dans le double-plafond d’un WC où il patientera jusqu’à pouvoir s’échapper, une fois le calme revenu.
30 01 au 8 02 1944
Conférence à Brazzaville, au Congo, qui rassemble tous les cadres coloniaux de l’empire, à l’exception des cadres de l’Indochine, encore occupée par les Japonais, le tout sous la présidence du général de Gaulle, chef du GRPF – Gouvernement Provisoire de la République Française -. On en fit l’acte d’émancipation de l’Afrique Française, quand son préambule disait précisément le contraire : […] Les fins de l’œuvre de civilisation accomplie par la France dans les colonies écartent toute idée d’autonomie, toute possibilité d’évolution hors du bloc français de l’Empire ; la constitution éventuelle, même lointaine de self-goverments dans les colonies est à écarter.
Mais de Gaulle, dans son discours d’ouverture dit précisément le contraire, se montrant adepte du grand écart, même, vu sa taille, du très grand écart : […] N’y aurait-il aucun progrès, si les hommes sur leur terre natale n’en profitaient pas matériellement et moralement, s’ils ne pouvaient s’élever peu à peu jusqu’au niveau où ils seront capables de participer, chez eux, à la gestion de leurs propres affaires. Tel est le but vers lequel nous avons à vous diriger. Nous ne nous dissimulons pas la longueur des étapes.
*****
Avant même la fin de la guerre, du 30 janvier au 8 février 1944, la conférence de Brazzaville fut convoquée par le Comité français de la Libération Nationale afin de déterminer le rôle et l’avenir de l’empire colonial français. C’est à l’issue de cette conférence que l’abolition du code de l’indigénat, sous le couvert duquel tant d’abus aveint été commis, allait être retenue. C’est enfin au cours de cette même conférence qu’allait être décidée non pas l’indépendance des colonies mais au contraire la mise en place d’une politique d’assimilation de leurs populations au sein de la République française. Alors la métropole allait enfin financer le développement de ses colonies érigées en territoires de la République.
Philippe San Marco. Sortir de l’impasse coloniale. Mon petit éditeur 2016
02 02 1944
Pierre Brossolette, Émile Bollaert et une trentaine d’autres marins et aviateurs alliés ont voulu s’embarquer pour l’Angleterre depuis le port breton de l’île Tudy, mais la pinasse le jouet des flots a une voie d’eau et s’échoue à Feunteun Aod à Plogoff, sans parvenir à rejoindre la frégate anglaise qui les attendait au large de Sein. À terre, ils sont dénoncés par une collaboratrice, et emmenés à la prison Jacques Cartier de Rennes.
6 02 1944
Les nazis avaient crée de nombreuses maternités en Allemagne pour régénérer la race, les pères étant de beaux aryens, souvent SS ou officiers de la Wehrmacht : leur choix se porte ce jour sur la petite ville de Lamorlaye, dans l’Oise, plein nord de Paris, équidistante de Paris et de Beauvais ; il faut croire que les Françaises, les Belges et les Hollandaises étaient suffisamment nombreuses à attendre un enfant d’un Allemand pour justifier ce choix : il y aurait eu 23 naissances. La durée de vie de l’établissement sera courte – 185 jours – après quoi la maternité pliera bagages le 10 août 1944, emportant avec elle les enfants en Allemagne, évidemment nés de père et de mère inconnus.
8 02 1944
Jeannette Guyot, 25 ans, est parachutée en Indre et Loire, près de Loches : c’est la mission Pathfinder, chargée de trouver des planques pour les membres du commando Sussex : en six mois elle va en trouver une centaine, jusqu’au cœur de Paris. Elle avait commencé par rejoindre en Bourgogne, peu après la défaite le réseau clandestin Amarante, dirigé par Félix Svagrowsky au sein duquel elle avait la charge d’exfiltrer en zone libre des agents trop exposés en zone occupée. Puis elle avait intégré un réseau du colonel Rémy, du BCRA à Londres, pour mettre en place le réseau de la Confrérie Notre Dame. Arrêtée à Chalons sur Saône en février 1942, elle n’avait pas parlé malgré des interrogatoires musclés et avait été relâchée trois mois plus tard faute de preuves. Réfugiée à Lyon après la trahison de son réseau elle rencontre Jacques Robert du réseau Phratrie, suite de la mission Pathfinder, en charge entre autres de planquer les aviateurs anglais dont les avions ont été abattus. Mais l’étau de la Gestapo se resserre et elle s’envole pour l’Angleterre le 14 mai 1944 ; affectée à l’école de Praewood House, au nord de Londres, elle y est formée aux techniques du renseignement militaire par des instructeurs de l’Intelligence Service et de l’Office of Strategic Service avant d’intégrer le plan Sussex, en vue du débarquement allié de Normandie.
À la fin de la guerre, elle apprendra la mort de son père en déportation en Bavière et pourra accueillir sa mère, survivante de Ravensbrück. Chevalier de la Légion d’honneur, Croix de guerre avec palmes, décorée de la British George Medal et de l’American Distinguished Cross, accordée à 2 femmes seulement, l’autre étant Virginia Hall, une américaine opératrice de radio et chef de réseau qui, au sein du SOE, puis de l’OSS américain, aida considérablement la Résistance Française du Lyonnais et du Centre. Devenue unijambiste suite à un accident de chasse, elle parviendra à semer Klaus Barbie qui aurait beaucoup aimé l’accrocher à son tableau de chasse, en passant les Pyrénées malgré sa jambe de bois. Jeannette Guyot mourra à 97 ans, en avril 2016, sortie d’un oubli qu’elle avait elle-même voulu par le Daily Telegraph, puis par Le Monde. Une bien grande dame.
14 02 1944
Fritz et Anne Finaly, juifs réfugiés dans un village près de Grenoble, sont capturés par la Gestapo : ils sont déportés à Drancy puis à Auschwitz où ils seront gazés. Auparavant, ils avaient confié leurs enfants – Robert, né en avril 1941 et Gérald, en juillet 1942 – à la directrice d’un établissement catholique, Mademoiselle Brun. L’affaire va faire alors grand bruit. À la fin de la guerre, une tante australienne écrit à Mademoiselle Brun, pour qu’elle lui envoie les enfants : Mademoiselle Brun reste muette et se fait attribuer la tutelle des enfants… qu’elle fait baptiser en 1948. Une autre tante, installée en Israël, essaie de nouveau, par voie de justice : le tribunal de Grenoble ordonne la restitution des enfants le 13 décembre 1950 ; l’appel confirme : Mademoiselle Brun est emprisonnée ; mais les enfants ont disparu, cachés dans un couvent basque de l’Espagne franquiste, où ils sont retrouvés en juin 1953. La cour de cassation rejette le pourvoi de Mademoiselle Brun… les enfants partiront en Israël.
19 02 1944
La centrale d’Eysses, dans le Lot et Garonne rassemble des droits communs aussi bien que des politiques, au nombre de 1 400, résistants de tous bords. Une tentative d’évasion massive a été préparée essentiellement par les soins de Serge Ravanel. Mais certains droits communs vendent la mèche aux surveillants qui font avorter le projet. Darnand, le chef de la Milice, demande 50 têtes : ce sont finalement 12 détenus qui seront exécutés le 23 février.
21 02 1944
Procès de l’Affiche rouge : 22 membres de la MOI : Main d’Œuvre Immigrée, sont exécutés. Une femme, Olga Bancic, roumaine, sera décapitée le 10 mai à Stuttgart. Celestino Alfonso était espagnol, Joseph Boczov, Thomas Elek, Emeric Glasz étaient hongrois, Rino Della Negra, Spartaco Fontano, Cesare Luccarini, Antoine Salvadori Amedeo Usseglio étaient italiens, Maurice Fingercwajg, Marcel Rayman, Willy Szapiro, Stanislas Kubacki, Jonas Geduldig, Léon Goldberg, Szlama Grzywacz, Wolf Wajsbrot étaient polonais, Missak Manouchian, Armenak Arpen Manoukian étaient arméniens, Georges Cloarec, Roger Rouxel, Robert Witchitz étaient français.

Missak Manouchian écrit à sa femme :
Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée,
Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 heures. Cela m’arrive comme un accident dans ma vie, je n’y crois pas mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais.
Que puis-je t’écrire ? Tout est confus en moi et bien et clair en même temps.
Je m’étais engagé dans l’Armée de Libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la Victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la Liberté et de la Paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la Liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n’ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit, chacun aura ce qu’il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous… J’ai un regret profond de ne t’avoir pas rendue heureuse, j’aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d’avoir un enfant pour mon bonheur, et pour accomplir ma dernière volonté, marie-toi avec quelqu’un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires je les lègue à toi, à ta sœur et à mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l’armée française de la libération.
Avec l’aide des amis qui voudront bien m’honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits… Tu apporteras mes souvenirs si possible à mes parents en Arménie. Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l’heure avec le courage et la sérénité d’un homme qui a la conscience bien tranquille… Aujourd’hui, il y a du soleil. C’est en regardant le soleil et la belle nature que j’ai tant aimée que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis… Je t’embrasse bien fort ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près, je vous serre tous sur mon cœur. Adieu. Ton ami, ton camarade, ton mari.
Manouchian Michel
En 2009, le romancier Didier Daeninckx écrira Missak, roman dans lequel il remplit le vide signifié par les trois points de suspension qui séparent la conscience bien tranquille de aujourd’hui il y a du soleil par la phrase suivante : Je pardonne à tous ceux qui m’ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. En clair cela signifie que Missak aurait été trotskyste, reconnu comme tel par les communistes et par eux dénoncé à la Gestapo. Hypothèse pour le moins vraisemblable. Louis Aragon s’inspirera de cette lettre pour le poème qu’il écrira à l’occasion de l’inauguration d’une rue Manouchian à Paris.
Vous n’aviez réclamé la gloire ni les larmes
Ni l’orgue ni la prière aux agonisants.
Onze ans déjà que cela passe vite onze ans
Vous vous étiez servi simplement de vos armes
La mort n’éblouit pas les yeux des Partisans
Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes
Noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants
L’affiche qui semblait une tache de sang
Parce qu’à prononcer vos noms sont difficiles
Y cherchait un effet de peur sur les passants
Nul ne semblait vous voir Français de préférence
Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant
Mais à l’heure du couvre-feu des doigts errants
Avaient écrit sous vos photos MORTS POUR LA FRANCE
Et les mornes matins en étaient différents
Tout avait la couleur uniforme du givre
À la fin février pour vos derniers moments
Et c’est alors que l’un de vous dit calmement
Bonheur à tous Bonheur à ceux qui vont survivre
Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand
Adieu la peine et le plaisir Adieu les roses,
Adieu la vie adieu la lumière et le vent
Marie-toi sois heureuse et pense à moi souvent
Toi qui va demeurer dans la beauté des choses
Quand tout sera fini plus tard en Erivan
Un grand soleil d’hiver éclaire la colline
Que la nature est belle et que le cœur me fend
La justice viendra sur nos pas triomphants
Ma Mélinée ô mon amour mon orpheline
Et je te dis de vivre et d’avoir un enfant
Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent
Vingt et trois qui donnaient leur cœur avant le temps
Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant
Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir
Vingt et trois qui criaient La France en s’abattant
Louis Aragon, 1955
22 02 1944
Arrestation de Robert Desnos, du réseau de Résistance AGIR.
23 02 1944
Staline jette dans des wagons à bestiaux des centaines de milliers de Tchétchènes et d’Ingouches et les déporte en Asie centrale, principalement au Kazakhstan. L’opération est menée par Lavrenti Beria. Les survivants n’en reviendront qu’en 1957.
Les serviteurs des grands pays militaires commettent toutes sortes d’infamies contre les petits peuples, tout en maintenant qu’il est impossible de les traiter autrement. Telle a été la situation dans le Caucase. Les commandants militaires russes, en quête d’honneurs pour eux-mêmes et afin de s’approprier les butins de la guerre, envahirent des terres paisibles, ravagèrent des villages, tuèrent des centaines de personnes, violèrent des femmes, s’emparèrent de milliers de têtes de bétail, et ensuite reprochèrent aux hommes de ces tribus de mener des attaques contre des biens russes.
Léon Tolstoï. 1828 – 1910.
27 02 1944
À Khaïbakh, au sud-ouest de la Tchétchénie, en montagne, la neige ne facilite pas les transports. Les militaires rassemblent toute la population dans l’écurie du kolkhoze Lavrenti Beria, et y mettent le feu. Ils étaient 705, vieillards, – un de 110 ans -, femmes, enfants – un bébé né le jour-même -. Certains parvinrent à sortir : ils furent fusillés. Personne ne peut oublier pareilles atrocités. Un mois et demi plus tard naîtra dans le village voisin de Pervomaïskoé Djokahr Doudaev, qui allait être le premier président de Tchétchénie, quelque soixante ans plus tard.
Pourtant, les Tchéchènes avaient tenu en échec les troupes allemandes assiégeant Grozny, mais cela n’avait pas empêché Staline d’en faire des traîtres : il fait déporter en Asie centrale tout le peuple Tchéchène : 450 000, dont 140 000 mourront dans les trains et les camions ou à leur arrivée dans les steppes glaciales du Kazakhstan. Ils n’avaient eu droit qu’à 20 kilos de bagages par famille. Il faudra attendre 1957 pour voir autorisé le retour en Tchétchénie, mais les victimes ne retrouveron bien souvent ni les terres ni les biens perdus.
3 03 1944
L’Italie vit comme elle peut, avec ce qu’elle a ; les trains s’approvisionnent avec un charbon de mauvaise qualité. Un train de marchandises, sur lequel les passagers sont en principe interdits, en transporte en fait en grand nombre, formé surtout de trafiquants de cigarettes et autres bienfaits amenées dans les bagages des Américains. Il y a deux locomotives, car les pentes sont nombreuses. Dans le tunnel de Balvano, à l’ouest de Potenza, en Italie du sud, le train s’arrête : il n’a plus la force d’avancer : l’émanation de monoxyde de carbone va faire des ravages, tuant 517 personnes.
7 03 1944
Le gouvernement provisoire de la France Libre accorde la citoyenneté française dans le respect du statut musulman à plusieurs dizaines de milliers d’Algériens : cela va dans le sens de l’intégration, non de l’émancipation.
- Dans ses deux premiers articles, l’ordonnance affirme l’égalité des droits et des devoirs entre tous les Français non musulmans et musulmans d’Algérie, nonobstant la conservation de leur statut personnel coranique et coutumier par ceux de ces derniers qui n’auraient pas expressément déclaré leur volonté d’être placé sous l’empire intégrale la loi française.
- L’article 3 définit les catégories de Français musulmans admis à titre personnel à exercer leurs droits civiques dans les mêmes conditions que les citoyens de statut civil français.
- L’article 4 commence par affirmer : Les autres Français musulmans sont appelés à recevoir la citoyenneté française, mais il laisse à la future Assemblée nationale constituante le soin de fixer les conditions et les modalités de cette accession. Dans l’immédiat, il reprend les propositions de la commission sur la représentation spéciale des Musulmans dans les assemblées algériennes, mais il écarte la proposition de leur accorder en même temps une représentation paritaire au Parlement français (la commission préparatoire comprenait 4 hauts-fonctionnaires, 6 Français non musulmans et 6 Français musulmans).
11 03 1944
Voilà plusieurs jours que des fumées malodorantes sortent d’une cheminée du 21, Rue Le Sueur, proche de l’Étoile à Paris, ce dont les voisins se plaignent à la police, qui vient, sonne et, puisque personne ne répond, entre de force. Le spectacle est à donner la nausée à plus d’un : une chaudière, une fosse, des morceaux de corps humains prêts à être brûlés. L’immeuble appartient à Marcel Petiot, médecin à la cervelle bien dérangée depuis longtemps. Trois mois plus tôt, il sortait de la prison de Fresnes après y avoir passé 8 mois, sans avoir rien avoué à la Gestapo qui avait découvert son réseau de soi-disant voyage en Argentine pour les résistants qui voulaient s’éloigner des zones dangereuses : en fait il ne faisait que les dépouiller avant de les faire disparaître. Le commissaire Georges Massu et le Docteur Paul, médecin légiste vont identifier 27 corps. Ils finiront par retrouver l’auteur des crimes le 31 octobre 1944 : il avait pris les habits d’un officier FFI : il se défendra comme un beau diable, certifiant sa qualité de résistant qui n’avait fait que tuer des collaborateurs. La défense du grand avocat Floriot n’y fera rien : il sera exécuté le 25 mai 1946.
12 03 1944
Les Allemands lancent l’opération Margarethe qui vise à occuper en totalité la Hongrie, pour éviter que le pays ne se rende aux Russes.
19 03 1944
Maria Casarès rencontre Albert Camus chez Michel Leiris. Elle joue Martha dans Le Malentendu. Il devient pour elle père, frère, ami, amant, et fils parfois. La guerre et Francine Faure, pianiste, mathématicienne et compagne de Camus, les sépareront. Ils se retrouveront en 1948 et entretiendront une liaison qui ne prendra fin qu’avec la mort accidentelle de l’écrivain, en 1960.
22 03 1944
Pierre Brossolette est torturé depuis 2 jours dans les locaux de la Gestapo, avenue Foch. Profitant d’un moment d’inattention de ses bourreaux, il se défenestre, tombe sur le balcon du 5° étage, se relève et saute encore et pour la dernière fois, dans le vide. Chroniqueur engagé dans la presse écrite et radiodiffusée – il nommait les résistants les Soutiers de la gloire –, il avait participé à l’élaboration du Conseil National de la Résistance et était devenu l’adjoint du colonel Passy. Pressenti pour succéder à Jean Moulin, de Gaulle s’y était opposé, le jugeant incontrôlable, à la suite d’un courrier dans lequel ce dernier l’incitait à devenir un peu moins hautain, un peu plus humain.
23 03 1944
En plein centre de Rome, via Rasella, un commando de la résistance italienne fait exploser une bombe au passage d’une colonne allemande de la SS, causant la mort de 32 soldats, et une autre le lendemain. En représailles, le commandant Kappler organise le 24 mars le massacre de 335 otages – les quatre premiers sont choisis parmi les condamnés à mort de la prison de Regina Coeli à Rome. Leur nombre étant nettement insuffisant, les Allemands prennent plus de 200 autres détenus. Le nombre de 335 est atteint après une rafle de 77 Juifs dans le ghetto de Rome. Ils sont tous tués d’une balle dans la tête dans les Fosses ardéatines, des grottes dans la banlieue sud de Rome.
24 03 1944
La Gestapo arrête 17 enfants juifs à Voiron. Déportés via Drancy à Auschwitz, puis à Gleiwitz, en Haute Silésie, un seul en sortira vivant.
Au camp Stalag Luft III à Sagan [aujourd’hui Żagaṅ] en Pologne, dans la province de Basse-Silésie, à environ 150 km au Sud Est de Berlin, 76 soldats britanniques et canadiens parviennent à se faire la belle, au nez et à la barbe des nazis. Pourtant, ce camp était censé être le mieux gardé en raison de la présence de nombreux soldats ayant déjà tenté de s’évader d’autres camps ; il avait été mis en œuvre sous les ordres directs d’Hermann Göring, patron de la Luftwaffe, qui avait nommé à sa direction, le colonel Friedrich Lindeiner, vétéran de la Première Guerre mondiale. Le chef d’escadron Roger Bushell, pilote de chasse de la Royal Air Force, avait pris la tête de ce plan d’évasion de masse. Avec ses collègues triés sur le volet, ils avaient élaboré un système ultrasophistiqué de tunnels. Les 3 tunnels avaient été nommés Tom, Dick et Harry. Le capitaine d’aviation Wally Floody ayant déjà travaillé dans l’industrie des mines à Kirkland Lake en Ontario, s’était occupé des plans ; mais il avait été malheureusement transféré avant l’évasion. Par la suite, des dizaines d’hommes s’étaient attelés à construire incognito les 3 tunnels. La tâche n’était pas de tout repos car il fallait trouver les matériaux afin de réaliser un système de ventilation à l’intérieur des tunnels, en plus d’y amener l’électricité et un chemin de fer. D’autres prisonniers étaient chargés d’évacuer la terre grâce à des petits sacs qu’ils dissimulaient dans leurs pantalons, répandant ainsi les gravats dans la cour de promenade. En tout, 600 hommes avaient participé à cette entreprise d’évasion. Pour fabriquer les outils et matériaux nécessaires à ce chantier, on avait fait feu de tout bois : panneaux de lit, lattes de sommier, matelas, chaises, tables, couteaux, cuillères, pelles, fourchettes, bidons de lait ou fils électriques. Ils étaient même parvenus à corrompre quelques gardes allemands pour obtenir du matériel, en échangeant des vivres reçus dans des colis humanitaires de la Croix Rouge. Ils avaient aussi réussi à se fabriquer des vêtements civils pour se noyer dans la population après l’évasion, ainsi que des faux papiers.
La construction du tunnel Dick avait été abandonnée, la galerie s’étant avérée trop dangereuse et instable. Tom avait été découvert par les gardiens en septembre 1943. Ne restait plus qu’Harry. Ce soir de mars 1944, une attaque aérienne dans le secteur avait obligé les dirigeants du camp à instaurer un black-out total. Ainsi, les sentinelles ne pourront pas déclencher de projecteurs. Plus de 200 prisonniers se tiennent prêts à s’échapper du Stalag III par Harry. Normalement, le tunnel devait déboucher dans la forêt, hors de la vue des sentinelles. Les aviateurs se rendent malheureusement compte que leur ouvrage est trop court de 10 mètres. Long de 110 mètres, le tunnel ne leur permet pas d’être à l’abri des regards. Les soldats doivent donc attendre que la sentinelle ait le dos tourné pour bondir et courir se cacher dans les bois.
Très tôt le matin, un gardien se rend compte de l’évasion et donne l’alerte ! 76 prisonniers sont portés manquants. Très vite, une horde de gardes reprennent 73 personnes, qui sont pour la plupart rapatriés au camp. Afin d’empêcher toutes nouvelles velléités de fuite, la Gestapo, sous le commandement d’Adolf Hitler, ordonne l’exécution de 50 soldats alliés d’une balle dans la nuque. Seulement 3 soldats sont parvenus à rejoindre l’Angleterre : le sergent Peter Bergsland, le sous-lieutenant Jens Müller et le capitaine d’aviation Bram, Bob Van der Stok.
Malgré les exécutions des 50 prisonniers, un 4° tunnel sera creusé, appelé George, qui ne servira jamais car creusé pour stocker du matériel et des armes. Le camp sera finalement évacué avant l’arrivée de l’armée soviétique. Après la guerre, 18 gardiens du Stalag III seront arrêtés et jugés par un tribunal militaire. 13 seront exécutés et 5 autres condamnés à la prison à vie. Plusieurs autres responsables du massacre des 50 soldats seront traqués et liquidés. D’anciens SS parviendront à s’exiler en Amérique du Sud.
Avant 1963, la notoriété de cette tentative d’évasion hors normes, était restée faible, mais il est certain qu’alors elle devint la plus célèbre, avec la sortie sur les écrans de La Grande évasion le 11 septembre 1963 en France de John Sturgess, avec un casting de rêve : Steve Mac Queen, James Coburn, Charles Bronson, James Garner, Richard Attenborough etc… En France, 8.8 millions de personnes iront le voir.
26 03 1944
Maquis des Glières, en Haute Savoie.
Le général Valette d’Osia, commandant le 27° Bataillon de Chasseurs Alpins à Annecy, est entré dans la clandestinité dès novembre 1942. Arrêté en novembre 1943, il s’évade pour se retrouver à Londres.
Romans Petit, publiciste et capitaine d’aviation de réserve, crée à Manigot en décembre 1943 une école de formation des cadres de l’Armée Secrète qui enseigne la guérilla. Il s’appuie sur Tom Morel, ex-instructeur à Saint Cyr, replié sur Aix depuis la défaite, – il s’agit donc de l’armée d’armistice -. Tom s’est déjà illustré sur les Alpes, en juin 1940, où il a capturé toute une compagnie italienne de Bersaglieri. Depuis novembre 1942 – occupation de la zone libre par les Allemands – le général Valette d’Osia lui a aussi confié la charge du CDM – Camouflage du matériel – pour la région. Romans Petit doit partir dans l’Ain et c’est le commandant Humbert Clair qui le remplace. La situation du plateau des Glières, à 1 200 m. d’altitude et à proximité de lacs importants – Annecy, Léman -, qui facilitent le repérage par les avions, en font le lieu idéal pour les parachutages d’armes, dont la Résistance a un besoin urgent, en provenance de Londres. Le 31 janvier 1944, 120 maquisards y montent, commandés par Tom Morel, dépourvus d’armes. Au 10 février, on compte 465 hommes dont 56 républicains espagnols, 3 sections de Francs Tireurs Patriotes… Ils sont encadrés par 5 officiers. Deux parachutages seront effectués, les 14 février et 4 mars : armes automatiques, pistolets et fusils mitrailleurs, mais pas d’arme lourde : ces hommes qui vont être attaqués par l’armée allemande disposant de chasseurs bombardiers et d’artillerie, ne reçoivent que des armes de commando, et pas de moyens de transmission, pas de nourriture, pas de médicaments. Les accrochages avec la Milice et les Gardes Mobiles de Réserve commencent le 5 Février. Jean Rosenthal – alias Cantinier – rejoindra les hommes du Plateau des Glières en mars.
Le 10 mars 1944, Tom mène avec 100 hommes un raid de ravitaillement sur Entremont, prend l’hôtel de France où sont cantonnés les GMR, qu’il fait prisonniers ; leur chef, le commandant Lefevre, obtient de garder son arme… et s’en sert pour tuer Tom, dont les hommes se déchaînent, laissant sur le terrain 70 gardes morts ou blessés ; 47 prisonniers remonteront avec eux sur le plateau, tirant des traîneaux chargés des corps de Tom Morel et de Léo Descours, d’armes saisies et de ravitaillement. Le même soir a lieu le plus important parachutage d’armes : 31 quadrimoteurs Halifax larguent 90 tonnes de matériel. L’enterrement aura lieu le 13 mars sous les rafales de neige, sur le plateau ; dans la vallée les cloches sonnent le glas. Le 15 mars, le capitaine Anjot, adjoint du colonel Valette d’Osia, commandant le 27° BCA, prend le commandement, après un intérim du lieutenant Jourdan Joubert.

![]()
Les Allemands ont souhaité jusqu’à présent ne pas intervenir et laisser les forces de l’ordre françaises régler l’affaire. Mais devant l’ampleur prise par ce maquis et la relative complaisance des forces françaises dont certains chefs veulent éviter les combats fratricides, ils prennent l’affaire en main et les 12, 17 et 23 mars, envoient leur aviation bombarder les Glières ; le 26 mars, ce sont près de 20 000 hommes qui donnent l’assaut : ceux de la 157° division alpine de la Wehrmacht et la Milice.
Les maquisards résistent toute la journée. Le capitaine Anjot donne l’ordre de décrocher dans la nuit ; parvenu dans la vallée, il sera dénoncé et tué. Le lieutenant Jourdan Joubert sera le seul officier à s’en sortir : il reviendra un mois plus tard sur le plateau et y effectuera des manœuvres. Le lieutenant Bastian, blessé par une pierre en voulant échapper par la falaise aux Allemands dans le défilé de Morette, sera arrêté le 28 mars, torturé un mois durant par la Milice puis la Gestapo, et finira par parler. Lalande, réfugié à Aix, reviendra à Annecy pour prendre des nouvelles et sera arrêté. Il mourra pendant son transport à Thônes avec Bastian qui sera exécuté, sur les lieux où il avait été blessé. Sur les 465 maquisards, 125 seront tués, 30 disparus, et on comptera 160 prisonniers pratiquement tous morts en déportation, dénoncés ou capturés sur la base des informations obtenues sous la torture… Les Allemands auront perdu 300 hommes et les forces de Vichy 150. Certains rescapés auront marché 35 heures d’affilée pour échapper aux Allemands et à la Milice. Le 4 mai, la cour martiale d’Annecy prononce 9 condamnations à mort, dont 5 seront aussitôt exécutés.
Le 1° Août 1944, 1 900 hommes (1 500 pour l’Armée secrète et 400 FTP) reçoivent sur le plateau des Glières le plus important parachutage d’armes.
Le 5 novembre 1944, de Gaulle parlera de témoignage splendide jeté à travers le monde. Mais la belle phrase n’empêchera pas les querelles, qui seront vives après la guerre pour déterminer l’intérêt que représentait ce maquis, dès lors que Londres ne pouvait lui parachuter les armes lourdes nécessaires. Le choix d’un regroupement des forces de la Résistance répondait en grande partie à la crainte de l’autre stratégie : la dispersion en petits groupes dans tout le département, stratégie beaucoup plus prisée des communistes ; et la France Libre à Londres craignait beaucoup une prise de pouvoir par les communistes à la faveur des inévitables troubles de la libération à venir.
Mais au nom de quoi pouvait-on justifier tant de pertes humaines ? Le choix stratégique du Plateau des Glières, décidé par une mission venue de Londres, menée par Cantinier, de son vrai nom Rosenthal, était très discutable dès lors que le BCRA – Bureau Central de Renseignements et d’Action de la France Libre – ne pouvait être certain d’obtenir des Anglais les armes lourdes indispensables pour tenir.
On comptera à la fin de la guerre 29 000 Français fusillés pendant l’Occupation.
En novembre 2011, Claude Barbier soutiendra en Sorbonne, devant un jury comptant nombre d’historiens reconnus une thèse minimisant l’importance de cette bataille des Glières du 26 mars 1944, la ramenant à un bref engagement qui a fait deux morts parmi les 500 à 600 maquisards – des jeunes qui avaient refusé le STO. Le repli s’est fait dans des conditions particulièrement épouvantables et a contraint les maquisards, affamés, à bout de forces et dont le courage est indiscutable, à se rendre aux Miliciens et aux Allemands. Une soixantaine ont été fusillés, ainsi que 8 civils ; 80 ont été emprisonnés, plusieurs autres envoyés au STO ou déportés. [ L’Histoire n° 375 mai 2012]
29 03 1944
Jacques de Prévaux, agent dans le réseau de résistance franco polonais F2, est arrêté par la Gestapo à Toulon : mis au secret et torturé à Montluc, il sera abattu peu avant la libération de Lyon. Brillant capitaine de vaisseau, il avait été révoqué de son dernier poste officiel : – président du tribunal maritime de Toulon -, en décembre 1941, pour sa trop grande bienveillance envers les dissidents.
1 04 1944
Victor Andréiévitch Kravchenko est membre de la Commission d’achat de l’ambassade de Russie à Washington. Il a derrière lui un passé qui lui a permis de voir la réalité du quotidien des ouvriers des grands combinats russes, comme des koulaks insoumis, qui lui a permis d’être témoin des famines organisés par le régime en Ukraine, il sait l’existence du goulag [2]. Nommé aux États-Unis, il décide de passer à l’ouest, demandant l’asile politique aux États-Unis. Il va rester caché pendant deux ans, utilisant ce temps pour témoigner de ce qu’il a vu : et cela donne en février 1946 un livre de 600 pages : I choose freedom.
Schauffausen, ville suisse, est bombardée : les Alliés, sans aller jusqu’à dire : Poisson d’avril… c’était pour rire, parleront d’erreur. Bâle l’avait été aussi et c’avait été aussi une erreur.
2 04 1944
Vers 2 heures du matin prend fin le massacre d’Ascq, une petite ville à mi-chemin de Lille et de la frontière belge : 86 personnes, de 15 à 74 ans, auront été fusillées par des SS transportés dans un train qui a été victime quelques heures plus tôt d’un attentat qui n’a fait que des dégâts légers et aucune victime. Le convoi transportait environ 400 hommes de la 12° Panzerdivision SS Hitlerjugend. Karl Münter, qui avait participé au massacre, bénéficiera finalement d’un non-lieu de la justice allemande en 2018, à 95 ans.
vers le 10 avril 44
Simone Jacob, 16 ans [future Simone Veil] a été arrêtée avec sa mère, son frère Jean et sa sœur Madeleine le 30 mars à Nice. D’abord retenus à l’Hôtel Excelsior, ils ont été internés à Drancy le 7 avril et les trois femmes seront déportées sur Auschwitz le 13. Son père arrivera à Drancy après leur départ pour Auschwitz, y retrouvant Jean : tous deux seront déportés à Kaunas, en Lituanie ; personne ne saura jamais rien d’autre d’eux. Une autre sœur, Denise qui avait déjà rejoint la Résistance à Lyon fin 43, sera elle aussi arrêtée et déportée, puis libérée en avril 1945.
Jour après jour, nous attendions donc tous les quatre, Maman, ma sœur Milou, mon frère et moi, un départ pour l’Allemagne dont nous ignorions aussi bien la date que la destination, avec le seul espoir de ne pas être séparés. Personne n’avait entendu parler d’Auschwitz, dont le nom n’était jamais prononcé. Comment aurions-nous pu avoir une idée quelconque de l’avenir que les nazis nous réservaient ? Aujourd’hui, il est devenu difficile de réaliser à quel point l’information, sous l’Occupation, était rationnée et cloisonnée. Elle l’était du fait de la police et de la censure. On a peine à croire, à présent, que personne, hors les quartiers concernés, n’ait entendu parler de la grande rafle du Vel d’Hiv de juillet 1942, laquelle, depuis lors, a fait couler tant d’encre et nourri tant de polémiques.
Lorsque, bien plus tard, j’en ai eu moi-même connaissance, j’ai partagé la stupeur collective face à révélation du comportement de la police parisienne. Sa complicité dans l’opération me semblait une tache indélébile sur l’honneur des fonctionnaires français. Aujourd’hui, même si nos concitoyens, dans leur immense majorité, partagent ce point de vue, mon jugement s’est précisé, et je pense qu’il convient de moduler l’opprobre. Jamais, jamais on ne pourra passer l’éponge sur la responsabilité des dirigeants de Vichy qui ont prêté main forte à la solution finale en apportant aux Allemands la collaboration de la police française et de la milice, notamment à Paris.
Cela n’atténue en rien le mérite de ceux de ces policiers qui, par exemple, ont prévenu et ainsi sauvé la moitié des vingt-cinq mille Juifs répertoriés à Paris avant la rafle du Vel d’Hiv en juillet 1942.
Plus généralement, si les trois quarts de la population juive vivant en France ont échappé à la déportation, c’est d’abord du fait de l’existence, jusqu’en novembre 1942, de la zone libre et jusqu’en septembre 1943, de l’occupation italienne.
Et puis, nombre de Français, n’en déplaise aux auteurs du Chagrin et la Pitié, ont eu un comportement exemplaire. Les enfants ont été, pour le plus grand nombre d’entre eux, sauvés grâce à toutes sortes de réseaux, comme la Cimade. Je pense en particulier aux protestants du Chambon-sur-Lignon et d’ailleurs, ou encore aux nombreux couvents qui ont recueilli des familles entières. En fin de compte, de tous les pays occupés par les nazis, la France est, et de loin, celui où les arrestations furent, en pourcentage, les moins nombreuses. Les Juifs néerlandais ont été éliminés à plus de quatre-vingts pour cent.
En Grèce, ce fut la même chose. L’an passé, en voyage à Athènes, j’ai pu constater qu’il ne reste rien de la communauté juive de Salonique. On m’a raconté que la fureur des nazis était telle que l’arrestation de deux personnes réfugiées sur une petite île grecque avait mobilisé toute une unité SS.
Aucun événement historique, aucun choix politique des gouvernants, surtout dans des périodes aussi troubles, n’entraîne des conséquences uniformément blanches ou noires. Nul ne peut nier que la collaboration, consacrée par les sept étoiles de Pétain, ait induit en erreur nombre de nos concitoyens. J’ai cependant été frappée de la réponse que m’a faite, bien des années plus tard, la reine Béatrix des Pays Bas, un jour où j’évoquais avec admiration le départ de la reine Wilhelmine et de son gouvernement pour Londres dès l’invasion de son pays, en 1940. Ne croyez pas que ce soit aussi simple, m’a confié la reine. On a beaucoup critiqué l’attitude de Wilhelmine, regrettant qu’elle ait abandonné son peuple. Et c’est ce qui se dit encore aujourd’hui dans notre pays. On ignore souvent en France que, compte tenu du vide politique qui régnait aux Pays-Bas, les Juifs y ont été très souvent dénoncés. Ce fut le cas d’Anne Frank.
Simone Veil. Une vie. Stock 2007
Certains Français se plaisent à flétrir le passé de notre pays. Je n’ai jamais été de ceux-là. J’ai toujours dit, et je le répète ce soir solennellement, qu’il y a eu la France de Vichy, responsable de la déportation de soixante seize mille Juifs, dont onze mille enfants, mais qu’il y a eu aussi tous les hommes, toutes les femmes, grâce auxquels les trois quart des Juifs de notre pays ont échappé à la traque. Ailleurs, aux Pays Bas, en Grèce, quatre vingt pour cent des Juifs ont été arrêtés et exterminés dans les camps. Dans aucun pays occupé par les nazis, à l’exception du Danemark, il n’y a eu un élan de solidarité comparable à ce qui s’est passé chez nous.
Simone Veil. le 18 janvier 2007 au Panthéon
On peut ajouter quelques précisions aux propos de Simone Veil, tenant à un contexte local précis : celui de la Corse, viscéralement solidaire de tout persécuté, juifs compris : et cela fût vrai pendant la guerre, y compris sous occupation italienne après suppression de la zone libre : la Corse, pouvoirs publics en tête, escamotera des statistiques avant les grandes rafles de l’été 1942. De Bastia, on cachera les Juifs à Asco, puis en haute Balagne. On ne les donnera pas.
6 04 1944
Sur ordre de Klaus Barbie [3], 43 orphelins juifs d’Izieu, dans l’Ain, sont déportés à Drancy, puis Auschwitz. Certains d’entre eux venaient de Campestre, (aujourd’hui établissement scolaire de Lodève) où ils avaient été placés par l’Œuvre de Secours aux Enfants, institution juive internationale après avoir été retirés des camps d’internement de Rivesaltes, Gurs et Agde ; c’est une infirmière juive, Sabine Zlatin, licenciée de la Croix Rouge qui, après le déménagement en catastrophe de l’OSE, en février 43, prit en charge ces enfants abandonnés à Campestre en demandant au sous préfet de Belley, Pierre Marcel Wiltzer de les accueillir : il trouva la maison d’Izieu, leur obtint des cartes de ravitaillement et fit rouvrir l’école du village. Muté à Châtellerault en mars 44, il n’apprit le drame qu’à la fin de la guerre.
Il était parvenu à ne jamais prêter serment d’allégeance à Pétain.
![[Procès Klaus Barbie : Sabine Zlatin, témoin du ministère public]](https://numelyo.bm-lyon.fr/f_eserv/BML:BML_01ICO0010158e4d80157054/web_Source0.jpg)
Sabine Zlatin, témoin du ministère public au procès de Klaus Barbie, en 1987
Lors des audiences de ce procès Barbie, l’avocat général Truche demande doucement à Charlotte Wardy, une survivante :
- Peu de personnes acceptent de dire ce qui s’est passé dans ce train [le dernier train de déportés, le 141 166 du 11 août 1944 ; ils étaient 620 dont la moitié de Juifs, de Lyon Perrache à Auschwitz], acceptent d’en parler. Vous sentez-vous autorisé à le faire ?
Le témoin a semblé ne pas comprendre la question.
- On avait très chaud. Nous avions faim, a-t-elle simplement répondu.
Comme les autres, la femme n’a pas accepté de raconter les nuits passées debout, les souffrances, les saloperies faites dans le noir par des malheureux à d’autres malheureux. Lors des audiences, on a entendu la Résistante Simone Lagrange avouer qu’un mort, cela faisait une place supplémentaire dans le wagon. On a écouté cet homme, jeune alors, expliquer qu’il avait été violemment neutralisé par ses compagnons de douleur pour qu’il ne s’évade pas. La cour n’a plus posé de question lorsque le témoin Mario Blardone a révélé l’existence d’un serment entre déportés, pour ne jamais révéler ce qui s’était produit dans ces convois.
Des femmes et des enfants piétinés, des batailles aux ongles pour un interstice d’air et de lumière, des morsures de douleur dans l’obscurité, des terreurs calmées à coups de poing, des soupirs de soulagement lorsque les râles d’un mourant cessaient enfin. Mais tout cela, comment le dire, un jour paisible de juin 1987 ? Comment raconter à des jurés, à un public silencieux, à des journalistes, au pays tout entier, que le désespoir et la peur folle, n’ont pas toujours engendré cette solidarité admirable que certains viennent pleurer ici ?
Sorj Chalandon. Enfant de salaud. Grasset 2021
10 04 1944
Rudolf Vrba, né Walter Rosenberg, Slovaque de moins de 20 ans et Alfred Wetzler, Polonais, tous deux secrétaires de chefs de blocks à Auschwitz, s’évadent : ils y étaient arrivés presque deux ans plus tôt en juin 1942. Leur fonction leur permettait de circuler facilement dans tout le camp et ils avaient habilement utilisé cette connaissance des lieux en se cachant pendant trois jours à l’intérieur d’une pile de planches aux abords du camp, suffisamment éloignée de la zone de surveillance constante pour que les patrouilles abandonnent les recherches en cas d’évasion au bout de trois jours.
Quinze jours plus tard, parvenus en Slovaquie, ils entrent en contact avec les responsables du conseil juif en Slovaquie et rédigent un rapport sur leurs deux ans passés à Auschwitz, rapport qui parviendra à Churchill, Roosevelt via Mgr Mario Martilotti, nonce apostolique de Slovaquie, et le Vatican ; sur leurs deux années passés dans le camp le rapport faisait état de 1 765 000 morts gazés. Ces chiffres ne pouvaient être exacts, – et comment auraient-ils pu l’être, dans les conditions où ils avaient été recueillis ?-. Pour les seuls Français, ils donnaient un chiffre de 150 000 morts quand Serge et Beate Klarsfeld parviennent à 76 000 pour la totalité des camps. [Mais, il reste vrai que dans les semaines qui suivirent leur évasion, de mai à juillet 1944, ce sont 5 000 juifs qui seront assassinés par jour à Birkenau]. Malgré ces erreurs ce rapport permit aux juifs hongrois de bénéficier d’une suspension des déportations et de ne pas être tous massacrés. Il sera question de bombarder Auschwitz-Birkenau – Churchill y fut favorable – mais les Américains, à 60 jours du débarquement, préférèrent concentrer leurs forces sur ce seul objectif.
10 04 1944
La 2° DB embarque à Casablanca pour Swansea, au pays de Galles où elle arrivera 12 jours plus tard : elle est désormais forte de 4 611 véhicules, tous perçus après le 1° octobre 1943, à l’exception de la caravane de Leclerc.
13 04 1944
Les États-Unis et l’Angleterre exigent de la Suède l’arrêt des livraisons de roulements à bille aux Allemands.
16 04 1944
À la tête de la Milice, Raoul Dagostini lance la répression de la Résistance dans le Vercors, autour de Vassieux en Vercors. Pendant huit jours, les fermes seront pillées, incendiées, les habitants torturés, d’autres plus tard, déportés et trois d’entre eux fusillés pour avoir été dénoncés par des Français.
18 04 1944
À Londres, au Claridge, on fête les infirmières. Bien sûr, cela s’arrose ; le major général Henry JF Miller, de l’U.S. Airforce américaine se lâche : le débarquement aura lieu avant le 15 juin. Eisenhower est furieux : tout le mal que l’on se donne pour que le secret soit tenu, et voilà un imbécile qui ne sait pas tenir sa langue… Il obtiendra son renvoi au pays et sa rétrogradation au rang de lieutenant colonel.
Dans sa guerre contre la Chine, le Japon lance sa plus grande opération militaire de la guerre, Ichigo – numéro un – qui vise à relier par voie de terre la Corée au Vietnam, afin de compenser la supériorité navale américaine, et à détruire les bases aériennes de Chine du Sud et du Sud-Ouest, d’où partent les bombardiers à destination de Tokyo et du trafic maritime entre le Japon et ses conquêtes d’Asie du sud-est. À part le nœud ferroviaire de Hengyang qui résistera un mois et demi, au prix de plus de 5 000 morts, l’opération est rondement menée. En novembre un corridor sera établi en continu entre Moukden, en Mandchourie et Hanoi, au Vietnam. Puis, but atteint, les Japonais ne pousseront pas leur avantage, convaincus qu’ils ne vaincront pas l’Amérique et préférant ne pas provoquer la chute de Chiang Kai-shek, qui ne pourrait que profiter aux communistes.
19 04 1944
Rouen est bombardé : 2 000 morts !

La Tour Saint Romain de la cathédrale
20 04 1944
Le chalutier norvégien Voorbod, faisant route d’Oslo vers le nord de la Norvège, fait escale à Bergen. À son bord, 120 tonnes d’explosifs, 50 caisses de mèches et 180 000 amorces. Le tout explose, faisant plus de 1 000 morts norvégiens. Les nombreux Allemands présents ne donneront pas le nombre des leurs.
La gare de triage de Paris-La-Chapelle est bombardée : on dénombrera 600 morts sur Montmartre, Saint-Ouen, Saint-Denis. Inquiet de la tournure des événements, Churchill demande à Eisenhower d’interrompre les bombardements. En vain.
Après le bombardement d’un train, Simone de Beauvoir écrit à Nelson Algren, son amant américain : Ça se passait tout à la fin de la guerre, quand vous essayiez de stopper les trains et d’anéantir les locomotives, comme vous deviez le faire, personne ne s’en indignait, on était seulement un peu effrayés.
On parle de 60 000 morts pour l’ensemble des victimes civiles des bombardements alliés.
À Anzio, sur la côte, au droit de Rome, les Allemands mettent en service pour la première fois leur torpille humaine Neger conçue 3 par l’institut de recherche sur les torpilles Eckernförde. Il se compose de deux torpilles G7e à propulsion électrique disposées l’une au-dessus de l’autre. La charge militaire de la torpille supérieure est retirée et remplacée par un poste de pilotage succinct avec un capot en plexiglas, équipé d’un appareil respiratoire et d’un espace pour le pilote portant une boussole de poignet. Le tableau de bord est réduit au minimum : une manette pour le démarrage et l’arrêt, un manche à balai pour virer à bâbord ou à tribord et enfin un levier pour la mise à feu de la torpille. L’engin ne comporte aucune autre arme. La visée se fait à travers une simple mire métallique installée dans le dôme transparent. Arrivé à la bonne distance, la torpille inférieure est désengagée et poursuit seule sa route jusqu’à la cible. Le pilote est alimenté en air par un système Draeger, souvent à l’origine d’empoisonnements à l’oxyde de carbone. Le dôme transparent permet la navigation à vue en direction de l’objectif. Emprisonné dans ce dôme haut de 50 cm, le pilote a une vue limitée sur l’horizon. Cet inconvénient majeur gêne considérablement la navigation et la recherche des cibles potentielles. Il est impossible d’ouvrir le dôme en mer pour respirer un peu d’air frais ou pour mieux apercevoir la cible, en raison du risque d’enfourner un paquet d’eau de mer et de chavirer. Une fois la torpille inférieure lancée vers sa cible, la partie supérieure peut faire demi-tour et tenter de se mettre à l’abri en cas de coup au but. En raison de sa petite taille, le Neger est difficile à détecter par les dispositifs de repérage ennemis tels que le radar et le sonar, mais l’engin n’a pas de capacité de navigation sous-marine et est facilement repérable par les guetteurs et extrêmement vulnérable aux attaques ennemies. De plus, en cas de détérioration du dôme transparent, le pilote a très peu de chances d’échapper au naufrage de l’engin. Une fois son attaque menée, le pilote rejoint sa base en utilisant la partie supérieure de l’engin. En cas de panne de batterie, il ne lui reste plus que la nage. Donc, pour ce qui est de la sécurité du pilote on n’est pas loin des avions suicides japonais que l’on verra en service quinze mois plus tard, lors des dernières semaines de la guerre dans le Pacifique.
Caractéristiques :
- Poids : 2,7 t, Longueur : 8,0 m, Diamètre : 0,53 m, Armement : 1 torpille 53,3 cm (G7e) Motorisation : 1 moteur électrique alimenté par batterie, Puissance : 12 ch, Vitesse: 4,2 nœuds en surface
- Autonomie : 18-20 milles. À trois nœuds, son autonomie est de 30 milles. Début de fabrication : 1943, Nombre d’exemplaires construits : environ 200.
La torpille elle-même G 7e :
- Longueur : 7,2 m , Poids : 1,5 tt , Année de construction : 1939, Charge militaire 300 kg hexanite, Distance franchissable de 5 à 7 km, Vitesse : 30 nœuds, Propulsion batterie acide/plomb
- Vitesse : max. 98 PS
Les torpilles à propulsion électrique étaient équipées d’hélices contrarotatives. Leurs performances, vitesse et distance, nécessitaient néanmoins un maintien en température aux environs de +30 °C avant utilisation et d’une maintenance de charge électrique appliquée au moins une fois par semaine. Elles étaient sans conteste beaucoup plus fiables que les autres versions d’où leur utilisation plus intensive. Elles étaient connues aussi sous le nom de ETO.
Devant Anzio, 30 unités devaient attaquer le nord de la tête de pont depuis Torre Vaianica. Ce fut un échec total, seulement 17 unités furent lancées, perdant leur chemin en route, le commandant de l’escadrille périt dès le début de l’opération d’une intoxication au CO2. Trois unités furent perdues, toutes les autres s’échouèrent et furent capturées.

21 04 1944
Une ordonnance du gouvernement français provisoire d’Alger donne le droit de vote aux femmes : disposition qui sera confirmée par une loi le 5 octobre.
26 04 1944
Pétain est reçu triomphalement à Paris.
27 04 1944
1 700 prisonniers politiques partent du camp de Compiègne Royallieu pour Auschwitz, puis Buchenwald, puis essentiellement Flossenbürg. 45 d’entre eux mourront pendant le voyage de Compiègne à Auschwitz. 867 d’entre eux mourront en captivité, 833 rentreront à la fin de la guerre, mais 100 d’entre eux mourront dans l’année qui suivra leur retour. Une association verra le jour : Amicale des déportés tatoués du 27 avril 1944.
Sol de Compiègne !
Terre grasse et cependant stérile
Terre de silex et de craie
Dans ta chair
Nous marquons l’empreinte de nos semelles
Pour qu’un jour la pluie de printemps
S’y repose comme l’œil d’un oiseau
Et reflète le ciel, le ciel de Compiègne
Avec tes images et tes astres
Lourd de souvenirs et de rêves
(…)
Sol de Compiègne !
Un jour nous secouerons notre poussière
Sur ta poussière
Et nous partirons en chantant.
Nous partirons en chantant
En chantant vers nos amours
La vie est brève et bref le temps.
Rien n’est plus beau que nos amours.
Nous laisserons notre poussière
Dans la poussière de Compiègne
Et nous emporterons nos amours
Nos amours qu’il nous en souvienne
Qu’il nous en souvienne.
Robert Desnos. Il était de ce convoi, et mourra du typhus à Thésésienstadt le 8 juin 1945

Les rescapés se souviendront
27 et 28 04 1944
Sur les plages anglaises de Slapton Sands, dans le Devonshire, dont la configuration ressemble à celle d’Omaha et Utah Beach, deux des plages de Normandie choisies pour le débarquement, on répète le débarquement qui aura lieu cinq semaines plus tard… La défense allemande avait été orientée par les certitudes de Hitler, certitude que les Alliés ne pourraient débarquer que là où il y avait des ports importants… d’où le choix des Alliés pour des plages plutôt mal défendues.
On répète, mais on ne joue pas à la guerre : on la fait avec des balles réelles, et comme on fait beaucoup d’erreurs, cela coûtera 946 vies : ça s’appelle l’opération Tigre, qui va durer 9 jours.
Le 21 avril 1944, 9 vedettes lance-torpilles allemandes avaient quitté Cherbourg, pour intercepter 2 convois signalés au large de la presqu’île de Portland. Le brouillard les en empêchèrent, mais elles tombèrent par hasard, dans la baie de Lyme, sur 8 gros LST américains en cours de répétition de débarquement dans le cadre de cette opération, escortés seulement par la corvette HMS Azalea, avec des radios non calées sur la même fréquence. Le convoi devait théoriquement être protégé également par le HMS Scimitar, un destroyer de la Première guerre mondiale, mais, en cours de réparations, il était resté à Plymouth et son remplaçant n’était pas encore en place à l’arrivée des S-Boote. Bien que l’alerte au S-Boote ait été donnée 2 heures plus tôt, l’incompréhensible lenteur du convoi de débarquement permit aux vedettes rapides de torpiller les LST 507 et 531 et d’endommager gravement le LST 289. Quoique repérées par les Britanniques, les vedettes ne furent pas signalées aux Américains. Par manque de coopération entre l’U.S. Army et l’U.S. Navy, nombreux furent les GI’s qui périrent noyés dans la Manche ou bloqués dans les LST coulés ou encore d’hypothermie. En un quart d’heure à peine, l’attaque causa la mort de 198 marins et 551 soldats, soit au total 749 et en blessa une centaine d’autres. Eisenhower ne donna l’ordre de récupérer les naufragés qu’à l’aube, ce qui laissa le temps à de nombreux marins de mourir noyés. Les soldats, non amarinés, paniquèrent et n’attachèrent pas correctement leur gilet de sauvetage. En sautant à l’eau, le poids de leur équipement de combat les faisait basculer en arrière, leur maintenant la tête sous l’eau et les noyant. Un certain nombre d’officiers noyés durant l’exercice Tiger étaient porteurs de plans partiels du débarquement de Normandie (opération Overlord), avec des instructions secrètes référencées sous le nom de code bigot.
L’État-Major allié, qui s’était lancé dans un vaste plan de diversion et d’intoxication (opération Fortitude, prévoyant un débarquement aux environs de Calais) craignit que l’attaque des S-boote allemands n’ait pas été une simple coïncidence et que les plans du débarquement avec l’objectif réel dans le Cotentin ne soient tombés aux mains des Allemands. Il fallut lancer une vaste pêche aux cadavres dans la baie de Lyme et ce n’est que lorsque tous les plans manquants furent récupérés que le feu vert put être donné à la poursuite de l’opération Overlord. De toutes ces mortelles erreurs, – Baden Powell s’en serait mieux sorti – on tira tout de même quelques enseignements : une standardisation des fréquences radio américaines et britanniques, un meilleur entrainement à l’utilisation des gilets de sauvetage, une planification de récupération d’éventuels naufragés par l’utilisation de petites embarcations, et un renforcement de la collaboration entre les États-majors alliés, et entre la marine et l’armée de terre. Le plus strict secret militaire entourera longtemps cet événement ; mais aujourd’hui tout de même, on peut lire sur une plaque érigée sur la plage d’Utah Beach :
À la mémoire des 946 militaires américains qui ont été tués dans la nuit de 26 au 27 avril 1944 devant la côte de Slapton Sands (RU) pendant l’entrainement-exercice Tigre en vue du débarquement sur Utah Beach le jour J.
5 juin 2012, l’association Deep Respect
29 04 1944
Heinrich Harrer s’évade de Prem Nagar, en compagnie de sept autres détenus, étant entendu que, sitôt hors vue des gardiens du camps, chacun va de son côté selon ses préférences. Col de Tchangtchok à 5 300 m le 17 mai, où il retrouve Peter Aufschnaiter, le chef de l’expédition au Nanga Parbat, Kopp, et Treipel. Kasapuling ; Chipki Thulig le 9 juin, col de Bud Bud La, 5 700 m.
En gros il s’agit d’accéder, en se dirigeant vers le nord, à la haute vallée de l’Indus, de la remonter, d’ouest en est, puis de descendre la haute vallée du Brahmapoutre, d’ouest en est, et ensuite de quitter cette vallée par la rive gauche pour faire une longue boucle par le nord pour atteindre Lhassa.
Traxigang, sur la haute vallée de l’Indus, Gartok, qu’ils quittent le 14 juillet, sources du Tsang lo (le Brahmapoutre) Gyabnak, Tradam. À la mi-novembre Kopp se laisse convaincre par les autorités locales de se diriger vers le Népal, où les autorités le renverront sur l’Inde et ses camps de prisonniers ! À la mi-janvier 1945, ils arriveront à Kyirong, petit coin de paradis où ils resteront 9 mois [4].
Kyirong signifie en tibétain village de la béatitude. Et jamais, en vérité, je n’oublierai les mois que j’y ai passés. Si j’avais le choix et qu’on me demandait où j’aimerais finir mes jours, sans hésiter, je répondrais : à Kyirong. Je ferais construire un chalet en bois de cèdre rouge et détournerais l’eau d’un des innombrables ruisseaux qui descendent de la montagne pour irriguer mon jardin. Tous les fruits, toutes les fleurs poussent à Kyirong qui, malgré son altitude de 2 770 mètres, n’en est pas moins situé sur le 28° degré de latitude (… les Canaries. ndlr).
Nous sommes à la mi-janvier et la température est voisine de zéro degré. Jamais le thermomètre ne descend plus bas que dix degrés en dessous de zéro. Si la longueur des saisons est sensiblement la même que dans nos Alpes, la végétation accuse un caractère nettement tropical. Kyirong serait un centre idéal de sports d’hiver : de la neige toute l’année pour les skieurs et des cimes de six à sept mille mètres pour les alpinistes.
De Tagye Gyirong, Dzonga, col de Kargyu, col de Kora, col de Sangsung, Labrang Trova ; début janvier 1946 Col de Guring 5 972 m. Detchen, Lhassa, 3 700 m d’altitude, le 15 janvier 1946.
Il contera tout cela dans Sept ans d’aventure au Tibet en 1953 : immense succès.
Un Européen conçoit difficilement que les moindres fantaisies du Dalaï Lama puissent avoir force de loi. Et pourtant, c’est un fait. Pour le satisfaire, on mobilise, si besoin est, tout l’appareil gouvernemental. On essaie d’abord de trouver à Lhassa l’objet désiré par le monarque : en cas d’échec, un messager, muni d’un passeport spécial, part immédiatement pour les Indes. Le fanion rouge qu’il arbore, insigne de sa fonction, signifie que chacun doit lui prêter secours en toute circonstance. Les chefs des relais qui flanquent la route des caravanes lui réservent le meilleur cheval et le messager a priorité sur tout voyageur, quels que soient son rang et son titre. Souvent, il se fait précéder d’une estafette qui avise les autorités de son passage.
Ces messagers, les atrung, parcourent des distances de cent à cent-vingt kilomètres sans descendre de cheval et franchissent les cols, qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il neige. Il leur est interdit de s’arrêter tant que leur mission n’a pas été remplie. La ceinture de leur pelisse est scellée du cachet gouvernemental, ce qui les empêcherait de se déshabiller si, oublieux de leur devoir, ils profitaient d’une halte pour se coucher. Cette précaution est d’ailleurs superflue ; les atrung, fiers de leurs privilèges et de leurs exploits, sont célèbres dans tout le Tibet.
Nancy Wake est parachutée en Auvergne avec mission de coordonner les maquisards, organiser le parachutage d’armes et saboter les infrastructures allemandes avant le débarquement. Née 1912 à Wellington, en Nouvelle Zélande, elle a grandi Australie. Après des études de journalisme à Londres, elle devient rapidement correspondante à Paris pour le Chicago Tribune. En 1939, elle s’installe à Marseille où habite son mari Henri Fiocca, un riche industriel. Dès les premiers mois de l’occupation, elle rejoint un réseau de la Résistance française. Son rôle ? Aider les soldats britanniques et les Juifs à fuir vers l’Espagne en leur fournissant des faux papiers et en organisant leur passage. Pendant trois ans, elle joue un jeu dangereux, multipliant les allers-retours entre la France et l’Angleterre. La Gestapo, incapable de l’attraper, la surnomme la souris blanche. Sa tête est mise à prix pour 5 millions de francs. En 1943, son réseau est infiltré et son mari capturé, torturé et exécuté par la Gestapo, mais Nancy, elle, parvient à fuir. Arrêtée, elle endure plusieurs jours d’interrogatoire sans jamais parler. Finalement relâchée, elle rejoint Londres, où elle est recrutée par le Special Operations Executive (SOE), les services secrets britanniques. L’un de ses plus remarquables exploits reste, après la destruction du matériel radio permettant aux résistants de communiquer avec Londres, 430 km en vélo en 3 jours à travers les lignes ennemies pour transmettre un message crucial, prouesse qui permet de rétablir le contact avec l’Angleterre et d’assurer l’approvisionnement des maquis. Après la Libération, Nancy Wake est couverte de médailles : Légion d’honneur, Croix de guerre, Médaille de la Résistance en France ; George Medal au Royaume-Uni ; Médaille de la Liberté aux États-Unis. Elle devient ainsi la femme la plus décorée de la seconde guerre mondiale.

Nancy Wake
deuxième semaine de mai 1944
George Lane, de son vrai nom Dyuri Lanyi, [ils avaient tous changé de nom] du commando des X Troops, débarque de nuit sur les côtes françaises pour rapporter des photographies d’un nouveau type de mines installées sur les plages françaises. Par une nuit sans lune et sous une pluie battante, il embarque sur une vedette rapide avec trois autres camarades, puis rejoint en canot pneumatique noir la plage d’Ault, dans la Somme. Les ennuis vont commencer quand, au moment de prendre en photo la mine, son appareil infrarouge émet un flash. Immédiatement, des cris retentissent sur la plage, puis des tirs. Deux patrouilles allemandes, paniquées et sans visibilité aucune, se tirent dessus. George Lane et son camarade se plaquent dans l’eau de longues minutes avant de parvenir, sans se faire repérer, à rejoindre leur canot. Mais la vedette ne les a pas attendus : ils sont seuls, dérivant sur la Manche. Au petit matin, ils sont capturés, interrogés de longues heures par la Gestapo avant d’être présentés à Erwin Rommel, l’un des plus haut gradés du III° Reich, dans son quartier-général au château de La Roche-Guyon (Val-d’Oise). À aucun moment leur véritable identité ne sera découverte. Et par miracle, les deux hommes ne sont pas fusillés, contrairement à ce qu’Adolf Hitler avait ordonné en 1942 lors de la capture d’espions. Ils finiront la guerre dans un camp de prisonniers en Allemagne.
10 05 1944
Depuis janvier 1944, Philippe Henriot est secrétaire d’État à l’Information et à la Propagande du gouvernement de Laval ; orateur redoutable, on l’entend souvent sur Radio Paris : ce jour-là, il attaque frontalement Pierre Dac, juif et principal animateur de la Radio de la France libre ; il répondra à Philippe Henriot le lendemain.
La Conférence générale de l’ OIT – Organisation Internationale du Travail -, réunie à Philadelphie, adopte la Déclaration de Philadelphie qui redéfinit ses buts et objectifs.
Cette déclaration, adoptée à l’unanimité par les représentants (délégués des gouvernements, des employeurs et des salariés) s’adresse à tous les humains et insiste sur leur dignité. Elle consacre la reconnaissance à l’échelle internationale de l’importance des questions économiques et sociales, et du fait qu’elles sont indissociables des autres aspects des questions internationales.
La Conférence générale de l’Organisation internationale du travail, réunie à Philadelphie en sa vingt-sixième session, adopte, ce dixième jour de , la présente Déclaration des buts et objectifs de l’Organisation internationale du travail, ainsi que des principes dont devrait s’inspirer la politique de ses membres.
Article I
La Conférence affirme à nouveau les principes fondamentaux sur lesquels est fondée l’Organisation, à savoir notamment :
- le travail n’est pas une marchandise ;
- la liberté d’expression et d’association est une condition indispensable d’un progrès soutenu ;
- la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous ;
- la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie au sein de chaque nation et par un effort international continu et concerté dans lequel les représentants des travailleurs et des employeurs, coopérant sur un pied d’égalité avec ceux des gouvernements, participent à de libres discussions et à des décisions de caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun.
Article II
Convaincue que l’expérience a pleinement démontré le bien-fondé de la déclaration contenue dans la Constitution de l’Organisation internationale du travail, et d’après laquelle une paix durable ne peut être établie que sur la base de la justice sociale, la Conférence affirme que :
- tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales ;
- la réalisation des conditions permettant d’aboutir à ce résultat doit constituer le but central de toute politique nationale et internationale ;
- tous les programmes d’action et mesures prises sur le plan national et international, notamment dans le domaine économique et financier, doivent être appréciés de ce point de vue et acceptés seulement dans la mesure où ils apparaissent de nature à favoriser, et non à entraver, l’accomplissement de cet objectif fondamental ;
- il incombe à l’Organisation internationale du travail d’examiner et de considérer à la lumière de cet objectif fondamental, dans le domaine international, tous les programmes d’action et mesures d’ordre économique et financier ;
- en s’acquittant des tâches qui lui sont confiées, l’Organisation internationale du travail, après avoir tenu compte de tous les facteurs économiques et financiers pertinents, a qualité pour inclure dans ses décisions et recommandations toutes dispositions qu’elle juge appropriées.
Article III
La Conférence reconnaît l’obligation solennelle pour l’Organisation internationale du travail de seconder la mise en œuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser :
- la plénitude de l’emploi et l’élévation des travailleurs ;
- l’emploi des travailleurs à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leurs connaissances et de contribuer le mieux au bien-être commun ;
- pour atteindre ce but, la mise en œuvre, moyennant garanties adéquates pour tous les intéressés, de possibilités de formation et de moyens propres à faciliter les transferts de travailleurs, y compris les migrations de main-d’œuvre et de colons ;
- la possibilité pour tous d’une participation équitable aux fruits du progrès en matière de salaires et de gains, de durée du travail et autres conditions de travail, et un salaire minimum vital pour tous ceux qui ont un emploi et ont besoin d’une telle protection ;
- la reconnaissance effective du droit de négociation collective et la coopération des employeurs et de la main-d’œuvre pour l’amélioration continue de l’organisation de la production, ainsi que la collaboration des travailleurs et des employeurs à l’élaboration et à l’application de la politique sociale et économique ;
- l’extension des mesures de sécurité sociale en vue d’assurer un revenu de base à tous ceux qui ont besoin d’une telle protection, ainsi que des soins médicaux complets ;
- une protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les occupations ;
- la protection de l’enfance et de la maternité ;
- un niveau adéquat d’alimentation, de logement et de moyens de récréation et de culture ;
- la garantie de chances égales dans le domaine éducatif et professionnel.
Article IV
Convaincue qu’une utilisation plus complète et plus large des ressources productives du monde, nécessaire à l’accomplissement des objectifs énumérés dans la présente Déclaration, peut être assurée par une action efficace sur le plan international et national, et notamment par des mesures tendant à promouvoir l’expansion de la production et de la consommation, à éviter des fluctuations économiques graves, à réaliser l’avancement économique et social des régions dont la mise en valeur est peu avancée, à assurer une plus grande stabilité des prix mondiaux des matières premières et denrées, et à promouvoir un commerce international de volume élevé et constant, la Conférence promet l’entière collaboration de l’Organisation internationale du travail avec tous les organismes internationaux auxquels pourra être confiée une part de responsabilité dans cette grande tâche, ainsi que dans l’amélioration de la santé, de l’éducation et du bien-être de tous les peuples.
Article V
La Conférence affirme que les principes énoncés dans la présente Déclaration sont pleinement applicables à tous les peuples du monde, et que, si, dans les modalités de leur application, il doit être dûment tenu compte du degré de développement social et économique de chaque peuple, leur application progressive aux peuples qui sont encore dépendants, aussi bien qu’à ceux qui ont atteint le stade où ils se gouvernent eux-mêmes, intéresse l’ensemble du monde civilisé.
Wikipedia

Roosevelt et Phelan, directeur par intérim de l’OIT et principal auteur de la Déclaration signant la Déclaration de Philadelphie en 1944
Il est bien difficile de savoir dans quelle mesure ces vœux pieux ont influencé réellement les politiques sociales des pays membres. On est tenté de n’y voir qu’un immense récital d’incantations, ce que de Gaulle nommera le machin, et Greta Thunberg Bla, Bla, Bla
18 05 1944
Trois mois après avoir massivement déporté les Tchétchènes et les Ingouches, Staline déporte vers l’Ouzbékistan les Tatars de Crimée, surtout des femmes, des enfants et des vieillards – la plupart des hommes étaient au front -. Les nombreux morts durant le voyage ne pourront être enterrés qu’au bout de plusieurs jours, à l’arrivée, chose inadmissible pour des musulmans.
20 05 1944
Les Japonais subissent leur premiers revers depuis longtemps face aux Forces alliées du SEAC : South East Asia Command, en Assam, à Kohima, puis un mois plus tard à Imphal. La puanteur du champ de bataille, se souviendra Mountbatten à la tête du SEAC, était indescriptible. Les Chinois se mettaient de l’herbe dans les narines pour s’empêcher de vomir
Quelques mois plus tôt, il exhortait ainsi ses troupes : J’entends dire que vous appelez ce secteur le front oublié, et que vous vous considérez comme l’armée oubliée… Eh bien, laissez-moi vous dire que ceci n’est pas le front oublié, et que vous n’êtes pas l’armée oubliée… Et ce pour la bonne raison que jamais personne n’a entendu parler de vous.
… Mais à partir de maintenant , on va entendre parler de vous, car voici ce que nous allons faire…
En Chine, à Changsha, au Hunan, qui a vu Mao Zedong étudier pendant sa jeunesse, où il a rencontré aussi sa première femme, la bataille est rude : les Japonais finiront par l’emporter au mois d’août au prix de milliers de vies. La bataille se déplacera à Hengyang où les armées nationalistes résisteront pendant 47 jours aux Japonais. Sans artillerie lourde ni aviation, ils sont défaits. Chang Kai-Chek avait choisi comme chef d’état major le général américain Stilwell, un ancien de Verdun, qui ne portait pas en haute estime la valeur du soldat chinois et avait préféré faire porter sur la Birmanie l’essentiel de ses efforts, laissant à eux-mêmes les soldats nationalistes à Hengyang.
21 05 1944
Le cardinal Suhard consacre Paris et son diocèse à la Vierge : Notre Dame de Paris, vous qui êtes à la fois reine de France et reine de la paix, daignez nous écouter.
______________________________________________________________________________________________
[1] La bombe A est une bombe à fission, soit une rupture du noyau de l’atome : ce sont les armes nucléaires de première génération.
[2] Acronyme de Glavnoie OUpravlenie LAGuereï – Direction principale des camps -.
[3] Après la guerre, l’homme restera dans son domaine de compétences, informateur d’abord pour la CIA en Allemagne, puis, sous d’autres cieux, chef de la police nationale bolivienne sous les dictatures du général Barrientos, puis celle du Général Bravo Candia. En 1980, son organisation secrète, les Fiancés de la mort préparera l’arrivée au pouvoir du général Arce Gomez. Démasqué par Beate Klarsfeld dès 1972, il sera livré à la France en 1983, condamné à perpétuité et mourra à Lyon en 1991.
[4] appréciation qui sera confirmée par Tashi, moine dob-dob tibétain qui y séjournera comme employé d’un gouverneur bête et méchant, bien que tibétain. Dans Mémoires d’un moine aventurier tibétain Editions Philippe Picquier 1998
Laisser un commentaire