| Publié par (l.peltier) le 23 octobre 2008 | En savoir plus |
1812
Au printemps 2001, dans le fossé d’une fortification de Vilnius, capitale de la Lituanie, on découvrira les ossements de 3 260 soldats de Napoléon, reconnaissables aux boutons des uniformes : ils n’avaient pas été tués par les Russes entrés dans la ville 24 heures plus tard, mais étaient bien morts de froid, de faim et de la septicémie que provoquent les maladies transmises par les poux ! En décembre 1812, il avait fait – 38° à Vilnius : on ne pouvait pas creuser et donc on avait déposé les corps dans ces fossés… on estime à 40 000 le nombre de soldats morts à Vilnius… c’est là, le 5 décembre, que Napoléon quitta son armée en lambeaux pour regagner précipitamment Paris : peu après le début de la retraite, il avait appris la conspiration du général Malet [1] qui, sitôt évadé de prison le 23 octobre, avait tenté de le faire passer pour mort : de retour à Paris, Napoléon sera pris d’une colère noire contre tous les gardiens des institutions : et quand bien même j’aurais été mort, il ne s’est trouvé aucun d’entre vous pour penser à mon fils, mon héritier, le Roi de Rome ! Le ciment n’avait pas encore pris, et tout cela était encore sable.
Le 18 juin 1815, Jean Annez, juge de paix à Grammont (Belgique), ramasse parmi les corps du champ de bataille de Waterloo un manuscrit ensanglanté. C’est le récit d’un certain Louis Chenot, soldat de l’armée napoléonienne, mort lors des combats, rapportant ce que fût pour lui la retraite de Russie.
La Grande Misère de Louis Chenot, ainsi que celle de ses chers Compagnons d’arme,
qu’ils ont souffert dans la maudite Russie, dans les années 1812, 1813, 1814
Ce journal de soldat, une trentaine de feuillets est ensuite passé de main en main, deux siècles durant, sans jamais avoir été publié. Jean Annez l’a transmis à son frère Henri, qui l’a confié, en 1864, à son neveu par alliance, Auguste de Portemont. En 1925, la famille de Portemont le donne au général Henri Waymel, parent éloigné, qui l’a laissé à sa fille en 1960, Anne-Marie Waymel, son actuelle propriétaire.
[sic] Nous sommes arrivés à Moskow le 14 septembre 1812. Nous avons commencé notre retraite le 18 octobre 1812, qui a été le commencement de notre grande misère. L’armée russe,… avait déjà brûlé les villes, bourgs et villages, le moins à 9 ou 10 lieues chaque côté de la route de manière que nous soyons sans vivre n’y sans espérance d’en avoir pour les hommes n’y pour les chevaux. Les routes étaient interceptées de tous cotés par les Kosaques et l’armée russe. Nous étions toujours enveloppés des Kosaques. Nous sommes arrivés à Smolinki le 12 novembre 1812. Nous avons évacué la ville dans la nuit du 14 au 15 novembre 1812.
Lorsque j’ai été pris, j’étais blessé ; j’avais l’épaule droite démise et un coup de baïonnette dans la cuisse droite. Après avoir été pris, les Kosaques m’ont traité comme des barbares et des lâches qu’ils sont. Après avoir été leur esclave et soumis à eux, ils m’ont fait présent de sept coups de lance, même que j’eus beaucoup de peine à m’en rétablir. Nous avons été pris le 18 novembre 1812, 15 000 hommes. Dans l’espace de deux mois et six jours, nous sommes restés à 500 hommes. De 15 000, ils en ont tué et fait mourir 14 500. […]
Nous mourrions de faim et de soif. Nous étions obligés de boire de notre urine. Les scélérats qu’ils nous gardaient, comme il y avait beaucoup de bestiaux de crevé dans la ville, des chevaux, des bœufs, des vaches, des moutons et des chiens, ils allaient prendre de ces charognes, qu’il y en avait qui étaient toutes pourries, ils nous la vendaient 2 et 3 francs la livre.
Dans des endroits où qu’il y pouvait coucher 20 hommes, ils nous y mettaient 60, 70, 80. Tous les matins, il y en avait toujours 20, 25, et 30 de morts. Ils leur mettaient la corde aux pieds, ensuite ils les tiraient dehors. Ensuite ils les couchaient dehors, pour les réchauffer, ils y mettaient le feu ! Pour qu’ils ne me missent pas nus, comme mes camarades que je voyais déshabillés à chaque instant, mes habillements, ceux qui n’avaient pas beaucoup de trous, j’en faisais. Ensuite, je les raccommodais avec de mauvaises pièces de différentes couleurs ainsi que gros fil, de manière qu’ils n’en pouvaient rien faire. Et à moi, ils m’étaient bien utiles pour me garantir de la grande fraîcheur. Je n’ ai eu que les oreilles, le nez, les lèvres, les mains et les pieds qu’ils ont gelés. En route, il me pendait des glaçons aux yeux gros comme les doigts. Des larmes qui me coulaient des yeux, elles étaient à peine sorties de mes yeux qu’elles étaient gelées.
Dans l’espace des 40 jours, il en est mort passé la moitié. Sur les derniers jours, nous étions pas trop gênés dans les logements. Tous les jours les paysans passaient dans les logements pour enlever les morts. Ils en chargeaient plein des traîneaux, ensuite ils les menaient à 300 pas du village. Ils en faisaient un tas, le couvraient de bois et ensuite ils y mettaient le feu et les réduisaient en cendre.
Le gouverneur qui gouvernait cette ville aimait depuis longtemps les français. Nous voyant si accablés de misère et enfoncés si avant dans l’esclavage et que nous étions les victimes d’un grand nombre de scélérats. Comme l’humanité l’exige, il a eu un peu pitié de notre sort, il a ordonné à la police de la ville, qu’il fallait désormais nous traiter avec plus de douceur et nous faire loger dans un faubourg de la ville, chez les habitants, deux, trois et quatre au plus par maison.
Mais les habitants étaient pour le moins aussi sales que nous. Les poux sont plus communs chez eux que l’argent, parce qu’ils n’ont point d’argent : des poux ils en ont en grande quantité. Moi je peux dire que j’en ai eu autant comme l’on peut en avoir parce que si j’en avais eu davantage, ils m’auraient mangé tout vif. Ils m’avaient déjà plus de moitié mangé. Je n’avais plus que la peau étendue sur les os. Mon corps ressemblait à un squelette, j’avais les yeux morts dans la tête, je ne pouvais plus parler, presque plus de mouvements dans les membres.
Oh Grand Dieu ! Lorsque je songe à d’aussi cruels tourments, que j’ai souffert, le sang m’en frémi encore dans les veines. Si je n’avais pas passé par un chemin aussi rude ou que je n’aurais pas eu quelques espérances semblables. Non, l’on ne m’aurait jamais fait croire que l’homme est dans le cas d’endurer d’aussi grands tourments comme j’en ai enduré sans succomber au tombeau.
J’ai été six mois et huit jours sans changer de chemise : depuis le douze novembre 1812 jusqu’au vingt mai 1813. Ainsi jugez si elle devait être bien blanche ! J’en avais deux, l’une surtout, elle me garantissait beaucoup plus de la rigueur du temps mais en récompense il n’y manquait pas de compagnons !!! Lorsque je pouvais les mettre réchauffer dans un four, je ne manquais pas l’occasion lorsqu’elle était aussi avantageuse pour moi. Lorsque je retirais mes chemises du four, les poux étaient brûlés. Ils étaient ramassés en tas gros comme le pouce. De place en place dans mes chemises, lorsqu’ils étaient bien brûlés, je secouais mes chemises, les poux tombaient comme de la poussière, ainsi voyez qu’il y en avait quelques uns !
Suite d’un peu plus de soulagement à l’époque du vingt mai 1813. Depuis cette époque que nous avons eu la permission de travailler. Mais j’étais bien faible, bien misérable. Je faisais pitié. L’on aurait pas donné deux sous de ma personne, mais plusieurs journées se sont écoulées, le beau temps et les beaux jours ont commencé à renaître. Le sang a commencé de nouveau à flotter dans mes veines. Le courage et la force m’est successivement revenu. Les cheveux m’ont tombé de la tête. Une nouvelle peau s’est formée sur mon pauvre cadavre dont qu’elle en a fait tomber la vieille par morceau.
Mon corps a recommencé de nouveau à prendre de la nourriture, de sorte qu’en peu de temps je m’ai suis rétabli. J’avais un appétit si tellement grand que j’aurais bien mangé cinq livres de pain par jour. Jour et nuit, j’avais toujours faim. Je ne pouvais pas me rassasier. J’aurais mangé le diable et ses cornes.
Ceux qu’ils habitent les villes ne sont esclaves que de la couronne. Ils vendent eux-mêmes leurs propres enfants à ceux qu’il les veulent acheter. Ils ne vendent pas cher, un garçon de 16, 18 et 20 ans, se vend depuis 25 à 30 francs, une fille se vend 20 à 25 francs. Tous les habitants des campagnes appartiennent aux barons de sorte qu’ils peuvent en disposer à leur gré. Ils peuvent les battre, les tuer et les vendre.
Les barons nous ont sollicités beaucoup, pour rester chez eux, qu’ils nous auraient donné des emplois, que nous n’aurions point travaillé, nous aurions commandé les paysans, être chef d’atelier ou homme d’affaires. Dans la ville que, il en a resté 45 de 400 hommes. Pour y rester, il fallait se faire débaptiser et se faire baptiser russe parce qu’ils ne sont pas sont pas de même religion : ils sont Catholiques apostoliques asmatiques grecs et non romains. Moi, jamais leurs promesses ne m’ont tentées.
L’ordre de notre bienheureux départ est arrivé dans les gouvernements que nous étions le 4 juin 1814. Ils nous ont fait partir le 24 du dit mois, le jour de St Jean pour nous rendre dans notre chère patrie. Nous avons marché plusieurs fois 80, 90 et 100 lieues sans trouver une ville.
[…] Donc qu’il y avait 364 lieues en Russie que nous les avons faites en 37 jours de marche.
[…] Lorsque nous avons été arrivé à la Pologne, nous avons encore eu 11 jours de marche avant que d’entrer en Prusse.
[…] Nous avons continué de marcher jusqu’à la fin de tous les pays étrangers pour entrer dans notre belle France par Landau, première ville de France.
Louis Chenot, † à Waterloo le 18 06 1815.
14 12 1812
Dresde. À François Ier, Empereur d’Autriche. Monsieur mon frère et très cher Beau-Père, je m’arrête un moment à Dresde pour écrire à Votre Majesté et lui donner de mes nouvelles. Malgré d’assez grandes fatigues, ma santé n’a jamais été meilleure. Je suis parti le 4 de ce mois, après la bataille de la Bérézina, de Lituanie, laissant la Grande Armée sous les ordres du roi de Naples, le prince de Neufchâtel continuant à faire les fonctions de major général. Je serai dans quatre jours à Paris ; j’y resterai les mois d’hiver pour vaquer à mes affaires les plus importantes.
Je suis plein de confiance dans les sentiments de Votre Majesté. L’alliance que nous avons contractée forme un système permanent dont nos peuples doivent retirer de si grands avantages que je pense que Votre Majesté fera tout ce qu’elle m’a promis à Dresde pour assurer le triomphe de la cause commune et nous conduire promptement à une paix convenable.
19 12 1812
Je m’occupe sans relâche à réorganiser tous mes moyens. J’ai déjà une armée de 40 000 hommes à Berlin et sur l’Oder.
26 12 1812
Au général Clarke : S’il est nécessaire, j’ordonnerai que mes arsenaux de la marine travaillent aux équipages d’artillerie ; je préfère cela aux réquisitions. Un ou deux vaisseaux de plus ou de moins ne sont d’aucune influence dans la balance des affaires, tandis que le moindre manque d’artillerie peut m’être très préjudiciable.
30 12 1812
Au prince de Neufchâtel : J’ai reçu votre lettre du 21 ; j’ai reçu aussi votre note pertes réelles ; je vais y penser sérieusement. La conscription de cette année est fort belle, j’ai eu dimanche une parade d’environ 25 à 30 000 hommes.
Napoléon. Vie de Napoléon par lui-même. Compilation d’André Malraux. Gallimard 1930
1812
La fièvre aphteuse se répand dans tous les départements, notamment dans le nord.
Louis Braille a 3 ans : il traîne dans l’atelier de maroquinerie de son père et accidentellement s’enfonce un couteau dans l’œil : une ophtalmie sympathique le rend ensuite complètement aveugle, ce qui ne l’empêche pas de devenir rapidement violoncelliste et organiste ; à l’âge de 10 ans, il reçoit une bourse pour l’Institution des Jeunes aveugles, fondée par Valentin Haüy : trouvant l’alphabet romain illisible par des aveugles, il se met à élaborer un nouveau système qui permettrait aux aveugles, non seulement de lire, mais aussi d’écrire : il y parvint en simplifiant un système inventé par le capitaine d’artillerie Charles Barbier, utilisé par les soldats pour communiquer la nuit : Braille réduisit à 6 points la grille de 12 points de Barbier. Trop révolutionnaire et trop simple pour être admis immédiatement, l’invention de 1829 devra attendre 1837 pour être adoptée.
3 01 1813
Les exploitants de mines devront fournir aux ouvriers blessés secours médical et médicaments. Le travail des enfants de moins de dix ans est interdit.
7 01 1813
À l’empereur François : Je n’ai jamais rencontré l’armée russe que je ne l’aie battue. Ma garde n’a jamais donné. Elle n’a pas tiré un coup de fusil et n’a pas perdu un seul homme devant l’ennemi. Il est vrai que, du 7 novembre au 16, 30 000 de mes chevaux de cavalerie et d’artillerie sont morts ; j’ai abandonné plusieurs milliers de voitures, par défaut de chevaux. Dans cette terrible tempête de froid, le bivouac est devenu insupportable à mes gens ; beaucoup s’éloignaient le soir pour chercher des maisons et des abris ; je n’avais plus de cavalerie pour les protéger. Les Cosaques en ont ramassé plusieurs milliers.
Quant à la France, il est impossible d’être plus satisfait que je le suis : hommes, chevaux, argent, on m’offre tout. Mes finances sont en bon état.
La conséquence de tout ceci doit être que je ne ferai aucune démarche pour la paix.
Votre Majesté connaît à présent mes affaires et mes vues comme moi-même. Je suppose que cette lettre et les sentiments que je confie à Votre Majesté resteront entre Elle et moi ; mais elle peut, en conséquence de la connaissance qu’elle a de mes dispositions, agir comme Elle le jugera convenable dans l’intérêt de la paix.
19 01 1813
Ayant laissé un peu de sa superbe en Russie, Napoléon, accompagné de l’impératrice et de son fils, se rend à Fontainebleau pour négocier d’homme à homme avec le pape Pie VII. Isolé et pressé, le vieil homme finit par céder sur son pouvoir temporel, la nomination des évêques et même la réforme de la carte des diocèses d’Italie et d’Allemagne : il recule sur toute la ligne en échange d’une importante compensation financière, sa libération et celle des cardinaux détenus par la France. Napoléon s’empresse de nommer tout cela concordat de Fontainebleau le 23 janvier 1813. Le régime de détention du pape est assoupli ; il retrouve ses conseillers en désaccord avec ce texte qui l’incitent à le dénoncer, puisqu’obtenu sous la contrainte : ce qu’il fait le 24 mars. D’où retour du régime rigoureux.
21 04 1813
Le roi Frédéric-Guillaume III de Prusse crée par décret les Landsturm : des forces militaires non régulières, appelant à la résistance par tous les moyens à l’invasion des troupes françaises. Tous les citoyens prussiens ont obligation de s’opposer à l’invasion en utilisant toutes les armes disponibles … haches, fourches, faux ou fusils de chasse. Non seulement, ils doivent désobéir aux ordres de l’ennemi, mais encore lui nuire le plus possible.
C’est une rupture avec le traditionnel jus in bello (loi de la guerre), qui commandait aux populations civiles d’obéir aux ordres de la puissance occupante, et aux forces de police d’assister celle-ci au maintien de l’ordre. Le décret Landsturm précise explicitement qu’il est préférable de risquer le danger provoqué par la répression d’une armée envers la population plutôt que de laisser l’ennemi contrôler la situation. La légitime défense justifie l’usage de tous les moyens, y compris le chaos. Le décret sera modifié le 17 juillet 1813, nettoyé de son contenu subversif par rapport aux lois de la guerre.
26 04 1813
Au général Clarke : Je viens de voir le 37° d’infanterie légère ; il est impossible de voir un plus beau corps en soldats, mais il est impossible en même temps d’en voir un plus mauvais en officiers. Si votre bureau avait pris à tâche de nommer les officiers les plus ineptes de France, il n’aurait pas mieux réussi ; ces officiers sont la risée des soldats. Effectivement, ils sont tirés des bataillons coloniaux, du service hollandais ou de la garde nationale des Pyrénées et de l’Escaut ; la plupart des capitaines n’ont jamais vu le feu. Je vais être obligé de destituer et de renvoyer tous ces officiers.
3 05 1813
De notre camp impérial de Lützen : Soldats, je suis content de vous ! Vous avez rempli mon attente ! Vous avez suppléé à tout par votre bonne volonté et votre bravoure. Vous avez ajouté un nouveau lustre à la gloire de mes aigles ; vous avez montré tout ce dont est capable le sang français. La bataille de Lützen sera mise au-dessus des batailles d’Austerlitz, d’Iéna, de Friedland et de la Moskova.
13 06 1813
Au général Savary : Le ton de votre correspondance ne me plaît pas ; vous m’ennuyez toujours du besoin de la paix. Je connais mieux que vous la situation de mon Empire, et cette direction donnée à votre correspondance ne produit pas un bon effet sur moi. Je veux la paix, et j’y suis plus intéressé que personne : vos discours là-dessus sont donc inutiles ; mais je ne ferai pas une paix qui serait déshonorante, ou qui nous ramènerait une guerre plus acharnée dans six mois. Ne répondez pas à cela ; ces matières ne vous regardent pas, ne vous en mêlez pas.
18 06 1813
Au prince Cambacérès : Le ministre de la police paraît chercher à me rendre pacifique. Cela ne peut avoir aucun résultat, et me blesse, parce que cela supposerait que je ne suis pas pacifique. Je ne suis pas un rodomont ; je ne fais pas de la guerre un métier, et personne n’est plus pacifique que moi.
Napoléon. Vie de Napoléon par lui-même. Compilation d’André Malraux. Gallimard 1930
21 06 1813
Les troupes françaises qui accompagnaient le roi Joseph Bonaparte dans sa fuite sont battues à Vitoria par le général Arthur Wellesley, vicomte de Wellington, auquel Beethoven dédie la symphonie La Bataille.
26 06 1813
Clément de Metternich, ministre des Affaires étrangères de l’Empire d’Autriche, vient à Dresde pour y rencontrer, neuf heures durant, sans témoin, Napoléon, sorti très affaibli de la campagne de Russie.
Metternich vient proposer un marché à Napoléon : restituer certaines des conquêtes de l’Empire contre la promesse de la paix ou voir l’Autriche rejoindre les pays coalisés contre la France. Metternich est persuadé que Napoléon refusera ce marché qui se transforme alors en piège – il eut raison sur toute la ligne.
Nicolas Demorand. France Inter 10 mai 2021
Le blocus continental mis en place par Napoléon avait fait pâlir considérablement son étoile outre-Rhin. Metternich n’aura pas à trop forcer son talent pour que se défasse la Confédération du Rhin, et la toute nouvelle Westphalie avec de nombreux retournements d’alliances… les forces qui allaient mener à l’abdication de Fontainebleau se mettaient en place.
18 09 1813
La guerre n’est pas affaire de femmes ? Qu’à cela ne tienne, si femme veut la faire, elle n’a que de se faire passer pour un homme : et c’est ce qu’a fait Eléonore Prochaska, domestique prussienne de 28 ans qui, par haine de Napoléon, s’est engagée dans le corps franc de Lützow, tout récemment crée, sans gages, et devant fournir son uniforme ; sous le nom d’Auguste Arenz, elle se fait faucher par la mitraille française à Göhrde, qui est d’ailleurs la première victoire prussienne depuis nombre d’années contre Napoléon. Mortellement blessée, elle va mourir peu après. Les Prussiens la nommeront la Jeanne d’Arc de Potsdam.
19 10 1813
Lindenau Bulletin : L’Empereur avait ordonné au génie de pratiquer des fougasses sous le grand pont qui est entre Leipzig et Lindenau, afin de le faire sauter au dernier moment, une partie de l’armée était encore de l’autre coté avec un parc de 80 bouches à feu et de quelques centaines de voitures.
La tête de cette partie de l’armée, qui arrivait au pont, le voyant sauter, crut qu’il était au pouvoir de l’ennemi. Un cri d’épouvante se propagea de rang en rang : L’ennemi est sur nos derrières et les ponts sont coupés ! Ces malheureux se débandèrent et cherchèrent à se sauver. Le duc de Tarente passa la rivière [Elster] à la nage ; le comte Lauriston, moins heureux, se noya ; le prince Poniatowski, monté sur un cheval fougueux, s’élança dans l’eau et n’a plus reparu.
On ne peut encore évaluer les pertes occasionnées par ce malheureux événement ; mais les désordres qu’il a portés dans l’armée ont changé la situation des choses : l’armée française victorieuse arrive à Erfurt comme y arriverait une armée battue. L’ennemi, qui avait été consterné des batailles du 16 [Leipzig] et du 18 [Wachau], a repris par le désastre du 19, du courage et l’ascendant de la victoire. L’armée française, après de si brillants succès, a perdu son attitude victorieuse.
Je voyais clairement arriver l’heure décisive. L’étoile pâlissait, je sentais les rênes m’échapper, et je n’y pouvais rien. Un coup de tonnerre pouvait seul nous sauver. Il ne restait donc qu’à combattre ; et chaque jour, par une fatalité ou une autre, nos chances diminuaient !
Napoléon. Vie de Napoléon par lui-même. Compilation d’André Malraux. Gallimard 1930
La très lourde défaite de Leipzig ne peut se réduire à un terrible malentendu sur la mise à feu pour faire sauter ce pont. C’est tout l’édifice politique bâti par Napoléon avec la Confédération du Rhin qui se lézarde : Maximilien de Bavière, le membre le plus important, s’est déclaré neutre le 17 septembre, puis a rejoint la coalition le 8 octobre. Frédéric de Wurtemberg a entamé des négociations avec les coalisés. Et surtout, il y a les très nombreuses défections lors de la bataille elle-même ; avant même le déclenchement, c’est Bernadotte à la tête d’une armée du Nord [mais le retournement de Bernadotte est antérieur à la bataille de Leipzig], puis en cours de bataille, les troupes saxonnes du corps de Reynier – environ 3 000 hommes – passent en bloc à l’ennemi le 18 octobre au matin ; en même temps, la cavalerie wurtembergeoise – 600 hommes – change de camps. Au matin du 19 octobre Napoléon quitte le terrain de bataille pour Erfurt ; une brigade de soldats hessois, envoyée par Macdonald à Augereau en difficulté ouvre le feu sur les soldats français. Et c’est alors la tragédie du pont que les soldats de Monfort font sauter avant que la totalité de l’armée française ne l’ai franchi : 20 000 hommes restent à la merci de l’ennemi.
28 10 1813
Sur la chaussé en avant de Schlüchterne. Aux officiers polonais.
Est-il vrai que les Polonais veuillent me quitter ?
J’ai été trop loin, j’ai fait des fautes. La fortune depuis deux ans me tourne le dos ; mais c’est une femme, elle changera. Qui sait ? Peut-être votre mauvaise étoile a-t-elle entraîné la mienne. Du reste, avez-vous perdu confiance en moi ? N’ai-je plus de … dans mes c… ? Ai-je maigri ?
Je voudrais bien que les Alliés me brûlent deux ou trois de mes bonnes villes en France, cela me donnerait un million de soldats. Je livrerais bataille, je la gagnerais, et je les mènerais, tambour battant, jusqu’à la Vistule.[…]
3 11 1813
Napoléon n’a pas le monopole des massacres, du mépris de la vie humaine… aux États-Unis, 900 dragons américains sous le commandement du général Andrew Jackson se livrent eux aussi à un massacre sur les Indiens Red Sticks Creeks à Tallushatchee, à 5 km au nord d’Alexandria, en Alabama : 186 morts chez les Sticks, 5 chez les dragons américains. Nous les avons tué comme des chiens, dira Davy Crockett.
10 11 1813
Saint Cloud : Le directeur de la conscription promet 150 000 hommes. Ces 150 000 hommes étant insuffisants, je désire en lever 100 000 autres.
La conscription de 1815 est censée être de 160 000 hommes ; je pourrai en appeler 200 000.
12 11 1813
Je suis occupé dans ce moment à lever 600 000 hommes.
Napoléon. Vie de Napoléon par lui-même. Compilation d’André Malraux. Gallimard 1930
11 12 1813
Napoléon réinstalle sur le trône d’Espagne Ferdinand VII. Mais les forces anglaises avec Wellington, portugaises et espagnoles ont déjà franchi la frontière, soit à peu près 70 000 hommes.
1813
Le genevois Augustin Pyrame de Candolle, professeur à Montpellier, élabore la taxonomie, ensemble des principes de la classification des espèces botaniques. Le Français Henri Meynard atteint le sommet du Breithorn, au sud de Zermatt – 4171 m.-
La Grande Russie a eu raison de la Grande armée de Napoléon : pour la Campagne de France, il lève successivement en janvier 1813, 150 000 hommes de la classe 1814, 100 000 des classes 1809 à 1812, 100 000 dans le premier ban de la Garde nationale, 180 000 en avril, 160 000 de la classe 1815 et 120 000 des classes 1808 – 1814, en octobre, 150 000 des classes 1803 à 1814, en novembre…. On est tout près du million.
Les trois armées coalisées envahissent le territoire français par le Nord et l’Est. Le prince Schwarzenberg, stationné à Bâle et au nord de Trieste est à la tête de l’armée de Bohème [Autriche], forte de 200 000 hommes. Le maréchal Blücher, stationné à Kaub, près de Mayence, est à la tête de l’armée de Silésie [Prusse] avec 96 000 hommes. La troisième armée, dite du Nord, conduite par Von Bülow et Bernadotte, prince héritier de Suède, compte plus de 180 000 hommes, dont seulement 40 000 franchiront la frontière. En face, malgré l’énorme levée d’hommes, ce ne sont guère que 186 000 hommes que Napoléon peut aligner, 240 000 en y intégrant les régiments de la garde nationale. Et les plus jeunes, les Marie Louise, sont inexpérimentés.
Simon Bolivar est parvenu à lever une armée, pas plus de 1 000 hommes, avec lesquels il reprend le Venezuela : il se fait nommer dictateur et jouit de pouvoirs d’exception limités dans le temps. Limités dans le temps, ils le seront de toutes façons, car les partisans encore nombreux du roi et de l’Église reprennent le pouvoir dès 1814 : celui qu’on nomme déjà le Libertador s’exile en Haïti où il avait déjà trouvé auprès du président Pétion armes, bateaux et soldats. Il y retrouvera encore aide et soutien à condition d’affranchir tous les esclaves d’Amérique du Sud partout où ses troupes seraient victorieuses. Il se démène pour unifier les différentes guérillas vénézuéliennes et grenadines.
Le Paraguay, peuplé d’Indiens Guarani, devient indépendant ; c’est alors sans doute le pays le plus arriéré et le plus pauvre du Nouveau Monde : Gaspar Rodriguez de Francia, Dictateur suprême de la République guarani commence par engager dès 1814 une réforme agraire radicale : tous les grands domaines sont expropriés et l’État récupère ainsi plus de la moitié des terres du pays : la plus grosse part en sera louée à des familles de paysans : la production agricole sera ainsi stimulée, amenant entre autres un rente régulière à l’État. Francia installe le pays dans un protectionnisme à géométrie variable, interdisant tout achat à crédit sur les marchés extérieurs. À sa mort en 1840, il sera remplacé par Carlos Antonio Lopez.
Jusqu’à sa destruction, le Paraguay se dressait comme une exception en Amérique latine : il était l’unique nation que le capital étranger n’avait pas déformée. Le long gouvernement à main de fer du dictateur Gaspar Rodriguez de Francia (1814-1840) avait engendré, dans la matrice de l’isolement, un développement économique autonome et durable. L’État, paternaliste et tout-puissant, remplaçait une bourgeoisie nationale inexistante dans la mission d’organiser la nation, d’orienter ses ressources et son destin. Francia s’était appuyé sur les masses paysannes pour écraser l’oligarchie paraguayenne et avait conquis la paix intérieure en tendant un cordon sanitaire rigide face aux autres pays de l’ancienne vice-royauté du Rio de la Plata. Les expropriations, l’exil, les prisons, les persécutions et les amendes n’avaient pas été utilisés pour la consolidation de l’empire interne des propriétaires terriens et des commerçants mais, au contraire, pour sa ruine. Il n’y avait – il n’y aurait jamais – ni libertés politiques ni droit d’opposition, mais à cette période de l’histoire, seuls les nostalgiques des privilèges perdus souffraient du manque de démocratie. Lorsque Francia mourut, les grandes fortunes privées n’existaient pas et le Paraguay était le seul pays d’Amérique latine à ne compter ni mendiants, ni affamés, ni voleurs ; les voyageurs de l’époque y découvraient une oasis de tranquillité au milieu des autres régions secouées par des guerres continuelles. L’agent nord-américain Hopkins rapportait à son gouvernement, en 1845, qu’au Paraguay il n’y a pas d’enfant qui ne sache lire et écrire…. C’était aussi le seul pays qui ne vivait pas les yeux rivés sur l’autre côté de l’Océan. Le commerce extérieur ne constituait pas l’axe de la vie nationale ; la doctrine libérale – expression idéologique de l’articulation mondiale des marchés – manquait de réponses quant au défi que le Paraguay, contraint à un développement intérieur à cause de son isolement, se posait depuis le début du siècle. L’anéantissement de l’oligarchie rendit possible la concentration des ressorts économiques fondamentaux entre les mains de l’État et permit la poursuite de cette politique autarcique de croissance.
Eduardo Galeano. Les veines ouvertes de l’Amérique Latine. Terre humaine Plon
3 01 1814
Les Autrichiens occupent Montbéliard.
5 01 1814
Un autre curé de village du Mexique, José Maria Morelos, zambo – métis d’un charpentier Indien et d’une institutrice créole -, avait repris le flambeau de Miguel Hidalgo ; il était parvenu à rassembler sous la bannière de la citoyenneté nouvelle les deux communautés, il s’était emparé dès novembre 1812 d’Oaxaca, au sud ; mais le nouveau vice roi nommé par l’Espagne disperse son armée à Pururuan. Battu, trahi par les communautés indiennes, il sera fait prisonnier le 22 décembre 1815 et fusillé dans le dos.
8 01 1814
Murat, roi de Naples, passe un traité d’alliance avec l’Autriche. Il entame une marche triomphale avec son armée à travers l’Italie. Partout, il est acclamé. Après une échauffourée avec les troupes d’Eugène de Beauharnais, vice-roi d’Italie, il est pris de remords. Napoléon semble prêt à un compromis, mais, dans le même temps, abdique à Fontainebleau. Doublé par les Autrichiens et les Anglais, Murat rentre à Naples en mai. Il sera confirmé roi de Naples par le Congrès de Vienne. Des contacts se noueront cependant avec Napoléon à l’île d’Elbe. Lorsqu’il apprendra le débarquement de l’empereur en France, il déclarera la guerre à l’Autriche alors que Napoléon n’est pas encore arrivé aux Tuileries. Le 30 mars 1815, à Rimini, il appellera les Italiens à l’insurrection : Italiens ! L’heure est venue où doivent s’accomplir les destinées de l’Italie ; la Providence vous appelle enfin à être une nation indépendante ; un cri se fait entendre depuis les Alpes jusqu’au détroit de Scylla, et ce cri est : indépendance de l’Italie !
Les scènes de joie de l’année précédente se répéteront dans toute la péninsule. Sévèrement battu par les Autrichiens à Tolentino le 2 mai, il devra fuir Naples pour Cannes, puis la Corse : il tentera un débarquement en Calabre, sans avoir prévu que les Calabrais lui en voulaient d’avoir mis en prison les brigands. Mais les dés étaient jetés : il ne savait même pas que ce débarquement était dirigé en sous-main par l’Autriche, pour être voué à l’échec : des 300 hommes au départ, il n’en restait que 28 à l’arrivée ! Fait prisonnier, enfermé au château de Pizzo, en Calabre, il sera exécuté le 13 octobre 1815 : il avait été brave toute sa vie, brave il resta devant la mort : J’ai bravé la mort trop souvent pour la craindre. Soldats ! Faites votre devoir ! Droit au cœur mais épargnez le visage. Feu !
10 01 1814
Au maréchal Macdonald : Vous sentez combien il est important de retarder la marche de l’ennemi. Employez les garde forestiers, les gardes nationales, pour faire le plus de mal possible à l’ennemi. Ne jamais faire aucun préparatif pour abandonner Paris, et s’ensevelir sous ses ruines, s’il le faut.
14 01 1814
Le maréchal Ney doit évacuer Nancy.
16 01 1814
Les coalisés sont à Langres.
19 01 1814
Les coalisés, qui tiennent déjà Metz et Nancy, prennent Épinal, Chaumont et Dijon.
24 01 1814
Les défaites napoléoniennes qui vont sauver le pape, incitant l’empereur à le transférer à Savone, en évitant la vallée du Rhône où les risques sont trop élevés : le voyage à travers les campagnes de Provence se révèle triomphal, accueilli comme le Messie par un peuple qui est plus que fatigué des toutes ces guerres incessantes. Pie VII arrivera à Bologne le 31 mars, le jour où la coalition anti-impériale arrive à Paris, et revanche ultime, va se permettre d’envoyer des cardinaux au congrès de Vienne !
25 01 1814
Napoléon quitte Paris pour Vitry le François pour y prendre personnellement le commandement de l’armée.
26 01 1814
Châlons sur Marne. Au prince de Neufchâtel : Faites prendre à Vitry 2 à 300 000 bouteilles de vin et d’eau de vie, afin qu’on en fasse la distribution à l’armée aujourd’hui et demain. S’il n’y a pas d’autre vin que du vin de Champagne en bouteilles, prenez-le toujours ; il vaut mieux que nous le prenions que l’ennemi.
30 01 1814
Victoire de Brienne.
2 02 1814
Les troupes ennemies se comportent partout horriblement. Tous les habitants se réfugient dans les bois. On ne trouve plus de paysans dans les villages. L’ennemi mange tout, prend tous les chevaux, tous les bestiaux, tous les effets d’habillement, toutes les guenilles des paysans ; ils battent tout le monde, hommes et femmes, et commettent un grand nombre de viols. Je désire promptement tirer mes peuples de cet état de misère et de souffrance, qui est véritablement horrible. Cela doit aussi donner fort à penser aux ennemis, car le Français n’est pas patient ; il est naturellement brave, et je m’attends à les voir s’organiser d’eux-mêmes en bandes.
7 02 1814
À Joseph : L’Impératrice avait eu l’idée de se rendre à Sainte-Geneviève ; je crains que cela ne fasse un mauvais effet et n’ait pas d’autre résultat. Faites donc cesser ces prières de quarante heures et ces Miserere. Si l’on nous faisait tant de singeries, nous aurions tous peur de la mort. Il y a longtemps que l’on dit que les prêtres et les médecins rendent la mort douloureuse… Dans cette situation des choses, il faut montrer de la confiance et prendre des mesures hardies.
Au roi Joseph : Si, par des circonstances que je ne puis prévoir, je me portais sur la Loire, je ne laisserais pas l’Impératrice et mon fils loin de moi, parce que, dans tous les cas, il arriverait que l’un et l’autre seraient enlevés et conduits à Vienne. Cela arriverait bien davantage si je n’existais plus.
J’avoue que votre lettre du 7 à onze heures du soir m’a fait mal, parce que je ne vois aucune tenue dans vos idées et que vous vous laissez aller aux bavardages et aux opinions d’un tas de personnes qui ne réfléchissent pas. Or je vous parlerai franchement. Si Talleyrand est pour quelque chose dans cette opinion de laisser l’Impératrice à Paris, dans le cas où nos forces l’évacueraient, c’est une trahison qu’ils doivent comploter. Je vous le répète, méfiez-vous de cet homme. Je le pratique depuis seize années ; j’ai même eu de la faveur pour lui ; mais c’est sûrement le plus grand ennemi de notre maison, à présent que la fortune l’abandonne depuis quelque temps. Tenez-vous aux conseils que j’ai donnés. J’en sais plus que ces gens-là.
S’il arrivait bataille perdue et nouvelle de ma mort, vous en seriez instruit avant mes ministres. Faites partir l’Impératrice et le Roi de Rome pour Rambouillet ; ordonnez au Sénat, au Conseil d’État et à toutes les troupes de se réunir sur la Loire ; laissez à Paris ou le préfet, ou un commissaire impérial, ou un maire. Ne laissez jamais tomber l’Impératrice et le Roi de Rome entre les mains de l’ennemi.
Quant à mon opinion, je préférerais qu’on égorgeât mon fils plutôt que de le voir jamais élevé à Vienne, comme prince autrichien ; et j’ai assez bonne opinion de l’Impératrice pour être aussi persuadé qu’elle est de cet avis, autant qu’une femme et une mère peuvent l’être.
Je n’ai jamais vu représenter Andromaque que je n’aie plaint le sort d’Astyanax survivant à sa maison, et que je n’aie regardé comme un bonheur pour lui de ne pas survivre à son père. Vous ne connaissez pas la nation française : le résultat de ce qui se passerait dans ces grands événements est incalculable !
À M. Daru : L’armée meurt de faim, quoiqu’on ait mis tout à feu et à sang sur la route pour en tirer des subsistances. Cependant, si j’en crois vos rapports, l’armée est nourrie. Le duc de Bellune n’a rien ; le général Gérard n’a rien ; la cavalerie de la Garde meurt de faim.
9 02 1814
Envoyez une vingtaine de gendarmes d’élite et une vingtaine de gendarmes de Paris pour arrêter les traînards et les décimer, c’est-à-dire en fusiller un sur dix.
J’ai eu ici tant d’affaires toute cette nuit que je n’ai pu partir pour Sézanne. Le duc de Raguse est arrivé à Champaubert. Le général Sacken, avec 15 000 hommes, était à Montmirail. Je le fais attaquer demain.
10 02 1814
Sézanne, dix heures du matin : Je monte à cheval pour me porter à Champaubert. Je suis un peu contrarié par les chemins, ils sont affreux, il y a six pieds de boue.
Champaubert, dix heures du soir : J’ai attaqué l’ennemi à Champaubert. Il était fort de douze régiments ; il avait quarante pièces de canon. Le général en chef Olsoufief a été pris avec tous ses généraux, tous ses colonels, officiers, canons, caissons et bagages. On compte à cette heure 6 000 prisonniers, quarante canons, deux cents voitures. Le reste a été jeté dans un étang ou tué sur le champ de bataille.
Ce corps est entièrement détruit. On marche sur Montmirail, où nous serons ce soir à dix heures. J’ai les espérances les plus flatteuses que Sacken est perdu ; et si la fortune nous seconde comme aujourd’hui, les affaires seront changées dans un clin d’œil ; car c’est dans le corps de Sacken que consiste toute la force de l’armée russe, puisqu’il a dix divisions ou soixante régiments. Blücher est coupé de Sacken ; il a avec lui deux divisions.
11 02 1814
De la ferme de l’Épine-au-Bois, près de Montmirail : Mon frère. Il est huit heures, et, avant de dormir, je vous expédie ces deux mots pour vous faire connaître que la journée d’aujourd’hui a été décisive. L’armée ennemie de Silésie n’existe plus ; je l’ai mise dans une complète déroute. Nous avons pris tous ses canons, ses bagages et fait bien des milliers de prisonniers, peut-être plus de 7 000. Il nous en arrive à chaque instant. Il y a 5 à 6 000 ennemis sur le champ de bataille. Tout cela a été obtenu en engageant seulement la moitié de ma vieille Garde.
J’écris à l’Impératrice de faire tirer soixante coups de canon. Notre perte a été légère. Ma Garde à pied, mes dragons, mes grenadiers à cheval ont fait des miracles.
12 02 1814
L’ennemi a passé la Marne à Château-Thierry et brûlé le pont ; j’ai été obligé de m’arrêter. La vieille Garde a de beaucoup surpassé tout ce que je pouvais attendre d’une troupe d’élite. C’était absolument la tête de Méduse
14 02 1814
Victoire de Vauchamps.
17 02 1814
Nangis, trois heures après-midi : Toute la grande armée ennemie, autrichienne et russe, bavaroise et wurtembergeoise, repasse la Seine dans toutes les directions et avec la plus grande précipitation. Il est probable que cette nuit il n’y aura pas un seul homme de ce côté. Mais je perdrai un temps bien important, celui qu’il faudra pour faire rétablir le pont de Montereau.
Monsieur le duc de Vicence, je vous ai donné carte blanche pour sauver Paris et éviter une bataille qui était la dernière espérance de la nation. La bataille a eu lieu : la Providence a béni nos armes. J’ai fait 30 à 40 000 prisonniers ; j’ai pris deux cents pièces de canon, un grand nombre de généraux et détruit plusieurs armées sans presque coup férir. J’ai entamé hier l’armée du prince Schwarzenberg, que j’espère détruire avant qu’elle ait repassé mes frontières. Votre attitude doit être la même : vous devez tout faire pour la paix ; mais mon intention est que vous ne signiez rien sans mon ordre, parce que seul je connais ma position. Ma position est certainement plus avantageuse qu’à l’époque où les alliés étaient à Francfort : aujourd’hui c’est bien différent ; j’ai eu d’immenses avantages sur eux, et des avantages tels qu’une carrière militaire de vingt années et de quelque illustration n’en présente pas de pareils.
18 02 1814
Victoire de Montereau : Au prince de Neufchâtel : Témoignez au duc de Bellune mon mécontentement de ce qu’il n’a pas exécuté mes ordres qui lui prescrivaient de se rendre à Montereau ; qu’il fasse connaître pourquoi il n’a pas exécuté mon ordre, ce qui compromet le succès de la campagne. Faites-lui une lettre fort sèche.
Le prince de Schwarzenberg vient enfin de nous donner signe de vie. Il vient d’envoyer un parlementaire pour demander une suspension d’armes. Il est difficile d’être lâche à ce point ! Il avait constamment refusé, dans les termes les plus insultants, toute espèce de suspension d’armes. Ces misérables, au premier échec, tombent à genoux ! Heureusement qu’on n’a pas laissé entrer l’aide de camp du prince de Schwarzenberg. Je n’ai reçu que sa lettre à laquelle je répondrai à mon aise. Je n’accorderai aucun armistice qu’ils n’aient purgé mon territoire.
Au comte Tascher de la Pagerie : Tascher, tu vas partir tout de suite pour retourner en Italie ; tu ne t’arrêteras à Paris que pour voir ta femme, sans communiquer avec qui que ce soit. Tu diras à Eugène que j’ai été vainqueur à Champaubert et à Montmirail des meilleures troupes de la coalition ; que Schwarzenberg m’a fait demander cette nuit, par un de ses aides de camp, un armistice, mais que je n’en suis pas dupe, car c’est pour me leurrer et gagner du temps. Tu lui diras que si les ordres donnés au maréchal Victor pour se porter dès hier de Melun sur Montereau avaient été ponctuellement exécutés, il en serait résulté la perte du corps bavarois et des Wurtembergeois pris au dépourvu par ce mouvement, et qu’alors, n’ayant plus devant lui que des Autrichiens, qui sont de mauvais soldats, il les aurait menés à coups de fouet de poste ; mais que rien de ce qui avait été ordonné n’ayant été fait, il a fallu recourir à de nouvelles chances.
Dis à Eugène que je suis content de lui ; qu’il témoigne ma satisfaction à l’armée d’Italie et que sur toute la ligne il fasse tirer une salve de cent coups de canon en réjouissance des victoires de Champaubert et de Montmirail.
Nangis. À Joseph : Dites sourdement que l’ennemi a demandé un armistice ou une suspension d’armes, ce qui était une chose absurde, puisque c’était m’ôter les avantages de mes manœuvres. Ajoutez que cela fait voir jusqu’à quel point il est décontenancé. Que l’on n’imprime pas cela, mais qu’on le dise partout.
19 02 1814
Château de Surville: J’ai culbuté hier deux divisions de la réserve du général autrichien Bianchi et les Wurtembergeois ; ils ont perdu beaucoup de monde. On leur a pris plusieurs drapeaux et 3 ou 4 000 prisonniers. Mais ce qui est extrêmement précieux, c’est que j’ai eu le bonheur d’enlever le pont sans leur donner le temps de le couper.
Au général Caulaincourt. [alors ministre plénipotentiaire au Congrès de Prague] : Je suis si ému de l’infâme proposition que vous m’envoyez que je me crois déshonoré, rien que de m’être mis dans le cas qu’on vous l’ait proposée. Je vous ferai connaître de Troyes ou de Châtillon mes intentions ; mais je crois que j’aurais mieux aimé perdre Paris que de voir faire de telles propositions au peuple français. Vous parlez toujours des Bourbons : je préférerais voir les Bourbons en France avec des conditions raisonnables aux infâmes propositions que vous m’envoyez!
Au général Savary : Les journaux sont rédigés sans esprit. Est-il convenable, dans le moment actuel, d’aller dire que j’avais peu de monde, que je n’ai vaincu que parce que j’ai surpris l’ennemi, et que nous étions un contre trois ? Il faut, en vérité, que vous ayez perdu la tête à Paris pour dire de pareilles choses, lorsque moi je dis partout que j’ai 300 000 hommes, lorsque l’ennemi le croit, et qu’il faut le dire jusqu’à satiété. Un des premiers principes de la guerre est d’exagérer ses forces et non pas de les diminuer.
Il nous a fallu toute la journée pour passer cet horrible défilé de Montereau. Nous avons de la neige et un temps assez dur.
21 02 1814
Au maréchal Augereau, à Lyon : Mon cousin, le ministre de la Guerre m’a mis sous les yeux la lettre que vous lui avez écrite le 16. Cette lettre m’a vivement peiné. Quoi ! six heures après avoir reçu les premières troupes venant d’Espagne vous n’étiez pas déjà en campagne ! Six heures de repos leur suffisaient. J’ai remporté le combat de Nangis avec la brigade de dragons venant d’Espagne, qui de Bayonne n’avait pas encore débridé. Les six bataillons de la division de Nîmes manquent, dites-vous, d’habillement et d’équipement, et sont sans instruction. Quelle pauvre raison me donnez-vous là, Augereau ! J’ai détruit 80 000 ennemis avec des bataillons composés de conscrits, n’ayant pas de gibernes et étant mal habillés ! Les gardes nationales, dites-vous, sont pitoyables : j’en ai ici 4 000 venant d’Angers et de Bretagne, en chapeaux ronds, sans gibernes, avec des sabots, mais ayant de bons fusils ; j’en ai tiré un bon parti. Il n’y a pas d’argent, continuez-vous : et d’où espérez-vous tirer de l’argent ? Vous ne pourrez en avoir que quand nous aurons arraché nos recettes des mains de l’ennemi.
Vous manquez d’attelages : prenez-en partout. Vous n’avez pas de magasin : ceci est par trop ridicule. Je vous ordonne de partir douze heures après la réception de la présente lettre pour vous mettre en campagne. Si vous êtes toujours l’Augereau de Castiglione, gardez le commandement ; si vos soixante ans pèsent sur vous, quittez-le et remettez-le au plus ancien de vos officiers généraux. La patrie est menacée et en danger ; elle ne peut être sauvée que par l’audace et la bonne volonté; et non par de vaines temporisations. Vous devez avoir un noyau de plus de 6 000 hommes de troupes d’élite : je n’en ai pas tant, et j’ai pourtant détruit trois armées, fait 40 000 prisonniers, pris deux cents pièces de canon et sauvé trois fois la capitale. Soyez le premier aux balles. Il n’est plus question d’agir comme dans les derniers temps, mais il faut reprendre ses bottes et sa résolution de 93 ! Quand les Français verront votre panache aux avant-postes et qu’ils vous verront vous exposer le premier aux coups de fusil, vous en ferez ce que vous voudrez.
Napoléon. Vie de Napoléon par lui-même. Compilation d’André Malraux. Gallimard 1930
Arrivée à Vesoul de Monsieur, comte d’Artois, frère du prétendant au trône.
26 02 1814
Si j’avais eu un équipage de pont de dix pontons, la guerre serait finie et l’armée du prince Schwarzenberg n’existerait plus ; je lui aurais enlevé 8 à 10 000 voitures et pris son armée en détail. Mais, faute de bateaux, je n’ai pas pu passer la Seine.
À Joachim Napoléon [Murat] : Je ne vous parle point de mon mécontentement de votre conduite qui a été diamétralement opposée à vos devoirs. Cela provient toutefois de la faiblesse de votre caractère. Vous êtes un bon soldat sur le champ de bataille, mais hors de là, vous n’avez ni vigueur ni caractère. Tirer parti d’un acte de trahison que je n’attribue qu’à la crainte afin de me servir par une bonne intelligence. Je compte sur vous, sur votre contrition, sur vos promesses. S’il en était autrement, songez que vous vous en repentiriez. Je suppose que vous n’êtes pas de ceux qui pensent que le lion est mort.
27 02 1814
Dans les Pyrénées, le maréchal Soult est battu à Orthez par Wellington.
5 03 1814
Fismes. Je croyais que le duc de Raguse avait été hier à Soissons ; mais le général qui commandait dans cette place a eu l’infamie de l’évacuer sans tirer un coup de fusil. Il s’est retiré avec tout son monde avec les honneurs de la guerre et quatre pièces de canon. Je donne ordre au ministre de la Guerre de le faire arrêter, juger par un conseil de guerre et passer par les armes. Il faut qu’il soit fusillé au milieu de la place de Grève et qu’on donne beaucoup d’éclat à cette exécution. On nommera cinq généraux pour le juger. Il n’y a pas de doute que l’armée ennemie était perdue et tombait en dissolution. Actuellement il faut que je manœuvre et perde beaucoup de temps à faire des ponts.
13 03 1814
Victoire de Reims.
14 03 1814
Je suis arrivé hier à Reims. J’ai repris la ville, vingt pièces de canon, beaucoup de bagages et de caissons, et fait 5 000 prisonniers.
À Savary: Vous ne m’apprenez rien de ce qui se fait à Paris. Il y est question d’adresse, de régence et de mille intrigues, aussi plates qu’absurdes et qui peuvent tout au plus être conçues par un imbécile comme Miot. Tous ces gens-là ne savent pas que je tranche le nœud gordien à la manière d’Alexandre. Qu’ils sachent bien que je suis aujourd’hui le même homme que j’étais à Wagram et à Austerlitz, que je ne veux dans l’État aucune intrigue : qu’il n’y a point d’autre autorité que la mienne et qu’en cas d’événements pressés c’est la régente qui a exclusivement ma confiance.
16 03 1814
Au roi Joseph : Je vais manœuvrer de manière qu’il serait possible que vous fussiez plusieurs jours sans avoir de mes nouvelles. Si l’ennemi s’avançait sur Paris avec des forces telles que toute résistance devînt impossible, faites partir la Régente, mon fils, dans la direction de la Loire. Ne quittez pas mon fils et rappelez-vous que je préfèrerais le savoir dans la Seine plutôt que dans les mains des ennemis de la France. Le sort d’Astyanax prisonnier des Grecs m’a toujours paru le sort le plus malheureux de l’histoire.
20 03 1814
Au prince de Neufchâtel : Écrivez sur-le-champ au duc de Tarente de diriger tout sur Arcis, même le général Gérard, même les gardes nationales.
Au combat d’Arcis-sur-Aube, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour trouver une mort glorieuse en disputant pied à pied le sol de la patrie. Je me suis exposé sans ménagement. Les balles pleuvaient autour de moi ; mes habits en ont été criblés, et aucune n’a pu m’atteindre. Je suis un homme condamné à vivre !
22 03 1814
Le maréchal Augereau doit abandonner Lyon.
23 03 1814
Château du Plessis. Au prince de Neufchâtel : Mon Cousin, envoyez un gendarme déguisé à Metz ; envoyez-en un à Nancy et un à Bar, avec des lettres aux maires. Vous leur ferez connaître que nous arrivons sur les derrières de l’ennemi ; que le moment est venu de se lever en masse, de sonner le tocsin, d’arrêter partout les commandants de place, commissaires de guerre ennemis, de tomber sur les convois, de saisir les magasins et les réserves de l’ennemi ; qu’ils fassent publier sur-le-champ cet ordre dans toutes les communes des 2° et 4° divisions militaires. Ecrivez au commandant de Metz de réunir ses garnisons et de venir à notre rencontre sur la Meuse.
Napoléon. Vie de Napoléon par lui-même. Compilation d’André Malraux. Gallimard 1930
24 03 1814
Les Autrichiens occupent Lyon.
25 03 1814
Défaite de la Fère Champenoise
30 03 1814
De Buonaparte et des Bourbons, brochure de Chateaubriand, sort de presse : radicalement hostile à l’empereur, cette publication va marquer le début de la carrière politique de Chateaubriand.
30 03 1814
Capitulation de Paris après une bataille qui fait 18 000 morts et blessés de part et d’autre.
La Cour-de-France, dix heures du soir : Nous ordonnons au duc de Vicence, notre grand écuyer et notre ministre des relations extérieures, de rendre près des souverains alliés et du général en chef de leurs armées, pour leur recommander nos fidèles sujets de la capitale.
Nous l’investissons, par la présente, de tout pouvoir pour négocier et conclure la paix, promettant de ratifier tout ce qu’il fera pour le bien de notre service.
31 03 1814
Fontainebleau. Au prince de Neufchâtel : Mon Cousin, le duc de Raguse formera l’avant-garde et réunira toutes ses troupes à Essonne. Le corps du duc de Trévise se réunira entre Essonne et Fontainebleau. Écrivez au préfet d’Orléans pour lui annoncer la malheureuse nouvelle de l’occupation de Paris par l’ennemi, que mon arrivée, aurait empêchée si on avait retardé de trois heures. Recommandez au ministre de l’Intérieur de mettre partout en vigueur la mesure de la levée en masse pour remplir les cadres des bataillons.
1 04 1814
La vieille Garde avec l’artillerie et les batteries de réserve prendront position demain au débouché de la forêt.
Napoléon. Vie de Napoléon par lui-même. Compilation d’André Malraux. Gallimard 1930
Le Sénat nomme un gouvernement provisoire présidé par Talleyrand. Louis XVIII, frère de Louis XVI, débarque à Calais le 24 avril, entre à Paris le 3 mai et forme le gouvernement de la première restauration le 13 mai. [On se perd en conjectures pour savoir quelle subtile ruse se cache derrière ce choix du chiffre XVIII, puisque l’on a su sitôt la mort de Louis XVI que son fils ne régnerait jamais, et que l’on sait depuis 2011 qu’il est mort à la Conciergerie, très probablement d’une tuberculose osseuse. Donc Louis XVIII aurait dû se nommer Louis XVII].
Une commission constituée autour de l’abbé de Montesquiou élabore rapidement une Charte, [pour rompre avec l’image révolutionnaire du mot constitution en reprenant un vocabulaire lié à la monarchie]. Cette Charte se veut un texte de compromis : elle reconnaît et protège de fait la société issue de 1789, les grands principes acquis durant la période révolutionnaire : liberté individuelle, notamment la liberté religieuse, liberté de presse, égalité devant l’impôt… Afin de rétablir la cohésion du pays, l’amnistie politique est déclarée pour tous les faits antérieurs à 1814. En revanche, la Charte réaffirme les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire du souverain, ainsi que sa capacité à dissoudre la Chambre des députés et à nommer les pairs. Les chambres, élues au suffrage censitaire, ont plus de pouvoir que sous l’Empire. Les commissions et tribunaux extraordinaires liés à l’arbitraire napoléonien sont supprimés, mais toute l’œuvre juridique, administrative et législative de la Révolution et de l’Empire est conservée, notamment le Code civil. La Charte garantit toutes les propriétés, y compris celle des biens nationaux et commande l’oubli aux tribunaux et aux citoyens.
Par le Traité de Paris la France rentre dans ses frontières de 1792 et Napoléon n’est plus que le souverain de l’Ile d’Elbe. L’île Maurice et Diego Garcia deviennent anglaises. Cette dernière, en plein cœur de l’océan indien, au nord-est de la pointe sud de Madagascar, va être louée aux États-Unis à partir de 1966, qui en feront aux moindres frais, grâce à sa nature d’atoll, une redoutable base aéro-navale, employant 3 500 personnes. Les autochtones iront grossir les bidonvilles de l’île Maurice.
Les troupes coalisées occupent Paris… c’est une belle ville que les guerres de l’empereur n’ont en rien défiguré ; la culture y est omniprésente, les femmes sont belles, élégantes, le vin et la cuisine renommés… autant de motifs pour s’attarder… jusqu’au 2 juin. Faute d’avoir vu ses préférences [Bernadotte, un Orléans, ou pourquoi pas, une république] approuvées par les autres membres de la coalition, le tsar Alexandre I° s’était résigné au choix de Louis XVIII, qu’il tenait pour l’homme le plus nul et le plus insignifiant d’Europe que j’aie jamais rencontré.
Pendant ces deux mois, c’est lui qui va tenir le premier rôle, [sans que personne n’en prenne ombrage pendant le premier mois : Louis XVIII n’arrivera à Paris que le 3 mai] se livrant à un époustouflant one man show, omniprésent sur tous les terrains, militant fervent des idées libérales, soucieux de mettre à terre l’insupportable image du cosaque russe violeur et voleur, image très soigneusement entretenue par Napoléon lors de la campagne de Russie. Et il y parviendra à force de visites, de largesses, d’élégance : les musées qui recèlent nombre de chefs d’œuvre souvent pris par Napoléon ? Que ces œuvres restent ici, c’est là qu’ils seront le plus visités. Il reçoit Madame de Staël, Benjamin Constant, Chateaubriand, l’abbé Sicard, directeur de l’Institut des sourds et muets, connu de sa mère Maria Fiodorovna. Il se rend aux Invalides, distribue de l’argent aux pauvres des paroisses, visite plusieurs hôpitaux ! Il rencontre Marie-Louise, les Beauharnais, s’entiche d’Hortense, se désole de la mort de sa mère Joséphine le 29 mai, aux obsèques de laquelle un escadron cosaque rendra les honneurs ! Bref, la grande classe !
3 04 1814
Officiers, sous-officiers et soldats de la vieille Garde, l’ennemi nous a dérobé trois marches. Il est entré dans Paris. J’ai fait offrir à l’empereur Alexandre une paix achetée par de grands sacrifices. Non seulement il a refusé ; il a fait plus encore : par les suggestions perfides de ces émigrés auxquels j’ai accordé la vie, et que j’ai comblés de bienfaits, il les autorise à porter la cocarde blanche et bientôt il voudra la substituer à notre cocarde nationale. Dans peu de jours, j’irai l’attaquer à Paris. Je compte sur vous…
(On garde le silence.)
Ai-je raison ?
(Vive l’Empereur ! Vive l’Empereur ! À Paris ! À Paris ! )
Nous irons leur prouver que la nation française sait être maîtresse chez elle ; que, si nous l’avons été longtemps chez les autres, nous le serons toujours chez nous, et qu’enfin nous sommes capables de défendre notre cocarde, notre indépendance et l’intégrité de notre territoire ! Communiquez ces sentiments à vos soldats.
Napoléon. Vie de Napoléon par lui-même. Compilation d’André Malraux. Gallimard 1930
6 04 1814
Napoléon abdique à Fontainebleau.
10 04 1814
Je jetai les yeux sur un coin de terre où je pusse être mal, et profiter des fautes que l’on ferait. Je me décidai pour l’île d’Elbe. Cet acte fut celui d’une âme de rocher. Je suis d’un caractère bien singulier, sans doute, mais on ne serait pas extraordinaire si l’on n’était d’une trempe à part. Je suis une parcelle de rocher lancée dans l’espace.
L’information ne peut aller plus vite que le cheval qui la porte, [sauf si existe un réseau du télégraphe de Chappe, mais ce sont les régions où se déroulaient les batailles qui étaient prioritaires] et la nouvelle de l’abdication de Napoléon n’est pas encore parvenue à Toulouse, où se trouvent d’un côté l’armée du maréchal Soult et de l’autre celle du général anglais Wellesley, plus connu sous le nom de Wellington… et donc ils livrent bataille : Soult a 35 000 soldats et 7 300 conscrits, Wellington a 55 000 soldats plus 13 000 espagnols. La bataille, indécise fait quelques centaines de morts ; Soult met la nuit à profit pour quitter les lieux vers la Méditerranée. Wellington entre en vainqueur à Toulouse, et tranquillise ses habitants en se présentant en défenseur de la paix, le tout en français !
11 04 1814
Traité de Fontainebleau, signé en fait à Paris. Il sera ratifié par Napoléon le 13 avril.
S.M. l’empereur Napoléon d’une part, et LL. MM. l’empereur d’Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, l’empereur de toutes les Russies et le roi de Prusse, stipulant tant en leur nom qu’on celui de tous les alliés de l’autre, ayant nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
S.M. l’empereur Napoléon : les sieurs Armand-Augustin-Louis de Caulaincourt, duc de Vicence, son grand écuyer, sénateur, ministre des relations extérieures, grand-aigle de la Légion d’honneur, chevalier des ordres de Léopold d’Autriche, de Saint-André, de Saint-Alexandre- Newsky, de Sainte-Anne de Russie et de plusieurs autres ; Michel Ney, duc d’Elchingen et maréchal de l’Empire, grand-aigle de la Légion d’honneur, chevalier de la Couronne de fer et de l’ordre du Christ ; Jacques-Étienne-Alexandre Macdonald, duc de Tarente, maréchal de l’Empire, grand-aigle de la Légion d’honneur et chevalier de la Couronne de fer.
Et S.M. l’empereur d’Autriche : le sieur Clément-Wenceslas-Lothaire, prince de Metternich, Winehourg-Sachsenhausen, chevalier de la Toison d’or, grand-croix de l’ordre royal de Saint-Etienne, grand-aigle de la Légion d’honneur, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint- Alexandre-Newsky et de Sainte-Anne de Russie, de l’Aigle noir et de l’Aigle rouge de Prusse, grand-croix de l’ordre de Saint-Joseph de Wurtzbourg, chevalier de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem et de plusieurs autres, chancelier de l’ordre militaire de Marie-Thérèse, curateur de l’Académie impériale de S.M. impériale et royale apostolique, et son ministre d’état des conférences et des affaires étrangères.
(Dans le traité avec la Russie sont les titres du baron de Nesslrode, et dans le traité avec la Prusse sont les titres du baron de Hardemberg.) Les plénipotentiaires ci-dessus nommés, après avoir procédé à l’échange de leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :
Article I° L’Empereur Napoléon renonce pour lui, ses successeurs et descendants, ainsi que pour chacun des membres de sa famille, à tout droit de souveraineté et de domination tant sur l’Empire français et le royaume d’Italie que sur tout autre pays.
Article 2 LL. MM. L’empereur Napoléon et l’impératrice Marie-Louise conserveront ces titres et qualités, pour en jouir leur vie durant. La mère, les frères, les sœurs, neveux et nièces de l’Empereur conserveront également, partout où ils se trouveront, les titres de princes de sa famille.
Article 3 L’île d’Elbe, adoptée par S.M. l’Empereur Napoléon pour le lieu de son séjour, formera, sa vie durant, une principauté séparée, qui sera possédée par lui en toute souveraineté et propriété. II sera donné en outre en toute propriété à l’empereur Napoléon un revenu annuel de 2 millions de francs en rentes sur le grand-livre de France, dont l million réversible à l’Impératrice.
Article 5 Les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla seront donnés en toute propriété et souveraineté à S.M. l’impératrice Marie- Louise. Ils passeront à son fils et à sa descendance en ligne directe. Le prince son fils prendra, dès ce moment, le titre de prince de Parme, de Plaisance et de Guastalla.
Article 6 Il sera réservé dans les pays auxquels Napoléon renonce, pour lui et sa famille, des domaines, ou donné des rentes sur le grand- livre de France, produisant un revenu annuel net, et déduction faite de toutes charges, de 2 500 000 francs ; ces domaines ou rentes appartiendront en toute propriété, et pour en disposer comme bon leur semblera, aux princes et princesses de sa famille, et seront répartis entre eux, de manière à ce que le revenu de chacun soit dans la proportion suivante :
À Madame mère, 300 000 francs ; au roi Joseph et à la reine, 500 000 francs ; au roi Louis, 200 000 francs ; à la reine Hortense et à ses enfants, 400 000 francs ; au roi Jérôme et à la reine, 500 000 francs ; à la princesse Élisa, 300 000 francs ; à la princesse Pauline, 300 000 francs. Les princes et princesses de la famille de l’empereur Napoléon conserveront en outre tous les biens meubles et immeubles, de quelque nature que ce soit, qu’ils possèdent à titre particulier, et notamment les rentes dont ils jouissent, également comme particuliers, sur le grand-livre de France ou le Monte-Napoleone de Milan.
Article 7 Le traitement annuel de l’impératrice Joséphine sera réduit à 1 million, en domaines ou en inscriptions sur le grand-livre de France. Elle continuera à jouir en toute propriété de tous ses biens meubles et immeubles particuliers, et pour en disposer conformément aux lois françaises.
Article 8 II sera donné au prince Eugène, vice-roi d’Italie, un établissement convenable hors de France.
Article 9 Les propriétés que S.M. l’empereur Napoléon possède en France, soit comme domaine extraordinaire, soit comme domaine privé, resteront à la couronne.
Sur les fonds placés par l’empereur Napoléon, soit sur le grand-livre, soit sur la banque de France, soit sur les actions des canaux, soit de toute autre manière, et dont S.M. fait l’abandon à la couronne, il sera réservé un capital, qui n’excédera pas 2 millions, pour être employé en gratifications en faveur des personnes qui seront portées sur l’état que signera l’empereur Napoléon et qui sera remis au gouvernement français.
Article 10 Tous les diamants de la couronne resteront à la France.
Article 11 L’empereur Napoléon fera retourner au trésor et autres caisses publiques toutes les sommes et effets qui auraient été déplacés par ses ordres, à l’exception de ce qui provient de la liste civile.
Article 15 La garde impériale fournira un détachement de 12 à 1 500 hommes de toutes armes, pour servir d’escorte jusqu’à Saint- Tropez, lieu de l’embarquement.
Article 17 La garde impériale française fournira un détachement de douze à quinze cents hommes pour servir d’escorte. S.M. l’Empereur Napoléon pourra conserver pour sa garde 400 hommes de bonne volonté.
12 04 1814
Dans la nuit, Caulaincourt, qui vient de discuter longuement avec son maître des termes du traité de Fontainebleau, est rappelé d’urgence à son chevet où il le trouve agonisant. Napoléon reprend suffisamment connaissance pour lui dire qu’il vient d’absorber une poche de poison qu’il conservait sur lui depuis la retraite de Russie, quand les cosaques avaient failli s’emparer de lui. Caulaincourt envoie chercher le médecin personnel de l’empereur, le baron Yvan, qui parvient à lui faire vomir une partie du poison, par ailleurs très probablement éventé. Le lendemain, Napoléon, rétabli, fera promettre à son entourage de tenir secrète sa tentative de suicide.
Maintenant, ce n’est pas seulement une femme qui l’a trahi, c’est la vie. L’Europe conquise a cédé sous ses pieds. En six mois, il a tout perdu. Comme si le destin avait décidé de lui reprendre tout ce qu’il lui avait donné. Quelle brutale dépossession ! L’Empire s’est effondré comme un château de cartes. Son règne lui semble aussi éphémère qu’une monarchie de huit jours.
Ce n’est pas le désastre qui le décide à mourir. Il lui en faut plus que l’effondrement de son empire pour entamer son caractère d’acier. Les échecs, loin de le décourager, l’ont toujours stimulé. Il n’a jamais cru les défaites définitives. Il est toujours resté serein, même devant ces engrenages de malchances qui semblent s’enfanter les unes les autres. Il s’est prémuni d’avance contre les aléas du destin : que les humiliations succèdent aux moments de gloire, son ignominieuse déchéance proclamée par le Sénat après son sacre, la Bérézina après Austerlitz, tout cela lui semble appartenir à un ordre des choses contre lequel il serait vain de s’insurger. Seuls le ciel et l’étoile qui le protège en connaissent les raisons.
C’est la trahison qui a eu raison de lui. Elle seule a atteint son principe vital. Faire face à ses ennemis, vaincre l’adversité, c’est dans la nature de son génie. Être trahi par ses proches – Murât, son beau-frère, Caroline, sa sœur, Marmont, dont il a fait la fortune -, cela le laisse désemparé. Et que dire de ces hommes, maréchaux, généraux, qui sont venus ici lui extorquer son abdication ? Et tous ceux qui, derrière eux, ministres comme Cambacérès, se sont déjà abouchés avec les Alliés pour sauver leur carrière ! Lui qui ne s’est jamais fait d’illusion sur la nature humaine a cependant cru à ce minimum vital de dignité de ceux qui lui doivent tout.
Dans son agonie, comme elle le hante, cette scène au cours de laquelle Ney, Lefebvre, Moncey et Macdonald, faisant irruption dans son cabinet, sont venus lui porter le coup de grâce.
Ces hommes devant lui, qu’il a connus obséquieux, quémandeurs de prébendes, flatteurs, semblent le défier. Il sent leur arrogance nouvelle. Il feint de n’en rien voir et les rappelle à leur devoir.
– Les Alliés ! Je vais les écraser dans Paris. Il faut marcher sur la capitale sans tarder.
– Nous ne pouvons pas exposer Paris au sort de Moscou, rétorque Macdonald.
– Je ferai appel à l’armée, dit l’Empereur d’un ton cassant.
– L’armée ne marchera pas, dit Ney.
– L’armée m’obéira ! crie Napoléon.
– Sire, l’armée obéit à ses généraux, déclare Ney.
Devant ces paroles insolentes, Napoléon est décontenancé. Autant que César au Capitole devant les stylets de ses amis soudain levés contre lui.
– Enfin, que voulez-vous donc, messieurs ?
– L’abdication ! disent d’une même voix Oudinot et Ney.
Si prompt à la fureur qu’il soit, Napoléon semble sonné. Sa voix est maintenant empreinte de douceur. Il parle avec calme, comme si ce qu’on lui proposait était la chose la plus naturelle du monde. Mais les maréchaux s’accrochent à leur résolution. Ils ont décidé de ne plus céder devant son charme. À cet instant, ils partagent la pensée vulgaire de Lefebvre qui rabâche : Croit-il donc que, lorsque nous avons des titres, des hôtels, des terres, nous nous ferons tuer pour lui ? Comme si ces terres, ces hôtels, ces titres, ce n’est pas à lui qu’ils les doivent ! Mais c’est aussi tout un passif de rancœurs, de jalousies, d’envies, d’humiliations qui remontent à la surface et s’aigrissent en ingratitude. Combien de fois dans leur for intérieur ou en face de leurs épouses ambitieuses n’ont-ils pas avoué que, s’il n’avait tenu qu’à eux, ils auraient pu être à sa place ! Oui, Premier consul et, pourquoi pas ? empereur ! N’avaient-ils pas autant de mérites militaires que lui, autant de courage, de savoir-faire, d’intelligence ? Il y a tout cela dans leur silence.
– Eh bien, messieurs, puisqu’il en est ainsi, j’abdiquerai.
Mais, devant ces maréchaux désormais décontenancés par son attitude, il change soudain de ton. Il se jette sur un canapé et, se frappant la cuisse de la main, il lance, comme s’il ne se sentait nullement lié par ce qu’il vient de dire :
– Bah, messieurs, laissons cela. Notre situation n’est pas mauvaise. Marchons demain. Nous les battrons devant les murs de Paris !
Sa dernière botte secrète : faire appel à leur instinct de soldat, à leur devoir, à des sentiments qui ne peuvent être complètement éteints dans leur cœur.
Mais ils restent de marbre. Ils lui soutirent l’abdication conditionnelle en faveur de son fils. Deux jours plus tard, ils reviennent pour lui arracher l’abdication sans condition. Il n’a plus le choix : Marmont est passé avec son armée du côté des Alliés.
Les maréchaux sont à nouveau devant lui. Une aube sale blanchit les vitres. Il leur propose de continuer la résistance dans la vallée du Rhône et, pourquoi pas ? en Italie. Il tente de réveiller l’ardeur de leur jeunesse. Aucune réponse. Seulement le mur d’un lourd silence.
Alors il lance : Vous voulez du repos ? Eh bien, ayez-en !
Et il écrit à la plume le texte de son abdication : Les puissances ayant déclaré que l’Empereur Napoléon était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, l’Empereur Napoléon, fidèle à ses serments, déclare qu’il renonce pour lui et ses enfants au trône de France et d’Italie, et qu’il n’est aucun sacrifice, même celui de sa vie, qu’il ne soit prêt à faire à l’intérêt de la France. Il signe puis murmure : Je suis humilié que des hommes que j’ai élevés si haut se ravalent si bas.
Et encore ne sait-il pas tout de l’ampleur des défections, des reniements, des trahisons ! Il ignore que Joséphine et Hortense fêteront à la Malmaison le tsar et le roi de Prusse ; qu’aucun de ses ministres ne se déplacera pour lui dire un dernier adieu ; que Berthier, le fidèle Berthier, va l’abandonner, pressé comme tous les autres purs jacobins d’aller faire ses dévotions aux Bourbons. Oui, même le mamelouk Roustam, qui dormait sur le seuil de sa porte. Il s’en va. Constant, son valet de chambre, le quitte aussi.
Et encore, il n’a pas eu connaissance de ce que disent de lui ses proches. Murât : Il n’est que trop juste qu’il soit rayé de la liste des souverains, enfermé et réduit à ne plus être en état de faire le malheur du monde entier. Ou son frère Jérôme : L’Empereur, après avoir fait notre malheur, se survit.
Alors la mort ! Mais elle ne veut pas de lui. À 7 heures du matin, il finit par s’assoupir. Puis il s’éveille et montre les signes du plus profond accablement. Caulaincourt l’aide à se lever et le soutient jusqu’à la fenêtre ouverte. La brise fraîche lui fait du bien. Il dit : Puisque la mort ne veut pas de moi, j’écrirai l’histoire de mes braves.
Jean Marie Rouart. Napoléon ou La Destinée. Gallimard 2012
20 04 1814
Adieux à la Garde.
Soldats de ma vieille Garde, je vous fais mes adieux. Depuis vingt ans, je vous ai trouvés constamment sur le chemin de l’honneur et de la gloire. Dans ces derniers temps, comme dans ceux de notre prospérité, vous n’avez cessé d’être des modèles de bravoure et de fidélité. Avec des hommes tels que vous, notre cause n’était pas perdue. Mais la guerre était interminable ; c’eût été la guerre civile, et la France n’en serait devenue que plus malheureuse. J’ai donc sacrifié tous nos intérêts à ceux de la patrie ; je pars. Vous, mes amis, continuez de servir la France. Son bonheur était mon unique pensée ; il sera toujours l’objet de mes vœux ! Ne plaignez pas mon sort ; si j’ai consenti à me survivre, c’est pour servir encore à votre gloire ; je veux écrire les grandes choses que nous avons faites ensemble ! Adieu, mes enfants ! Je voudrais vous presser tous sur mon cœur ; que j’embrasse au moins votre drapeau !…
Adieu ! encore une fois, mes vieux compagnons ! Que ce dernier baiser passe dans vos cœurs !
28 04 1814
À Orgon, en Provence, Napoléon a été conspué et a revêtu l’uniforme d’un courrier à la sortie de la ville. Le navire l’emmenant sur l’île d’Elbe devait être français. Mais à ce moment le maître de fait de la France, était Talleyrand, dont Napoléon se méfiait à tel point qu’il redouta un mauvais coup et préféra s’en remettre aux mains de l’ennemi anglais pour effectuer cette traversée ; ce fut le Undaunted, à quai à Fréjus.
Les Bourbons, – pauvres diables, – se contentent d’avoir leurs terres et leurs châteaux, mais si le peuple français devient mécontent de cela, et trouve qu’il n’y a pas d’encouragement pour leurs manufactures, ils seront chassés dans six mois.
30 05 1814
Angleterre, Russie, Prusse, Autriche, Espagne, Portugal, Suède signent avec la France, en l’occurrence Louis XVIII le traité de Paris : il s’agit de ramener la France dans ses frontières de 1792, sans l’humilier, et elle ne le sera pas.
4 06 1814
La Charte promulguée est une des plus libérales d’Europe : elle met en place un régime dominé par la personne du roi, qui a un rôle fondamental dans les institutions : l’autorité tout entière réside en France dans la personne du roi qui est selon cette charte inviolable et sacrée. Elle est en ce sens plus proche d’une monarchie limitée que d’une monarchie parlementaire.
25 07 1814
George Stephenson, ingénieur anglais, procède aux essais concluants de sa locomotive Blücher, qui tire quelques wagons ; c’est lui qui a le premier compris le principe d’adhérence d’une roue lisse sur une surface lisse. Il est considéré comme le véritable créateur du train, plus précisément, de la traction à vapeur sur voie ferrée.
2 08 1814
Note pour le général Bertrand : Comme je ne suis pas encore assez bien logé pour donner des fêtes, j’attendrai l’arrivée de l’Impératrice ou de la princesse Pauline, qui doit avoir lieu dans les premiers jours de septembre, pour faire tirer les feux d’artifice. Je désire que la commune fasse les frais d’un bal qu’elle donnera sur la place publique, où l’on construira une salle en bois, et que les officiers de la Garde Impériale y soient invités. Aux environs de cette salle, on établira des orchestres pour faire danser les soldats, et on aura soin de disposer quelques barriques de vin pour qu’ils puissent boire. Je désire que la commune marie deux jeunes gens et qu’elle les dote. Le grand maréchal et les autorités assisteront à ce mariage, qui se célébrera à la grand’messe.
Napoléon. Vie de Napoléon par lui-même. Compilation d’André Malraux. Gallimard 1930
7 08 1814
Sitôt libéré des serres napoléoniennes, le pape Pie VII proclame par la bulle Sollicitudo omnium ecclesarium, le rétablissement des Jésuites dans leur Institut et leurs privilèges : l’ostracisme romain aura duré quarante ans. Il va de soi que le retour des Bourbons très catholiques sur le trône de France ira de pair avec celui des Jésuites.
Dire que les Jésuites de ce début du XIX° ne sont pas ceux de la seconde moitié du XVI °, c’est peu dire : ils sont méconnaissables. Ils ont subi les persécutions ; nombre d’entre eux ne doivent leur survie qu’à la Russie de Catherine II ou la Prusse de Frédéric II ; ils y ont appris à être du coté du manche, et ils ont nourri leur rancune contre le siècle des Lumières et la Révolution, puis l’Empire qui les ont mis à l’ombre, déguisés sous une kyrielle d’associations religieuses. Tout était là pour qu’ils fassent le jeu des ultras, et ils ne voudront connaître que celui-là.
Réaction. Le mot est lâché. De quelques signification idéologique qu’on le revête, il exprime ce type de mouvement pendulaire qu’appelle ou provoque toute accélération, déviation ou secousse sociale : en l’occurrence, la révolution française, de ses prodromes philosophiques à ses retombées impériales.
Comment s’étonner que la Restauration s’accomplisse à l’encontre de la Révolution ? que l’Ancien Régime s’arrache au tombeau en piétinant ses fossoyeurs ? que les émigrés rendent coup pour coup aux Jacobins ? On sait que cela fut opéré sur le mode mineur, que la Terreur Blanche ne prit jamais l’ampleur de sa devancière, que le plus surprenant, en l’occurrence, fut la brièveté ou la timidité des représailles : il suffit de comparer cet épisode aux lendemains de la Commune de 1871. Cocarde tricolore ou fleur de lys, on ne se comporte pas entre notables comme de grands bourgeois à prolétaires. La réaction royaliste de 1815 fut dure. Elle ne pouvait pas ne pas l’être, surtout après Waterloo.
Mais […] fallait-il que les jésuites se fissent les choristes ou les machinistes de cet inévitable opéra de la revanche ?
Les pères qui avaient donné au monde un modèle de plasticité créatrice ; qui, de Kagoshima au Rio de la Plata en passant par les collèges parisiens, s’étaient faits les pionniers de l’humanisme occidental à travers trois continents ; qui avaient su inventer, sous tant de latitudes, l’échange culturel égalitaire et le respect de l’autre, les voici mués en fourriers du conservatisme bourbon et romain, en militants de l’alliance du trône et de l’autel, en propagandistes de la Restauration, en gardiens de l’ordre établi au Congrès de Vienne.
Cet art qu’ils avaient su montrer de se mettre en consonance avec leur temps, de se faire non seulement tout à tous, mais de réussir leur mue en toute saison, humanistes au temps de la Renaissance, mondialistes à l’époque des grands découvreurs et presque déistes à l’âge de Voltaire, aboutit ici à un mimétisme moins éclatant : les voici ultra avec les ultras, ou passéistes au temps de la contre-révolution.
Jean Lacouture. Jésuites. Les Conquérants. Seuil 1991
Se mirent alors à fleurir nombre d’écrits qui ne pouvaient qu’ajouter de l’eau au moulin de la Jésuitophobie. Au premier rang, dès 1612, moultes fois rééditées, les Monita secreta de Jérôme Zahorowski, jésuite polonais exclu de la Compagnie, devenu curé de paroisse en Silésie ; c’est aux Jésuites ce que les Protocoles des Sages de Sion sont aux Juifs : des recommandations en chaine pour aboutir au but suprême qu’est le pouvoir… plutôt nauséeux.
Pour se limiter à la France il y aura en ce début de XIX° siècle deux phares jésuites : le noviciat de Montrouge et le collège de Saint Aheul, proche d’Amiens où le Révérend Père Nicolas Loriquet donnait à apprendre une Histoire de France à l‘usage de la Jeunesse écrite de sa blanche main :
- Nuit du 4 août 1789 : Là, sans discussion, sans délibération, uniquement inspirés par les vapeurs du vin, l’Assemblée décrète une foule d’injustices contre les seigneurs, contre les propriétaires des droits féodaux [tome 4, p.159]
- Les mouvements populaires : On vit sortir des loges maçonniques l’odieuse association des jacobins […], plus contagieuse que la peste […] On voyait accourir du Midi de la France les bandits, la plupart échappés des galères, qui portaient le nom de Marseillais.
- Waterloo : les troupes de Bonaparte […] excitées par la rivalité nationale, montrent une animosité qui tient de la fureur, face à un Wellington inébranlable. […] On vit ces forcenés [de la garde impériale] tirer les uns sur les autres et s’entretuer sous les yeux des Anglais, que cet étrange spectacle tenait dans un saisissement mêlé d’horreur. [tome IV, p.411]
C’est prendre des bâtons pour se faire battre. Cette littérature proche du caniveau allait en appeler une autre, de l’adversaire, qui restera à peu près dans les mêmes strates : ainsi les très fameux couplets de Pierre Jean de Béranger, fin 1819 :
Les Révérends Pères
Hommes noirs, d’où sortez-vous ?
Nous sortons de dessous terre.
Moitié renards, moitié loups,
Notre règle est un mystère.
Nous sommes fils de Loyola ;
Vous savez pourquoi l’on nous exila.
Nous rentrons ; songez à vous taire !
Et que vos enfants suivent nos leçons.
Refrain
C’est nous qui fessons,
Et qui refessons
Les jolis petits, les jolis garçons.
Un pape nous abolit ;
Il mourut dans les coliques.
Un pape nous rétablit ;
Nous en ferons des reliques.
Confessons, pour être absous ;
Henri Quatre est mort, qu’on en parle plus.
Vivent les rois bons catholiques !
Pour Ferdinand VII [le roi d’Espagne] nous nous prononçons
Par le grand homme du jour,
Nous maisons sont protégées.
Oui, un baptême de cour
Voyez en nous les dragées
Le favori, par tant d’égards,
Espère acquérir de pieux mouchards.
Encore quelques lois de changées,
Et, pour le sauver, nous le renversons
Si tout ne changeait dans peu,
Si l’on croyait la canaille,
La Charte serait de feu,
Et le monarque de paille.
Nous avons le secret d’en-haut :
La Charte de paille est ce qu’il nous faut.
C’est litière pour la prêtraille ;
Elle aura la dîme et nous les moissons.
Du fond d’un certain palais
Nous dirigeons nos attaques.
Les moines sont nos valets :
On a refait leurs casaques.
Les missionnaires sont tous
Commis voyageurs trafiquant pour nous.
Les capucins sont nos cosaques.
À prendre Paris nous les exerçons.
Enfin reconnaissez-nous
Aux âmes déjà séduites.
Escobar va sous nos coups
Voir vos écoles détruites.
Au pape rendez tous ses droits ;
Léguez nous vos biens, et portez nos croix.
Nous sommes, nous sommes jésuites
Français, tremblez tous : nous vous bénissons.
Les second couteaux n’étaient pas seuls dans cette croisade ; plus tard s’en mêleront aussi des grosses pointures comme Michelet, Edgar Quinet avec souvent une rigueur pour le moins légère : Dira t-on qu’en ce même Collège de France Edgar Quinet mena la charge contre les Jésuites avec plus de mesure, en tous cas de souci scientifique, dénonçant moins leur néant ou leur tradition que leur conservatisme intellectuel ? Oui. Mais, s’agissant du respect des faits, on citera, à son propos, le commentaire qu’en fit l’historien protestant Gabriel Monod. Traitant dans son cours de 1909 de l’évangélisation de la Chine, Monod se réfère au récit de Quinet, où il est question de Monseigneur de Tournon, prélat français venu enquêter à Pékin, arrêté à l’instigation des Jésuites, et mort en prison. Arrivé à ce point, Monod s’interrompit : Autant d’erreurs que de mots, Tournon est italien ; il n’est pas pris par les Jésuites ; il ne meurt pas en prison. Arrêté en 1705, il est bientôt relâché, retourne en Europe, est fait cardinal et meurt tranquillement en 1710.
Jean Lacouture. Jésuites. Les Conquérants. Seuil 1991
24 08 1814
Les Anglais incendient les bâtiments publics de Washington : le Capitole, avec une bibliothèque de 3 000 volumes, et aussi, bien sûr, la Maison Blanche, dont on dit qu’elle tient son nom de la couleur blanche utilisée pour masquer le noir de l’incendie, quand ils la reconstruisirent ; mais il pourrait venir aussi du nom du domaine de l’épouse de Washington : White House Plantation. Ce raid était en réponse à l’incendie de la ville canadienne d’York [future Toronto] par les Américains l’année précédente. Mais les Anglais échoueront en janvier 1815 devant la Nouvelle Orléans. Au final, ce sera tout de même un échec américain, car le Canada ne deviendra pas le Nième État américain, et s’affranchira plus tard de la tutelle anglaise : les Canadiens doivent beaucoup à la médiocrité de William Hull, le général en chef américain.
09 1814 au 9 06 1815
Ouverture du Congrès de Vienne – le congrès danse, mais il ne marche pas, persifle le vieux prince de Ligne, qui en fait ne se réunit jamais puisque tout se passa au sein de comités spéciaux : il entérine la disparition de nombreuses principautés aux marches du territoire français, passés à la trappe de la révolution française… seule la principauté de Monaco échappe au naufrage : Honoré IV, le Grimaldi d’alors, avait eu la chance d’être camarade d’école de Talleyrand, qui lui assura qu’il recouvrerait sa principauté. Les groupes de pression – nommés aujourd’hui lobbys – ne manquent pas : anciens maréchaux d’empire désireux de faire valoir leurs droits, Juifs d’Allemagne, abolitionnistes venus peser pour l’abandon de la traite etc… Dans une ville de 250 000 habitants, on estime à 100 000 les étrangers venus à un titre ou à un autre participer au Congrès.
Les anciens Pays Bas autrichiens, dont faisait partie l’actuelle Belgique – la principauté de Liège et les Provinces Unies sont réunis pour former les Pays Bas, sous l’autorité de Guillaume I° d’Orange, qui s’en prend aux libertés, désavantage les catholiques, pourtant majoritaires dans les régions belges, impose le néerlandais comme langue officielle, quand la population parle soit le français, soit le flamand, plutôt éloigné du néerlandais. Une Confédération des États germaniques regroupant 39 participants est créée, présidée par l’Autriche, siégeant à Francfort. Le grand duché de Varsovie est rattaché à la Russie.
Quant à l’Italie, le premier mot qui vient à l’esprit est encore pour de longues années celui de confettis : L’Italie issue du Congrès de Vienne était encore une expression géographique, selon le mot de Metternich, un morcellement de petits États comprenant la principauté de Monaco, le royaume de Piémont Sardaigne, le royaume lombard-vénitien, administré pour l’empereur autrichien par un vice-roi et deux gouverneurs, l’un à Milan, l’autre à Venise, le duché de Parme, le duché de Modène, qui annexera le duché de Massa en 1829, le grand duché de Toscane auquel sera réuni le duché de Lucques, la république de Saint Marin, les États pontificaux, comprenant la Romagne, les Marches, l’Ombrie, le Latium, et l’enclave de Pontecorvo et de Bénévent, au nord du royaume de Naples et le royaume des Deux Siciles composé des royaumes de Naples et de Sicile qui seront unifiés en 1816 .
Hubert Heyriès. Garibaldi, le mythe de la révolution romantique. Privat 2002
La France a la consolation de voir ses marchés à nouveau approvisionnée en morue française puisque Saint Pierre et Miquelon, jusqu’alors anglaise depuis 1778, lui a été restituée.
Le grand maître d’œuvre en est le chancelier autrichien Metternich, qui éprouve le plus profond mépris pour le monde bourgeois, qui compare les nations tantôt à des femmes nerveuses, tantôt à des enfants irresponsables.
Le but des factieux est un et uniforme, c’est le renversement de toute chose légalement existante, le principe que les monarques doivent opposer, c’est celui de la conservation de toute chose légalement existante.
*****
Il ne prépara jamais l’avenir, parce qu’il ne voulait pas que cet avenir fût différent du passé.
André Maurois.
Passé l’effroi de la nouvelle du retour sur le sol français de Napoléon, à Vallauris le 1°mars 1815, [2] le grand vainqueur à long terme de l’affaire va être l’Angleterre, dont la puissance maritime va lui assurer un siècle de domination mondiale. Le point d’orgue va en être le règne de Victoria. C’est l’époque du Rule, Britannia, on the waves. Talleyrand représente la France : muni d’une mauvaise jambe, il a pris soin depuis longtemps d’avoir une bonne tête, et il en use magistralement. Mais, si le congrès dansait, il travaillait aussi, et ardemment.
À son arrivée à Vienne, Talleyrand fut à même de constater que les quatre grandes puissances (l’Autriche, la Prusse, la Russie et l’Angleterre) avaient déjà tenu des réunions officieuses et décidé d’arrêter entre elles seules toutes les mesures touchant à l’Allemagne, à l’Italie et à la Pologne. Or il était convenu que la France devait être consultée sur ces questions. Les Alliés avaient négligé ce détail. Talleyrand protesta. Metternich et Nesselrode l’invitèrent à titre personnel à assister à une réunion. Labrador, qui représentait l’Espagne, reçut la même invitation. Ni l’un ni l’autre n’avaient voix délibérative. Cette réunion eut lieu à la chancellerie de Metternich. Lord Castlereagh représentait l’Angleterre, Nesselrode, la Russie, Hardenberg et Humboldt, la Prusse. Gentz, très hostile à la France, servait de secrétaire. La séance commença par les déclarations de Metternich et de Hardenberg sur la nécessité de construire la paix de l’Europe sur des bases solides. Ils employèrent à plusieurs reprises, l’expression de puissances alliées.
Alliées ? dit soudain Talleyrand. Alliées, et contre qui ? Ce n’est plus contre Napoléon : il est à Sainte Hélène ; ce n’est plus contre la France : la paix est faite. Ce n’est sûrement pas contre le roi de France : il est garant de la durée de cette paix. Messieurs, parlons franchement. S’il y a encore des puissances alliées, je suis de trop ici…
Ils étaient abasourdis. Aucun d’eux, même le subtil Metternich, n’avait prévu cette parade, ne trouvait le moindre argument contre ce raisonnement d’une implacable logique. Talleyrand venait de marquer un point. Il poursuivit : Et cependant, si je n’étais pas ici, je vous manquerais essentiellement, messieurs ; je suis peut-être le seul qui ne demande rien. De grands égards, c’est là tout ce que je veux pour la France. Elle est assez puissante par ses ressources, par son étendue, par le nombre et l’esprit de ses habitants, par la contiguïté de ses provinces, par l’unité de son administration, par les défenses dont la nature et l’art ont garanti ses frontières. Je ne veux rien, je vous le répète ; et je vous apporte immensément. La présence d’un ministre de Louis XVIII consacre ici le principe sur lequel repose tout l’ordre social. Le premier besoin de l’Europe est de bannir à jamais l’opinion qu’on peut acquérir des droits par la seule conquête, et de faire revivre le principe sacré de la légitimité d’où découlent l’ordre et la stabilité.
Montrer aujourd’hui que la France gêne vos délibérations, ce serait dire que les vrais principes seuls ne vous conduisent plus et que vous ne voulez pas être justes…
Profitant de son avantage, il poussa cette pointe : Si, comme on le répand, quelques puissances privilégiées voulaient exercer sur le congrès un pouvoir dictatorial, je dois dire que, me renfermant dans les termes du traité de Paris, je ne pourrais consentir à reconnaître dans cette réunion, aucun pouvoir suprême dans les questions qui sont de la compétence du congrès…
Ensuite, pour pallier l’enchevêtrement des affaires à évoquer, il proposa de les classer en distinguant les questions d’intérêt secondaire des problèmes d’importance primordiale. Ils acquiescèrent. Ils venaient ainsi de se donner un maître, sans toutefois s’en rendre compte. Gentz avouera plus tard que l’intervention de Talleyrand avait renversé les plans des quatre puissances ; il n’oublia jamais cette scène. Il détruisit les procès-verbaux des séances antérieures, puis établit un protocole que Talleyrand accepta de signer. Le soir même, celui-ci adressa aux quatre ministres une note dans laquelle il déclarait que les décisions du congrès n’auraient de validité qu’en y associant les huit puissances signataires du traité de Paris. À la suite de quoi, on créa dix commissions d’inégale importance. Cet émiettement était propice aux manœuvres du représentant de la France et retardait les décisions finales. Le temps profitait toujours à Talleyrand !
Désormais, la France cessa d’être écartée des délibérations. Bien plus, Talleyrand, en évoquant le cas des petites puissances (l’Espagne, le Portugal, le Danemark, la Suède, le Wurtemberg), avait rendu, à notre pays sa place dans le concert des nations et son rôle traditionnel de protecteur des petits États. C’était désormais autour de lui que se groupaient leurs représentants. C’était un succès digne de Mazarin, à la différence près que ce dernier négociait en position de force.
Georges Bordonove. Talleyrand. Pygmalion 1999
Que Talleyrand ait été très largement fourni en génie, personne n’oserait en douter, et Georges Bordonove encore moins que tout autre, mais, chose plus rare, le génie chez lui faisait bon ménage avec le simple bon sens, lequel bon sens a une grande part de responsabilité dans ses succès au Congrès de Vienne ; il avait commencé par bien se loger : le palais Kaunitz, dans la Johannesgasse, suffisamment spacieux pour y recevoir grandement, même s’il est en piteux état et qu’il faut refaire peintures, mobilier, tapis, rideaux et tapisserie ; il avait aussi emmené Antonin Carême – le mal nommé -, alors probablement le plus grand chef [c’est lui-même qui créa le mot] cuisinier de l’époque, et il reçut à sa table tout le gratin diplomatique d’Europe qu’Antonin Carême régalait tant et plus. Comment voulez-vous humilier et traiter plus bas que terre un vaincu quand celui-ci développe votre bonne humeur avec des plats à en rêver la nuit ?

Destin exceptionnel que celui de cet homme, abandonné à huit ans par ses parents en pleine révolution française – 1792 – son père l’avait jugé le plus dégourdi de ses 14 enfants… celui-là, il devrait parvenir à s’en tirer tout seul – il se place comme apprenti dans une pâtisserie de la rue Vivienne ; en 1801, il ouvre sa première boutique, la Pâtisserie de la rue de la Paix, qu’il conservera jusqu’en 1813, tout en étant premier tourier à l’hôtel de Galliffet, le ministère des Relations extérieures. Dans le même temps, sur la demande de Talleyrand, il prend en main les fourneaux du château de Valençay où il régale les diplomates de toute l’Europe. Encore dix bonnes années et Talleyrand l’emmène au Congrès de Vienne, après lequel il se met au service de différentes cours d’Europe : Angleterre, Autriche, Russie, pour regagner Paris en 1823, au service des Rothschild… d’où les nombreuses recettes portant leur nom, et d’où encore le tournedos Rossini, ce dernier étant très souvent l’invité des premiers, jusqu’à devenir l’ami de Carême. Et aussi l’éclair, le vol au vent…, mais sur ce dernier, on discute beaucoup, car Marie Leszczinska, épouse de Louis XV avait inventé la bouchée à la reine, apparemment identique en tous points sinon la taille – comme son nom l’indique, la bouchée est individuelle, et le vol au vent un plat – il y aurait une différence quant à la pâte utilisée : une croûte – pâte à foncer – pour la bouchée à la reine, une pâte feuilletée légère, qui vole au vent, pour le vol au vent.
Pour se distraire un peu le soir des austères marchandages de la journée, on s’était mis à parler gastronomie… un thème par soir, et vint le tour des fromages : l’émissaire britannique, le vicomte de Castlereagh, défend le stilton et le chester. Metternich vante les mérites des produits de Bohême, tandis que Charles Robert de Nesselrode, le diplomate russe, complimente ceux de Livonie. Talleyrand ne pipe mot mais annonce qu’Augustin Carême vient de lui annoncer la livraison de Paris de brie, qu’il fait servir sur-le-champ. La France, une fois n’est pas coutume, remporte la victoire. Le brie est désigné roi des fromages.
Oui, mais lequel décrocha la couronne ? Brie de Meaux ou brie de Melun ? Les comptes rendus du baron espion ne l’établissent pas. Ses mouchards, femmes de ménage et maîtres d’hôtel placés au service de chaque délégation, ne devaient pas s’y connaître assez en fromage pour faire la différence… Pourtant, elle est bien réelle. Une roue de brie de Meaux fait entre 36 et 37 centimètres de diamètre, pèse jusqu’à 3,2 kg et sa pâte, affinée huit semaines au maximum, dégage un arôme de beurre et de noisette. Le brie de Melun est plus petit : 28 cm et 1,8 kg au meilleur de sa forme. Vieilli plus longtemps, jusqu’à trois mois, il est long en bouche. Voilà pourquoi, à M’lun, certains osent dire que le brie de Meaux est fade.
Il mourra à 48 ans, peut-être d’un excès de caries dentaires… à trop goûter ses gâteaux et pâtisseries… Il avait pris connaissance des idées de Catherine de Médicis en matière de cuisine… On lui doit la création de la toque en 1821 ; outre l’élaboration de sauces plus légères que celle héritées du Moyen-Âge, quand on cherchait surtout à masquer le goût faisandé des viandes, il a les a groupées par quatre : l’allemande, la béchamel, l’espagnole et le velouté. Il serait également à l’origine du remplacement du service à la française – tous les plats servis en même temps – par le service à la russe, qui sert chaque plat dans l’ordre imprimé sur le menu, après son retour de la cour de Russie. Nous restera encore le diplomate, un gâteau à base de biscuit à la cuiller ou de brioche un peu rassie, agrémenté de rhum, d’œufs et de crème… anglaise.
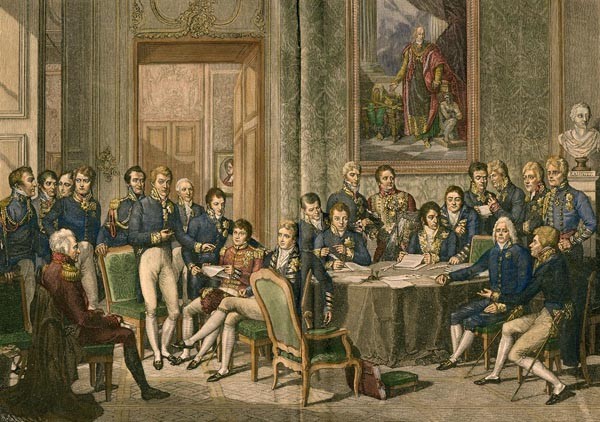
9 juin 1815 – L’Acte final du Congrès de Vienne par Jean-Baptiste Isabey 1767-1855
17 10 1814
Accident à la Meux Company Brewery de Tottenham Court Road à Londres : la paroi d’une cuve de bière de plus de 600 000 litres se fend ; la violence du flot entraîne la rupture de cuves voisines et ce sont 1 470 000 litres de bière qui inondent le quartier : murs défoncés, maisons démolies et neuf morts qui seront dispensés de mise en bière [3].
31 12 1814
Le dernier soldat de Napoléon quitte la Suisse, qui ne va désormais plus connaître aucune occupation étrangère de force.
1814
Utilisation de la presse mécanique en imprimerie. Pierre Michel Moisson-Desroches a remis à l’empereur un mémoire : Sur la possibilité d’abréger les distances en sillonnant l’empire de sept grandes voies ferrées. On ne sait même pas si l’empereur le lut, certes, il avait d’autres choix à fouetter, et pourtant, Pierre Michel Moisson-Desroches voyait juste… Belfort, fortifié par Vauban au XVIII°, subit un premier siège sans se rendre. Le repos dominical est institué : cela va durer jusqu’en 1880 : il sera alors supprimé puis rétabli en 1906.
Le traité de Gand met fin à la seconde guerre d’indépendance entre les États-Unis et la Grande Bretagne ; il y est dit que les Indiens devraient jouir de tous les droits et privilèges dont ils bénéficiaient avant la guerre… C’est à dire, aucun, puisqu’ils étaient considérés alors comme des étrangers sur leurs propres terres. En traversant l’Atlantique pour coloniser l’Amérique, les immigrants n’avaient pas oublié d’emporter dans leurs bagages cynisme et tartuferie.
Les aléas de la guerre en Europe entraînent des changements de propriétaire dans la colonie du Cap : hollandaise depuis 1652, elle devient anglaise : Durant l’hiver 1795, la contagion révolutionnaire qui s’était développée en Hollande avait débouché sur la proclamation, au mois de mars, d’une République batave, sœur de la République française, et les autorités hollandaises se réfugièrent en Angleterre. N’étant plus en mesure d’exercer sa souveraineté, la VOC demanda alors à Londres de prendre provisoirement en charge ses intérêts ultra-marins. Le 11 juin 1795 une flotte anglaise commandée par l’amiral Elphinstone se présenta dans la baie de la Table et un corps expéditionnaire commandé par le général Craig fut mis à terre.
En 1802, la France et l’Angleterre signèrent le traité d’Amiens. Londres, qui reconnaissait l’existence et la légitimité de la république batave, devait donc rétrocéder à cette dernière l’ancien comptoir hollandais du cap de Bonne-Espérance. Entre la France et l’Angleterre, la guerre reprit en 1803. En conséquence, le 7 janvier 1806, Londres réoccupa le Cap puis, en 1814, la Hollande lui vendit son ancien comptoir pour la somme de 6 millions de livres. Quelques mois plus tard, en 1815, le congrès de Vienne entérina le transfert de souveraineté intervenu en Afrique australe : l’Angleterre devenait propriétaire d’un territoire immense peuplé de 26 000 Blancs, 30 000 esclaves et 20 000 Khoi San.
Bernard Lugan. Histoire de l’Afrique. ellipses 2009
18 01 1815
Le corps de Marie Antoinette est exhumé du cimetière de la Rue d’Anjou. Celui de Louis XVI le sera le lendemain. Ils seront emmenés en procession le 23 du même mois en la cathédrale de Saint Denis.
1 03 1815
Napoléon débarque à Vallauris, golfe Juan : le bis va durer Cent Jours. À l’armée.
Soldats, nous n’avons pas été vaincus !
Soldats, dans mon exil, j’ai entendu votre voix, je suis arrivé à travers tous les obstacles et tous les périls. Votre général, appelé au trône par le choix du peuple et élevé sur vos pavois, vous est rendu ; venez le joindre. Arrachez les couleurs que la nation a proscrites, et qui, pendant vingt-cinq ans, servirent de ralliement à tous les ennemis de la France ! Arborez cette cocarde tricolore ; vous la portiez dans nos grandes journées. Reprenez ces aigles que vous aviez à Ulm, à Austerlitz, à Iéna, à Eylau, à Friedland, à Tudela, à Eckmühl, à Essling, à Wagram, à Smolensk, à la Moskova, à Lützen, à Wurschen, à Montmirail ! Pensez-vous que cette poignée de Français aujourd’hui si arrogants puissent en soutenir la vue ? Ils retourneront d’où ils viennent ; et là, s’ils le veulent, ils régneront comme ils prétendent avoir régné pendant dix-neuf ans.
Soldats, venez vous ranger sous les drapeaux de votre chef. La victoire marchera au pas de charge. L’aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clocher jusqu’aux tours de Notre-Dame. Alors vous pourrez montrer avec honneur vos cicatrices. Alors vous pourrez vous vanter de ce que vous aurez fait, vous serez les libérateurs de la patrie ! Dans votre vieillesse, entourés et considérés de vos concitoyens, ils vous entendront avec respect raconter vos hauts faits; vous pourrez dire avec orgueil : Et moi aussi je faisais partie de cette grande armée qui est entrée deux fois dans les murs de Vienne, dans ceux de Rome, de Berlin, de Madrid, de Moscou et qui a délivré Paris de la souillure que la trahison et la présence de l’ennemi y ont empreinte !
9 03 1815
Grenoble. Aux habitants du département de l’Isère : Citoyens, lorsque, dans mon exil, j’appris tous les malheurs qui pesaient sur la nation, que tous les droits du peuple étaient méconnus, et qu’on me reprochait le repos dans lequel je vivais, je ne perdis pas un moment : je m’embarquai sur un frêle navire, je traversai les mers au milieu des vaisseaux de guerre des différentes nations, je débarquai sur le sol de la patrie, et je n’eus en vue que d’arriver avec la rapidité de l’aigle dans cette bonne ville de Grenoble, dont le patriotisme et l’attachement à ma personne m’étaient particulièrement connus.
Dauphinois, vous avez rempli mon attente !
12 03 1815
Au maréchal Ney : Mon Cousin, mon major général vous expédie l’ordre de marche. Je ne doute pas qu’au moment où vous aurez appris mon arrivée à Lyon vous n’ayez fait reprendre à vos troupes le drapeau tricolore. Exécutez les ordres de Bertrand et venez me joindre à Chalon. Je vous recevrai comme le lendemain de la bataille de la Moskova. [Napoléon était donc capable de jeter la rancune à la rivière : Ney avait tout de même déclaré à Louis XVIII : Je ramènerai le monstre dans une cage de fer]
27 03 1815
Au maréchal Davout : Faites monter à Paris des ateliers pour monter 400 fusils par jour, avec des pièces de rechange. Cela donnera du travail à la ville.

Le retour de Napoléon de l’île d’Elbe en février 1815, par Steuben von Karl August, 1818
29 03 1815
À dater du présent décret, la traite des noirs est abolie.
*****
La traite des Noirs avait rendu prospères les ports de l’Atlantique jusqu’à ce que la guerre maritime franco-anglaise ruine ce commerce. La pratique en fut rétablie clandestinement par les Anglais qui faisaient effectuer les voyages par des navires battant pavillon espagnol ou portugais. Par le choix de ce texte, Malraux montre que la décision de Napoléon n’avait pour objectif que de faire sortir l’Angleterre de la coalition.
Philippe Delpuech
1 04 1815
L’ouvrage de quinze années est détruit ; il ne peut se recommencer. Il faudrait vingt ans et deux millions d’hommes à sacrifier. D’ailleurs, je désire la paix, et je ne l’obtiendrai qu’à force de victoires. Je ne veux pas vous donner de fausses espérances ; je laisse dire qu’il y a des négociations, il n’y en a point. Je prévois une lutte difficile, une longue guerre. Pour la soutenir, il faut que la nation m’appuie ; mais, en récompense, elle exigera de la liberté : elle en aura. La situation est neuve. Je ne demande pas mieux que d’être éclairé. Je vieillis : l’on n’est plus à quarante-cinq ans ce qu’on était à trente. Le repos d’un Roi constitutionnel peut me convenir. Il conviendra plus sûrement encore à mon fils.
Napoléon. Vie de Napoléon par lui-même. Compilation d’André Malraux. Gallimard 1930
10 04 1815
Éruption du volcan Tambora sur l’île Sumbawa, à l’est de Bali en Indonésie, faisant entre 71 000 et 91 000 morts. La montagne, haute de 4 200 mètres, s’effondre à 2 751 mètres. Il creuse un cratère de 10 km de diamètre et de 1 km de profondeur, par lequel sont éjectés plus de 35 km³ de magma dense. Sur le dust veil index, un indice crée par Hubert Lamb pour mesurer le volume de particules rejetées par un volcan au moment de son éruption, celle du Tambora est affectée d’un indice de 4 200, quand celle du Krakatoa, en 1883 a un indice de 1 000.
Dans les décennies suivantes, les pentes du volcan accueilleront parfaitement le klangoo [Duabanga moluccana], un bois très apprécié en menuiserie : il sera exploité et surexploité. Les différents travaux du sol mettront à jour nombre des vestiges des 3 royaumes qui se partageaient les flancs de la montagne au moment de l’éruption : Pekat, Sanggar et Tambora. Ces îles étaient alors sous contrôle anglais ; les explosions sont entendues jusqu’à Sumatra, à 2 000 km. Sir Thomas Raffle, lieutenant-gouverneur de Java, voulant connaître la provenance des bruits de canon, puis de la pluie de cendres envoie le lieutenant Owen Phillips vers l’est de l’archipel pour en avoir le cœur net : Cela ressemblait à des bruits de canon, si bien qu’un détachement militaire avait été dépêché de Yogyakarta [Java central] en prévision d’une attaque ennemie.
Le lieutenant Owens débarquera finalement sur l’île de Sumbawa le 23 avril ; la ville de Sanggar est ravagée : 15 000 morts. Il y rencontrera le roi de Sanggar, qui n’a plus que des lambeaux de vêtements sur lui. Il a perdu sa fille :
Vers 19 heures, le 10 avril, trois colonnes de flammes surgirent du cratère du Tambora. Après être montées séparément à une hauteur vertigineuse, elles se rassemblèrent en une seule colonne, terrifiante. En l’espace d’un éclair, le corps de la montagne près de Saugur [aujourd’hui Sanggar] se transforma en un océan de feu qui se déversa dans plusieurs directions.
Les communications de l’époque étaient telles que l’événement resta circonscrit au lieu de l’accident. Mais ses conséquences passèrent, et largement, les frontières : Un nuage de cendre se répand à travers le continent, qui retombe vite. En revanche, le dioxyde de soufre contenu dans la colonne de 40 km de haut est pris dans les courants stratosphériques. Les particules de sulfate deviennent autant de petits écrans solaires. L’impact climatique est considérable. En Europe occidentale, la température moyenne chute de 3 degrés en 1816. C’est l’année sans été.
En Allemagne, les réfugiés errent sur les routes. En Grande-Bretagne, les émeutes se multiplient. En Irlande, frappée par la faim et le typhus (145 000 morts), une première vague émigre aux États-Unis, dans un prélude, presque oublié, à la grande famine et à l’exode de 1845-1849. [et à Waterloo, la pluie qui paralysera l’artillerie de Napoléon… ndlr]
De la pluie, de la neige parfois, qui ruinent les cultures. Les raisins restent verts, les pommes de terre pourrissent, les fruits sont faméliques. Le prix des céréales a doublé entre 1815 et 1817 des deux côtés de l’Atlantique.
La famine fait 100 000 victimes en Europe. La natalité chute, tandis que la mortalité augmente de 4 % en France, de 6 % en Prusse, de 20 % en Suisse et en Toscane. Dans le Valais suisse, on verra apparaître un barrage de glace, puis la débâcle qui submergea la ville de Martigny, à l’origine de milliers de morts et de la théorie moderne de la formation des Alpes. Une épidémie de typhus frappe le centre de l’Europe et le bassin méditerranéen. Partout, des émeutes de la faim éclatent, violemment réprimées. À Cambridge, une loi spéciale a été promulguée, le Riot Act, des condamnations à mort ont été prononcées.
L’Asie elle aussi est frappée. Qui se souvient que c’est l’absence de mousson en 1816, puis les pluies diluviennes de 1817 qui ont provoqué la première grande épidémie de choléra en Inde ? Une crise alimentaire décime le Yunnan entre 1815 et 1818 et convertit la province chinoise à la culture de l’opium. […] Et encore, on observe une fonte de la banquise arctique – eh oui, il peut faire froid en Europe et chaud au Groenland, d’où la quête britannique du passage du Nord-Ouest.
Nathaniel Herzberg. Le Monde du 4 avril 2015
J’eus un rêve qui n’était pas tout-à-fait un rêve.
L’astre brillant du jour était éteint ;
les étoiles, désormais sans lumière, erraient à l’aventure dans les ténèbres de l’espace éternel ;
et la terre refroidie roulait, obscure et noire, dans une atmosphère sans lune.
Le matin venait et s’en allait, – venait sans ramener le jour :
les hommes oublièrent leurs passions dans la terreur d’un pareil désastre ;
et tous les cœurs glacés par l’égoïsme n’avaient d’ardeur que pour implorer le retour de la lumière.
On vivait près du feu : – les trônes, les palais des rois couronnés, –
les huttes, les habitations de tous les êtres animés, tout était brûlé pour devenir fanal.
Les villes étaient consumées,
et les hommes se rassemblaient autour de leurs demeures enflammées pour s’entre-regarder encore une fois.
Heureux ceux qui habitaient sous l’œil des volcans, et qu’éclairait la torche du cratère !
Il n’y avait plus dans le monde qu’une attente terrible.
Lord Byron 1816


22 04 1815
Acte additionnel : Napoléon, par la grâce de Dieu et les Constitutions, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut. Depuis que nous avons été appelés, il y a quinze années, par le vœu de la France, au gouvernement de l’État, nous avons cherché à perfectionner, à diverses époques, les formes constitutionnelles, suivant les besoins et les désirs de la nation, et en profitant des leçons de l’expérience.
Nous avions alors pour but d’organiser un grand système fédératif européen, que nous avions adopté comme conforme à l’esprit du siècle et favorable au progrès de la civilisation. Notre but n’est plus désormais que d’accroître la prospérité de la France par l’affermissement de la liberté publique. De là résulte la nécessité de plusieurs modifications importantes dans les constitutions, sénatus-consultes et autres actes qui régissent cet Empire.
Benjamin Constant, dont les idées libérales avaient fait un opposant confirmé de Napoléon, s’est réconcilié avec lui pendant les Cent Jours : c’est lui qui a rédigé cet acte additionnel qui était un véritable bouleversement institutionnel dont le pouvoir législatif sortait renforcé ; il était désormais composé de 2 Chambres, celle des représentants – 629 membres élus pour cinq ans au suffrage censitaire – et celle des Pairs, en nombre illimité et nommés par l’Empereur. Le domaine de la loi était précisé de façon à réduire la puissance de l’exécutif : l’impôt direct ou indirect, l’emprunt, l’inscription d’une créance au Grand Livre de la dette publique, l’aliénation d’un domaine relevaient de la loi, de même que les levés de troupe, la définition des infractions pénales, les restrictions au droit de publier et la proclamation de l’état de siège.
Les élections législatives voulues par cet acte additionnel seront catastrophiques pour Napoléon : plus de 70 % d’abstentions, 80 élus soutenant le régime contre 500 libéraux, au milieu desquels La Fayette. Les élections communales pour les communes de moins de 5 000 habitants, amplifieront ce revers : environ 80 % des maires et adjoints mis en place par le gouvernement royal seront réélus, souvent contre des candidats bonapartistes :
Le seul acte de popularité que fit Bonaparte à son retour fut de casser les maires et de charger les communes de s’en choisir de nouveaux. Il est remarquable que la plupart des choix que le peuple fit alors l’ont emporté à tous égards sur ceux de l’Empereur.
Madame de Chastenay. Mémoires Tome II
Ainsi donc, n’en déplaise aux fabricants et gourmands de légende, c’est bien la majorité des citoyens qui étaient fatigués de Napoléon… ils en avaient marre de lui, ras le bol !
Les Tuileries. Un palais à demi déserté par le faste impérial que la nuit et la pluie rendent fantomatique Dans le bureau, deux hommes les plus dissemblables qui soient, que seules des circonstances exceptionnelles peuvent faire se rencontrer. Tout les sépare, le caractère, les idées, les ambitions. L’un a dominé le monde ; l’autre a une pathétique incapacité à se dominer lui-même. Et il le sait. Il n’est que contradictions, velléités, rêves inaboutis. L’un est un monstre de cohérence entre l’action et le rêve, l’autre un phénomène d’incohérence proche de la dislocation mentale. Et pourtant, folie de l’histoire, ils ont rendez-vous ensemble. Le despote a besoin du libéral, l’homme d’action du légiste. Napoléon fait face à Benjamin Constant.
L’inconséquence pathologique de Benjamin Constant est dans sa nature. Il n’a jamais pu prendre un parti sans voir les avantages du parti opposé. Il est aussi volage dans ses idées que dans ses amours, véritable marqueterie de qualités et de défauts, de vices et de vertus, dont il est lui-même l’observateur curieux et fataliste. C’est un psychologue à la pointe acérée qui s’adonne à l’autoportrait sans pitié. Nature femelle, ondoyante, tendre sous le cynisme, toujours en recherche d’une volonté forte qui puisse dominer ses épuisantes contradictions, il était naturel que sa complexion de mollusque s’attachât à un rocher. Et quel rocher plus solide que Napoléon ! Du basalte chauffé au feu du volcan.
Mais le Napoléon qui est en face de lui n’est plus celui d’Austerlitz et de Tilsit. C’est un Napoléon à la fois volontaire et désemparé en proie – et cela le rapproche de Benjamin – à de terribles contradictions qu’il est trop intelligent pour ne pas voir. Revenu de l’île d’Elbe en trombe, il a vu se rallumer sur son passage les foyers mal éteints de la Révolution. À travers lui, c’est la cocarde tricolore qu’on acclame, le Robespierre à cheval, le continuateur. Certes, il y a les inconditionnels, ses soldats, qui l’aimeront toujours. Surtout, on le préfère à l’impotent Louis XVIII qui a rétabli l’étiquette et les insupportables prétentions de l’ancienne cour. C’est la France républicaine qui l’a acclamé de Grenoble à Lyon, de Fontainebleau à Paris. Tout cela dans des relents de Carmagnole, de Ça ira qui l’inquiètent. Même s’il admet cette part révolutionnaire de lui-même, d’où il tire son origine, il ne peut ni ne souhaite tirer un trait sur son couronnement, son titre d’empereur, ses prérogatives monarchiques.
Comment, avec tant d’aspirations contraires, rédiger une Constitution qui ait l’air libérale sans être un frein à son pouvoir ?
Car il ne s’agit entre les deux hommes de rien de moins que cela : faire une Constitution adaptée à la situation nouvelle. On est revenu à l’époque de Sieyès. Sauf que Benjamin Constant a des idées très arrêtées sur le sujet. C’est bien le seul domaine, d’ailleurs, où ses convictions soient invariables.
En face de lui, il y a un homme qui a le despotisme éclairé dans le sang. Mais qui a toujours su s’adapter à son seul maître : les circonstances. Au Paris vaut bien une messe de son lointain prédécesseur, ce génial opportuniste répond Paris vaut bien une Constitution. Quitte à abjurer cette manie démocratique à la première occasion en réduisant autant que faire se peut cette représentation nationale à laquelle – il faut lui rendre justice – il a toujours tenu. À condition que ce soit à très petites doses. Et avec une discrétion de bon aloi.
Les deux hommes pourraient parler de littérature si les circonstances s’y prêtaient mieux. Mais, alors, Benjamin n’est connu que comme un idéologue fumeux qui a traîné son insatisfaction et son caractère velléitaire de Madame de Staël, sa maîtresse en mauvais lieux, jusqu’à sa récente passion rédemptrice pour la froide Juliette Récamier qui le regarde avec indifférence brûler d’amour à ses pieds.
Entre ces deux joueurs, c’est une partie de poker qui commence. Napoléon veut une Constitution, à laquelle Benjamin Constant apporte sa garantie de libéralisme[4], pour apparaître comme un homme qui a renoncé au despotisme. Il accepte le frein d’un régime représentatif à son arbitraire. C’est bien le moins qu’il puisse faire puisque Louis XVIII lui-même a accordé une charte. Même si la représentation nationale est en l’occurrence lilliputienne : quinze mille électeurs composent le collège électoral.
Benjamin voudrait, lui, convertir Napoléon au régime libéral, à une sorte de démocratie à l’anglaise.
La première rencontre se passe bien : il s’agit de généralités. Napoléon veut montrer sa figure de démocrate tandis que Benjamin est trop heureux de voir que l’Empereur ne lui tient pas rigueur de l’article assassin qu’il a publié deux semaines plus tôt où, entre autres amabilités, il le comparait à Attila et à Gengis Khan. Il se voyait fusillé à Vincennes il y a quelques jours. Maintenant, il se voit ministre. Conseiller d’État pour commencer ! Et, pour lui montrer à quel point il l’a bien compris, Napoléon lui verse trente mille francs d’acompte sur son futur traitement de conseiller, exactement la somme que Benjamin vient de perdre au jeu. Napoléon tient l’information de Fouché lui-même qui a servi d’intermédiaire pour leur rencontre. C’est tout Benjamin : la vertu du démocrate et les vices du joueur inextricablement mêlés.
Qu’on trouve la patte de Fouché dans cette abracadabrante association entre le despote et l’idéologue, voilà qui aurait dû inquiéter le principal intéressé. Il est en train de sauter à pieds joints sur la plus grossière erreur qu’il pouvait commettre en prenant les rênes du pouvoir : se mettre entre les mains des adversaires qui l’ont toujours combattu, moins les royalistes que les idéologues, les avocats, qui tentent d’instaurer une démocratie à l’anglaise.
Cette erreur, parmi tant d’autres à la même époque, il la reconnaîtra à Sainte-Hélène devant Montholon : J’ai fait une faute en ne prenant point la dictature. Le peuple me l’offrait lorsqu’il m’accompagnait aux cris frénétiques de À bas les traîtres ! À bas les nobles ! Les souvenirs de ma jeunesse m’effrayèrent. Je ne vis de freins possibles aux rancunes populaires que dans le règne des idées constitutionnelles et libérales.
Ce n’est évidemment pas ce discours qu’il tient avec Benjamin, le soir de leur première rencontre. Il veut désamorcer ses préventions : Je serai l’homme du peuple. Des discussions, des élections libres, des ministres, je veux tout cela, la liberté de la presse surtout : l’étouffer est absurde. Je vous charge de me rédiger un projet de Constitution.
Benjamin rentre chez lui en effervescence. Il note dans son journal intime : C’est un homme étonnant. Peut-être se dit-il en commençant à rédiger sa Constitution que la gloire s’offre à lui, qui va lui permettre peut-être de forcer le cœur de l’imprenable Juliette Récamier. Car, chez lui, tout se mêle dans un salmigondis de désirs : l’amour, les idées libérales, les dettes de jeu. Et, pour ne rien simplifier, sa passion pour l’histoire des religions. Deux mois plus tôt, il n’en avait que pour Bernadotte. Le voilà, sans transition, devenu Aristote auprès d’Alexandre.
Quand Constant revient le lendemain aux Tuileries, portant fièrement son projet, il ne suscite pas l’enthousiasme escompté. Il a négligé une toute petite chose, rien, une broutille : l’Empire. Le malentendu commence.
L’Empereur est mécontent : Ce n’est pas là ce que j’entends. Vous m’ôtez mon passé, je veux le conserver. Que faites-vous donc de mes onze ans de règne ? J’y ai quelques droits, je pense. Il faut que la nouvelle Constitution se rattache à l’ancienne. Elle aura la sanction de la gloire.
Votre Majesté a plus besoin de popularité que de gloire, rétorque Constant.
Un mot d’auteur. Napoléon hausse les épaules.
Ce n’est plus le chef décidé, péremptoire, sûr de lui comme de l’univers qu’a devant lui Benjamin, mais un homme que les abandons et les trahisons ont miné. Son audace, qui lui a si bien réussi, s’effiloche en velléités et en indécisions. S’il a quitté l’île d’Elbe, c’est parce qu’il n’avait pas le choix : l’épée dans les reins, la menace de l’empoisonnement ou d’une déportation dégradante. Mais, maintenant, qui est-il ? Vers qui se portent les acclamations, les applaudissements, l’espoir? L’Empereur ? Rien n’est moins certain : en dehors de ses grognards, le monarque rappelle trop la guerre meurtrière et porte avec lui des relents d’Ancien Régime qui agacent. La nomination de frères plus ou moins incapables, portés arbitrairement sur des trônes, se concilie mal avec la religion du mérite. On aspire à retrouver le Premier consul : l’Empereur, mais mis à nu, débarrassé de son étiquette de pacotille, de sa cour d’opérette, de ses momeries de monarchie qui choquent la fibre républicaine.
Si Napoléon penche maintenant vers les libéraux, quitte à se dénaturer, ce n’est pas par goût, c’est par peur de réveiller l’hydre révolutionnaire, les démons de la guerre civile. Il le dit lui-même : c’est par peur de la populace et de ses furies.
S’il était toujours lui-même, d’abord, il n’aurait pas vu Benjamin Constant. Il aurait compris que cette cuisine aux ingrédients contradictoires entre son passé, l’Empire, l’autoritarisme et ce libéralisme de façade, ne le menait à rien. Après avoir été tant trahi, le voilà qui se trahit lui-même. En fait, il essaie de se servir de ce trop corruptible Benjamin pour corriger son image de despote, mais celui-ci est lui-même manipulé par un intrigant hors pair : Fouché.
Serait-on dans une époque paisible, sans menaces extérieures, il pourrait donner le change en se déguisant en libéral. C’est tout le contraire. Les Alliés menacent. La coalition s’est reconstituée. La situation est critique. C’est dans ce contexte terriblement périlleux que Napoléon se lie les mains et demande des conseils au moins doué des hommes d’action, au plus désorganisé des idéologues, à une intelligence ultrabrillante mais spéculative en proie à une anarchie intérieure permanente. Benjamin, si romanesque que soit leur rencontre, ne peut dans ces circonstances que rajouter des problèmes et de la confusion, comme s’il n’y en avait pas déjà assez.
Benjamin au comble de ses contradictions se sent tellement déchiré qu’il confie sa tempête intérieure à La Fayette, l’homme de France dont l’amitié lui est la plus précieuse. Et ce qu’il lui avoue dans ces circonstances est proprement affolant : on dirait qu’il se caricature à plaisir, empêtré dans les scrupules, rongé par l’irrésolution, faisant le pathétique aveu de la faiblesse de son caractère et de son affligeante carence comme homme d’action. Je suis dans une route sombre et douteuse et je crains d’avoir conçu une entreprise au-dessus de mes forces. Je vois l’Empereur revenir par moments à d’anciennes habitudes qui m’affligent. Il a pour moi de la bienveillance. Peut-être ne serai-je pas toujours impartial. On ne peut guère auprès du pouvoir répondre de soi-même. Souvenez-vous de ce que je vous dis maintenant : surveillez-le et si jamais il vous paraît marcher au despotisme, ne croyez pas ce que je vous dirai dans la suite. Ne me confiez rien ; agissez sans moi et contre moi-même. Napoléon est bien mal parti avec un tel conseiller d’État emberlificoté dans ses états d’âme ! Quant à La Fayette il n’entendra que trop bien le propos de Benjamin.
Ces Cent Jours ne sont qu’une inexorable suite d’erreurs commises par un génie qui a cessé de croire en lui-même et se raccroche aux illusoires leviers d’un pouvoir qu’il a perdu. Homme de guerre déguisé en homme de paix, despote grimé en démocrate, empereur sans empire, se défiant de ses soutiens révolutionnaires qui voudraient faire de lui le roi de la jacquerie, tiraillé par des partis opposés, submergé de conseils contradictoires, craignant de faire une guerre qui est plus que jamais nécessaire, qui plus est malade, attristé par l’infidélité de Marie-Louise et la captivité de son fils, c’est désormais un joueur décavé qui n’a plus pour perspective que de miser son va-tout avant de se tirer une balle dans la tête. Ce n’est pas par hasard s’il trouve en Benjamin, autre joueur déboussolé, un complice.
Après plusieurs entrevues et une foule d’amendements, la Constitution est enfin sur pied. Elle s’appellera Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire. Le pouvoir exécutif appartient à l’Empereur qui exerce le pouvoir législatif avec deux chambres : une Chambre des pairs, nommés par Napoléon, une Chambre des représentants, qui est élue au suffrage censitaire et renouvelable tous les cinq ans. Le collège électoral passe de quinze mille à cent mille électeurs. L’Empereur aura le droit de dissoudre la Chambre des représentants. La liberté de la presse est consacrée.
Napoléon renâcle à se voir bridé par une assemblée délibérante.
On me pousse dans une voie qui n’est pas la mienne. On m’affaiblit, on m’enchaîne. La France me cherche et ne me trouve plus. La France se demande ce qu’est devenu le vieux bras de l’Empereur, ce bras dont elle a besoin pour dompter l’Europe. Que me parle-t-on de bonté et de justice abstraites, de lois naturelles. La première loi, c’est la nécessité ; la première justice, c’est le salut public.
Finalement, mécontent, il cède. Personne n’est satisfait. Tous les partis jugent cette Constitution inepte. On l’appelle la benjamine. C’est un journaliste, Montlosier, qui lui a trouvé ce nom. Fureur de Benjamin qui le provoque en duel. Voilà l’ambiance ! Benjamin Constant, qui passe sa vie à harceler Juliette Récamier de protestations d’amour, menace de se suicider ou de se faire tuer en duel, tout en défendant tant bien que mal une Constitution qui frustre tout le monde. Je suis dans un véritable désespoir. Je vous conjure de me dédommager et de me dire quand je pourrais vous voir, écrit-il à Juliette après son entrevue avec l’Empereur. Lui qui, pour plaire à Madame Récamier, a publié quinze jours plus tôt un article dans Le Journal des débats où il proclamait son ralliement aux Bourbons ne sait plus où donner de la tête pour se faire pardonner son revirement. Dans son affolement, il écrit aussi à l’Empereur pour s’excuser de son duel : Je regrette, Sire, d’avoir eu si peu de temps pour vous prouver mon zèle. J’emporte au tombeau une profonde reconnaissance et mes derniers vœux sont pour deux choses inséparables : la gloire de Votre Majesté Impériale et la liberté de la France. Trois jours plus tard, chez Juliette, il lit pendant trois heures, adossé à la cheminée, son roman Adolphe, qui émeut tellement Juliette qu’elle éclate en sanglots, suivie bientôt de toute l’assistance.
Une atmosphère qui n’est pas propice à résoudre une situation politique dramatique. Un amoureux qui menace de se suicider et ajoute un duel à sa situation confuse de farouche opposant fraîchement rallié, auteur d’une Constitution hybride qui ne suscite que des mécontentements, décidément, en Benjamin Constant, Napoléon n’a pas choisi l’homme le plus propre à le rassurer sur son avenir. Il n’a pas tort de penser qu’il a commis une erreur : personne autant que ce subtil écrivain n’est plus apte à le guider vers la catastrophe.
Jean Marie Rouart. Napoléon ou la Destinée. Gallimard 2012
1 06 1815
Aux Français depuis le Champ de Mars : Français, vous allez retourner dans vos départements. Dites aux citoyens que les circonstances sont grandes, qu’avec de l’union, de l’énergie, de la persévérance, nous sortirons victorieux de cette lutte d’un grand peuple contre ses oppresseurs ; que les générations à venir scruteront sévèrement notre conduite ; qu’une nation a tout perdu quand elle a perdu l’indépendance. Dites-leur que des rois étrangers que j’ai élevés sur le trône ou qui me doivent la conservation de leur couronne ; qui tous, au temps de ma prospérité, ont brigué mon alliance et la protection du peuple français, dirigent aujourd’hui tous leurs coups contre ma personne. Si je ne voyais que c’est à la patrie qu’ils en veulent, je mettrai à leur merci cette existence contre laquelle ils se montrent si acharnés. Mais dites aux citoyens que tant que les Français me conserveront des sentiments d’amour dont ils me donnent tant de preuves, cette rage de nos ennemis sera impuissante. Français, ma volonté est celle du peuple ; mes droits sont les siens ; mon honneur, ma gloire, mon bonheur, ne peuvent être autres que l’honneur, la gloire et le bonheur de la France.
Napoléon. (ne figure pas dans la compilation d’André Malraux)
14 06 1815
Soldats, c’est aujourd’hui l’anniversaire de Marengo et de Friedland, qui décidèrent deux fois du destin de l’Europe. Alors, comme après Austerlitz, comme après Wagram, nous fûmes trop généreux ; nous crûmes aux protestations et aux serments des princes que nous laissâmes sur le trône
Soldats, à Iéna, contre ces mêmes Prussiens aujourd’hui si arrogants, vous étiez un contre trois ; à Montmirail, un contre six. Les insensés ! Un moment de prospérité les aveugle. S’ils entrent en France, ils y trouveront leur tombeau. Soldats, nous avons des marches forcées à faire, des batailles à livrer, des périls à courir ; mais, avec de la constance, la victoire sera à nous : les droits, l’honneur de la patrie seront reconquis. Pour tout Français qui a du cœur, le moment est arrivé de vaincre ou de périr ! Aujourd’hui, cependant, coalisés contre nous, ils en veulent à l’indépendance et aux droits les plus sacrés de la France. Ils ont commencé la plus injuste des agressions. Marchons donc à leur rencontre : eux et nous ne sommes-nous plus les mêmes hommes ?
16 06 1815
À sept heures, nous étions maîtres de tous les villages [des alentours de Fleurus] l’ennemi occupait encore avec toutes ses masses le plateau du moulin de Bussy. L’empereur se porta avec sa Garde au village de Ligny. Huit bataillons de la Garde débouchèrent à la baïonnette, et derrière eux les quatre escadrons de service, les cuirassiers du général Delort, ceux du général Milhaud, et les grenadiers à cheval de la Garde. La vieille Garde aborda à la baïonnette les colonnes ennemies qui étaient sur les hauteurs de Bussy, et en un instant couvrit de morts le champ de bataille. À dix heures, la bataille était finie, et nous nous trouvions maîtres de tout le champ de bataille.
Napoléon. Vie de Napoléon par lui-même. Compilation d’André Malraux. Gallimard 1930
_________________________________________________________________________________________
[1] auquel on prête le mot : si tu vois un fou qui se prend pour Napoléon, dis-lui bien que son état empire.
[2] La comtesse Bernstorff, issue d’une vieille lignée d’Allemagne du Nord, résumera, cinglante : Le congrès ressemblait à une représentation théâtrale dans une maison en feu. Jean-Paul Deléage devait avoir lu cela, qui soufflera à Jacque Chirac le fameux Notre maison brûle et nous regardons ailleurs, à Johannesburg, au 4° sommet de la Terre le 2 septembre 2002.
[3] Ceci pour le jeu de mots que l’histoire appelle puisqu’en fait les deux bières n’ont rien à voir : dans la mise en bière, la bière vient de bera, un mot de l’ancienne langue franque parlée au neuvième siècle, qui était le nom de la planche sur laquelle on mettait, puis enterrait le corps.
[4] Avant que de devenir une doctrine économique visant à la liberté des échanges comme des entreprises, le libéralisme fut une doctrine politique qui s’opposait simultanément à l’absolutisme des régimes monarchiques et au jacobinisme exalté de la Terreur.
Laisser un commentaire