| Publié par (l.peltier) le 8 octobre 2008 | En savoir plus |
16 03 1870
Léopold von Hohenzollern Sigmaringen est pressenti pour occuper le trône d’Espagne, après la fuite d’Isabelle IV. Il accepte le 3 Juillet.
8 05 1870
Cinquième plébiscite organisé par Napoléon III : les deux premiers étaient nationaux [20 et 21 12 1851, puis 21 et 22 11 1852], les deux suivants étaient régionaux [15 et 16 04 1860 pour le comté de Nice, et 22 et 23 04 1860 pour la Savoie] :
Le peuple approuve les réformes libérales opérées dans la Constitution depuis 1860 par l’Empereur avec le concours des grands Corps de l’État et ratifie le Sénatus-Consulte du 20 avril 1870.
Suit une proclamation de l’Empereur : En apportant au scrutin un vote affirmatif, vous conjurerez les menaces de la révolution; vous assoirez sur une base solide l’ordre et la liberté, et vous rendrez plus facile, dans l’avenir, la transmission de la Couronne à mon Fils. Vous avez été presque unanimes, il y a dix-huit ans, pour me conférer les pouvoirs les plus étendus; soyez aussi nombreux aujourd’hui.
C’est plus qu’un succès : un raz de marée : 7 336 434 OUI – 67.88 % – , 1 560 709 NON – 14.44 % – et 1 900 000 abstentions – 17.58 % -.
Des résultats de tous ces référendums, les politiques entretiendront à l’avenir une grande méfiance, qui atteindra son apogée avec la V° république où ne manqueront pas ceux qui voudront rapprocher de Gaulle de Napoléon III. Ce dernier raflait l’essentiel du vote ouvrier pour avoir commencé par leur faire des promesses… qu’il a ensuite tenues, et encore l’essentiel du monde paysan pour lesquels il représentait un rempart contre les révolutionnaires de tout poil. Pareils résultats de démocratie directe ne pouvait que profondément déstabiliser les corps représentatifs qui voyaient là, et à juste raison, toute leur raison d’être menacée de disparition pure et simple.
19 05 1870
Au Canada français, la vallée du Saguenay-Lac Saint Jean, est ravagée par un incendie. Un sol encombré de résidus de chantiers de coupe forestière de l’année précédente, des feux de nettoiement non maîtrisés, la foudre et pour finir, un fort vent, tout cela provoque rapidement un gigantesque incendie : 7 morts, 555 familles sans-abri. des milliers d’hectares ravagés.
24 05 1870
De Charleville, Arthur Rimbaud, 17 ans, écrit à Théodore de Banville :
Cher Maître,
Nous sommes au mois d’amour ; j’ai dix-sept ans. L’âge des espérances et des chimères, comme on dit – et voici que je me suis mis, enfant touché par le doigt de la Muse, – pardon si c’est banal, – à dire mes bonnes croyances, mes espérances, mes sensations, toutes ces choses des poètes – moi j’appelle cela du printemps.
Que si je vous envoie quelques uns de ces vers, – et cela en passant par Alph. Lemerre, le bon éditeur, – c’est que j’aime tous les poètes, tous les bons Parnassiens, – puisque le poète est un Parnassien, – épris de la beauté idéale ; c’est que j’aime en vous, bien naïvement, un descendant de Ronsard, un frère de nos maîtres de 1830, un vrai romantique, un vrai poète. Voilà pourquoi. – C’est bête, n’est-ce pas, mais enfin ?…
Dans deux ans, dans un an peut-être, je serai à Paris – Anch’io, messieurs du journal, je serai Parnassien ! – Je ne sais ce que j’ai là… qui veut monter… – Je jure, cher maître, d’adorer toujours les deux déesses, Muse et Liberté.
Ne faites pas trop la moue, en lisant ces vers : …. vous me rendriez fou de joie et d’espérance, si vous vouliez, cher Maître, faire faire à la pièce Credo in unam une petite place entre les Parnassiens… Je viendrais à la dernière série du Parnasse : cela ferait le Credo des poètes ! … -Ambition ! ô Folle !
Arthur Rimbaud
Par les beaux soirs d’été, j’irai dans les sentiers
*****
Ophélie
Sur l’onde calme et noire où dorment les étoiles,
*****
Credo in unam
Le soleil, le foyer de tendresse et de vie,
*****
Si ces vers trouvaient place au Parnasse contemporain ?
Ne sont-ils pas la foi des poètes ?
Je ne suis pas connu ; qu’importe ? les poètes sont frères. Ces vers croient ; ils aiment ; ils espèrent : c’est tout.
Cher maître : Levez-moi un peu: je suis jeune : tendez-moi la main …
21 06 1870
Émeutes à Tientsin [qui deviendra Tianjin], en Chine : des rumeurs d’enlèvements d’enfants circulaient depuis un moment dans la communauté chinoise, effectués par les missionnaires français et l’orphelinat des Filles de la Charité. Trois jours plus tôt avaient été tués trois chinois accusés de jouer les rabatteurs pour les chrétiens, mais aussi le consul de France Fontanier et son chancelier Simon. La révolte s’était propagée et quarante chinois chrétiens sont tués ainsi qu’une vingtaine d’étrangers, essentiellement des religieux. Plusieurs églises sont incendiées, dont Notre Dame des Victoires. Les canonnières des puissances étrangères sont envoyées pour mettre fin à la révolte et cela coûtera très cher à la Chine ; il s’avérera que ces rumeurs d’enlèvement étaient totalement infondées.
23 06 1870
Gustave Courbet a refusé la Légion d’honneur, proposée par Napoléon III. Il s’en explique auprès de Maurice Richard, ministre des lettres, sciences et beaux-arts. Publiée dans Le Siècle, la lettre fait scandale et se termine ainsi : J’ai cinquante ans et j’ai toujours vécu libre. Laissez-moi terminer mon existence libre : quand je serai mort, il faudra qu’on dise de moi : Celui-là n’a jamais appartenu à aucune école, à aucune église, à aucune institution, à aucune académie, surtout à aucun régime, si ce n’est le régime de la liberté.
L’homme n’aura jamais fait l’unanimité et les insultes à son endroit fleuriront, surtout après son engagement dans la Commune, ainsi cette saillie d’Alexandre Dumas fils : De quel accouplement fabuleux d’une limace et d’un paon, de quelles antithèses génésiaques, de quel suintement sébacé peut avoir été générée cette chose qu’on appelle Gustave Courbet ? Sous quelle cloche, à l’aide de quel fumier, par suite de quelle mixture de vin, de bière, de mucus corrosif et d’œdème flatulent a pu pousser cette courge sonore et poilue, ce ventre esthétique, incarnation du Moi imbécile et impuissant
6 07 1870
Le gouvernement ne tolérera pas qu’une puissance étrangère, en plaçant un de ses princes sur le trône de Charles-Quint, puisse déranger à notre détriment l’équilibre actuel des forces en Europe et mettre en péril les intérêts et l’honneur de la France.
Agenor de Gramont, ministre des Affaires étrangères de la France, à l’Assemblée nationale.
12 07 1870
Napoléon III demande à la Prusse de s’opposer à cette intronisation : accord de Guillaume I° sur la demande française.
14 07 1870
Par la dépêche d’Ems, Bismarck rectifie la position de Guillaume I°, dans des termes difficilement admissibles pour la France.
15 07 1870
Les chambres votent la mobilisation.
Vous n’êtes pas prêts, avertit Adolphe Thiers.
Nous sommes prêts et archiprêts, rétorque le maréchal Lebœuf, ministre de la guerre. La guerre dût-elle durer deux ans, il ne manquerait pas un bouton de guêtre à nos soldats.
18 07 1870
Le concile Vatican I proclame l’infaillibilité pontificale en matière de définition doctrinale. Ceux qui y resteront opposés seront nommés vieux catholiques. Il s’est ouvert le 8 décembre de l’année précédente devant 700 pères ainsi représentés :
| 200 | Italiens | 29 % |
| 70 | Français | 10 % |
| 40 | Autrichiens-Hongrois | 6 % |
| 40 | Américains | 6 % |
| 9 | Canadiens | 1.3 % |
| 30 | Américains du sud | 4.3 % |
| 37 | Espagnols | 5.3 % |
| 19 | Irlandais | 2.7 % |
| 18 | Allemands | 2.6 % |
| 12 | Anglais | 1.7 % |
| 19 | d’autres pays | 2.7 % |
| près de cent évêques missionnaires | 14.3 % | |
| 50 prélats de rite oriental | 7.14 % |
La guerre va interrompre les travaux.
En matière de définition doctrinale… il faut entendre cela au sens large, et même très large ; c’est que, mes bien chers fils, la doctrine, ça touche à tout : ainsi la constitution Dei Filius dit-elle : Si quelqu’un dit qu’il est possible que les dogmes proposés par l’Église se voient donner parfois, suivant le progrès de la science, un sens différent que celui que l’Église a compris et comprend encore, qu’il soit anathème !
*****
Ainsi étaient claquées les portes au nez de tout savant qui tenterait de traduire les touchantes métaphores surgies de l’épopée juive puis du Moyen Âge chrétien en tenant compte des données d’une science qui accumulait alors les preuves du caractère poétique du discours biblique. L’Église et avec elle la Société de Jésus s’acharnent une fois de plus à attirer sur elles les sarcasmes de ceux qui cherchent, étudient, ou lisent, simplement…
Jean Lacouture. Jésuites. Les Conquérants. Seuil 1991
19 07 1870
La France déclare la guerre à la Prusse. L’état des forces françaises avait été gravement surestimé : elles étaient en fait épuisées par les nombreuses campagnes militaires dans le monde : guerre de Crimée, de 1853 à 1856, campagne d’Italie de 1859, campagnes en Asie – Cochinchine et Corée, expédition du Mexique en 1866-1867. Il se révélera que l’impréparation était totale : arrivée sur les frontières de l’est, les troupes n’y trouveront aucun ravitaillement, on manquera de tout. Nommé à Belfort, un général cherchera en vain son corps ; on verra des réservistes de Dunkerque envoyés à Perpignan pour être affectés à Strasbourg etc etc … une ahurissante pagaille…Une supériorité sur les Prussiens, mais une seule : la mitrailleuse, qui fera des ravages dans leurs rangs, au point qu’ils la représenteront souvent dans leur monuments érigés en Alsace-Moselle de 1870 à 1918. Et, dans les charges à la baïonnette, les Français auront assez souvent le dessus. Mais cela ne pouvait être mis en balance avec la puissance de l’artillerie prussienne qui leur permettait d’être hors de portée des Français quand eux-mêmes parvenaient à canarder l’ennemi.
Bismarck, qui veut aboutir à l’unité allemande, est parvenu à engager aux côtés de la Prusse, les grands royaumes du sud : Bade, Wurtemberg, Bavière : cette armée sera sous commandement prussien mais elle sera allemande.
24 07 1870
Courrier à ses proches du docteur Constant Chauvin, mobilisé à Rennes :
Le 17° bataillon de chasseurs à pied a reçu vendredi l’ordre de partir pour Bitche. À dix heures, il était en route. Vous ne sauriez vous imaginer, mes chers petits amis, avec quel enthousiasme il a été accompagné à la gare par la population de Rennes presque en masse. Elle s’était réunie et mêlée à ces soldats et dix mille personnes marchaient au chant de La Marseillaise ou en criant : mourir pour la patrie, c’est le sort le plus beau, le plus digne d’envie ! on se sentait étreint par la plus poignante émotion. Je n’aurai pas cru Rennes une ville aussi guerrière ! Et il paraît qu’il en est de même pour toute la France. À Paris surtout règne un enthousiasme frénétique : on nous dit qu’il y a plus de 80 000 engagés volontaires, sans doute parce qu’on a limité l’engagement à la durée de la guerre. Tout cela montre que le peuple français éprouve pour les Prussiens une très grande antipathie et qu’il est heureux de retrouver l’occasion de se venger de la défaite de Waterloo ! Mais, comme le dit Paul, à quel prix de sang et d’argent obtiendrions-nous cette revanche !
Nos soldats de toutes classes partent avec un entrain impossible à décrire (…) Dans cette guerre, je n’ai personnellement pas grand-chose à gagner: la décoration peut-être… Cependant je partirai sans faiblir et je ferai mon devoir ; mais ce ne sera pas sans avoir le cœur gros de préoccupations, toutes vous concernant…
docteur Constant Chauvin Sa correspondance de campagne, présentée par Léon Dupas. Revue générale de médecine vétérinaire n° 147 à 152 ; février-avril 1909 ; Sélectionné par Jean-François Lecaillon. Été 1870 La guerre racontée par les soldats. Bernard Giovanangeli Paris 2003
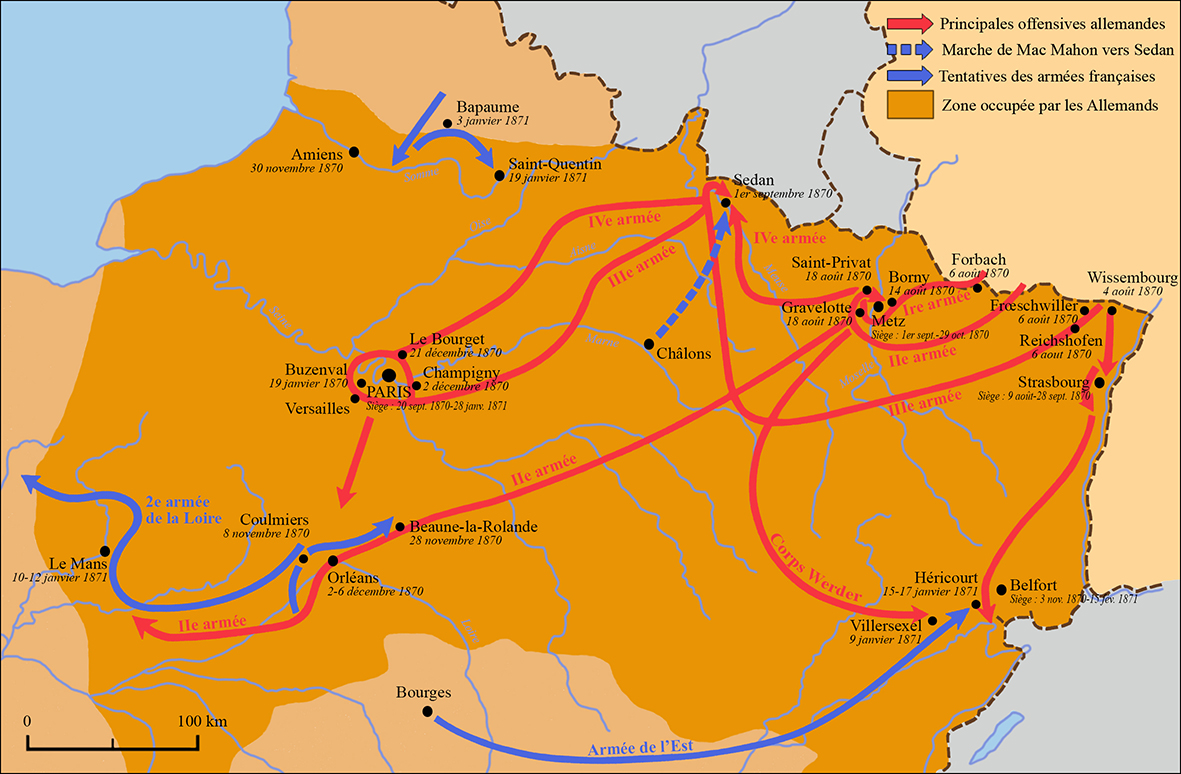
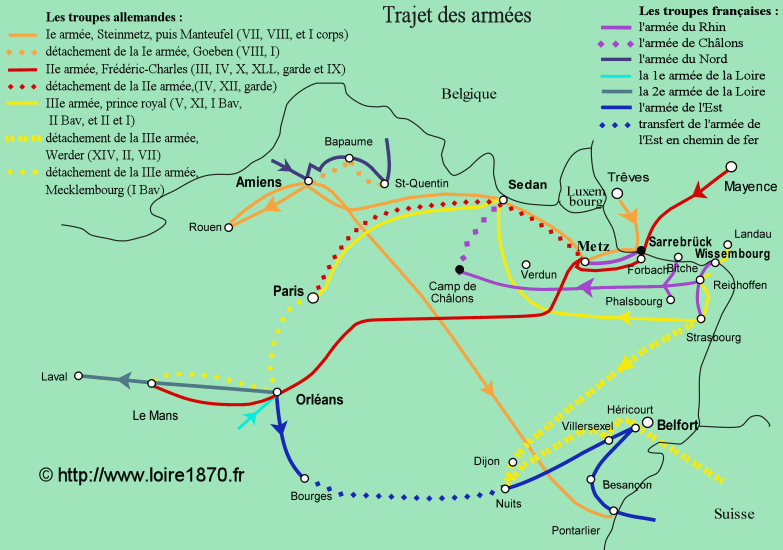
6 08 1870
Bataille de Reichshoffen

Nous avons fait un long détour pour arriver au village de Spicheren, [sur la commune de Forbach est, nord-est, et au sud-sud-est de Sarrebruck], où nous avions d’abord campé. De là, nous voyons les Prussiens sur les sommets que nous leur avions pris le 2 août. Quand nous passions sur une hauteur, les Prussiens ont jeté des bombes sur notre colonne : heureusement, ils ont jeté trop loin leurs projectiles ; d’autres compagnies qui nous suivaient ont eu des blessés. Deux capitaines et deux soldats se sont empressés de les emporter avec eux, mais, ô malheur, une autre bombe arrive, coupe un blessé en deux, tue le capitaine et blesse l’autre. Ensuite, on nous a embusqué dans un ravin profond, derrière une grande forêt. Nous sommes restés là plus d’une heure. les obus passaient au-dessus de nos têtes, faisant dans la terre des trous plus grands que nos marmites. Un colonel sort de la forêt et nous dit que son cheval est tué ; ils ne sont que deux régiments, nous en aurons bien vite raison. On nous a fait suivre la lisière de la forêt pendant un kilomètres environ. Là, j’ai vu fonctionner les mitrailleuses de bien près. En descendant la côte, j’ai vu une jument qui avait la jambe emportée. Descendu dans la plaine, j’ai vu nos chasseurs aux prises avec les Prussiens. Peu à peu, nous avons avancé dans un village qui était voisin (je ne sais s’il était français ou prussien). Les Prussiens étaient dans la gare (…) La générale sonne, je suis ému, mon pauvre cœur palpite à l’idée du danger. En ce moment, tous les soldats sont sous les armes, munis de leurs cartouches, attendant le signal du départ. Après une demi-heure de perplexité, on sonne : la baïonnette au canon et le rompez vos rangs (…) Ensuite nous avançons pour chasser l’ennemi. Nous traversons une fonderie dont les plaques et les toits résonnaient sous les balles, puis avançant de cinquante mètres, on m’a embusqué derrière les pierres de taille. À peine avais-je tiré trois coups que mon fusil ne fonctionnait plus : jugez de mon embarras. Heureusement, j’étais à couvert. Prenant mon nécessaire d’arme, j’ai démonté et remonté mon fusil avec le plus grand sang-froid. Peine inutile ! Enfin, j’ai remarqué un tube de papier qui empêchait la cartouche de passer. Je l’enlevai rapidement. À deux pas de moi, un chasseur à pied avait reçu une balle dans les jambes, un autre était mort à ses côtés.
Quelques soldats s’étaient abrités derrière lui. Un lieutenant embusqué à huit pas de moi, nous dit d’avancer sur les Prussiens. Je m’élance avec vingt de mes compagnons ; à toute haleine, nous traversons les rails du chemin de fer, puis nous nous sommes retranchés derrière des tonnes en fonte d’une grosseur extraordinaire. Nous étions à l’abri des balles qui venaient en ligne droite, mais non de celles venant des lignes obliques.
À mes pieds se trouvait un capitaine des chasseurs ayant une balle dans la tête, couché dans une marre de sang. Derrière lui, il y avait un colonel qui avait reçu une balle dans la tempe qui lui avait traversé la tête de part en part.
Il y avait de quoi être malade, mais j’avais autre chose à faire que de réfléchir. Nous étions à quatre cent mètres d’un corps prussien masqué dans un bois et derrière un fossé.
Le lieutenant, brave soldat, criait de toutes ses forces : Capitaine Péron, soutenez-nous et nous attaquerons les Prussiens dans le bois. Mais le capitaine ne l’entendait pas. Enfin, il dit : allons-y seuls. Les uns disant que c’est une témérité, les autres qu’en allant rapidement nous avions quelque chance de leur échapper. Cet avis fut gouté et exécuté. Au pas de vélocité, nous traversons une prairie de deux cents mètres de largeur sous les balles prussiennes, avant d’arriver à l’endroit choisi. J’ai passé à côté d’un chasseur qui avait une balle dans le bas-ventre. Quant à moi, je me suis abrité derrière une corde de bois à cent-cinquante mètres des Prussiens, sans considérer que mes confrères, plus prudents, s’étaient arrêtés à trente ou quarante mètres plus bas. Ma position était critique. Je n’osais tirer dans la crainte qu’ils ne sussent que j’étais là. Si les ennemis sortaient de leurs tranchées, je ne pouvais leur échapper. Après réflexion, je me décidai peu à peu à faire usage de mes armes et je tirai à bout portant. Peu à peu, beaucoup des nôtres s’étaient retirés dans un jardin qui n’était guère éloigné. En me trouvant à ce moment donné seul, j’ai battu en retraite où étaient mes confrères. Enfin arrivé au jardin, je fus surpris de n’y trouver personne ; seuls un lieutenant et trois soldats avaient gardé leur position.
Je demande à l’officier ce que je devais faire : il me répondit d’aller chercher du renfort.
Je lui obéis promptement et m’adressant au colonel, je lui ai expliqué ma mission. Sa réponse fut négative ; j’allais en avertir le lieutenant et, à notre grand regret, à cinq seulement, nous avons gardé en respect un bataillon allemand. Nous retournâmes par un hôtel saccagé, et où, au lieu de fauteuils, tapis, cognac et autres liqueurs, j’aurais désiré trouver de l’eau et un peu de pain. Je ramassais un bidon en passant et bus l’eau de la main d’un infirmier prussien. Je l’en ai remercié par geste. M’a-t-il compris ? Peut-être.
Yves-Charles Quentel. Correspondance à sa famille pendant la campagne contre les Prussiens, en 1870. Guéchall. Bulletin de la Société finistérienne d’histoire et d’archéologie. Tomes II et III. Quimper 1979 et 1980. Sélectionné par Jean-François Lecaillon. Été 1870 La guerre racontée par les soldats. Bernard Giovanangeli Paris 2003
On n’écoutait plus les chefs. La faim – nous n’avions pas mangé depuis la veille au matin – faisait de nous des révoltés. L’indiscipline était partout. Notre unique pensée était de trouver du pain et de manger… après, on verrait. Des troupes arrivées avant nous circulaient déjà dans les rues de Saverne ; des soldats erraient comme des bandes de loups, envahissaient les boulangeries, les charcuteries, les cabarets. Les braves habitants étaient effrayés et on voyait des vieilles affolées, lever les bras au ciel et s’écrier : C’est-y Dieu possible ! Les Cosaques n’ont pas fait pis ! Sur la grande place je vis l’une d’elles courir après des zouaves qui venaient de lui chaparder des canards, et qui fuyaient en tenant ces volailles par les pattes, dont les couacs, couacs… se mêlaient aux lamentations de la vieille. Chacun pillait comme en pays conquis. Alors, voyant cela, nous fîmes comme tout le monde…
À l’étalage d’une charcuterie, un carré de porc s’offrait, tentateur à notre appétit.- Toi décrocher ça, dit Moulah. Et il m’enleva dans ses bras robustes. La côte disparut sous ma veste. Le charcutier, en nous voyant, sortit pour défendre sa marchandise ; mais une quinzaine de camarades s’étant rués dans sa boutique, il dut y rentrer aussitôt pour défendre ses saucissons, ses andouilles et ses pieds truffés. Hélas, que vouliez-vous qu’il fit contre quinze ?
Urbain Lutringer. Souvenirs, recueillis par Guy-Peron Sélectionné par Jean-François Lecaillon. Été 1870 La guerre racontée par les soldats. Bernard Giovanangeli Paris 2003
Le régiment était formé en bataille, lorsqu’un obus, arrivant droit sur notre colonel (de La Carre) et éclatant à ce moment, lui emporte la tête devant le front de son régiment (…) C’est la légende, qui raconte que notre colonel eut la tête enlevée dans la charge et que son corps fut emporté par son cheval dans les rangs ennemis.
La division s’ébranle (…) Je fis de tout cœur un acte de contrition. Nous partons sur un terrain en pente, entre Eberbach et Elsasshausen [entre Reichshoffen et Woerth]; tout d’un coup, au-dessus de nos têtes, un déchirement strident se fait entendre ; regardant en arrière, j’aperçois le feu de la batterie de mitrailleuses qui tirait par-dessus nous. Nous arrivons à un chemin bordé d’arbres et de fossés ; au-delà, le terrain remontait. Le brave cheval Héros s’en tire très bien, et nos évitons un arbre contre lequel se cogne Rigaud, un camarade. Et en avant ! au galop ! Chargez ! À cet instant, je reçois un choc à la tête, avec l’impression que j’ai le dessus de la tête effleuré, par quoi ?
Nous sommes en face de houblonnières, d’où nous arrive un feu très nourri ; impossible d’aborder l’ennemi. Les Allemands sont presque invisibles dans ces gaulis. Deux fois, successivement retentit le commandement : Pelotons à gauche (…) Nous sommes un instant pris en écharpe ; puis, voilà le retour, mitraille dans le dos, chevaux fatigués, et n’ayant pu donner aucun coup de sabre aux Allemands. Un camarade se trouvait à côté de moi, son cheval épuisé ; je l’aidais à le faire avancer, en frappant la croupe du cheval du plat de mon sabre pour lui faire prendre une allure plus vive ; un voisin tombe, une balle ayant traversé le dos de ses cuirasses ; un autre en reçoit une dans son porte-manteau, qui, amortie par cette épaisseur, ne lui fait aucun mal. Le maréchal de logis Vandelbeuque est tué d’une balle au front (…) Le lieutenant-colonel de La Salle, qui venait de prendre le commandement, ordonnait au capitaine Matter, blessé, de se rendre à l’ambulance; celui-ci refusait ; il était comme fou, criant Venez, venez, je vais vous faire voir comment je me bats. Il fallut toute l’énergie de son chef d’escadron, M. Pinard, pour l’arrêter.
Georges de Moussac. Dans la mêlée : journal d’un cuirassier de 1870-1871. Paris Perrin et Cie, 1911 Sélectionné par Jean-François Lecaillon. Été 1870 La guerre racontée par les soldats. Bernard Giovanangeli Paris 2003
Il fait une chaleur accablante. Nous sommes sans vivres. Les villages que nous traversons sont encombrés par les fuyards et les débandés du I° corps d »armée qui entrent dans les auberges ou dans les maisons particulières, s’y attablent et s’y font servir à boire et à manger ; d’autres pillent les arbres fruitiers le long de la route et chassent, avec leurs munitions, les volailles de basse-cour des habitants. Plusieurs accidents résultent de ce désordre ; quelques hommes sont tués ou blessés par ces chasseurs imprudents, ivres pour la plupart. Nous traversons le canal de la Marne au Rhin ainsi que la voie ferrée de Paris à Strasbourg [aux alentours de Saverne] et vers deux heures de l’après-midi nous arrivons à Saverne où l’on nous fait arrêter le long du canal pour prendre quelque repos. Les habitants de Saverne apportent aux troupes des victuailles et des boissons, vin et bière.
Louis Lebeau. Carnet de notes du sous-lieutenant au 68° RI. SHAT : l k T 133 Sélectionné par Jean-François Lecaillon. Été 1870 La guerre racontée par les soldats. Bernard Giovanangeli Paris 2003
9 08 1870
Certains n’auront connu que la débandade : Voilà six jours que nous marchons jour et nuit ou que nous nous battons sans vivres ni subsistance aucune. Je ne sais pas comment les hommes tiennent debout. Nous sommes partis hier, ou plutôt cette nuit, de Sarrebourg, à minuit, et il faut que nous soyons demain soir à Metz ou à Nancy : c’est cent kilomètres en deux jours. Encore si la route était libre ! Mais l’artillerie, les bagages, les impedimenta de toutes sortes nous précèdent et nous sommes obligés de marcher à raison d’un kilomètres par demi-heure. C’est plus fatiguant que de marcher vite.
Je suis navré mais je vais bien pour un homme qui ne s’est pas déshabillé depuis six jours, qui a perdu ses bagages, sa tente, qui couche en plein air avec la pluie sur le dos, sans même un caban à se jeter sur les épaules, sans un sac pour appuyer sa tête. Mon sac est resté sur le champ de bataille de Woerth.
Albert Duruy. Lettre à son père 9 août 1870. Tableaux de l’année tragique; anthologie de la guerre de 1870, d’après le récit des littérateurs, poètes, historiens, hommes de guerre, orateurs politiques et de la chaire, les correspondances et mémoires. Paris, Hachette et Cie, 1901. Sélectionné par Jean-François Lecaillon. Été 1870 La guerre racontée par les soldats. Bernard Giovanangeli Paris 2003
16 08 1870
C’est jour de foire à Hautefaye, en Dordogne. Un jeune noble du coin de 32 ans, Alain de Monéys, vient y chercher une génisse. Il habite près de Bretanges dans le domaine familial. Dans cette région ultra bonapartiste le cousin d’Alain de Monéys, Camille de Maillard, républicain convaincu, se moque des paysans en lançant un Vive la République à une foule en colère qui se retourne contre lui. Camille réussit à s’échapper, aidé de ses métayers mais la rumeur circule en ville que son cousin, Alain, est au village et qu’il est forcément aussi une vermine détournant l’argent des honnêtes paysans pour l’envoyer aux Prussiens. La rumeur enfle. Le jeune Alain va être pris et massacré par plus de 200 personnes qui, tout en allant boire à l’auberge, reviennent rouer de coups le jeune homme qui ne cesse de crier tout au long de son supplice Vive l’Empereur ! Rien n’y fera. Même le courage du curé et des métayers d’Alain de Monéys, ne permettront pas de le soustraire à une foule en transe, avide de sang et de sacrifice propitiatoire à même de conjurer la peur de l’envahisseur. Après avoir été frappé, sanglé comme un cheval, avoir pris des coups de bâtons, de fourches, de crochets de boucher, il sera finalement, alors qu’on assemble à la va-vite du bois et des meubles, brûlé vif sur la place du Lac desséché par des villageois de 14 à 60 ans.
La gnôle prise sur le zinc, qui désinhibe les réserves de tous ces solitaires pour donner le premier rôle à la convivialité propre à ces rencontres, ne peut suffire à elle seule à expliquer pareil déchaînement de violence tirée du fond des âges ; ces paysans étaient ultra bonapartistes probablement parce qu’ils avaient réalisé qu’il ne pouvait plus servir à rien d’être royaliste. Vengeance envers celui qu’ils estimaient avoir trahi ses origines ? Peur viscérale de l’ogre prussien ? Qui peut le savoir ? Le procès se tiendra à Périgueux en décembre 1871 : parmi les 19 inculpés, 4 seront condamnés à la peine capitale, et exécutés sur la place du village.
20 08 1870
Armée de Metz, impressions d’ambulance. Dans une grande ferme dite de Montigny-la-Grange, [un écart de la commune d’Amanvillers, de la communauté d’agglomération de Metz] se trouvaient cinq à six cents blessés abandonnés depuis plusieurs jours, sans vivres et sans soins (…) La cour était littéralement jonchée de blessés, les granges, les écuries en étaient remplies. Ils étaient là, étendus sur la paille, sur les fumiers, sur la terre nue, mutilés d’un ou de plusieurs membres, défigurés, saignants, implorants un peu d’eau ou de pain ; les tortures de la faim et de la soif faisaient taire chez eux la douleur des blessures. Il y en avait là depuis plusieurs jours ; nul n’avait été pansé, puisque les médecins militaires les avaient abandonnés pour suivre leurs régiments. Ironie amère d’hommes placés pour rester au chevet des blessés et qui partent avec des hommes valides ! Pardon, un d’entre eux était demeuré à son poste. Le docteur Liénart, du 98° de ligne, vint saluer notre arrivée (…) Quand notre désastre fut consommé et que l’armée s’éloigna, il resta, lui, jugeant que son poste ne pouvait être que là où il y avait des souffrances à alléger.
Anonyme Sélectionné par Jean-François Lecaillon. Été 1870 La guerre racontée par les soldats. Bernard Giovanangeli Paris 2003
30 08 1870
Défaite de Napoléon III déjà très diminué par la maladie, et Mac Mahon, à Sedan, face aux Prussiens commandés par Moltke. Napoléon III capitule le 2 septembre ; il est prisonnier : c’est la chute de l’Empire, mais la guerre continue. Ce n’est pas en contraignant les militaires au silence que l’on peut embrasser la victoire : Je rayerai du tableau d’avancement tout officier dont je verrai le nom sur une couverture de livre.
Arthur Rimbaud a 16 ans, et le génie est déjà là pour dire l’horreur de la guerre. Bien plus tard, Serge Reggiani le chantera :
C’est un trou de verdure où chante une rivière
Accrochant follement aux herbes des haillons
D’argent, où le soleil, de la montagne fière,
Luit ; c’est un petit val qui mousse de rayons.
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort : il est étendu dans l’herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme.
Nature, berce-le chaudement : il a froid !
Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Arthur Rimbaud. Le dormeur du val. 1870
31 08 1870
Bataille de Bazeilles où chaque camp perd 2 500 hommes. Alphonse de Neuville immortalisera dans Les dernières cartouches la défense de l’auberge Bourgerie, où l’on peut voir le commandant Arsène Lambert et une poignée d’hommes défendre la maison jusqu’à épuisement complet des munitions.
Mais pourquoi donc les dernières cartouches quand on en est au début d’une guerre ? L’industrie nationale, n’étant pas en mesure de satisfaire à la demande de l’armée, un marché avait été passé avec la manufacture belge de Herstal, sans avoir cherché à en connaître les actionnaires. Or le Kronprinz en était le principal, qui s’était empressé de faire en sorte que les commandes françaises n’arrivent pas à destination, et c’est ainsi que les munitions commandées en Belgique n’arrivèrent pas à temps à Sedan. Mais cela n’empêchera pas la Manufacture d’Herstal de présenter sa facture qui sera réglée par la III° République.
L’impératrice Eugénie fait évacuer par train spécial les collections de tableaux et dessins du Louvre, Joconde incluse ; destination : l’arsenal de Brest qui gardera le trésor pendant un an, au bout duquel, les risques encourus par la Commune ayant disparu, il reviendra à Paris.
2 09 1870
La santé défaillante de Jules Michelet ne lui permet pas de supporter le climat angoissant de la France : il part en Suisse puis à Florence, accompagné de son épouse.
Michelet se met, le 8 décembre, à écrire La France devant l’Europe, douloureuse protestation patriotique en faveur de la France, élevée par un apôtre de la fraternité des peuples, auprès des nations qui assistent indifférentes ou muettes à son écrasement. Achevé le 23 janvier, le livre imprimé à mesure, parut le 26 à Florence chez les frères Le Monnier. Ce travail acharné de 45 jours, et la nouvelle de la capitulation de Paris avaient anéanti Michelet. La fièvre le prend le 9 février. Il espère retrouver la santé à Pise, où il se rend le 7 mars ; mais là de nouvelles catastrophes viennent l’atteindre : la révolution de la Commune, la France se déchirant de ses propres mains. Il ne put y résister. Le 30 avril il était frappé d’une attaque d’apoplexie. Les soins dévoués et habiles de sa femme le relevèrent assez vite ; il put, le 13 mai, retourner auprès de ses amis de Florence. Mais le 22, à l’annonce des scènes terribles qui se passaient à Paris, il perdit, par une nouvelle attaque l’usage de la main droite et la parole. Ce fut miracle s’il put revenir à la santé, retrouver encore assez de forces et de vie pour achever, pendant les trois années qui suivirent, les trois volumes de son Histoire du XIX° siècle. Si ce miracle s’accomplit, ce fut avant tout grâce aux soins de sa femme, mais aussi grâce à ceux de ses amis de Florence, et à ce ciel qui toujours lui parlait de renaissance. Il quitta l’Italie pour la dernière fois le 23 juin 1871, pour achever de se guérir.
http://bibnum.enc.sorbonne.fr/omeka/files/original/4d272fb7821f983b9af9915dd2aea70f.pdf
Il mourra à Hyères le 9 février 1874. Jules Simon, ministre de l’Instruction publique du 4 septembre 1870 au 18 mai 1873 n’avait rien fait pour arranger les choses quand il avait décidé de ne pas le rétablir dans sa chaire du Collège de France.
4 09 1870
Les Parisiens ont appris la veille la défaite de Sedan et manifestent aux portes de la Chambre des Députés, défendue sans conviction aucune par des sergents de ville et des gardes de Paris. La Chambre finit par être envahie par la foule, le Sénat quant à lui, se disperse de lui-même : le pouvoir tombe et Jules Favre [grand père de Jacques Maritain] proclame la République qui sera gouvernée jusqu’en février 1871 sous le régime d’un gouvernement de la Défense Nationale, présidé par le général Trochu (dont Hugo dira que c’est le participe passé du verbe trop choir – il aurait mieux fait de s’abstenir… ça fleure bon le potache –). Léon Gambetta est ministre de l’Intérieur :
Citoyens,
Attendu que la patrie est en danger
Attendu que tout le temps nécessaire a été donné à la représentation nationale pour prononcer la déchéance
Attendu que nous sommes et que nous constituons le pouvoir régulier issu du suffrage universel libre ;
Nous déclarons que Louis Napoléon Bonaparte et sa dynastie ont à jamais cessé de régner sur la France
Il va instaurer un moratoire sur les loyers parisiens.
Je demande pour les religions le droit à l’outrage.
Jules Simon, ministre de l’Instruction publique, des cultes et des beaux arts
Clemenceau et quelques autres députés républicains, pour punir la Corse d’avoir voulu rester fidèle aux Bonaparte, demandent qu’elle soit rendue à l’Italie : la demande ne sera pas examinée. Les troupes françaises en poste à Rome pour y garantir le maintien du pape sont rappelées en France.
Selon l’imagerie d’Épinal, le 4 septembre 1870, comme le phénix renaissant de ses cendres, la République s’impose à la France pour sauver la patrie. En fait, aux républicains du Corps législatif – et à Gambetta lui-même – cet élan lyrique faisait défaut. Ces hommes que la défaite de Sedan projette sur le devant de la scène [Jules Favre, Gambetta, Trochu, Adolphe Thiers…] sont des libéraux qui aspirent à une république modérée légalement établie : l’horreur d’une république née de l’insurrection du gouvernement révolutionnaire de l’an II et de tous ses excès, [avec au premier rang Auguste Blanqui] ils veulent l’éviter à tout prix. De surcroît, s’ils poursuivent la lutte en leur nom, une défaite définitive des armées françaises discréditerait de façon irréparable le régime républicain.
Michel Winock. L’Histoire n° 469 mars 2020
Napoléon III, prisonnier de la Prusse quitte Sedan pour le château de Wilhelmshöhe où il arrivera le lendemain ; il en partira en mars 1871, pour rejoindre Eugénie et son fils à Chileshurst, en Angleterre.

Dans son exil en Angleterre, il était probablement le plus connu, mais les gens de peu, – des Communards – quand ils n’avaient pas été déportés en Nouvelle Calédonie, s’étaient aussi exilés en Angleterre :
Sous le ciel crachotant, les voici qui ont affronté le roulis de la mer et qui arrivent ; il y a eu des marchands, des musiciens, des philosophes, des révolutionnaires ; il y a eu des Allemands, des Italiens, des Russes, des Tchèques et des Polonais misérables ; il y a eu des Français, des huguenots fuyant les guerres de religion, des protestants fuyant de nouvelles persécutions, des aristocrates fuyant la Révolution française, des bonapartistes fuyant la Restauration, des républicains fuyant la République marâtre de 48 puis l’Empire sans fils légitime ; et maintenant les voici, plus misérables encore que les réfugiés polonais, après les exilés, les émigrés, les proscrits, ce sont les fugitifs français qui posent le pied sur le sol londonien, affamés, éperdus et perdus, sales et las, et deviennent des réfugiés.
Michèle Audin. Josée Meunier, 19, rue des Juifs. Gallimard 2021
5 09 1870
Onze hommes arrivent au sommet du Mont Blanc, à 14 h ; ils sont rapidement pris par une tempête qui va durer huit jours. Le 17 septembre, Sylvain Couttet découvrira au sommet du mur de la Côte – au sud du Col de la Brenva, c’est alors la voie normale – cinq corps. Sur celui de l’américain Jos Bean, un carnet de notes faisant ses adieux à sa femme, indique une mort probable le 7 septembre au soir. Les six autres corps ne seront jamais retrouvés.
Le Comité central républicain des 20 arrondissements commence à siéger rue de la Corderie. C’est un autre pouvoir qui se met en place. Le gouvernement n’est pas décidé à la lutte, mais le peuple de Paris, fort des 380 000 hommes qui constituent la garde nationale, dirigée par le Comité central, réclame la guerre à outrance. Victor Hugo revient à Paris.
9 09 1870
Victor Hugo lance un appel de fraternité aux Allemands : Il me convient d’être avec les peuples qui meurent, je vous plains d’être avec les rois qui tuent.
19 09 1870
Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, sans autre mandat précis, négocie avec Bismarck les conditions d’une armistice ; cela se passe au château de Ferrières, 20 km à l’est de Paris. Les extraits suivants sont la publication par le Journal Officiel du journal qu’il a tenu pendant ces journées. L’homme est très ému, le dit, le répète, mais sa sincérité ne va pas jusqu’à mentionner l’énormité de la bourde qu’il commet, oubliant purement et simplement le sort réservé à Belfort ainsi qu’à l’armée de l’Est, celle du général Bourbaki, qui abandonnée, oubliée par le gouvernement, pas par les Prussiens, va perdre 33 000 des 120 000 hommes qu’elle comptait pour finalement passer en Suisse, sauvant ainsi les 87 000 hommes restant. La monumentale bourde ne lui valut qu’une monumentale colère de Gambetta, ce qui n’est pas cher payé.
Malgré ma répugnance, je me déterminai à user des bons offices qui m’étaient offerts, et, le 10 septembre, un télégramme parvenait à M. de Bismarck, lui demandant s’il voulait entrer en conversation sur les conditions de transaction, une première réponse était une fin de non recevoir tirée de l’irrégularité de notre gouvernement. Toutefois le chancelier de la Confédération du Nord n’insista pas, et me fit demander quelles garanties nous présentions pour l’exécution d’un traité.
Quelques échanges s’ensuivent et l’affaire est entendue. Le gouvernement n’est toujours pas averti, mais il y a eu des fuites et un journal annonce cette préparation. Quant à Jules Favre, il se promène, à Charenton, à Villeneuve-Saint-Georges, et finalement, c’est à Meaux que Bismarck lui demande de venir le voir le 18 septembre.
À neuf heures, l’escorte était prête, et je partais avec elle. Arrivé près de Meaux vers trois heures de l’après-midi, j’étais arrêté par un aide de camp venant m’annoncer que le comte [de Bismarck] avait quitté Meaux avec le roi pour aller coucher à Ferrières. Nous nous étions croisés. En revenant l’un et l’autre sur nos pas nous devions nous rencontrer. Je rebroussai chemin, et descendis dans la cour d’une ferme entièrement saccagée comme presque toutes les maisons que j’ai vues sur ma route. Au bout d’une heure, M. de Bismarck m’y rejoignait. Il nous était difficile de causer dans un tel lieu, Une habitation, le château de la Haute-Maison, appartenant à M. le comte de Rillac, était à notre proximité; nous nous y rendîmes. Et la conversation s’engagea dans un salon où gisaient en désordre des débris de toute nature.
Après lui avoir dit que Strasbourg est la clef de la maison et qu’il la lui faut, Bismarck dit alors
que les deux départements du Bas et du Haut-Rhin, une partie de celui de la Moselle avec Metz, Château-Salins et Soissons lui étaient indispensables, et qu’il ne pouvait y renoncer.
Même si les populations concernées ne le souhaitent pas.
Nos politiciens vont coucher au château de Ferrières. Et reprennent la discussion le lendemain (nous sommes donc alors le 19 septembre). Bismarck a mis ses conditions par écrit, en allemand, mais il a la bonté de les expliquer à Jules Favre.
Il demandait pour gage l’occupation de Strasbourg, de Toul et de Phalsbourg, et comme, sur sa demande, j’avais dit la veille que l’Assemblée devrait être réunie à Paris, il voulait, dans ce cas, avoir un fort dominant la ville… celui du mont Valérien, par exemple…
Jules Favre parle alors de réunir l’Assemblée à Tours, et que les Prussiens ne prennent aucun gage du côté de Paris.
Il m’a proposé d’en parler au roi, et, revenant sur l’occupation de Strasbourg, il a ajouté: La ville va tomber entre nos mains, ce n’est plus qu’une affaire de calcul d’ingénieur. Aussi je vous demande que la garnison se rende prisonnière de guerre. À ces mots j’ai bondi de douleur, et, me levant, je me suis écrié : Vous oubliez que vous parlez à un Français, monsieur le comte.
Bref, les larmes étouffent Jules Favre. Il rentre à Paris. Et il s’inspire du cœur de la France, dit-il, pour écrire à Bismarck la dépêche qui suit:
Monsieur le comte,
J’ai exposé fidèlement à mes collègues du gouvernement de la défense nationale la déclaration que Votre Excellence a bien voulu me faire. J’ai le regret de faire connaître à Votre Excellence que le gouvernement n’a pu admettre vos propositions. Il accepterait un armistice ayant pour objet l’élection et la réunion d’une Assemblée nationale. Mais il ne peut souscrire aux conditions auxquelles Votre Excellence le subordonne. Quant à moi, j’ai la conscience d’avoir tout fait pour que l’effusion du sang cessât, et que la paix fût rendue à nos deux nations pour lesquelles elle serait un grand bienfait. Je ne m’arrête qu’en face d’un devoir impérieux, m’ordonnant de ne pas sacrifier l’honneur de mon pays déterminé à résister énergiquement. Je m’associe sans réservé à son vœu, ainsi qu’à celui de mes collègues. Dieu, qui nous juge, décidera de nos destinées. J’ai foi dans sa justice.
J’ai l’honneur d’être, monsieur le comte, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur,
JULES FAVRE. 21 septembre 1870.
Quand, il vit se fermer toute issue pacifique, M. Jules Favre se sentit étouffé par les larmes. Généreuse et sainte émotion! De même qu’autrefois, au temps de Froissart, il y avait grand’pitié au royaume de France, que les Anglais envahissaient, de même aujourd’hui nous ne pouvons songer, sans être émus, aux flots de sang que va faire couler encore la brutale avidité des Prussiens ; mais c’est une émotion qui, loin d’affaiblir les courages, les excite et inspire les mâles résolutions, émotion virile, comme celle que nous éprouvons quand nous voyons sur la place de la Concorde la statue de Strasbourg surchargée d’immortelles.
Le texte, en caractères droits, hors Journal de Jules Favre, est celui du journaliste du Journal des débats.
*****
Début du siège de Paris. L’idée du ballon monté vint du photographe Nadar ; elle va être mise en œuvre par l’ingénieur du génie maritime Dupuy de Lôme qui parvient à faire sortir 67 ballons de la capitale : dans l’un d’eux, le 7 octobre se trouve Gambetta. Il était plus facile de quitter Paris en ballon que d’y arriver : aussi avait-on mis au point des boules de Moulins pour y apporter le courrier : on confia à la Seine des boules étanches en zinc pouvant contenir 500 lettres, en espérant que le courant les porterait jusqu’aux filets qui barraient la Seine à Paris. Sur les 55 boules qui furent ainsi expédiés aucune n’arriva. 35 boules furent retrouvées envasées, la dernière en 1982 ; il en reste donc encore 20. Elles ont été baptisées boules de Moulins car le courrier à destination de la capitale était centralisé à Moulins. Donc, pour des messages de grande importance, le pigeon était encore le meilleur moyen de communiquer. Nadar était aussi une plume :
Une vague, lointaine rumeur, semble vouloir rompre le charme de notre ravissement muet ; […] et, tout d’un coup, comme par la subite déchirure d’une voile, apparaît sous nous un immense foyer de lumière. C’est encore Paris ! Paris la nuit ! […]. Et nous descendons si bas que nous rasons les toits fumeux sous lesquels tout cela veille ou rêve, les assouvis et les affamés […] les vaincus et les forts, les féroces et les niais ; ce qui pense et ce qui digère : toutes les félicités menteuses de l’heure présente et toutes les détresses, le cri du nouveau-né et les affres du mourant, […], fausses joies et désespoirs sombres, chimères, trahisons, fiels et venins… Mais un souffle du vent qui se lève nous emporte loin de ces misères […] Tout fuit sous nous, lumière et bruit… […] – et nous poursuivons notre vol, au hasard, par le sombre infini.
Félix Nadar. Le Dessus et le Dessous de Paris. Paris-Guide de 1868
Victor Hugo, volontairement enfermé dans Paris, publie son appel :
Aux Français
La France doit à tous les peuples et à tous les hommes de sauver Paris,
non pour Paris, mais pour le monde.
Ce devoir, la France l’accomplira.
Que toutes les communes se lèvent !
Que toutes les campagnes prennent feu !
Que toutes les forêts s’emplissent de voix tonnantes !
Tocsin ! Tocsin !
Que de chaque maison il sorte un soldat ;
Que le faubourg devienne régiment ;
Que la ville se fasse armée.
Les Prussiens sont 800 000,
Vous êtes 40 millions d’hommes (…)
Faisons la guerre de jour et de nuit,
La guerre des montagnes, la guerre des plaines.
Levez-vous ! Levez-vous !
Pas de trêve, pas de repos, pas de sommeil.
Le despotisme attaque la liberté, l’Allemagne attente à la France…
Ô francs-tireurs, allez, traversez les halliers, passez les torrents,
Profitez de l’ombre et du crépuscule, serpentez dans les ravins,
Glissez-vous, rampez, ajustez , tirez, exterminez l’invasion.
Défendez la France avec héroïsme, avec désespoir, avec tendresse.
Soyez terrible, ô patriotes !
Arrêtez-vous seulement, quand vous passerez devant une chaumière,
Pour baiser au front un petit enfant endormi.
20 09 1870
La défaite de Napoléon III a entrainé la fin du soutien de la France à la papauté et les Italiens mettent à profit la situation livrer les batailles de l’Agro romano. Emmanuel II peut engager les troupes de Rafaelle Cardona contre les troupes des États Pontificaux, bien maigrichonnes après la défection de la France. Les bersaglieri du général de La Marmora entrent dans Rome : c’est la fin du pouvoir temporel du pape sur une partie non négligeable de l’Italie. La monarchie italienne achevait son unité. Le pape se considérera désormais prisonnier du gouvernement italien au Vatican. Il faudra attendre Mussolini pour que soient normalisées les relations entre le Saint Siège et le gouvernement italien le 11 février 1929 !
De bons serviteurs de l’Église s’étaient inquiétés dès 1862, de l’éventualité de cette annexion du principal des États Pontificaux par l’Italie, et donc, du transfert des ressources que procurait ces États – impôts divers – vers le budget italien. François Xavier de Mérode un Belge très futé fit acheter par les Société immobilière du Vatican les terrains de l’actuelle gare de Rome-Termini : on était alors sur des terrains qui n’étaient que de la roupie de sansonnet, mais le belge perspicace avait deviné que Rome ne pourrait s’agrandir que sur ces terrains : la plus value réalisée des années plus tard, lors de leur revente marque le début du trésor du Vatican.
26 09 1870
Les bombardements prussiens mettent le feu à la cathédrale de Strasbourg. En 1873, l’architecte Gustave Klotz veillera à lui redonner son aspect d’origine en reconstruisant la couverture en cuivre et la charpente en bois. Depuis 1998, celle-ci se divise en tronçons séparés par des murs en béton pour éviter la propagation du feu.

L’Aubette (bâtiment militaire bordant la place Kleber) sous les flammes.


11 10 1870
Pierre Cara, blessé sous Orléans, est fait prisonnier. Il s’évadera et rejoindra l’armée de Chanzy. Pierre Cara, c’est le nom qu’a choisi Petar Karađorđević, d’une dynastie royale serbe. L’assassinat du roi de la dynastie rivale le portera au pouvoir en 1903 : il deviendra Pierre I° de Serbie. Il avait fait St Cyr en tant qu’étranger de 1862 à 1864, et s’était engagé au 5° bataillon de la Légion Étrangère en 1870.
Léon Gambetta arrive à Tours, où il trouve Garibaldi (!), toujours disponible pour une juste cause. Il lui propose le commandement de quelques centaines de volontaires en Savoie. Garibaldi fait la fine bouche… Ce sera alors le commandement de tous les corps francs des Vosges, de Strasbourg à Paris, et d’une brigade de gardes mobiles. Garibaldi installera son Quartier Général à Dole, puis Autun. Perclus de rhumatismes, il confia l’essentiel des actions à son gendre Ricciotti, qui fit souffrir les Prussiens le 19 novembre à Chatillon-sur-Saône. Ayant occupé Dijon, ils repoussèrent les Prussiens qui voulaient les en déloger le 21 janvier 1871, s’emparant même du drapeau du 61° régiment de Poméranie, le seul que les Prussiens perdirent durant toute la guerre !
Les avis sur sa prestation seront loin d’être unanimes : Lorsque Garibaldi arriva à Tours, aucun officiel n’était présent à la gare. Un logis misérable suintant l’humidité attendait celui qui se donnait à la République malgré ses rhumatismes. Honteux, le comité d’accueil prit l’initiative de l’installer à la préfecture en délogeant le préfet. Mais le héros ne perdit rien de sa superbe et sut électriser un petit auditoire venu entendre des paroles d’espoir.
[…] Il parla. Du haut de cette tribune improvisée, sa voix claire, vibrante, sans embarras, s’animait quand il parlait de république et de liberté ! On l’écoutait en silence. Il semblait que sa venue présageait le succès prochain […]. Garibaldi parle bien le français ; c’ est par une coquetterie de vieillard qu’il s’excuse. Sa figure grandiose et calme respire un air de franche simplicité, de bonhomie triste. Son œil brille d’un feu doux qui s’éclaire quand il parle. Il a vraiment grand air avec sa chemise rouge, son vaste manteau gris perle blé de rouge et théâtralement relevé sur l’épaule, son chapeau de feutre mou, d’où s’échappent les mèches blanches de ses longs cheveux flottant sur le cou, sa barbe blanche négligée, sa physionomie pensive, non dénuée de finesse. Les mains sont belles, les jambes sont grosses, lourdes, impotentes, enveloppées d’un grossier pantalon trop large, des chaussés de souliers informes déparent le tableau. Il faut voir Garibaldi à cheval un jour de bataille, fièrement campé sur sa selle, qu’il ne quitte pas tant que dure le danger.
G. Cavalier, Les Mémoires à Pipe-en-bois, Champvallon, Seyssel
[…] Le teint mat à peine rosés par la froidure font bien sous la casquette rouge. La chemise de flanelle de même couleur, à parements et à cols noirs, entre dans le pantalon gris enfermé dans des guêtres de cuir ; une ceinture bleue roulée autour de la taille, un élégant petit manteau gris, complètent ce costume plein de coquetterie […]. Une nuée d’officiers papillonnent autour de cette brillante jeunesse. Ils sont tellement attifés, bichonnés, pomponnés, qu’il faut regarder à plusieurs reprises […] pour bien se convaincre que ce sont des soldats […]. À côté se rangent d’autres troupes qui n’ont guère que le costume de commun. Les visages sombres, les traits flétris, les types de bandits, les figures de sac et de corde y abondent et prennent, sous la chemise rouge, une expression d’oiseaux de proie, de hyènes en quête de cadavres.
[…] Garibaldi pouvait se glorifier d’avoir transformé une ville honnête [Autun] en un bagne où les forçats [les volontaires garibaldiens] étaient les maîtres. Retiré dans ses appartements, enfoui sous des couvertures […], il languissait tout le jour, oisif, indolent, l’intelligence obscurcie, presque éteinte, et ne sortait de sa stupeur, ne retrouvait une étincelle de vie, que pour applaudir à ces abominateurs, pour vomir une insulte nouvelle contre la religion et les meilleurs citoyens. Il n’a jamais cessé d’être l’ennemi acharné de notre pays, il est venu pour organiser l’armée du désordre, enrôler les coquins, les conduire au pillage, au sac de la France, et compléter l’œuvre de l’Allemagne ; soit qu’une convention expresse le liât à M. de Bismarck, soit plutôt qu’il se contentât d’agir pour le compte de l’Internationale et de la franc-maçonnerie cosmopolite, qui depuis Frédéric le Grand reçoit son mot d’ordre de Berlin. Révolutionnaire dont l’orgueil insensé côtoyait la folie, sectaire sans patrie, insulteur même de ses concitoyens, complaisant pour le piétiste Guillaume, auxiliaire de Bismarck, homme de Cavour, pensionné de Victor-Emmanuel, il n’a eu de la démocratie que le masque. Mais il était un démagogue habile, déclamateur et théâtral, excellent imprésario de son funeste personnage.
Theyras, Garibaldi en France, Autun, 1888.
Quant à Garibaldi, ces attaques répétées des 21 et 23 janvier lui ont fait croire qu’il avait devant lui d’importantes forces allemandes. Il s’est borné à une défense prudente : c’est en termes dithyrambiques qu’il chante ses succès. Résultat : les désastres de l’armée de l’Est. L’erreur est humaine, dira-t-on, elle n’est pas une faute. Le crime n’est pas là, il consiste en ce que Garibaldi, ayant reçu l’ordre de rejoindre l’armée de l’Est, ne l’a pas rejointe. Exécuter l’ordre, il n’y a pas songé. Ce sont des vues personnelles, la recherche de succès propres, qui ont dicté sa conduite. S’il avait cherché à obéir, aucune impossibilité matérielle ne l’en eût empêché : la division Pélissier maintenue à Dijon suffisait à absorber l’activité du général de Kettler ; l’armée des Vosges pouvait librement rejoindre l’armée de l’Est. D’où le désastre par la même voie : l’indiscipline intellectuelle, l’oubli du devoir militaire, au sens le plus exact du mot. La satisfaction donnée à ce devoir, dans un cas comme dans l’autre, ne présentait aucune difficulté, mais il fallait le connaître, pour cela le chercher ; il fallait avoir le sentiment de la discipline. Éviter l’erreur, la faute, empêcher le désastre ; tout était obtenu par un simple acte d’obéissance.
Ferdinand Foch (le futur maréchal de 1918). Conférence à l’École supérieure de guerre parue en avril 1903
28 10 1870
Les Prussiens prennent Le Bourget et Bazaine, bloqué dans Metz, se rend, livrant 170 000 hommes, 6 000 officiers, 1 400 canons et 250 000 fusils aux Allemands. On parlera de trahison de Bazaine. Bonapartiste, il soutenait à contre-cœur un régime républicain et avait négocié secrètement avec Bismarck et Eugénie dès septembre. Il sera condamné à mort par un conseil de guerre le 10 décembre 1873, peine commuée aussitôt en 20 ans de forteresse.
29 10 1870
Le peintre Gustave Courbet, affiche son pacifisme en écrivant aux Allemands : Laissez-nous vos canons Krupp : nous les fondrons avec les nôtres. Le dernier canon, gueule en l’air, coiffé du bonnet phrygien, planté sur un piédestal que nous érigerons ensemble sur la place Vendôme, sera notre colonne, à nous et à vous, la colonne de l’Allemagne et de la France à jamais fédérées.
Lettre ouverte à l’armée allemande et aux artistes allemands
Il avait refusé la Légion d’honneur dont Napoléon III aurait voulu le décorer : Souffrez donc, Monsieur le Ministre, que je décline l’honneur que vous avez cru me faire. J’ai 50 ans et j’ai toujours vécu libre. Laisse-moi terminer mon existence, libre.
31 10 1870
Le peuple de Paris apprend l’échec de la sortie du Bourget, la capitulation de Metz et l’ouverture des négociations : la foule envahit l’Hôtel de Ville, retenant le gouvernement prisonnier. Les gardes nationaux demandent sa déchéance aux cris de Vive la Commune. Un compromis est trouvé dans l’organisation d’un référendum, trois jours plus tard, qui devra répondre à la question : La population de Paris maintient-elle, oui ou non, les pouvoirs du gouvernement de la Défense Nationale ? Le Oui l’emportera, avec 557 996 voix, mais il y aura quand même 62 638 Non, lesquelles vont former l’ébauche de la Commune. Le refus du verdict du suffrage universel sera la marque de naissance de la Commune. Le garde des Sceaux Isaac Moïse Crémieux, alias Adolphe Crémieux s’écriera : Majorité de ruraux, honte de la France. Le Corrézien, quotidien régional, se risquera à publier sans signature les vers fielleux d’un ancien communard :
Le troupeau d’électeurs, de paysans stupides
Que nul sentiment ne peut aiguillonner,
Ce peuple de lourdauds, de hobereaux cupides,
Veut tenter, Ô Paris, de te découronner.
Sujets du Sous-préfet et du Garde-champêtre,
Dociles à la voix du Maire et du curé,
Gros ruminants, pareils aux bœufs qu’ils mènent paître,
Blasphèment bêtement ton grand nom vénéré.
Ces paysans stupides garderont longtemps encore le goût de la religion, c’est à dire, qu’à cette époque, ils resteront dociles à la voix du Maire et du curé, et ne se cacheront pas pour le dire, en accord en cela avec les chrétiens de Paris qui construiront le Sacré-Cœur de Montmartre. On peut lire ainsi à Saint Véran, en Queyras, sur un vœu figurant au bas d’un calvaire de mission une adresse au révolté qui n’est jamais content. Le révolté qui n’est jamais content, cela englobe la classe ouvrière naissante, les premiers syndicats, les premiers mouvements ouvriers, … tous ceux qui refusent de se satisfaire désormais de leur sort, et donc refusent la consigne globale de l’Eglise : acceptez de bon cœur le sort qui vous est fait, la révolte, c’est le mal, l’obéissance, c’est le salut.

à Saint Véran, dans le Queyras
Adolphe Crémieux donnera son nom, au décret du 24 octobre accordant la citoyenneté française aux 35 000 juifs algériens, leur ouvrant les portes de l’école de la République, puis de l’administration : ils vont ainsi se détacher de la communauté musulmane, qui n’avait pas renoncé à la loi coranique et était donc restée illettrée et algérienne. Les Juifs ne viennent pas tous d’une immigration récente, le plus souvent européenne, car nombre d’entre eux sont des berbères, convertis d’une part par les Juifs qui ont quitté les rives du Nil pour la Cyrénaïque vers ~900, puis par ceux qui accompagnaient les Phéniciens qui avaient fondé Carthage vers ~300, d’autre part par premiers Juifs qui ont fui Israël après la destruction du temple de Jérusalem, par Titus en 70. Des armées juives avaient vaincu les Romains en Cyrénaïque pour être in fine repoussées vers les Aurès. Les Berbères forment le peuplement le plus ancien de l’Afrique du Nord.
5 11 1870
Début du siège de Belfort, français depuis 1636, défendu par Denfert Rochereau ; aux Prussiens qui le sommaient de se rendre, il répondit très militairement : Nous connaissons l’étendue de nos devoirs envers la France et envers la République et nous sommes décidés à les remplir. Sur ordre du gouvernement, il évacuera Belfort après cent trois jours de siège, le 18 02 1871. Cette résistance sera reconnue par les Prussiens qui n’annexeront pas la ville : c’est l’origine du Territoire de Belfort, constitué en 1922. De 1871 à 1918, Belfort sera la partie restée française du département du Haut Rhin. La ville s’était déjà fait remarquer quand, en 1815, le lieutenant général Lecourbe défendit la Haute Alsace pied à pied contre l’invasion et conserva Belfort à la France. En mémoire de la résistance de Denfert Rochereau et de ses troupes, Bartholdi – qui réalisera la statue de la Liberté, dans la baie de New York -, se mit à sculpter dès 1875 un Lion dans les grès rouges sur lesquels sont assises les fortifications de Belfort.
Emil du Bois-Raymond, recteur de l’université de Berlin cadre l’éducation allemande : Nous, l’Université de Berlin, sise face au palais royal, sommes, par notre acte de fondation, le garde du corps intellectuel de la maison de Hohenzollern. Si Emil du Bois-Raymond voulait préparer le terrain aux nazis, il ne pouvait mieux dire ! Il suffira de remplacer Hohenzollern par Hitler !
Theodor Mommsen, historien allemand de l’Antiquité, réclame l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine du Nord en se référant aux similitudes culturelles. Son collègue français, Fustel de Coulanges, lui répond : Vous croyez avoir prouvé que l’Alsace est de nationalité allemande, parce que sa population est de race germanique et parce que son langage est allemand. Mais je m’étonne qu’un historien comme vous affecte d’ignorer que ce n’est ni la race, ni la langue qui fait la nationalité. […]
Ce qui distingue les nations, ce n’est ni la race ni la langue.
Les hommes sentent dans leur cœur qu’ils sont un même peuple lorsqu’ils ont une communauté d’idées, d’intérêts, d’affections, de souvenirs et d’espérances. Voilà ce qui fait la patrie. Voilà pourquoi les hommes veulent marcher ensemble, ensemble travailler, ensemble combattre, vivre et mourir les uns pour les autres. La patrie, c’est ce qu’on aime. Il se peut que l’Alsace soit allemande par la race et par le langage. Mais par la nationalité et le sentiment de la patrie, elle est française. Et savez-vous ce qui l’a rendue française ? Ce n’est pas Louis XIV, c’est la Révolution de 1789.
Fustel de Coulanges. L’Alsace est-elle allemande ou française ?
10 11 1870
Léon Gambetta, partisan de la guerre à outrance avait voulu préparer une contre offensive en mettant en place onze camps militaires, occupés par des armées nouvelles. Gambetta était parvenu à mobiliser 600 000 hommes, auxquels venaient s’ajouter les 150 000 restant du début de la guerre. Les Prussiens étaient aux portes d’Orléans et la désorganisation générale.
Le général Émile de Kératry, convaincu lui aussi du bien-fondé de la poursuite de la guerre, avait été nommé à la tête de l’armée de Bretagne le 22 octobre et, pour venir en appui de l’armée de la Loire, il avait été chargé d’établir à la hâte un camp à Conlie, sur la butte de la Jaunelière, dans la région du Mans [Sarthe], affecté à la formation, et d’y rassembler les mobilisés et les volontaires de l’ouest de la France pour y former une armée de Bretagne. Le contingent mobilisable des cinq départements bretons était, à lui seul, de 80 000 hommes.
Ce camp pouvait accueillir 50 000 hommes et 25 000 hommes s’y trouvaient dès le 10 novembre. Près de 60 000 hommes y seront passé au total et il avait été prévu de les armer avec les surplus de la guerre de Sécession américaine (1861-1865), lesquels surplus promis par Gambetta n’étaient pas parvenus à destination. À l’arrivée des mobilisés, les baraquements n’ayant pas été construits, des tentes avaient été établies en urgence. Comme le terrain avait été nivelé un peu plus tôt, le piétinement de milliers d’hommes en avait fait rapidement un bourbier. Des pluies torrentielles l’avaient inondé que les soldats avaient surnommé Kerfank – la ville de boue -. Avec les premières neiges, les maladies s’étaient développées : fièvre typhoïde, variole, etc.
Est-ce bien un camp ? C’est plutôt un vaste marécage, une plaine liquéfiée, un lac de boue. Tout ce qu’on a pu dire sur ce camp trop célèbre est au-dessous de la vérité. On y enfonce jusqu’aux genoux dans une pâte molle et humide. Les malheureux mobiles se sont pourvus de sabots et pataugent dans la boue où ils pourraient certainement faire des parties de canots. Ils sont là quarante mille nous dit-on et, tous les jours, on enlève 500 ou 600 malades. Quand il pleut trop fort, on retrouve dans les bas-fonds des baraquements submergés. Il y a eu ces jours derniers quelques soldats engloutis, noyés dans leur lit pendant un orage.
Gaston Tissandier, de passage le 15 décembre 1870
Le manque d’instructeurs, prisonniers en Allemagne, de matériel, de ravitaillement, provoquent le découragement au sein d’une troupe pourtant largement constituée de volontaires mais livrés à l’oisiveté et à l’ennui. Kerartry avait informé Gambetta à plusieurs reprises, qui s’était refusé à l’évacuation. La polémique avait commencé à faire rage et le général de Kérartry avait démissionné, remplacé par le général de Marivault qui avait ordonné immédiatement une première évacuation, contre les ordres de Gambetta, qui ne signera la première autorisation que quelques jours plus tard, le 19 décembre 1870. Dès le lendemain, les 15 000 soldats les plus faibles s’étaient replié sur Rennes, les plus malades renvoyés dans leurs familles. Le scandale prend plus d’ampleur, devant l’état des hommes qui rentrent chez eux. Une commission d’enquête parlementaire sera nommée, dont les conclusions, rédigées en 1872, seront publiées en 1874. Le général de Lalande déclarera devant elle : Je crois que nous avons été sacrifiés. Pourquoi ? Je n’en sais rien. Mais j’affirme qu’on n’aurait pas dû nous envoyer là, parce que l’on devait savoir que nous n’étions pas armés pour faire face à des troupes régulières. Inutile de dire que les Bretons ne portent pas Gambetta dans leur cœur et que l’une des premières mesures prises lors de manifestations d’indépendance sera de débaptiser un boulevard Gambetta.
Sous-préfet de Chateaulin de 1930 à 1933, Jean Moulin illustrera le recueil Armor de Tristan Corbière, publié en 1935, avec la La Pastorale de Conlie, sous son nom d’artiste : Romanin. S’il ne paraît pas avoir fait un gros travail d’archives, puisqu’il y met une femme au centre, alors qu’il n’a pas eu de femme à Conlie, l’atmosphère générale du dessin tient de la prescience des camps de la mort des nazis. http://art-maniac.over-blog.com/article-jean-moulin-peintre-et-marchand-d-art-69640402.html
16 11 1870
En Espagne, les Cortes élisent roi le duc Amédée d’Aoste.
25 11 1870
Sous le pseudonyme de Jean Baudry, Arthur Rimbaud écrit dans Le Progrès des Ardennes, Le rêve de Bismarck, qu’il qualifie de Fantaisie.
C’est le soir. Sous sa tente, pleine de silence et de rêve, Bismarck, un doigt sur la carte de France, médite ; de son immense pipe s’échappe un filet bleu. Bismarck médite. Son petit index crochu chemine, sur le vélin, du Rhin à la Moselle, de la Moselle à la Seine ; de l’ongle, il a rayé imperceptiblement le papier autour de Strasbourg : il passe outre. À Sarrebruck, à Wissembourg, à Woerth, à Sedan, il tressaille, le petit doigt crochu : il caresse Nancy, égratigne Bitche et Phalsbourg, raie Metz, trace sur les frontières de petites lignes brisées, – et s’arrête…
Triomphant, Bismarck a couvert de son index l’Alsace et la Lorraine ! – Oh ! sous son crâne jaune, quels délires d’avare ! Quels délicieux nuages de fumée répand la pipe bienheureuse !
Bismarck médite. Tiens, un gros point noir semble arrêter l’index frétillant. C’est Paris.
Donc, le petit ongle mauvais, de rayer, de rayer le papier, de ci, de là, avec rage, – enfin de s’arrêter… Le doigt reste là, moitié plié, immobile.
Paris ! Paris ! – Puis, le bonhomme a tant rêvé l’œil ouvert, que, doucement, la somnolence s’empare de lui : son front penche vers le papier ; machinalement, le fourreau de sa pipe, échappée à ses lèvres, s’abat sur le vilain point noir …
Hi ! povero ! en abandonnant sa pauvre tête, son nez, le nez de M. Otto de Bismarck, s’est plongé dans le fourneau ardent… Hi ! povero ! Va povero ! dans le fourneau incandescent de la pipe…, Ho povero ! son index était sur Paris ! … Fini, le rêve glorieux !
Il était si fin, si spirituel, si heureux, ce nez de vieux premier diplomate ! – Cachez, cachez ce nez ! …
Eh bien ! mon cher, quand, pour partager la choucroute royale, vous rentrerez au palais [sur l’exemplaire du Progrès des Ardennes, les dernières lignes étaient devenues illisibles en 2008].
Voilà ! Fallait pas rêvasser.
Jean Baudry Le Progrès des Ardennes du 25 novembre 1870
3 12 1870
Les troupes françaises sont battues à Orléans.
8 12 1870
La délégation du gouvernement qui s’était installée à Tours le 11 septembre, déménage à Bordeaux.
25 12 1870
Joyeux Noël ! Il manque juste du chien… qui se trouvait sur la carte d’autres restaurants …, à moins que, flairant qu’ils risquaient désormais de passer à la casserole, ils ne se soient mis à se cacher des humains.
J’ai mangé de tout, cheval, mulet, chat, chien, rat et j’ai trouvé le tout très bon. Je me promets (…) de vous faire manger des salmis de rats d’eau excellents…
Un interne des Hôpitaux de Paris
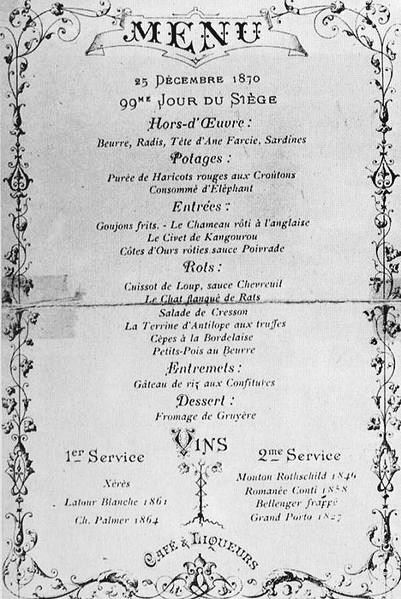
Café Voisin. 261, Rue Saint-Honoré. Paris
27 12 1870
Les Prussiens commencent à bombarder Paris. Victor Hugo est devenu un personnage sacré… on donne son nom à un ballon-poste, à un canon. Un autre canon dû à une souscription porte celui d’une de ses œuvres – Le Châtiment – Il écrira dans l’Année terrible : Nous mangions du cheval, du rat, de l’ours, de l’âne. Et, le 2 janvier 1871, il notait dans son Journal : On a abattu l’éléphant du Jardin des Plantes ; il a pleuré. Et l’éléphant ne fût pas le seul à connaître ce sort, il en alla de même pour les tigres, lions, girafes, chameaux et dromadaires et autres zèbres que l’on pouvait découvrir au jardin d’acclimatation, crée quelques années plus tôt par Napoléon III.

dessin de Victor Hugo
Le journal L’Illustration félicite les commerçants qui ne tirent pas profit de la situation – nombre d’entre eux ne s’en privent pas, faisant valser les étiquettes – . Les produits alimentaires Felix Pottin, la maison de conserve Chevallier-Appert, les établissements de bouillon Liebig, la maison des Deux Chinois ont droit à la gratitude du pays. Félix Potin réserve ses produits à ses clients, organise en leur faveur un système de rationnement et de répartition, à prix stabilisés. Et, quand vient le manque, il achète Castor, l’un des deux éléphants du Jardin d’acclimatation, qu’il fait abattre et débiter en tranches.
Jean-Michel Dumay. Le Monde Magazine 7 août 2010
La consommation d’absinthe augmentera de 500 %. L’usage médicinal de la plante existait depuis les Assyriens et les Babyloniens : appelée aussi alvine, elle est de la famille des armoises ou artémis, en l’honneur de la Diane grecque Artemis – qui signifie privé de douceur. On soignait ainsi les maux d’estomac, du foie et des reins, ainsi que les fièvres des régions marécageuses et même le mal de mer. Dans le Val d’Aoste on l’utilisait en cataplasme contre les vers chez les enfants, en bouquet dans les chalets pour éloigner les puces etc…
Pour couvrir les évidents méfaits de ses 72° et, plus précisément de la thuyone, une molécule convulsivante, désinhibitrice et même hallucinogène, on la coiffa de nombreuses vertus : elle donne de l’appétit, combat la colique et la jaunisse, éveille l’intelligence, enraye les fièvres… bref c’est la fée verte. Le succès ira croissant, et l’offre s’alignera très bien sur la demande : Pontarlier comptera quatre distilleries en 1826 et vingt cinq en 1913, produisant cinquante cinq mille litres d’absinthe … par jour ! Il y en a une aussi à Annecy dès 1903. En 1874, la production française était de 700 000 litres, elle sera de 36 000 000 litres en 1910 ! Pour la vodka Zubrowka, qui contient la fameuse herbe à bison – la Hiérochloé odorata –, c’est la coumarine qui est toxique : on l’utilise dans la composition d’un raticide ; quand on passe avant les bisons, on la trouve dans la forêt primaire de Bialowieza, en Biélorussie, vendue 1 000 $ le boisseau.
Les tentatives pour redresser la barre ne manqueront pas et l’on verra fleurir des affiches amusantes : le vin, oui, l’alcool non :



Des nouvelles macabres du siège de Paris nous parvinrent bientôt. Des détails féroces. On fabriquait du pain avec de la sciure et de l’avoine qu’on disputait aux chevaux. On dévorait ces derniers par milliers, dans des marchés spéciaux, même les purs sangs offerts par le tsar à Napoléon III. Ils finissaient en saucissons chevaleresques. C’était un avantage que ces écuries débordantes, car aujourd’hui, en 1927, on ne pourrait pas dévorer les voitures ! les vaches et les moutons lâchées dans les abattis du bois de Boulogne avaient déjà tous été boulottés. Les gens affamés demeuraient pendant des heures dans le froid devant les boucheries municipales dans l’espoir d’acquérir un morceau de sang gelé ou une livre de chien pour moins d’un franc. Un fuyard nous raconta qu’il était passé devant la maison Chevet, rempli de la nostalgie des langoustes écarquillées, des poulardes du Mans perlées de graisse, des perdrix et des gélinottes de Russie, des cuissots de chevreuil odorants, des foies gras potelés. Hélas, il n’y avait plus qu’un vil entassement de boites de conserve, une cervelle de panthère avariée et des rognons de rhinocéros rassis. Les restaurants chics proposaient des salmis de rats arrosés de mouton-Rothschild. Chez Peter’s, les soupeuses efflanquées ne levaient plus le client à la sortie, elles rabattaient sur le trottoir sans avoir mangé. La passe contre un quignon. Mais les riches se pourvoyaient en douce. On nous raconta encore que Castor et Pollux, les deux éléphants du Jardin des Plantes, étaient passés à la casserole. Cette viande se payait très cher à la boucherie anglaise du boulevard Haussmann. On dégustait – si ma mémoire ne m’égare et si on ne m’a pas raconté des histoires – quelques chose comme de la trompe d’éléphants sauce mousseline, des papillotes de calao, des toucans à la rémoulade, de la fricassée d’autruche, du steak de kangourou et d’antilope, des rondelles de boa au chèvrefeuille, du ratas de crocodile. Un marché aux rats était établi devant l’Hôtel de Ville. Huit sous le gaspard. Les dames les palpaient comme on le faisait jadis, d’un petit poulet. C’étaient de forts beaux rats du temps de l’Empire. Des rats modernes qui avaient circulé et s’étaient reproduits dans les égouts dernier cri d’Eugène Belgrand et dans un des chapitres les plus hallucinants des Misérables. Des rats progressistes et littéraires, en somme, et patriotes par-dessus tout.
Les belles dames efflanquées, en proie aux borborygmes de la fringale, cajolaient leur toutou de compagnie et commençaient à le fixer des yeux. Elles le tâtaient drôlement. Le chien, alerté par l’instinct, gémissait, hululait lugubre sous ces doigts qui le soupesaient sans l’habituelle tendresse. Affolé, il tentait de s’échapper. La belle dame retroussait ses jupons et le coursait, couteau à la main. Elle et ses consœurs finissaient par dévorer Ulysse, Hector, Napoléon, Hugo, leur bichon qu’elles préféraient souvent à leur mari. Mais manger le mari ne se faisait pas encore. Pendant ces agapes, les obus pleuvaient, le plus grand froid sévissait. Edmond de Goncourt raconterait que, consumé de douleur par le deuil de son frère et armé de son sabre japonais, il décapitait mélancoliquement ses petites poules qu’il adorait. Victor Hugo fut obligé de manger du cheval qu’il digérait fort mal, ce qui nous valut cette blague en alexandrins.
Mon dîner m’inquiète et même me harcèle
J’ai mangé du cheval et je songe à la selle.
Patrick Grainville. Falaise des fous. Seuil. 2018
La Défense de Paris 1870 Auteur anonyme. Musique : sur l’air de Fualdès
Non jamais sur cette terre
On ne vit en vérité,
Pareille calamité,
Ni plus affreuse misère,
Que celle que l’on subit
Sous le siège de Paris.
Paris ! cette ville aimable,
Qui donc ose l’assiéger ?
Serait-ce cet étranger,
Qu’avec un accueil affable
Elle admettait dans son sein ?
Oui, c’est lui son assassin.
C’est d’accord avec l’infâme
Celui qui livra Sedan :
Bonaparte, ce tyran !
Ce gredin sans cœur, sans âme !
Que la Prusse avec ardeur,
Accomplit notre malheur.
Lors du fameux plébiscite,
Sans tous ceux qu’ont voté oui
On n’aurait pas aujourd’hui
Cette guerre tant maudite :
Paris qui n’y est pour rien
À cette heure en souffre bien.
Que de chagrin, que de peine !
Pour un moment d’abandon ;
Si l’on avait voté non,
La France Républicaine,
Pour l’instant, ne serait pas
Dans un si triste embarras.
Quand on pense que nous sommes
Privés de relations,
De communications,
Avec le reste des hommes ;
Du monde pour nous le bout
Ne va pas même à Saint-Cloud.
Quand le ballon nous emporte
Dans tous les départements.
Des lettres pour nos parents,
Jamais il ne nous rapporte
Les réponses, ce qui fait
Qu’on en est très inquiet.
Nous n’avons de leurs nouvelles
Qu’au moyen de nos pigeons ;
Mais des Prussiens, les faucons
Les chassent à tire-d’aile :
Sur dix, il en revient deux ;
On le voit, c’est très chanceux.
L’aspect de toutes nos rues
Est lugubre, car, hélas !
On a supprimé le gaz
Même avant une heure indue,
Et les magasins, le soir,
Font vraiment du mal à voir.
D’ailleurs, toutes les boutiques
N’ont plus rien d’étalagé,
À part chez le boulanger,
C’est en vain que les pratiques
Chercheraient quoi que ce soit ;
On n’a plus même de bois.
Car dans cet horrible siège
On est bien privé de tout ;
Mais de chauffage surtout,
Et sur nos toits, blancs de neige,
L’hiver, en signe de deuil,
Vient étendre son linceul.
Un jour une pauvre mère
Privée de bois, de charbon,
Attend la distribution
Une journée tout entière ;
Dans ses bras cruel effroi !
Son enfant est mort de froid !
On a vu dans les tranchées
Des soldats, de froid périr ;
Ils préféreraient mourir
D’une mort plus recherchée,
Vis-à-vis de l’ennemi,
En défendant le pays.
Et nos pauvres ménagères
Attendent en pataugeant,
Souvent trois heures durant,
Pour obtenir d’ordinaire
Un pot-au-feu de cheval
Ce brave et noble animal.
C’est en pleurant qu’on le mange,
Et l’on n’en a pas toujours ;
Il arrive bien des jours
Que, par force, l’on s’arrange
D’un plat, qui n’est pas très gros,
De riz cuit avec de l’eau.
Il est des êtres rapaces !
J’en rougis ; mais des marchands
Exploitent les pauvres gens ;
Jugez où va leur audace,
Ils vendent un mauvais chou
Jusqu’à des six francs dix sous.
On se nourrit d’épluchures,
De chats, de chiens et de rats ;
On vend des choses au tas
Que l’on jetait aux ordures ;
Mais on s’en repaît enfin,
Pour ne pas mourir de faim.
Dans une pauvre mansarde,
Située rue Desnoyers
La femme vient d’expirer,
Et, seul, son mari la garde ;
Quand, privé de tout secours,
De faim, il meurt à son tour.
Et le matin quand on rentre
De la garde rempart,
Des pommes de terre au lard
Feraient tant de bien au ventre ;
Mais ce légume est passé ;
Du moins, c’est pour les blessés.
Or, toutes les ambulances
Que l’on a fait à grands frais,
Sont pleines, ou à peu près,
Sans compter ceux que la France,
Parmi ses enfants perdus,
Ne reverra jamais plus !
Que de mères en alarmes !
Gémissent en ce moment
Sur le sort de leurs enfants
Qu’a trahi celui des armes ;
Mort sous le plomb meurtrier,
Ou tout au moins prisonnier !
Moralité
Eh ! bien de tous ces ravages,
Nous souffrons sans murmurer ;
Loin de nous désespérer
Ils augmentent nos courages :
On ne vaincra pas Paris,
Tant que nous serons unis !
1870
Marie Louise Jay, née à Samoëns en 1838, avait épousé Ernest Cognacq, né à St Martin en Ré en 1839. Tous deux fervents catholiques, ils fonderont à Paris de nombreuses bonnes œuvres, dont la meilleure fût sans conteste La Samaritaine. Ils moururent tous deux à 87 ans. Tout cela méritait bien une rue. Marie Louise n’ayant pas oublié Samoëns, lui offrit sur 3,5 ha un jardin botanique qui rassemble quelque 5 000 plantes du monde entier.
La Bonne Mère, en cuivre galvanoplastique, une réalisation de la maison Christofle, est dressée au sommet de Notre Dame de la Garde, à Marseille. Les édiles font inscrire sur le fronton de l’Hôtel de ville : Marseille, fille de Phocée, sœur de Rome, rivale de Carthage, émule d’Athènes. Ils auraient pu ajouter cousine de Chicago où l’on joue tous les jours plus brève la vie…
L’Américain George Westinghouse met au point un procédé de freinage des locomotives par air comprimé, expérimenté deux ans plus tard sur un train de voyageurs. Il fera plus tard adopter la traction électrique et fondera la Westinghouse Electric Corporation, aujourd’hui premier constructeur mondial de centrales nucléaires.
Première importation d’une cargaison entière de nitrates plus communément nommé salpêtre du Chili, – un nitrate de sodium naturel -, avec des magasins à Dunkerque, Nantes, La Rochelle et Bordeaux. Le navire est de l’armement Le Quellec-Bordes qui en possède alors quatre. Antoine Dominique Bordes était parti au Chili en 1834 pour y représenter le capitaine Le Quellec, établi à Bordeaux. Ils s’étaient associés en 1847 en achetant quatre navires marchands pour importer au Chili du charbon anglais et en exporter du salpêtre, du cuivre et du guano. La mort de M. Le Quellec fera d’Antoine Dominique Bordes l’unique propriétaire de la maison. L’homme avait deviné l’accroissement de la demande en nitrates pour ce qui allait devenir les fameux NPK de l’agriculture : il commande 13 navires jaugeant de 600 à 1 200 tonnes. En 1883, il cède l’entreprise à ses trois fils, Adolphe, Alexandre et Antonin. La maison Bordes était lancée, vite réputée pour sa rigueur et son sérieux : à la veille de la Première guerre mondiale, elle sera le deuxième armateur au monde, avec 46 navires jaugeant 163 000 tonnes, dont le fameux 5 mâts barque France II, le plus grand voilier du monde, développant 6 350 m² de voiles !
Proche du Mont Lozère, à la confluence des deux rivières, la Picardière et le Luech, la fonderie du Vialas, créée en 1827 est à l’apogée de sa production d’argent avec 1 600 kg, le quart de la production nationale. Ce plomb argentifère et cette galène ont fait dès le Moyen-Âge la richesse des évêques de Mende.
1870
Nicolaï Prjevalski, explorateur russe, est à Ourga, aujourd’hui Oulan-Bator, capitale de la Mongolie extérieure. Il lui sera reproché par la critique de manquer de romantisme dans des écrits qu’il voulait objectifs. Il laissera quelques écrits qui viennent bien montrer combien il avait aimé cette vie : Plus le temps avance, plus il me semble que j’ai laissé dans les lointains déserts de l’Asie quelque chose de bien cher que l’Europe ne peut pas me rendre. C’est que là-bas pousse une herbe bien précieuse ; c’est la liberté, liberté sauvage il est vrai, mais exempte d’entraves et presque absolue. Les fatigues, les périls, sont oubliés ou ne servent qu’à donner plus de reliefs aux moments de joie et de satisfaction intérieures. Aussi le voyageur passionné ne rêve plus qu’à ses aventures passées ; devant ses yeux défile incessamment le panorama de cet heureux temps qui l’engage à substituer au confort de la vie civilisée les fatigues et les labeurs d’une existence vagabonde, mais pleine de liberté et de ravissement.
*****
Ourga est la principale ville de Mongolie septentrionale. Elle est connue chez les nomades sous le nom de Bogdo Kourène ou Da Kourène, c’est-à-dire l’Enceinte sacrée. Le nom d’Ourga vient du russe ourgo qui signifie palais. La ville est partagée en deux quartiers : le quartier mongol et le quartier chinois. C’est le premier qui s’appelle proprement Bogdo Kourène ; le second, qui est à quatre verstes à l’est du premier, s’appelle Maïmatchine se compose essentiellement de fonctionnaires et de négociants chinois. Toutes les maisons sont construites en pisé.
Au premier plan de la ville mongole se dressent les temples avec leurs coupoles dorées, et le palais du houtouktou, image de la divinité sur la terre. Ce palais ne diffère pas beaucoup des temples, dont le plus grand et le mieux bâti est celui du maïdari, censé devoir un jour régner sur le monde. C’est un haut édifice carré, avec un toit en terrasse et des murs crénelés. Dans l’intérieur se voir la statue du maïdari, représenté sous la forme d’un homme assis et souriant. Cette statue est haute de 5 sagènes, et pèse, dit-on, 8 000 pouds [16.38 kg]. Elle est en cuivre, a été fabriquée à Dolon-Nor, et transportée par morceaux à Ourga.
Devant la statue du maïdari est dressée une table couverte d’offrandes, parmi lesquelles on remarque, à une place honorable, un vulgaire bouchon de carafe. Les murs de l’édifice disparaissent sous une grande quantité de petites idoles et de tableaux sacrés.
Les habitants du quartier mongol d’Ourga sont pour la plupart des lamas ou ecclésiastiques. Leur nombre atteint près de 10 000 personnes. Pour les mongols, Ourga, au point de vue religieux, ne le cède qu’à Lhassa (en mongol, Meungké Dzou, le sanctuaire éternel)
À Ourga réside une houtouktou, espèce d’archevêque. Dans beaucoup de temples de Mongolie et à Pékin résident d’autres houtouktous ou hyghens ; mais leur sainteté est au-dessous de celle de leur collègue de Bogdo Kourène, et quand ils paraissent devant lui, il faut qu’ils se prosternent comme le commun des mortels.
Au-dessus du houtouktou d’Ourga, dans la hiérarchie bouddhiste, il n’y a que le ban-tchin-erdem et le dalaï-lama (Prêtre-Océan) de Lhassa.
La nullité personnelle du dalaï-lama et son manque de relations de parenté avec les familles puissantes du pays (il est toujours choisi parmi les familles pauvres) sont pour les Chinois la meilleure garantie, sinon de leur suzeraineté en Thibet, du moins de la tranquillité de ce turbulant voisin. Dans le fait, la Chine a toute raisons de se tenir sur ses gardes. Qu’un homme intelligent et énergique monte sur le trône du dalaï-lama, sur un signe d’un homme tous les nomades se lèveront de l’Himalaya jusqu’en Sibérie. Animées par le fanatisme religieux et la haine de leur oppresseurs, ces hordes sauvages ne tarderaient pas à faire irruption, en Chine, où il ne leur serait pas difficile de tout bouleverser.
L’influence du clergé sur ces grossiers nomades n’a pas de limites. Pour eux, le plus grand bonheur – bonheur qui ne s’acquiert qu’à beaux deniers – c’est d’adresser leurs prières au prêtre, d’obtenir sa bénédiction, ou de toucher simplement le bord de sa robe. Aussi les temples de Mongolie sont-ils colossalement riches ; les pèlerins y affluent et nul n’y serai admis les mains vides.
À l’exception des temples et d’un petit nombre de maisons chinoises, toutes les autres demeures de la ville mongole sont ou des tentes en feutre (les yourtes. ndlr) ou de petites bananes en pisé. Les unes et les autres sont toujours entourées de palissades. Tantôt ces habitations s’étendent sur un même alignement, et forment alors des rues ; tantôt elles sont groupées sans aucun ordre. Au milieu de la ville s’élève le bazar, où le principal article de vente est le thé en brique.
L’aspect du quartier mongol est d’une malpropreté repoussante. Les immondices de toute nature encombrent les rues. Sur la place du marché stationnent de nombreuses bandes de mendiants affamés. Quelques-uns d’entre eux, surtout de vieilles femmes, y ont établi leur domicile. Il est difficile de se représenter un spectacle aussi hideux.
Nicolaï Prjevalski. Sur le toit du monde. Mongolie, Dzoungarie Thibet (1870-1880) Paris, Phébus, 1988
11 01 1871
Défaite des troupes françaises au Mans ; la veille de la bataille du Mans, on avait distribué à 19 000 hommes des fusils Springfield rouillés et des cartouches avariées. Dans certains cas, certaines de ces armes explosaient au moment du tir. Le général Chanzy rejettera la responsabilité de la défaite aux hommes de Conlie, car c’est sur leur position de la Tuilerie que les Prussiens font porter leur effort décisif, qui décida de la victoire. Les soldats français, épuisés par deux mois de privations, mal armés, presque pas préparés, sont taillés en pièces dans la nuit du 11 au 12 par la 20° division prussienne du général von Krautz-Koschlau.
15/17 01 1871
Le général Bourbaki, défait à la bataille d’Héricourt, va tenter de se suicider le 26 janvier et c’est le général Clinchant, qui, prenant le commandement, ira se réfugier aux Verrières, en Suisse avec ses 87 847 hommes dont 2 467 officiers. C’est la première intervention de la Croix Rouge Suisse.
Le spectacle que présenta l’entrée des troupes françaises (…) fut saisissant, et le cœur était profondément ému à l’aspect de telles souffrances. (…) Un très grand nombre [de soldats] marchaient les pieds nus ou enveloppés de misérables chiffons ; leurs chaussures faites avec un cuir spongieux, mal tanné, et la plupart du temps trop étroites, n’avaient pu supporter les marches dans la neige et la boue ; (…) les semelles étaient absentes ou dans un état pitoyable, aussi beaucoup de ces malheureux avaient-ils les pieds gelés ou tout en sang. (…) Les chevaux surtout présentaient le plus piteux aspect : affamés, privés de soins depuis longtemps, mal harnachés souvent, leur corps n’offrait parfois qu’une plaie dégoûtante ; maigres, efflanqués et pouvant à peine se tenir sur leurs jambes, ils cherchaient à ronger tout ce qui se trouvait à leur portée : des jantes de roues, de vieux paniers, la queue et la crinière de leurs voisins…
Emile Davall, major suisse

Les soldats de Bourbaki dans le Jura, près de Soleur – Solothurn -.

Timbre suisse en 2021

Armée de l’Est déposant les armes en Suisse. J.P. Neri (Foto) Edouard Clastres (Panorama) — tableau du musée de Lucerne -. L’ensemble de cette toile cylindrique est de 112 mètres de circonférence sur 14 mètres de haut.

Panorama Bourbaki de Lucerne (Suisse), représentant l’arrivée des Bourbaki aux Verrières. Bernard Bonnefon / AKG-Images.
À Pontmain, dans la Mayenne, apparition de la Vierge à 7 enfants, dont l’une se rétractera. Les adultes présents sur le lieu, ne voyaient rien. L’Eglise ne retiendra que le témoignage de deux enfants.
18 01 1871
Dans la galerie des glaces du château de Versailles, proclamation de l’Empire d’Allemagne. Louis II de Bavière avait compris qu’il allait être mangé par l’ogre prussien, mais par son habileté manœuvrière, sous couvert de désengagement, de fuite même, il parvint à choisir à quelle sauce il serait mangé et c’est ainsi qu’il obtint une autonomie fiscale et administrative et un nombre de voix déterminant au futur Conseil fédéral, ce qui fit de la Bavière le Land le plus puissant de l’Allemagne [et c’est encore le cas aujourd’hui]. Cet empire unifiait une mosaïque de pas loin de 300 petits royaumes, principautés et villes indépendantes.

Anton von Werner 1885
19 01 1871
Défaite des troupes françaises à Saint Quentin.
22 01 1871
Paris se révolte à l’annonce de la démarche de Jules Favre, envoyé du gouvernement auprès de Bismarck pour la conclusion d’un armistice. Ce dernier exige l’élection d’une Assemblée nationale, afin de signer la paix avec un gouvernement légitime
26 01 1871
Jules Favre signe un cessez le feu avec les plénipotentiaires du Reich.
6 02 1871
Léon Gambetta démissionne à Bordeaux.
8 02 1871
Le gouvernement de la Défense nationale remet ses pouvoirs à l’Assemblée Nationale élue le 8 février : Victor Hugo est le deuxième élu des parisiens, derrière Louis Blanc. La majorité parlementaire est anti républicaine : 500 députés monarchistes dont 200 légitimistes, 200 orléanistes, et 30 bonapartistes contre 200 républicains modérés et 20 représentants de la gauche extrême. L’une des premières mesures sera de mettre fin au moratoire sur les loyers institué par le précédent gouvernement en septembre 1870.
13 02 1871
Réunion à Bordeaux de la nouvelle Assemblée Nationale.
Au fond de la salle, un vieillard, seul sur son banc, se lève et demande la parole. Sous son grand manteau brille une chemise rouge. C’est Garibaldi. À l’appel de son nom il a voulu répondre, dire d’un mot qu’il résigne son mandat dont Paris l’a honoré. Les hurlements couvrent sa voix. Il reste debout, élève cette main desséchée qui a pris un drapeau aux Prussiens, les injures redoublent ! Le châtiment tombe des tribunes. Majorité rurale ! Honte de la France ! jette la voix sonore de Gaston Crémieux de Marseille. Les députés se retournent, menacent. Les bravos et les défis des tribunes tombent encore. Au sortir de la séance la foule applaudit Garibaldi. La garde nationale lui présente les armes, malgré M. Thiers qui apostropha l’officier commandant.
Gaston Lissagaray
14 02 1871
Cette période de troubles va voir se nouer la destinée peu commune d’Aurélie Picard. Née 22 ans plus tôt en Champagne, fille d’un gendarme qui a passé de nombreuses années en Algérie, elle ne manque pas de prestance et devient demoiselle de compagnie de la famille Steenakers : Monsieur Steenakers est alors conseiller général. Élu député en 1870, il a suivi le gouvernement à Bordeaux, où il devient ministre des Postes. Il confie à Aurélie l’apprentissage des pigeons voyageurs.
Sidi Ahmed Tidjani, noir, chef de l’influente confrérie tidjaniya du sud algérien, est en exil à Bordeaux car soupçonné de sympathies pour les rebelles Ouled Ziad. Il rend visite à M Steenakers et tombe amoureux d’Aurélie… qui ne dit pas non. L’affaire va mettre quelques mois pour se conclure, le temps pour Sidi Ahmed Tidjani d’accepter de répudier toutes ses autres épouses, et de promettre de n’en prendre aucune autre. La bénédiction nuptiale sera donnée à Alger par Mgr Lavigerie, lequel avait pris la mesure de la portée symbolique de la situation : une blanche chrétienne qui épouse un noir musulman sans pour autant répudier sa religion : cela méritait une souplesse dans l’adaptation des habitudes en vigueur que l’évêque d’Alger était tout à fait à même d’assumer. Il s’était d’ailleurs associé pour la circonstance au mufti Bou Kandoura.
On n’est pas vraiment sûr qu’Aurélie ait été heureuse : à son arrivée à Alger, c’est elle qui dût mettre à exécution la promesse du mari, en chassant les deux premières épouses ; sept ans plus tard, elle en découvrit une troisième, qu’elle chassa aussi mais en adoptant son enfant, Ali. Son mari mourut en 1897 et elle épousa alors son frère. Mais on sait qu’elle vécut longtemps – jusqu’en 1933 – et qu’elle passa ce temps à faire œuvre utile, avec l’aide d’une bourse du gouvernement, en construisant le petit palais de Kourdane à Aïn Madhi, 80 km à l’ouest de Laghouat, et surtout en y créant de magnifiques jardins, une école française, un dispensaire, et en allant même inoculer de la rigueur comptable dans les finances de la confrérie. Quelle vitrine de rêve pour la colonisation ! Frison Roche en fera le canevas de son livre Djebel Amour. Devenue Lalla Tidjani, on l’avait surnommée Lalla Yamina, [sainte femme d’Islam] : c’était un temps où l’intégrisme, d’un coté comme de l’autre, ne sévissait pas encore ; la largesse d’esprit pouvait donc s’exprimer.
17 02 1871
Adolphe Thiers est nommé chef du pouvoir exécutif de la République. Protestation solennelle des députés Alsaciens et des Lorrains (ils représentent 1,5 M habitants) contre leur future annexion à l’Allemagne.
26 02 1871
Armistice de Versailles. La conflit aura fait 139 000 morts côté français, 50 000 côté allemand. En avant goût de la Paix à venir, la ville de Paris versera à l’Allemagne 200 millions de Francs, soit 4 milliards de Francs 1992.
Si l’œuvre violente à laquelle on donne en ce moment le nom de traité s’accomplit,
si cette paix inexorable se conclut, c’en est fait du repos de l’Europe ;
L’immense insomnie du monde va commencer.
Il y aura désormais en Europe deux nations qui seront redoutables ; l’une parce qu’elle sera victorieuse, l’autre parce qu’elle sera vaincue.
Victor Hugo
D’août 1870 à mars 1871, ce sont plus de 509 000 combattants français – 20 000 d’entre eux mourront en captivité – qui auront été faits prisonniers, dont 420 000 détenus en Allemagne, 4 000 internés en Belgique et 85 000 en Suisse. Ce sont surtout les capitulations successives de Sedan le 2 septembre – 83 000 prisonniers – , de Strasbourg le 28 septembre – 17 500 – et de Metz le 27 octobre – 150 000 – qui en forment le principal.
8 03 1871
De toutes les puissances européennes, aucune ne s’est levée pour défendre cette France qui, tant de fois, avait pris en main la cause de l’Europe… Pas un roi, pas un État, personne ! […] Un homme est intervenu, et cet homme est une puissance […]. Il est le seul des généraux français qui ont lutté pour la France, le seul qui n’ait pas été vaincu […]. Il y a trois semaines, vous avez refusé d’entendre Garibaldi […]. Aujourd’hui vous refusez de m’entendre. Cela me suffit. Je donne ma démission.
Victor Hugo
18 03 1871
À Paris, début de la Commune : la capitulation devant les Prussiens, la fuite de l’Assemblée nationale à Versailles, et quelques autres maladresses, dont la suppression du moratoire sur les loyers, déclenchent le soulèvement des milieux ouvriers. Le général Vinoy a reçu l’ordre de reprendre les canons que les Parisiens, à la nouvelle de l’occupation de Paris par les uhlans à partir du 1° mars, ont mis en sûreté dans les hauts lieux de la capitale : Montmartre, Buttes Chaumont, Belleville ; deux généraux sont exécutés, mais le contre-ordre arrive rapidement et l’armée évacue Paris. Les Communards se dotent d’un gouvernement révolutionnaire qui durera jusqu’au 28 mai 1871 remerciant l’armée de n’avoir pas voulu porter la main sur l’arche sainte de nos libertés, et appelant Paris et la France à jeter ensemble les bases d’une république acclamée avec toutes ses conséquences, le seul gouvernement qui fermera pour toujours l’ère des invasions et des guerres civiles.
La mort soudaine de son fils Charles, le 13 mars, éloigne Victor Hugo des événements ; de Bruxelles où l’ont appelé ses affaires, meurtri, impuissant, il ne peut que condamner ces affrontements devant l’éclat de rire affreux des Prussiens… La Commune n’est pas plus Paris que l’Assemblée n’est la France. Par après, les pouvoirs en place dans toute l’Europe voudront voir derrière tout cela la patte de Karl Marx qui aurait été le principal inspirateur.
28 03 1871
La RFU – Rugby Football Union – a précisé les 37 règles du rugby établies en 1845 par William Delafield Arnold, qui deviennent les 59 règles qui encadrent le premier match international de l’histoire entre l’Écosse et l’Angleterre.
03 1871
Correspondant de guerre du Chicago Tribune et du New York Herald, Stanley se voit confiée par Gordon Bennett la mission de retrouver Livingstone : il ne part pas sans biscuit, et les Américains ont déjà, bien ancrée, une tradition de logistique lourde, voire très lourde : 27 kilomètres d’étoffe pour les échanges, des centaines de rouleaux de fil de fer, inestimable bien sous ces latitudes, quantité de fausses perles de toutes les manières ; trente et un volontaires armés, 153 porteurs, 27 bêtes de somme, 2 chevaux, et, attachés directement à sa personne 3 gardes du corps blancs. La malaria fait rapidement des ravages chez les humains, la mouche tsé-tsé chez les animaux. La mutinerie menace contre laquelle il n’hésite pas à faire usage de ses armes. Il va mettre 8 mois pour rejoindre le lac Tanganyika.
8 04 1871
Du Constantinois à la Kabylie, c’est plus d’un tiers de la population algérienne qui se soulève contre la France : environ 200 000 insurgés contre 86 000 soldats. Nombreux étaient les griefs, mais la naturalisation des juifs était l’un des principaux, mal perçue par les Kabyles. La population européenne était devenue farouchement antimilitariste et ce n’était pas sans inquiéter les Arabes et les Berbères, qui éprouvaient un respect certain pour l’armée. Le père du bachaga Mokrani avait été khalifa, lui-même n’était plus que bachaga, certes officier de la Légion d’honneur mais devenu un fonctionnaire, payant des impôts, aux prises avec l’administration pour des histoires de corvées de ses sujets
Dernière grande révolte indépendantiste avant celle de 1945 et de 1954, le soulèvement de 1871, où révolte des Mokrani, procède d’une somme de mécontentements perceptibles dès avant la guerre franco-prussienne […] l’insurrection gagne la Petite et la Grande Kabylie, l’essentiel du Constantinois et quelques tribus de l’Oranie, soit le tiers de la population algérienne. La répression fut à la hauteur de l’événement, visant par son outrance à dompter définitivement des tribus, tout en procurant de nouveaux moyens à la colonisation. Aux amendes de guerre estimées à 36 millions de francs-or, s’ajoutèrent la confiscation et la mise sous séquestre d’un patrimoine foncier de l’ordre de 450 000 hectares [de bonnes terres, celles de la plaine, près de la mer, ne laissant ainsi aux Kabyles que la montagne].
Bernard Droz
Dès 1864 le général Mac Mahon jugeait que les procédés des Européens à l’égard des Arabes sont durs et injustes… leur presse se livre à des attaques incessantes contre eux : elle ameute les rancunes et les haines
7 ans plus tard le général Lapasset contresignait : l’abîme ainsi crée sera comblé un jour par des cadavres.
Le général Allard, lui, fait son métier de commissaire du gouvernement au Sénat : Le gouvernement ne perdra pas de vue que la tendance de la politique doit en général être l’amoindrissement de l’influence des chefs et la désagrégation de la tribu.
Alexis de Tocqueville constate la même chose, non pour le recommander mais bien pour le déplorer : La société musulmane en Afrique n’était pas incivilisée (…) Il existait en son sein un grand nombre de fondations pieuses, ayant pour objet de pourvoir aux besoins de la charité ou de l’instruction publique. Partout, nous avons mis la main sur ses revenus en les détournant en partie de leurs anciens usages ; nous avons détruit les établissements charitables, laissé tomber les écoles, dispersé les séminaires. Autour de nous, les Lumières se sont éteintes, le recrutement des hommes de religion et des hommes de loi a cessé ; c’est à dire que nous avons rendu la société beaucoup plus misérable, plus désordonnée, plus ignorante et plus barbare qu’elle n’était avant de nous connaître.

Un caïd algérien devant les autorités françaises, à Sétif, après l’insurrection de 1871. Gravure de l' »Illustration » du 17 juin 1871. ADOC-PHOTOS/BF
12 04 1871
La colonne impériale est un monument de barbarie, un symbole de force brute et de fausse gloire, une affirmation du militarisme, une négation du droit international, une insulte permanente des vainqueurs aux vaincus, un attentat perpétuel à l’un des trois grands principes de la République française, la fraternité.
La commune de Paris
17 04 1871
Gustave Courbet est élu président de la Fédération des artistes ; il demandait que la colonne Vendôme soit déboulonnée, attendu que ce monument est dénué de valeur artistique et tend à perpétuer les idées de guerre et de conquête qui étaient dans la dynastie impériale. Mais, déboulonnée ne signifie pas détruite. Il avait néanmoins demandé son démontage par plaques pour les exposer aux Invalides. Dès septembre 1870, il avait fait protéger des bombardements ennemis les statues du Louvre, les Chevaux de Marly, les musées de Cluny et du Luxembourg, et même les bas-reliefs très napoléoniens de l’Arc de Triomphe. Il n’appartient pas aux artistes, dont la mission est essentiellement créatrice, de détruire un objet d’art, si mauvais soit-il.
*****
Sous quelle cloche, à l’aide de quel fumier, par suite de quelle mixture de vin, de bière, de mucus corrosif et d’œdème flatulant a pu pousser cette courge sonore, cette incarnation du Moi imbécile et impuissant.
Alexandre Dumas fils
La légende ! C’est ce qui a perdu Courbet. Il avait eu la fortune de créer un mot, correct d’ailleurs, déboulonner… qui avait eu un succès immédiat. Dans les brasseries, dans les cafés, dans les salons, c’était à qui l’emploierait, à qui le placerait à propos. On ne savait pas bien ce qu’au fond il signifiait, mais on le trouvait original et neuf et cela suffisait
Jules Antoine Castagnary, critique d’art. Plaidoyer pour un ami mort 1883
04 1871
Louise Michel, née dans un château délabré de la Marne, voue une admiration sans bornes à Hugo ; libertaire – je n’ai pas voulu être le potage de l’homme – elle se trouve aux avant postes de la Commune. S’éloignant des engagements de Clamart ou d’Issy les Moulineaux, elle entre dans l’église réformée de Neuilly et commence à y composer La danse des bombes, qui restera inachevée :
Amis, il pleut de la mitraille
En avant tous ! Volons ! Volons !
Le tonnerre de la bataille
Gronde sur nous… Amis, chantons !
Versailles, Montmartre salue.
Garde à vous ! Voici les lions !
La mer des révolutions
Vous emportera dans sa crue.
En avant, en avant sous les rouges drapeaux !
Vie ou tombeaux.
Les horizons aujourd’hui sont tous beaux !
Frères, nous léguerons nos mères
A ceux qui nous survivront.
Sur nous point de larmes amères !
Tout en mourant nous chanterons.
Ainsi, dans la lutte géante
Montmartre, j’aime tes enfants,
La flamme est dans leurs yeux ardents
Ils sont à l’aise dans la tourmente.
C’est un brillant lever d’étoiles
Où tout aujourd’hui dit : Espoir !
Le dix-huit mars nous gonfle les voiles
Ô fleur, dis lui bien Au revoir
*****
Madame et Pauline Roland,
Charlotte, Théroigne, Lucile,
Presque Jeanne d’Arc, étoilant
Le front de la foule imbécile,
Nom des cieux, cœur divin qu’exile
Cette espèce de moins que rien
France bourgeoise au dos facile,
Louise Michel est très bien.
Elle aime le Pauvre âpre et franc
Ou timide, elle est la faucille
Dans le blé mûr pour le pain blanc
Du Pauvre, et la sainte Cécile,
Et la Muse rauque et gracile
Du Pauvre et son ange gardien
À ce simple, à cet indocile.
Louise Michel est très bien
Gouvernements de malatent,
Mégathérium ou bacille,
Soldat brut, robin insolent,
Ou quelque compromis fragile,
Tout cela, son courroux chrétien
L’écrase d’un mépris agile,
Louise Miche est très bien.
Citoyenne ! votre évangile
On meurt pour ! c’est l’Honneur ! et bien
Loin des Taxil et des Bazile,
Louise Michel est très bien
Paul Verlaine Ballade en l’honneur de Louise Michel
Et ceux qui, comme moi, te savent incapable
De tout ce qui n’est pas héroïsme et vertu…
Ceux qui savent tes vers mystérieux et doux,
Tes jours, tes nuits, tes soins, tes pleurs donnés à tous,
Ton oubli de toi-même à secourir les autres…
Ta bonté, ta fierté de femme populaire,
L’âpre attendrissement qui dort sous ta colère…
Qui savent que si on te disait : D’où viens-tu ?
Tu répondrais : Je viens de la nuit où l’on souffre…
Victor Hugo Viro Major Décembre 1871

1830 – 1905

10 05 1871
Traité de Francfort : la France cède à l’Allemagne une grande partie de la Lorraine et l’Alsace, à l’exception de Belfort. L’est du pays sera occupé jusqu’au 2 03 1875, date du dernier règlement des 5 milliards que la France doit verser à l’Allemagne, l’équivalent de 3 ans de recettes fiscales, 100 milliards de francs 1992 : Bismarck aurait bien voulu étouffer la France. Mais Adolphe Thiers ne veut en aucun cas gouverner en traînant ce boulet : à un an d’intervalle, il lance les deux emprunts les plus élevés du siècle : pour le premier, du 27 juin 1871, le gouvernement souhaite lever 2,3 milliards de francs: en moins de 6 heures, plus du double est réuni : 335 000 personnes souscriront pour 4,9 milliards de francs. Pour le deuxième, les 28 et 29 juillet 1872, ce sont 49 milliards qui seront souscrits, dont 28 depuis l’étranger. Il faut préciser que les banques étaient de la partie, se portant garantes de la réussite moyennant commission ; au premier rang, on trouvait la Banque Rothschild, qui sera encore présente pour le deuxième emprunt, malgré les oppositions des autres banques, ce qui lui permettra d’encaisser une commission de plus de 7 millions, contre seulement 875 000 pour le Crédit Lyonnais. Cela permettra de solder le règlement de ces réparations avec une belle avance sur l’échéancier : le dernier règlement sera effectué le 18 09 1873 ; les troupes allemandes quitteront alors le territoire français.
Les Alsaciens et les Lorrains ont jusqu’au 10 Octobre pour décider de se fixer en France : ils seront 158 000 à le faire, soit 10 % de la population des territoires annexés : c’est l’origine de l’expansion et de l’industrialisation de Belfort et Nancy. Un bon nombre partit aussi en Algérie.
La monarchie des Hohenzollern rendait à la France ce que les Capétiens avaient fait autrefois à l’Allemagne : elle voyait chez nous avec faveur des institutions qui étaient le contraire des siennes. Et, quant à l’attitude à prendre vis-à-vis des affaires de France, Bismarck donnait à son maître le même conseil que Pierre Dubois avait donné à Philippe le Bel et Marillac à Henri II : tenir sous main les affaires d’Allemagne en la plus grande difficulté qu’on pourra.
Jacques Bainville. Histoire de deux peuples continuée jusqu’à Hitler. 1933
Quand un peuple tombe esclave, tant qu’il tient bien sa langue, c’est comme s’il tenait les clés de sa prison.
Alphonse Daudet, parlant du français en Alsace en 1872
Le désastre face aux Prussiens fut immédiat, dans la consternation générale. Les Français combattaient pourtant avec courage dans d’innombrables batailles. Wissembourg, Forbach, Reichshoffen, Gravelotte, Sedan, Bazeilles, Chalon, Reims. Autant d’étapes du terrible chemin de croix d’un peuple mal engagé, mal commandé et mal équipé. Contraint de faire une guerre dont il n’avait pas envisagé la nature, et dont les formes lui étaient imposées. Bombardement des villes et donc des civils, destruction des églises et des hôpitaux, prises d’otages, massacres et viols en tous genres, nous n’avions jamais connu cela sur le sol national. Nous retrouverons ces traits en 1914 et encore en 1940. Pourquoi serions-nous aujourd’hui meilleurs que nos parents et grands-parents ? Pourquoi serions-nous protégés du malheur au point de ne même pas pouvoir le concevoir ?
Charles de Gaulle dans La France et son armée écrira plus tard à propos de la guerre de 1870 : L’idéologie, l’insouciance portaient leurs fruits amers et sanglants. Grandir sa force à la mesure de ses desseins, ne pas attendre du hasard, ni des formules, ce qu’on néglige de préparer, proportionner l’enjeu et les moyens : l’action des peuples, comme celle des individus, est soumise à ces froides règles. Inexorables, elles ne se laissent fléchir ni par les plus belles causes ni par les principes les plus généreux. Mais pourquoi faut-il qu’on ne les voie bien qu’à travers les larmes des vaincus ? Nous ferions aujourd’hui profit de la lecture et de la relecture de cette phrase. En la confrontant au monde qui est le nôtre, pas à celui d’hier.
Enfin cette guerre de 1870 se singularise encore par l’effondrement du régime qui l’avait déclarée et son remplacement le 4 septembre 1870 par la République dans l’improvisation générale, sans consultation populaire, et alors que l’ennemi occupait un quart du territoire national. Et là, on voit vite que le meilleur et le pire peuvent sortir du peuple français jeté à terre.
Le meilleur, c’est cette volonté de tenir, de résister, de faire face. C’est Gambetta, encore un Français de fraîche date, petit-fils d’un immigré Ligure, qui allait soulever l’enthousiasme patriotique et relacer la défense nationale. Et c’est là enfin que nous retrouveront Faidherbe, auquel Gambetta allait donner le commandement de l’armée du Nord. Celle qui s’illustra à Bapaume, qui sauva Le Havre et qui empêchera que le nord de la France soit occupé par l’ennemi. Le vieil officier allait montrer dans le désastre que l’improvisation, l’adaptation au terrain, la faiblesse des moyens, toutes caractéristiques de l’œuvre coloniale, avaient été la meilleure préparation à la guerre qui venait, bien loin du respect rigoureux du règlement et de la terne vie de garnison. On retrouvera cette singularité en 1914 quand il fallut en six mois se débarrasser de 50 % de l’effectif des généraux en place et que fût promue la génération des officiers qui avaient combattu outre-mer. Devant ces faits, et puisque certains voudraient nous imposer une réécriture de l’histoire, on pourrait s’amuser nous aussi à la réécrire complètement, tout reprendre par la fin, et par exemple constater finalement que l’œuvre coloniale n’aura eu qu’un seul but, ou plutôt qu’un seul effet, mais majeur, essentiel, celui de permettre à de Gaulle de bénéficier avec le Cameroun et l’AEF (dont le gouverneur Felix Éboué était un Noir de la Guyane) d’un ancrage territorial qui le légitimait quand, de légitimité, il n’en avait aucune. Car la France libre fut africaine selon le titre du beau livre qu’Éric Jennings a consacré à cette épopée. C’est le serment de Leclerc à Koufra en mars 1941 qui avait montré au monde entier que la France défaite 9 mois plus tôt était à nouveau debout et combattante. Une autre manière de lire l’histoire serait ainsi de le faire au vu des seuls résultats, fussent-ils totalement inattendus, et pas des objectifs.
[…] Faidherbe s’était donc imposé face à l’ennemi en 1871. Il était bien le seul quand les autres grands chefs militaires s’étaient retrouvés au pire prisonniers des Prussiens et au mieux, tel Bourbaki, réfugié en Suisse avec toutes ses troupes, mais obligé pour passer la frontière d’un pays neutre de déposer préalablement leurs armes sous l’œil vigilant des Prussiens qui sans cela se seraient emparés de la tristement célèbre armée de Bourbaki. Grâce à Gambetta et à l’énergie incroyable du peuple français qu’il avait su mobiliser, la défaite consommée dès septembre 1870 allait de ce fait n’être reconnue qu’en janvier 1871. Quatre mois de résistance formidable, mais vaine, le courage et l’exaltation pouvant sauver l’honneur mais ne pouvant pallier l’accumulation des erreurs stratégiques.
Le pire allait être la guerre civile en présence de l’ennemi. Tandis qu’au château de Versailles, dans la galerie des Glaces, était proclamée la création d’une Allemagne unifiée autour du roi de Prusse, la Commune de Paris allait ajouter du malheur au malheur. Il en sera de même en 1940 quand il ne suffit pas à certains de demander l’armistice, ce qui pouvait se concevoir pour répondre à l’urgence et attendre la suite des événements, mais qui profitèrent de la situation pour se lancer dans une révolution nationale en présence de l’ennemi qui n’en demandait pas tant. Le parallèle est politiquement totalement incorrect. Car l’air du tems, où domine l’expertise en recomposition-manipulation du passé, range la Commune parmi les vaches sacrées de l’histoire nationale. Tant mieux pour elle. Pourtant il n’est pas difficile d’imaginer quelle serait aujourd’hui la réaction de tout gouvernement si un mouvement parisien d’extrême gauche se réunissait en tribunal populaire, condamnait à mort deux généraux qu’il retenait prisonniers, les passait par les armes sur le champ avant de prendre en otage l’archevêque de Paris et de le fusiller également. N’aggravons pas notre cas.
Philippe San Marco. Sortir de l’impasse coloniale. Mon petit éditeur 2016
16 05 1871
La colonne Vendôme est renversée. L’ambiance était à la fête : aussi, pour éviter les risques de tout rassemblement non contrôlé, on avait limité le nombre d’invitations à 20 000, en distribuant des tickets. Il ne s’agissait pas de tirer dessus tout simplement, mais de la mettre en vibration avec un cabestan… jusqu’à ce que l’amplification des vibrations entraine la chute.
Considérant que la colonne impériale de la place Vendôme est un monument de Barbarie, un symbole de force brute et de fausse gloire, une affirmation du militarisme, une négation du droit international, une insulte permanente du vainqueur aux vaincus, un attentat perpétuel à l’un des trois grands principes de la République Française : la Fraternité, la Commune de Paris décrète : la colonne de la place Vendôme sera démolie.
Décret de la Commune de Paris du 12 avril 1871.
La statue du premier des Bonaparte en empereur romain est à la voirie. C’est fort bien : mais ça ne suffit pas. La carcasse emmaillotée de ce maître coquin est encore aux Invalides. Il faut qu’elle soit brûlée coram populo et que ses cendres soient jetées au vent. Plus de ces ignobles reliques.
Jules Vallès. Le cri du peuple.
Cela, la Commune n’eut pas le temps de le faire.

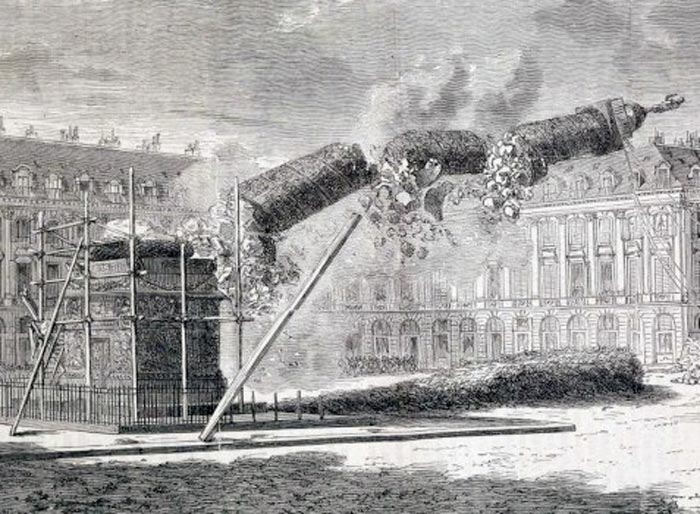

photographe anonyme La tâche sombre à gauche du pied de la colonne : ce sont les testes de fagots et de fumier qui avaient été amenés pour amortir le choc.

Gustave Courbet en 1872, réfugié chez ses parent à Ornans en Franche-Comté

Courbet peint par lui-même et par Gill. La Lune du 9 juin 1867

La flèche pointe Gustave Courbet. À terre, Napoléon I°, sculpté par Auguste Dumont.
17 h 30′ Blouf ! Un nuage de poussière… Tout est fini… La colonne est à terre, ouverte, les entrailles de pierre au vent. César est couché sur le dos, décapité. La tête, couronne de lauriers, a roulé, comme un potiron, jusqu’à la bordure du trottoir. Vuillaume
17 05 1871
Explosion de la cartoucherie du Champ de Mars, encore dite cartoucherie de Grenelle, à l’angle de l’avenue Rapp et de l’avenue Labourdonnais. Le feu a pris dans l’atelier des poudres, où travaillent huit cents ouvrières et s’est propagé au bâtiment voisin : le dépôt des projectiles chargés ; c’est lui qui aurait explosé, faisant tomber une pluie de balles sur Paris. Mais, pour on ne sait quelles raisons, les employées, ce jour-là, étaient parties à cinq heures de l’après-midi, au lieu de six habituellement, et l’explosion eut lieu à cinq heures et demi. On ne parviendra pas à connaître le nombre réel de victimes.

21 au 28 05 1871
Semaine rouge, Semaine sanglante, qui fit près de 25 000 morts, dont 150 chez les Versaillais : l’armée est entrée dans Paris, prenant les barricades à l’envers : Paris est mis à feu et à sang : pétroleurs et pétroleuses arrosent les monuments : le 24, les Tuileries flambent et s’écroulent aux trois-quarts, le feu se propage à la bibliothèque du Louvre, riche de plus de 100 000 volumes, dont les plans manuscrits du monument ; mais le conservateur du Louvre Barbet de Jouy bataille comme un beau diable pour que le musée reste hors d’atteinte des émeutiers : il coordonne l’action des gardiens, veille à la sécurité. Doué d’un sens aigu du service public et de ses responsabilités, il est l’interlocuteur intraitable des artistes communards qui veulent diriger le musée, Courbet ou Dalou ; (mais, par la suite il témoignera en faveur des artistes et aidera Dalou à obtenir un passeport pour l’Angleterre). L’armée, sous la direction de Bernard de Sigoyer, éteint l’incendie qui menaçait la Grande Galerie, et Barbet de Jouy assure la protection des collections avec l’aide d’Antoine Héron de Villefosse et de la cohorte des gardiens. L’Hôtel de Ville [1] et la Cour des Comptes brûlent aussi, et avec eux l’état civil des Parisiens depuis le XVI° siècle ; les 80 000 volumes de la bibliothèque installée dans les combles de l’Hôtel de Ville partent en fumée ; le lendemain des incendies sont allumés au Palais Royal, au ministères des Finances. Le Palais de Justice est disloqué…un véritable holocauste patrimonial, dira Alexandre Gady. Louise Michel veut mettre le tout en musique en délaissant les barricades pour les orgues abîmées d’une église, le tout au son du canon : on dirait un orage d’été, jubile-t-elle. Mgr Darboy, archevêque de Paris, est exécuté ; quelques heures plus tard, c’est au tour de 15 dominicains d’Arcueil. Le 26, 52 civils, gendarmes et prêtres [3] sont fusillés à Belleville.
Ainsi qu’une forêt immense, la Ville brûlait et flambait. Le tocsin ne s’arrêtait pas… L’air était tissu de flammes. Avivés encore par la rafale, les incendies se dressaient de toutes parts ainsi que des torses géants. Des démons de feu semblaient cerner la Ville, léchant le ciel de leurs langues monstrueuses.
Elémir Bourges Les oiseaux s’envolent et les fleurs tombent

incendie de la nuit du 24 mai 1871
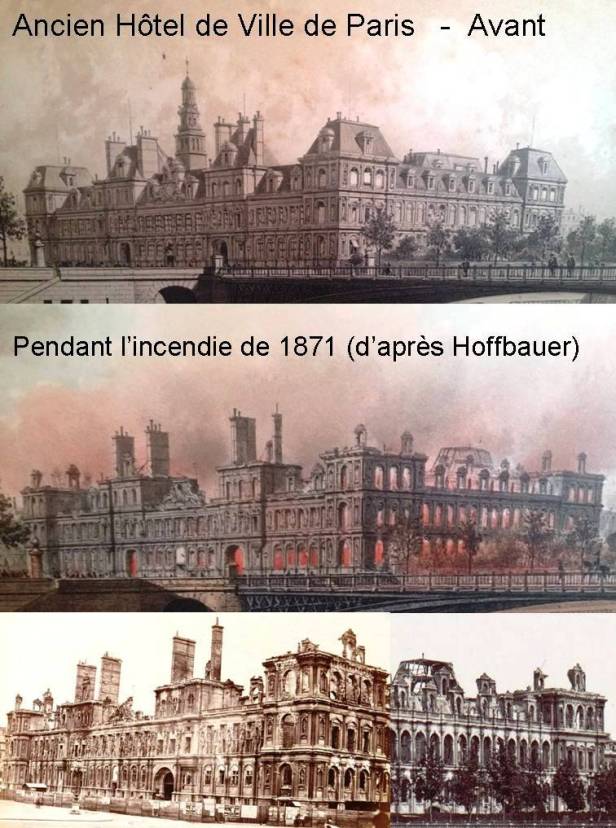

L’Hôtel de Ville de Paris, après l’incendie du 24 mai 1871. Hippolyte Auguste Collard 1871 Musée Carnavalet.

![Structurae [fr]: Hôtel de ville, Paris](https://files.structurae.net/files/photos/1/20100416/dsc01178_shift.jpg)
aujourd’hui
28 05 1871
Fin de la Commune : 147 émeutiers, retranchés au cimetière du Père La Chaise, sont fusillés au mur des Fédérés. [le père La Chaise, confesseur jésuite de Louis XIV avait obtenu de lui ce domaine où il se lamentait auprès du Seigneur : S’il est bien vrai que vous portez les péchés du monde, Seigneur, moi, je porte ceux du roi, et, croyez moi, cela n’est pas rien …]
Ces parisiens montant à l’assaut du ciel…
Le véritable secret de la Commune, le voici : c’était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le résultat de la lutte des classes des producteurs contre la classe des appropriateurs, la forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l’émancipation économique du Travail.
[…] Le Paris ouvrier, avec sa Commune, sera célébré à jamais comme le glorieux fourrier d’une société nouvelle. Ses martyrs seront enclos dans le grand cœur de la classe ouvrière.
Karl Marx. La guerre civile en France [3]
La justice sera à l’image de la répression : 10 042 condamnés, dont 4 500 déportés en Nouvelle-Calédonie, 3 761 condamnés par contumace, 93 condamnés à mort. 19 000 accusés seront acquittés. Certains feront antichambre à l’Orangerie du château de Versailles le temps d’un été, après quoi le nécessaire retour des orangers chassera les condamnés.
Mais cette période laissera arriver jusqu’à nous Le temps des cerises, qui est tout de même autre chose que la Marseillaise ; il faudra attendre qu’à son retour d’exil, Clément la dédie à Louise, ambulancière de la Commune, pour qu’elle accède à la notoriété, car rien ne prouve qu’elle ait été chantée au moment de la Commune ; les paroles sont de Jean Baptiste Clément [4] en 1866 et la musique, d’Antoine Renard en 1868 :
Quand nous chanterons le temps des cerises
Et gai rossignol, et merle moqueur
Seront tous en fête.
Les belles auront la folie en tête
Et les amoureux du soleil au cœur.
Quand nous chanterons le temps des cerises,
Sifflera bien mieux le merle moqueur.
Mais il est bien court, le temps des cerises,
Où l’on s’en va deux, cueillir en rêvant
Des pendants d’oreille…
Cerises d’amour aux robes pareilles,
Tombant sous la feuille en gouttes de sang.
Mais il est bien court, le temps des cerises,
Pendants de corail qu’on cueille en rêvant.
Quand vous en serez au temps des cerises,
Si vous avez peur des chagrins d’amour,
Évitez les belles !
Moi qui ne crains pas les peines cruelles,
Je ne vivrai point sans souffrir un jour.
Quand vous en serez au temps des cerises,
Vous aurez aussi des peines d’amour !
J’aimerai toujours le temps des cerises ;
C’est de ce temps-là que je garde au cœur
Une plaie ouverte.
Et Dame Fortune en m’étant offerte
Ne pourra jamais calmer ma douleur.
J’aimerai toujours le temps des cerises
Et le souvenir que je garde au cœur
Les contemporains ne seront pas tendres : à part Hugo qui veut rester homme avant tout, la condamnation violente est quasi unanime, dépassant largement les rangs du seul camp conservateur.
On aurait dû condamner aux galères toute la Commune et forcer ces sanglants imbéciles à déblayer les ruines de Paris, la chaîne au cou, en simples forçats.
[…] Plus que jamais, je sens le besoin de vivre dans un monde à part, en haut d’une tour d’ivoire, bien au-dessus de la fange où barbotte le commun des hommes.
La commune a déplacé la haine entre les Français, en éteignant tout désir de vengeance contre les Prussiens.
Gustave Flaubert
Car, lorsque le cher homme disait : il n’y a qu’une chose que je comprenne dans la politique, c’est l’émeute, il entendait bien sûr que toutes les émeutes ne sont pas à mettre sur le même pied : il en va des émeutes comme du reste : il y a les bonnes et il y a les mauvaises.
Je me refuse à plaindre l’écrasement d’une pareille démagogie.
Georges Sand
Les Versaillais, c’était la partie saine de la France, la raisonnable, la pondérée, la paysanne, qui supprimait la partie folle. Le bain de sang que le peuple de Paris vient de prendre était peut-être une horrible nécessité pour calmer certaines de ses fièvres. Vous le verrez maintenant grandir en sagesse et splendeur.
Émile Zola
Aucun événement de notre histoire moderne, et peut-être de notre histoire tout court, n’a été l’objet d’un pareil surinvestissement d’intérêt, par rapport à sa brièveté. Il dure quelques mois, de mars à mai 1871, et ne pèse pas lourd sur les événements qui vont suivre, puisqu’il se solde par la défaite et la répression.
[…] Le souvenir de la Commune a eu la chance de se trouver transfiguré par un grand événement postérieur : la Révolution russe de 1917 l’a intégré à sa généalogie, par l’intermédiaire du livre que Marx avait consacré à l’événement dès 1871.
[…] Pourtant, la Commune doit beaucoup plus aux circonstances de l’hiver 1871 et au terreau politique français qu’au socialisme marxiste, auquel elle ne tient par rien.
François Furet
La Commune, dépourvue d’idées neuves, de valeurs fondatrices et de dirigeants d’envergure, ne fut jamais en mesure de précipiter l’enfantement d’un monde nouveau
François Broche, Sylvain Pivot
La Commune ? Ce fut la ligue de tous les déclassés, de tous les incapables, de tous les envieux, de tous les assassins, de tous les voleurs, mauvais poètes, mauvais peintres, journalistes manqués, tenanciers de bas étage.
Charles Marie Leconte de Lisle, José Maria de Heredia
La seule chose, j’en reviens toujours là, c’est un gouvernement de mandarins. Le peuple est un éternel mineur. Je hais la démocratie.
[…] Le premier remède serait d’en finir avec le suffrage universel, la honte de l’esprit humain. Dans une entreprise industrielle (société anonyme), chaque actionnaire vote en raison de son apport. Il en devrait être ainsi dans le gouvernement d’une nation.
[…] L’instruction obligatoire et gratuite n’y fera rien qu’augmenter le nombre des imbéciles. Le plus pressé est d’instruire les riches qui, en somme, sont les plus forts.
[…] On ne va penser qu’à cela, à se venger de l’Allemagne. Le gouvernement quel qu’il soit ne pourra se maintenir qu’en spéculant sur cette passion. Le meurtre en grand va être le but de tous nos efforts, l’idéal de la France.
Gustave Flaubert. Lettres à George Sand
Cette Commune est une crise de vomissements, les saturnales de la folie.
George Sand Lettres à Gustave Flaubert.
Les communards ? Des têtes de pions, collets crasseux, cheveux luisants, les toqués, les éleveurs d’escargots, les sauveurs du peuple, les déclassés, les tristes, les traînards, les incapables ; pourquoi les ouvriers se sont-ils mêlés de politique ?
Alphonse Daudet
J’abhorre la guerre que le prolétariat parisien vient de susciter. Il s’est rendu cruellement coupable à l’égard de la patrie, ivre qu’il était de doctrines farouches : le devoir étroit des gouvernements est de réprimer fermement le socialisme dans ses écarts anarchiques.
Émile Littré
On demande formellement que tous les membres de la Commune, que tous les journalistes qui ont lâchement pactisé avec l’émeute triomphante, que tous les Polonais interlopes et les Valaques de fantaisie soient passés par les armes devant le peuple rassemblé.
Le Figaro
On les abat à la mitrailleuse. Quand j’ai entendu le coup de grâce, ça m’a soulagé.
Edmond de Goncourt
On ne compte pas que des ivrognes et des énergumènes parmi les fédérés, chefs ou soldats. […] Il y a peut-être chez eux des forces vives et nouvelles qu’il sera juste et même nécessaire d’utiliser.
Catulle Mendès
Il est désormais nécessaire que ceux qui possèdent viennent en aide, par tous les moyens à ceux qui ne possèdent pas. […] Mais l’oisif doit disparaître du monde
Alexandre Dumas, fils
Qu’un vaincu de Paris, qu’un homme de la réunion dite Commune, que Paris a fort peu élue et que, pour ma part, je n’ai jamais approuvée, qu’un de ces hommes, fût-il mon ennemi personnel, surtout s’il est mon ennemi personnel, frappe à ma porte, j’ouvre. Il est dans ma maison. Il est inviolable.
Victor Hugo dans L’Indépendance belge
Le même encore, ailleurs : la victoire est pour les Prussiens, mais la gloire est pour la France. Victor Hugo. Eh, où a-t-il vu de la gloire, lui ? Qu’est-ce que cela prouve ? seulement qu’un génie peut dire de temps à autre une connerie.
Ernest Delahaye est un ami d’enfance d’Arthur Rimbaud. Il rapporte une conversation où il tient des propos très marqués par l’utopie, mais à 17 ans n’est-ce pas ? c’est bien permis ; mais au milieu de ces phrases parfois bien prétentieuses, d’un idéalisme naïf – pénétré d’horreur pour la force et la conquête – vertueux sentiment sur lequel il s’assiéra sans état d’âme quinze ans plus tard quand il se fera marchand d’armes en Abyssinie – se glissent des fulgurances comme cette vision du nazisme qui un jour, viendra corseter l’Allemagne pour l’emmener dans la folie meurtrière.
Il envisage d’une façon toute particulière le patriotisme. Rejetant l’idée de nationalité qu’il veut remplacer par celle de république européenne, pénétré d’horreur pour la force et la conquête qu’enguirlandent l’hypocrisie et la sottise pour l’unique profit, au fond, de sales canailles convoitises individuelles, il méprise, il déteste les Prussiens, non parce qu’ils sont vainqueurs mais parce que leur victoire en fera un peuple bête.
Je dois placer ici une conversation datant de 1871. Les deux villes, toutes voisines de Charleville et de Mézières étaient souvent traversées par des troupes qui retournaient en Allemagne. Fantassins noirs, bleus, verts, cuirassiers moyenâgeux, artilleurs à ceinturon blanc, casque à pointe, casque à boule, caque à chenille, fourgons, caissons peints en gros, canons à culasse dument emmaillotée défilaient chaque jour. Parfois, il y avait des revues générales où paradait une division. C’était un spectacle évité par les gens dignes. Mais les gamins allaient voir.
Rimbaud, sarcastique, remarquait l’extrême discipline, la parfaite obéissance, l’extraordinaire précision de mouvement, l’habillement confortable des troupes, leur bonne mine ; il rappelait tous les racontars dont s’était bercée l’illusion française, au commencement de la campagne, sur ces soldats que l’on représentait, si complaisamment comme affamés, en loques, prêtes à la révolte, puis il détaillait nos fautes, mettait en regard de notre imprévoyance la complète organisation, la science méthodique de l’ennemi.
Ah ! fis-je mélancoliquement, ces gens-là nous sont bien supérieurs ! Il se retourna vivement : ils nous sont bien inférieurs. Et comme j’éternuais de stupéfaction à cette conséquence inattendue de ses précédentes paroles :
Oui, continua Rimbaud, le peuple allemand paiera cher sa victoire. Les imbéciles ! Derrière leurs aigres trompettes et leurs plats tambours, ils s’en retournent dans leur pays manger leurs saucisses, et ils croient que c’est fini. Mais attends un peu ! Les voilà maintenant militarisés à outrance, et pour longtemps, et sous des maîtres bouffis d’orgueil, qui ne les lâcheront pas ! Ils vont avaler toutes les saletés de la gloire. Obligés de se maintenir en face de l’Europe envieuse et inquiète, qui leur préparera des coups de Jarnac, ils en ont pour cinquante ans à être cravachés… Je vois d’ici l’administration de fer et de folie qui va encaserner la société allemande, la pensée allemande… Et tout cela, pour être écrasés à la fin par une coalition !… Si encore ils s’en tenaient à la ridicule satisfaction d’avoir été les plus forts ! Mais non, ils nous prennent deux provinces : ils veulent étendre la teinte plate qui marque leur pays sur une carte… afin d’être bien sûrs qu’on reviendra un jour leur tomber dessus ! Bismarck est plus idiot que Napoléon I° !…
Napoléon n’a rien compris à la mission que lui assignaient les circonstances. Arrivé par la révolution, il l’a fait avorter stupidement. Au lieu d’organiser le communisme, – chose facile, puisque la propriété n’existait plus guère de fait, et plus du tout moralement et légalement – il a rebâti une société plus inique que l’ancienne. Un rôle colossal s’offrait à lui ; il n’a pas voulu, il n’a pas vu, il n’a pensé qu’à rester, à se traîner si longtemps qu’il pouvait, – par des moyens surannés, enfantins : la conquête, la gloire, – à la tête de quelques centaines d’individus qui l’ont jeté dehors, comme un chien galeux, quand il n’a été plus bon à rien. En France, il a tout gâché : sens artistique, sens littéraire, l’administration, l’instruction publique, même le catholicisme. La centralisation, qui peut être une bonne chose, il l’a rendue stérilisante, néfaste. En Europe, avec toutes ses tueries, il n’a rien empêché, rien fixé, rien fait ; mais il a donné aux ennemis de son pays une force qu’ils n’avaient jamais eue, sans compter la saignée de trois millions d’hommes dont il a appauvri la race française.
N’importe ! Les Allemands nous sont inférieurs ; car plus un peuple est vaniteux, plus il approche de la décadence. L’histoire le prouve. Du moment qu’une nation veut conquérir, sortir de chez elle pour en dominer d’autres, elle marche au suicide. Les Allemands nous sont inférieurs à cause de leur victoire qui les abrutit.
Notre chauvinisme a reçu un coup dont il ne se relèvera pas. Tant mieux ! La défaite nous libère de préjugés stupides, la défaite nous transforme et nous sauve.
Ernest Delahaye, alias Rimbaud. Revue littéraire de Paris et de Champagne. Paris Reims 1905/1906.
05 1871
Claude-Marie Perret, tailleur de pierre, est condamné à mort par contumace pour avoir participé à l’incendie des Tuileries : il s’enfuira en Belgique avec son épouse Pauline Lucie Lorimey : et c’est ainsi que leurs trois enfants, futurs architectes illustres naîtront en Belgique, Auguste à Ixelles et Gustave et Claude à Laeken où leur père a créé une entreprise de bâtiment, suffisamment prospère pour leur permettre de regagner Paris, à la faveur d’une loi d’amnistie en 1880. Au tribunal, madame Lemel, inculpée elle aussi, déclarera : Puisque nous ne voulons plus de roi, nous n’avons plus besoin de palais.
Un an plus tard, Ludovic Halévy dira dans ses Carnets son sentiment, avec plus de sécheresse que Clément : Je commence à m’embrouiller moi, dans ces insurrections qui sont un devoir et dans ces insurrections qui sont un crime : je ne vois pas bien la différence.
*****
Je vous accorderais que la France est dans un état désespéré si on pouvait la considérer comme soumise aux règles ordinaires, mais elle a toujours été un pays si étrange, si plein d’anomalies que la morale commune fondée sur l’histoire lui est absolument inapplicable.
Lord Westbury. 1872
Le même jour, le journal Le Faucigny publie un manifeste sécessionniste, qui met à profit la défaite de la France pour demander l’organisation d’un nouveau référendum, respectueux des procédures qui s’y attachent : aujourd’hui le Conseil d’État annule des élections pour des irrégularités qui sont des broutilles en regard de celles alors commises par Napoléon III.
Monsieur Thiers, lui, y répondra par l’envoi de 10 000 hommes en Savoie, dont 1 000 à Bonneville.
09 1871
L’Allemand Heinrich Schliemann, persuadé, contrairement à la majorité des archéologues, que la ville de Troie, chantée par Homère dans l’Odyssée, est située à l’emplacement du village d’Hissarlik, à 6 km du détroit des Dardanelles, se met à creuser, ne s’encombrant pas des couches successives qu’il croit être postérieures à Troie : il alla en fait trop bas, mettant à jour des ruines d’une ville datant d’un millier d’années avant la Troie de Priam… qu’il avait dépassé, 3 niveaux plus haut. Il parvint à évacuer le trésor découvert – 9 000 objets en tout – hors de Turquie, illégalement bien entendu, mais ce fut pour le donner à la Grèce qui mit tout cela au musée d’Athènes. Il fit à nouveau une fabuleuse découverte à Mycènes en 1878, où il crut découvrir le tombeau d’Agamemnon, faisant là encore erreur, car sa trouvaille était antérieure de plusieurs siècles. Il reste néanmoins l’un des pionniers de l’archéologie et de la stratigraphie.
J’ai le grand plaisir de vous annoncer que je viens de découvrir les tombeaux qui, dans la tradition, sont connus pour être ceux d’Agamemnon, Cassandre, Eurymédon et leurs camarades. À l’intérieur j’ai trouvé un trésor colossal qui se compose d’objets archaïques en or massif.
Heinrich Schliemann au roi Georges I° de Grèce, en 1876
10 1871
Une vache pas sage renverse une lampe à pétrole dans l’écurie de Catherine O’Leary, à Chicago et c’est les trois-quarts de la ville qui brûlent : 300 morts, 17 000 bâtiments partis en fumée, 200 millions $ de dégâts. Peut-être la ville, détentrice d’un bon savoir sur les animaux, avait entendu parler de l’origine thérapeutique des eaux d’Avène en France, puisque l’histoire dit que c’est un cheval qui en a été le premier bénéficiaire en 1736… toujours est-il que les très nombreux brûlés furent soignés, avec une grande efficacité, avec de l’eau d’Avène. La ville sera reconstruite en pierre et en brique, un excellent isolant, à laquelle on s’attachera à donner un style néo gothique d’un conservatisme qui exclue toute créativité ; mais les matériaux vont évoluer : la fonte va faire place à l’acier, moins cassant et les premiers gratte-ciel verront le jour 15 ans plus tard : le conformisme esthétique devra faire de plus en plus de place à la logique résumée dans la formule de Louis Sullivan : Form follows function – la forme suit la fonction -. Quarante ans plus tôt, la ville n’était encore qu’un gros hameau d’Indiens et de marchands de fourrure. Sa position sur les rives du lac Michigan, au cœur d’un réseau ferroviaire et routier – voie ferrée vers l’ouest dès 1848 – vont en faire rapidement le point de convergence des grains, des bestiaux et des produits de la forêt. Les abattoirs de l’Union Stockyards ont ouvert en 1865. En 1870 la ville compte 300 000 habitants.
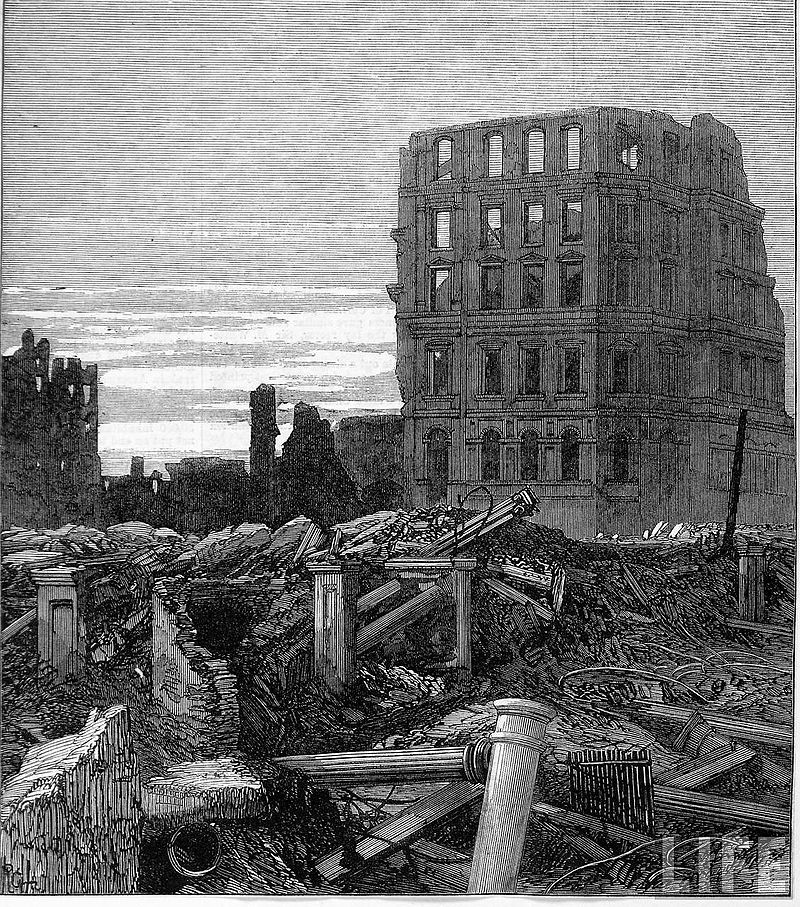

L’intersection de Dearborn Street et Monroe Street après l’incendie.
8 11 1871
Charles Francis Hall, commandant du Polaris, meurt après avoir bu du café. Bizarre ! En juin 1872, une tentative a été faite pour atteindre le pôle, en vain. Un an plus tôt, le 8 novembre 1871, la mort très brutale et donc suspecte – juste après avoir pris une tasse de café – du chef d’expédition Hall, par 83°05′ N, laisse planer le soupçon d’empoisonnement, par un – ou plusieurs – membre de l’équipage. Quand on mesure le poids de la qualité des relations humaines dans une expédition de ce genre, il n’est guère étonnant que tout cela ait mené à la catastrophe et les naufragés qui ont dérivé vers le sud ne doivent leur vie qu’aux Esquimaux.
Charles Francis Hall était un homme excentrique, sans doute le type le moins susceptible de devenir explorateur de l’Arctique, explique Russell A. Potter, professeur au Rhode Island College. Peu éduqué, ce père de famille menait une vie tranquille de graveur et d’éditeur modeste à Cincinnati, dans l’Ohio. Mais l’intérêt qu’il portait pour la quête vouée à l’échec de Franklin s’était transformé en une obsession pour l’Arctique et une mission personnelle destinée à trouver des survivants.
À la fin des années 1850, plusieurs expéditions avaient permis de retrouver le corps et des objets des membres de l’équipage de Franklin, réduisant les espoirs de trouver des survivants. Cela n’empêcha cependant pas Charles Francis Hall, alors âgé de 39 ans, de quitter l’Ohio pour l’Arctique en 1860 pour, s’il le pouvait, sauver des naufragés.
L’homme se rendit dans l’Arctique à deux reprises pendant les années 1860. S’il ne trouva aucun survivant de l’équipe de Franklin, il vécut cependant parmi les Inuits pendant près de huit ans et fut le premier à décrire leur culture de manière aussi détaillée.
À son retour à Washington en 1869, Charles Francis Hall avait une nouvelle lubie : partir pour le pôle Nord, devenu le principal objectif des explorateurs de l’Arctique en lieu et place du passage du Nord-Ouest. Outre le fait que la recherche de ce passage était coûteuse, ce dernier était également considéré par beaucoup comme non rentable d’un point de vue commercial. Grâce à un travail de lobbying important, Hall parvint à obtenir le soutien du président Ulysses S. Grant.
Le Congrès débloqua 50 000 $ pour l’expédition, la première entièrement financée par le gouvernement fédéral. Un bateau à vapeur à pale utilisé par l’Union lors de la guerre de Sécession fut rénové pour affronter la banquise arctique, sa coque renforcée avec du chêne et sa proue recouverte d’acier. Renommé l’U.S.S Polaris, le navire quitta New York le 29 juin 1871 avec à son bord vingt-cinq membres d’équipage, dont le guide inuit Ipirvik et son épouse Taqulittuq ainsi que leur petit garçon. Le bateau fit escale au Groenland, où l’équipage fut rejoint par le guide et chasseur Inuk Hans Hendrick et sa famille.
Si Charles Francis Hall savait comment survivre dans l’Arctique, il ignorait comment diriger une expédition de cette envergure. Il était un commandant sans rang militaire ou naval et un capitaine sans expérience en mer. C’est finalement Sidney O. Budington qui endossa le rôle de navigateur, tandis que le rôle d’assistant de navigation revint à George E. Tyson. Le navire était donc placé sous le commandement de trois personnes.
Comme si cela ne suffisait pas, une équipe de scientifiques allemands, également à bord, suscita de nouvelles divisions. Celle-ci était dirigée par le scientifique et chirurgien Emil Bessels, 24 ans et diplômé de l’école de médecine de l’université de Heidelberg. Lui et son équipe n’avaient que peu de respect pour Hall l’inculte.
Après un mois en mer, la tension était palpable et les conflits de plus en plus nombreux. Comme l’écrivit par la suite George E. Tyson, certains membres du groupe semblent prêts à tout pour défier l’ordre, et si Hall veut que quelque chose soit fait, c’est exactement ce qu’ils ne feront pas. Il existe déjà deux groupes, si ce n’est trois, à bord.
Ceci n’empêcha pas le Polaris de poursuivre sa route, devenant le premier navire de l’histoire à naviguer dans des eaux aussi septentrionales, à une latitude de 82° 29’N. Il n’alla cependant pas plus loin. Contraint à faire demi-tour par la banquise dans la mer de Lincoln, le Polaris passa l’hiver dans le nord-ouest du Groenland, dans un lieu surnommé le port de la délivrance par Hall, à 800 km au sud du pôle Nord.
Après deux semaines passées à explorer le Nord en traîneau, Charles Francis Hall regagna le navire le 24 octobre 1871. Il tomba gravement malade après avoir bu une tasse de café. L’explorateur délirait et souffrait d’une paralysie partielle, ce qui laissa penser à Emil Bessels qu’il est atteint d’apoplexie (un AVC).
Hall était quant à lui convaincu que le chirurgien essayait de l’empoisonner. Il alla même jusqu’à l’interdire de le soigner entre le 29 octobre et le 4 novembre, durée au cours de laquelle son état s’améliora. L’Américain, qui se sentait mieux au point de pouvoir sortir sur le pont, fit néanmoins une rechute et mourut le 8 novembre 1871. Il fut enterré non loin de là.

gravure de 1880 : procession funéraire de Hall, son cercueil recouvert du drapeau américain.
Cette nuit-là, dix-neuf membres de l’expédition, dont George E. Tyson et tous les Inuits, se trouvaient sur la banquise lorsque celle-ci se brisa soudainement. Dans l’obscurité de la nuit, le navire se dégagea de la glace, laissant les pauvres explorateurs coincés sur le floe. Très vite, le contact fut perdu entre le navire et ses quatorze hommes à bord (dont Budington) et le groupe sur le floe. Celui-ci dériva pendant plus de six mois avant d’être secouru par un baleinier au large de la côte du Labrador. Le groupe dut sa survie aux Inuits qui étaient parmi eux et qui chassèrent depuis le bord du floe.

C’est dans le détroit de Smith, au nord de la baie de Baffin, que le Polaris se libéra soudainement des glaces, laissant derrière lui dix-neuf membres d’équipage bloqués sur un floe. Ils dérivèrent pendant plus de six mois sur près de 2 900 km, dans des conditions extrêmes, avant d’être secourus au large du Labrador.
PHOTOGRAPHIE DE Bertrand Rieger, Gtres
Les quatorze survivants à bord du Polaris connurent eux aussi une véritable odyssée. Alors que le charbon commençait à manquer, Budington décida de faire échouer le navire près d’Etha, au Groenland. L’équipage se construisit une cabane et survécut à l’hiver grâce à l’aide des Inuits du coin. Avec le bois récupéré sur le Polaris, il fabriqua ensuite deux voiliers avant de prendre la direction du sud. Les quatorze hommes furent secourus le 23 juin 1873 par un baleinier au large du cap York.
UN MEURTRE TOUJOURS NON ÉLUCIDÉ
Malgré l’ouverture d’une enquête sur la mort de Charles Francis Hall par la Navy, personne ne put être inculpé en raison des témoignages contradictoires et de l’impossibilité d’effectuer une autopsie du corps. Les autorités étaient par ailleurs peu enclines à ajouter un scandale à une expédition déjà désastreuse.
Près d’un siècle après la disparition de Hall, l’historien spécialiste de l’Arctique Chauncey C. Loomis a enquêté sur ce mystère, une expérience qu’il relate dans son ouvrage intitulé Le Robinson de la banquise : L’histoire de Charles Francis Hall, explorateur. À la demande de l’historien, le corps de l’explorateur est exhumé en 1968. Les analyses révèlent alors qu’il avait ingéré d’importantes doses d’arsenic au cours des deux semaines précédant sa mort. La substance était à l’époque un incontournable des trousses médicales, mais n’était jamais administrée dans de telles quantités. Chauncey C. Loomis a dans un premier temps soupçonné Budington, qui redoutait le voyage vers le nord, d’avoir assassiné Hall, mais l’arsenic avait été administré pour simuler une apoplexie, ce que Budington n’aurait su faire.
L’historien a donc conclu qu’Emil Bessels était la seule personne dotée des compétences nécessaires pour assassiner Hall, mais il n’avait pas de mobile digne de ce nom. Le chirurgien ne cachait certes pas son dédain pour Hall, lequel lui retournait la faveur en le surnommant « le petit maître de danse allemand ». Selon Chauncey C. Loomis, cette antipathie ne constituait pas un mobile suffisamment solide pour tuer quelqu’un.
La découverte d’un nouvel élément de preuve en 2015 par Russell Potter, professeur au Rhode Island College, a rebattu les cartes. Il s’agissait d’une enveloppe tamponnée par la Poste le 23 octobre 1871 et adressée par Charles Francis Hall à Miss Vinnie Ream, une artiste talentueuse âgée de 24 ans qui avait réalisé une statue d’Abraham Lincoln alors qu’elle n’avait que 18 ans. Cette dernière avait fréquenté Hall et Bessels à New York avant que les deux hommes n’embarquent à bord du Polaris.
Russell Potter savait que Miss Ream et Emil Bessels s’écrivaient des lettres, ce qui suggérait l’existence d’une relation romantique. L’artiste avait également envoyé un buste de Lincoln à Charles Francis Hall, qui l’avait placé dans sa cabine sur le Polaris. Selon le professeur, un triangle amoureux serait la raison du meurtre de l’explorateur. « Ceci donne à Bessels un autre mobile solide. Mais sans machine à remonter le temps, je doute que cette affaire soit un jour complètement élucidée », reconnaît Russell Potter.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.
10 11 1871
Stanley, retrouve à Uji, sur les rives du lac Tanganyika David Livingstone, debout, isolé, s’abritant les yeux de la main, en veston de flanelle rouge, pantalon gris et casquette à bande d’or, vieux gentleman maigre au visage chagrin, malade donné pour mort en Angleterre.
Nous avançons rapidement. Nous faisons halte près d’un petit torrent dont nous escaladons la haute berge nue, le tout dernier d’une myriade que nous avons traversés. Nous arrivons au sommet, et voilà Ujiji dessous nous, enchâssé dans les palmiers, à moins de deux cents mètres de nous. À cet instant capital, nous ne pensons plus aux centaines de milles que nous avons parcourus, aux centaines de collines que nous avons escaladées et redescendues, aux nombreuses forêts que nous avons traversées, aux jungles et aux broussailles qui nous ont exaspérés, aux plaines salées qui ont martyrisé nos pieds, aux soleils brûlants qui nous ont brûlés, ni aux dangers et aux difficultés désormais surmontés avec succès. C’est notre cœur et nos émotions qui soutiennent nos yeux braqués sur les palmiers en essayant de deviner dans quelle hutte ou maison loge l’homme blanc avec la grande moustache grise dont nous avons entendu parler au Malagarazi. Nous sommes maintenant à environ cent mètres du village d’Uji et une foule dense commence à m’entourer. Soudain, j’entends une voix sur ma droite dire
– Bonjour, Sir ! C’est Susi, le domestique de Livingstone.
– Quoi ! Est-ce que le Docteur Livingstone est par là ?
– Oui, Sir.
– Dans ce village ?
– Oui, Sir.
– En êtes-vous sûr ?
– Certain, certain. Je viens juste de le quitter.
Comme j’avançais doucement dans sa direction je constatai qu’il était pâle, qu’il semblait exténué… J’aurais voulu courir à lui, seulement la présence d’une foule aussi importante m’a effrayé ; j’aurais voulu l’embrasser, mais c’était un Anglais et je ne savais pas comment il aurait accepté cela. Aussi je fis ce que la couardise et une fierté mal placée me suggéraient comme étant la meilleure chose à faire, je marchai délibérément vers lui, soulevai mon chapeau, et dis :
– Docteur Livingstone, je suppose ?
– Oui, c’est mon nom, répondit-il avec un doux sourire, tout en soulevant doucement son chapeau.
Il n’avait pas vu d’Européen depuis six ans.
L’échange fameux, trop fameux, appartient très probablement à la cohorte sans fin des mots historiques – Du haut de ces pyramides, quarante siècles vous contemplent- etc etc .. qui n’ont jamais été prononcées par leur présumé auteur mais inventés par les commentateurs avides du poids des mots autant que du choc des photos, fabricants de fiction, sans scrupules aucuns quant au respect de la réalité. En l’occurrence, pour ce qui concerne Stanley, il est pour le moins étrange que l’on trouve cela seulement dans le récit qu’il en a fait dans le New York Herald et non dans son propre carnet de voyage, dont les pages correspondantes ont été arrachées ; et le journal de Livingstone ne rapporte rien de tel. Il lui fallait probablement trouver des mots à même de répondre à l’attente des lecteurs, mis en condition depuis des mois par Gordon Bennett, le patron du New York Herald

David Livingstone Henry Morton Stanley

Lithographie du XIX° siècle
En 1863, le gouvernement anglais avait révoqué la mission dont il avait chargé Livingstone. De retour en Afrique trois ans plus tard, il était revenu au lac Nyassa depuis la côte est, était arrivé le 1° avril 1867 à l’extrémité sud du lac Tanganyika, accompagné de quelques fidèles indigènes. Le 8 novembre 1867, il découvre le lac Moero, en juillet 1868, le lac Bangoueolo. Du lac Tanganyika, il repart vers l’ouest où il découvre la source de la Loualaba, – nom du cours supérieur du Congo – un peu à l’ouest de Lumumbashi, qu’il prend pour celles du Nil. Le 15 octobre, il avait assisté au massacre de 400 esclaves africains par des Arabes esclavagistes. Il n’a plus la force de vérifier ce qu’il croit avoir découvert et revient à Uji, sur les bords du lac Tanganyika. Il y est le 23 octobre, quatre jours avant Stanley. Avec Stanley, il découvrira que le lac Tanganyika n’alimente pas le lac Victoria, et ne peut donc être la source du Nil… qui ne se trouve pas très loin. Ils se quittent le 14 mars 1872… pour ne plus se revoir.
Un mysticisme voisin du martyre rejoignait chez lui la soif de la découverte.
Stanley
En fait, à 59 ans, Livingstone n’est plus en mesure de poursuivre ses explorations épuisantes. Il poursuit néanmoins ses recherches de la source du Nil. Le 31 mai 1872 il écrit : En ce qui concerne cette source du Nil, je suis en perpétuel doute et perplexité. La grande Loualaba peut s’avérer comme étant le Congo. Vers le Nil, elle serait plus courte. Sa grande courbe vers l’ouest est en faveur du Congo. J’en sais déjà trop pour me montrer trop affirmatif.
Il mourra épuisé le 30 avril 1873 sur les bords du lac Banguelo. Stanley était alors rentré en Europe. Ses serviteurs, se comportant à l’opposé de la tradition africaine, embaumeront son corps pour l’emmener sur Zanzibar, d’où il sera ramené sur l’Angleterre natale.
Son caractère et sa carrière ont été de ceux qui seront toujours un exemple pour notre race. Né sans avantages sociaux, sans perspectives encourageantes, sans appuis influents, cet invincible Écossais a taillé son chemin à travers le monde et profondément gravé son nom dans l’histoire de l’Humanité, pour finalement être mis au tombeau dans l’abbaye de Westminster parmi l’admiration pleine de regrets de tout un peuple, laissant un nom qui brillera à jamais pour nos compatriotes. Comment donc y est-il arrivé ?
Par l’audace dans la conception, la fertilité dans l’imagination, le courage dans l’exécution, par une noble endurance dans la souffrance et le désappointement, par le sacrifice de lui-même jusqu’à la mort : c’est ainsi qu’il a pu, de l’insuccès même, faire sortir le triomphe, et dans la pire obscurité ne cesser de voir devant lui la lumière. L’œuvre de Livingstone se dresse toujours avec une grandeur monumentale parmi les réalisations de l’énergie humaine.
Lord Curzon, en 1913 à l’occasion du centenaire de sa naissance
Deux dévoués Zanzibarites avaient transporté le corps embaumé du vénérable Dr Livingstone sur les milliers de kilomètres qui séparent les grands lacs de Bagamoyo, sur la côte. Ils lui avaient d’abord ôté le cœur qu’ils avaient enterré là où il était mort, puis ils avaient embaumé le corps. Comment avaient-ils pensé à faire cela ? Où donc deux porteurs indigènes avaient-ils pu trouver l’idée d’un geste aussi noble et aussi symbolique ? imaginez deux journaliers, deux terrassiers de chez nous, auxquels serait venue pareille idée. Peut-être le bon docteur avait-il laissé des instructions, mais, même dans ce cas, ils auraient pu tout aussi bien jeter sa dépouille dans le premier marigot et se hâter de rentrer chez eux Quel saint il avait fallu que cet homme soit pour inspirer à ses gens pareille loyauté.
Abdulrazak Gurnah Adieu Zanzibar Denoël. 2022 Nobel de littérature 2021
23 12 1871
Albert de Mun, René de la Tour du Pin et Maurice Maignen fondent à Paris les premiers cercles ouvriers.
28 12 1871
Antonio Meucci protège son invention du téléphone, par un avertissement de brevet, formule renouvelable plus économique qu’un brevet. Deux semaines auparavant, il a fondé la Telettrofono Company avec trois associés – le telettrophone, c’est le nom de son invention, réalisé dès 1850 pour pouvoir communiquer depuis son bureau avec sa femme immobilisée dans sa chambre par des crises d’arthrite. N’ayant pas les moyens financiers de prolonger son avertissement de brevet, il va le laisser expirer en 1876. Ayant fait des études de mécanique dans son Italie natale, il vit à Cuba depuis 1835 où il est technicien de théâtre. Il faudra attendre cent trente et un ans pour que, le 11 juin 2002, la Chambre des représentants lui fasse justice : Expressing the sense of the House of Representatives to honor the life and achievements of 19th Century Italian-American inventor Antonio Meucci, and his work in the invention of the telephone.
Jusqu’en 1989, personne n’avait jamais remis en question la paternité de Bell sur l’invention du téléphone, quand, cette année-là, Basilio Catania, ancien directeur général de la CSELT -l’agence de recherche et de développement des télécoms italiennes-, découvre les travaux d’Antonio Meucci, alors qu’il est technicien du théâtre à Florence. Basilio Catania renifle alors une éventuelle spoliation de Meucci par Bell. L’appareil construit par Meucci, le Telettrophone, aurait bel et bien fonctionné. Réalisé dès 1850, il en aurait fait une démonstration à son ami Enrico Bendelari dix ans plus tard, et l’expérience aurait été relatée par un journal new-yorkais de langue italienne, L’Eco d’Italia.
Il va alors rencontrer B. Grant, vice-président de la Western Union Telegraph Company, en vue d’une démonstration. C’est à partir de là que la spoliation aurait commencé. Grant aurait offert à Meucci d’utiliser ses locaux et d’y entreposer son matériel, et lui aurait demandé d’examiner les plans de son invention. Ceci étant fait, Grant aurait systématiquement repoussé la démonstration, permettant à Graham Bell, écossais naturalisé canadien, professeur de physiologie vocale, qui aurait travaillé dans ces locaux, de voler l’invention de Meucci. En mars 1876, Graham Bell déposa le brevet du téléphone, transfert du son par voie électromagnétique, puis expérimenta son appareil à l’exposition internationale de Philadelphie la même année. Puis vint le grand succès de Londres où il installa un téléphone à la Chambre des communes. Pour soutenir cette thèse, Catania s’appuie également sur les travaux d’une commission d’enquête dont l’attention aurait été attirée par les plaintes de Meucci pour ententes illicites : il aurait existé une connexion secrète entre des employés de l’office des brevets et la compagnie de Bell. Et celle-ci s’était engagée à rétrocéder à la Western Union 20 % des bénéfices de l’invention, le téléphone. La controverse, ignorée de la communauté scientifique, a connu un certain écho dans le grand public, et en particulier auprès de la communauté italienne de New York qui est parvenue à convaincre Rudolph Giuliani, le maire, de réhabiliter Meucci en faisant du 1° mai 2000, le Meucci Day, réhabilitation officialisée par la Chambre des Représentants. La querelle est de taille, car on ne peut ignorer par ailleurs l’existence d’un troisième inventeur, Elisha Gray, américain, qui sera en procès longtemps avec Bell, fondée sur un c’était moi le premier au bureau des brevets.
Eugène Mercier a acheté deux ans plus tôt le site du Mont Bernon à Épernay : pendant six ans, il va faire creuser 47 galeries représentant un total de 18 km, jusqu’à 30 mètres en dessous du sol, où il pourra entreposer 18 millions de bouteilles de Champagne à une température constante de 10°C, et un taux d’humidité de 90 %.
Inauguration du tunnel du Mt Cenis. En Angleterre, la RFU : Rugby Football Union entérine la règle du port du ballon à la main. Le ballon restera cependant plus ou moins sphérique jusqu’en 1920 : ses dimensions ovales ne deviendront définitives qu’en 1931. Toujours en Angleterre, Thomas Lipton (1850-1931) monte une épicerie à Glasgow, avec des campagnes publicitaires qu’il a pu observer aux États-Unis. Le succès est au rendez-vous. Neuf ans plus tard, il ouvrira son vingtième commerce. Dans les années 1890, il en possédera plus de trois cents. Mais surtout, au cours d’un voyage en Australie, une escale à Ceylan va transformer sa vie. Il rachète cinq plantations de thé en faillite. Il vendra le thé directement dans ses épiceries. Les intermédiaires sont supprimés. Le slogan est tout trouvé : Direct from the tea gardens to the teapot – Directement des plantations à la théière -. Le succès deviendra vite planétaire.
Les rapports de Genève et de la Savoie du nord continuent à alimenter les gazettes : Chacun sait que la plus forte partie de l’émigration qui envahit Genève se recrute dans les populations de la Savoie du Nord ; d’autre part, ce pays a manifesté à plusieurs reprises sa sympathie pour la Suisse, et ses intérêts matériels sont solidairement liés à ceux de Genève. Ces conditions une fois connues, voici l’influence qu’elles peuvent exercer sur notre canton : si ces populations sont réunies à la Suisse, elles y trouvent la base même de leur intérêt matériel, moral et politique, c’est à dire, leur nationalité véritable. Ce ne sont plus des étrangers, des inconnus sans lien commun avec nous, mais des vrais citoyens suisses rentrant dans leur patrie et leur capitale naturelles, intéressés à son bien-être qui est le leur et à son indépendance qui fixe pour toujours leur sort si souvent tourmenté.
Joseph Bard
31 12 1871
L’Allemand Carl Benz présente le premier moteur à explosion à 2 temps.
________________________________________________________________________________________
[1] En s’effondrant sur le pavé parisien, le mécanisme de la grande horloge résista à la chute : bravo l’horloger.
[2] cinq d’entre eux seront béatifiés ainsi que Mgr Darboy en mai 2023, pratiquement à l’insu des évêques de France, pas du tout chauds à la perspective d’affronter la bronca des toujours chauds partisans de la Commune.
[3] Le retentissement de la Commune à l’international aura une bien réelle existence : le 31 décembre 1922, la Marine de guerre soviétique rebaptisera Kommuna le Volkhov, un catamaran ravitailleur de sous-marin et releveur de sous-marins coulés, lancé en 1913 et toujours en service en 2020 : le plus vieux navire de guerre du monde !
[4] Lequel serait l’un des principaux responsables de la destruction de la colonne Vendôme, insistant pour qu’elle fût entièrement brisée et détruite.
Laisser un commentaire