| Publié par (l.peltier) le 19 octobre 2008 | En savoir plus |
7 04 1823
L’armée des Pyrénées entre en Espagne ; on la nommera les Cent Mille Fils de Saint Louis. Mais de quoi s’agit-il donc ? Louis XVIII serait-il tenté par une aventure là où Napoléon s’était cassé les dents ? En fait, ce n’est que l’application à la lettre d’un engagement du traité de la Quadruple Alliance du 20 novembre 1815, [Russie, Autriche, Prusse, Angleterre] puis d’Aix la Chapelle en 1818 [les mêmes plus la France] qui veut qu’un souverain européen menacé dans l’exercice de son pouvoir puisse faire appel aux autres souverains pour le rétablir dans ses prérogatives.
Conformément aux paroles des Saintes Écritures qui ordonne à tous les hommes de se regarder comme frères, les trois monarques contractant demeureront unis par les liens d’une fraternité véritable et indissoluble, et, se considérant comme compatriotes, ils se prêteront, en toutes occasion et en tout lieu, assistance, aide et secours ; se regardant envers leurs sujets et leurs armées comme père de famille, ils les dirigeront dans le même esprit de fraternité dont ils sont animés pour protéger la religion, la paix et la justice.
Alexandre, tzar de Russie, après le Congrès de Vienne, quand les signataires avaient commencé par n’être que trois : Russie, Autriche, Prusse, d’où l’intitulé : La très Sainte et Indivisible Trinité.
On raconte qu’à la lecture de ce texte, Metternich lâcha une grosse larme de joie.
*****
En 1820, le roi d’Espagne Ferdinand VII avait dû faire face à un soulèvement populaire conduit par les libéraux, qui lui reprochaient son absolutisme et les répressions à leur encontre. Le roi avait dû se soumettre, et remettre en vigueur la Constitution de 1812, confiant ainsi le pouvoir à des ministres libéraux. L’année précédente, des élections avaient donné la victoire à Rafael del Riego. Ferdinand VII s’était retiré à Aranjuez, où il se considérait comme prisonnier des Cortès. À Urgell, ses partisans avaient pris les armes et remis en place une régence absolutiste, puis ils avaient essuyé un échec. Aussi, en 1822, Ferdinand VII, s’appuyant sur les thèses du Congrès de Vienne, avait-il sollicité l’aide des monarques européens, rejoignant la Sainte-Alliance formée par la Russie, la Prusse, l’Autriche et la France pour restaurer l’absolutisme.
En France, les ultras pressent le roi Louis XVIII d’intervenir. Pour tempérer leur ardeur contre-révolutionnaire, le duc de Richelieu avait fait déployer, le long des Pyrénées, des troupes chargées de protéger la France contre la prolifération du libéralisme venant d’Espagne et la contagion de la fièvre jaune. En septembre 1822, ce cordon sanitaire était devenu un corps d’observation, qui se transformera vite en expédition militaire.
Après des débats passionnés à Paris, début 1823 un discours du roi Louis XVIII avait annoncé le soutien français au Roi d’Espagne.
Le 22 janvier 1823, un traité secret était signé lors du congrès de Vérone, qui permet à la France d’envahir l’Espagne pour rétablir Ferdinand VII en monarque absolu. Avec cet accord de la part de la Sainte-Alliance, Louis XVIII annonce le 28 janvier 1823, que cent mille Français sont prêts à marcher en invoquant le nom de Saint Louis pour conserver le trône d’Espagne à un petit-fils d’Henri IV. Les Espagnols appelleront l’armée française : los Cien Mil Hijos de San Luis (les Cent Mille Fils de Saint Louis); le corps expéditionnaire français comporte en réalité 95.000 hommes. Fin février, les Chambres votent un crédit extraordinaire pour l’expédition. Chateaubriand et les ultras exultent : l’armée royale va prouver sa valeur et son dévouement face aux libéraux espagnols pour la gloire de la monarchie des Bourbons.
Le nouveau Premier ministre, Joseph de Villèle, va s’y opposer. Le coût de l’opération lui paraît excessif, l’organisation de l’armée défectueuse et l’obéissance des troupes incertaine. L’intendance militaire est incapable d’assurer le soutien logistique des 95 000 hommes concentrés, fin mars, dans les Basses-Pyrénées et les Landes, avec 20 000 chevaux et 96 pièces d’artillerie. Pour pallier ses carences, il faut recourir aux services du munitionnaire Ouvrard, prompt à conclure en Espagne, au détriment du Trésor public, des marchés aussi favorables à ses propres intérêts qu’à ceux de l’armée.
Louis XVIII confie le commandement de l’expédition à son neveu le duc d’Angoulême, fils aîné du futur Charles X.
Il faut bien donner aux fidèles des Bourbons l’occasion de montrer leurs grades fraîchement acquis qu’ils doivent au roi, sans compromettre ni la sûreté, ni l’efficacité de l’armée. La solution retenue est habile : aux anciens émigrés et Vendéens les commandements secondaires, aux anciens généraux de la Révolution et de l’Empire les responsabilités principales. Le duc d’Angoulême, fils de Charles X, est nommé commandant en chef de l’armée des Pyrénées, malgré son manque d’expérience militaire, mais il accepte de n’assurer que les honneurs de son titre et la direction politique de l’expédition, laissant à son major général, Guilleminot, général d’Empire aux compétences reconnues, le soin de prendre les décisions militaires. Sur cinq corps d’armée, quatre sont placés sous les ordres d’anciens serviteurs de Napoléon : le maréchal Oudinot, duc de Reggio, le général Molitor, le maréchal Bon Adrien Jeannot de Moncey, duc de Conegliano et le général Étienne Tardif de Pommeroux de Bordesoulle. Le prince de Hohenlohe commande le 3° corps, le plus faible avec deux divisions au lieu de trois ou quatre et 16 000 hommes au lieu de 20 000 à 27 000 pour les autres.
Il faut maintenant savoir si les régiments, où il y a nombre d’officiers, de sous-officiers et de soldats marqués par les souvenirs des campagnes impériales, sont disposés à marcher gentiment pour les Bourbons de France et d’Espagne. Les libéraux espèrent les dissuader d’aller combattre pour des moines, contre la liberté. Villèle s’inquiète de leur propagande dans les cabarets et les chambrées, où se diffuse, en mars et avril, une chanson de Béranger incitant les militaires à la désobéissance :
Brav’ soldats, v’la l’ord’ du jour : / Point de victoire / Où n’y a point de gloire. / Brav’ soldat, v’la l’ord’ du jour : / Gard’ à vous! Demi-tour !
Le 6 avril, les doutes des uns et les illusions des autres se dissipent. Sur les rives de la Bidassoa, cent cinquante libéraux français et piémontais se présentent face aux avant-postes du 9° léger. Parmi eux se trouvent le colonel Fabvier et une trentaine d’officiers en uniforme. Ils brandissent le drapeau tricolore, chantent La Marseillaise et incitent les soldats à ne pas franchir la frontière. Les fantassins du roi hésitent. Le général Vallin accourt et ordonne d’ouvrir le feu. Plusieurs manifestants sont tués. Les autres se dispersent. Beaucoup forment quelques semaines plus tard, avec les Anglais du colonel Robert Wilson, les Belges de Janssens et d’autres volontaires venus de France ou d’Italie, une légion libérale et un escadron de lanciers de la liberté, qui combattent aux côtés des forces constitutionnelles.
Le 7 avril, l’armée des Pyrénées pénètre sans bruit en Espagne. Le clergé, les paysans, les absolutistes de l’armée de la Foi lui font bon accueil. Les armées constitutionnelles, soutenues surtout par la bourgeoisie et une partie de la population urbaine, se replient. Le gouvernement libéral et les Cortès transfèrent leur siège à Séville, puis, le 14 juin, à Cadix, emmenant avec eux le roi Ferdinand VII. Le 23 mai, les troupes françaises entrent dans Madrid, où le duc d’Angoulême installe une régence sous son protectorat. Jusqu’en novembre, elles livrent à travers toute la péninsule une série de combats aux libéraux.
Au nord, les divisions de Hohenlohe, renforcées en juillet par le 5° corps de Lauriston, obligent le général Pablo Morillo à battre en retraite, puis à se rallier. Elles contrôlent la Navarre, les Asturies, la Galice. Mais faute de matériel de siège, elles ne peuvent que bloquer les villes où les constitutionnels prolongent la résistance durant plusieurs mois. La Corogne ne capitule que le 21 août, Pampelune le 16 septembre, Saint-Sébastien le 27.
À l’est et au sud-est, Molitor repousse Ballesteros en Aragon, le poursuit jusqu’à Murcie et Grenade, le combat victorieusement à Campillo de Arenas le 28 juillet et obtient sa reddition le 4 août. Aux abords de Jaén, il défait les dernières colonnes de Riego, lequel est capturé par les absolutistes le 15 septembre et pendu le 7 novembre à Madrid, deux jours avant la chute d’Alicante.
En Catalogne, Moncey parvint difficilement à réduire les unités régulières et les guérilléros du général Mina. Barcelone ne se rend que le 2 novembre.
En Andalousie se déroulent les opérations les plus décisives, parce qu’elles visent le principal objectif stratégique de la campagne : Cadix, transformée provisoirement en capitale politique. Une garnison de 14 000 hommes y défend le gouvernement et les Cortès, dont le roi est le prisonnier. Riego, au début, les généraux L’Abisbal, Quiroga et Alava jusqu’à la fin, dirigent son action. Les accès de la place sont protégés par les batteries des forts Sainte-Catherine et Saint-Sébastien à l’ouest, du fort Santi-Pietri à l’est et surtout de la presqu’île fortifiée du Trocadéro, où le colonel Garcès dispose de 1 700 hommes et de 50 bouches à feu.
Sous le commandement du général Bordesoulle, bientôt rejoint par le duc d’Angoulême et Guilleminot, l’infanterie des généraux Bourmont, Obert et Goujeon, la cavalerie de Foissac-Latour, l’artillerie de Tirlet, le génie de Dode de La Brunerie prennent position devant Cadix à partir de mi-juillet. La marine, contrainte d’employer plusieurs divisions navales à la surveillance des côtes et des ports de l’Atlantique et de la Méditerranée où s’accrochent les constitutionnels, n’envoie pour bloquer le port qu’une petite escadre d’à peine dix bâtiments, avec lesquels le contre-amiral Hamelin ne peut assurer sa mission. Le 27 août, il est remplacé par le contre-amiral des Rotours, puis par Duperré, qui n’arrive que le 17 septembre, avec des moyens renforcés. Le 31 août, l’infanterie française donne l’assaut du Fort du Trocadéro. Au prix de 35 tués et 110 blessés, elle s’empare de la presqu’île et de ses puissants canons retournés contre la ville de Cadix. Elle inflige à l’ennemi la perte de 150 morts, 300 blessés et 1 100 prisonniers.
Le 20 septembre, le fort Santi-Pietri tombe à son tour devant une action combinée de l’armée et de la marine. Le 23, ses canons, ceux du fort du Trocadero et de la flotte de Duperré bombardent la ville. Le 28, les constitutionnels jugent la partie perdue : les Cortès décident de se dissoudre et de rendre à Ferdinand VII le pouvoir absolu. Le 30, Cadix capitule. Le 3 octobre, plus de 4 600 Français débarquent sur les quais du port.
L’armée du roi de France tire ses derniers coups de fusil au début du mois de novembre. Le 5 novembre, le duc d’Angoulême quitte Madrid. Il rentre en France le 23, laissant derrière lui un corps d’occupation de 45 000 hommes, sous le commandement de Bourmont. L’évacuation progressive de l’Espagne ne s’achèvera qu’en 1828.
Chef de l’état-major général du duc d’Angoulême, le général Armand Charles Guilleminot rédige l’ordonnance d’Andujar qui provoque la colère des royalistes espagnols, car elle est jugée trop clémente pour les libéraux vaincus.
Les libéraux négocient alors leur reddition en échange du serment du roi de respecter les droits des Espagnols. Ferdinand VII accepte. Mais le 1° octobre 1823, se sentant appuyé par les troupes françaises, Ferdinand VII abroge de nouveau la Constitution de Cadix, manquant ainsi à son serment. Il déclare nuls et sans valeur les actes et mesures du gouvernement libéral. C’est le début de la décennie abominable pour l’Espagne.
*****
Enjamber d’un pas les Espagnes, réussir là où Bonaparte avait échoué, triompher sur ce même sol où les armes de l’homme fantastique avaient eu des revers, faire en six mois ce qu’il n’avait pu faire en sept ans, c’était un véritable prodige !
Chateaubriand, ministre des affaires étrangères du gouvernement Villèle (du 28 décembre 1822 au 6 juin 1824), Mémoires d’outre-tombe
Wikipedia
9 05 1823
Manifeste de la Chambre Royale des Comptes portant notification du Règlement approuvé par Sa Majesté Charles Félix de Savoie pour la visite et les courses des glaciers et autres endroits remarquables de la vallée de Chamonix. Plus simplement, c’est la création de la Compagnie des Guides de Chamonix. Le catholicisme, religion d’État, vit ses dernières belles années et le règlement précise qu’ Il est défendu à tout guide d’entreprendre une course dans les jours de fête sans avoir préalablement rempli les devoirs de la religion et avoir entendu la sainte messe. Lequel catholicisme fréquentait encore avec assiduité l’obscurantisme : c’est dans ces années-là que le pape Léon XII fit interdire la vaccination dans les États pontificaux, car d’invention diabolique.
L’organisation de la profession n’a pas traîné : l’accident de l’été 1820 y est sans aucun doute pour beaucoup : les guides ont vite senti que les rapports habituels entre client et prestataire de service ne pouvaient pas continuer à prévaloir dans leur domaine et que leurs prérogatives devaient être clairement définies. Le goût de l’organisation, datant de l’époque où les communes n’existaient pas, a donné une structure propre à maîtriser le développement de cette profession naissante, car la mise au point des prérogatives de guides n’était pas le seul motif pour réglementer la profession.
Qui pouvait alors prétendre devenir guide ? Les chasseurs de chamois, les cristalliers, et les rentourneurs et marronniers, les deux dernières étant professions très semblables : les rentourneurs accompagnaient les animaux loués par les voyageurs et prenaient en charge leur retour une fois ces voyageurs arrivés à destination. Les marronniers accompagnaient les voyageurs de part et d’autre des grands cols, assuraient le portage des bagages, et avaient aussi le devoir de porter secours. Dès 1273, de chaque coté du Grand Saint Bernard, ils s’étaient réunis en corporation et obtinrent deux privilèges : celui du marronnage, en vertu duquel l’usager d’une forêt peut exiger le bois de construction nécessaire à ses besoins, en tenant compte des possibilités de la forêt et sans pouvoir se servir lui-même, et celui de viérie, qui accorde un monopole du transport. En 1627, Charles Emmanuel, duc de Savoie, les exempta de service militaire : Vue la requeste a nous présentée de la part des hommes et habitans de Saint Rémy et Bosses en notre Duché d’Aouste, (…) nous avons déclairé et déclairons voullons et nous plait que les dits suppliants soyent et demeurent, ores et pour l’advenir a perpetuité, francz immunis, exempts de tout le service militaire auquel comme les autres lieux du dit Duché (…) accordons autant plus volontiers la dite exemption aux suppliants qu’ils sont obligéz à un plus dangereux service que ceux de la Tullie, pas du Petit Saint Bernard, à cause de l’âpreté de la montagne du dit Grand Saint Bernard, et parce qu’ils sont frontière du Peys de Valley et par conséquent sujetz à une plus étroite garde, particulièrement à l’occasion du mal de contagion…
Ces deux métiers après une longue disparition ont refait surface à la fin du XX° siècle, – sous d’autres noms bien sur, mais les fonctions sont restées les mêmes -, via les agences de voyage spécialisées en randonnée à pied. La bonne santé moyenne des seniors – fin d’activité ou début de retraite – les amène à pratiquer volontiers la randonnée, en cherchant toutefois à porter des sacs le plus léger possible : les agences ont su répondre à ce besoin relativement nouveau en proposant des formules randonnée-liberté qui comprend essentiellement le transport des bagages par voiture d’étape à étape, la réservation du gîte et du couvert, et, éventuellement le retour au départ en fin de randonnée. De plus, on vous fournit la reproduction sur une carte au 25 000° ou au 50 000° de l’itinéraire. Excellente formule.
Napoléon, reconnaissant des bonnes conditions de passage du col du Grand Saint Bernard en 1800 et de leur accueil à Saint Rhémy et Saint Oyen, confirma le statut de ces soldats de la neige : l’institution ne sera abolie qu’en 1927.
Il existe aujourd’hui un village nommé Maronne à coté de Huez, sur la route du Mont Cenis, le plus important passage des Alpes. Les marronniers et rentourneurs étaient organisés depuis longtemps et ce n’était évidemment pas le cas des cristalliers et des chasseurs, activités essentiellement individualistes et sans doute plus récentes. Mais ces derniers connaissaient certainement mieux la haute montagne que les premiers, qui ne montaient pas plus haut que les cols. Sentant le danger que représentaient la tradition et le sens de l’organisation des premiers, les cristalliers et chasseurs créèrent donc rapidement la Compagnie des Guides dont les statuts assuraient à chacun une quantité de travail identique, venant ainsi compenser les écarts qu’auraient pu créer les préférences des clients pour tel ou tel. L’enjeu était important, car la plupart de ces étrangers coureurs de cimes étaient fortunés et il y avait là une source de revenus nettement plus importante que les revenus antérieurs de la chasse, des cristaux ou des accompagnements de voyageurs. Il était préférable de prendre des précautions en mettant un numerus clausus, avant de réaliser si le gâteau était assez gros pour pouvoir être partagé par tous ou seulement par quelques uns.
Autres infatigables marcheurs en montagne, les colporteurs, présents dans toutes les Alpes : Dès la fin d’octobre, on les voyait se masser au Bourg-d’Oisans et s’engager sur l’étroite route de la vallée de la Romanche. […] À la fin d’avril et en mai, tout ce monde remontait pour faire le travail des champs et mettre les bêtes à la montagne. Réguliers comme le soleil, les gens de l’Oisans à leurs deux voyages annonçaient sur leur chemin la bonne et la mauvaise saison. Pour ceux de Vizille qui en voyaient chaque année le départ et le retour, ils étaient les hirondelles. Migrants saisonniers, les colporteurs de l’Oisans passaient l’hiver loin de leur village, sur les routes. Pourquoi partaient-ils ? Dans ces sociétés montagnardes qui vivaient quasiment en autarcie et où la morte-saison durait six longs mois, cela faisait des bouches de moins à nourrir, explique Marie-Christine Bailly-Maître, conservatrice du musée d’Huez et de l’Oisans. En se faisant commerçants ambulants, les hommes rapportaient un peu d’argent dans les familles, de quoi payer les impôts et s’acheter ce qui ne pouvait être produit sur place – chaussures, sel, sucre, tabac, outils… Attestée depuis le Moyen Âge, cette émigration saisonnière prend de l’ampleur au XIX° siècle, où elle atteint son apogée. Vers 1880, on compte quasiment un millier de colporteurs en Oisans. Une famille sur trois ou presque est concernée. Ensuite, la pratique décline progressivement puis disparaît peu après la Première Guerre mondiale.
Les colporteurs portent littéralement leur charge sur le col, dans leur balle faite d’osier ou de bois, d’où leur surnom de porte-balle. Le plus souvent, ils se déplacent à pied et logent chez l’habitant ou dans des auberges. Mais quand ils gagnent plus d’argent, ils mettent leur chargement sur un mulet ou, pour les plus riches, sur une charrette tirée par un cheval. Car, si au départ les colporteurs ne font que vendre le surplus de leur propre production, peu à peu ils se spécialisent et s’organisent selon des tournées fixes. Transmises de père en fils, ces tournées sont en général situées à proximité de leur centre d’approvisionnement, où ils récupèrent les produits qu’ils ont commandés à l’avance. Ils circulent ensuite de village en village, porteurs de produits comme de nouvelles dans les campagnes les plus reculées. La circulation n’étant pas libre à l’époque, ils doivent posséder un document administratif un passeport intérieur, qui précise notamment leur métier et leur lieu de destination, principalement le Massif central, l’Aquitaine, le Jura et la Lorraine. Les plus représentés, les merciers et les épiciers, vendent un bric-à-brac d’objets : aiguilles, bobines de fil, rasoirs, tissus, nœuds papillons, boules pour le linge, cacao, sucre, thé… Viennent ensuite les colporteurs spécialisés dans des produits particuliers, souvent répartis par village : bijoux et horloges à Auris, lunettes à Huez, rouenniers (marchands de draps et de tissus) à La Garde. Horloges et lunettes sont achetées dans le Jura, notamment à Morez, où les colporteurs lunetiers remplissent leur marmotte, la mallette spéciale qu’ils transportent. Quant aux fleuristes, les gros seigneurs du colportage Uissan, ils habitent Mont-de-Lans, Le Freney et Vénosc : Ces trois communes tirent quelque orgueil d’avoir été les seules en France à pratiquer le commerce lointain de la fleur […]. Ce colportage a fait l’occupation et parfois la fortune de quatre générations. Au début, ils transportaient dans les bas pays les fleurs de la montagne : le rhododendron, la gentiane, le lis martagon, l’edelweiss. Pour les fleurs qui s’y prêtaient, ils vendaient le plus souvent le bulbe ou la racine, en montrant à l’acheteur une image de la plante. Petit à petit, ils diversifient leurs ventes avec des fleurs ornementales, qu’ils achètent à crédit à Lyon, Tours, Nantes, Angers ou en région parisienne. Ils les revendent ensuite à une clientèle aisée, urbaine, d’abord en Europe, puis de plus en plus loin. Ils poussent ainsi en Russie, dans les pays méditerranéens, et finissent à l’autre bout du monde : au Japon, en Nouvelle-Zélande, au Vietnam, en Chine, et dans de nombreux pays d’Amérique du Nord et du Sud. Une fois sur place, ils louent une boutique où ils exposent leurs planches de fleurs, afin de montrer à leurs clients ce que deviendront bulbes et semences. S’ils restent parfois deux saisons de suite pour amortir le voyage, la plupart d’entre eux rentrent au pays chaque printemps. Comme toutes les hirondelles de l’Oisans.
Floriane Dupuis. Sur les chemins des marchands marcheurs. Passion Rando N°28 Juillet Août 2013
11 1823
À Rugby, localité de 70 000 âmes nichée dans le comté du Warwickshire dans les Midlands, le jeune anglais William Webb Ellis, 16 ans marque un but balle à la main au jeu du ballon rond : l’anecdote va être l’élément fondateur d’un jeu aux règles très compliquées : le rugby. Il mettra cinquante ans pour traverser la Manche.
Une plaque y commémore l’exploit de William Webb Ellis qui, avec un beau mépris pour les règles du football pratiquées à son époque, fut le premier à prendre le ballon dans ses bras et à courir avec, en étant ainsi à l’origine des caractéristiques distinctes du jeu de rugby.
L’ancienne échoppe du cordonnier de Mathews Street, William Gilbert, pervers inventeur, autour de 1835, du ballon ovale, abrite aujourd’hui le Webb Ellis Rugby Football Museum. Dans un premier temps, l’artisan se contentait d’approvisionner les élèves du collège d’en face, de plus en plus nombreux à pratiquer ce sport d’automne-hiver qui allait se répandre dans l’Empire britannique. À sa mort en 1877, l’entreprise produisait 2 800 sphères par an, gonflées par le fils, James, aux impressionnantes capacités pulmonaires. Gilbert est aujourd’hui leader du marché et fournisseur officiel de la Coupe du monde 2015.
Le responsable du grand schisme d’avec le navrant football lorsqu’il s’empara du ballon avec les mains – ce qui était licite – mais pour s’échapper avec – ce qui était strictement prohibé -. C’est une histoire à la Robin des bois !, s’amuse le curateur Paul Jackson. Je pense qu’il s’est enfui tout simplement parce qu’il pétait de trouille ! Webb Ellis était un joueur de cricket, déjà soupçonné de coups tordus, et il n’était pas à l’aise avec le football. Mais c’est une jolie légende. Comme avec le monstre du loch Ness, tout le monde a envie que ce soit vrai.
Seule Rugby semble toujours accorder du crédit à ce qui n’est que faribole pour les rationalistes du musée de Twickenham. Dès 1895, une enquête avait établi qu’il n’existait aucune preuve de la véracité de l’incident. La seule source provient d’un antiquaire local qui affirmait tenir l’histoire d’une tierce personne, évidemment anonyme. L’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours. L’affaire fut rapportée en 1876 dans The Meteor, le journal de l’école, soit plus d’un demi-siècle après les faits supposés et quatre ans après la mort d’Ellis, qui n’a, de son côté, jamais rien revendiqué. Mais c’est la légende qui a été imprimée.
L’histoire des débuts du rugby dans notre école, c’est un peu comme l’Ancien Testament : cela contient une parcelle de vérité, sourit Peter Green, le directeur de la Rugby School. De fait, tout le monde, y compris les révisionnistes, s’accorde sur un point : le rugby est bien né dans cet établissement. Ce sont des Rugbeians qui ont pour la première fois rédigé les règles en 1845, sans se préoccuper de la limitation des joueurs. En 1839, raconte Rusty Maclean, le bibliothécaire et archiviste de l’école, la reine Adelaïde – épouse de Guillaume IV – est venue visiter l’école et a assisté à un match. La partie, qui a duré de cinq à sept jours, a opposé une équipe de 75 joueurs à une autre de 225 !
Ce sont encore d’anciens élèves qui ont fondé la RFU en 1871 et décidé que la sélection d’Angleterre porterait une tenue blanche sur le modèle de celle de Rugby. L’école a surtout rapidement fourni des missionnaires. Le rugby football a commencé à se répandre dans le reste de l’Angleterre dès les années 1830, puis dans le reste du monde dans les années 1840, grâce aux élèves et professeurs de Rugby School, explique Peter Green. Beaucoup d’entre eux sont allés dans d’autres établissements et ils ont apporté avec eux les règles. L’évêque George Cotton en est un bon exemple. Il est passé par la Rugby School, puis a apporté le rugby au Marlborough College – entre Londres et Bristol -, dont il était le directeur. Ensuite, il est devenu évêque de Calcutta, et a été le premier à faire venir le rugby en Inde. Avec le succès que l’on sait.
Bruno Lesprit. Le Monde du 19 09 2015
2 12 1823
Les États-Unis croient voir des menaces russes et même européennes planer sur le continent américain. Le président Monroe présente alors dans un message au Congrès l’orientation à venir de son gouvernement en matière de politique étrangère : les craintes s’avéreront infondées, mais la doctrine restera et sera appliquée en d’autres occasions, prenant le nom de doctrine Monroe : Dans les discussions auxquelles cet intérêt a donné lieu (l’Alaska) et dans les arrangements qui peuvent les terminer, l’occasion a été jugée convenable pour affirmer, comme un principe, où sont impliqués les droits et intérêts des États-Unis, que les continents par la condition libre et indépendante qu’ils ont conquise et qu’ils maintiennent, ne doivent plus être considérés comme susceptibles de colonisation à l’avenir par aucune puissance européenne…
Dans les guerres entre puissances européennes nées des difficultés qui ne regardent qu’elles-mêmes, nous n’avons pris aucune part, et notre politique est de pratiquer l’abstention. C’est seulement quand nos droits sont attaqués ou sérieusement menacés, que nous ressentons nos injures et faisons des préparatifs pour notre défense. Nous sommes bien plus intéressés par les mouvements qui se produisent dans cet hémisphère, et cela pour des raisons qui doivent être évidentes à l’observateur éclairé et impartial. Le système politique des puissances alliées est essentiellement différent à cet égard de celui de l’Amérique et cette différence procède de celle qui existe dans leurs gouvernements respectifs…
Nous devons en conséquence, à la bonne foi et aux relations amicales qui existent entre les États-Unis et ces puissances, de déclarer que nous devons considérer toute tentative de leur part pour étendre leur système à une portion quelconque de cet hémisphère comme dangereuse pour notre tranquillité et notre sécurité. En ce qui concerne les dépendances actuelles de telle ou telle puissance européenne en Amérique, nous ne sommes pas intervenus et n’interviendrons pas. Mais pour ce qui regarde les gouvernements qui ont proclamé leurs affranchissements, qui l’ont maintenu, et dont, après mûres considérations et conformément à la justice, nous avons reconnu l’indépendance, nous ne pourrions regarder toute intervention d’une puissance européenne, ayant pour objet soit d’obtenir leur soumission, soit d’exercer une action sur leurs destinées que comme la manifestation d’une disposition hostile à l’égard des États-Unis.
… Il est impossible que les puissances alliées puissent étendre leur système politique à aucune portion de l’un ou l’autre continent sans mettre en danger notre sécurité et notre bonheur… La vraie politique des États-Unis est de laisser les anciennes colonies de l’Espagne à elles-mêmes, dans l’espérance que les autres puissances adopteront la même attitude.
1823
La France compte 30 millions d’habitants, dont 100 000 électeurs. Augustin Fresnel, neveu de Prosper Mérimée, après avoir élaboré la théorie ondulatoire de la lumière, invente la lentille à échelon qui va faire des phares en mer des outils très sûrs quand ils étaient jusqu’alors d’un fonctionnement incertain, tant dans le temps que dans la distance à laquelle ils portaient. [autrefois] Il fallait quatre bûches de sapin pour l’allumage et quatre-vingt kilos de charbon par nuit, qu’on devait monter avec le treuil à main. Une fois par mois, un voilier de Brest apportait cinquante barriques de charbon de terre, deux tonnes de bois et trois cents fagots. Impossible de le débarquer par forte mer. Les feux s’éteignaient souvent en hiver, d’où les naufrages. Quand le bois a manqué, on a brûlé de l’huile végétale, colza ou olive. Au XVII° siècle, sur les fanaux à réverbère, on comptait jusqu’à cinquante mèches à huile. Les feux tournants à réflecteur parabolique permettant d’identifier le phare sont apparus en 1783. Mais c’est la lentille à échelon de Fresnel qui a créé le phare moderne en 1823. Elle concentre la lumière et la distribue équitablement sur tout l’horizon, jusqu’à trente milles par temps clair.
Jean Jacques Antier. Tempête sur Armen VDB 2007
L’appareil dioptrique est une lentille convergente à échelon, basée sur les lois de la réfraction de la lumière. Tout autour on dispose d’anneaux encadrés dans un châssis métallique. Au lieu de se disperser, la lumière est dirigée grâce à un jeu de miroirs en un seul faisceau, vers l’horizon. On récupère ainsi la lumière qui s’échappe de haut en bas.
École des gardiens de phare de Brest. Début XX° siècle
Ces lentilles des Fresnel ont été aussi utilisées très longtemps pour les phares des camions et voitures automobiles, dans les projecteurs de cinéma, et aujourd’hui encore, pour ces loupes qui permettent de voir le contenu des caddies aux caisses des supermarchés, comme sur le pare-brise arrière des cars, pour que le chauffeur puisse voir ce qu’il y a immédiatement derrière son véhicule.
Lancement du premier bateau à vapeur sur le lac Léman : le Guillaume Tell. L’anglais Clapperton traverse le Sahara de Tripoli au Tchad. Le chimiste écossais Charles Macintosh invente la toile imperméable par dissolution de caoutchouc dans de la benzine portée à ébullition. Son nom restera synonyme du vêtement imperméable en Angleterre.
Un petit groupe de Jésuites, venus d’Amsterdam, débarque à Baltimore ; il leur faut rejoindre la ferme de Florissant, à quelques 25 kilomètres au nord de Saint Louis : en 50 jours, ils vont faire 2 000 km à pied, à travers les Alleghany, sur l’Ohio à bord d’un radeau, puis à travers les marécages de l’Illinois. Parmi eux, Pierre Jean De Smet, qui n’a pas fini de faire parler de lui, et en premier lieu chez les Indiens. Plus de solidité que d’éclat ; plus de bon sens que de génie ; plus de finesse que de culture ; plus de savoir que de science, plus de vivacité que d’esprit ; le fils de l’armateur de Termonde était fait pour les grands espaces de l’Ouest mieux que pour le Borgo Santo Spirito de Rome. Généreux, hardi, tolérant, jovial, il déploya pendant un demi-siècle toutes les ressources d’une imagination rutilante à la Rubens, et d’une charité que n’altérait ni sa susceptibilité à fleur de peau, ni une certaine manie de la persécution, ni un tempérament explosif.
Jean Lacouture. Jésuites. Les Conquérants. Seuil 1991
Il va commencer par plusieurs années passées auprès des Potowatomies : mission bien ingrate vu la concurrence parfaitement déloyale que représente l’alcool : il a beau défoncer à coup de hache les tonneaux de whisky, rien n’y fait. De plus il ne dispose même pas d’un refuge un tant soit peu douillet : Je n’ai ici qu’une pauvre petite cabane de quatorze pieds carrés, construite avec des troncs d’arbre fendus, et couverte de grossiers bardeaux, qui ne garantissent ni de la neige, ni de la pluie. L’autre nuit, comme il pleuvait à verse, j’ai du placer mon parapluie ouvert au-dessus de mon oreiller, pour empêcher l’eau de tomber sur ma figure et de m’éveiller. Une croix, une petite table, un banc, une pile de livres, voilà tout mon mobilier. Un morceau de viande, ou quelques herbes ou racines sauvages, avec un bon verre d’eau de fontaine, c’est à peu près ma seule nourriture. Mon jardin, c’est l’immense forêt de Chateaubriand aussi antique que la terre qui la porte, le long du plus grand fleuve de l’univers ; c’est une immense prairie, semblable à une vaste mer, où la gazelle, le chevreuil, la biche, le buffle, le bison, paissent en liberté…
Ma carabine m’accompagne toujours dans mes courses, car il faut se tenir en garde contre les attaques de l’ours à ongle rouge et des loups affamés qu’on rencontre pour ainsi dire à chaque pas. D’ailleurs, les guerres que se livrent entre eux les sauvages rendent notre vie très précaire. Des bandes d’Otoes, de Pawnees, de Sioux, rôdent dans tous les sens pour enlever des chevelures. Nos nouvelles de chaque jour consistent à entendre le récit de leurs cruautés.
Pierre Jean De Smet S.J.
À la cure de Megève, dans une Savoie qui fait encore partie du Royaume de Piémont, arrive le révérend Ambroise Martin, natif d’Évian. À 29 ans, doté d’un dynamisme inoxydable, il va réaliser une œuvre considérable de 1823 à 1863, dont la plus remarquable est le calvaire, sur l’ancien chemin du Mont d’Arbois, dont la configuration peut rappeler celle du Golgotha et d’où la vue sur Megève est splendide. L’inspiration lui en est venue du calvaire du Mont Sacré de Varallo, en Piémont. Quatorze stations dont la réalisation est confiée à Joseph Prosper Socquet-Juglard pour l’exécution et au sculpteur Carlo Pedrini, originaire du Val Sezia, en Piémont pour la réalisation des sculptures de taille réelle, réalisées en tilleul et bouleau, enduite d’huile de lin chauffée et de blanc de Troyes avant que d’être peintes. Édifice religieux d’importance qui va faire de Megève un centre de pèlerinage très fréquenté pendant tout le XIX° siècle.
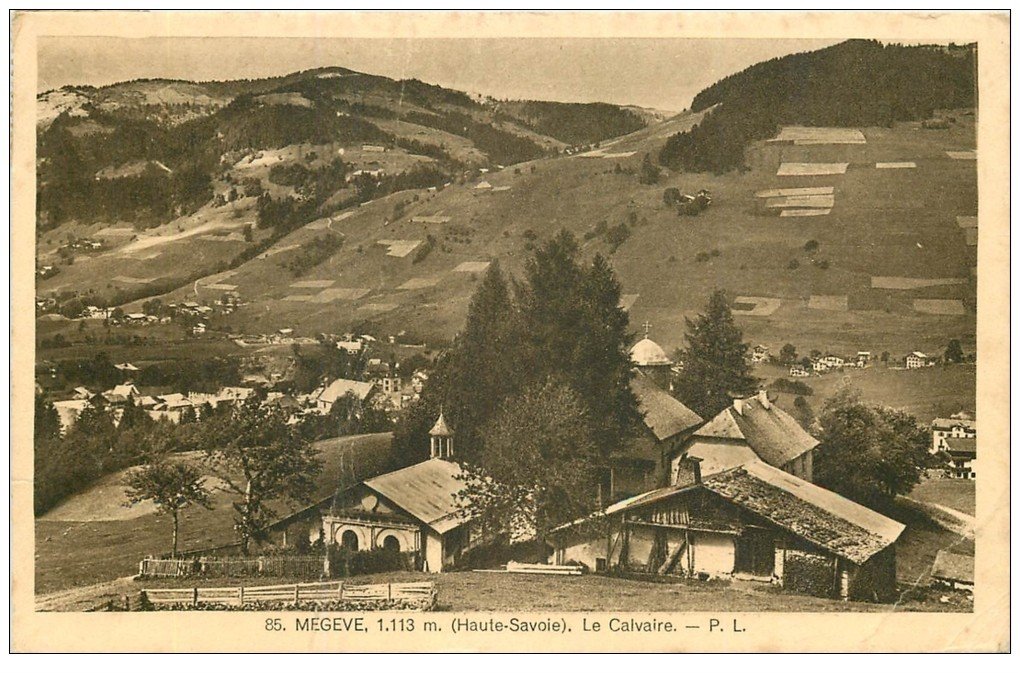




Une restauration sera entreprise de 2008 à 2011 qui laïcisera l’ensemble, ne s’attachant qu’aux façades des chapelles et à l’ensemble du site, désormais richement doté en bancs publics chics où se reposer de la dure fatigue de la montée en contemplant le bâti de plus en plus dense de Megève. Aucune disposition ne sera prise pour que soit permise à la vue du public le contenu des chapelles : les sculptures de Carlo Pedrini et de Prosper Socquet-Juglard. Portes bien évidemment fermées en permanence, double voire triple grillage qui fait que l’on ne voit quasiment rien quand, à quelques kilomètres de là, sur les chapelles de Saint Nicolas de Véroce et de Saint Gervais, sur les pentes du Bettex, les restaurations antérieures avaient été dotées d’un dispositif satisfaisant à même de concilier la vue par le public et la sécurité : les portes d’entrée ont été supprimées et remplacées par des grilles à trois vantaux qui entrent dans la chapelle sur une distance d’à peu près un mètre, suffisante pour découvrir de façon correcte l’ensemble de l’intérieur. Mais, à Megève, on ne va pas s’inspirer de ce que fait le voisin ! Comment expliquer ce parti pris de gommer l’essentiel de ce calvaire en lui ôtant tout caractère religieux, de vider cette réalisation du curé Martin du cœur de son contenu… jusqu’à rendre illisible l’intitulé de chaque station, sinon par l’appartenance à la Franc Maçonnerie du curé de Megève, Pascal Vesin, en cette décennie des années 2000 ; l’évêque d’Annecy attendra fin juillet 2013 pour l’envoyer ailleurs, sur ordre de Rome. On ne sait pas très bien ce que la religion catholique a gagné à cette restauration, mais la Franc Maçonnerie a marqué un point, ça c’est sûr : Chapeau, curé pour ce remarquable travail de sape ; tu as bien repeint la coquille tout en la vidant de son contenu et tes braves paroissiens n’y ont vu que du feu : et pour cause, il n’y avait aucun risque que l’un ou l’autre fut choqué de ce gommage très réussi du religieux… finalement ton évêque a eu bien tort de te déplacer : ton athéisme s’entendait fort bien avec le conformisme superficiel de tes paroissiens.
Le Père Pascal Vesin est parti à pied à Rome plaider sa cause ; il donne ainsi du temps au temps… et au train où vont les choses peut-être que lorsqu’il arrivera, on aura déjà perdu son dossier… En attendant, il écrit, probablement pour montrer qu’à l’heure d’Internet, tout est compatible. Il mourra en novembre 2019 à Thollon les Mémises, ayant travaillé les dernières années de sa voie comme employé de banque.
Quoi qu’il en soit, la doctrine du Vatican semble pour le moins fluctuante quant à sa position sur la Franc-Maçonnerie : condamnée à plusieurs reprises, la première fois le 28 avril 1738 par le pape Clément XII avec la bulle In eminenti apostolatus specula, et encore le 20 avril 1884, avec l’encyclique Humanum genus, par le pape Léon XIII comme étant la religion de Satan, on verra en août 1978, quelques jours après l’élection de Jean-Paul I°, dans l’Osservatore politico la liste d’une centaine de personnalités ecclésiastiques membres de la franc-maçonnerie, parmi lesquelles Mgr Jean-Marie Villot, secrétaire d’État du pape, tous responsables de premier plan dans l’organigramme du Vatican. Cette liste ne sera jamais dénoncée comme fausse… qui ne dit mot consent.
George Canning, à la tête du Foreign Office, veut exprimer clairement au chargé d’affaires français sa condition de vaincu : il le fait au cours d’un toast, meilleur moment possible pour serrer la main des autres avec une main de fer dans un gant de velours : À vous, la gloire du triomphe, suivi du désastre et de la ruine ; à nous, le trafic sans gloire de l’industrie et de la prospérité toujours croissante… Le temps de la chevalerie appartient au passé ; celui des économistes et des calculateurs lui a succédé. Et, un an plus tard : L’affaire est dans le sac ; l’Amérique hispanique est libre ; et si nous ne menons pas trop tristement nos affaires, elle est anglaise.
*****
Napoléon avait été définitivement vaincu quelques années plus tôt et l’ère de la Pax Britannica s’ouvrait sur le monde. En Amérique latine, l’indépendance avait ancré à perpétuité le pouvoir des seigneurs terriens et, dans les ports, celui des commerçants enrichis aux dépens de la ruine anticipée des pays naissants. Les anciennes colonies espagnoles, et aussi le Brésil, étaient des marchés prospères pour les tissus anglais et les livres sterling à tant pour cent. La machine à vapeur, le métier à tisser mécanique et le perfectionnement des filatures et tissages avaient fait murir la révolution industrielle en Angleterre de façon vertigineuse. Les fabriques et les banques se multipliaient ; les moteurs à combustion interne avaient modernisé la navigation et les grands bateaux naviguaient aux quatre points cardinaux, en universalisant l’expansion industrielle anglaise. L’économie britannique payait en cotonnades les cuirs du Rio de la Plata, le guano et le nitrate du Pérou, le cuivre du Chili, le sucre de Cuba, le café du Brésil. Les exportations industrielles, le fret, les assurances, les intérêts des prêts et les bénéfices des investissements allaient alimenter, pendant tout le XIX° siècle, la prospérité vigoureuse de l’Angleterre. En réalité, avant les guerres d’indépendance, les Anglais contrôlaient déjà une bonne partie du commerce légal entre l’Espagne et ses colonies et avaient déversé sur les côtes de l’Amérique latine un flot abondant et suivi de marchandises de contrebande. Le trafic d’esclaves offrait un paravent efficace pour le commerce clandestin, même si, au bout du compte, la précaution s’avérait inutile étant donné que les douanes constataient dans toute l’Amérique latine que la majorité des produits ne provenaient pas d’Espagne. Dans les faits, le monopole espagnol n’avait jamais existé. : la colonie était déjà perdue pour la métropole, bien avant 1810 et la révolution ne représenta qu’une reconnaissance politique d’une réalité. [Manfred Kossok.]
Eduardo Galeano. Les veines de l’Amérique Latine Terre humaine. Plon
01 1824
Charles Cyrille Bissette, neveu de Joséphine de Beauharnais, est condamné aux galères à perpétuité : on avait trouvé chez lui une brochure, plutôt modérée : De la situation des gens de couleur libres aux Antilles françaises, ainsi que diverses pétitions. Il est marqué au fer : GAL – galérien-. Poursuivant la procédure, il parvient à faire casser le jugement et obtient un nouveau procès en Guadeloupe, qui le condamne à 10 ans de bannissement des colonies françaises. 200 Martiniquais libres, de couleur, sont déportés en métropole. L’affaire Bisette creusera durablement le fossé entre colons blancs et libres de couleur.
7 05 1824
Création au National Hoftheater de Vienne de la 9° symphonie de Beethoven, et encore du Kyrie, Gloria et Credo de la Missa Solemnis. C’est un triomphe pour le vieux maître sourd. Les premières ébauches remontaient à 1812, mais il fallut attendre la commande de la Société Philharmonique de Londres pour un montant de 50 Livres pour que les notes viennent meubler les portées. C’est à Friedrich Schiller qu’il emprunta l’hymne à la joie du final. Le 19 janvier En 1972, l’Europe fera sienne la seule mélodie de cet hymne, sans référence au poème de Schiller. La version officielle est celle enregistrée par Herbert von Karajan et le Berliner Philharmoniker en février-mars 1972. Sa durée est de 2 minutes et 15 secondes et correspond aux mesures 140-187 du quatrième mouvement de la symphonie.
Joie ! Joie ! Belle étincelle divine,
Fille de l’Élysée,
Nous entrons l’âme enivrée
Dans ton temple glorieux.
Ton magique attrait resserre
Ce que la mode en vain détruit ;
Tous les hommes deviennent frères
Où ton aile nous conduit.
Si le sort comblant ton âme,
D’un ami t’a fait l’ami,
Si tu as conquis l’amour d’une noble femme,
Mêle ton exultation à la nôtre !
Viens, même si tu n’aimas qu’une heure
Qu’un seul être sous les cieux !
Mais vous que nul amour n’effleure,
En pleurant, quittez ce chœur !
Tous les êtres boivent la joie,
En pressant le sein de la nature
Tous, bons et méchants,
Suivent les roses sur ses traces,
Elle nous donne baisers et vendanges,
Et nous offre l’ami à l’épreuve de la mort,
L’ivresse s’empare du vermisseau,
Et le chérubin apparaît devant Dieu.
Heureux, tels les soleils qui volent
Dans le plan resplendissant des cieux,
Parcourez, frères, votre course,
Joyeux comme un héros volant à la victoire !
Qu’ils s’enlacent tous les êtres !
Ce baiser au monde entier !
Frères, au-dessus de la tente céleste
Doit régner un tendre père.
Vous prosternez-vous millions d’êtres ?
Pressens-tu ce créateur, Monde ?
Cherche-le au-dessus de la tente céleste,
Au-delà des étoiles il demeure nécessairement.
Traduction de Jean Berger – 1917-2014 -.
Que la joie qui nous appelle
Nous accueille en sa clarté !
Que s’éveille sous son aile
L’allégresse et la beauté !
Plus de haine sur la terre
Que renaisse le bonheur
Tous les hommes sont des frères
Quand la joie unit les cœurs.
Peuples des cités lointaines
Qui rayonnent chaque soir,
Sentez-vous vos âmes pleines
D’un ardent et noble espoir ?
Luttez-vous pour la justice ?
Etes-vous déjà vainqueurs
Ah! Qu’un hymne retentisse
A vos cœurs mêlant nos cœurs
Si l’esprit vous illumine
Parlez-nous à votre tour ;
Dites-nous que tout chemine
Vers la paix et vers l’amour.
Dites-nous que la nature
Ne sera que joie et fleurs,
Et que la cité future
Oubliera le temps des pleurs.
Traduction de Jean Rouault pour le 1° couplet, de Maurice Buchor, – 1855-1929 – pour les 2° et 3°couplets
Oh ! quel magnifique rêve
Vient illuminer mes yeux
Quel brillant soleil se lève
Dans les purs et larges cieux
Temps prédits par nos ancêtres
Temps sacrés, c’ est vous enfin
Car la joie emplit les êtres
Tout est beau, riant, divin
On ne voit que fleurs écloses
Près des murmurantes eaux
Plus suaves sont les roses
Plus exquis les chants d’oiseaux
Pour mener gaiement nos rondes
Nous cherchons les bois ombreux
Mers, vallons, forêts profondes
Comme nous tout semble heureux
Plus de fratricides luttes
Plus de larmes, plus de sang
Il s’élève un chant de flûte
Calme et doux le soir descend
Oh ! merveille la tendresse
En un seul fond tous les cœurs
Et l’amour qui nous oppresse
Va jaillir en cri vainqueur.
Hymne des temps futurs, chantée dans les écoles d’Alsace dans les années 1920
Joie discrète, humble et fidèle
Qui murmure dans les eaux
Dans le froissement des ailes
Et les hymnes des oiseaux.
Joie qui vibre dans les feuilles
Dans les prés et les moissons
Nos âmes blanches t’accueillent
Par de naïves chansons.
Tous les hommes de la terre
Veulent se donner la main
Vivre et s’entraider en frères
Pour un plus beau lendemain,
Plus de haine, plus de frontière,
Plus de charniers sur nos chemins
Nous voulons d’une âme fière
Nous forger un grand destin
Que les peuples se rassemblent
Dans une éternelle foi
Que les hommes se rassemblent
Dans l’égalité des droits.
Nous pourrons tous vivre ensemble
La charité nous unira
Que pas un de nous ne tremble
La fraternité viendra.
Joie immense, joie profonde,
Ombre vivante de Dieu
Abats-toi sur notre monde
Comme un aigle vient des cieux.
Enserre dans ton étreinte
La tremblante humanité
Que s’évapore la crainte
Que naisse la liberté
Joie énorme, joie terrible
Du sacrifice total
Toi qui domptes l’impossible,
Et maîtrises le fatal ;
Joie sauvage, âpre et farouche,
Cavalière de la mort,
Nous soufflons à pleine bouche
Dans l’ivoire de ton cor.
Joie qui monte et déborde,
Tu veux nos cœurs ? les voilà.
Et nos âmes sont les cordes,
Où ton archet passera
Que ton rythme nous emporte
Aux splendeurs de l’Éternel
Comme un vol de feuilles mortes,
Que l’orage entraîne au ciel.
Traduction de Joseph Folliet 1903-1972, adoptée par les Scouts
Il n’est de pinceau, il n’est de plume, il n’est de burin qui ait dit avec plus de plénitude et de puissance que cet hymne à la joie, gloire de la vie, renaissance éternelle de l’homme triomphant de la souffrance, de l’humiliation, de la solitude… et des tremblements de terre. C’est l’herbe verte qui repousse sur un tapis de cendres. Cette musique transfigure musiciens et chanteurs [en 2011, le chef japonais Yutaka Sado fera chanter la Daïku – c’est le nom japonais de l’hymne à la joie – par 10 000 choristes/musiciens en mémoire aux victimes du tremblement de terre].
Folsom Symphony and Sacramento Master Singers « Glorious Beethoven » March 25, 2012. Beethoven Symphony No.9 Choral Movement IV. Michael Neumann, Folsom Symphony Music Director & Conductor. Soloists : Robin Fisher, Soprano ; Buffy Baggott, Mezzo soprano.
Parfois la fantaisie peut s’emparer d’un chef d’œuvre quand lui prend l’envie de se réapproprier l’espace public : c’est le spectacle de rue au XXI° siècle. L’interprétation qui suit, sponsorisée par Banco Sabadell, se passe à Sabadell, près de Barcelone. L’interprétation est certes excellente : mais ce qui en fait un petit chef d’œuvre, c’est cette communion d’usagers d’une petite ville espagnole qui découvrent un chef d’œuvre chez eux : de l’archange qui dirige, assurément entouré au berceau d’une théorie de fées bienveillantes, à la petite vieille, bien obligée de jeter un œil au sol, – sait-on jamais où l’on met les pieds ! – , mais qui les relève vite, gourmande de tout ce bonheur, à l’homme de 40 ans, soufflé de cette puissance musicale. Même les enfants sont enchantés ! Mais il y a encore l’immense talent de toutes celles et ceux qu’on maintient trop souvent dans l’ombre : les preneurs de son, les cameramen, les monteurs, qui ont fait de cette vidéo un (trop) petit chef d’œuvre de sensibilité, de goût, de talent à saisir l’instantané. Cela tient d’une parabole d’Évangile, cette histoire dans laquelle tout se passe au-delà des codes habituels : des gens lambda dans leur quotidien, sur une place publique, qui, surpris, mettent ce quotidien en arrêt pour tomber, enchantés, sous la magie de la beauté, de la vie.
Un seul regret : que cet hymne à la joie de 23′ ait été réduit à 5′. Personne, oh non personne, n’aurait trouvé à redire qu’il ait été donné en intégral. Les festivals de cinéma devraient intégrer ce genre de vidéo.
Une petite fille, 10, 12 ans, en rouge et bleu, s’avance face à un violoncelliste sur la place de la cathédrale de Nüremberg, toute ensoleillée. Elle joue les premières notes de l’Hymne à la Joie. Le violoncelliste, deux fois grand comme elle, enchaîne… elle lui répond…. les musiciens se regroupent et donnent la suite. Et c’est un enchantement, servi par une excellente prise de son, et une aussi excellente prise de vue. Les spectateurs, qui ne demandaient qu’à faire cet arrêt dans leur quotidien s’engagent avec un bonheur non dissimulé dans ce chef d’œuvre. Il n’est aucun orchestre dans aucune salle de concert qui soit à même de procurer un tel plaisir.

Beethoven à la cravate par Antoine Bourdelle. Bronze 1890
Vienne est alors la capitale culturelle de l’Europe, au moins de la Mitteleuropa. Paris n’est pas encore parvenue à faire oublier ses fureurs révolutionnaires. C’est cette Vienne musicienne, littéraire, cosmopolite, tolérante, que connaîtra Stefan Zweig, quelques décennies plus tard : Il n’y avait plus guère de ville en Europe où l’aspiration à la culture fût plus passionnée qu’à Vienne. C’est justement parce que, depuis des siècles, la monarchie, l’Autriche, n’avait plus fait valoir d’ambitions politiques ni connu de succès particuliers dans ses entreprises militaires, que l’orgueil patriotique s’y était le plus fortement reporté sur le désir de conquérir la suprématie artistique. L’Empire des Habsbourg, qui avait dominé l’Europe, avait vu depuis longtemps se détacher de lui ses provinces les plus importantes et les plus prospères, allemandes et italiennes, flamandes et wallonnes ; la capitale était restée intacte dans son ancienne splendeur, asile de la cour, conservatrice d’une tradition millénaire. Les Romains avaient posé les premières pierres de cette cité en érigeant un castrum, poste avancé destiné à protéger la civilisation latine contre les barbares et, plus de mille ans après, l’assaut des Ottomans contre l‘Occident s’était brisé sur ces murailles. Ici étaient venus les Nibelungen, ici avait resplendi sur le monde l’Immortelle pléiade de la musique : Gluck, Haydn et Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms et Johann Strauss ; ici ont conflué tous les courants de la culture européenne ; à la cour, dans l’aristocratie, dans le peuple, les sangs allemand, slave, hongrois, espagnol, italien, français, flamand s’étaient mêlés, et ce fut le génie propre de cette ville de la musique que de fondre harmonieusement tous ces contrastes en une réalité nouvelle et singulière, l’esprit autrichien, l’esprit viennois. Accueillante et douée d’un sens particulier de la réceptivité, cette cité attira à elle les forces les plus disparates, elle les détendit, les assouplit, les apaisa ; la vie était douce dans cette atmosphère de conciliation spirituelle et, à son insu, chaque citoyen de cette ville recevait d’elle une éducation qui transcendait les limites nationales, une éducation cosmopolite, une éducation de citoyen du monde.
Cet art de l’assimilation, des transitions insensibles et musicales, se manifestait déjà dans la structure extérieure de la ville. S’étant agrandie lentement au cours des siècles et développée organiquement à partir de sa première enceinte centrale, elle était assez populeuse, avec ses deux millions d’habitants, pour offrir tout le luxe et toute la diversité d’une métropole, sans cependant qu’une extension démesurée la séparât de la nature, comme Londres ou New York. Les dernières maisons de la ville se miraient dans le cours puissant du Danube, ou prenaient vue sur la grande plaine, ou se perdaient dans des jardins et des champs, ou s’étageaient sur les flancs de douces collines, derniers contreforts des Alpes, couverts de vertes forêts ; on percevait à peine où commençait la nature, où commençait la ville, l’une se fondait dans l’autre sans résistance ni contradiction. À l’intérieur, on sentait que la ville avait poussé comme un arbre ; un anneau après l’autre ; et à la place des anciennes fortifications, c’était le Ring, avec ses édifices solennels, qui entourait le précieux cœur de la cité ; au centre, les vieux palais de la cour et de l’aristocratie racontaient toute une histoire consignée dans les pierres : ici, chez les Lichnowsky, Beethoven avait joué ; là, les Esterhâzy avaient reçu Haydn ; plus loin, dans la vieille université, avait retenti pour la première fois La Création de Haydn ; la Hofburg avait vu des générations d’empereurs, et Schönbrunn Napoléon ; dans la cathédrale Saint-Etienne, les princes alliés de la chrétienté s’étaient agenouillés pour rendre grâces à Dieu d’avoir sauvé celle-ci des Turcs ; l’Université avait vu dans ses murs d’innombrables flambeaux de la science. Et parmi tous ces monuments se dressait la nouvelle architecture, fière et fastueuse, avec ses avenues resplendissantes et ses magasins étincelants. Mais ici, l’ancien se querellait aussi peu avec le nouveau que la pierre taillée avec la nature vierge. Il était merveilleux de vivre dans cette ville hospitalière, qui accueillait tout ce qui venait de étranger et se donnait généreusement ; il était plus naturel de jouir de la vie dans son air léger, ailé de sérénité, comme à Paris. Vienne était, on le sait, une jouisseuse, mais quel est le sens de la culture sinon d’extraire de la matière brute de l’existence, par les séductions flatteuses de l’art et de l’amour, ce qu’elle recèle de plus fin, de plus tendre et de plus subtil ? Si l’on était fort gourmet dans cette ville, très soucieux de bon vin, de bière fraîche et agréablement amère, d’entremets et de tourtes plantureuses, on se montrait également exigeant dans les jouissances plus raffinées. Pratiquer la musique, danser, jouer du théâtre, converser, se comporter avec goût et agrément, ici, on cultivait tout cela comme un art particulier. Ce n’étaient pas les affaires militaires, politiques ou commerciales qui occupaient la place prépondérante dans la vie de chacun, non plus que de la société dans son ensemble ; le premier regard que le Viennois moyen jetait chaque matin à son journal ne se portait pas sur les discussions du Parlement ou les événements mondiaux, mais sur le répertoire du théâtre, lequel prenait une importance dans la vie publique qu’on n’eût guère comprise dans d’autres villes. Car le théâtre impérial, le Burgtheater était pour le Viennois, pour l’Autrichien, plus qu’une simple scène où les acteurs jouaient des pièces ; c’était le microcosme reflétant le macrocosme, le miroir où la société contemplait son image bigarrée, le seul véritable Cortegiano du bon goût. En regardant l’acteur du Hoftheater, le spectateur apprenait de lui par l’exemple comment on s’habillait, comment on entrait dans une chambre, comment on conversait, de quels mots pouvait user un homme bien élevé, lesquels on devait éviter ; la scène n’était pas un simple lieu de divertissement, mais un guide en paroles et en actes des bonnes manières, de la prononciation correcte, et un nimbe de respect auréolait tout ce qui avait quelque rapport, même le plus lointain, avec le théâtre du château impérial. Le président du Conseil, le plus riche magnat pouvaient passer par les rues de Vienne sans que personne se retournât ; mais chaque vendeuse, chaque cocher de fiacre reconnaissaient un acteur du Théâtre ou une chanteuse de l’Opéra ; quand nous autres, garçons, avions croisé l’un d’entre eux (dont chacun de nous collectionnait les photographies, les autographes), nous nous le racontions avec fierté, et ce culte presque religieux voué à leur personne allait si loin qu’il s’étendait même à tout leur entourage ; le coiffeur de Sonnenthal le cocher de Joseph Kainz étaient des gens respectés, que l’on enviait secrètement ; de jeunes élégants s’enorgueillissaient d’être habillés par le même tailleur. Chaque jubilé, chaque enterrement d’un grand acteur, était un événement d’importance, qui reléguait dans l’ombre tous ceux de la politique. Être joué au Burgtheater était le rêve suprême de tout écrivain viennois, car cela conférait une sorte de noblesse viagère et comportait toute une série de distinctions honorifiques, telles que des entrées gratuites sa vie durant et des invitations à toutes les manifestations officielles ; on était devenu l’hôte d’une maison impériale, et je me souviens encore de la solennité qui entoura ma propre admission. Le matin, le directeur du Théâtre m’avait prié de passer à son bureau pour m’informer – après m’avoir présenté ses félicitations – que mon drame était accepté. Le soir, quand je rentrai chez moi, j’y trouvai sa carte : il m’avait rendu visite dans les formes, à moi qui n’avais que vingt-six ans ; en qualité d’auteur de la scène impériale, j’avais, par ma seule admission, accédé au rang de gentleman, et un directeur de cette institution impériale se devait de me traiter de pair à compagnon. Et ce qui se passait au Théâtre impérial touchait indirectement tout un chacun, même s’il n’avait aucun rapport direct avec l’événement. Je me souviens, par exemple, qu’un jour de ma prime jeunesse, notre cuisinière fit irruption dans le salon, les larmes aux yeux : on venait de lui rapporter que Charlotte Wolter, la plus célèbre actrice du Burgtheater, était morte ; le grotesque de ce deuil tumultueux, était évidemment que cette vieille cuisinière, à moitié analphabète, n’avait jamais vu Charlotte Wolter, ni sur scène ni dans la vie, et n’avait jamais mis les pieds dans ce théâtre distingué. Mais à Vienne, une grande actrice nationale était tellement la propriété collective de toute la cité que même celui qui n’y avait aucune part personnellement éprouvait sa mort comme une catastrophe. Chaque perte, le départ d’un chanteur ou d’un artiste aimé, se transformait irrésistiblement en deuil national. Juste avant la démolition du vieux Burgtheater où l’on avait entendu pour la première fois Les Noces de Figaro de Mozart, toute la société viennoise, solennelle et affligée comme pour des funérailles, se rassembla une dernière fois dans la salle. À peine le rideau tombé, chacun se précipita sur la scène pour emporter au moins comme relique un éclat de ces planches où s’étaient produits ses chers artistes ; et dans des douzaines de maisons bourgeoises on pouvait voir encore après des décennies ces morceaux de bois de peu d’apparence conservés dans de précieuses cassettes, comme dans les églises les fragments de la sainte Croix. Nous-mêmes n’eûmes pas une conduite beaucoup plus raisonnable quand on démolit la salle dite de Bosendorf.
En elle-même, cette salle de concert exclusivement réservée à la musique de chambre était une construction sans aucun intérêt, sans caractère artistique ; ancien manège du prince Lichtenstein, elle n’avait été adaptée à des fins musicales que par un lambrissage de bois dépourvu de tout apparat. Mais elle avait la résonance d’un violon ancien, elle était pour les amateurs de musique un lieu sanctifié parce que Chopin et Brahms, Liszt et Rubinstein y avaient donné des concerts et que nombre des plus célèbres quatuors y avaient été joués pour la première fois ; et maintenant, il lui fallait laisser la place à un nouvel édifice purement utilitaire ; pour nous, qui y avions vécu des heures inoubliables, c’était inconcevable. Quand expirèrent les dernières mesures de Beethoven, joué plus divinement que jamais par le quatuor Rosé, personne ne quitta sa place. Nous applaudissions à grand bruit, quelques femmes sanglotaient d’émotion, personne ne voulait admettre que ce fût un adieu à jamais. On éteignit les lumières de la salle pour nous chasser. Pas un des quatre ou cinq cents fanatiques ne se leva. Nous demeurâmes une demi-heure, une heure, comme si nous pouvions par la force de notre seule présence obtenir que ce vieil espace fût sauvé. Et comme nous nous sommes battus, nous autres, étudiants, multipliant pétitions, manifestations, articles dans les journaux, pour que la maison mortuaire de Beethoven ne fût pas détruite ! Chacune de ces demeures historiques, à Vienne, était pour nous un peu d’âme qu’on nous arrachait du corps.
Ce fanatisme pour les beaux-arts, et pour l’art théâtral en particulier, se rencontrait à Vienne dans toutes les couches de la population. En elle-même, Vienne, par sa tradition centenaire, était une ville très-nettement stratifiée, mais en même temps – comme je l’ai écrit un jour – merveilleusement orchestrée. Le pupitre était toujours tenu par la maison impériale. Non seulement au sens spatial, mais aussi au sens culturel, le Château était au centre de ce qui, dans la monarchie, transcendait les limites des nationalités. Autour de ce château, les palais de la haute aristocratie autrichienne, polonaise, tchèque, hongroise formaient en quelque sorte la seconde enceinte. Venait ensuite la bonne société que constituaient la petite noblesse, les hauts fonctionnaires, les représentants de l’industrie et les vieilles familles ; enfin, au-dessous, la petite bourgeoisie et le prolétariat. Chacune de ces couches vivait dans son cercle propre, et même dans son arrondissement propre ; la haute noblesse vivait dans ses palais au cœur de la ville, la diplomatie dans le troisième arrondissement, l’industrie et le commerce dans le voisinage du Ring, la petite bourgeoisie dans les arrondissements du centre, du deuxième au neuvième, le prolétariat dans les quartiers extérieurs. Mais tout le monde communiait au théâtre ou lors des grandes festivités, comme le corso fleuri sur le Prater, où trois cent mille personnes acclamaient avec enthousiasme les dix mille de la haute société dans leurs voitures magnifiquement décorées. À Vienne, tout ce qui comportait couleurs ou musique devenait occasion de festivités, les processions religieuses comme la Fête-Dieu, les parades militaires, la Musique du château impérial ; même les funérailles attiraient un grand concours de peuple enthousiaste et c’était l’ambition de tout bon Viennois d’avoir un beau convoi avec un cortège fastueux et une suite nombreuse ; un vrai Viennois métamorphosait sa mort même en spectacle attrayant pour les autres. Toute la ville s’accordait dans ce goût des couleurs, des sonorités, des fêtes, dans le plaisir qu’elle prenait au spectacle considéré comme un jeu et comme un miroir de la vie, que ce fût sur la scène ou dans l’espace de la réalité.
Il n’était certes pas difficile de railler cette théâtromanie des Viennois, qui parfois tournait véritablement au grotesque, quand elle les poussait à s’enquérir des circonstances les plus futiles de la vie de leurs favoris ; et l’on peut en effet attribuer pour une part notre indolence politique, notre infériorité économique en face de notre voisin si résolu, l’Empire allemand, à cette surestimation des plaisirs. Mais du point de vue de la culture, cette attention excessive accordée aux événements du monde des arts a fait mûrir chez nous quelque chose d’unique – tout d’abord une extraordinaire vénération pour toute production artistique -, puis, grâce à des siècles de pratique, une connaissance sans pareille en ce domaine, et enfin un niveau culturel très élevé. C’est toujours dans les lieux où on l’estime, où même on le surestime, que l’artiste se sent le plus à l’aise et le plus stimulé. C’est toujours dans les lieux où il devient essentiel à la vie de tout un peuple que l’art atteint son apogée. Et de même que Florence et Rome, à l’époque de la Renaissance, attiraient à elles les peintres et leur enseignaient la grandeur – parce que chacun sentait qu’il lui fallait sans cesse surpasser les autres et lui-même dans cette perpétuelle compétition livrée sous les yeux de tous les citoyens -, de même, à Vienne, les musiciens, les acteurs connaissaient leur importance dans la ville. À l’Opéra de Vienne, au Burgtheater, on ne laissait échapper aucune imperfection : toute fausse note était aussitôt remarquée, toute rentrée incorrecte ou toute coupure censurée, et ce n’étaient pas seulement les critiques professionnels qui exerçaient ce contrôle lors des premières mais, soir après soir, l’oreille attentive du public tout entier, affinée par de perpétuelles comparaisons. Tandis qu’en matière de politique, d’administration, de mœurs, tout allait assez tranquillement son train et que l’on manifestait une indifférence débonnaire à toutes les veuleries et de l’indulgence pour tous les manquements, dans les choses de l’art il n’y avait pas de pardon ; là, l’honneur de la cité était enjeu. Tout chanteur, tout acteur, tout musicien était constamment obligé de donner toute sa mesure, sinon il était perdu. Il était délicieux d’être le favori de Vienne, mais il était difficile de le demeurer ; jamais un relâchement n’était pardonné. Et cette conscience d’être sans cesse surveillé avec une attention impitoyable contraignant tous les artistes viennois à donner leur maximum expliquait aussi leur merveilleux niveau collectif. De ces années de notre jeunesse, chacun d’entre nous a conservé toute sa vie une règle sévère, inflexible, pour juger des productions artistiques. Qui a connu à l’Opéra, sous la direction de Gustav Mahler, cette discipline de fer poussée jusque dans les moindres détails, à l’Orchestre symphonique cet élan lié comme tout naturellement à l’exactitude la plus rigoureuse, celui-là est aujourd’hui bien rarement satisfait d’un spectacle ou de l’exécution d’une œuvre musicale. Nous avons toutefois appris aussi à être sévères envers nous-mêmes pour toutes nos productions artistiques ; un certain niveau de perfection était et demeurait pour nous exemplaire. Ce sens du rythme et du mouvement justes descendait jusque dans les profondeurs du peuple ; car même le plus humble citoyen assis devant son verre exigeait de l’orchestre qu’il lui jouât de la bonne musique, comme du cabaretier qu’il lui servît du bon vin nouveau ; au Prater, le peuple savait exactement laquelle des fanfares militaires avait le plus d’allant, les Maîtres allemands ou les Hongrois ; qui vivait à Vienne respirait avec l’air le sentiment du rythme. Et de même que ce sens de la musique s’exprimait chez nous, écrivains, par une prose particulièrement châtiée, le sens de la mesure se manifestait chez les autres par leur tenue en société et leur vie de tous les jours. Un Viennois dépourvu de sens artistique et qui ne trouvât pas de plaisir à la beauté formelle était inconcevable dans ce qu’on appelle la bonne société ; mais même dans les couches inférieures, la vie du plus pauvre comportait un certain instinct de la beauté que suffisait à lui communiquer le paysage, cette atmosphère de sérénité humaine ; on n’était pas un vrai Viennois sans cet amour de la culture, sans ce don de joindre le sens du plaisir à celui de l’examen critique devant ce plus sain des superflus que nous offre la vie.
Stefan Zweig. Le Monde d’hier. 1944 Traduction française Belfond 1982.
1 09 1824
Alexandre Mathieu de Dombasle crée l’école d’agriculture de Roville, près de Nancy ; suivront celles de Grignon en 1826, Grandjouan et La Saulsaie. Les premières fermes écoles apparaîtront en 1830.
16 09 1824
Mort de Louis XVIII. Son frère, Charles X, lui succède.
10 1824
Pierre Parissot ouvre le premier grand magasin de confection de série : La Belle Jardinière. Le pantalon prend de l’ampleur et n’est plus moulant : les mondaines s’en plaignent : avec ces nouveaux pantalons, on ne sait plus ce que pensent les hommes.
1824
1° École de formation moderne et scientifique des ingénieurs aux États-Unis. Le marquis de La Fayette se rend aux États-Unis, sans penser que sa tournée sera un triomphe : il est accueilli comme le libérateur : il a une faim canine pour la popularité, dira tout de même de lui Jefferson. Au Pérou, la dernière armée espagnole est battue à Ayacucho.
1° École forestière à Nancy, dont les élèves, 20 ans plus tard, planteront méthodiquement les millions de pins maritimes qui forment aujourd’hui la forêt des Landes, le but de départ étant de fixer les dunes de la côte. L’ingénieur Chambrelent entreprend s’assainir la plaine intérieure des Landes, rebelle à toute tentative de colonisation agricole en commençant par défoncer la couche d’alios [grès des landes de Gascogne, formé par concrétion des sables] puis en réalisant d’importants travaux de drainage, de défrichement et d’ensemencement forestier : pin maritime, chêne-liège et chêne vert. Essentiellement grâce au pin, le département des Landes va ainsi devenir le plus riche de France. Entre 15 et 20 ans après les semis ont lieu les premières coupes pour les poteaux de mines et le bois de papèterie. La guerre de Sécession va créer une pénurie de résine en Europe, et on se mit alors à collecter la gemme de ces pins. Entre 30 et 40 ans, le gemmeur incise périodiquement le pin à l’aide d’un hapchot. Par cette plaie, la gemme coule dans des petits pots de terre cramponnés au fut ou des sachets en plastique. Toutes les 3 semaines environ, la gemme est récoltée et amassée dans des barriques expédiées vers les usines de distillation qui, pour le principal, consiste à chauffer le produit à 185°. L’oléorésine est composée pour 70% de colophane, 20 % de térébenthine et 10 % d’eau. La térébenthine est utilisée pour les produits d’entretien, les peintures et vernis, les produits de synthèse et l’industrie pharmaceutique. Le procédé d’activation par l’acide sulfurique, pratiqué tous les 12 jours, remplacera le système de gemmage traditionnel, car il réduit considérablement la blessure faite à l’arbre et force la résine à couler aussitôt. Le gemmage sera abandonné dans les années 1990, par la seule concurrence des produits d’importation, moins chers. Les pins maritimes couvrent environ 950 000 ha. Si la récolte de la résine est aujourd’hui quasiment abandonnée (il existe quelques tentatives de réactiver ce secteur économique) les Landes restent aujourd’hui une région opulente où le bois lui-même est très largement exploité, source d’une très voyante opulence : le nombre d’entreprises de transformation du bois de l’état de grumes à celui d’avivés [dès qu’une pièce de bois a une forme géométrique : tasseau, solive, poutre, planche, c’est un avivé, panneaux de particules etc – est impressionnant.
Car, pour lui dérober ses larmes de résine
L’homme, coriace bourreau de la création,
Qui ne vit qu’aux dépens de ceux qu’il assassine,
Dans son tronc douloureux ouvre un large sillon.
Théophile Gautier. Le Pin des Landes 5 juin 1845
Moissonneuse faucheuse de Mac Cormick. L’usage du ciment se généralise en construction, mettant un terme à celui de la chaux.
16 02 1825
John Franklin quitte Liverpool, toujours pour explorer les côtes arctiques de l’Amérique du Nord, de part et d’autre de l’embouchure du Mackenzie, à l’est de la frontière actuelle Canada-Alaska. Il va explorer des milliers de km de côtes allant vers l’est jusqu’à la Terre de Wollaston, sur l’île Victoria et à l’ouest vers Icy Cape. Il rentrera en juillet 1827.
28 02 1825
Un comité philhellène est crée à Paris, dont le succès débordera largement les frontières hexagonales : de Lisbonne à Londres et de New-York à Saint Pétersbourg, les comités de soutien vont fleurir comme fleurs au printemps. La finalité philanthropique dominait, mais certains comités avaient du mal à dissimuler leur vocation militaire et politique. On verra des aristocrates, de grandes bourgeoises aller quêter jusque dans les quartiers pauvres de Paris : il fallait tout de même oser le faire, et y remporter, qui plus est, un franc succès !
7 04 1825
L’indépendance d’Haïti, acquise depuis 21 ans, est reconnue par la France… qui ne peut que renoncer à reprendre l’île : les Américains auraient perçu cela comme une atteinte à leurs intérêts, tout comme l’Angleterre, devenue seule grande puissance coloniale. Mais l’affaire ne se fit pas sans compensations… lesquelles étaient réclamées avec ténacité par les quelques 10 000 familles françaises qui avaient alors dû quitter l’île, abandonnant ce considérable capital que représentait environ un demi-million d’esclaves [1]. Donc la France exigeait d’Haïti l’équivalent du budget national français, soit 150 millions de franc-or, avec un intérêt annuel cumulé de 12 % : les Haïtiens rachetaient leur propre liberté, pourtant conquise par une victoire militaire. Le rapport de forces était tel qu’un refus d’Haïti n’était pas envisageable ; la jeune et pauvre république n’étant pas en mesure d’assumer pareille saignée, on trouva un arrangement et c’est le planteur de café haïtien qui fit les frais de l’escroquerie en exportant gratis son café en France pendant des années, jusqu’à concurrence d’une somme ramenée à 90 millions. L’affaire dura jusqu’en 1888.
27 04 1825
La loi dite du milliard des émigrés vient partiellement dédommager ceux-ci de la perte de leurs biens pendant la Révolution.
29 05 1825
Charles X est sacré à Reims : Victor Hugo est du nombre, invité personnellement et officiellement, à 23 ans ! Par fidélité à sa mère Sophie, ultraroyaliste, décédée 6 ans plus tôt, il a commencé par être ardent royaliste.
25 07 1825
Deux mois plus tôt, l’Aventure, une goélette de 55 tonneaux commandée par Guillaume Lesquin, 22 ans, de Roscoff, a appareillé de l’île Maurice pour une campagne de chasse aux îles Crozet ; 16 hommes à bord, dont 7 d’équipage et 9 chasseurs d’éléphants de mer, de plusieurs nationalité ; le commandement de l’expédition est anglais : Fotheringham ; dans des conditions normales, le voyage dure 30 jours et le bateau a été approvisionné en eau douce en conséquence. Le 8 juillet, lorsque la goélette mouille au large de l’île aux Cochons, l’état de la mer interdit toute opération de débarquement. La tempête va durer un mois, et l’eau commence à manquer. Lesquin se résigne alors à envoyer un canot avec 9 hommes à terre. Malheureusement la chaîne de l’ancre rompt, contraignant le bateau à appareiller avant leur retour et scindant le groupe en deux.
L’Aventure se réfugie dans les îles orientales de l’archipel et mouille dans une baie au nord de l’île de l’Est. Le 29 juillet, la mer déchaînée fait riper la goélette qui s’écrase sur les récifs. Les 7 hommes gagnent la rive à la nage, où ils peuvent enfin se désaltérer. Ils ne peuvent récupérer de l’épave que les débris et les objets qui s’échouent sur la grève : bois, outillage, nourriture…
L’hiver austral bat son plein, les conditions sont rudes et les naufragés, se mettant d’abord à l’abri dans une petite grotte, construisent une cabane constituée de pierres et de planches. Leur alimentation : des albatros, des éléphants de mer (cœur, foie et langue) et des œufs de manchots. Mais ils épuisent rapidement les ressources de ce qu’ils ont nommé la Vallée du Naufrage.
Lesquin et Fotheringham partent alors à la recherche de nourriture par delà les montagnes. Le 24 août, ils découvrent une vallée où vivent de nombreux éléphants de mer, manchots et poussins albatros, mais la nuit et la tempête les empêchent de revenir avec des provisions. Faute de nourriture, les naufragés s’affaiblissent. 4 hommes partent à nouveau, réussissent à se nourrir et à transporter de la chair d’éléphant de mer. Mais l’un d’eux, épuisé et incapable de franchir les montagnes est abandonné sur le chemin du retour. À l’arrivée, ils nourrissent les 3 autres pratiquement à la becquée. Le septième parviendra finalement à rejoindre seul le camp.
L’arrivée de l’été améliore leurs conditions de survie. Les aller-retour vers la vallée providentielle qu’ils nomment Vallée de l’Abondance se multiplient et deviennent moins risqués. Un jour de novembre 1825, de retour d’une expédition, la découverte de leur équipier hollandais, Metzelaar, assommé à la suite d’une dispute, provoque la scission du groupe : Lesquin et Fotheringham et Metzelaar construisent une seconde cabane, laissant la première aux 4 autres.
Les 2 groupes ne communiquent plus jusqu’à ce que Lesquin découvre un moyen de fabriquer des pots de terre avec de l’argile et de la tourbe. Voulant faire profiter les autres de sa découverte, il apprend alors que ceux-ci ont construit une embarcation de fortune et qu’ils vont tenter de partir pour l’île aux Cochons, pour rejoindre les 9 autres.
Le 17 décembre 1825, l’embarquement des 4 hommes est suivi d’une grosse tempête. Persuadés de la perte de leurs compagnons, Lesquin, Fotheringham et Metzelaar vont se servir. Mais les 4 échappent cette fois-ci au naufrage et reviennent : rendez-nous nos affaires !
En mars 1826, Adolphe Fortier, un des hommes du groupe de 4 meurt d’épuisement. Cette tragédie prélude à la réconciliation des clans. Metzelaar retourne dans la première cabane, Lesquin et Fotheringham restent seuls jusqu’à la destruction de leur habitation au cours d’une forte tempête hivernale. Les 6 survivants feront alors cause commune.
Au retour du deuxième printemps, en octobre 1826, Lesquin décide de participer activement à leur sauvetage. Il confectionne 100 petits sacs de peau contenant un message de détresse que les hommes attachent au cou de jeunes albatros qui vont prendre leur envol. La tentative restera sans suite.
En décembre 1826, alors qu’ils s’apprêtent à mettre à l’eau un nouveau bateau de fortune constitué de peaux tendues sur une structure en bois, les rescapés aperçoivent un baleinier anglais. Ce n’est qu’après plus de 2 semaines qu’ils réussiront à se faire remarquer en allumant un feu. Le 7 janvier 1827, après 17 mois de survie, les 6 hommes embarquent sur le Cape Packet. Le 3 février, à la demande des rescapés, un passage est effectué devant l’île aux Cochons : les 9 chasseurs ont eux aussi réussi à survivre et sont récupérés. Tous les rescapés seront déposés au Cap le 5 mars 1827. Lesquin sera assassiné à Valparaiso en 1830, à l’âge de 27 ans.
Les compagnons d’infortune, pénétrés de la vérité de mon adage continuel, que de notre bonne intelligence dépendait la prolongation de notre existence sur cette île, nous témoignèrent plus d’égards qu’ils n’en avaient jamais eus. Notre situation, quoique affreuse, semblait être quelquefois oubliée par nous. Une nuit du mois de septembre, je rêvais auprès de notre feu, sur les chances que nous pouvions avoir d’échapper à la destinée qui nous menaçait, lorsque deux idées se présentèrent à mon esprit.
Je savais que les jeunes albatros, en quittant leur nid et en prenant leur essor pour la première fois, se dirigent toujours vers le nord et se rendent souvent dans les parages que fréquentent les navires, à bord desquels ils sont quelquefois pris à l’hameçon.
Je formais donc le projet de leur attacher au col des petits sacs de peau, dans lesquels je déposerais un billet qui indiquerait la position des îles et par lequel je prierai le navigateur entre les mains duquel ce billet pourrait tomber, de dévier un peu de sa route pour nous retirer de notre misérable situation. J’engagerais en outre un baleinier à venir, par l’appât de la grande quantité d’huile que l’on pourrait faire en peu de temps. Toutes les fois en effet qu’un baleinier dépèce une baleine dans ces mers, il est entouré d’une grande quantité d’albatros et j’avais lieu d’espérer que la curiosité de savoir ce que contenait le petit sac suspendu au col de l’albatros, engagerait quelque personne à s’efforcer de le prendre.
Le lendemain je mis la main à l’œuvre et je fis cent sacs de peau. J’écrivis ensuite cent billets de la même teneur que je plaçai dans chaque sac bien cousu. Au premier beau temps, nous nous acheminâmes tous vers la vallée de l’Abondance et nous attachâmes nos sacs aux jeunes albatros. Notre illusion fut si grande, que nous crûmes être certains de sortir de l’île par ce moyen.
Guillaume Lesquin. Relation du naufrage de la goélette l’Aventure de l’Ile-de-France.
25 09 1825
Les Anglais inaugurent le premier chemin de fer : Un exploit sans précédent a été réalisé, en Angleterre, par l’ingénieur George Stephenson, que la plupart des gens sérieux ont traité de fou quand il a exposé son projet. La machine à vapeur qu’il a construite et à laquelle il a donné le nom de Locomotion a remorqué un train de wagons de Stockton, sur une distance de 39 km, jusqu’à Darlington. Le train, composé de trente wagons chargés de charbon et d’une voiture couverte où avaient pris place les directeurs, a roulé sur des rails qui sont normalement utilisés à la circulation des convois miniers traînés par des chevaux. Une foule importante a assisté à cet essai. Le train était précédé par un cavalier porte-drapeau.
Le Journal du Monde, sous la direction de Gérard Caillet. Denoël 1975
17 11 1825
Pierre Suchard fonde à Neufchâtel une confiserie où il propose des desserts frais et nouveaux au chocolat fin de sa fabrique. Son chocolat ne contient pas de lait. Ce n’est qu’en 1875 que Daniel Peter créera le chocolat au lait, que Suchard commercialisera à partir de 1890. La marque Milka – Milch und Kakao -, de Suchard sera déposée en 1901. Après de multiples changements de propriétaires, Milka-Suchard sera racheté par l’américain Mondelēz International, qui en 2017 revendra Suchard au français Eurazeo, mais gardera Milka, d’où la séparation commerciale de Suchard et de Milka.
1 12 1825
Le tsar Alexandre 1° meurt d’un refroidissement à Taganrog, dans le sud de la Russie où il était allé rendre visite à son épouse en cure. Les funérailles ne se dérouleront à Saint Pétersbourg que le 13 mars 1826, son cercueil restant fermé, contrairement à la tradition. Tolstoï dans l’un de ses romans accréditera la thèse selon laquelle il ne serait pas mort mais se serait retiré à Tomsk, en Sibérie où il aurait continué à vivre sous l’identité de Fiodor Kouzmitch, starets. Son petit neveu Alexandre III fera ouvrir son cercueil : il était vide. En 1995, celui de Fiodor Kouzmich sera exhumé à Tomsk, mais il faudra attendre le résultat de test ADN pour savoir si l’évolution d’Alexandre I° dans ses dernières années au pouvoir vers le mysticisme s’était ainsi confirmée.
14 12 1825 [2]
Emmenés par Troubetskoï, des officiers russes qui, lors de leur découverte de l’Occident de 1805 à 1815, en se battant contre Napoléon, avaient découvert les mouvements de libération nationale, les régimes parlementaires et l’abolition du servage, tentent de soulever la garnison de Saint Pétersbourg pour obtenir des réformes du nouveau tzar Nicolas I°. Les décembristes sont écrasés ; les survivants seront déportés en Sibérie. De là naîtra l’intelligentsia, rejetant l’absolutisme et le servage, et les pionniers du mouvement révolutionnaire russe se réclameront des décembristes.
Au fond des mines sibériennes
Gardez une patience fière :
Votre labeur plein de souffrance n’aura pas été vain
Ni la hauteur de vos aspirations
En votre sombre souterrain,
Compagne fidèle du malheur,
L’espérance éveillera vie et joie
Et le temps si désiré viendra :
L’amour et l’amitié franchiront
Les verrous funestes de vos bagnes.
De même que ma vois libre
Vous parvient dans vos terriers ;
Les fers pesants tomberont,
Les prisons s’effondreront, la liberté
Vous accueillera, joyeuse,
Et vos frères vous remettront vos épées.
Alexandre Pouchkine. Lettre pour la Sibérie, 1827 Traduit par W. Berelowitch.
1825
L’Anglais Thomas Telford réalise le plus grand pont suspendu : 176 m. Les Anglais Cyrus et James Clarks commencent par fabriquer des chaussons avec des chutes de peau de mouton ; ils passeront ensuite à la chaussure : 200 ans plus tard, elles seront toujours là, fabriquées au Vietnam, puis en Inde. Il faut faire très attention à deux choses dans la vie : le lit et les chaussures car, quand on n’est pas dans l’un, on est dans l’autre. Elie de Beaumont et Pierre Dufrenoy entreprennent l’établissement de la carte géologique de la France. Simon Bolivar est président des trois républiques du Pérou, de la Bolivie et de la Grande Colombie [Panama, Colombie, Venezuela et Équateur]. L’Oklahoma devient réserve pour l’ensemble des cinq nations indiennes, afin de garantir, selon les termes de James Barbour, secrétaire à la Guerre que la tranquillité du futur lieu de résidence de ces peuples ne soit jamais perturbée.
Jean Anthelme Brillat-Savarin, natif de Belley, dans l’Ain (1755-1826), magistrat, député, féru de sciences, publie La Physiologie du goût. On y trouve un oreiller de la belle Aurore, nom accordé par le chef à cette pièce de gourmandise charcutière réalisée par son cuisinier qui en pinçait pour sa mère, Claudine Aurore Récamier. Ce pâté en croûte carré, fourré d’une multitude de viandes, dont la recette sera rapportée dans La Table au pays de Brillat-Savarin, 1892, par son gendre, Lucien Tendret, appartient au patrimoine gastronomique gaulois : rares sont ceux qui, de nos jours, osent se lancer dans sa réalisation. Jugez-en et si vous ressentez une énergie positive, lancez-vous, en prenant soin de ne pas courir deux lièvres à la fois :
Ayez une noix de veau, deux perdreaux rouges, le râble d’un lièvre, un poulet, un canard, une demi-livre de filet de porc et deux ris de veau blanchis. Divisez ces viandes en filets de trois ou quatre centimètres de largeur, enlevez la peau dont elles sont recouvertes et faites-les mariner pendant au moins douze heures dans de l’huile d’olive et trois verres de vinaigre de vin blanc ; ajoutez deux ou trois oignons coupés en rouelles, un bouquet de thym, du sel et du poivre. Préparez deux farces, la première faite de viande maigre de veau, de porc, de lard gras, de jambon, la seconde composée de foies blonds de poulets et de poulardes de Bresse, de ceux des perdreaux, de mœlle de bœuf, de champignons et de truffes noires. De l’assemblage de ces chairs dans une pâte croustillante et dorée naît l’oreiller de la belle Aurore, dont le parfum des truffes noires mêlé au fumet des viandes embaume la salle à manger.
Pour la fin du repas, il pouvait faire plus léger, en réinventant la composition du sirop de trempage du baba au rhum, dont il fit bénéficier les frères Julien, pâtissiers qui remplaceront le rhum par du kirsch, supprimeront les raisins secs, le formeront en couronne et le nommeront Savarin.
vers 1825
Michael Faraday, né à Newington, alors dans la banlieue de Londres, a dû subvenir aux besoins de sa famille dès ses 13 ans, en commençant comme garçon de courses chez un libraire ; un an plus tard il passait à la reliure qu’il pratiqua pendant 7 ans, s’attardant sur les ouvrages scientifiques, ce qui le fit remarquer par un client qui lui offrit un billet pour une série de cours dispensés par Humphry Davy. Ce dernier, à la suite d’un accident de laboratoire, souffrit ultérieurement d’une cécité temporaire et prit alors Faraday comme assistant. En 1825, il devenait directeur du laboratoire, et, en 1833, professeur de chimie.
Il formule l’hypothèse que, si l’électricité qui passe dans un fil produit des effets magnétiques, comme Ampère l’avait démontré, la réciproque devait également se vérifier : un effet magnétique devait produire un courant électrique. D’où l’expérience suivante : enrouler autour d’un anneau de fer deux rouleaux de fils séparés. L’un des rouleaux conduit à une batterie, l’autre à un galvanomètre [détecteur sensible au courant électrique], et Faraday découvrit que, lorsqu’il branchait et débranchait la batterie, un courant électrique passait temporairement dans l’autre fil. Manifestement, ce second courant était produit par les effets magnétiques du premier courant. Il s’agissait donc d’une conversion directe du magnétisme en électricité.
[…] Ces expériences menèrent à toutes espèces de résultats pratiques : développement du moteur électrique et du générateur électrique, et donc des trains et tramways électriques, fourniture d’électricité au public, télégraphe électrique et, dans les mains d’un inventeur tel qu’Alexander Bell, téléphone
Colin Ronan. Histoire mondiale des sciences. Seuil 1988
Le sac des tombeaux des rois de France à l’abbaye de Saint Denis en 1793, par ses seuls excès a marqué les esprits, ne pouvant que produire des réactions favorables à la protection légale des bâtiments présentant un intérêt artistique. Dans un premier temps, c’est à l’abbé Grégoire que l’on doit ces mesures. Mais des saccages se sont néanmoins poursuivis. Victor Hugo est à l’aube de son génie : il a vingt trois ans, et il plante ses premières banderilles dans le lard de la bêtise et de la cupidité.
Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays. Une loi suffirait : qu’on la fasse. Quels que soient les droits de propriété, la destruction d’un édifice historique et monumental ne doit pas être permise à ces ignobles spéculateurs que leur intérêt aveugle sur leur honneur, misérables hommes et si imbéciles qu’ils ne comprennent même pas qu’ils sont des barbares. Il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté ; son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde ; à vous, à moi, à nous. Donc, le détruire, c’est dépasser son droit.
Victor Hugo était alors à la littérature ce qu’Alexandre et Bonaparte avaient été à la guerre et à la politique : Le Hugo embourgeoisé et pair de France, le vaticinateur de Guernesey, et le barde national panthéonisé de la III° République ont éclipsé pour nous le jeune dieu des années 20, décoré par Charles X à vingt-trois ans, et invité au sacre de Reims, comme s’il y était venu au coté du roi relever la bannière de la poésie, cependant que les Jeune France pâlissaient à la seule idée de lui être présentés. Aucun autre poète français n’a connu en littérature ces commencements d’Alexandre ou de Bonaparte, cette étoile au front, ce cortège électrisé et un peu fou de jeunesse et de succès. Il dût y avoir là, dans la France tenue en lisière par la Sainte Alliance, et sous l’éteignoir morose de la Restauration, comme un début d’embellie nationale, une ébauche de revanche de Waterloo. Le Napoléon de l’alexandrin arrivait en retard sur l’Histoire, mais il arrivait.
Julien Gracq
Lequel éteignoir morose n’aura tout de même pas empêché que la Restauration ait été le laboratoire de nombreuses pratiques politiques : parlementarisme, amendement, initiative des lois, responsabilité, enquête législative.
Emmanuel de Waresquiel
11 05 1826
François Fauconnet fonde la Société des Eaux d’Évian.
15 06 1826
Le sultan Mahmoud massacre les janissaires révoltés. Crées au XIV° siècle, ils étaient recrutés parmi les chrétiens de naissance : leur valeur militaire et leur bravoure n’eurent longtemps d’égal que leur turbulence. Les janissaires manifestaient leur mécontentement en renversant leurs marmites, en répandant leur soupe et leurs portions de riz, et faisaient un bruit diabolique en frappant de leurs cuillères les fonds de leurs plats.
Cette milice qui dispose quelquefois du trône et trouble l’État presque toujours autant qu’elle le soutient.
Voltaire
Longtemps les janissaires, ce corps institué dans un esprit de conquête pour la foi, ont été les guerriers favorisés du ciel, que l’histoire nous fait voir triomphants en toute rencontre. Mais, depuis près d’un siècle, des intrigants ont limé sourdement le collier de leur discipline et rompu enfin la chaîne de leur subordination envers les chefs
Ordonnance de Mahmoud de 1826
16 07 1826
Maurice Alhoy fonde le Figaro, prenant pour devise les mots que Beaumarchais lui prête : Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur.
13 08 1826
Alexander Gordon Laing, major écossais envoyé par le Royal African Corps, arrive seul à Tombouctou. Parti de Tripoli, il était passé par Ghadamès, In Salah, et avait traversé le Tanezrouf en s’intégrant à une caravane touareg. Attaqué, gravement blessé, il n’en franchit pas moins 650 km de désert pour arriver dans la ville mythique aux yeux de l’Occident, où il lève des plans et prend des notes. Expulsé par le sultan, il en repart mais sera assassiné par des Maures dans le désert : 70 ans plus tard, en 1895, Félix Dubois demandant aux Soudanais pourquoi ils l’avaient assassiné, s’attirera cette réponse : Le major ne bavardait pas avec les gens. Il ne les a pas amusés par ses récits. Sinon, il aurait eu des amis dans la ville.
Paul Morand fera lui aussi le voyage, cent ans plus tard : Tombouctou, qui fut jadis une cité de plus de cent mille âmes, n’est plus qu’un village de cinq mille habitants. Envahie par le désert, gonflée de poussière, pénétrée par les sables, recroquevillée par les nuits fraîches, dilatée par la chaleur, fendue par les écarts de température, bâtie en matériaux périssables, elle tombe en ruine et n’a plus d’importance stratégique ou commerciale. Cependant, l’impression que laisse Tombouctou est très forte. C’est la fin du monde nègre, de la beauté des corps, des gras pâturages, de la joie de vivre, du bruit, des rires : ici commence l’islam avec son intolérance, sa silencieuse sérénité, sa décrépitude : pas une culture, pas une irrigation, malgré le Niger à quelques kilomètres, pas un édifice, ni une route, ni un ouvrage d’art. Le sable y fait éternuer comme du poivre, assèche et étouffe les poumons. Le pas feutré par ce sable, qui amortit tout bruit, les maisons sans fenêtre, qu’on dirait fortifiées, le vent coupant du désert, des têtes sinistres vous épiant derrières les grillages de bois peint, derrières les portes cloutées comme des coffre-forts, les terrains vagues, les rues tortueuses, les entrées disposées en chicane et les places désertes où seuls quelques méharis reposent à l’ombre, gardés par un Touareg voilé, maigre comme une chèvre, la bouche barrée de noir, je n’oublierai plus cela. Les nègres, à Tombouctou, ne sont pas beaux, tant il y a eu de croisements, de métissage. Ils sont relégués à l’arrière-plan. Les femmes sont effrontées et habituées à servir, à exploiter l’étranger, à calmer le jeûne de générations de voyageurs. Elles descendent des anciennes courtisanes de Tombouctou, célèbres par leur culture et leurs appâts sociables. Déjà, en 1350, Ibn Batouta, voyageur arabe, remarquait avec indignation qu’ici, les femmes recevaient des hommes sans que les maris en prissent ombrage. On reconnaît là déjà la facilité des mœurs des Noirs. C’est que Tombouctou, s’il est l’islam, n’est pas l’islam pur.
Paul Morand. Paris- Tombouctou 1928
L’islam n’est pas seulement une religion d’État comme l’a été le catholicisme sous Louis XIV […] c’est la religion excluant l’État.
Ernest Renan
23 10 1826
Le brigantin sarde I due Fratelli mouille à Marseille : il amène une girafe, cadeau du sultan d’Égypte à Charles X. Pour qu’elle soit à l’aise, on a fait percer le pont, et aménager un toit au-dessus de sa tête, car on avait décidé qu’elle craignait le soleil. On avait encore décidé qu’elle devait boire 25 litres de lait par jour, d’où l’embarquement de trois bonnes vaches laitières, dont une succombera au mal de mer. On redoute un voyage en hiver… qu’elle va donc passer à Marseille, ne prenant la route pour Paris qu’au mois de mai : le voyage est long… pour lui assurer un peu de repos, il se fera en péniche de Lyon à Macon. Zarafa – c’est son nom -, est revêtue d’une cape dotée d’une très longue capuche brodée aux armes du roi de France et du pacha d’Égypte, les sabots sont enveloppés de chaussons ! La girafe va tenir la vedette tout l’été dans la Rotonde du Jardin du Muséum National : 600 000 spectateurs dans les six premiers mois ! Elle vivra jusqu’en 1845, et mourra alors d’une tuberculose bovine venue du lait !
1826
Le duc Decazes et l’ingénieur Cabrol fondent la Société des Houillères et Fonderies de l’Aveyron au hameau de Lassalle, qui deviendra Decazeville en 1831 : c’est le début de l’exploitation industrielle. Cela commencera par la fabrication de rails de chemin de fer : au milieu du XIX° siècle, la production sera deux fois plus importante que celle du Creusot. Les accords de libre échange mettront à mal cette production qui se reportera sur la seule exploitation du charbon dont la production sera, de la fin du XIX° siècle aux années trente de 500 000 tonnes/an – le double en 1917 -. Decazeville comptera 36 000 habitants en 1911, la moitié en 1990 Jean-Marcel Jeanneney annoncera la fermeture prochaine en 1961. Le site fermera en 2001.
Peter Dillon, un phoquier irlandais familier du Pacifique découvre sur l’île Tikopia, 13°S, 168°E, dans l’est de l’archipel des Santa Cruz, à l’est des Nouvelles Hébrides, une garde d’épée montée en collier au cou d’un indigène, et une base de chandelier : le récit des indigènes lui laissent penser qu’il pourrait bien s’agir d’objets ayant appartenu à l’expédition de La Pérouse, échouée sur l’île de Vanikoro, 12°S, 166°E, appartenant au même archipel, à 140 miles à l’O-NO de Tikopia.
Le panaméricanisme, vœu très cher de Simon Bolivar pour au moins fédérer, sinon unifier le Panama, le Venezuela, la Colombie et l’Équateur est tenu en échec lors du Congrès de Panama. Les frontières des pays d’Amérique du Sud finiront par coïncider approximativement, à la fin du XIX° siècle, avec les limites administratives des audiences coloniales. Le cadre des anciennes vice royautés [Grande Grenade, Pérou, Rio de la Plata, Brésil] était trop vaste. Entreprendre une révolution dans les Amériques revient à labourer la mer. Bolivar
24 01 1827
Les Autrichiens donnent une réception à l’ambassade d’Autriche à Paris : 4 anciens maréchaux d’Empire, ralliés aux Bourbons, y sont conviés : Mac Donald, Oudinot, Soult et Mortier, qui sont annoncés par leur nom de famille et pas du tout par leur titre impérial : duc de Tarente, de Reggio, de Dalmatie, de Trévise. Le coup, plutôt bas, a été orchestré par Metternich. En France, c’est l’indignation, qui n’épargne aucune classe de la société. Victor Hugo veut y voir une insulte à son père, général d’Empire, et voit rouge. Sa profonde amitié avec Lamennais, son aîné rencontré 6 ans plus tôt, avait préparé son éloignement des opinions monarchistes : l’indignation née de cette imbécillité lui fait écrire : l’Ode à la colonne [Vendôme], qui marque son patriotisme, son amour de la liberté et son éloignement des thèses monarchistes :
… À quoi pense-t-il donc, l’étranger qui nous brave ?
N’avions-nous pas hier, l’Europe, pour esclave…
De quel droit viennent-ils découronner nos gloires ? …
Condamnés à la paix, aiglons bannis des cieux
Sachons du moins, veillant aux gloires paternelles
Garder de tout affront, jalouses sentinelles
Les armures de nos aïeux ! …
Prenez-garde ! La France où grandit un autre âge
N’est pas si morte encore qu’elle souffre un outrage
Contre une injure, ici tout s’unit, tout se lève…
C’est le coq gaulois qui réveille le monde
Et son cri peut promettre à votre nuit profonde
L’aube du soleil d’Austerlitz.
*****
La jeunesse des écoles exulte, les vieux grognards et les demi-soldes sont enthousiasmés, les libéraux peuvent redresser la tête. Cette ode est une réponse arrogante et maîtrisée, une insolence voulue du poète parisien au chancelier d’Empire, de la jeunesse romantique à la vieillesse apeurée, de la liberté créatrice à l’autorité engoncée, du David-Hugo…. au Goliath-Metternich, de la France-Nation à l’Autriche-Empire.
Gaston Bordet. Hugo, Hier, Maintenant, Demain. Delagrave 2002
26 03 1827
Il neige abondamment sur Vienne quand s’éteint Ludwig van Beethoven. Mozart l’avait entendu jouer, alors jeune : Gardez un œil sur ce garçon. Un jour, le monde entendra parler de lui. Une centaine d’années plus tard, Lénine lui rendra aussi hommage, à sa façon : Si j’écoute l’Appassionata jusqu’à la fin, je ne finirai pas la Révolution.[3]
04 1827
Benoît Fourneyron fait tourner la première turbine à Pont sur l’Ognon, dans le Jura, pour le compte de la Société des forges de Pourtales : elle actionne un laminoir et fournit une énergie de 6 chevaux vapeur sous une chute d’eau d’1,40 m. avec un rendement de 83 %. Elle sera utilisée dans l’industrie à partir de 1832. En 1840, il en mettra une autre en œuvre en Allemagne au bas d’une chute de 114 m.
21 05 1827
Un nouveau code forestier voir le jour, fortement inspiré de l’ordonnance de Colbert de 1669. La surface de la forêt française ne cesse de diminuer – 15 % – quand elle a été de 25 %, 27 % aujourd’hui, soit 120 000 km² – et il est nécessaire d’enrayer ce déclin : les droits d’usage fondés ou simplement traditionnels des paysans sont restreints.
Ce nouveau code prive en effet un certain nombre d’habitants de bois mort pour le chauffage, de feuilles mortes utilisées pour les animaux dans les étables ou comme engrais, de bruyères et de genêts qui servent de fourrage, du pacage pour le bétail et de la cueillette des baies et fruits sauvages et de champignons.
Robin Angelats
6 06 1827
Il pleut beaucoup dans le sud-est de la France : la Nartuby est en crue et fait six morts à Draguignan, qui ont péri en tentant de sauver leurs gerbes.
30 06 1827
Chemin de fer St Étienne-Andrézieux, – trois wagons – tracté par des chevaux : 20 km, à l’initiative des ingénieurs Louis-Antoine Beaunier et Louis de Gallois. Les chevaux céderont la place à la machine à vapeur en juillet 1832. Début 1827, Andrézieux n’était qu’un hameau de moins de 500 habitants, qui deviendront 700 puis 900 en 1830, lui conférant alors le statut de commune de plein droit. Grâce à l’acier, elle obtiendra la construction d’un pont suspendu en 1831 ; le bac qui franchissait la Loire sera mis au rebut.

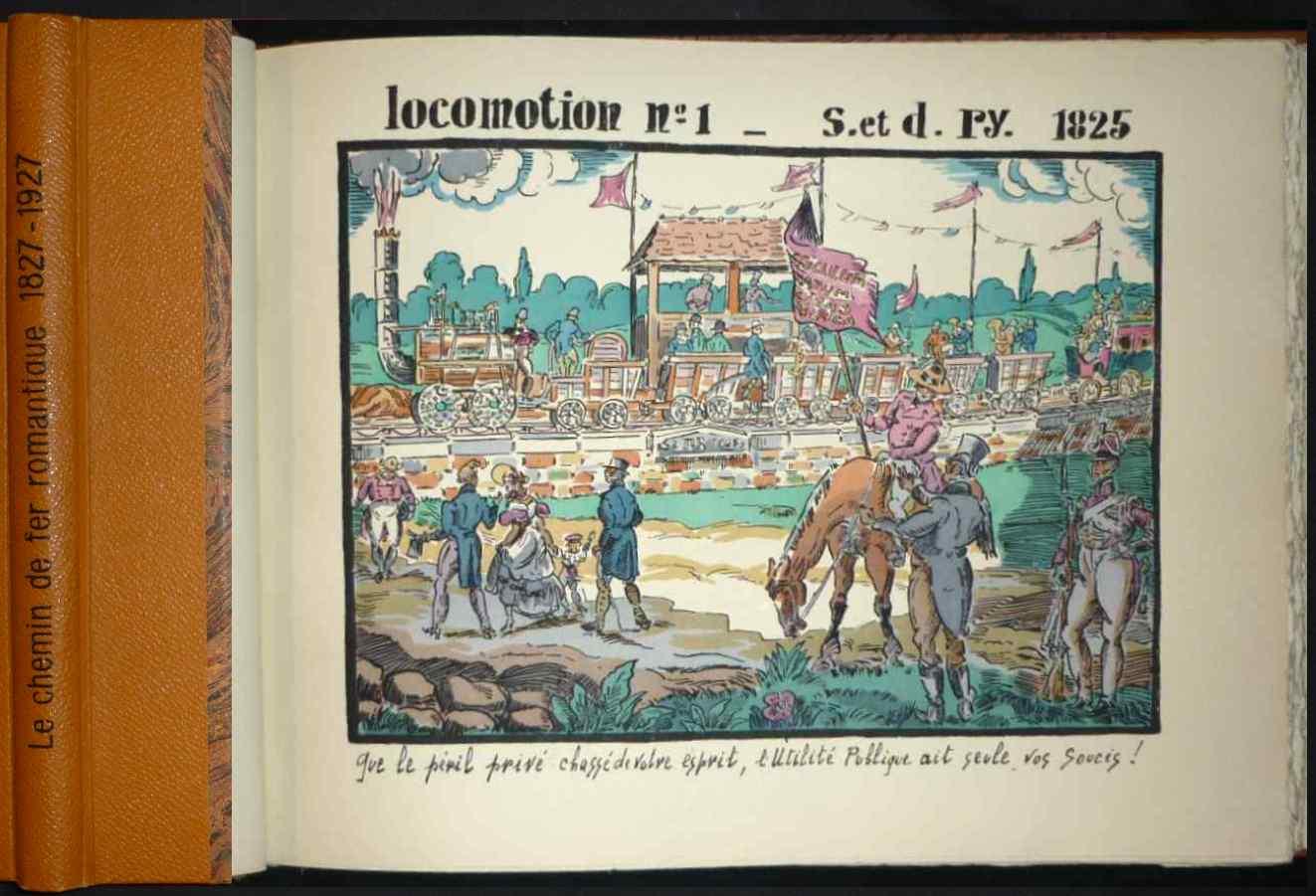
Le chemin de fer romantique 1827-1927

L’exploitation des mines de charbon exigeait beaucoup d’innovations techniques et le chemin de fer en fût l’une des premières manifestations. Quand des hommes de grand talent et de cœur se prennent à conter l’histoire des gueules noires, quand l’amour d’un métier des plus durs devient le partenaire de l’audace des ingénieurs pour une ambition, cela donne une épopée dont le souffle balaie toute autre reconstitution historique : c’est le diaporama du Musée de la Mine de St Étienne… allez-y… c’est superbe.
Delesset propose de fabriquer du sucre de betterave pour compenser les effets du blocus continental.
Le blocus continental, instauré pour asphyxier économiquement les îles britanniques, est une chance décisive pour l’industrialisation du continent, car il permet une évolution en douceur, à l’abri des menaces du compétiteur anglais. La paix revenue, s’il apparaît nécessaire d’adopter les procédés anglais, l’industrie doit être protégée pour éviter la concurrence des produits britanniques. Pour la France, cela dure jusqu’au traité de 1860.
Si les Anglais désignent le XVIII° siècle comme le siècle de l’invention, c’est qu’il se produit en Angleterre, à la fin de ce siècle, une mécanisation encore très limitée, qui a pour effet de permettre, par la spécialisation et la division du travail, une hausse de la productivité. […] Avec Malthus, la théorie classique montre que le point d’aboutissement est un état stationnaire lorsque le volume des subsistances constituera une limite infranchissable pour la croissance. Ce qu’il est impossible d’imaginer sur le moment, c’est le potentiel de croissance que va permettre le remplacement de matières premières d’origine agricole (bois, laine…) par des matières premières importées ou d’origine minérale et le remplacement des sources d’énergie traditionnelles (humaine, animale, hydraulique) par l’énergie de la vapeur fournie par le charbon grâce aux progrès de la métallurgie au coke. Ce n’est pas une Révolution industrielle mais une lente et progressive mutation agro-industrielle. Elle provient d’une substitution d’une mineral-based energy economy à une économie dite organique, substitution qui abolit la concurrence entre consommation humaine et besoins de l’industrie, vis-à-vis d’une production agricole limitée en superficie.
Le coton, la houille et le fer procurent aux économies occidentales des opportunités de croissance parce que les productions correspondantes peuvent croître sans d’autres limites que celles des débouchés, car les matières premières sont importées ou extraites des sous-sol et non produites par l’agriculture en concurrence avec les besoins de la consommation humaine. Avec les débouchés le grand mot est lâché. Si, en deux siècles, le génie humain va être en mesure de mettre au point les innovations technologiques qui rendent possible la croissance, on se heurtera en permanence aux contraintes de l’inertie des structures institutionnelles et sociales : impérialisme ou partage social ?
La machine à vapeur triomphe dans les transports. C’est l’ère du steamer qui est bientôt à coque métallique. Les durées de trajet s’abaissent considérablement. En quelques années l’Europe n’est plus qu’à quinze jours des États-Unis, au lieu de quarante jours précédemment. Après la réalisation du canal de Suez, le temps nécessaire pour joindre Londres à l’Inde baisse de 42 %. Mais la vapeur c’est surtout l’ère du chemin de fer. L’Angleterre pend une avance considérable. La première ligne relie en 1825 Stockton à Darlington [39 km/h. On prend des voyageurs s’il reste de la place]. La première ligne de grande longueur, de Manchester à Liverpool soit environ 300 kilomètres, est mise en exploitation dès 1830 [40 km/h, pour voyageurs], tandis qu’en France la voie ferrée de Lyon à Saint-Etienne reste seule en service à partir de 1828 ; et encore l’exploitation est faite de façon très particulière, en partie par des chevaux, en partie au moyen de câbles et en partie au moyen de locomotives. La première ligne destinée au transport de voyageurs est celle de Paris à Saint-Germain (20 kilomètres) inaugurée en 1836.
Yves Carsalade. Les grandes étapes de l’histoire économique. Les éditions de l’École polytechnique. 2009
07 1827
Vingt quatre ans après la vente de la Louisiane par Napoléon aux États-Unis, six Indiens Osages – deux femmes, quatre hommes – entreprennent d’aller découvrir cette France dont ils gardent un plutôt bon souvenir à travers ses représentants en Louisiane autrefois : trappeurs, négociants en peaux et missionnaires. Ils débarquent au Havre où ils sont applaudis par des milliers de personnes. David Delaunay, breton naturalisé américain et Paul Dubois, traducteur, les prennent en charge, c’est à dire les baladent un peu partout comme des bêtes de foire et encaissent les revenus. Le spectacle finira par lasser : ils passeront les frontières : Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, puis finiront par les abandonner. Ceux-ci décident alors de prendre contact avec leur ancien évêque en Louisiane et Missouri : Louis-Guillaume Dubourg, devenu évêque de Montauban. Trois d’entre eux meurent en cours de route, et les trois autres frappent à la port de l’évêché en novembre 1829. Mgr Dubourg parviendra à réunir assez d’argent pour qu’ils puissent rentrer au pays.
Le voyage chez les Yeux Pâles, – 2015 Michel Lafon – de Philippe Brassard racontera l’histoire. Une association réhabilitera leur mémoire.
20 10 1827
La Russie, le Royaume-Uni et la France, interviennent aux cotés des Grecs dans la guerre qui les oppose aux Turcs, chacun envoyant une flotte en Grèce. Elle interceptera à Navarin, dans l’ouest du Péloponnèse la flotte turco-égyptienne qui aurait du attaquer Hydra, une île grecque. Un corps français sera envoyé dans le Péloponnèse pour superviser son évacuation par l’armée égyptienne en 1828, tandis que les Grecs obtenaient des succès contre les Ottomans en Grèce Centrale. La Russie déclarera la guerre aux Turcs la même année. Sa victoire sera entérinée par le traité d’Andrinople, en 1829.
C’est la dernière grande bataille navale de la marine à voile, avant l’avènement des navires à vapeur, des cuirassés et des obus. Des coups de feu tirés d’un navire ottoman, avant que tout ordre ait été donné, entraînèrent une bataille qui n’était projetée par aucun des deux adversaires. Malgré leur infériorité numérique, les navires des puissances étaient largement supérieurs à leurs adversaires. Dans un combat qui se déroula pratiquement à l’ancre et à bout portant, leurs artilleurs firent des ravages dans la flotte ottomane. Les plus petits navires de la flotte des puissances, qui ne s’ancrèrent pas, remplirent avec succès leur mission de neutraliser les brûlots, l’arme ottomane la plus redoutable. Sans perdre un seul navire, mais après avoir subi d’importants dégâts, la flotte franco-russo-britannique détruisit une soixantaine de navires ottomano-égyptiens, provoquant un véritable carnage.
11 1827
Onésime Pecqueur invente l’engrenage différentiel, qui permet aux roues de tourner à des vitesses différentes : dans les virages, ça aide…
12 1827
La préface de Cromwell de Victor Hugo [la pièce attendra son centenaire pour être jouée… en 1927 !] dit l’histoire de la littérature.
la poésie a trois âges dont chacun correspond à une période de la société : l’ode, l’épopée, le drame. Les temps primitifs sont lyriques, les temps antiques sont épiques, les temps modernes sont dramatiques : l’ode chante l’éternité, l’épopée solennise l’histoire, le drame peint la vie. Le caractère de la première poésie est la naïveté, le caractère de la seconde est la simplicité, le caractère de la troisième, la vérité. […] Nous voici parvenus à la sommité poétique des temps modernes : Shakespeare, c’est le drame ; et le drame qui fond, sous un même souffle, le grotesque et le sublime, le terrible et le bouffon, la tragédie et la comédie ; le drame est la caractéristique de la troisième époque de poésie, de la littérature actuelle.
1827
Nicéphore Niepce réalise à St Loup de Varennes, son village natal près de Chalon sur Saône, après une dizaine d’heures d’exposition au soleil, la première photographie. Le matériel utilisé était une plaque d’étain polie et sensibilisée au bitume de Judée. Il s’associera deux ans plus tard avec Louis Daguerre et, en 1837, ils réaliseront le premier portrait photographique, réalisé avec deux minutes de pose. Le contrat stipulait qu’en cas de décès avant expiration du contrat, la découverte reviendrait au survivant. Or Niepce a 64 ans et Daguerre 42. Niepce mourra, quasiment aveugle, en 1833 et Daguerre raflera donc la mise, en faisant tomber dans l’oubli le nom de Niepce, sans élégance aucune. Le Daguerréotype naîtra en 1838, avec le soutien d’Arago… et la raillerie de Baudelaire qui, pour les portraits, parlera de cadavres exquis. En France, on leur attribue l’invention de la photographie. Les Anglais eux, disent que c’est William Henry Fox Talbot, l’inventeur du négatif en 1841.

Vue de la fenêtre, au Gras.
L’Allemand Georg Simon Ohm établit la proportionnalité entre le courant et l’intensité : c’est la loi d’Ohm : U = R x I
Peter Dillon se rend sur l’île de Vanikoro, où il découvre plusieurs objets dont les quatre canons formant les pilastres de la pyramide que l’ancien musée de la Marine avait élevé pour La Pérouse. Il emporte à Paris la cloche de l’Astrolabe, et où Charles X, tenant la promesse de la Constituante en 1791, lui accordera la récompense de 4 000 franc-or.
Un Français sur deux ne sait pas écrire. Sur 37 367 communes, 16 000 n’ont pas d’école de garçons et 25 000 n’ont pas d’école de filles. Pour un pays de 32 millions d’habitants, on estime les enfants scolarisés à 1 million pour les garçons et 0.5 million pour les filles
22 02 1828
Marc Seguin dépose le brevet d’une locomotive à vapeur qui sera construite à Perrache.
23 02 1828
Antoine Marie Berthet est exécuté à Grenoble, place Grenette : ce séminariste, ancien précepteur chez Michoud de La Tour, à Brangnes, a tiré sur sa maîtresse, Mme Michoud, la blessant grièvement. Stendhal s’inspirera de ce fait divers pour Le Rouge et le Noir, qui paraîtra douze ans plus tard.
14 03 1828
Dumont d’Urville a appris d’une princesse de Tonga Tabou que deux navires battant pavillon blanc avaient relâché entre le passage de Cook et celui d’Entrecasteaux. En escale dans la terre de Diémen, il a eu vent des découvertes de Peter Dillon, et se rend à Vanikoro où il rencontre un vieux qui se souvient avoir vu deux Blancs. Du 21 février au 17 mars, il rassemble d’autres objets de l’Astrolabe, qui, de retour à Paris, seront authentifiés par Jean Baptiste Barthélémy de Lesseps, membre de l’expédition.
Nos gens virent disséminés au fond de la mer, à trois ou quatre brasses sous l’eau, des ancres, des canons, des boulets, des saumons, et surtout une immense quantité de plaques de plomb. Tout le bois avait disparu, et les objets les plus menus en cuivre et en fer étaient corrodés par la rouille, ou complètement défigurés. J’envoyai la chaloupe relever au moins une ancre et un canon, afin de les porter en France comme preuves irrécusables du naufrage de nos infortunés compatriotes.
Il fait édifier un petit monument, une simple plaque de plomb, portant l’inscription : À la mémoire de La Pérouse et de ses compagnons
L’Astrolabe 14 03 1828
Il va mettre noir sur blanc la tradition orale des indigènes, qui parlent de survivants de l’expédition, dont le dernier ne serait mort que quelques années avant la découverte de Peter Dillon. En 2004/2005, une nième expédition, l’association Salomon, reprendra ces récits de tradition orale : Thalassa du 30 décembre 2005 diffusera l’un d’eux : Il y a bien longtemps, un terrible ouragan brisa nos arbres à fruits. On aperçut au loin deux pirogues géantes sur le récif. Des hommes blancs sont arrivés sur notre île. Nous voulions les tuer, les prenant pour des esprits malfaisants. Ils ont planté autour d’eux une forte palissade et ils ont construit un autre bateau. Après cinq lunes, ils partirent au loin, laissant deux de leurs compagnons. Ils ne les revirent jamais.
Ces chercheurs découvriront dans ce qu’ils nommeront le camp des Français, au bord de la rivière Lawrence, des balles de mousquet, des tessons de vaisselle, des boutons d’uniforme, mais aussi plusieurs crânes et même un squelette entier très bien conservé ; et sur les fonds marins, de nombreux objets de La Boussole, reposant par 40 m de fond.
Ils s’étonneront encore d’une liane porteuse d’un haricot là-bas nommé cassoulet ; or, on ne retrouve ainsi nommé ce haricot dans aucune autre île voisine ; La Pérouse était parti pour une mission scientifique chargée de rapporter entre autres nombre d’échantillons de flore, mais, au départ, les cales n’étaient pas vides : il avait mission de découvrir, mais aussi de faire découvrir, et donc les navires étaient chargés de biens représentatifs de notre civilisation… dont, probablement, des haricots.
Voyages de Bellot dans les mers Arctiques. De 1826 à 1833, voyages d’Alcide d’Orbigny en Amérique du Sud : Brésil, Paraguay, Uruguay, Argentine, Chili, Bolivie, Pérou : zoologue, botaniste, ethnologue et archéologue, géologue et géographe, il est envoyé par le Muséum d’Histoire Naturelle ; il est surtout le père de la stratigraphie, décrivant et classant en 28 strates 20 000 mollusques. Il rentre à La Rochelle en septembre 1833, croisant Darwin, parti en juillet 1832. Ils polémiqueront, d’Orbigny s’étant ancré, à l’instar de son maître Cuvier, dans la théorie fixiste. [Cuvier, un œil sur la Genèse et l’autre sur la nature, s’efforçait de plaire à la réaction bigote en mettant les fossiles d’accord avec les textes et en faisant flatter Moïse par les mastodontes. Victor Hugo Les Misérables]. Darwin tenait tout de même d’Orbigny en haute estime, lui qui mérite, après Humboldt, la première place sur la liste de voyageurs en Amérique.
Humboldt, la première place ? Oh que oui !
Humboldt, comme Alexander von Humboldt (1769-1859), bien sûr. Seul humain à avoir donné son nom à l’un des 70 principaux courants de la planète. Les amateurs de toponymes ne s’en étonneront pourtant pas : selon Andrea Wulf, autrice d’une récente et passionnante biographie, le scientifique allemand détiendrait le record toutes catégories des usages toponymiques d’un nom propre, laissant derrière lui les présidents et les rois, les artistes les plus célèbres et les savants les plus renommés – Newton et Vinci compris. On ne parle pas ici de rues ou de places, d’écoles ou d’universités. Mais de chaînes de montagnes, sur tous les continents, de dizaines de rivières, de chutes d’eau, de parcs, de baies. De villes et de comtés. De centaines de plantes et d’animaux, dont le célèbre manchot de Humboldt. Des dizaines de minéraux. Même la Lune dispose de sa Mare humboldtianum et de son cratère de Humboldt.
Si, en France, trois guerres contre l’Allemagne ont sans doute contribué à reléguer l’aristocrate prussien au second plan, le reste du monde sait ce qu’il doit à l’explorateur intrépide, chercheur infatigable, maître audacieux de la synthèse. Certes il n’a pas inventé la relativité ou la théorie de l’évolution. Mais Darwin assurait devoir son envie de science et de découverte à la lecture des ouvrages de son « modèle », plus particulièrement les Voyages dans l’Amérique équinoxiale (dont il avait emporté quelques-uns des onze volumes sur le Beagle).
Pendant cinq ans, de 1799 à 1804, Humboldt traverse l’Amazonie et gravit des sommets andins. Surtout, il observe, compile, collecte données et échantillons de toutes sortes, avec le souci constant de leur donner du sens. Ainsi le géologue de formation affirma-t-il, avant tout le monde, l’existence de liens entre « l’univers inanimé » et les règnes animal et végétal. Pour lui, la Terre est un tout qu’il souhaite déchiffrer. Un système vivant et merveilleux que l’humain s’emploie à détruire. Bien que soutenu par le roi d’Espagne, l’ami de Simon Bolivar, qu’il a connu à Paris, dénonce à son retour les activités des colons, la déforestation massive, l’usage excessif de l’eau et la stérilisation des sols. De quoi modifier les grands équilibres de la planète, annonce-t-il. Ça ne vous rappelle rien ?
Mais pour ce père de l’écologie, il faut d’abord mesurer. Température, pression, humidité, champ magnétique : partout où il passe, il sort ses instruments. Pendant des centaines de kilomètres à travers la forêt amazonienne, lors de son ascension du Chimborazo, le plus haut sommet andin alors connu, et enfin lorsqu’il atteint la côte Pacifique. En septembre 1802, il prend la température de l’eau à Trujillo, dans le nord du Pérou. 12,8 degrés Réaumur, note-t-il, soit 16,1 °C. En novembre, il réédite l’opération plus au sud, à Callao, le port de Lima : 15,5 °C. Une température étonnamment basse pour une eau tropicale, près de 7 °C au-dessous de ce que l’on observe normalement sous la même latitude.
Plus remarquable encore, lors de son retour en bateau vers Guayaquil (Equateur), en décembre et janvier, il constate qu’au large l’eau atteint 22 °C. Pris par ses multiples autres projets, le génial touche-à-tout ne reviendra sur le sujet qu’en 1827, dans une conférence devant l’Académie prussienne des sciences consacrée à la circulation océanique. S’il admet ne pas encore bien comprendre l’ensemble du phénomène, il ne doute pas que cette eau froide arrive directement du grand Sud. Une fausse évidence qui perdurera encore pendant plus d’un siècle.
Pour ses admirateurs, il faut honorer le grand homme. En 1835, son protégé, Franz Julius Ferdinand Meyen, propose de donner au courant le nom de son « découvreur ». Il est suivi par le géographe Heinrich Berghaus en 1837, puis par le très officiel atlas maritime prussien en 1840. Humboldt sait pertinemment que d’autres ont décrit le flux marin sans l’attendre : l’officier espagnol Cosme Damian de Churruca, quelques années avant lui, ou encore le jésuite José de Acosta, deux siècles plus tôt. Surtout, « ce courant est connu de tous les jeunes pêcheurs, du Chili à Paita [nord du Pérou] », proteste-t-il. Lui continuera, toute sa longue vie (il meurt à 90 ans), à l’appeler « courant du Pérou ». Les autres adopteront son nouveau patronyme.
Humboldt a vu juste sur un point : tout le Pérou connaît, sinon le courant, du moins sa principale conséquence, l’abondance de ressources marines…
Nathaniel Herzberg Le Monde du 23 08 2023
Louis Hachette crée sa librairie et lui donne de solides bases financières en fournissant les écoles primaires, puis, avec sa collection La Bibliothèque des chemins de fer, il prendra comme premier réseau de distribution les boutiques des gares : la littérature de gare est donc une vieille affaire. Rejet de la loi sur le droit d’aînesse.
20 04 1828
René Caillié veut aller à Tombouctou. Il a vu le gouverneur du Sénégal lui refuser 6 000 francs pour son expédition. Il va en Sierra Leone où les Anglais le paient pour diriger une fabrique d’indigo. C’est avec ces économies qu’il est parti de Boké, un an plus tôt, dans le nord-ouest de la Guinée. Il arrive à Tombouctou où il reste jusqu’au 4 mai. Il lui fallait passer pour un arabe – il en avait appris la langue… à peu près – et avait arrangé une histoire pour expliquer sa présence : il aurait été capturé par les troupes de Bonaparte à Alexandrie, se serait échappée de France pour regagner sa ville natale… L’histoire, à ce qu’il en dit, en laissa plus d’un septique.
En entrant dans cette cité mystérieuse, objet de recherches des nations civilisées de l’Europe, je fus saisi d’un sentiment inexprimable de satisfaction.
[…] Revenu de mon enthousiasme, je trouvais que le spectacle que j’avais sous les yeux ne répondait pas à mon attente ; je m’étais fait de la grandeur et de la richesse de cette ville une tout autre idée : c’est une ville triste, bâtie dans les sables, où les gens faute de bois, brûlent la fiente des chameaux, où il faut acheter de l’eau sur le marché. Elle n’offre, au premier aspect, qu’un amas de maisons en terre, mal construites ; dans toutes les directions, on ne voit que des plaines immenses de sable mouvant, d’un blanc tirant sur le jaune, et de la plus grande aridité. Le ciel, à l’horizon, est d’un rouge pâle ; tout est triste dans la nature ; le plus grand silence y règne ; on n’entend pas le chant d’un seul oiseau.
Cependant il y a un je ne sais quoi d’imposant à voir une grande ville élevée au milieu des sables, et l’on admire les efforts qu’ont eu à faire ses fondateurs.
René Caillié. Voyage à Temboctou.1830
Il est probable – mais on n’en a pas de preuve – que ce récit ait été rédigé par François Edme, membre de la Société de géographie, à partir des notes prises par René Caillié. Il finira son voyage au sein d’une caravane de Maures, se dirigeant vers le nord-ouest : il sera à Tanger le 7 septembre : 4 500 km à pied, sans moyens, incognito, pendant 508 jours. Voyageur géographe, pionnier de l’ethnographie et botaniste, il fût en quelque sorte l’inventeur de l’africanisme. Pour un vol mineur, son père avait été envoyé au bagne de Rochefort en 1799, l’année de sa naissance : il y mourut avant d’avoir achevé sa peine de 12 ans.
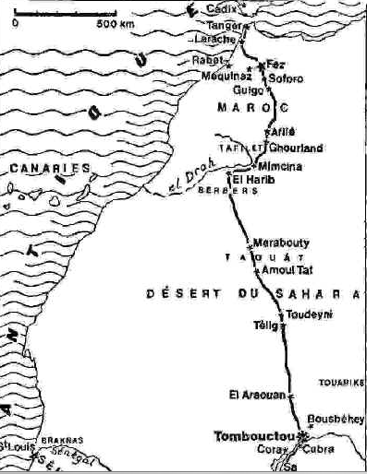

par Alexandre Oliva. Musée Bernard d’Agesci à Niort.
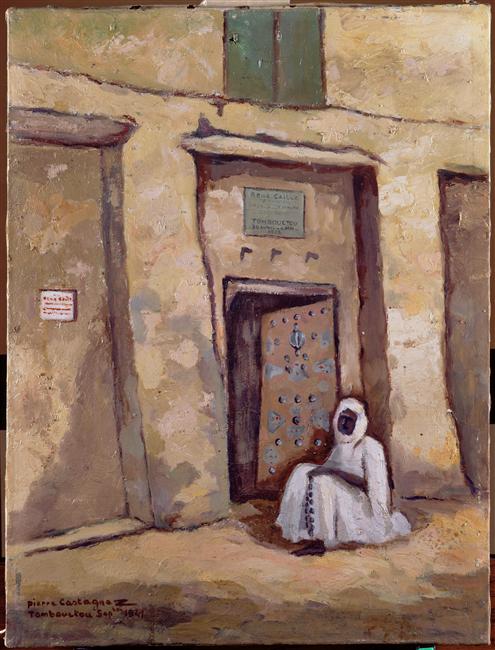
Maison de René Caillé à Tombouctou par Pierre Castagnez.1941

26 05 1828
Un garçon de 16 ans titube de fatigue dans une rue de Nuremberg. Ses propos sont incompréhensibles. Il tient à la main une lettre adressée au commandant d’un régiment de chevaux légers : elle dit que son père aurait appartenu à ce régiment et un autre billet, joint à la lettre, le déclare né le 30 avril 1812. Il se nomme Kaspar Hauser, sait écrire son nom et prononcer une dizaine de mots intelligibles. Le premier des deux messages aurait soi-disant été écrit par l’homme qui a élevé Kaspar Hauser, le second par sa mère.
Abandonné par ses parents peu après sa naissance, il aurait passé toute son enfance dans un cachot. Cible de deux attentats en 1828 et 1830, il succombera au troisième en décembre 1833. Il est difficile de croire que l’on se serait ainsi acharné sur lui s’il n’y avait eu des enjeux importants. On a dit qu’il était d’une naissance liée à la famille du Grand Duché de Bade. Des analyses d’ADN effectuées en 1996 et 2002 ont donné des résultats contradictoires.
Ce drame inspirera Verlaine, – dans Sagesse – ; Georges Moustaki, Serge Reggiani le chanteront dans les années 60 et Werner Herzog en fera un film en 1974 :
Je suis venu, calme orphelin,
Riche de mes seuls yeux tranquilles,
Vers les hommes des grandes villes :
Ils ne m’ont pas trouvé malin.
À vingt ans un trouble nouveau
Sous le nom d’amoureuses flammes
M’a fait trouver belles les femmes :
Elles ne m’ont pas trouvé beau.
Bien que sans patrie et sans roi
Et très brave ne l’étant guère,
J’ai voulu mourir à la guerre :
La mort n’a pas voulu de moi.
Suis-je né trop tôt ou trop tard ?
Qu’est-ce que je fais en ce monde ?
Ô vous tous, ma peine est profonde :
Priez pour le pauvre Gaspard !
16 06 1828
Le très pieux et très pleutre Charles X interdit les Jésuites d’enseignement : à l’origine de l’affaire, l’opuscule d’un obscur aristocrate aigri, François de Reynaud, comte de Montlosier : Mémoire à consulter sur un système politique et religieux tendant à renverser la religion, la société et le trône : entreprise de démolition de la pédagogie jésuite, où le faux prend beaucoup plus de place que le vrai.
1828
Année catastrophique pour le champagne : 80 % de la production est perdue : les procédés encore artisanaux de fabrication ne permettaient pas de maîtriser correctement la fermentation… qui faisait fréquemment exploser les bouteilles. Ce risque expliquait un prix de vente très élevé. Mais plus au sud, dans le Languedoc, les affaires de la vigne marchent fort bien depuis plusieurs années : la production augmente plus vite que les surfaces, avec de nouveaux cépages comme l’aramon dont le rendement est excellent et le carignan qui fait monter le degré d’alcool des vins.
Premiers transports en commun à Paris, avec des omnibus qui circulent de 8 h à 23 h ou minuit, c’est à dire bien après le départ matinal des ouvriers, et pas au-delà de l’heure de clôture obligatoire de la plupart des établissements publics.
Agricol Perdiguier, compagnon du Tour de France [4] et républicain convaincu, termine son tour de France de 4 ans, qui l’a mené à travailler dans 11 villes : il raconte tout cela dans Le livre du compagnonnage. Interdit par la Révolution qui y voyait un frein à la liberté du commerce et de l’embauche, le compagnonnage a repris vigueur à la Restauration.
Un homme doté d’un esprit plus curieux que celui des habitants du village de Caille, 43° 44′ nord, 6° 47′ est, dans les Alpes Maritimes reconnait dans l’assise d’un banc public une météorite, qui aurait été découverte entre 1650 et 1700 dans la montagne de l’Audibergue, proche du village. Mais on n’en sait guère plus sinon qu’en échange de son départ pour le Jardin du Roy, le village aurait reçu une cloche ! La météorite pèse encore 625 kg après qu’un maréchal ferrant en ait extrait le nécessaire pour quelques fers à cheval. C’est la plus grosse météorite jamais trouvée en France.

L’Allemand Friedrich Wöhler parvient à fabriquer de l’urée, établissant ainsi que les composés inorganiques obéissent aux mêmes lois que les composés organiques, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de différence fondamentale entre le vivant et l’inerte.
La Cisplatine, province la plus méridionale du Brésil prend son indépendance sous le nom de République de la rive orientale de l’Uruguay. C’est un échec pour dom Pedro I°, empereur du Brésil qui, confronté de plus à de graves difficultés financières, abdiquera en faveur de son fils de 5 ans le 7 avril 1831.
Dans la colonie du Cap, les Noirs libres obtiennent l’égalité juridique avec les Blancs.
Jean-Baptiste Guimet, polytechnicien, puis chimiste lyonnais, met au point un équivalent synthétique du bleu outremer jusqu’alors obtenu par broyage du lapis-lazuli, ce qui coûtait à peu près cent fois plus cher. Autre application, autrement plus juteuse que la vente aux peintres du dimanche, et aux autres, Ingres par exemple, intégrée au lavage du linge, elle a un pouvoir blanchissant : il n’en fallait pas plus pour assurer la fortune de la famille : c’est la naissance d’une industrie familiale qui, un jour, deviendra Pechiney.
Émile, fils de Jean-Baptiste et de Zélie Bidauld, artiste peintre suffisamment connue pour avoir exposé deux fois au Salon, est beaucoup plus passionné d’art, de musique et surtout de voyages – comme beaucoup – que de gestion d’entreprise, aura à sa disposition – comme très peu – les moyens de satisfaire ses goûts, ce qu’il fera en compagnie de son ami peintre et dessinateur de presse Félix Régamay. Et quand, les malles emplies de souvenirs, d’achats, de croquis, ils rentreront d’Extrême Orient, ils arriveront juste à temps pour trouver un emplacement où exposer tout cela à l’Exposition universelle de 1878 au Trocadéro. Puis le tout sera ramené à Lyon où Jules Ferry, ministre de l’instruction publique et des Beaux-Arts inaugurera le 30 juillet 1879 le musée Guimet. Las, à cette époque les Lyonnais ne se montrent pas friands d’orientalisme et Emile Guimet parviendra à ficeler un projet pour redéménager le tout à Paris : ce sera le musée Guimet qui ouvrira ses portes le 20 novembre 1889.
Je veux voir et je veux que tout le monde voie !
Emile Guimet
25 03 1829
L’Astrolabe de Dumont d’Urville jette l’ancre à Marseille : pendant trois années de navigation, elle a parcouru 25 000 lieues, rassemblé 1 600 plantes, 900 échantillons de roche : la moisson est unique. Mais ce n’est pas cela qui fait perdre toute modestie à Dumont d’Urville : il était déjà comme ça avant : Cette aventureuse campagne a surpassé toutes celles qui avaient eu lieu jusqu’alors par la fréquence et l’immensité des périls qu’elle a courus, comme par le nombre et l’étendue des résultats obtenus, en tout genre. Une volonté de fer ne m’a jamais permis de reculer devant aucun obstacle. Le parti une fois pris de périr ou de réussir m’avait mis à l’abri de toute hésitation, de toute incertitude. Vingt fois j’ai vu l’Astrolabe sur le point de se perdre, sans conserver, même au fond de l’âme, aucun espoir de salut (…). Mille fois j’ai compromis l’existence de mes compagnons de voyage (…) et je puis affirmer que, durant deux années consécutives, nous avons couru plus de dangers réels chaque jour que n’en offre la plus longue campagne de la navigation ordinaire.
13 04 1829
En Irlande, l’Acte d’émancipation accorde aux catholiques le libre accès à toutes les fonctions militaires ou civiles, à l’exception de la vice-royauté d’Irlande, des postes de chancelier d’Angleterre et de chancelier d’Irlande : à l’origine de cet important progrès, l’initiative de Daniel O’Connell, tribun hors-pair, fondateur de la Catholic Association qui n’hésite pas à bousculer la prudence de l’Église catholique irlandaise, avait osé, contre la loi, se présenter en 1828 aux élections dans le comté de Clare, contre le candidat officiel du gouvernement [les catholiques avaient le droit de vote mais n’étaient pas éligibles]. Il avait été élu triomphalement, si bien que le gouvernement avait été contraint à déposer un projet de loi mettant enfin protestants et catholiques sur un pied d’égalité. En 1841, il sera élu maire de Dublin. Il demandait l’abrogation de l’Union Act de 1801 pour que l’Irlande puisse avoir son propre parlement ; il encourageait aussi la guerre des dîmes menée contre l’Église et ses partisans, de plus en plus nombreux, organisaient des manifestations monstres. Un meeting était prévu à Clontarf en 1843, qui mirent les Anglais sur le pied de guerre ; il l’annula, par crainte des risques de violence – celles de la révolution française étaient encore dans toutes les têtes -. Son étoile pâlit… jusqu’à sa mort à Gênes, en 1847 : il allait à Rome.
24 05 1829
John Ross repart à la conquête du passage du nord-ouest avec son neveu James Clark Ross : il est financé par John Booth ; c’est la première fois que l’on utilise un bateau à vapeur, le Victory, pour une expédition dans le nord : le coup d’essai ne sera pas un coup de maître : la motorisation à vapeur va vite rendre l’âme : on continuera avec les seules voiles. Il sera escorté au départ par le Krusentern. Ils doublent à nouveau le détroit de Lancaster, descendent le détroit du prince Regent, découvrent le golfe de Boothia et effectuent la première détermination du pôle magnétique par 69°34′ N et 94°54′ O. Ils hibernent à Felix Harbor en 1830 en organisant plusieurs expéditions, découvrant entre autres l’île du Roi Guillaume. En 1832, il abandonne le Victory, hiberne encore à proximité et réussit à regagner le détroit de Lancaster grâce aux chaloupes. Il sera recueilli en mer de Baffin par un baleinier, l’Isabelle, son ancien navire.
08 1829
Charles X, le dernier des Bourbons, nomme, à la tête de son gouvernement, Jules de Polignac, une figure plus qu’impopulaire. La plupart des élus demandent de la modération, et le roi Charles X, têtu, envoie l’un de ses ministres les plus rigides en première ligne. La majorité des députés, refusant d’accorder leur confiance à Polignac, écrivent donc une adresse au roi, tout en délicatesse : La Charte […] fait du concours permanent des vues politiques de votre gouvernement avec les vœux de votre peuple la condition indispensable de la marche régulière des affaires publiques. Sire, notre loyauté, notre dévouement, nous obligent à vous dire que ce concours n’existe pas. Charles X est piqué au vif. Comment osent-ils ?
28 11 1829
Les Français Vavasseur et Lenoir déposent un brevet pour fabriquer de la fausse fourrure, ce qui signifie que tout se brevète, y compris le faux : les Chinois y ont-ils pensé ?
1829
Éclairage au gaz dans les rues de Paris. Trois cents périodiques scientifiques. Jean Pierre Calmels crée un atelier de coutellerie à Laguiole : il ne pensera pas à déposer une marque, ce qui fait que tous les Laguiole sont des vrais Laguiole, et c’est bien pour cela qu’on en voit autant, avec leurs faux crans d’arrêt, leur faux ivoire etc… Mais en 1993, un commercial habitant la banlieue parisienne, futé et sans élégance utilisera le nom pour déposer une marque sous laquelle il commercialisera une kyrielle de produits, fabriqués un peu partout dans le monde ; son business étant légal, quand la commune de Laguiole ira en justice pour faire valoir ce qu’elle estime être ses droits, elle perdra, en première instance comme en appel. Mais elle finira par gagner devant la justice européenne en 2014, annulant la marque Laguiole de Gilbert Szajner pour les outils et instruments à main entraînés manuellement, ce qui lui laisse tout de même la possibilité de vendre tout le reste sous la marque Laguiole.
Des liaisons fluviales pour le transport des passagers se mettent en place : Orléans-Nantes, Lyon-Arles. Le nouveau code forestier de 1827 passe mal, et c’est bien sûr là où il y a le plus de forêts qui profitaient jusqu’alors aux villageois, principalement avec le pacage des moutons, chèvres et cochons. Ajoutez à cela une simple mine de fer – à Vicdessos précisément – qui a besoin du charbon de bois fourni par les charbonniers pour alimenter ses fourneaux, et cela suffit à énerver les gens jusqu’à provoquer de très bruyantes manifestations dans toute l’Ariège : les Demoiselles – en fait des hommes barbouillés de suie – qui, fatigué des amendes et saisie de bétail, font un énorme tintamarre quasi carnavalesque mais s’en prennent aussi aux gardes forestiers, chargés de faire appliquer la loi. Les gendarmes interviendront, se feront souvent rosser et les troubles dureront jusqu’en 1872.
L’Angleterre, met fin à la coutume, [venue du brahmanisme] qu’elle estime barbare du satï en Inde : le suicide collectif des veuves sur le bûcher funéraire de leurs époux décédés, surtout pratiqué dans les clans rajpoutes.
Louis Grégoire Domeny de Rienzi est un inconsolable de Napoléon et ne peut supporter les Bourbons : dès 1815, il est parti voyager et le voyage prend fin avec le naufrage de l’O Dourado, en mer de Chine méridionale, qui engloutit 14 ans de notes, spécimens, un Atlas de 400 cartes, 12 volumes de recherches. Il ne s’en remettra pas et survivra de travaux alimentaires. Il avait parcouru le Caucase, l’Abkhazie, la Géorgie, la Circassie, le Mexique, Haïti, la Colombie, la Grèce où il combattit aux cotés des indépendantistes, l’Abyssinie, l’Arabie, la Perse, l’Inde, la Chine, les îles de la Sonde, Sumatra, Bali, les Moluques, les Philippines, les îles Salomon, la Nouvelle Guinée !
Mais il en est d’autres qui auront mieux négocié leur disponibilité à la fin de l’empire : soldat de la Grande Armée, c’était là une compétence reconnue et qui pouvait bien se monnayer ; ainsi d’Auguste Claude Court qui sut vendre ses services en Orient de 1818 à 1844, au service du shah de Perse, puis du roi sikh du Lahore ; en 1826, il voyagera longuement en Afghanistan et finira sa vie de mercenaire avec le grade de général en 1836 : L’Afghan est un être brut en comparaison du Persan ; au lieu d’avoir comme celui-ci des manières prévenantes et polies, il accompagne les siennes d’arrogance et de beaucoup de rudesse, mais la franchise qui le caractérise ne saurait le faire plier à ces afféteries banales et pleines de bassesse qu’emploie ordinairement le Persan, surtout lorsqu’il veut parvenir à ses fins ; cependant il usera comme lui de fourberie partout où il y aura lieu de le faire.
Hors les égards qu’il doit à ses maîtres, envers lesquels il pratique l’obéissance la plus aveugle et la plus passive, il regarde tous les autres comme ses égaux et les traite à la sans façon : aussi tout européen qui parcourt l’Afghanistan est-il frappé de ces manières austères et grossières et surtout de la familiarité qui existe du petit au grand : on dirait vraiment que la liberté est innée chez eux. Cependant chefs et gouvernements sont absolus et despotes, mais malgré cela ils sont forcés de marcher d’accord avec cette franche liberté que le peuple afghan doit, depuis un temps immémorial, à cette énergie qui porte l’homme à rechercher ses droits naturels et à s’en assurer la jouissance. C’est là une liberté presque sauvage dont il ne s’est jamais départi, même sous les souverains les plus absolus et qui le rend ennemi de toute espèce de domination étrangère. Elle est même une calamité pour lui, car il en abuse pour s’entredéchirer par des querelles sanglantes qui déciment parfois les tribus.
Aux États-Unis, échec de la colonie communiste de New Harmony fondée par Robert Owen. Des Américains ont trouvé de l’or sur le territoire cherokee de Géorgie et la ruée va balayer tout ce qui pouvait exister comme traités. Car il existait un traité remontant à 1791, garantissant aux natives leur sécurité et la propriété de leur sol. John Belle, représentant le Tennessee déclare alors au Congrès : L’Union, ne pouvant appliquer plus longtemps des principes abstraits et théoriques, décida généreusement de transporter les tribus à ses frais au-delà du Mississippi où s’offrent à elles les riches terres vierges de l’Arkansas.
Les Chickasaws vendirent leur terres et s’en allèrent vers l’ouest. Creeks et Choctaws s’installèrent sur leurs parcelles individuelles, créées par les traités qui avaient démembré les territoires collectifs ; les Cherokees seront déportés en masse au-delà du Mississippi. Les Creeks refusèrent de partir vers l’ouest : c’est ainsi que débuta la deuxième guerre contre les Creeks.
La guerre contre les Creeks est une vaste fumisterie. Il s’agit, au fond, d’un plan diabolique conçu par des hommes cupides pour empêcher une race ignorante de jouir de ses justes droits et de la priver des maigres revenus qu’on lui a concédés.
Un journal d’Alabama
Frères, j’ai entendu bien des discours de notre Grand-Père blanc. Quand il est arrivé d’au-delà des grandes eaux, il n’était qu’un petit homme (…) un tout petit homme. Ses jambes lui faisaient mal d’avoir été assis longtemps dans son grand bateau et il mendiait un peu d’aide pour lui allumer son feu. (…) Mais quand l’homme blanc se fût réchauffé au feu des Indiens et nourri de leur bouillie de maïs, il devint très grand. En un seul pas, il enjambait les montagnes et ses pieds couvraient les plaines et les vallées. Ses mains se saisissaient des mers de l’est et de l’ouest tandis que sa tête reposait sur la lune. Alors, il devint notre Grand-Père. Il aimait ses enfants rouges et leur disait : Allez vous mettre un peu plus loin de crainte que je ne vous écrase. Frères, j’ai entendu bien des discours de notre Grand-Père, et ils commencent et se finissent toujours ainsi : Allez vous mettre un peu plus loin, vous êtes trop près.
Speckled Snake, Creek centenaire
Les premiers Américains tempéraient leur fierté d’une singulière humilité. L’arrogance spirituelle était étrangère à leur nature et à leur enseignement. Ils n’ont jamais prétendu que le pouvoir de la parole articulée était une preuve de supériorité sur la création muette ; la parole était pour eux un cadeau empoisonné. […] Ils croyaient profondément au silence, signe d’une harmonie parfaite. Le silence est l’équilibre absolu du corps, de l’esprit et de l’âme. L’homme qui préserve l’unité de son être reste calme et inébranlable devant les tourments de l’existence ; pas une feuille ne bouge sur l’arbre ; aucune ride à la surface de l’étang qui brille. Telle est pour le sage illettré l’attitude idéale pour la conduite de la vie. Si vous lui demandez : Qu’est-ce que le silence ? il répondra : C’est le Grand Mystère ! Le silence sacré est sa voix ! Et si vous lui demandez : Quels sont les fruits du silence ? il dira : La maîtrise de soi, le vrai courage ou la persévérance, la patience, la dignité et le respect. Le silence est la pierre angulaire du caractère. […] Hélas, dans la vie silencieuse des Indiens d’Amérique du Nord, nous avons semé les graines du bruit, de la précipitation en même temps que nous y introduisions les livres, la poudre à fusil et mille étranges folies. Comme le disait Sun Chief, un Hopi né au siècle dernier : J’ai maintenant appris qu’une personne pense avec sa tête au lieu de son cœur.
Ohiyesa, écrivain Dakota, plus connu sous son nom américain, Charles Eastman

3 02 1830
La conférence de Londres proclame l’indépendance de la Grèce, garantie par les grandes puissances… à tel point que deux ans plus tard, après s’être révélée incapable de gérer ses propres affaires avec, au poste de gouverneur Jean Capodistria, assassiné en septembre 1831 pour avoir fait emprisonner six mois plus tôt Petros Mavromichalis, un magnat du Magne qui refusait de reconnaître le pouvoir central et la nouvelle fiscalité, elle se verra imposée comme roi Othon de Wittelsbach, cadet du roi de Bavière, … qui, en 1833, apportera avec lui 3 500 soldats qui prendront la place des troupes françaises, et des ministres bavarois pour former le gouvernement ! Cette garantie des grandes puissances n’est pas gratuite : le nouvel État doit rembourser l’aide qui lui a été accordée pendant la révolution grecque. Encore mineur, Othon ne pourra régner tout de suite et un conseil de régence se mettra en place au sein duquel Georg von Maurer mettra en place un nouvel appareil législatif, dont certains codes de lois, entrés en vigueur vers 1835, dureront jusqu’en 1950.
Dans une grande colonie grecque, 200 av. J.C. 1928
Il est peut-être temps, comme bien des gens le pensent,
De faire venir un contrôleur pour restructurer l’État.
Pourtant, l’inconvénient et la difficulté,
avec ces contrôleurs, c’est qu’ils font
des histoires à n’en plus finir,
avec n’importe quoi […]
Ils s’enquièrent du plus infime détail et passent tout au peigne fin.
Et aussitôt se mettent en tête de réformes radicales
En réclamant qu’elles soient appliquées sans délai.
En plus ils ont tendance à imposer des sacrifices.
[…] Et plus ils avancent dans leur enquête,
plus ils trouvent de nouvelles dépenses à éliminer :
comme si cela pouvait se faire aussi facilement.
[…] Et quand, la chance aidant, ils auront achevé leur travail,
et qu’une fois tout passé en revue, et tout disséqué avec soin,
ils s’en seront allées, empochant leur juste salaire,
nous verrons ce qui va rester, après,
une telle rigueur chirurgicale.
Constantin Cafavy.
Constantin Cafavy – 1863-1933 -, a en fait passé l’essentiel de sa vie à Alexandrie.
Nous dirons que, si les puissances garantes de l’emprunt des 60 millions apprécient comme il doit l’être l’état réel des choses, elles peuvent, en continuant à user de la bienveillance qu’elles ont toujours témoigné à la Grèce, sauver le pays dans le présent et assurer sa prospérité dans l’avenir, et dégager les garanties en recouvrant le montant de leurs avances.
Casimir Lecomte Etude économique le la Grèce 1847
De cette indépendance à nos jours, la Grèce sera en cessation de paiements presque une année sur deux.
25 02 1830
On donne au Théâtre Français Hernani ou l’honneur castillan, de Victor Hugo, et c’est la grandiloquente empoignade en cours de représentation entre classiques et romantiques, une querelle littéraire comme on les aime tant à Paris. Les deux vers qui mirent le feu aux poudres parlaient d’une armoire en termes colorés :
Serait-ce l’écurie où tu mets d’aventure
Le manche de balais qui te sert de monture ?
Et encore, il suffit qu’un dur de la feuille traduise vieillard stupide par viel as de pique pour que toute la salle embraye à 100 à l’heure sur ce viel as de pique etc etc … vieil as de pique ? et après tout, pourquoi pas ?
Impossible dès lors de taire, tant la France lui doit, le nom du baron Taylor, né à Bruxelles, mais français d’origine irlandaise ; il est administrateur de la Comédie Française depuis 6 ans. Et celle-ci ronronne dans le délabrement artistique et financier. Taylor a voulu lui rendre son éclat, lui ramener son public en accueillant de jeunes auteurs, rétablir l’ordre et la discipline, moderniser la mise en scène. Taylor fait appel à Alexandre Dumas, Victor Hugo, Alfred de Vigny. Il fera basculer le destin de la Comédie Française avec la représentation d’Hernani.
Cette date reste écrite dans le fond de notre passé en caractères flamboyants : la toute première représentation d’Hernani ! Cette soirée décida de notre vie ! Là nous reçûmes l’impulsion qui nous pousse encore après tant d’années et qui nous fera marcher jusqu’au bout de notre carrière.
Théophile Gautier
Je me rappelle qu’un journal, je ne sais plus lequel, a demandé une fois ce qu’avait donc fait M. le baron Taylor pour mériter sa réputation d’homme de lettres, de commissaire du roi, de diplomate et d’artiste : nous allons en deux mots répondre à cette question.
Comme homme de lettres, M. Taylor a publié un ouvrage [Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France. 1°tome en 1820] qui manquait en France sur les antiquités de la France ; ouvrage qui a contribué à répandre dans toutes les classes de la société le goût archéologique, à éveiller dans les municipalités l’orgueil des richesses antiques romanes et gothiques qu’elles possèdent : enfin, à faire nommer un conservateur des monuments historiques échappés aux bandes noires révolutionnaires et commerciales.
Comme Commissaire du roi, il a soutenu le Théâtre Français qui glissait sur une pente si inclinée qu’elle ressemblait à un précipice; a pris d’une main la littérature de Corneille de l’autre celle de Shakespeare et les a forcées, d’ennemies qu’elles étaient, de s’estimer comme deux émules et de s’embrasser comme deux sœurs.
Comme envoyé extraordinaire, il a été réaliser en Orient le rêve de l’Institut, il a matérialisé au bord de la Seine, par un trophée enlevé au bord du Nil, le souvenir de la campagne d’Égypte. Il a fait pour Paris, cette reine guerrière du monde, ce que des empereurs et des papes ont fait pour Rome, cette reine chrétienne de la terre.
Enfin, comme artiste, il a, par dévotion pour l’art, jeté sa vie au milieu des révolutions, disputé les chefs d’œuvre du génie de la paix au démon de la guerre, doté la France d’un trésor qui allait être perdu pour le monde et rapporté pour 800 000 francs, quatre cents tableaux qui valent trois millions.
Qu’on nous cite beaucoup d’hommes de lettres, de commissaires royaux, d’envoyés extraordinaires et de peintres qui en aient fait autant … !
Alexandre Dumas. Feuilleton M. Le baron Taylor au théâtre français, en Egypte, en Espagne. La Presse, 1837
Cet homme-protée, qui joua un si grand rôle dans le monde des arts et des lettres du XIX° siècle, est curieusement resté quelque peu en marge de la grande célébrité posthume. Le scénario qu’offrait cette vie aventureuse n’a trouvé ni son romancier ni son cinéaste. Cet activisme, au bon sens du terme, est caractéristique de l’extraordinaire énergie créatrice du XIX° siècle. Il y a chez Taylor un souffle, une force, un optimisme qui sont ceux d’un Balzac comme d’un Hetzel, d’un Viollet-le-Duc comme d’un Lesseps.
Bruno Foucart, Directeur scientifique de la Fondation Taylor
26 02 1830
Création d’ateliers pour les ouvriers chômeurs.
18 05 1830
L’Anglais Edwin Beard Budding invente la tondeuse à gazon. Le brevet sera déposé en 1831. De quoi occuper le dimanche en attendant l’arrivée de la télévision.
5 1830
L’Indian Removal Act repousse à l’ouest du Mississippi les Indiens de l’Est et du Sud-Est. Entre 1831 et 1838, des dizaines de milliers d’Indiens entreprennent le voyage à pied, dans de très dures conditions : jonchée de morts, la route suivie sera baptisée piste des larmes.
Dès l’indépendance, il avait été convenu que les Indiens auraient le droit de résider à l’est du Mississippi, à condition d’être alphabétisés, et parfois même, de se convertir à la religion chrétienne – protestante bien sûr -, pour former ce que l’on nommait les tribus civilisées.
Mais la découverte de minerais dans leurs sous-sols dès 1820 avaient attisé la convoitise des Blancs. Le territoire des bisons et des Indiens est coupée en deux : les Grandes Plaines représentent à elles seules la moitié des États-Unis : 9 385 000 km². Il y avait alors entre 70 et 80 millions de bisons dans ces grandes plaines, et s’ils étaient si nombreux, c’est sans doute parce que les Indiens n’avaient pu les chasser avec efficacité que depuis leur alliance avec le cheval introduit sur leur territoire par les Espagnols, 300 ans plus tôt. Et le prélèvement restait inférieur à l’accroissement. Et pourtant, si dans notre France profonde, dans le cochon, tout est bon, là-bas, c’est dans le bison que tout est bon :
Les guerriers vont récupérer leurs flèches qui portent des marques spécifiques et leurs permettent de s’attribuer leurs bisons. Grand Nuage, le fils d’Aigle, est très fier. Il a tué deux bisons. Les Indiens achèvent des animaux frappée qui rampent et culbutent en beuglant et soufflant. Ils éventrent quelques bêtes et se gavent du foie fumant. Puis ils partent.
Bientôt, c’est le cortège lent des chevaux de bât qui portent des femmes et des vieillards encore vaillants. Il y a toute une troupe qui suit à pied avec les chiens. Ils sont des centaines. Catlin les voir avancer le long du fleuve, monter vers les collines. Ils se dispersent par groupes autour d’une quarantaine de dépouilles rebondies. Les femmes, réparties sur les collines, dégainent leurs grands couteaux d’écorcheuses et entaillent le cuir. Le but n’est pas de récolter de belles fourrures, car au début de l’été, les bisons muent, et leurs toisons offrent des plaques de lambeaux et de guenilles. Le but, c’est d’abord la viande, reconstituer des provisions. Elles commencent par dépecer le dos afin d’extraire la chair la plus tendre. Les peaux roulent et délivrent les carcasses rougeâtres, roses et jaunies de graisse. Les têtes, les crânes cabossés des bisons écorchés, jaillissent des crinières. Puis les femmes tranchent les pattes avant et les omoplates. Elles s’y mettent à plusieurs. Il y faut de la force et surtout de l’adresse. La manœuvre dégage la viande exquise de la bosse et des côtes et donne accès aux entrailles. Alors, elles découpent la colonne vertébrale, isolent le bassin, sectionnent les pattes arrière, enfin le cou et la tête. Ils comportent de la viande dure, destinée à sécher pour fabriquer du pemmican. L’ensemble des opérations est un boulot costaud car les bisons pèsent lourd, ils ont le garrot épais. Il faut traverser des masses de muscles et d’os puissants, résistants. Le paysage devient un étal de boucherie gigantesque.
Tout est bon dans le bison, rien ne se perd. Les Sioux sont un peuple bison. Pour un wigwam, il faut sept peaux. Puis on fabrique, robes, chemises, manteaux de parade, culottes et pagnes, couvertures, doublures du wigwam, pare flèches, sacs, canoës, lassos, licous. Avec la vessie et l’estomac des bisons, on obtient des récipients pour la viande séchée, l’eau. Les tendons font des cordes pour les arcs. Les os servent d’alênes, de grattoirs ou sont brisés pour en savourer la moelle. Les cornes donnent des louches, des cuillères, des coiffes. Les crânes sont déposés dans les rituels de la Danse du Soleil ou de la hutte de sudation. On enduit les peaux de cervelle de bisons pour les ramollir. On fabrique de la colle, des hochets avec les sabots. Les mocassins sont taillés dans la peau des jarrets. On fait des fouets, des chasse-mouches avec les nerfs. On remplit de poils les balles pour jouer, avec eux on bricole encore des cheveux de poupées pour les petits. Le village est le corps éclaté des bisons. Les vêtements sont des enveloppes de bison. La nourriture est de la viande de bison. Tout sent le suint, la graisse, la fourrure des bisons. On fait l’amour entre les peaux. On naît dans des berceaux de peau. On meurt enseveli sous des manteaux de cuir. Et les rêves sont peuplés de grands bisons solaires.
Les essaims de femmes et les vieillards s’activent sur les amoncellements de chair vive. Les côtes percées par les flèchent saignent. Les mains coupent les délicieuses langues, plongent de nouveau dans les tripes pour saisir les foies qui n’ont pas déjà été consommés par les guerriers, trier les rognons, les panses et les boyaux par paquets. C’est un grand vrac trépidant, ruisselant, une énorme braderie de barbaque scalpée. On lance des morceaux aux chiens qui envahissent le terrain. Les corbeaux se rameutent dans le ciel. Les mouches affluent. Cela pue. C’est brillant, tout vivant de quartiers de viande nue, découpée savamment, ficelée par des cordes de cuir ou enfouie dans les grands sacs, des quintaux pour les festins. Les gosses sont barbouillés de sang frais. Les vieux chevaux bronchent, s’ébrouent, chassent les mouches. Les chiens se chipent les bouts sanglants, un gros œil blanc, gélatineux, valse entre les museaux rougis. Soudain, un jeune adolescent avise un corbeau trop hardi qui voltige au-dessus d’une carcasse. Il tend son arc, décoche sa flèche. L’oiseau s’agite et tombe puis court en voletant partout. La flèche n’a endommagé qu’une aile. Un chien voyant l’alléchante proie zigzaguer se met à la poursuivre, l’attraper, la lâcher, comme dans un jeu. Le jeune adolescent bondit, chasse le chien et s’empare du corbeau qu’il serre entre ses mains. Puis il va recueillir sa flèche. Et le long, lent cortège repart, chargé de trophées qui pèsent des tonnes.
Patrick Grainville. Bison. Seuil 2014
Ce Bison est l’histoire de George Catlin, avocat et peintre portraitiste américain qui, en 1832, avait quitté femme, enfants, peinture académique, plutôt rémunératrice, pour vivre au milieu des Indiens, qui ne savaient pas encore qu’ils allaient être bientôt victimes d’un pieux génocide, pour reprendre l’expression de Régis Debray, les peindre avec d’autant plus de hâte que venant de l’est, il devinait bien quel sort leur allait être réservé.
J’aime ce peuple qui m’a toujours bien accueilli très chaleureusement… qui est honnête, qui n’a ni prison, ni hospice… qui n’a jamais prononcé le nom de Dieu sans pensée profonde… qui ne connaît pas l’intolérance religieuse… qui n’a jamais levé la main sur moi, ni volé ma propriété… Il n’a jamais livré bataille à l’homme blanc excepté sur son territoire… Oh, combien j’aime ce peuple qui ne vit pas pour l’amour de l’argent.
*****
Catlin est parti seul, sans amis et sans conseils, armé de ses pinceaux et de sa palette, pour fixer sur la toile et sauver de l’oubli les traits, les mœurs et les coutumes de ces peuplades dites sauvages, et qu’il faudrait plutôt désigner par le nom d’hommes primitifs. Il a consacré huit années à cette exploration, et visité, au péril de sa vie, les divers établissements d’une population d’environ cinq cent mille âmes, aujourd’hui déjà réduite de plus de la moitié par l’envahissement du territoire, l’eau-de-vie, la poudre à canon, la petite vérole et autres bienfaits de la civilisation.
George Sand. Relation d’un voyage chez les sauvages de Paris
Catlin a supérieurement rendu le caractère fier et libre, et l’expression noble de ces braves gens ; la construction de leur tête est parfaitement bien comprise. Par leurs belles attitudes et l’aisance de leurs mouvements, ces sauvages font comprendre la culture antique. Quant à la couleur, elle a quelques chose de mystérieux qui me plaît plus que je ne saurais dire. Le rouge, la couleur du sang, la couleur de la vie, abondait tellement dans ce sombre musée, que c’était une ivresse ; quant aux paysages – montagnes boisées, savanes immenses, rivières désertes -, ils étaient monotonement, éternellement verts ; le rouge, cette couleur si obscure, si épaisse, plus difficile à pénétrer que les yeux d’un serpent, le vert, cette couleur calme et gaie et souriante de la nature, je les retrouve chantant leur antithèse mélodique jusque sur le visage de ces deux héros.
Charles Baudelaire. Les curiosités esthétiques

Eeh tow wées ka zeet, He Who Has Eyes Behind Him – George Catlin. 1832

George Catlin. vers 1846

George Catlin. 1844
Le territoire des États-Unis a désormais pris sa physionomie définitive, celle même que nous sommes accoutumés à lui voir sur les cartes. En un demi-siècle, entre 1803 et 1853, ils se sont immensément agrandis : leur croissance a ouvert au peuplement, d’un océan à l’autre, un champ grand comme les quatre cinquièmes de l’Europe, avec ses sept millions huit cent mille kilomètres carrés. C’est dans ce cadre que se déroule, au cours du XIX° siècle, l’épopée du peuplement, une histoire quelquefois dramatique, souvent héroïque, toujours énergique et grandiose. Statiques, les frontières politiques coïncident rarement avec la frontière de peuplement, la seule qui importe, limite constamment mobile qui jalonne l’avance extrême de la civilisation. Il arrive sur certains points que le peuplement devance l’annexion, comme en Oregon ou au Texas où il lui a frayé les voies ; plus généralement, il est en retrait sur elle de dix, vingt ou trente années pour remplir le cadre tracé par la négociation ou la victoire.
Quels sont ces hommes qui s’avancent à la découverte d’un monde inconnu ? Pour la plupart des gens venus des États de l’Est : même au plus fort du mouvement d’immigration européenne, les immigrants fraîchement débarqués se dirigent rarement vers l’Ouest, ils prennent la place laissée vide par les Américains partis au-delà du Mississippi ou des Rocheuses. Un goût souvent héréditaire de la vie libre et aventureuse entraîne loin des villes, loin des sociétés établies, les pionniers de l’Ouest. L’instabilité géographique est un trait constant du caractère américain ; est-ce parce qu’il est sans passé ? Le farmer des États-Unis n’a pas contracté avec le sol ce lien mystique qui unit pour le meilleur et le pire le paysan européen à sa terre. Il n’est pas exceptionnel que des fermiers changent trois ou quatre fois de résidence dans leur existence ; on cite le cas du père d’Abraham Lincoln qui passa successivement du Kentucky à l’Indiana et de l’Indiana à l’Illinois ; c’est aussi le cas de tous ces hommes pour qui l’Ouest représente l’indépendance et qui reprennent leur marche dès que la civilisation les rejoint. Le peuplement s’effectue ainsi par vagues successives.
C’est un flot continu qui grossit sans cesse : il s’insinue d’abord par les cols, s’infiltre à travers les défilés des Alleghanys, redescend sur le versant opposé, chemine à travers les forêts, se regroupe autour des rivières ; l’Ohio est, avec ses affluents, le grand axe de pénétration ; plus tard, ce seront les affluents de la rive droite du Mississippi qui joueront ce rôle. Les pionniers descendent l’Ohio avec leur famille, sur des radeaux ou des bateaux à fond plat ; plus à l’ouest des chariots lourdement chargés les transporteront. Arrivés au terme de leur voyage, marqués par l’extrême pointe de la colonisation, ils prennent terre ou détellent ; des planches du radeau ou du fourgon ils se font un abri provisoire ; ils commencent de défricher alentour une petite clairière où ils sèment quelques pieds de maïs ou de blé. L’homme coupe les arbres, arrache les souches, plante une palissade, la femme nourrit quelques volailles, vaque au ménage. L’année suivante, on agrandit la clairière. Bientôt d’autres pionniers s’établissent à un mille ou deux : partout la forêt résonne sous les coups de hache, les arbres tombent. De place en place des villages naissent : on se met d’accord pour construire en commun un bâtiment qui servira à la fois d’école, d’église, au besoin de tribunal ; des responsables sont élus pour gérer les intérêts communs. La civilisation rejoint cet îlot : une route, une ligne de poste le relie à l’intérieur. Déjà ceux qui préfèrent la solitude et l’aventure sont repartis plus loin vers l’Ouest. Ainsi en quelques saisons un coin de forêt sauvage se trouve raccordé au monde civilisé, intégré dans l’ordre politique et social et la même aventure se reproduit simultanément sur des centaines de points de l’immense front qui marque l’avance de la civilisation.
Les nouveaux États se multiplient : en 1820, huit se sont déjà constitués. Progressivement le centre de gravité de la population américaine se déplace d’est en ouest à mesure qu’augmente le nombre de ceux qui vivent au-delà des Alleghanys : sept cent mille en 1800, ils sont déjà un million en 1810, en 1820 ils ont dépassé les deux millions, ils approchent des trois millions en 1830. Le développement de l’Ouest commence à poser de façon aiguë le problème de l’unité politique d’un si vaste territoire : plus les distances s’allongent et plus les rapports s’étirent. En un temps où le pas des chevaux mesure encore les étapes journalières, le risque d’une dislocation de l’Union n’est pas absolument imaginaire : des jours et des jours sont déjà nécessaires pour relier les nouveaux États aux ports de la côte atlantique, et ils se tournent davantage vers le Mississippi et vers la Nouvelle-Orléans qui devient la grande porte de sortie de cette immense région. Le développement de l’Ouest entraîne un déplacement des courants commerciaux dont les cités de l’Est risquent de faire les frais. Un quart de siècle plus tard le péril pour l’unité s’aggrave encore du fait de la brusque dilatation des frontières : la Californie est à six mille milles de Washington et ne communique avec l’Est, dont elle est séparée par la masse formidable des Rocheuses encore mal reconnues, que par l’Amérique centrale ou le détour du cap Horn. Comment maintenir dans de telles conditions géographiques l’unité morale et politique d’un grand pays, comment garder liés entre eux des noyaux de peuplement séparés par de grands vides ? Les États-Unis ont eu cette chance, parmi tant d’autres dont le destin les favorisa, que leur croissance territoriale et politique s’est faite parallèlement à la révolution des transports : les routes et les canaux d’abord dans les années 1810-1830, puis les chemins de fer et les transcontinentaux, plus tard le téléphone, aujourd’hui l’avion, la radio, la télévision ont été les artisans opportuns et efficaces de l’unité politique et psychologique de cette nation grande comme un continent. Moyens de communication et de liaison ont aux États-Unis, du fait de l’étendue, représenté plus que des inventions techniques : ils ont joué un rôle politique national.
René Rémond. Histoire Universelle La Pléiade 1986
En 1776, les États-Unis comptaient environ 1,03 million de kilomètres carrés. Cette superficie fut doublée à l’issue de la guerre d’Indépendance, les treize colonies recevant les 1,27 million de kilomètres carrés de la Réserve indienne située entre les monts Alleghanys et le Mississippi. Ces 2,30 millions de kilomètres carrés furent ensuite doublés en 1803 par l’achat de la Louisiane, transaction conclue avec Napoléon pour la somme dérisoire de 15 millions $. Napoléon savait qu’il n’aurait pu conserver ce territoire à moins d’une longue guerre coloniale à laquelle il n’était pas préparé. À l’époque, il n’existait encore aucune carte de la région du Mississippi, mais des explorateurs comme Meriwether Lewis et William Clark ne tardèrent pas à partir pour Saint Louis, et à atteindre le Pacifique en passant par le nord du Dakota. En 1819, la Floride – soit 186 431 kilomètres carrés supplémentaires – était achetée à l’Espagne pour la somme de 6,5 millions de dollars. Au cours du XIX° siècle, suivirent l’annexion du Texas, auparavant indépendant, et qui avait appartenu au Mexique avant 1836 – encore un million de kilomètres carrés (1845), et l’achat de la Californie, de l’Arizona, du Nevada et de certaines parties du Wyoming et du Colorado, cédés par le Mexique pour la somme dérisoire de 15 millions de dollars – 1,37 million de kilomètres carrés supplémentaires. Cette transaction suivait en 1846 une guerre ruineuse contre le Mexique, qui laissa ce dernier dévasté et profondément pessimiste quant à son avenir.
La découverte d’or en Californie l’année suivante entraîna une conquête de l’Ouest si rapide que certains États, comme le Nevada, ne furent vraiment découverts qu’après leur fondation. Après négociations, le Canada céda gratuitement à l’Union les États d’Oregon et de Washington, au sud du 49° parallèle, soit 741 843 kilomètres carrés. Suivirent enfin l’achat de l’Alaska, en 1867, et des îles Hawaï, en 1895, pour les sommes respectives de 7,2 et 4 millions $. Ceci ajoutait respectivement 1,5 million de kilomètres carrés et 16 571 kilomètres carrés au territoire américain. Porto Rico – environ 8 800 kilomètres carrés – fut annexé sans paiement après la guerre hispano-américaine. Des acquisitions ultérieures – Samoa, Guam, les îles Vierges – portèrent la superficie des États-Unis à plus de 10,5 millions de kilomètres carrés, les 9,4 millions de kilomètres carrés acquis depuis 1776 ayant été achetés pour la somme dérisoire de 47 millions $. Aucun autre pays ne s’est jamais étendu si rapidement, à si bas prix, et en livrant aussi peu de batailles.
Hugh Thomas. Histoire inachevée du monde. Robert Laffont 1986
L’Amérique a beaucoup de chance : au nord et au sud, des voisins faibles, à l’est et à l’ouest, des poissons.
Bismarck
13 06 1830
Charles X a prononcé le 16 mai la dissolution de l’Assemblée et a convoqué les électeurs les 23 juin et 3 juillet 1830. Il publie dans Le Moniteur, un journal de propagande, un appel aux Français dans lequel il accuse les députés de la Chambre dissoute d’avoir méconnu ses intentions et demande aux électeurs de ne pas se laisser égarer par le langage insidieux des ennemis de leur repos. C’est votre roi qui vous le demande. C’est un père qui vous appelle. Remplissez vos devoirs, je saurai remplir les miens.
Les résultats tombent : encore plus de députés libéraux rentrent à la Chambre. La dissolution n’a fait qu’aggraver la situation pour les royalistes. Au suffrage censitaire, les Français envoient à la Chambre une majorité davantage libérale, avec encore plus d’opposants. Les élections de juillet sont un triomphe pour l’opposition qui, au lieu des 221, compte désormais 274 députés hostiles à Polignac.
14 06 1830
Le corps expéditionnaire français commandé par le général de Bourmont débarque sur la presqu’île de Sidi Ferruch, près d’Alger, qui sera prise le 5 juillet : Hussayn, dey [5] d’Alger, réclamait à la France une dette de blé datant du Directoire : un contingent de soldats arabes avait été prêté à Bonaparte pour son expédition en Égypte : le dey d’Alger était trop heureux de s’opposer ainsi au dey d’Égypte ; 40 ans plus tard, il ne faisait que vouloir se faire rembourser la nourriture de ces hommes. Perdant patience, il avait souffleté de son éventail M. Deval, consul de France. En signe de sujétion, son sceau lui fut confisqué : Jacques Chirac le rendra au président Bouteflika le 3 mars 2003.
Une louche affaire menée par des mercantis juifs d’Alger avec la complicité de politiciens tarés de Paris ; un incident provoqué par un diplomate suspect ; une expédition médiocrement conduite par un général discrédité ; une victoire accueillie avec indifférence par l’opinion publique et suivie de la chute de la dynastie qui en revendiquait le mérite, tels furent les débuts singuliers de la conquête de la Berbérie par la France.
Un historien de l’Afrique du Nord cité par Gaston Wiet Histoire Universelle La Pléiade 1986
La civilisation de l’Algérie en 1830 est rudimentaire, puisqu’elle ne construit plus à cette époque de monuments d’une grande valeur artistique, puisque sa littérature est médiocre et sa science en retard de plusieurs siècles. Mais il y a civilisation dès que l’homme s’impose à lui-même des contraintes morales : charité, politesse, morale familiale et qu’il est capable de dominer certains appétits terrestres. […] L’Algérie de 1830 était resté un pays médiéval, mais l’éducation musulmane lui avait donné une grande énergie morale.
Marcel Émerit. L’état intellectuel et moral de l’Algérie en 1830. Revue d’Histoire moderne et contemporaine Juillet-septembre 1954.p 212
La conquête fût d’abord strictement limitée aux régions côtières. Les lisières septentrionales du Sahara furent atteintes seulement en 1844 par l’occupation de Biskra. Laghouat ne fut occupée qu’en 1852 et Touggourt en 1854.
On comptera 25 000 colons en Algérie en 1840, 376 000 en 1881.
Personne à l’époque en France ne savait ce que nous allions réellement y faire. Une seule chose était sûre, c’est d’ailleurs celle que l’on ne cite jamais : il était plus que temps que quelqu’un mette fin au désordre créé depuis des siècles en Méditerranée par les corsaires basés à Alger, constitutifs de cet État-pirate plus ou moins dépendant du Sultan de Constantinople. Et de cela tout le monde nous fût reconnaissant [c’est tout de même les Américains qui avaient commencé en bombardant Tunis le 10 juin 1805. ndlr]. Allions-nous partir ou rester ? L’effondrement du régime de Charles X juste après la prise d’Alger et l’installation de la monarchie de Juillet renvoya le débat à des temps meilleurs. L’armée s’installa donc dans les possessions du bey d’Alger, c’est-à-dire la ville et sa grande périphérie. Mais partout ailleurs les choses restèrent en l’état. C’est Abd-el-Kader qui peu à peu modifia la situation en réunissant de gré mais aussi de force les multiples tribus jalouses de leur indépendance. Une nouvelle entité politique structurée prit ainsi forme dans laquelle la France dans un premier temps ne vit que des avantages et avec laquelle elle passa à plusieurs reprises des accords de paix. Bien sûr les habitants de ces territoires qui n’avaient jamais eu jusque là conscience de partager un destin commun, commencèrent à se trouver une identité commune dans le rejet, non pas tellement de l’étranger, puisqu’ils étaient depuis des siècles sous domination étrangère, mais dans le rejet du non musulman. Nul ne sait comment l’histoire aurait évolué si la nouvelle république issue de la révolution de février 1848 n’avait pas relancé la présence française en Algérie en y exilant par dizaines de milliers les insurgés de juin 1848. L’engrenage infernal des contraintes d’une colonisation de peuplement, amplifié en 1871 par l’installation des Alsaciens et des Lorrains qui refusaient l’annexion allemande, pouvait alors se mettre en place alors que personne ne l’avait voulu au départ. La grande figure d’Abd-el-Kader illumine encore de nos jours cette possibilité d’une autre histoire qui fut alors gâchée. En 1860 alors en exil en Syrie, la protection qu’il assura aux chrétiens de ce pays, déjà persécutés par les mêmes qu’aujourd’hui, lui valut d’être fait grand-croix de la Légion d’honneur et titulaire de l’ordre de Pie IX, distinction qu’il accepta sans pour autant se sentir déshonoré.
Philippe San Marco. Sortir de l’impasse coloniale. Mon petit éditeur 2016
__________________________________________________________________________________
[1] Dans le voisinage, les autres îles en avaient beaucoup moins : Jamaïque : 220 000, Cuba, moins de 50 000, Martinique et Guadeloupe, à peine 10 000 chacune
[2] Date du calendrier Julien, en retard de 13 jours sur le nôtre – le grégorien – .
[3] Peut-on rêver d’un plus beau sujet pour le bac philo ? Avec élégance et précision, Lénine paraphrase Marx – la religion est l’opium du peuple – et disant en quelques sorte : la beauté est l’opium du révolutionnaire. À la différence – et elle est de taille – que Marx se pose en ennemi de la religion : si la religion est l’opium du peuple, il faut la détruire, tandis que Lénine dit : l’Appassionata ne cessera jamais de m’enchanter, et donc, il ne saurait être question de vouloir la détruire.
[4] Les compagnons ne sont plus aujourd’hui les chouchous des médias, mais ils existent bel et bien : les responsables de l’aéroport de Roissy se trouvaient confrontés à des problèmes de vibration dans les tunnels qui passent sous les pistes : seuls les Compagnons ont su régler l’affaire.
[5] Dey était le nom donné au chef du gouvernement d’Alger sous la domination turque, entre 1671 et 1830. Hussayn était donc un janissaire turc.