Un journal du monde
7 janvier au 10 novembre 1918. Les emprunts russes : pfft ! Traité de Brest-Litovsk. Les soviets liquident la famille impériale. 24720
Poster un commentaire
| Publié par (l.peltier) le 18 septembre 2008 | En savoir plus |
7 01 1918
Création des comptes courants et des Comptes Chèques Postaux : CCP.
8 01 1918
À l’occasion de la rentrée parlementaire, Jules Siegfried fait l’éloge du rôle des femmes dans la guerre : Il faudra que leur soit donné le bulletin de vote pour leur admirable attitude. L’affaire attendra encore 26 ans, jusqu’en octobre 1944.
14 01 1918
Clemenceau est parvenu à obtenir des députés la levée de l’immunité parlementaire de Joseph Caillaux : il est arrêté pour intelligence avec l’ennemi. Le Tigre triomphe : Caillaux est à la Santé, en pleine santé. Condamné à trois ans de prison le 23 avril 1920, il sera gracié par la Haute Cour en 1925. À la suite de sa démission en 1914, il avait été envoyé à l’étranger, notamment en Italie, pour nouer des contacts en vue d’une éventuelle armistice : c’est lui qui avait désamorcé la crise d’Agadir avec l’Allemagne, en lui accordant quelques concessions, et on lui connaissait de grandes sympathies pour la recherche de la paix. La France sortait de la période des mutineries, les Bolcheviks avaient cessé de se battre et les Allemands allaient pouvoir concentrer toutes leurs forces sur le front ouest : Clemenceau voulait empêcher coûte que coûte la propagation d’une volonté de paix à tout prix et c’est ainsi que Joseph Caillaux, personnage d’envergure, était devenu sa bête noire.
18 01 1918
C’est le jour de l’ouverture de la session parlementaire russe : les députés commencent par rejeter la motion bolchevique définissant les compétences de la nouvelle institution et élisent le S-R Tchernoff à la présidence. Face à ce pouvoir concurrent, les gardes rouges vont faire évacuer l’Assemblée dès le lendemain : la démocratie parlementaire était mort-née en Russie. Il n’y aura plus d’élection libre en Russie avant 1991.
Le 18 janvier 1918, l’Assemblée constituante se réunit enfin. Bonch-Bruyevitch amène au palais de Tauride un détachement de 200 marins bolcheviques. […]
Seuls les socialistes révolutionnaires de gauche de Maria Spiridonova ont fait bloc avec les bolcheviks : deux d’entre eux entrent au gouvernement. Il n’y aura pas de deuxième session de la Constituante : le 19 janvier, l’assemblée ayant refusé de céder ses prérogatives au gouvernement, Lénine la déclare dissoute. La Garde rouge interdit les accès aux élus venant siéger. Ils sont dispersés et l’on dénombre des blessés. Les militants, de tous les partis, et même des bolcheviks sont scandalisés.
Ces violences venues d’en bas se sont manifestées dès la prise du pouvoir par les bolcheviks les 24 et 25 octobre [1], avec la fermeture de journaux bourgeois. Loin de condamner l’atteinte à la liberté de la presse, Lénine approuve ces violences et stigmatise son camarade Grigori Zinoviev qui les réprouve.
La violence politique s’érige en système. Quand Lénine apprend que la Tcheka de Petrograd, la police politique créée le 7 décembre, retient les ouvriers voulant répondre par une terreur de masse à l’assassinat, le 20 juin 1918, du bolchevik Volodarski, par un socialiste révolutionnaire de droite, il écrit : Je proteste fermement. Nous nous compromettons, alors que nous n’hésitons pas dans nos résolutions à menacer de frapper de terreur de masse les députés des soviets, lorsqu’il s’agit de passer aux actes, nous freinons l’initiative révolutionnaire des masses, entièrement fondée. Ce n’est pas possible. Les terroristes vont nous considérer comme des chiffes molles. Il faut encourager l’énergie et la nature de masse de la terreur, particulièrement à Petrograd, où l’exemple doit être décisif.
Une autre terreur vient s’ajouter à ce climat, avec la guerre civile, dès novembre 1917, quand le général Kaledine soulève les cosaques du Kouban. Cette Vendée blanche sert de point d’appui à des opérations plus vastes : la révolte de l’Ukraine, son occupation par les Allemands. Le noyau des forces blanches est désormais constitué par l’Armée des volontaires, formée d’officiers, dirigée par l’ancien généralissime Alexeïev, puis par Anton Denikine. Simultanément, à Samara, les démocrates de l’Assemblée constituante forment un gouvernement sous la houlette du socialiste révolutionnaire Nicolaï Avksentiev, ni rouge, ni blanc. Mais celui-ci perd toute autorité quand des prisonniers tchèques finissent par se rallier au gouvernement antibolchevique de l’amiral Koltchak, en Sibérie occidentale.
Tous ces soulèvements ont lieu pendant les négociations de paix de Brest-Litovsk (de la fin décembre 1917 au 3 mars 1918) qu’Adolf Joffé et Trotski, membres de la délégation bolchevique, font traîner dans l’espoir que l’esprit révolutionnaire gagne les soldats allemands, puis l’arrière. En vain. Pour prévenir une nouvelle avancée allemande, Lénine, Trotski et Joffé finissent par conclure ce qui n’est ni la paix, ni la guerre, mais la cession de territoires, de manière à gagner du temps. Ils conviennent que les soviets ne feront plus aucune propagande dans les empires centraux. Indigne, s’exclame Boukharine en sanglotant, pour garder le pouvoir, nous faisons du parti un tas de fumier.
Cette décision va provoquer une vive opposition des socialistes révolutionnaires de gauche qui s’insurgent contre cette trahison du prolétariat allemand : pour eux, la révolution européenne passe avant le maintien des soviets au pouvoir. À l’appel de Maria Spiridonova, ils lancent une campagne terroriste contre les représentants de l’impérialisme allemand, c’est-à-dire les bolcheviks. Disposant du tiers des membres au VI° congrès des soviets, le 6 juillet 1918, ils incarcèrent les dirigeants de la Tcheka, rendent caduques les décisions du gouvernement et assassinent le comte Wilhelm von Mirbach, ambassadeur d’Allemagne à Moscou.
Par la suite, les socialistes révolutionnaires de gauche d’Ekaterinbourg exigent qu’on exécute la famille impériale. Mais les troupes de Denikine et ses Tchécoslovaques avancent vers la ville. Finalement, le 16 juillet, le soviet de la ville décide d’exécuter le tsar.
L’insurrection socialiste révolutionnaire de gauche finalement matée, ce parti est désormais condamné. Il est dommage que vous ne les ayez pas tous arrêtés, mais hélas je ne peux pas vous en donner l’ordre écrit, dit Lénine à un soviet bolchevisé. Quant aux socialistes révolutionnaires de droite, ils interdisent à leurs troupes de réagir. Ces soldats défilent donc sans armes en faveur de la Constituante. Mais la Garde rouge tire, faisant une centaine de morts et de blessés. Exclus des soviets pour collusion avec les contre-révolutionnaires, les socialistes révolutionnaires font appel aux Tchécoslovaques et sont condamnés comme complices de la révolte blanche conduite par Denikine. Quant aux mencheviks, opposants loyaux, ils sont néanmoins exclus et interdits. À fusiller s’ils montrent le nez, écrit Lénine.
Trotski, à la tête de l’Armée rouge, n’est pas moins radical que Lénine. Il compte sur la peur pour être obéi. C’est ainsi qu’il prend en otages les parents des 30 000 officiers ralliés à la révolution auxquels il tient, car ils sont compétents. De même, Trotski n’accepte le ralliement, en Ukraine, de l’anarchiste Nestor Makhno qu’avec suspicion.
Le pouvoir des soviets demeure menacé par l’intervention étrangère, Anglais dans le Caucase, Français à Odessa, Japonais en Sibérie. Aussi, pour les bolcheviks, il faut étendre la révolution à l’Europe et créer une III° Internationale. La défaite de l’armée allemande en 1918 apparaît opportune pour étendre la révolution en Allemagne. Mais les spartakistes allemands, derrière Rosa Luxemburg, jugent son développement prématuré. En revanche, l’éclatement de la révolution hongroise avec Béla Kun, en novembre 1918, encourage Lénine.
Résumé de Marc Ferro. Le Monde Juillet 2017
1° avion de combat Dassault. Au Canada, premières velléités d’indépendance du Québec.
23 01 1918
Un des tous premiers décrets des soviets enlève tout statut juridique à l’Église.
24 01 1918
Trotski envoie un télégramme à Vienne, sollicitant l’autorisation de se rendre dans la capitale autrichienne pour engager des pourparlers avec les représentants du prolétariat autrichien ! Ahurissant ! le loup qui demande au berger la clef du cadenas pour entrer dans la bergerie non pas pour croquer les moutons, mais pour leur dire : mettez à la porte votre berger et choisissez-moi, je vous garderai beaucoup mieux que lui !
Commissaire du peuple aux affaires étrangères, Trotski avait alors la haute main sur les négociations en cours avec les Allemands sur la fin de la guerre. Tous les bolcheviques étaient d’accord pour constater que l’armée russe avait cessé d’être une force de combat : Trotski avait vu les paysans en uniforme quitter les tranchées et se précipiter dans leurs campagnes pour saisir leur part du gâteau lors de la redistribution des terres, encouragées par les bolcheviks et leur commission de démobilisation. Mais à partir de là naissaient les désaccords, selon la vision que l’on avait de l’avenir : soit on considérait que les institutions politiques allemandes n’étaient pas appelées à connaître de profonds changements, auquel cas il convenait de continuer à se battre contre eux, à outrance même pour leur arracher la moins mauvaise paix possible… soit on était convaincu que la révolution prolétarienne allait immanquablement gagner l’Allemagne et que dès lors toutes les conditions seraient réunies pour obtenir la meilleure paix possible, puisqu’on serait entre camarades.
Trotski était de ces derniers et œuvrait en ce sens : faire durer les pourparlers le plus longtemps possible, jusqu’à ce que la révolution prolétarienne apporte l’Allemagne aux Russes sur un plateau !
28 01 1918
Encore par décret, Lénine nationalise avoirs étrangers, réserves d’or et de pierres précieuses, joyaux de la couronne, trésor de l’Église orthodoxe : le tout est envoyé sous bonne garde à Nijni Novgorod et à Kazan. Il décide encore de ne plus honorer les dettes de l’ancien régime : ils vont être nombreux à boire le bouillon, les souscripteurs de tous les pays d’Europe, mais parmi eux, les Français auront double ration. La spoliation érigée en principe de gouvernement ! ce sont 1.6 million de petits porteurs français, chiffre diminué de ceux qui étaient morts au front et ailleurs, auxquels il ne reste que les yeux pour pleurer la perte de 12 milliards de francs-or : les fameux emprunts russes.
Article 3 : Tous les emprunts étrangers sont annulés inconditionnellement et sans aucune exception.
30 01 1918
Bombardement aérien allemand sur les hôpitaux parisiens.
L’état-major, face à la crainte de voir Paris détruit conçu alors un plan pour détourner les bombardiers allemands : tandis que Paris resterait dans le noir, on allait construire au nord-est – sur l’emplacement de l’actuel aéroport de Roissy – ou au nord-ouest, tout un simulacre qui donne les apparences d’une grande ville la nuit : gares, voies ferrés, places, tout cela généreusement éclairé. Quelques réalisations furent effectuées, mais l’armistice viendra mettre fin au projet : on ne peut donc savoir si les Allemands seraient ou non tombés dans le panneau.
01 1918
Le sous-marin allemand U 84 coule au large de Penmarc’h, entre Benodet de la pointe du Raz, se faisant cercueil pour le Kapitänleutnant Walter Roehr et ses 39 hommes d’équipage, à – 84 mètres. Il en va ainsi de bien des épaves : on commence par découvrir l’épave, puis commence un très important travail administratif pour parvenir à l’identification : en l’occurrence il s’agira de contact avec les associations allemandes.
La descente commençait dans le bleu et augurait une belle plongée. Mais, à partir de –30 m, la luminosité baissait puis, vers les –50 m, l’eau commençait à changer de couleur pour passer au marron. La profondeur augmentant, on finissait par n’apercevoir que ses équipiers et le bout nous amenant à la gueuse que nous atteignions, peu après, dans une obscurité totale. Les ordinateurs indiquaient alors – 84 m. Alain fixait le fil d’Ariane et, quelques secondes après, nous survolions l’épave. Une bien agréable surprise nous attendait sagement : un sous-marin ! Évoluant essentiellement dans le cadre d’un repérage, nous arrivions bientôt sur le kiosque dont la forme et des détails architecturaux permettaient immédiatement d’établir qu’il ne s’agit pas d’un type VII. Exit l’U 618, il s’agit manifestement d’un autre type d’U–Boot ! La trappe d’accès ouverte interpellait encore et laissait penser que des hommes auraient pu tenter de s’échapper. Les périscopes étaient rentrés dans leurs puits et l’un d’eux était recouvert d’un morceau de filet.
Nous poursuivions notre progression vers ce qui s’avérait être l’avant du submersible. Passé un panneau circulaire fermé, nous tombions en arrêt devant un grand canon, à poste sur son affût. Un chalut, dont une grande partie remonte à la verticale, tiré par des bouées, s’est enroulé sur sa culasse et son frein de recul. On aperçoit ces éléments mais seul le long tube du canon est clairement visible. Plusieurs conteneurs à obus reposent au pied de cette impressionnante pièce d’artillerie dont l’aspect inquiétant est renforcé par la turbidité de l’eau fortement chargée en particules. L’absence de luminosité et la mauvaise visibilité – moins de deux mètres –, ajoutaient une note surréaliste à cette singulière équipée subaquatique. Nous palmions jusqu’au panneau d’embarquement des torpilles avant, survolant les vestiges du pont, mais le temps étant compté – tout particulièrement à cette profondeur – nous devions stopper cette première rencontre avec ce qui est devenu, à nos yeux, l’U-Boot inconnu de Penmarc’h car il s’agit sans conteste d’un sous-marin allemand… de la Grande Guerre. Sitôt effectués les longs paliers, nous pouvions enfin partager avec Hugues, qui veillait au grain en surface, le rare plaisir d’une telle découverte près des côtes de Cornouaille.
Priorité était dorénavant donnée à cette épave. Malgré l’intérêt évident de cette découverte, la presse française s’est avérée, pour l’essentiel, complètement hermétique au sujet. Fait pour le moins surprenant en pleine période de célébration du centenaire de la Grande Guerre… C’est en Allemagne que la nouvelle interpellait, aboutissant, par des chemins détournés – en fait via l’amiral Mathey, ancien président de l’Agasm (association générale amicale des sous mariniers) qui avait eu vent de la trouvaille -, sur le bureau du Korvettenkapitän Juergen Weber, ancien commandant d’U-Boote et vice-président du Verband Deutscher Ubootfahrer e.V. Il nous contactait immédiatement et, parallèlement à notre action, prenait vie un projet franco-allemand destiné à honorer la mémoire des sous-mariniers disparus, toutes nationalités confondues. Bien entendu, les Allemands étaient favorablement interpellés par notre action d’identification et de diffusion de l’information afin de promouvoir, d’une certaine manière, la connaissance d’une petite page d’histoire maritime noyée dans la grande tragédie de la Première Guerre mondiale. Cette action mémorielle naissante avait aussi pour objectif de conforter l’amitié franco-allemande. Et quelle meilleure façon que de réunir des sous-mariniers des deux pays, héritiers d’une tradition commune forgée dans les combats par leurs prédécesseurs ; des pêcheurs bretons dont les ancêtres ont payé le prix fort face aux U-Boot du Kaiser ; des plongeurs passionnés et des élus sensibles à cette démarche ?
[…] Malgré tout, l’U-Boot n’était toujours pas identifié et l’affaire s’avérait compliquée. Nous avions rapidement pris conscience que l’identification de ce sous-marin serait un véritable challenge, tant technique qu’humain, au vu des difficultés d’accès dues à la profondeur et aux conditions rencontrées sur le site. Néanmoins, de nouvelles plongées s’imposaient. Sous couvert de petits coefficients de marée permettant de profiter de courants – omniprésents sur cette zone où la marée ne semble jamais vraiment étaler – moins puissants, il nous fallait examiner l’épave avec minutie et la disséquer plongée après plongée. Tributaire du peu de temps alloué à chaque exploration, il nous fallait établir un plan de travail avec des zones délimitées et des actions ciblées. Seule une certaine rigueur peut permettre de collecter des informations pertinentes.
Avant toute chose, une plongée dans l’histoire de la Grande Guerre et les archives s’imposait. La recherche historique étant indissociable des examens in situ du sujet, les spécialistes des U-Boot de la Kaiserliche Marine, tout particulièrement Yves Dufeil, allaient nous être d’un grand secours en partageant leur analyse finement réfléchie et leur érudition. Première certitude, nous sommes en présence d’un sous-marin océanique de type U ayant coulé, par recoupement, en janvier 1918. Quatre U-Boote de ce type, ayant appareillé pour ce secteur ou y ayant opéré, n’étaient jamais rentrés de patrouille : U 84, U 93, U 95 et U 109. Hormis l’U 95, identifié comme tel par une équipe de plongeurs de la côte d’Opale, tous ont disparu à une date indéterminée, pour des causes inconnues et à des positions totalement ignorées. Cependant, des différences architecturales existaient et pouvaient permettre de trancher ! Nous avions déjà noté qu’il n’y avait qu’un seul panneau sur le pont, entre le canon avant et le kiosque. Seul l’U 84 adoptait cette configuration et, de fait, nous penchions pour ce submersible. Si la présence d’un panneau – et non deux – n’était pas un élément d’identification formelle, gardant à l’esprit qu’un chantier naval, en tant de guerre, était susceptible d’avoir pris certaines libertés lors de la construction de l’U-Boot pour ne poser qu’un seul panneau, la probabilité qu’il s’agisse là de l’U 84 restait du domaine du possible.
Nous avions donc été jusqu’à l’avant, qui est en assez bon état avec l’ancre toujours à poste dans son écubier. Les portes externes des tubes lance-torpilles demeuraient invisibles, cachées sous la couche de concrétions et de sédiments, ou bien envasées. Restait une inconnue : la partie arrière. Deux plongées furent nécessaires pour avoir une idée plus précise de l’état de cette portion de l’épave.
Le premier élément intéressant s’avérait être un canon 8,8 cm L/30, dénommé officiellement Feststehendes 8,8 cm U-Bootsgeschütz L 30 avec son frein de recul à l’extrémité caractéristique placé sur le dessus du tube plutôt court de 2,64 m (le canon de pont à l’avant est un 10,5 cm SK-L/45, bien plus imposant avec son tube long de 4,72 m). À l’extrémité du sous-marin étaient visibles deux tubes lance-torpilles fermés. Malheureusement, les deux hélices sont désormais invisibles, totalement envasées. Nous caressions l’espoir qu’une hélice soit visible et qu’il serait possible de gratter entre les pales où doivent figurer chiffres et données techniques permettant d’aider à l’identification du submersible. Hélas ! Cette piste s’avérait dorénavant inexploitable. Collecter des informations sur les canons où plusieurs marquages existent forcément, notamment au dos des culasses, était du domaine du possible mais seule la pièce arrière était facilement accessible, celle de l’avant étant recouverte d’un filet nécessitant d’être ôté – opération ô combien délicate, voire dangereuse à cette profondeur. Le plus simple restait finalement de mesurer la distance entre la base du kiosque et la base du canon avant car il y avait une différence notable entre les sous-marins des séries U 81 / U 86, U 93 / U 95 et U 105 / U 114. L’U 84, notamment, était plus court d’environ 2 m que les autres séries.
Le samedi 5 septembre 2019, nous organisions donc une plongée, toujours au départ du port de Saint-Guénolé, à laquelle participaient Hugues Priol, Alain Vincent Gautron, Alain Le Garo et votre serviteur. Cette fois, la tâche était partagée, un plongeur devant mesurer la distance kiosque / support canon et les deux autres ayant pour objectif de déployer sur l’épave, en mémoire de l’équipage disparu, le drapeau du Verband Deutscher Ubootfahrer e.V remis, pour l’occasion, par le Korvettenkapitän Juergen Weber. Le succès était au rendez-vous et la mesure relevée donnait 10 m pour 9,9 m sur le plan. Le doute n’était plus permis : il s’agit bien de l’U 84 ! Nous savons désormais où le Kapitänleutnant Walter Roehr et les 39 hommes de son équipage reposent depuis le mois de janvier 1918. Il reste maintenant à retracer sa dernière patrouille et comprendre les événements qui ont mené à sa perte mystérieuse, un jour de janvier 1918.
Jean-Louis Maurette

Le U 84 en navigation
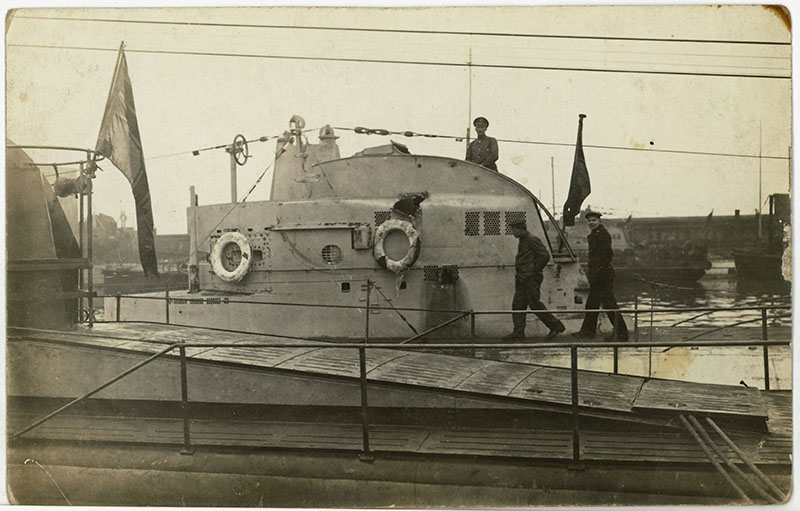
L’économie d’énergie n’est pas une idée neuve : voyez donc cette marmite norvégienne :

Marmite norvégienne exposée lors d’un salon en Grande-Bretagne, sur les économies alimentaires en janvier 1918. L’économie de carburant pendant la première guerre mondiale a conduit à l’adoption de ce système de cuisson par inertie. BRIDGEMAN IMAGES
Œufs cocotte au micro-ondes plutôt que pot-au-feu longuement mitonné. La crise énergétique transparaît dans les engouements culinaires du moment, sur Internet. Recettes délicieuses et sans cuisson, Cuisiner presque sans gaz ni électricité, Recettes qui demandent peu ou pas d’électricité … Les sites de cuisine, ces temps-ci, préfèrent le tiède au bouillant, le juste saisi et même le cru aux plats en sauce. Ils tassent tous les ingrédients dans une grosse casserole, une même fournée. Et redécouvrent les vertus de l’inertie thermique. La magie de la cuisson passive.
Grâce à la chaleur emmagasinée, les pâtes peuvent finir de cuire plaque ou feu éteint, c’est même un Prix Nobel de physique italien qui le suggère – Giogio Parisi, en septembre 2022, sur Facebook – et Barilla qui le confirme sur ses paquets : deux minutes dans l’eau bouillante puis douze minutes d’attente hors feu, sous couvercle, pour les farfalles… À ce jeu du frichti le plus maigre en énergie triomphent les initiés de la marmite norvégienne. Leurs rangs grossissent si l’on se fie à l’offre et l’audience croissantes des blogs, groupes Facebook, recettes et autres tutoriels consacrés au sujet – 74 000 vues sur YouTube pour Fabriquer une marmite norvégienne haute performance dans un tiroir, 14 000 pour …Cuisson d’un bœuf bourguignon dans une couverture de survie
Marmite norvégienne ? Une histoire de cuisson passive, à nouveau, plutôt que de faitout miraculeux inventé en Scandinavie. Ladite marmite consiste en un réceptacle hermétique très isolé qui accueille, une fois passée l’ébullition, la cocotte bien chaude : la cuisson s’y poursuit sans apport d’électricité ni de gaz, durant plusieurs heures. Une technique volontiers qualifiée d’ancestrale, faute de pouvoir la dater, maniée par les Hébreux pour manger chaud durant le shabbat, par tous les paysans du monde disposant de suffisamment de foin pour enfouir une marmite, présentée par les Norvégiens lors de l’exposition universelle de 1867 à Paris (d’où son nom), exhumée lors des deux guerres mondiales, puis refoulée tel un mauvais souvenir dès l’abondance énergétique revenue.
Jusqu’à ce qu’une conjonction peu réjouissante de facteurs transforme la boîte isolante en star des low-tech version 2023. Le renchérissement de l’énergie, les craintes de coupures de courant, l’érosion du pouvoir d’achat, accessoirement la réduction nécessaire des émissions de carbone, relancent la cuisson à l’étouffée et à l’économie. Au lieu de cuire une heure et trente minutes, les pois chiches, par exemple, quittent le feu dès trente minutes pour un séjour moelleux de trois heures en marmite norvégienne.
Cela demande juste un petit effort d’organisation, prévoir le repas trois ou quatre heures en avance – Valentin Castelli-Kerec, 39 ans, consultant en innovation
Une offre commerciale émerge, bien entendu – une couveuse culinaire en laine de mouton, à partir de 148 euros ; un Cooking Bag de la marque Solar Brother à 99,90 euros, en rupture de stock… Mais la version occidentale du Thermal Cooker prisé en Asie se bricole, le plus souvent, en piochant dans le bazar de la cave – vieux anoraks ou duvets, couvertures de laine ou de survie, plaques de liège, caisses en bois, en polystyrène, glacière souple ou rigide… Sur Facebook, des réceptacles hétéroclites s’affichent, dont les seuls points communs sont les propriétés isolantes et la fierté de leurs concepteurs. Leur stupéfaction, aussi, à la première utilisation. Le plat est encore bouillant au bout de deux heures, il faut les maniques, témoigne Alexandrine Maes, 53 ans, une employée dans la logistique convertie à la marmite norvégienne il y a plus de dix ans. Mais, depuis qu’on risque des coupures, les gens écoutent… D’autant que ça enlève une charge mentale. On ne surveille plus la cuisson, pas de risque que ça déborde ou brûle.
Enseignante dans la Vienne, Sandra Morin l’utilise pour tout ce qui cuit dans du jus, comme le cassoulet ou le bœuf bourguignon. On ne laisse sur le feu qu’un tiers du temps prévu pour la cuisson. Avec deux enfants, c’est génial. On arrive le midi, tout est prêt ! Et l’été, en pleine canicule, c’est moins de chaleur en cuisine, vante la quadragénaire. Franchement, quand vous faites cuire vos légumes sans énergie, la première fois, c’est incroyable, se souvient Valentin Castelli-Kerec, 39 ans, consultant en innovation. On se demande pourquoi tout le monde ne le fait pas ! Cela demande juste un petit effort d’organisation, prévoir le repas trois ou quatre heures en avance. Au gré des passages nuageux, cet habitant de la périphérie nantaise alterne marmite norvégienne et four solaire. Les low-tech, je suis sûr à 100 % que ce sera notre quotidien, alors je préfère anticiper, je serai prêt quand nous n’aurons plus qu’un crédit carbone de 2 tonnes par personne, en 2050.

Les étapes de la fabrication d’une marmite norvégienne, de haut en bas : construction d’une boîte en bois et conception d’un couvercle isolé avec du liège ; détail de l’intérieur de la marmite norvégienne. ALIZÉE PERRIN
Résister aux sirènes du Thermomix pour cuisiner à la marmite norvégienne ? C’est mettre un premier pieddans le plat des low-tech, confirme Pierre-Alain Lévêque, ingénieur de 32 ans et président de l’association Low-tech Lab : La marmite est très simple, pas chère, réalisable par n’importe qui, utilisable en contexte rural comme urbain. On comprend facilement son fonctionnement et son intérêt. Elle satisfait au triptyque utilité-durabilité-accessibilité qui définit ces objets et techniques de basse technologie répondant aux besoins fondamentaux, utilisant le moins de ressources et d’énergie possible, aisés à fabriquer et à réparer.
Auteurs du livre Objets low-tech du quotidien (Ulmer, 2022), fondateurs de l’association Chemin de faire, Alizée Perrin et Yoann Vandendriessche, la petite trentaine, ont parcouru la France pendant quatre ans au volant d’un camion de pompiers reconverti en atelier, avant de s’installer en Ariège. Auprès d’eux, le public s’initie à la marmite norvégienne, découvre le frigo du désert (qui reproduit la fraîcheur d’une cave grâce à deux pots en terre cuite séparés de sable mouillé), le germoir à graines, le bokashi (compost de cuisine japonais), le blender à pédale. Et même les vertus du garde-manger de grand-mère.
Dans cette phase d’anxiété, les low-tech permettent de se remonter les manches pour passer à l’action. De se forger un imaginaire du futur – Pierre-Alain Lévêque, cofondateur du Low-tech Lab
La cuisine est intéressante, dans nos sociétés occidentales, car elle est l’un des derniers lieux de fabrication, d’expérimentation, remarque Yoann Vandendriessche, designer industriel de formation. Cela permet de montrer que les low-tech sont à la portée de tous, sans disposer d’un espace énorme ni remplacer les appareils existants mais en complément, pour tendre vers un mode de vie plus sobre, retrouver une autonomie, revoir notre rapport au temps. Sans baisser le curseur du confort. Utiliser une marmite norvégienne, c’est le moyen de faire des économies sans privation, une illustration de l’inventivité à laquelle nous devrions tous être appelés, source éminente de joie, plaidait le 29 octobre 2022, dans une tribune au Monde, un collectif fort du soutien de l’ancien commissaire au Plan Jean-Baptiste de Foucauld.
Au début de l’été 2022, le festival du Low-tech Lab a drainé à Concarneau (Finistère) 15 000 visiteurs en neuf journées qui toutes s’ouvraient par des démonstrations de cuisine low-tech, four solaire en vedette. Par la convivialité gourmande (et peu énergivore) : voilà comment infusent les low-tech, concept né dans le monde anglo-saxon des années 1970, longtemps associé, en France, aux ingénieurs écolos bidouilleurs d’objets moches. Mais depuis son poste d’observation du Low-tech Lab, créé fin 2013, Pierre-Alain Lévêque voit l’intérêt du grand public qui monte, carrément !En témoigne le succès des tutoriels mis en ligne (en open source) par l’association. Et l’émergence de communautés de passionnés, dans nombre de villes. Dans cette phase d’anxiété, poursuit-il, les low-tech permettent de se remonter les manches pour passer à l’action. De se forger un imaginaire du futur.
Sur YouTube, près de 300 000 vues ont été engrangées en deux semaines par la vidéo Ils créent des objets du quotidien qui fonctionnent sans électricité du média en ligne Brut, consacrée à Alizée Perrin et Yoann Vandendriessche. Après avoir été pris pour des fous furieuxà leurs débuts il y a dix ans, ces derniers hallucinent de presque passer pour des sauveurs, aujourd’hui, avec leurs objets au design soigné qui peuvent s’adresser aux citadins. Collectivités locales, entreprises, écoles, les voilà sollicités de toutes parts. C’est aussi le quotidien de Paul Mouraz, à Saint-Nazaire, ce jeune ingénieur fondateur de L’Avant d’après, société conceptrice de solutions basse technologie adaptées aux entreprises – des déshydrateurs solaires, par exemple.
Depuis peu, la région Bretagne a intégré les low-tech dans sa stratégie de soutien à l’innovation : elle forme et expérimente à tour de bras. La Ville de Bordeaux étudie une climatisation de rue faite de drains en argile poreux, avec le Low-tech Lab local. Celle de Paris, comme le département de Seine-Saint-Denis et l’État, subventionnent l’association Skakti21 qui prête des marmites norvégiennes aux personnes hébergées en hôtels sociaux, afin qu’elles recommencent à se concocter de vrais plats.
Et l’Agence de la transition écologique (Ademe) promeut cette nouvelle façon d’innover, pleinement intégrée, désormais, aux scénarios prospectifs visant la neutralité carbone en 2050. L’ eXtrême Défi est même lancé, appel à projets pour une voiture low-tech, véhicule intermédiaire entre automobile et vélo. Un peu plus corsé que la cuisson hors feu des pois chiches.
Fabriquer soi-même sa marmite norvégienne en 3 étapes
1. Utiliser de préférence une cocotte en fonte ou en Inox, pour une bonne inertie thermique, nécessairement chapeautée d’un couvercle.
2. La glisser dans un réceptacle extrêmement isolant. Ce peut être un simple coffre ou un panier rempli de couvertures. Ou, plus esthétique et efficace, une caisse en bois dont les parois intérieures et l’envers du couvercle sont doublés d’une couche épaisse de liège. Encore plus pratique : la marmite norvégienne directement intégrée dans un tiroir de cuisine.
3. La cocotte, remplie pour une bonne part de liquide, doit avoir passé le stade de l’ébullition, couvercle fermé. Nichée dans la caisse isotherme, elle poursuivra la cuisson de manière autonome. La durée du séjour en marmite norvégienne égale, au minimum, celle classiquement prévue pour la cuisson du plat (vite retiré du feu). Mais elle monte fréquemment jusqu’à deux heures, voire trois, pour les légumineuses, par exemple. Attention à la bonne qualité isolante de la marmite norvégienne : si la température baisse trop dans la cocotte qu’elle abrite, des bactéries peuvent se développer.
2 02 1918
Tykhon, le nouveau patriarche élu de Moscou, publie une encyclique dans laquelle il condamne l’état endémique de guerre civile : ainsi les soviets peuvent-ils classer l’orthodoxie parmi les organisations antisoviétiques ; c’est le début de la plus grande persécution religieuse de l’histoire : partout on détruit, on tue, on profane, on déporte : à Moscou, le patriarche est jeté en prison, il y mourra empoisonné. À Saint Pétersbourg, l’évêque Benjamin meurt en bénissant le peloton d’exécution. À la Trinité Saint Serge, des femmes recueillent les reliques jetées aux chiens. Dans les campagnes, les enfants des prêtres sont exécutés pour avoir refusé de témoigner contre leurs parents. Jusqu’en 1941, on va liquider 600 évêques, 40 000 prêtres, 120 000 moines et moniales. Jusqu’aux années 60, sous Khrouchtchev, on détruira 75 000 lieux de culte.
12 02 1918
Fête franco-américaine au théâtre Graslin de Nantes : la Musique du 369° régiment d’infanterie de l’armée américaine entre en scène. Elle s’est déjà donnée à Aix-les-Bains avant d’aller combattre sur le Rhin, où elle a reçu la croix de guerre et son surnom d’Harlem Hellfighters. Lorsque les États-Unis étaient entré en guerre, le colonel Edwards, commandant le régiment avait demandé à James Reese Europe, chef d’orchestre de mettre sur pied le foutu meilleur orchestre de l’armée américaine.
Qu’on ne s’imagine pas que ces rag-times, malgré leurs origines, ne soient pas riches d’avenir. C’est de la musique de primitifs, ce sont des chansons de nègres, soit, mais tout un art savant est en train de sortir de ces chansons, de leurs rythmes syncopés si originaux que l’oreille qui les a perçus ne les oublie pas. Enrichie de nos harmonisations modernes, cette musique de nègre devient ultramoderne avec certains auteurs.
L’Ouest-Eclair, papa de Ouest-France
Comme quoi la condescendance raciste ne rend pas forcément aveugle.
3 03 1918
Le traité de Brest-Litovsk entérine la capitulation des Russes, qui renoncent ainsi aux territoires de la Pologne, de la Lituanie et de la Courlande, et doivent reconnaître l’indépendance de l’Ukraine et de la Finlande. L’Ukraine va s’empresser d’accueillir les troupes blanches hostiles aux Bolchéviques. Aubaine pour les Allemands qui pensent qu’en reportant sur le front ouest toutes les divisions jusqu’alors sur le front est, ils vont pouvoir enfoncer les lignes alliées : il s’en faudra de peu, mais l’arrivée des Américains finira par contenir les avances allemandes. Une paix à un tel prix soulève un tollé au sein de l’opposition aux bolcheviques : nombre d’officiers démobilisés se rallient à l’armée de volontaires formée en novembre 1917 par le général Kornilov. L’opposition entre blancs et rouges va diviser désormais le pays. Le traité va devenir caduc quelques mois plus tard, avec la défaite de l’Allemagne. Par une nuit sans lune, le gouvernement quitte Petrograd pour s’installer à Moscou. Les bolcheviques contrôlent alors le nord et le centre du pays jusqu’à la moyenne Volga, plus quelques grandes villes importantes du sud, Bakou, Tachkent. L’Ukraine indépendante accepte la protection de l’armée allemande, la Géorgie est aux mains des Mencheviks. Les Cosaques du Don et du Koulan se soulèvent. La Sibérie occidentale passe aux mains de la légion tchèque, créée en 1917, formée de 15 à 20 000 bons soldats, bien armés qui, se sentant plus slaves que sujets de l’empire austro-hongrois, avaient déserté dès le début de la guerre pour se battre aux cotés des Russes. Leurs rangs s’étaient grossis ensuite de prisonniers libérés sur ordre de Trotski, de sympathisants divers et très variés, jusqu’à former, une armée indépendante forte de 65 000 hommes. La guerre terminée, ils ne pouvaient envisager de regagner directement leur pays sur la route duquel se trouvaient les Allemands, et ils avaient donc décidé de gagner à l’est Vladivostok et de là un embarquement pour l’Europe. Mais le traité de Brest-Litosk amena Trotski à leur demander de déposer les armes, ce qu’ils perçurent comme un piège : aussi la légion tchèque de Tchéliabinsk se révolta fin mai 1918 et redirigea ses trains vers la Russie : arrivée à Samara, sur la Volga, elle apporta aux socialistes révolutionnaires toute la région de la Volga, Kazan inclue : le Komuch [ou gouvernement de Samara] est le gouvernement que les socialistes révolutionnaires instaureront en juin 1918 contre les bolcheviks, justifiant son existence sur le résultat des élections de l’assemblée constituante en janvier 1918.
De plus Français et Britanniques arrivent à Mourmansk, Arkhangelsk et Odessa pour contrer les ambitions allemandes sur les matières premières.
L’usage de plus en plus fréquent du char va casser la logique de la guerre de tranchées : ne craignant pas le balayage, jusqu’alors meurtrier, des mitrailleuses installées dans les trous d’obus, ils permettent le déplacement du front.
S’il est indispensable de noter l’apport du progrès technique dans la stratégie de la guerre, il ne faut pas perdre de vue pour autant la réalité qu’a transformé cette nouveauté : et la réalité d’avant le char, c’est le cheval ; il y eut bien sur la cavalerie, rapidement marginalisée par la guerre des tranchées, mais les chevaux, eux, gardèrent du service : au mois d’août 1914, ce sont pas moins de 730 000 chevaux qui sont mobilisés, principalement affectés au ravitaillement et à la traction du matériel d’artillerie, et les réquisitions dureront tout au long de la guerre. En 1915, les Américains en amèneront 500 000, l’Argentine, 70 000. Les chevaux américains, très souvent étaient sauvages : l’armée française les avait payés : elle s’en aperçut trop tard quand elle découvrit que ce n’était pas un cadeau : On amenait dans le manège de Saint Nazaire des chevaux qui n’avaient jamais été montés, qui sortaient d’une traversée de l’Atlantique de plusieurs semaines ; deux ou trois gars tenaient la bride, un quatrième sautait en selle, on lâchait tout, fallait qu’il se démerde. […] Des anciens revenus du front qu’on mettait au dressage disaient : c’est pire que la guerre.
Grenadou, Prévost Grenadou, paysan français. Seuil 1966
On avance le chiffre de 1 140 000 chevaux morts pendant cette guerre, pour le seul camp des Alliés.
4 03 1918
Premier signalement d’un mort dû à une grippe que l’on qualifiera plus tard d’espagnole : c’est dans le camp militaire de Funston, dans le Kansas. Peu de temps auparavant, un bataillon américain était revenu de la région de Canton, en Chine, où aurait sévi début 1918, une épidémie de grippe bénigne, mais très contagieuse. Trois mois plus tard, le variant fera des ravages en Afrique, tuant plus de 2.5 millions de personnes en moins d’un an.
14 03 1918
Le traité de Brest-Litovsk a été une défaite pour la Russie, mais aussi pour Trotski personnellement puisque dans la ligne de ses opposants. Lénine en voit son prestige renforcé, et Trotski ne peut plus être en charge des affaires étrangères : il est nommé commissaire du peuple aux affaires militaires, où il va donner le meilleur de lui-même et retrouver toute sa popularité.
15 03 1918
Marie Juliette Olga Boulanger, dite Lili Boulanger, meurt d’une tuberculose intestinale à 24 ans. Cinq ans plus tôt, elle avait eu le grand prix de Rome de composition musicale pour sa cantate Faust et Hélène. Sa sœur aînée Nadia, 31 ans, elle aussi compositrice avait décidé de se consacrer entièrement au développement de la carrière de sa sœur : ma musique n’était pas assez mauvaise pour être drôle, ni assez bonne pour être belle. Elle était bien faite […] c’était son principal défaut.
Filles d’Ernest Boulanger, compositeur et professeur de chant et de Raïssa Ivanovna Mychetsky (ou Mychetskaya), princesse et cantatrice russe, originaire de Saint Petersbourg. La mort de sa sœur oriente sa vie vers le professorat : elle n’en sortira plus : Conservatoire National de Musique, École Normale de Musique fondée par Alfred Cortot en 1920, Conservatoire américain de Fontainebleau, Harvard, Peabody Conservatory de Baltimore, Juilliard School of New York… Elle aura pour élèves Aaron Copland, Michael Levinas, Elliot Carter, Daniel Barenboim, Pierre Boulez, Betsy Jolas, Iannis Xenakis, Pierre Henry, Philippe Glass, Tristan Murail, George Benjamin, Michel Legrand : tous diront ce que leur a apporté leur passage à la boulangerie. L’Argentin Astor Piazzola raconte : Un jour, Nadia Boulanger me dit enfin que tout ce que je lui avais montré était bien écrit, mais qu’elle n’en voyait pas l’esprit. Deux jours plus tard, je lui avouais mon passé de tanguero. Mademoiselle me demanda alors de jouer un de mes tangos. Je choisis Triunfal. Je crois que je ne suis pas arrivé à la moitié. Nadia m’arrêta, me prit les mains, et avec son doux accent anglais, me dit : Astor, cela est beau, j’aime beaucoup, voilà le vrai Piazzola, ne l’abandonnez jamais.
23 03 1918
Depuis le Mont de Joie, dans la forêt de La Ferté Saint Gobain, dans l’Aisne, à 140 km de Paris, scellé dans du béton armé, les trois canons à longue portée Long Max [2], encore nommés Gotha, – calibre de 420 mm, 5 m de longueur de tube, 9 300 m de portée – tirent sur Paris. Et le 29 mars vers 16 h 30, c’est l’église St Gervais, où l’on célèbre l’Office des Ténèbres du Vendredi Saint, qui est touchée de plein fouet : on comptera 88 morts. L’indignation fût énorme, la haine du Boche atteint son point culminant et hâta la préparation des armées américaines. Plus de 100 000 parisiens fuiront. En 4 mois et demi, 367 tirs touchèrent la capitale, mais pour la plupart, à 1, 1,5 km de la cible, tout simplement parce que les artilleurs allemands ne tenaient pas compte de la force de Coriolis qui infléchit les trajectoires.



Il aura fallu attendre d’être à deux pas de la défaite pour que les Alliés parviennent à vaincre toutes leurs réticences à nommer un seul et unique décideur des opérations : Clemenceau, le Père de la Victoire, impose le général Foch comme commandant en chef, qui lâchera, expérience faite : Depuis que je sais ce qu’est une coalition, j’ai beaucoup moins d’estime pour Napoléon. Mais l’homme avait le talent pour que ces difficultés à se mettre d’accord autour d’un table ne deviennent pas insurmontables : il placera les relations interalliées au cœur de sa stratégie et fera preuve d’énormément de tact à l’égard des Britanniques et des Américains.
D’une certaine façon, on peut dire que Foch revenait de loin : il n’avait jusqu’alors pas brillé par ses exploits, ce serait même plutôt le contraire : responsable de la mort de 5 000 hommes dans les premiers jours de la guerre pour avoir joué perso sans attendre les ordres, il avait fait d’autres bêtises lors de la bataille de la Somme à l’issu de laquelle, en décembre 1916, il avait été destitué du commandement du Groupe d’armées du Nord (Gan) et était tombé en discrédit, d’où le sortit Clémenceau le 26 mars 1918. La personnalité folle de Ferdinand Foch s’imposait, comme l’expliqua Clemenceau une fois le conflit terminé : Je me suis dit : essayons Foch ! Au moins, nous mourrons le fusil à la main ! J’ai laissé cet homme sensé, plein de raison qu’était Pétain ; j’ai adopté ce fou qu’était Foch. C’est le fou qui nous a tirés de là !
Chez les Allemands, la mise en service du code ADFGVX, avait beaucoup contribué à leur succès : les Alliés n’auront de cesse de le casser.
printemps 1918
Les Anglais ont aussi leur arrière : Londres. Paul Morand, insatiable gourmand de découverte, plume indémodable, corseté dans une volonté crispée d’Apartheid qui sent le grenier, – le métissage, voilà l’ennemi – indécrottable aristocrate tout imbibé de couardise, le connaît bien qui, toute sa vie, aura préféré l’arrière au front :
En 1916, Londres change d’aspect : il est devenu entièrement kaki, y compris le brouillard. Il faut l’avoir vu alors, pour comprendre ce que peut signifier le mot obscurité ; tous les réverbères sont en deuil, tous les globes voltaïques ont été peints au goudron et les vitrages des usines en bleu. Cela surpasse les deux espèces ordinaires de brouillard londonien, le brouillard blanc et le brouillard purée de pois : c’est une couverture étouffante, épaisse comme un feutre.
Peu à peu, la grande épidémie continentale se rapproche, enserre l’Angleterre. On fait la guerre même le dimanche ! Les journaux publient chaque matin d’interminables listes de blessés, de morts, de disparus. Des files d’ambulances attendent à la gare Victoria l’arrivée des trains continentaux. Tout le monde est de service, jusqu’aux boys scouts et aux jeunes filles des pensions suburbaines. Enfin voici la conscription, pour toute l’Angleterre, sinon pour l’Irlande.
Pendant les mauvais jours de la fin 1917 et du printemps 1918, après la prise d’Armentières et de Soissons, l’enfoncement de la 5° armée britannique du général Gough qui provoque le front unique et la nomination de Foch, la guerre industrielle s’organise, malgré l’opposition des syndicats ouvriers, que M. Lloyd George doit persuader et conquérir un à un. C’est l’heure la plus dangereuse, à Londres comme à Paris. Blasé sur les horreurs de la guerre, l’arrière s’est ressaisi et veut vivre pour soi : nouveaux riches, ouvriers gâtés par les hauts salaires, embusqués et profiteurs, espions de tous genres, microphones dans les grands hôtels ; princesses russes en fuite, aventuriers internationaux, coureurs de dot autour des veuves de guerre, marchands de munitions américains au Ritz, envoyant des orchidées et prenant des commandes. Les clubs de nuit font fortune. Ils n’ont d’ailleurs pratiquement jamais fermé, tant les Anglais considèrent que le danger n’empêche pas de se divertir et qu’on a aussi bien le droit de danser que de se faire tuer. Noël 1914, vit le bal de Christmas au Carlton ; en 1915, aux théâtres les blessés sont invités en foule : centaines de bras à éclisses posés sur le rebord en velours des loges ; béquillards plein des dancings ; Murray’s, Ciro’s ne chôment guère ; gourdes de whisky dans les poches, jeunes lieutenants et vieux généraux s’essayant à un nouveau pas nommé fox-trot, au son des premiers jazz, avant de retourner au travail, le lundi matin, dans leurs tranchées flamandes.
Dans les théâtres, les revues, style parisien, où se spécialisent les acteurs français, font salle pleine. En l’absence de nos cuisiniers partis au front, les dînettes et luncheonnettes dans Soho, aux petites tables quadrillées des petits restaurants ridicules et faussement français qui s’intitulent : La Madelon, etc., sont servis par des Italiens qui s’enrichissent. Le centre des squares et des parcs est occupé par les baraques de bois de l’YMCA, où les permissionnaires jouent aux cartes. Les blessés et les mutilés en uniforme de toile bleue visitent Londres sur les impériales des autobus. Au Claridge, tous les dimanches soir, sous le patronage de la princesse Alice de Monaco, Isidore de Lara, de sa main puissante, dirige les vocalises d’un chœur de musiciens de toutes provenances. Premiers succès du cinéma américain, premiers films de Chaplin. Les commissions d’achat interalliées groupent dans Kingsway des intermédiaires, des banquiers en mission et des sursitaires, auprès des grandes maisons en deuil et de l’aristocratie décimée. Mais malgré quelques essais nationalistes isolés, tels que le pillage du quartier des bouchers juifs à noms allemands de Whitechapel, une opposition défaitiste et pacifique beaucoup moins sourde et moins timide qu’à Paris, se manifeste parmi l’intelligentzia, parmi les objecteurs de conscience, au café Royal ou dans Bloomsbory, tandis qu’au contraire, à notre consulat général, de périodiques conseils de révision viennent ratisser les derniers hommes valides, ne laissant à Londres que quelques auxiliaires grelottants et nus.
La nuit, lorsque approchent les zeppelins, dont la visite nous est annoncée par l’Amirauté, Londres s’entoure d’un cercle de feu. Dès les premiers coups de canon, nous montons sur le toit de l’ambassade pour voir les grands poissons au ventre d’argent, éclairés par mille projecteurs, passer dans un fracas de verres cassés et de maisons écroulées. Comme dans les vers londoniens de Verlaine :
Non vraiment, c’est trop un martyre sans espérance,
Non vraiment, cela finit trop mal, vraiment c’est triste,
Oh ! le feu du ciel sur cette ville de la Bible !…
Paul Morand Londres 1933
1 04 1918
Au Canada, 4 morts lors d’émeutes contre la conscription. Les Canadiens auront perdu 60 000 des leurs dans cette guerre.
21 04 1918
Manfred von Richtofen, 25 ans, dit le Baron rouge, – il avait commencé à peindre en rouge son Albatros, est abattu au-dessus de la Somme, par un tir venu du sol. Une balle dans la poitrine, il a le temps de poser son appareil à Vaux en Somme, secteur tenu par les Australiens, qui lui rendront des funérailles militaires. As des as allemand, il avait déjà 80 victoires à son actif, à bord de son Fokker.
D’avril à décembre 1918, l’Ukraine sera indépendante, dirigée par le général Skoropadski.
9 05 1918
René Fonck, pilote de chasse comme l’était Guynemer, au sein de l’escadrille 103, dite Groupe des Cigognes, abat 6 avions ennemis pour cette seule journée. Il en fera encore de même le 26 septembre. Une hygiène de vie qui tenait de l’ascèse jointe à des qualités de tireur d’élite, lui permettaient de monter plus haut que l’ennemi, puis de fondre sur lui, masqué par le soleil et d’abattre en priorité le pilote. Il terminera la guerre avec un palmarès de 75 victoires homologuées, en fait 127, qui feront de lui l’as des as. Le 21 septembre 1926, il tentera de traverser l’Atlantique, avec trois coéquipiers, aux commandes d’un bimoteur S 35, mais, trop chargé, pas assez puissant, l’avion s’écrasera au décollage, tuant 2 hommes. Son rôle auprès de Pétain pendant la deuxième guerre mondiale – oreille du maréchal auprès des Allemands, très opposé à Laval – , le déboulonnera du piédestal de la gloire.

L’avion est un Spad XIII de 1918

20 05 1918
En France, le sous-secrétariat à la Santé dénombre près de 15 000 soldats grippés, dont 6 ont décédé.
25 05 1918
La légion tchèque en poste sur la ligne du Transsibérien, ayant appris qu’elle allait être livrée par les Russes aux Allemands se soulève contre les soviets sur ordre du général Gaïda, de Novo-Nikolayévsk.
27 05 1918
Les Allemands sont à 75 km de Paris. Mais leur code va être brisé le 2 juin par le capitaine Georges Painvin, et les Alliés connaîtront désormais la programmation de leur mouvements, ce qui leur permettra de retourner la situation en leur faveur. Il y avait en France cinq services du chiffre, qui employaient des mathématiciens de haut niveau, pour casser les codes : deux au ministère de la guerre (un au grand quartier général (GQG), un au cabinet du ministre, un à la marine, un à l’intérieur et un aux affaires étrangères, qui n’avait pas d’existence officielle ; il s’appelait le service des travaux réservés ; ses archives ont été détruites avant l’arrivée des Allemands en mai 1940. Il avait à sa tête Robert Chodron de Courcel, le grand-père de Bernadette Chirac ! Téléphone, télégraphe, courrier, radio télégrammes : on écoutait et décryptait les Allemands, les Autrichiens, mais aussi les Alliés.
Abel Gance n’a pas trente ans. Poumons atteints, il a quitté une usine d’Aubervilliers où l’on fabrique des gaz toxiques. Au cœur d’un bataillon américain, il va tourner J’accuse, dans lequel on passe de la réalité du front aux scènes surréalistes qui font se lever les morts des champs d’horreur : Lorsque je découvris la mort de la plupart de mes amis, j’eus cette rage insensée d’utiliser ce nouveau medium, le cinéma, pour montrer au monde la stupidité de la guerre. Nous étions encore au milieu du conflit, et il était très difficile de faire un film pacifiste. Je me demandais quel sujet je pourrais choisir pour bien montrer la stupidité du conflit. Un jour, alors que je traversais le boulevard du Château, étant encore mobilisé, j’eus cette idée qu’il fallait que tous les morts reviennent, et dès lors, devenus incontournables, ils nous obligeraient à finir la guerre immédiatement.
28 05 1918
Proclamation d’indépendance de l’Arménie. Mais l’étoile montante de Mustafa Kemal, qui l’amènera au pouvoir en avril 1920 imposera les vues de la Turquie, à savoir le refus pur et simple des frontières définies par le Traité de Sèvres : défaits militairement par la Turquie, la République arménienne cessera d’exister le 2 décembre 1920. Ce que n’ont pas repris les Turcs passera sous la coupe de la Russie.
05 1918
Les Américains mettent en service à Gièvres, proche de Romorantin, à mi-chemin entre les ports de l’Atlantique et le front, une usine ultra-moderne frigorifique de conservation de la viande qui peut stocker jusqu’à 6 500 tonnes de viande. La ration journalière du soldat américain comprend 500 gr de viande ; ils sont 2 millions soit 1 000 tonnes par jour ! Les 600 employés de l’usine comprennent 260 ouvriers américains, venus là spécialement pour les postes principaux. Le bâtiment fait 12 000 m², peut contenir 18 000 carcasses de bœuf mais aussi du bœuf désossé pour gagner de la place dans les bateaux. Le procédé utilisé est celui de la réfrigération par l’ammoniac développé par Charles Tellier dans les années 1860, qui permet de fabriquer 500 tonnes de glace par jour. À la fin de la guerre, les Américains laisseront l’équipement sur place … que la France s’avérera incapable de reprendre à son compte et vendra pour de tout autres utilisation à la découpe.
12 07 1918
Alexandra David-Néel est au Monastère de Kum Bum. Tibet
J’ai envie de dire : ouf ! Me voici à Kum-bum ! Combien là-bas, au Japon, j’ai regardé de fois, sur la carte, ce nom inscrit en tout petits caractères à peine visible parmi l’ombre des montagnes. Cela semblait si loin de Pékin et l’est en réalité – entre 2 500 et 3 000 km. Je me demandais, ignorant l’état des routes, comment j’effectuerais le trajet et quels obstacles apporteraient, peut-être, à mon projet, les gens des pays à traverser. Mais voilà, une fois de plus, je constate que les difficultés des voyages sont, surtout, dans les écrits des voyageurs et dans les appréhensions précédant le départ. Une fois en route, tout se simplifie. On ne mange pas toujours bien, on ne dort pas toujours bien ; il faut parfois endurer la poussière ou la chaleur, ou la pluie, ou le froid ; les gîtes manquent de confort. Rien de tragique là-dedans. Et les kilomètres défilent, on laisse derrière soi des villes, des rivières, des montagnes et, après tout, on continue à marcher sur la terre et sur ses deux jambes… C’est bien facile. À Si-in, très aimablement, le prêtre belge (R.P. Schram) et les missionnaires protestants m’ont prêté des livres des voyageurs qui ont parcouru quelques parties du Tibet. Je m’émerveille des tartarinades de ces gens et de leur façon de voyager. D’abord, pas un n’entendait la langue du pays ; ensuite, ils s’embarquaient avec des douzaines de chameaux, des douzaines de chevaux, des douzaines de serviteurs, il fallait ravitailler tout cela et le pire, c’est que, sans discernement, ils emmenaient des chameaux habitués aux steppes mongoles parmi les glaciers des cols tibétains, et des musulmans dans le pays des lamas. Grand gâchis, on l’imagine, et c’est avec l’histoire de ce gâchis qu’ils ont composé leurs livres. Leur façon de se conduire avec les indigènes mérite une mention. Les uns se fournissaient de gibier en tirant dans les propriétés des monastères sur des animaux familiers, un autre, – je regrette qu’il soit français – ici, à Kum-Bum, se mit à graver son nom sur l’arbre sacré. Que penserait-il si un visiteur s’avisait d’inscrire son nom sur la place de son salon ? … Enfin, d’autres enlevaient de force les chevaux des nomades pour remplacer ceux de leur caravane qui étaient morts. Ce qui m’étonne, c’est la mansuétude des Naturels qui n’ont pas massacré ces intrus mal élevés.
Mais revenons à Kum-Bum. On m’y a donné une gentille habitation dépendant d’un des grands Temples du monastère, mais complètement isolée, c’est-à-dire que je puis fermer la porte de mon patio donnant sur la cour d’honneur du Temple. Les bâtiments à Kum-Bum sont de style chinois, généralement bien entretenus et d’aspect cossu. Ma demeure comprend un petit patio avec appartements de trois côtés et un mur orné de fresques chinoises sur le quatrième côté. Au rez-de-chaussée, il y a la chambre principale divisée en trois parties, celle du milieu, en face de la porte, étant flanquée de deux compartiments dont le plancher est surélevé d’environ quarante centimètres. En hiver, on allume du feu sous ces sortes d’estrade et l’on s’y assoit sur le plancher chaud, on y étend ses couvertures pour la nuit. C’est l’usage dans toute la Chine du Nord et de la Mongolie. Aphur occupe l’appartement du rez-de-chaussée qui doit aussi servir à recevoir les visiteurs. Les murs sont décorés de fresques représentant Tsong-Khapa [réformateur du bouddhisme tibétain et fondateur de la secte des Geloup-pas, généralement dénommés bonnets jaunes] et des déités diverses dans l’un des compartiments et, dans les autres, des scènes pittoresques de monastères perchés sur d’invraisemblables monts neigeux, au bord de lacs extraordinaires. Des cortèges royaux cavalcadent ces paysages, épiés par des Dieux trônant dans des nuages de pourpre. Je préfère qu’Aphur jouisse de ces œuvres d’art, elles m’empêcheraient de dormir. J’occupe le premier étage, où les pièces donnent sur un balcon courant autour du patio. Ma chambre est l’exacte reproduction de celle d’Aphur, moins les fresques. Mes boiseries sont uniformément peintes en jaune, l’encadrement des panneaux étant en rouge vif. J’ai atténué quelque peu l’effet violent des couleurs en étendant des nattes japonaises comme lambris et en couvrant le plancher du plus grand des compartiments qui, maintenant, avec sa petite table haute de 20 centimètres, son coussin pour s’accroupir devant et sa large fenêtre où le papier remplace les vitres, figure assez exactement une chambre japonaise… C’est loin le Japon… Y-suis-je jamais allé ? … Je me le demande parfois. Étrange pays, gens étranges, monde différent de tout, inscrutable, désorientant, irritant et qui serait pourtant intéressant à connaître si on pouvait l’étudier. Mais la première condition pour cela serait d’en savoir la langue. J’aurais pu, certainement, apprendre le japonais parlé, mais la langue littéraire me serait restée inconnue et, alors, que peut-on savoir d’un peuple, si l’on ne peut pas lire ses écrivains ? Avec le tibétain, c’est différent, je lirai bien tôt mieux que je ne parle. Je me demande si je vais trouver ici quelque lettré accueillant avec qui je vais pouvoir travailler. Je me trouve bien, le pays aux alentours est beau, les buts de promenade ne manquent pas, la vie est bon marché. Je voudrais faire halte ici, travailler, écrire car la plume me démange et j’ai un tas de sujets en tête.
Le silence qui règne parmi les temples est un délice après tant de temp passé parmi le bruit. Il y a à Kum-Bum, répartie entre les différents temples, une population évaluée à 3 800 lamas, mais un silence complet enveloppe tous ces bâtiments étagés sur le flanc de deux montagnes enserrant une étroite vallée. On n’entend que le bruit des longues trompettes tibétaines appelant aux exercices religieux et de lointaines harmonies de musique sacrée de la demeure du pontife de Kum-Bum, actuellement un gamin de dix ans. Les chefs de Kum-Bum sont comme les Dalaï-Lamas, les Tashis -Lamas, et beaucoup d’autres, ce que le vulgaire appelle des réincarnés (c’est là une fort mauvaise traduction de Toulkou […] en sanscrit nirmanakâya […] admire mon érudition ! ! ! – qui signifie corps de manifestation ou corps matériel qui manifeste les autres personnalités. – Je ne t’infligerai pas une publication de la théorie des trois corps ou trois Kâya). Donc, à la mort d’un de ces lamas, son successeur se trouve être un enfant, né peu après le décès du grand lama dont il s’agit. Cela t’explique le gosse qui est le chef de Kum-Bum. Pour l’instant du reste, il est sous la férule de ses précepteurs. Je ne l’ai pas encore vu mais lui rendrai visite dans quelques jours. Je suis arrivé au moment d’un des grandes fêtes annuelles ; demain et après-demain des lamas joueront, ou plutôt mimeront et danseront une sorte de drame religieux. Il y aura encore d’autres attractions et, déjà, des milliers de gens sont arrivé des environs pour prendre part à la fête.
Alexandra David-Néel. Journal de voyage. Paris Plon 1975

Monastère de Palcho

Dzong (forteresse) de Gyantse

Monastère de Kumbum Xining Qinghai

Kumbum
Gyantse Kumbum chorten
Quel est donc le charme redoutable de ce pays étrange où toujours sont retournés ceux qui l’avaient une première fois entrevu ? Pour retrouver ses montagnes et ses hommes, on repasse la mer, on traverse des royaumes entiers, toute la Chine, au pas lent des chameaux ou des mules.
On arrive alors dans des déserts glacés, si hauts qu’ils ne semblent plus appartenir à la terre, on escalade des montagnes affreuses, chaos d’abîmes noirs et de sommets blancs qui baignent dans le froid absolu du ciel. On y voit des maisons pareilles à des donjons massifs, toutes bourdonnantes de prières et qui sentent le beurre rance et l’encens. Ce pays est le Tibet, pays de pasteurs et de moines, interdit aux étrangers, isolé du monde et si voisin du ciel, que l’occupation naturelle de ses habitants est la prière
Jacques Bacot. Le Tibet révolté (1912) Paris, R. Chabaud, 1988
L’attitude xénophobe des Tibétains s’expliquait par deux peurs essentielles. La première était la conviction que les étrangers voulaient s’approprier l’or tibétain. La seconde, bien plus grave et savamment entretenue par les Chinois, était la menace qui pesait sur leur religion, que les Russes et les Anglais avaient pour ambition de détruire. Cela suffit à expliquer la crainte des Tibétains pour les missionnaires et leur ferme détermination à empêcher l’accès de Lhassa aux étrangers.
Michel Jan. Introduction à l’anthologie Le voyage en Asie centrale et au Tibet Bouquins Robert Laffont 1992
14 07 1918
Quentin Roosevelt, le fils cadet du président Théodore Roosevelt est tué en combat aérien à Chamery, près de Reims, à bord de son Nieuport 28, un avion français.


Le Nieuport 28.
17 07 1918
Assassinat de la famille impériale de Russie dans la villa Ipatiev à Ekaterinbourg, l’ancienne Sverdlovsk, dans l’Oural : le tzar Nicolas II, son épouse Alexandra Fedorovna, leurs quatre filles, leur fils et quatre autres proches. Ce sont les autorités locales qui ont pris la décision, dans la crainte des avancées militaires des Russes Blancs vers Ekaterinbourg. Ce sera du moins la version officielle, à laquelle toutes les parties avaient intérêt : les bolcheviks, parce que l’assassinat du seul tzar Nicolas II supposait des négociations avec les Allemands pour mettre en lieu sur l’impératrice et ses enfants, et les Russes Blancs parce qu’ils ne souhaitaient de toutes façons pas reprendre le pouvoir en y installant à nouveau les Romanov.
En fait, plusieurs personnes fort bien documentées, et parmi elles, l’historien français Marc Ferro soutiennent que l’impératrice et ses 5 enfants ont été épargnées. Anastasia aurait faussé compagnie à ses geôliers de Perm en septembre 1918, serait passée en Allemagne, puis aux États-Unis où elle aurait vécu sous le nom de Anna Anderson. L’impératrice et les quatre autres enfants auraient été évacués par les soviets. En 2012, Marie Stravlo, une Américaine de l’Oklahoma s’apprête à publier le Journal d’Olga, l’ainée des enfants, retrouvé dans la bibliothèque du Vatican.
Mais, le 29 juillet 2007, on retrouvera deux corps, à 60 mètres de la fosse principale, et l’ADN révélera leur appartenance à la famille Romanov : les corps étaient donc au complet ; le mystère était levé et toutes les spéculations, supputations sur l’existence d’un descendant direct des Romanov devenaient nulles et non avenues. Et tant pis pour ceux qui font leur miel de ce genre de drame.


Nicolas II de Russie, Alexandra Fiodorovna, Olga Nikolaïevna, l’aînée, Tatiana Nikolaïevna, 2°fille, Maria Nikolaïevna, 3°fille, Anastasia Nikolaïevna, 4° fille, Alexis Nikolaïevitch.

Grand Duchesses Olga and Tatiana Nikolaevna of Russia with their tutor, Pierre Gilliard, at Livadia, Crimée, in 1911 is from the Beinecke Library , Yale University
28 07 1918
La seconde bataille de la Marne voit le début de la retraite de l’armée allemande. En 1919, l’État souhaitera marquer la bataille dans la pierre, et c’est Pierre Landowski qui s’en chargera, sur la butte de Chalmont à Oulchy-le-Château, dans l’Aisne, où il sera inauguré en 1935.
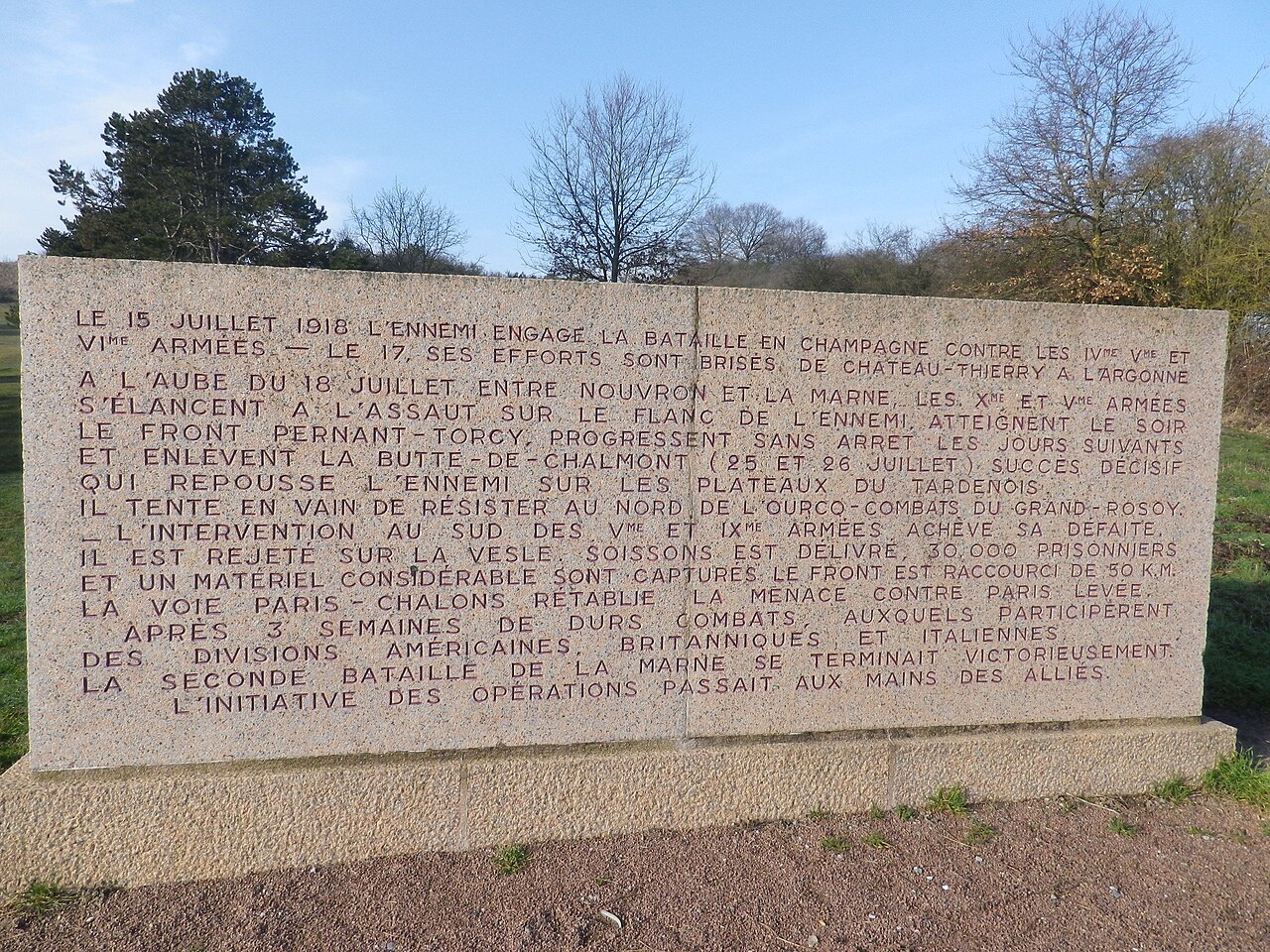

La France et, derrière elle, quatre marches – les quatre années de guerre – pour accéder au groupe des fantômes

Une jeune recrue, un sapeur, un mitrailleur, un grenadier, un soldat colonial, un fantassin, un aviateur et le spectre de la mort sortant de son linceul.
07 1918
Reprise dès septembre 1914 par les Français, Reims n’est plus qu’un tas de ruines, mais le commandement veut qu’à tout prix la Montagne de Reims reste française : ce sont les Tirailleurs Sénégalais qui feront le travail. En 1924, Daladier inaugurera un monument qui leur sera dédié : il sera abattu en 1940, par la Wehrmacht, sur ordre des Nazis, qui en feront des canons.
Qui dira le plaisir intense que l’on ressent en enfonçant sa baïonnette dans les génitoires de l’ennemi ? De sentir la lame les fouiller jusqu’à les faire exploser dans des gerbes de sang chaud qui s’éparpille sur votre figure. Et le Teuton, beuglant de douleur et d’incrédulité mêlées, qui s’effondre, s’agrippant absurdement à son casque à la pointe ô combien ridicule. Le Teuton qui éructe, qui s’époumone, qui vous maudit, qui appelle Dieu à son aide, qui gigote sur le sol couvert de neige boueuse. Et ses paroles scandées à l’orée de la mort de s’accrocher à vos oreilles qui n’en comprennent goutte, mais qui refusent de vous laisser tranquille, qui vous poursuivent le lendemain, le surlendemain et les jours d’après. Sa stupeur de voir surgir face à lui un Nègre, lui qui sans doute n’en avait jamais vu de toute sa vie, hormis dans les livres illustrés ou les journaux. Corps à corps dans les entrailles du corps blanc qui ne bouge plus. Le laboure jusqu’à en faire jaillir les intestins, le foie, les poumons, le cœur enfin. Éviscération démentielle qui teinte la neige d’écarlate, lequel vire vite au marron sale, puis à cette couleur hideuse qui n’a sans doute de dénomination dans aucune langue.
La baïonnette qui s’enfonce dans le corps blanc efface d’un seul trait des siècles d’agenouillement, d’humiliation. Le Teuton, qui vous fait face, à l’instant où vous jaillissez de votre tranchée parce que l’ordre de fondre sur l’ennemi vous a été donné, ce Teuton au visage juvénile, souvent imberbe, aux yeux d’une claireté si bouleversante d’innocence, voire de tendresse – allez savoir ! -, ce Teuton-là devient le Béké, le Blanc créole, devant lequel les vôtres et vous n’ont jamais pu que courber l’échine et balbutier oui, missié. Mais l’immense satisfaction qui vous étreint alors ne saurait être partagée, même par ceux qui tout comme vous l’éprouvent et cela au même instant, c’est-à-dire soldats d’Afrique et du Maghreb, car aussitôt la honte vous saisit, le sentiment plus exactement d’être descendu au niveau des bêtes les plus immondes. Ce sentiment-là, cette revanche prise à la venvole, elle demeure en chacun de vous, secrète et fiévreuse tout à la fois, et vos chefs, ces lieutenants ou capitaines natifs de Bourgogne, de Normandie ou de Provence, de vous couvrir d’éloges. Ah, le soldat des colonies est un vaillant homme ! Il monte à l’assaut de l’ennemi sans peur ni reproche. Il ne craint pas la mort, et on jurerait même que c’est elle qui tremble devant lui. Et si par extraordinaire vous réchappez à la boucherie, voici que l’on vous cite à l’Ordre de la Nation, qu’on vous décore, qu’on vous serre les mains, qu’on vous baille l’accolade et vous, gêné au plus profond de vous-même, de baisser la hauteur de votre regard, car vous savez que dans toute cette affaire, il n’a point été question de courage, mais de soif. Soif de venger vos arrière-grands-mères violées, impunément violées, et cela à un âge à peine nubile, par le maître de la plantation. Soif de rendre justice aux hommes de votre lignée dont vous ne connaîtrez jamais ni les visages ni les noms, ceux-là qui subirent ce fouet colonial dénommé rigoise et les chaînes aux pieds, le carcan au cou et l’humide cachot d’habitation. Mais une fois la baïonnette retirée, une fois la satisfaction savourée, voici qu’un malaise s’empare de vous et vous rend incapable d’entonner les chants de victoire de vos camarades métropolitains. Et eux de vous bousculer gentiment de l’épaule : Hé, Chocolat, pourquoi tu gardes la bouche fermée ? Bamboula, ta mémoire défaille ou quoi ? Allez, avale ce verre de vin et chante avec nous ! Qu’est-ce qui lui arrive ce soir, Blanchette, il songe à son île ensoleillée ou quoi ? Fais pas cette tête-là, mon gars ! Tu les reverras ton paradis et tes belles doudous à peau de caramel, ha-ha-ha !
Ils ne savent pas que ce plaisir qui s’est emparé de vous, à l’inverse du leur, vous intranquillise. Ni que leur ennemi, le Teuton, n’est pas vraiment le vôtre, n’a jamais été le vôtre en fait. Qu’au moment même où vous avez enfoncé la baïonnette dans les génitoires de celui qui vous a fait face, ce n’était ni sa nationalité, ni sa religion, ni sa langue que vous aviez cherché à détruire, mais son être même. Sa race. Ou, plus exactement, sa couleur. Oui, voilà : vous avez combattu la blancheur et non le Teuton. Cette blancheur qui, pour une fois, se trouvait à votre portée, que vous pouviez atteindre. Cette blancheur sur laquelle vous étiez dûment autorisé à porter la main. Autorisation donnée par d’autres Blancs !
Revenu au pays auréolé de gloire, même s’il vous manque parfois un bras ou les deux jambes, même si vos poumons sont à moitié détruits pour avoir respiré l’horrible gaz moutarde, vous vous employez à donner le change. À jouer au vaillant soldat, au héros qui a payé l’impôt du sang à la mère patrie au nom de tous les Martiniquais. Vous acceptez pluie de médailles et avalasses de discours pompeux, défilés patriotiques et embrassades de la populace. Mais une manière de souffrance vous habite que vous êtes seul à connaître, souffrance teintée du dégoût de soi et que vous tentez de noyer dans le rhum-coco-merlo, le plus raide de tous, sans pourtant nourrir la moindre envie de récupérer votre état d’esprit d’avant. D’avant-guerre. Quand la seule vue d’un homme blanc vous imposait immédiatement retenue, humilité, servilité même et parfois terreur.
Cette guerre barbare a comme rétabli votre humanité en vous plaçant désormais à exacte hauteur de l’homme blanc. Voici ce qui ne saurait se proclamer en place publique ! Tout cela qui peut demeurer longtemps obscur en vous, pour vous. Alors, vous laissez dire que vous avez mis tout votre courage, toute votre âme, au service de la patrie…
Raphaël Confiant. Le Bataillon créole. Mercure de France 2013
8 08 1918
La grande offensive des Alliés qui commence par la bataille d’Amiens marque le tournant de la guerre : les Allemands ne connaîtront plus de succès : le jour de deuil de l’armée allemande dira le général Ludendorff. Une campagne de saccage délibéré accompagne le retrait des troupes allemandes :
Ce qui nous retarde, ce sont les routes coupées, les ponts sautés, les arbres couchés sur tous les chemins.
Un soldat français.
J’ai remarqué sur notre passage la mutilation d’arbres fruitiers coupés pour le seul plaisir de détruire.
Un soldat de la 61°DI.
Personne à Sedan ne veut partir, nous périrons dans nos ruines plutôt que d’expirer sur les routes. L’évacuation, c’est la pire des guerres pour les civils, quittant leur abri, se traînant lamentablement sur des routes boueuses, attendant par une pluie battante l’écoulement des convois, sans toit, sans nourriture, ballottés de ville en ville, ils meurent littéralement de faim, les hommes sont séparés des femmes, les femmes sont séparées des enfants et des malades. Cette apothéose d’inhumanité qui consiste à faire périr des civils en plus grand nombre et par des raffinements inouïs est très cultivée par la Kultur allemande.
Yves Congar, [le futur théologien]. Journal de la guerre. Le Cerf 1997.
Il m’est signalé que les Allemands incendient méthodiquement le mobilier qu’ils n’ont pu emporter : les incendies sont allumés à l’aide de copeaux remplis de goudron.[…] Une passion effrénée de la dévastation est érigée en moyen de lutte.
Maréchal Foch. Note du 6 septembre
Ailleurs, des matelas sont éventrés, des lits souillés d’excréments… Un rapport de l’armée allemande reconnaîtra cet état de fait : même les mesures draconiennes, l’intervention impitoyable des supérieurs et des organes de police échouent face à une troupe qui, après une campagne pleine de privations et la longue guerre de positions, peut enfin vigoureusement avancer, qui, en raison de l’instruction superficielle dispensée en temps de guerre, n’est plus suffisamment disciplinée et qui, dans le butin et malheureusement dans les destructions désordonnées, cherche sa satisfaction.
*****
On ne peut plus espérer briser la volonté de nos ennemis par des actions offensives
Général Ludendorff
11 08 1918
Georges Félix Madon, 26 ans, abat son 40° avion allemand – en victoire homologuée -. Pour les 64 victoires probables, il riait en disant : le Boche connaît ses pertes. Il finira la guerre vivant, avec une victoire de plus. L’armée de l’air ne sera pas avare de compliments : Madon Georges Félix, lieutenant à titre temporaire (active) du Génie, pilote aviateur, officier d’élite, pilote de chasse d’une indomptable énergie, d’une bravoure héroïque et d’une suprême habileté. Toujours vainqueur au cours d’innombrables combats engagés sans souci du nombre des adversaires, ni de l’éloignement de nos lignes, jamais atteint, même d’une seule balle, grâce à la rapidité foudroyante de ses attaques, à la précision de ses manœuvres, à l’infaillibilité de son tir, meurtri parfois dans des chutes terribles, entraîne inlassablement, par son splendide exemple, l’escadrille qu’il commande et qu’il illustre chaque jour par de nouveaux exploits. Le 11 août 1918, il abat son 40° avion ennemi. Une blessure. Chevalier de la Légion d’Honneur pour faits de guerre. Dix-neuf citations.

Il se tuera le 11 novembre 1924 à l’occasion d’un vol pour la célébration de l’Armistice et l’inauguration d’une statue en l’honneur de Roland Garros, à Bizerte. En fait, il écrasera volontairement son avion, tombé en panne sèche, sur le toit d’un immeuble, afin d’éviter la foule. Il était âgé de 32 ans.

18 08 1918
En Sibérie, les légionnaires tchèques prennent Kazan et mettent la main sur le trésor de la banque impériale russe, 651 millions de roubles-or. Ils remettent ce trésor – 8 wagons d’or -, à l’amiral Koltchak, nouveau titulaire du pouvoir blanc. La légende voudra que ces 8 wagons d’or aient été s’abîmer dans le lac Baïkal lors d’un déraillement, mais il est bien probable que les fabricants de la légende aient été les bénéficiaires du gâteau, car aucun sous-marin ne retrouvera trace de ces huit wagons d’or reposant sur le fond du lac Baïkal. Huit wagons, ce n’est certes pas le Titanic, mais ça prend tout de même un peu de place.
En face, les Rouges, avec Trotski à la tête des armées, ne restaient pas les bras croisés : Trotski s’était doté d’une arme personnelle redoutable que personne jusque-là n’avait seulement osé rêver et qui lui permettait de mener grand train – qu’on en juge – :
Le commissaire du peuple aux affaires militaires voyageait à bord d’un train que l’on appela la train de Trotski. Il harcelait son état-major pour qu’il le maintienne en bon état de marche et le houspillait quand tout n’était pas conforme à ses désirs. La plupart des gens s’imaginaient que ce n’était qu’une locomotive suivie d’un train de wagons, mais en réalité Trotski disposait de quatre locomotrices et de deux trains de plusieurs wagons équipés spécialement pour lui d’un lit, d’un bureau, d’un fauteuil et d’un divan. Ses secrétaires particuliers et les domestiques avaient leur propre espace et l’équipement de la cuisine était correct. Le wagon-restaurant servait de club à tous les officiers d’état-major mobiles. Dans l’une des voitures se trouvait une presse à imprimer. Trotski y déversait le texte de ses discours qui en sortaient en un flot régulier d’articles. Sa section presse, officiellement connue comme la campagne de presse du président du Conseil militaire révolutionnaire de l’armée et de la marine de la République (RVSR), distribuait les prospectus et journaux de son équipe à chacune des gares étapes. Si le train s’arrêtait dans une ville, ou dans un petit village, Trotski prononçait un discours. En même temps que les informations sur l’administration des soviets pénétraient au cœur du pays, la population entendait donc parler de Lénine et de Trotski. Alors que Lénine s’adressait exclusivement au peuple moscovite et pétersbourgeois, Trotski était le porte-voix du bolchevisme en des centaines d’endroits de la Russie européenne et de l’Ukraine. Les ouvriers et paysans venus l’écouter étaient souvent sous le charme et il y avait toujours une foule curieuse d’apercevoir ce grand homme.
A la fin de 1918, un état-major complet voyageait à bord du train. Il était composé de :
- Cinq secrétaires particuliers
- Quatorze membres de l’équipe technique (photographe, peintre, graveur et trésorier notamment)
- Quatre employés de bureau du commandant du train
- Quarante et une personnes au service des communications
- Douze attachés au département finances
- Cinq chefs d’état-major
- Deux dessinateurs
- Dix-sept assistants à la composition
- Douze gardes du corps attachés à la personne de Trotski
- Trente-cinq membres de la fanfare
- Six cavaliers du 1er détachement du ravitaillement de Moscou
- Trente hommes du 2e régiment de fusiliers lettons
- Quinze hommes du 9e régiment de fusiliers lettons
- Trente-neuf artilleurs du 3e régiment des missions spéciales
- Trente-deux hommes du régiment d’infanterie Simonovski-Rogojski
- Onze unités de véhicules blindés
- Quatorze employés du wagon-restaurant
- Vingt-trois chauffeurs
- Seize mécaniciens
- Huit employés chargés du graissage
- Trente-huit gardes
Il ne s’agissait pas d’un simple moyen de transport pour un commissaire du peuple, mais de toute une organisation politico-militaire.
Robert Service. Trotski. Perrin 2009
Trotski a toujours pensé qu’il suffisait d’avoir raison et en cela même il eut tort. Il croyait que l’exemple suffirait, l’action, le courage physique, la probité, la raison. Il est un héros de l’Antiquité, un homme de Plutarque. Et dès la victoire de la révolution à Petrograd, à Moscou, plutôt que de demeurer dans les lieux du pouvoir il repart. Il fait assembler le train blindé, parcourt les fronts, le limes rouge, bouscule les Blancs et leurs détachements de Cosaques. Le train du Conseil révolutionnaire de la Guerre semble être partout à la fois. Il jaillit de la neige et du brouillard et galvanise les troupes débandées. Des dizaines de milliers de kilomètres parcourus tout au long de la guerre civile. Trotsky inspecte les campements, apporte des armes et des commandos capables de prêter main-forte. Le train est si lourd qu’il est tracté par deux grandes locomotives noires à l’étoile rouge dont l’une est toujours sous pression et prête au départ. Les yeux fermés, comme s’il marchait le long des rails, il remonte un à un les wagons du train blindé dans lequel il a passé plus de deux ans de sa vie, dans le rêve d’une société utopique en marche, un monde d’autarcie, d’ordre et de raison, parfaitement huilé. On voit grandir à l’horizon l’étoile rouge et derrière elle la locomotive noire qui approche.
Dans les wagons une imprimerie pour le Journal du train, une station télégraphique, une radio et une antenne qu’on déploie aux arrêts pour prendre les nouvelles de la planète, un wagon de vivres et de vêtements, du cuir pour coudre des bottes, du matériel de génie et des réserves de traverses pour réparer les voies sabotées, des groupes électrogènes, un wagon-hôpital, un wagon de bains-douches, deux wagons de mitrailleuses, un wagon-citerne de carburant et un tribunal révolutionnaire, des wagons-garages capables d’emporter des camionnettes et des automobiles. Au milieu du train qu’il parcourt de mémoire, le réduit du commissaire du peuple est un bureau-bibliothèque, flanqué d’un cabinet de toilette et d’un divan. La table de travail occupe tout un côté, surmontée d’une grande carte de la Russie. De l’autre côté les rayonnages, les encyclopédies, les livres classés par auteurs et par langues. Alfred Rosmer, qui vécut plusieurs semaines à bord du train, y feuillette une traduction française de l’œuvre philosophique d’Antonio Labriola, y trouve le Mallarmé de Vers et Prose à couverture bleue, de la Librairie académique Perrin.
Lorsqu’il descend sur le ballast, Trotsky porte un long manteau de cuir noir et une casquette à l’étoile rouge. Les deux cents hommes de la troupe d’élite du train blindé portent des vestes de cuir noir, un bonnet conique et au bras l’étoile rouge. Comme tout Russe lettré, dès qu’il voit des rails, Trotsky ne peut s’empêcher de retrouver Tolstoï et son Anna Karénine, de se souvenir qu’avec délices Anna Arka-diévna respirait à pleins poumons l’air froid plein de neige et, se tenant près du wagon, regardait le quai et la station illuminée. Mais c’est la guerre. Il lui faut bien quitter son wagon-bibliothèque, monter sur les talus le long de la voie, haranguer les combattants et les enflammer, distribuer le Journal du train, rassembler les déserteurs et les collaborateurs de la Légion tchèque et en fusiller quelques-uns. Sur les rives de la Volga, Trotsky rejoint les forces de la Flotte rouge, embarque sur le torpilleur de Fédor Raskolnikov. À bord se trouve Larissa Reisner. Ils vont s’emparer de Kazan.
Patrick Deville. Viva. Le Seuil 2014
24 08 1918
Fort d’un accord militaire avec le Conseil National Tchécoslovaque, le maréchal Foch nomme le général Maurice Janin commandant en chef des forces alliées en Russie avec mission d’embarquer vers l’Europe les troupes tchèques, présentes sur le territoire russe. Le général Janin, bon connaisseur de la Russie, était déjà chef de la mission militaire en Russie depuis 1916, forte de 205 officiers et 900 soldats. Pour ce faire, il leur faut rejoindre la Sibérie où se trouvent les Tchèques.
28 08 1918
Les Rouges prennent Sviajsk à la légion tchèque et au Komuch.
30 08 1918
Devant l’usine Mikelson de Moscou, Fanny Kaplan tire trois fois sur Lénine : deux balles l’atteignent, au cou et au poumon, que les chirurgiens renoncent à extraire. Sa santé va être considérablement affaiblie. Fanny Kaplan est membre du parti socialiste révolutionnaire. Elle déclarera : Je m’appelle Fanny Kaplan. J’ai tiré sur Lénine aujourd’hui. Je l’ai fait volontairement. Je ne dirai pas d’où provient le revolver. J’étais résolue à tuer Lénine depuis longtemps. Je le considère comme un traître à la Révolution. J’ai été exilée à Akatui pour avoir participé à la tentative d’assassinat du tsar à Kiev. J’ai passé là-bas sept ans à travailler dur. J’ai été libérée après la Révolution. J’étais en faveur de l’assemblée constituante et je le suis toujours… et, juste avant d’être exécutée sans jugement le 3 septembre 1918, j‘ai tiré sur Lénine parce que je le considère comme un traître au socialisme et parce que son existence discrédite le socialisme. Je suis sans réserve pour le gouvernement de Samara [ou Komuch] et pour la lutte contre l’Allemagne aux côtés des Alliés.
Lénine ne peut assumer ses responsabilités et c’est Sverdlov qui prend provisoirement la tête du gouvernement soviétique. Des milliers d’hommes et de femmes des classes moyennes et supérieures vont être arrêtées par la Tchéka, certaines fusillées sur le champ, d’autres gardées en otage, au cas où d’autres complots seraient découverts.
10 09 1918
Les Rouges reprennent Kazan à la légion tchèque.
Lorsque deux camarades qui ont travaillé ensemble en 1918, et combattu sous Kazan contre les Tchécoslovaques puis dans l’Oural ou à Samara et Tsaritsyne, se retrouvent après des années, cela ne manque jamais : l’un d’eux demande, après les premières questions, Tu te souviens de Sviajsk ? Et ils se donnent une nouvelle poignée de main.
Sviajsk ? C’est aujourd’hui une légende, l’une de ces légendes révolutionnaires que personne n’a encore écrites mais que l’on se raconte déjà d’un bout à l’autre de l’immensité russe. Aucun ancien soldat de l’Armée rouge, aucun d’entre les fondateurs de l’Armée ouvrière et paysanne n’oublie Sviajsk lorsqu’il rentre chez lui une fois démobilisé et qu’il se remémore les trois années de la Guerre civile : Sviajsk, (sur la Volga, un peu à l’ouest de Kazan, elle-même à l’est de Moscou. ndlr), c’est le carrefour où se mit à déferler pour la première fois le flot de l’offensive révolutionnaire dans les quatre directions. À l’est : vers l’Oural. Au sud : vers les rives de la mer Caspienne, le Caucase et les confins de la Perse. Au nord : vers Arkhangelsk et la Pologne. Pas d’un seul coup, bien sûr, pas en même temps. Mais ce n’est qu’après Sviajsk et Kazan que l’Armée rouge a pris corps sous la forme militaire et politique qui, au fil des changements et des perfectionnements, est devenue classique dans la RSFSR [République socialiste fédérative soviétique de Russie].
Le 6 août [1918] de nombreux régiments organisés à la hâte s’enfuirent de Kazan ; les meilleurs de ces soldats, ceux qui avaient la conscience de classe la plus élevée, s’accrochèrent à Sviajsk et décidèrent d’y rester et de combattre. Alors que les hordes de déserteurs fuyant Kazan atteignaient presque Nijni-Novgorod, les Tchécoslovaques étaient déjà arrêtés au barrage érigé à Sviajsk ; et leur général, qui avait essayé de prendre d’assaut le pont de chemin de fer enjambant la Volga, était tué pendant l’attaque nocturne. L’offensive tchécoslovaque était ainsi décapitée dès la première confrontation entre les blancs – qui venaient pourtant de prendre Kazan et avaient donc un moral et un matériel supérieurs – et le noyau de l’Armée rouge qui cherchait à défendre sa tête de pont de l’autre côté de la Volga. Les blancs perdaient avec le général Blagotitch leur chef le plus populaire et le plus capable. Ni les blancs, grisés par leur récente victoire, ni les rouges qui se rassemblaient autour de Sviajsk, n’avaient la moindre idée de l’importance historique qu’allaient prendre leurs premiers accrochages sur la Volga.
Il est très difficile de donner une idée de l’importance militaire de Sviajsk sans disposer des éléments indispensables, sans avoir une carte devant soi, sans le témoignage des camarades qui appartenaient alors à la Cinquième Armée. Il y a beaucoup de choses que j’ai déjà oubliées ; les visages et les noms s’embrument avec le temps. Mais il y a une chose que personne n’oubliera jamais : le sentiment de la responsabilité suprême que nous avions de tenir Sviajsk. C’est ce qui liait entre eux tous ses défenseurs : tant les membres du Comité militaire révolutionnaire que les simples soldats de l’Armée rouge qui avaient désespérément cherché leur régiment disparu quelque part et qui avaient fait brusquement volte-face, vers Kazan, pour combattre jusqu’au bout avec leur vieux fusil, le cœur empli d’une détermination farouche. Tout le monde comprenait ainsi la situation : toute retraite ouvrirait à l’ennemi la voie de la Volga jusqu’à Nijni-Novgorod et donc la route de Moscou.
Reculer encore aurait été le début de la fin : une condamnation à mort pour la République des soviets.
J’ignore dans quelle mesure c’était vrai d’un point de vue stratégique. Peut-être que, même si l’Armée rouge avait été repoussée plus loin, elle aurait pu encore se ressaisir comme à Sviajsk, se ressouder sur l’un de ces innombrables points sur la carte, et que de là elle aurait pu mener son drapeau à la victoire. Mais c’était indubitablement vrai du point de vue du moral. Et, dans la mesure où une retraite au-delà de la Volga aurait conduit à l’époque à un effondrement complet, la possibilité de tenir bon, avec le pont dans notre dos, nous emplissait d’un véritable espoir.
Pour l’éthique révolutionnaire, la situation complexe se définissait en ces simples termes : la retraite, c’est avoir les Tchèques qui entrent à Nijni et Moscou. Mais si l’on tient Sviajsk et le pont, cela veut dire que l’Armée rouge reprendra Kazan.
C’est trois ou quatre jours après la chute de Kazan, je crois, que Trotsky arriva à Sviajsk. Son train s’immobilisa pour de bon dans la petite gare ; la locomotive haleta un peu puis fut détachée ; elle partit prendre de l’eau mais on ne la revit plus. Les wagons restèrent en rang, immobiles comme les chaumières crasseuses et les baraques qu’occupait l’état-major de la Cinquième Armée. Cette immobilité semblait vouloir dire qu’il n’y avait nulle part où aller depuis ici et qu’il n’était pas permis de partir.
Peu à peu, la conviction fantastique que cette petite gare allait devenir le point de départ d’une contre-offensive sur Kazan commença à prendre forme et devenir réalité.
Chaque jour supplémentaire tenu face à un ennemi tellement plus fort élevait le moral de cette pauvre petite gare perdue et la renforçait. De quelques villages reculés à l’arrière arrivèrent d’abord un par un quelques soldats, puis ce furent de petits détachements, et finalement de véritables unités en bien meilleur état.
Je la vois encore, cette gare de Sviajsk, où pas un soldat ne combattit sous la contrainte. Tous ceux qui vivaient là et se défendaient étaient unis par les liens les plus étroits de la discipline volontaire, d’une participation volontaire à une lutte qui paraissait si désespérée au début.
Ceux qui dormaient sur le plancher de la gare, dans la paille mêlée de débris de verre, ne craignaient rien, n’espérant presque plus le succès. Personne ne se demandait quand et comment cela finirait. Il n’y avait tout simplement pas de demain ; il n’y avait qu’un court instant chaud et enfumé : aujourd’hui. Et l’on vivait de cela comme on vit au temps de la moisson.
Le matin, le midi, le soir, la nuit : on vivait chaque heure jusqu’au bout ; il fallait vivre et profiter de chaque heure jusqu’à la dernière seconde. Il fallait moissonner chaque heure avec soin, comme on fauche à la racine les blés mûrs dans les champs. Chaque heure passée semblait si riche, si différente du reste de la vie. Chaque heure passée semblait un miracle. Et c’en était un.
Les avions venaient larguer leurs bombes sur la gare et les wagons puis repartaient : l’aboiement détestable des mitrailleuses et la voix calme des canons se rapprochaient et s’éloignaient ; un soldat, en capote déchirée, coiffé d’un chapeau de civil, les orteils dépassant de ses bottes trouées – autrement dit, un défenseur de Sviajsk – sortait en souriant sa montre de sa poche et se disait :
Alors c’est ça : il est minuit trente… ou quatre heures ou 6 heures 20… je suis encore vivant. Sviajsk tient. Le train de Trotsky est encore sur ses rails ; une lampe s’allume à la fenêtre du service politique. Bon. La journée est finie.
Les médicaments manquaient presque complètement, Dieu sait avec quoi et comment les médecins faisaient les bandages. On n’avait ni honte ni peur de cette misère. Les soldats passaient, pour aller chercher la soupe, devant les mourants et les blessés allongés sur leur civière. La mort ne faisait pas peur. On s’y attendait chaque jour, chaque heure. Être couché dans une capote humide avec une tache rouge sur la chemise, un visage sans expression, un mutisme qui n’a plus rien d’humain – c’est une chose qui allait de soi.
Fraternité ! Il y a peu de mots qu’on ait autant galvaudés au point qu’ils en sont affligeants ! Mais la fraternité existe parfois, dans des moments de détresse et de danger extrêmes ; elle est alors si généreuse, si sacrée, si unique dans toute une vie. Personne n’a vécu, personne ne connaît rien de la vie s’il n’a pas une nuit été allongé sur le sol, dans des habits déchirés et infestés de poux, et pensé que le monde est beau, qu’il est infiniment beau ! Qu’ici ce qu’il y a d’ancien a été renversé et que la vie se bat à mains nues pour établir irréfutablement sa vérité, pour les cygnes blancs de sa résurrection, pour quelque chose de bien plus grand et de meilleur que ce morceau de ciel étoilé qu’on voit par la fenêtre noire aux carreaux cassés : pour l’avenir de toute l’humanité.
Le contact se fait une fois tous les cent ans et il y a transfusion d’un sang nouveau. Ces paroles magnifiques, ces paroles presque surhumaines de beauté, et l’odeur de la sueur vivante, de la respiration vivante des autres qui dorment à votre côté sur le sol. Pas de cauchemars, pas de sentimentalités, mais demain à l’aube le camarade G., un bolchévik tchèque, préparera une omelette pour toute la bande ; et le chef d’état-major mettra une vieille chemise rêche et raide, lavée la veille. Le jour se lèvera et quelqu’un mourra en sachant au dernier instant que la mort n’est qu’une chose parmi d’autres, et que ce n’est pas la chose la plus importante du tout ; il mourra en sachant qu’encore une fois Sviajsk n’est pas tombée et que sur le mur crasseux demeure l’inscription à la craie : Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !
Les journées pluvieuses d’août se suivirent. Nos lignes clairsemées et mal armées ne cédèrent pas, le pont resta entre nos mains et les renforts commencèrent à arriver de l’arrière, de quelque part très loin.
De vraies lignes de téléphone et de télégraphe vinrent s’attacher aux toiles d’araignées d’automne qui flottaient au vent et une sorte d’énorme appareil lourd et branlant commença à fonctionner dans cette gare perdue – Sviajsk, ce point minuscule, à peine discernable sur la carte de la Russie, où la révolution s’était accrochée dans un moment de fuite et de désespoir. Ici se révéla le génie organisateur de Trotsky qui sut reconstituer les filières d’approvisionnement, amener à Sviajsk, par des voies ferrées manifestement sabotées, une artillerie fraîche et quelques régiments, bref tout ce qu’il fallait pour la résistance et l’offensive. Il faut se rappeler qu’on était en 1918, à une époque où la démobilisation battait encore son plein, où le passage dans les rues de Moscou d’un détachement de soldats rouges bien vêtus faisait sensation. C’était remonter le courant, lutter contre la fatigue de quatre années de guerre, contre les eaux impétueuses de la révolution qui emportaient par tout le pays les épaves de l’ancienne discipline tsariste exécrée, et contre la haine farouche de tout ce qui ressemblait à des officiers gueulant des ordres, à la caserne, à la vie militaire d’autrefois.
Malgré tout cela, le ravitaillement apparut devant nos yeux. Des journaux, des bottes et des capotes arrivèrent. Et partout où l’on distribue des bottes pour de bon il y a un état-major vraiment solide ; là, les choses sont stables ; l’armée campe fermement sur ses positions et ne pense pas à fuir. Les bottes, c’est quelque chose de sérieux !
L’ordre du Drapeau rouge n’existait pas encore à l’époque de Sviajsk, sinon on en aurait distribué des centaines. Tout le monde, y compris les peureux et les nerveux, et les travailleurs ordinaires, et les simples soldats de l’Armée rouge, tous, sans la moindre exception, ont accompli des actes d’héroïsme incroyables ; tous se sont surpassés, comme les fleuves sortant de leur lit au printemps, tous ont débordé avec joie de leur niveau habituel.
C’était cela l’ambiance. Je me souviens d’avoir reçu alors, par un hasard extraordinaire, quelques lettres de Moscou. On y parlait de l’exultation de la petite bourgeoisie qui se préparait à répéter les jours terribles de la Commune de Paris.
Et pendant ce temps-là le front le plus avancé et le plus exposé de la République tenait à un fil, une ligne de chemin de fer. De là partit la flamme qui provoqua une conflagration héroïque sans précédent, une guerre qui dura trois ans encore, trois ans de faim, de typhus, et d’errance.
À Sviajsk, Trotsky parvint à donner une colonne vertébrale d’acier à l’Armée qui venait de naître. Il s’ancra au sol et refusa de céder le moindre pouce de terrain quoi qu’il advînt. Il fut capable de montrer à cette poignée de défenseurs un sang-froid plus glacé que le leur. Mais à Sviajsk Trotsky n’était pas seul. Il y avait de vieux militants du parti, de futurs membres du Conseil militaire révolutionnaire de la République et de Conseils militaires des différentes armées que les historiens de la Guerre civile appelleront à l’avenir les maréchaux de la Grande Révolution. Rosengoltz et Goussev, Ivan Nikititch Smirnov, Kobozev, Mejlaouk, l’autre Smirnov et bien d’autres camarades dont j’ai oublié le nom. Parmi les marins je me souviens de Raskolnikov [commandant la flotte de la Caspienne, qu’elle épousera dans les semaines suivantes. ndlr] et de notre regretté Markine.
En l’espace de quelques jours, Rosengoltz transforma son wagon en bureau du Conseil révolutionnaire de la Guerre ; des cartes apparaissaient, des machines à écrire crépitaient – trouvées on ne sait où. Bref, Rosengoltz s’était mis à bâtir un robuste appareil d’organisation aux lignes d’une rectitude géométrique, aux embranchements précis, de conception très simple et avec une capacité de travail infinie.
Plus tard, partout où le travail piétinait, on envoyait immédiatement Rosengoltz sur place, quels que soient l’armée ou le front, comme on amène dans un sac une abeille-reine à une ruche perturbée : il se mettait sur-le-champ à construire, organiser, former des cellules, faisant vibrer les câbles du télégraphe. Pourtant Rosengoltz, en dépit de son manteau militaire et du gros pistolet suspendu à sa ceinture, n’avait rien de martial, ni dans l’allure ni dans son visage pâle plutôt doux. Ce n’était pas du tout dans ce domaine que résidait sa force, mais plutôt dans sa capacité organique de régénérer, de réorganiser, d’intensifier fiévreusement la circulation ralentie du sang, jusqu’à une vitesse explosive. Aux côtés de Trotsky il était comme une dynamo, régulière, bien huilée, silencieuse, actionnant jour après jour des leviers puissants, tissant une toile organisationnelle indéchirable.
Je ne me souviens pas quel genre de travail I.N. Smirnov accomplissait officiellement dans l’état-major de la Cinquième Armée, s’il était membre du Conseil révolutionnaire de la Guerre ou s’il était en même temps aussi responsable du Département politique. Mais quels que soient les titres ou le cadre de son travail, il incarnait l’éthique de la révolution. Il représentait le critère moral le plus élevé : la conscience communiste de Sviajsk.
Même parmi les soldats sans parti et parmi les communistes qui ne l’avaient pas connu auparavant, sa correction et sa probité absolues furent tout de suite reconnues. Il ne savait sans doute pas combien on le craignait, combien on avait peur de se montrer lâche et faible devant lui, devant cet homme qui ne criait jamais, qui se bornait à être lui-même, tranquille et brave. Personne ne commandait le respect autant qu’Ivan Nikititch. On sentait qu’il serait, dans les pires moments, le plus brave et le plus intrépide.
Avec Trotsky on tomberait au combat après avoir brûlé sa dernière cartouche, on mourrait avec enthousiasme, oubliant ses blessures. Trotsky incarnait le pathos sacré du combat, les mots et les gestes évocateurs des plus belles pages de la Révolution française.
Mais avec le camarade Smirnov (c’est ce qui nous semblait à l’époque et c’est ce que nous nous disions tout bas, allongés par terre, serrés les uns contre les autres durant ces nuits d’automne déjà fraîches), avec Smirnov on se sentirait parfaitement calme au pied du mur, interrogé par les blancs dans la fosse sordide d’une prison. Oui, c’est ainsi qu’on parlait de lui à Sviajsk.
Boris Danilovitch Mikhaïlov arriva un peu plus tard, directement de Moscou, je crois, ou en tout cas du centre. Il arriva vêtu d’un manteau de civil, avec au visage cette expression illuminée et facilement changeante des gens qui viennent de sortir de prison ou qui arrivent d’une grande ville.
En l’espace de quelques heures il fut complètement saisi par l’ivresse sauvage de Sviajsk. Il se changea, partit avec une patrouille de reconnaissance vers Kazan tenue par les blancs, et il revint trois jours plus tard, fatigué, le visage tanné par le vent, le corps infesté de vermine. Mais d’un autre côté il revenait sain et sauf.
C’est un spectacle fascinant de voir la transformation intérieure profonde qui s’opère chez les gens qui arrivent sur le front révolutionnaire : ils prennent feu comme un toit de chaume allumé des quatre côtés, et ensuite en refroidissant ils deviennent un bloc de fonte réfractaire, parfaitement net et uniforme.
Mejlaouk était le plus jeune de tous. Valerian Ivanovitch. C’était particulièrement dur pour lui. Son petit frère et sa femme étaient restés à Kazan et la rumeur disait qu’ils avaient été fusillés. Il s’avéra plus tard que son frère était effectivement mort là-bas et que sa femme avait horriblement souffert. On ne se plaignait pas souvent de son propre sort à Sviajsk. Et Mejlaouk gardait un silence loyal ; il faisait son travail et marchait avec son long manteau de cavalerie dans la boue grasse d’automne, tout son être tendu vers un seul point brûlant : Kazan.
Pendant ce temps les blancs commençaient à se rendre compte que la résistance se renforçait et que Sviajsk devenait quelque chose d’important et de dangereux.
Les escarmouches et les attaques intermittentes s’arrêtèrent ; les blancs entamèrent un siège de Sviajsk en bonne et due forme, avec des forces importantes de tous les côtés. Mais ils avaient déjà laissé passer le moment propice.
Le vieux Slavine, commandant de la Cinquième Armée, n’était peut-être pas quelqu’un de brillant mais ce colonel connaissait son métier à fond et en détail ; il se fixa sur un point crucial de la défense, il conçut un plan déterminé et il le mena à bien avec une obstination toute lettone.
Sviajsk tint bon, les pieds fichés en terre comme un taureau, son large front baissé ; inébranlable, il regardait Kazan, secouant ses cornes tranchantes comme des baïonnettes.
Un matin ensoleillé d’automne arrivèrent à Sviajsk des torpilleurs de la Flotte de la Baltique, minces, agiles et rapides. Leur apparition fit sensation. L’Armée sentait maintenant que le côté du fleuve était protégé. Une série de duels d’artillerie commença sur la Volga, trois ou quatre fois par jour. Notre flottille, couverte par le feu de nos batteries dissimulées le long de la rive, s’aventurait maintenant assez loin à l’avant. Ces incursions finirent par devenir extrêmement audacieuses. Le marin Markine, l’un des fondateurs et des plus grands héros de la flotte rouge, s’aventura ainsi le matin du 9 septembre à bord d’un remorqueur blindé peu maniable jusque sur les jetées de Kazan, il mit en fuite les servants des batteries ennemies à coups de mitrailleuse et il ôta les percuteurs de plusieurs canons.
Une autre fois, tard dans la nuit du 30 août, nos bateaux s’approchèrent tout près de Kazan, bombardèrent la ville, mirent le feu à plusieurs barges chargées de munitions et de nourriture et se retirèrent sans avoir perdu un seul vaisseau. Trotski et le commandant se trouvaient sur l’un de ces bateaux, le torpilleur Protchny, qui dut réparer son gouvernail alors qu’il dérivait le long d’une barge ennemie, à portée immédiate des canons de l’artillerie blanche.
Vatsétis, le commandant en chef du front oriental, arriva à un moment où l’offensive contre Kazan était déjà lancée. Nous n’avions pour la plupart d’entre nous, y compris moi-même, pas d’information très précise sur le résultat de la conférence. Une seule chose devint rapidement connue de tous et saluée d’une profonde satisfaction générale : le vieux (c’est ainsi que nous appelions notre commandant entre nous) avait exprimé son désaccord avec Vatsétis qui voulait attaquer Kazan par la rive gauche du fleuve. Le commandant voulait lancer l’assaut depuis la rive droite qui domine la ville, alors que la rive gauche est plate et exposée.
Mais au moment précis où la Cinquième Armée tout entière était prête à l’attaque et où le gros de ses forces commençait finalement à avancer malgré d’incessantes contre-attaques et plusieurs grosses batailles durant des journées entières, trois sommités de la Russie blanche se réunirent pour mettre fin à la longue épopée de Sviajsk. Savinkov, Kappel et Fortunatov, à la tête d’une force considérable, lancèrent un raid audacieux contre une gare située près de Sviajsk, dans le but de prendre Sviajsk elle-même et le pont sur la Volga. Le raid fut brillamment mené ; après un long détour, les blancs fondirent soudainement sur la gare de Chikhrana, la mirent en pièces, saisirent les bâtiments de la gare, coupèrent la liaison avec le reste de la ligne de chemin de fer et incendièrent un train de munitions qui était garé là. La petite unité qui défendait Chikhrana fut massacrée jusqu’au dernier homme.
Et ce n’est pas tout : ils pourchassèrent et exterminèrent tout ce qu’il y avait de vivant dans cette petite gare. J’eus l’occasion de voir Chikhrana quelques heures après le raid. L’endroit portait les stigmates de la violence pogromiste complètement irrationnelle caractéristique de toutes les victoires de ces messieurs, qui ne se sentaient jamais les maîtres et futurs habitants du territoire qu’ils avaient accidentellement et temporairement conquis.
Dans une cour gisait une vache assassinée d’une manière atroce (je dis bien assassinée, pas tuée) ; le poulailler était jonché de poulets morts, criblés de façon absurde, trop humaine. Le puits, le petit potager, le château d’eau et les maisons avaient été traités comme s’il s’agissait d’êtres vivants capturés ou plutôt de bolchéviks et de Juifs. Tout avait été éviscéré. Les animaux et les objets inanimés traînaient de tous côtés, décimés, violés, défigurés. Au milieu de cette horrible scène de dévastation, qui avait été une habitation humaine, la mort indescriptible, inexprimable, de quelques cheminots et soldats de l’Armée rouge pris par surprise paraissait tout à fait dans l’ordre des choses.
Seuls les tableaux qu’a faits Goya de la campagne et de la guérilla en Espagne montrent une pareille harmonie d’arbres battus par les vents et ployant sous le poids des pendus, de poussière sur les routes, de sang et de pierre.
Depuis la gare de Chikhrana le détachement de Savinkov s’était dirigé vers Sviajsk, longeant la voie ferrée. Nous envoyâmes notre train blindé Russie libre à sa rencontre. Autant que je me souvienne il était équipé de canons de marine à longue portée. Mais son commandant ne fut pas à la hauteur de la tâche. Assailli sur deux côtés (à ce qu’il lui semblait), il abandonna son train et se précipita au rapport devant le Conseil révolutionnaire de la Guerre.
En son absence, le Russie libre fut taillée en pièces et incendié. Sa carcasse noire fumante resta longtemps couchée sur le côté au bord de la voie, tout près de Sviajsk.
Après la destruction du train blindé, la voie vers la Volga semblait tout à fait libre. Les blancs étaient juste sous Sviajsk, à une verste et demie ou deux du quartier général de la Cinquième Armée. Cela provoqua la panique. Une partie du Département politique, sinon sa totalité, se précipita vers la jetée pour embarquer sur les vapeurs.
Le régiment, qui combattait presque sur les rives de la Volga mais plus en amont, hésita puis s’enfuit avec ses commandants et commissaires. Ses détachements affolés se retrouvèrent vers le matin à bord des navires d’état-major dirigeant la flotte de guerre de la Volga.
À Sviajsk il ne restait que l’état-major de la Cinquième Armée avec ses officiers, et le train de Trotski.
Léon Davidovitch [Trotsky] mobilisa tout le personnel du train, les garçons de bureau, les télégraphistes, les infirmiers et la garde commandée par le chef d’état-major de la flotte, le camarade Lepetenko (qui d’ailleurs était l’un des soldats les plus courageux et dévoués de la révolution et dont la biographie pourrait bien offrir à ce livre son plus beau chapitre) – quiconque en un mot pouvait tenir un fusil.
Les bureaux se vidèrent, il n’y eut plus d’arrière. Tout fut jeté à la rencontre des blancs qui avaient avancé presque jusqu’à la gare. De Chikhrana aux premières maisons de Sviajsk toute la voie était labourée par les obus, couverte de cadavres de chevaux, d’armes abandonnées et de cartouches vides. Plus on s’approchait de Sviajsk, plus c’était le chaos. Les blancs dépassèrent l’énorme squelette calciné du train blindé qui fumait encore, dégageant une odeur de métal fondu, et là leur avancée fut stoppée. Les blancs qui avaient poussé jusqu’aux abords de Sviajsk reculèrent comme le ressac pour se jeter à nouveau contre les réserves de Sviajsk, mobilisées en hâte. Les deux camps s’affrontèrent alors pendant plusieurs heures, et il y eut de nombreux morts.
Les blancs se croyaient en présence de troupes fraîches, bien organisées, que même leur service de renseignement n’avait pas remarquées. Leurs soldats, épuisés par un raid de 48 heures, eurent tendance à surestimer la force de l’ennemi ; ils étaient loin de soupçonner que face à eux il n’y avait qu’une poignée de combattants rassemblés à la hâte, et que derrière ceux-ci il n’y avait que Trotsky et Slavine, assis après une nuit blanche devant une carte dans une salle enfumée du quartier général déserté, au centre de Sviajsk où il n’y avait plus âme qui vive et où les balles sifflaient dans les rues.
Cette nuit-là, comme les précédentes, le train de Léon Davidovitch était resté là comme toujours, sans sa locomotive. On ne dérangea pas un seul des détachements de la Cinquième Armée qui avançaient vers Kazan ou qui s’apprêtaient à la prendre d’assaut, on n’en préleva pas un seul du front pour couvrir Sviajsk qui était pratiquement sans défense. L’armée et la flotte ne furent informées de l’attaque nocturne qu’une fois que tout était fini et que les blancs étaient déjà en train de se retirer, convaincus d’avoir affaire à toute une division.
Le lendemain, 27 déserteurs qui avaient fui sur les bateaux au moment le plus critique furent jugés et fusillés. Il y avait parmi eux plusieurs communistes. On a beaucoup parlé plus tard de l’exécution de ces 27 déserteurs, notamment à l’arrière, bien sûr, où l’on ne savait pas à quel point la route de Moscou ne tenait qu’à un fil, et avec elle toute notre offensive contre Kazan entreprise avec nos derniers moyens et nos dernières forces.
Pour commencer, on disait partout dans l’armée que les communistes s’étaient montrés lâches, que la loi n’était pas faite pour eux, qu’ils pouvaient déserter impunément alors qu’on fusillait les simples soldats comme des chiens.
Sans l’extraordinaire courage de Trotsky, du commandant de l’armée et des membres du Conseil révolutionnaire de la Guerre, la réputation des communistes travaillant dans l’armée aurait été ruinée pour longtemps.
Quand une armée subit toutes les privations possibles pendant six semaines, quand elle se bat pratiquement à mains nues, sans même des bandages, aucun beau discours ne peut faire croire que la lâcheté n’est pas de la lâcheté et que la culpabilité peut avoir des circonstances atténuantes.
On dit que parmi ceux qui furent fusillés il y avait beaucoup de bons communistes, certains même dont la faute était rachetée par les services qu’ils avaient déjà rendus à la révolution, par des années de prison et d’exil. C’est parfaitement vrai. Personne ne prétend qu’ils périrent au nom des préceptes du vieux code militaire qui dit qu’il faut faire un exemple quand au milieu des roulements de tambour on fait œil pour œil, dent pour dent. Bien sûr que Sviajsk était une tragédie.
Mais tous ceux qui ont vécu la vie de l’Armée rouge, qui sont nés et sont devenus forts avec elle dans les batailles de Kazan, témoigneront que l’esprit d’airain de cette armée n’aurait jamais pu se forger, que la fusion entre le parti et la masse des soldats, entre la base et le sommet du commandement, rien de tout cela n’aurait pu se faire si, à la veille de l’assaut sur Kazan où des centaines de soldats allaient perdre la vie, le parti n’avait pas montré clairement aux yeux de tous qu’il était prêt à offrir à la Révolution ce grand sacrifice sanglant ; et que pour le parti aussi les lois sévères de la discipline entre camarades s’appliquent, que le parti a le courage d’appliquer sans faiblir les lois de la République soviétique à ses propres militants aussi.
Il y eut 27 fusillés, et cela combla la brèche que les blancs avaient réussi à ouvrir dans la cohésion et la confiance en elle-même de la Cinquième Armée. Cette salve, qui punissait des communistes, des commandants et de simples soldats pour leur lâcheté et leur comportement déshonorant sur le champ de bataille, força la partie la moins consciente de la masse des soldats, les plus enclins à déserter (car il y en avait bien sûr), à se ressaisir et à se ranger avec ceux qui allaient consciemment et sans la moindre contrainte au combat.
C’est à ce moment précis que se décida le sort de Kazan, et non seulement cela mais le sort de toute l’intervention blanche. L’Armée rouge reprit confiance, elle se régénéra et se renforça pendant les longues semaines de défense et d’attaque.
C’est dans une situation de danger constant et de grandes épreuves morales qu’elle élabora ses lois, sa discipline, ses nouveaux statuts héroïques. Pour la première fois s’évanouit la panique face à la technique plus moderne de l’ennemi. On apprit comment avancer sous les tirs d’artillerie ; et, sans qu’on le recherche, par simple instinct de conservation, on inventa de nouvelles méthodes militaires, ces méthodes de combat spécifiques, les méthodes de la Guerre civile, que l’on étudie déjà dans les écoles supérieures de guerre. C’est très important qu’il y ait eu un homme justement comme Trotsky à Sviajsk à ce moment-là.
Quel que soit son titre ou son nom, il est clair que l’organisateur de l’Armée rouge, le futur Président du Conseil militaire révolutionnaire de la République, se devait d’avoir été à Sviajsk et d’avoir vécu toute l’expérience pratique de ces semaines de combat ; il dut mobiliser toutes les ressources de sa volonté et de son génie organisationnel pour défendre Sviajsk, pour défendre l’organisme de l’armée écrasé sous le feu des blancs.
De plus, il y a dans la guerre révolutionnaire encore une autre force, un autre facteur sans lequel on ne peut remporter la victoire : c’est le puissant romantisme de la Révolution, grâce auquel on peut, tout frais revenu des barricades, se mouler dans les formes rigoureuses de l’appareil militaire, sans perdre le pas rapide et léger qu’on a acquis dans les manifestations politiques, ni l’esprit indépendant et la souplesse qu’on a pu acquérir au cours des longues années de travail du parti dans la clandestinité.
Pour l’emporter en 1918 il fallait prendre tout le feu de la révolution, toute sa chaleur incandescente et l’atteler au modèle séculaire, vulgaire, repoussant, de l’armée.
Jusqu’à présent l’histoire a toujours résolu ce problème avec des effets théâtraux imposants mais éculés. Elle faisait monter sur scène un personnage en tricorne et uniforme de campagne gris, et celui-ci, ou quelque autre général sur un cheval blanc, créait des républiques, des drapeaux, des slogans avec le sang et la moelle révolutionnaires.
La Révolution russe a suivi sa propre voie, en matière d’édification militaire comme en tant d’autres. L’insurrection et la guerre se sont fondues l’une dans l’autre, l’Armée et le Parti se sont développés ensemble, inextricablement entremêlés. L’unité de leurs objectifs mutuels était consignée sur les drapeaux des régiments avec toutes les formules les plus tranchantes de la lutte des classes. À Sviajsk tout cela était encore flou, c’était seulement dans l’air, cherchant son expression.
Il fallait que l’Armée ouvrière et paysanne trouvât son expression d’une façon ou d’une autre ; elle devait prendre sa forme extérieure, produire ses formules à elle, mais comment ? Personne ne le savait encore très bien. On ne disposait bien sûr à l’époque d’aucun précepte, d’aucun programme systématique indiquant comment cet organisme titanesque devait grandir et se développer.
Il y avait seulement un pressentiment créateur dans le parti et dans les masses : une prémonition de cette organisation révolutionnaire militaire qu’on n’avait jamais vue auparavant et dont chaque jour de combat soufflait une nouvelle caractéristique.
Ce fut là le grand mérite de Trotsky : il attrapait au vol le moindre geste des masses qui portât déjà en lui-même la marque de cette formule organisationnelle singulière tant recherchée.
Il triait et mettait en place toutes les menues formules pratiques grâce auxquelles Sviajsk assiégée simplifiait, hâtait ou organisait son travail de combat. Et cela pas seulement dans un sens technique étroit. Non. Toute nouvelle collaboration réussie entre un spécialiste et un commissaire, entre celui qui commande et celui qui exécute l’ordre et en porte la responsabilité, toute nouvelle collaboration était immédiatement transformée en ordre, circulaire ou règlement, une fois qu’elle avait subi le test de l’expérience et qu’elle avait été clairement formulée. De cette manière l’expérience révolutionnaire ne fut pas perdue, oubliée ou déformée.
La norme obligatoire pour tous n’était pas la médiocrité mais au contraire ce qu’il y avait de mieux, les idées de génie venues des masses elles-mêmes dans les moments de lutte les plus enflammés et les plus créatifs. Dans les petites choses comme dans les grandes, que ce fût des questions complexes comme la division du travail entre les membres du Conseil révolutionnaire de la Guerre ou un geste rapide, vif, amical échangé lorsque se saluaient un commandant rouge et un soldat, chacun occupé et pressé d’aller quelque part, tout cela, il fallait le tirer de la vie, l’assimiler et le rendre aux masses sous forme de norme universelle. Et quand les choses n’avançaient pas, que cela coinçait ou allait mal, il fallait comprendre pourquoi cela n’allait pas, il fallait aider, tirer comme la sage-femme tire le nouveau-né lors d’un accouchement difficile.
On peut s’exprimer avec la plus grande clarté, donner à une nouvelle armée une forme plastique impeccable et rationnelle, et malgré tout stériliser son esprit, le laisser s’évaporer sans pouvoir le garder vivant dans le dédale des formules juridiques. Pour éviter ce piège il faut être un grand révolutionnaire. Il faut posséder l’intuition d’un créateur et avoir en soi un puissant émetteur radio sans lequel on ne peut aller au contact des masses.
En dernière analyse, c’est précisément cet instinct révolutionnaire qui est le tribunal suprême ; c’est lui qui purifie sa nouvelle justice créatrice de toutes les tendances arriérées et contre-révolutionnaires cachées. Il attaque violemment la justice formelle trompeuse au nom de la justice prolétarienne supérieure, qui ne permet pas que ses lois souples s’ossifient et perdent tout rapport avec la vie, qu’elles soient un poids superflu, mesquin, irritant sur les épaules des soldats de l’Armée rouge.
Jamais il ne permettait au soldat, au chef militaire, au commandant qu’il y avait en lui de supplanter le révolutionnaire. Et quand de sa voix métallique surhumaine il confrontait un déserteur, il était terrifiant, un grand rebelle qui pouvait écraser et tuer quiconque pour sa lâcheté, sa trahison, non pas d’un point de vue militaire mais du point de vue de la cause révolutionnaire mondiale.
Trotski n’aurait pas pu faire preuve de lâcheté. Le mépris de cette armée extraordinaire l’aurait écrasé ; elle n’aurait pu pardonner à un faible d’avoir versé le sang de 27 de ses frères lors de sa première victoire.
Quelques jours avant l’occupation de Kazan par nos troupes, Léon Davidovitch avait dû quitter Sviajsk ; il avait été rappelé à Moscou à la nouvelle de la tentative d’assassinat contre Lénine. Mais ni le raid de Savinkov contre Sviajsk, organisé avec un remarquable savoir-faire par les socialistes-révolutionnaires, ni, presque au même moment, la tentative d’assassinat de ce même parti contre Lénine, ne pouvaient plus arrêter l’Armée rouge. La vague finale de l’offensive engloutit Kazan.
Les troupes embarquèrent tard dans la nuit du 9 septembre et au petit matin, vers 5 heures et demie, les lourds transporteurs de troupes à plusieurs ponts, escortés par des torpilleurs, approchèrent des quais de Kazan. C’était étrange de naviguer dans la pénombre à la lueur de la lune, de passer devant le moulin au toit vert, à moitié détruit, derrière lequel on avait repéré une batterie blanche ; puis devant le Dauphin à moitié calciné, pillé, échoué sur le rivage désert ; et devant tous les méandres, langues de terre, anses et bancs de sable familiers où du matin au soir la mort avait rôdé pendant de si longues semaines, où s’étaient élevées les volutes de fumée, où avaient jailli les gerbes dorées des tirs d’artillerie.
Nous naviguions tous feux éteints, dans un silence absolu, sur la Volga qui coulait, noire, froide et lisse. Derrière nous, une légère écume vibre sur le morne sillage, lavé par des vagues, oubliant tout, coulant avec indifférence vers la mer Caspienne. Et pourtant l’endroit où glissait maintenant silencieusement l’énorme bateau était hier encore un maelström déchiré et labouré par l’explosion incessante des obus. Ici, un oiseau nocturne a effleuré il y a un instant de son aile l’eau d’où montait une légère volute de brume dans l’air froid, alors qu’hier encore jaillissaient tant de fontaines blanches d’écume ; hier les ordres tonnaient sans arrêt ; les torpilleurs effilés traçaient leur chemin dans la fumée, les flammes et une pluie d’éclats d’acier, la coque tremblant sous l’impatience comprimée des moteurs et le recul des batteries doubles de canon qui tiraient un coup à la minute, émettant un son semblable à un hoquet d’acier.
On tirait, on se dispersait sous une grêle d’obus cliquetants, on épongeait le sang sur les ponts… Et maintenant tout est silence ; la Volga coule comme elle coulait il y a mille ans, comme elle coulera encore pendant des siècles.
Nous atteignîmes les quais sans tirer un seul coup de feu. Les premières lueurs de l’aube éclairaient le ciel. Dans la pénombre grise et rose commençaient à émerger de noirs fantômes bossus et calcinés. Grues, poutres de bâtiments incendiés, poteaux télégraphiques renversés, tout cela semblait avoir enduré une tristesse sans borne, perdu toute sensibilité, comme un arbre aux branches difformes et dénudées. Un royaume de la mort lavé par les roses glacées de l’aube nordique.
Et les canons abandonnés, la gueule vers le haut, ressemblaient dans la pénombre à des figures abattues, pétrifiées dans leur désespoir muet, la tête relevée par des mains froides et humides de rosée.
Brouillard. On commence à trembler de froid et de tension nerveuse ; l’air est imbibé de l’odeur de cambouis et de cordages enduits de résine. Le col bleu de l’artilleur tourne avec le mouvement du corps, regardant avec surprise la rive déserte et silencieuse reposant dans un silence de mort.
C’est cela la victoire.
Larissa Reissner. Sur le front
Larissa Reissner, qui appelait Ivan Nikititch [Smirnov] la conscience de Sviiajsk, occupait elle-même une place importante dans la V° armée, comme aussi dans toute la révolution. Cette belle jeune femme, qui avait ébloui bien des hommes, passa comme un brûlant météore sur le fond des événements. À l’aspect d’une déesse olympienne, elle joignait un esprit d’une fine ironie et la vaillance d’un guerrier. Lorsque Kazan fut occupé par les Blancs, elle se rendit, déguisée en paysanne, dans le camp ennemi pour espionner. Mais sa prestance était trop extraordinaire. Elle fut arrêtée. Un officier japonais, du service d’espionnage, lui fit subir un interrogatoire. Pendant une suspension de séance, elle réussit à se glisser par la porte qui était mal gardée, et disparut. Dès lors elle travailla en éclaireur. Plus tard, sur des navires de guerre, elle participa à des combats. Elle a consacré à la guerre civile des essais qui resteront dans la littérature. Elle décrivit non moins brillamment les industries de l’Oural et l’insurrection ouvrière dans la Ruhr. Elle désirait tout voir, tout connaître et participer à tout. En quelques brèves années, elle était devenue un écrivain de premier ordre. Sortie indemne des épreuves du feu et de l’eau, cette Pallas de la révolution fut brusquement consumée par le typhus, dans le calme de Moscou : elle n’avait pas trente ans.
Léon Trotski. Ma Vie. 1929
20 09 1918
Francesco Forgione, devenu Padre Pio, prêtre capucin de faible constitution n’a fait que de courts séjours sur le front et a fini par être réformé. Il est depuis deux ans au couvent de San Giovanni Rotondo, village reculé des Pouilles italiennes, dans le Gargano, entre Foggia et l’Adriatique ; en prière après avoir célébré la messe, il est surpris par la vision d’un personnage mystérieux dont les mains, les pieds et le coté ruissellent de sang. Lorsque la vision disparaît, les blessures sont devenues siennes. Il les gardera toute sa vie, sans que la science puisse y trouver une explication. Sa célébrité, et l’argent qui va avec, lui vaudront d’être marginalisé longtemps par l’Église officielle, laquelle craignait de le voir emmener de nombreuses ouailles dans des voies schismatiques. Le ministère de l’Intérieur est alerté contre le fanatisme des croyants, qui se pressent autour du moine, atteint de tuberculose, et ramassent ses crachats sanguinolents. Né à Pietrelcina en 1887, il meurt le 23 septembre 1968 : la toilette du mort ne laissera voir aucun stigmate, ni même une seule cicatrice. Mais il semblerait que ce cas ne soit pas unique et qu’on le rencontre chez des malades mentaux. Jean Paul II le canonisera le 16 juin 2002. San Giovanni Rotondo deviendra un lieu de pèlerinage très fréquenté, une église moderne ayant été accolée à la primitive, toute de marbre vêtue, dénuée de tout talent architectural.
09 1918
Dans l’Ukraine orientale, l’anarchiste Nestor Makhno fonde la Makhnovchtchina, l’aboutissement d’une Union des Paysans, un soviet anarchiste où est bannie la propriété privée. Politiquement, les choix à faire sont dramatiques : trop petit pour prétendre mener seul sa barque, il doit s’allier soit avec les Russes Blancs du général Denikine, qui va remporter d’importants succès, soit avec les rouges de Lénine. Il va choisir de combattre aux cotés de ces derniers. Autre personnage marquant de l’Ukraine, Guillaume François de Habsbourg devenu très populaire à la tête de la légion ukrainienne ; surnommé Basile le Brodé, l’Archiduc rouge, il va devenir colonel de l’armée de la République ukrainienne.
5 10 1918
Mort de Roland Garros : à l’issue d’un combat contre des Fokker D.VII, son SPAD XIII explose en l’air et s’écrase sur le territoire de la commune de Saint-Morel, dans les Ardennes, non loin de Vouziers où il est enterré. Il allait avoir 30 ans. Prisonnier du 18 avril 1915 au 15 février 1918, évadé, ce n’est que sur son insistance qu’il avait été à nouveau affecté à une escadrille sur le front.
Le prince Max de Bade, nouveau chancelier d’Allemagne depuis deux jours adresse une dépêche au président Wilson : Pour éviter que l’effusion de sang ne continue, le gouvernement allemand propose la conclusion immédiate d’un armistice général sur terre, sur mer, et dans les airs. Le vaincu savait déjà qui était le vainqueur.
7 10 1918
La Pologne proclame son indépendance. Pilsudski est chargé de former un gouvernement.
9 10 1918
Le président des États-Unis a fait savoir au prince de Bade que tant que les Allemands continueront à couler les navires de passagers, et ensuite les canots de sauvetage, tant qu’ils continueront à saccager systématiquement les villes en se retirant, il n’y avait rien à attendre… et de plus, qu’il leur faudrait procéder à la destruction ou la mise à l’impuissance de tout pouvoir arbitraire, où qu’il se trouve, qui peut séparément, secrètement et par sa seule volonté troubler la paix du monde. En termes choisis, Wilson exigeait des Allemands qu’ils se débarrassent de leur empereur ! Il n’acceptait de conclure la paix qu’avec un gouvernement parlementaire et non avec l’ancienne caste militaire prussienne. Et l’armée allemande appuiera ce changement, trouvant là un bon moyen de laver son honneur : 10 jours plus tôt, le 29 septembre, le général Ludendorff déclarait : que ceux qui nous ont mis dans cette situation se chargent de nous en sortir. Et un mois plus tard, le 11 novembre, le maréchal Hindenburg déclarera dans son dernier ordre du jour aux armées : L’armistice a été signé. Jusqu’à ce jour, nous avons porté nos armes avec honneur. Dans son fidèle dévouement et dans l’accomplissement de son devoir, l’armée a fait de grandes choses. Par des offensives victorieuses et par l’âpreté de notre défense, par de rudes combats sur terre et dans les airs, nous avons maintenu l’ennemi loin de nos frontières et protégé notre pays des horreurs et des dévastations de la guerre. Face au nombre croissant de nos adversaires, face à l’effondrement des alliés qui ont lutté à nos cotés jusqu’à l’extrémité de leur force et face aux difficultés économiques et de ravitaillement sans cesse plus oppressantes, notre gouvernement a du se résoudre à accepter de dures conditions d’armistice. Mais nous sortons la tête haute et emplis de fierté de la lutte menée pendant plus de quatre ans contre un monde d’ennemis. Dans la conscience d’avoir défendu notre pays et notre honneur jusqu’au bout, nous puisons une énergie nouvelle.
11 10 1918
À la chambre des députés, Poincaré lance à Clemenceau : Tout le monde espère fermement qu’on ne coupera pas les jarrets de nos troupes par un armistice, si court soit-il !
24 10 1918
Pressés par les Alliés, les Italiens infligent une lourde défaite à l’Autriche qui devra signer un armistice le 3 novembre, lequel donne un droit de passage aux Alliés pour prendre l’Allemagne à revers, via la Bavière. C’est le début de la désintégration de l’empire austro-hongrois des Habsbourg. Un conseil national hongrois est instauré à Budapest.
29 10 1918
La Serbie, la Croatie et la Slovénie proclament leur indépendance pour ne former qu’un seul pays : la Yougoslavie, yougo signifiant du sud en russe.
30 10 1918
Les Tchèques annexent les Slovaques pour ne former qu’un seul pays : la Tchécoslovaquie. La révolution éclate à Budapest. L’empire ottoman signe l’armistice avec l’Angleterre.
Poussé par les Anglais, soutenu aussi par la colonne française du capitaine Pisani, Fayçal d’Arabie entre triomphalement à Damas, d’où il chasse les émirs Abd el Kader et Said al-Jazairi, qui avaient formé un gouvernement provisoire favorable à la France ; Damas était alors dans la zone d’influence française prévue par les accords Sykes-Picot. Les Anglais, et surtout Lawrence, vont pousser Fayçal à se rendre rapidement à la conférence de la Paix à Paris, mettant ainsi les Français devant le fait accompli, frisant l’incident diplomatique. L’empire ottoman a instauré pendant toute la durée de la guerre un blocus total sur le Mont Liban : le typhus, la famine, les exécutions auront fait 200 000 morts dans la communauté chrétienne maronite. Mutineries de marins à Kiel.
1 11 1918
La monarchie allemande s’écroule : le Kaiser abdique : la république est proclamée.
4 11 1918
L’assassinat de l’archiduc François Ferdinand n’avait été que le prétexte du déclenchement de la guerre, la cause réelle étant l’impossibilité radicale pour l’Angleterre de voir la flotte navale allemande rivaliser en puissance avec la sienne. Pendant la guerre, les batailles navales s’étaient à peu près limitées à celle du Jutland et le blocus anglais avait été très efficace au point que la flotte allemande était pratiquement restée à quai pendant toute la guerre, ce qui n’était pas fait pour la rendre populaire : tous ces investissements pour rester au port ! Aussi l’amiral en chef et gouverneur avait-il prévu de sortir enfin pour livrer bataille sans en informer le gouvernement ; mais cette initiative n’avait pas été du goût des marins qui s’étaient mis en grève avec la création d’un conseil des soldats à Kiel. Les matelots s’en prenaient aux officiers dans les rues de Kiel. Le gouverneur avait demandé des renforts d’infanterie à Berlin pour mettre à la raison les mutins, mais, sitôt arrivés à Kiel, ces renforts d’infanterie se mirent à fraterniser avec eux ! Berlin enverra Gustav Noske pour négocier et il parviendra à les manipuler, prenant leur tête pour mieux les enfariner. Il commencera par leur offrir des vacances, ne réalisant pas que le meilleur moyen de répandre une révolution, c’est d’envoyer les révolutionnaires chez eux ! L’USPD – le parti socialiste indépendant, révolutionnaire, va finir par gagner presque toute l’Allemagne du nord à sa cause, mais c’est pour finir le MSPD – le parti socialiste majoritaire, réformiste, qui l’emportera. Les mutins finiront par être violemment réprimés lors du Noël sanglant du 23 au 25 décembre.
6 11 1918
Le général Gröner devient général en chef de l’armée allemande en remplacement du maréchal von Hindenburg.
7 11 1918
La commission d’armistice allemande passe la ligne de front dans le secteur de La Capelle, où un train spécial doit les conduire à Rethondes, en forêt de Compiègne. Elle est dirigée par un civil, Matthias Erzberger, député du Centre catholique. En Allemagne même, le mouvement révolutionnaire gagne Hanovre, Francfort et Munich, où le député socialiste-indépendant Kurt Eisner constitue un premier gouvernement républicain de Bavière. À Berlin, des manifestations exigent la République.
La famille princière de Catherine Sayn-Wittgenstein quitte la Russie. À Moguilev, ils étaient rive gauche du Dniestr, en Ukraine. Ils traversent le fleuve pour arriver en Bessarabie, alors sous domination autrichienne et polonaise :
Moguilev, 7 novembre
Un bouleversement politique ! Le maire a été déposé et également le général Iltchaninoff ; le pouvoir est entre les mains du bolchevik Kirienko et de la Zagin ukrainienne. Ils sont favorables à l’indépendance de l’Ukraine, en veulent au Hetman en raison de son décret sur l’unité de la Russie et ont décidé avec de grands éclats de voix d’ériger une Ukraine indépendante comme elle leur convient : avec de la terreur, des troubles, et d’autres choses similaires. Jusqu’à trois heures de l’après-midi nous n’en avons rien su, puis le vieux Krupko est arrivé et, complètement brisé, nous a donné cette nouvelle. Puis Papa a été appelé auprès du général Iltchaninoff ; Krupko voulait repasser encore ce soir pour apprendre ce qu’il y aurait de nouveau. Madame Jaruszinska, avec laquelle nous sommes devenus amis, est venue ; avec elle aussi nous avons débattu de ce qu’il fallait faire.
Papa revint, ses nouvelles n’étaient pas rassurantes : le général Iltchaninoff avait tout confirmé, et dit que Kirienko et ses hommes de main avaient préparé un manifeste pour les paysans et appelaient à l’anarchie, au pillage et aux pogroms ; il doit être publié demain. Iltchaninoff avait dit à Papa qu’il risquait d’être arrêté et lui avait conseillé de se cacher. Que faire ? Les nouvelles étaient très mauvaises, les trains ne circulaient pas; cette proclamation était comme une étincelle dans un tonneau de poudre. Pour nous sauver des Ukrainiens libres et des paysans, il ne restait qu’une seule solution : la fuite par-dessus le Dniestr. Comme toute la Bessarabie est occupée par les Roumains, les bolcheviks ukrainiens ne pourront rien nous y faire.
Madame Jaruszinska rentra à la maison pour entreprendre des démarches le plus rapidement possible au vu des nouvelles conditions ; nous nous rassemblâmes pour débattre et décidâmes de tout préparer pour la fuite. C’était vers cinq heures. Nous commençâmes immédiatement à faire nos bagages, à confectionner des poches secrètes, à coudre de l’argent dans les doublures et à rassembler le plus important. Sans perdre une minute, Boba partit se procurer des laissez-passer pour le pont. C’est bien que chez nous personne ne perde la tête dans une situation donnée, mais au contraire vaque tranquillement à ses occupations. Alors ce fut aussi le cas. Comme nous voulions tous nous enfuir au même moment et que nous ne savions pas pour combien de temps, il fallait préparer pas mal de choses pour vivre dans un trou juif aussi répugnant qu’Ataki. Vers une heure tout était fini, un plan d’action établi, et tout le monde se coucha. Il fallait se lever tôt le lendemain matin pour arriver tôt au pont. [Je me souviens mal comment chacun se prépara à la fuite. Chacun emporta ce qu’il voulait avoir avec lui, probablement un peu de linge, du savon et ainsi de suite. Chacun avait une petite valise qu’il pouvait porter lui-même. Je sais seulement que je mis mon Journal dans mes bagages. Je crois me souvenir que nous n’avons pas emporté de nourriture du tout. Nous nous sommes assis, avons fait le signe de la croix et quitté la maison. – Complément de l’auteur, 1982]
Ataki, la petite ville en face de Moguilev, le 8 novembre
Ce fut une journée pénible. Pour la première fois de notre vie, nous avons quitté notre maison sans savoir où nous logerions. Nous sommes partis pour nous soustraire au contrôle de nos ennemis. Nous avions déjà fui auparavant, mais aujourd’hui c’était autre chose.
À huit heures, nous étions tous prêts. Nous avons bu du café, emballé nos dernières affaires, et ne nous sommes pas beaucoup pressés de quitter notre rue Sadovaïa n°16. À dix heures, nous nous sommes mis en route avec la triste sensation que nous quittions notre propriété pour longtemps et que quelque chose de mauvais allait se passer ici. Nouditchka nous accompagna ; elle reste pour tout surveiller jusqu’à notre retour. On la connaît moins que nous ; si un danger menace, elle peut se cacher chez les voisins.
Nous nous mîmes en route dans l’ordre suivant : Maman et moi dans la pirogue – c’est là notre vieille voiture que nous avons toujours à Moguilev -, Olga sur le siège, les autres à pied. Derrière nous venait une voiture avec nos bagages. Il n’y avait pas encore de gel, la boue était si profonde que la pirogue glissait d’un côté à l’autre ; je descendis et continuai à pied. Nous choisîmes le chemin le plus court mais le plus difficile, le long de la rue Pouchkine qui mène à la gare. Nous pataugeâmes dans la boue ; puis Papa et moi trouvâmes une calèche et Boba, Tatiana et André s’installèrent sur le porte-bagages. En route, un spectacle effrayant s’offrit à nous. Depuis quelques jours déjà, des centaines et même des milliers d’anciens prisonniers de guerre en Autriche envahissaient Moguilev. Ils étaient presque tous malades : ils souffrent de différentes sortes de typhus, dysenterie ou tuberculose en phase terminale. On peut difficilement s’imaginer un spectacle plus horrible que tous ces gens à moitié nus qui n’ont rien mangé depuis des jours et submergent la gare. Ils sont presque tous tellement faibles qu’ils restent couchés, là où ils tombent, et ne peuvent même plus ramper. Les malades et les mourants, les vivants et les morts, ils sont tous couchés pêle-mêle. Des gens qui ont souffert longtemps en captivité, qu’on a fait souffrir de la faim et travailler dur pour que le plus grand nombre possible d’entre eux ne revienne pas dans leur patrie, s’étaient maintenant traînés jusqu’à Moguilev pour y mourir. D’autres avaient atteint d’autres endroits qui leur étaient tout aussi étrangers. C’est terrible d’imaginer quelle quantité de souffrance et de malheur existe autour de nous – que sont nos désagréments par rapport à cela ? Nous parvînmes au cimetière municipal. Je remarquai déjà de loin un attroupement de curieux debout près de la clôture. Lorsque nous arrivâmes tout près, un spectacle terrifiant s’offrit à nous : tout le long du mur gisaient des morts côte à côte ; une immense ligne blanche se détachait sur le gazon gris et desséché du cimetière. Un petit groupe de gens circulait entre les cadavres et quelques voitures stationnées à l’entrée ; des bâches qui recouvraient les voitures émergeaient des jambes et d’énormes mains aux poings serrés. Sur le cimetière on ne voyait ni prêtres, ni êtres humains qui seraient venus par compassion pour ces malheureux. Seule une petite troupe d’enfants s’y tenait ; ils regardaient avec une curiosité indifférente, et les porteurs s’acquittaient de leur travail avec paresse et mauvaise volonté, comme s’il ne s’agissait pas du devoir sacré de la restitution des morts à la terre, mais plutôt d’un travail dur et ennuyeux. Cette image laissa dans mon âme une impression terrible et inoubliable.
Après un instant, nous fûmes au-delà et passâmes à côté d’une cuisine roulante autour de laquelle s’agglutinait une mer humaine vêtue de la façon la plus fantastique. Entre eux, des lycéens et divers volontaires circulaient et distribuaient du thé et du pain. Le point de ravitaillement fonctionnait à plein. Sur une grande place, des tentes étaient dressées et des feux vacillaient ; sur un hangar flottait le drapeau de la Croix-Rouge. C’était triste de voir ces gens dont encore tant devaient se retrouver sur les charrettes bâchées – et de là sur un cimetière anonyme dans une fosse commune anonyme.
Nous passâmes rapidement devant la gare et, après avoir renvoyé le fiacre, nous marchâmes vers le pont en essayant de nous faire remarquer le moins possible. Les autres n’étaient pas encore là ; Papa et moi fîmes tranquillement les cent pas et attendîmes. Devant nous, par le pont depuis Ataki, on transportait sur des brancards d’anciens prisonniers de guerre qui ne pouvaient plus faire un pas eux-mêmes. On dit que les Roumains ne leur mettent pas de véhicules à disposition et obligent ces malheureux à faire tout ce chemin à pied. Il est difficile de s’imaginer comment ils arrivent jusqu’à Moguilev et combien d’entre eux meurent en route.
Papa et moi commencions déjà à avoir froid, pendant notre attente il n’y avait pas de gel ; en fait il ne gelait pas, mais un fort vent soufflait et il faisait très froid. Enfin, les autres arrivèrent et aussi les bagages. Nous nous approchâmes du pont. C’était vers onze heures, et à partir de ce moment-là commença notre infortune.
Un petit groupe de gens se pressait déjà près du pont ; à notre approche, ils nous dirent qu’on ne laissait passer personne par le pont. Nous posâmes nos bagages à terre et attendîmes ; Boba partit étudier la situation. Nous attendîmes assez longtemps puis nous prîmes nos bagages et allâmes sur le pont. La foule nous suivit : des juifs gelés, quelques lycéens et lycéennes. Quelques soldats de la Zagin se précipitèrent derrière nous en criant. Puis ils acceptèrent de nous laisser passer, mais voulurent garder nos affaires. Une corbeille que nos valets Grigori et Danilo portaient leur déplut particulièrement. Ils voulurent la fouiller, mais, après avoir reçu de Papa un salaire – dix roubles, ensuite le montant augmenta de jour en jour -, ils nous laissèrent en paix.
Au milieu du pont se trouve une glissière, la frontière entre l’Ukraine et la Roumanie. Là, nous tombâmes sur des soldats roumains. Ce sont d’autres gens : ils ne comprennent aucune langue, à part la leur ; ils sont d’une brutalité que je n’ai encore jamais vue et surpassent là même nos démocrates révolutionnaires.
Cela se passa mal pour nous sur le pont : nous attendîmes plus de trois heures avant qu’ils nous laissent passer ! Une fois on nous dit que c’était possible, puis on nous repoussa ! Finalement, nous fûmes si gelés et épuisés par cette attente que nous voulûmes rentrer chez nous. Ceci se passa après deux heures d’attente. Ce n’est qu’alors que Papa nous dit qu’il y avait dans la proclamation bolchevique un point dont nous ne savions encore rien ! On y dit que tous les propriétaires seront arrêtés et que leurs familles n’auront pas le droit de quitter la ville. Naturellement, Papa aurait été le premier arrêté. Il s’avéra que quelques minutes avant notre fuite deux juifs étaient venus trouver Papa, lui avaient montré la proclamation et l’avaient supplié de se cacher rapidement. [Je me souviens que j’entendis le son des voix directement sous ma fenêtre. C’est là que se trouvait la porte d’entrée. Je vis que Papa était debout sur les marches de l’entrée et qu’en bas, au pied du petit escalier, se trouvait le vieux juif Yankel que nous avions vu souvent à Bronitsa, un vénérable vieillard avec une grande barbe complètement blanche, vêtu d’une houppelande noire avec une calotte sur la tête. Il ressemblait à un patriarche ou à un prophète de l’Ancien Testament. Ils étaient très nerveux tous les deux. Je regrette de n’avoir compris que peu de chose de cette conversation ; cela sonnait à peu près ainsi : Votre Altesse, je vous en supplie, ne perdez pas une minute ! Vous et votre famille êtes en danger de mort ! Croyez-moi, à l’instant ! On vous recherche ! Je ne me souviens pas de la réponse de Papa, il parla à voix basse, peut-être pour ne pas nous effrayer. Je me retirai de la fenêtre en silence ; j’eus l’impression d’avoir surpris un secret. Cela me fut désagréable et j’en eus honte. – Complément de l’auteur, 1982.]
Après avoir entendu ce passage, il n’était plus possible de songer à un retour. Nous restâmes sur le pont et attendîmes encore. Il faisait terriblement froid. Sans arrêt, on transportait devant nous des prisonniers de guerre mourants sur des civières. Le temps était gris, les nuages bas. Comme je me tenais assise là, sur ma valise sur ce pont, transpercée par un vent glacial, je ressentis clairement pour la première fois que je n’avais pas de maison où me cacher, pas de toit sur ma tête. Ce fut une pensée accablante. Tatiana, Olga, André et même Maman faisaient les cent pas sur le pont pour essayer de se réchauffer, moi seule ne pouvais me résoudre à m’éloigner de ma place. Mon âme était lourde, le froid m’engourdissait. Le temps s’écoulait terriblement lentement. Finalement je devins tellement apathique que tout m’indifférait. À nos pieds, très bas, entre les piliers du pont, le Dniestr roulait, froid, puissant, vert. L’eau avait un certain effet apaisant sur les nerfs.
Enfin, un mouvement se fit sur le pont. Un petit soldat roumain, qui parlait allemand et qui, dans l’attente d’un pot-de-vin, était avec nous un peu plus aimable, vint vers nous pour un instant et nous dit que le commandant du pont était arrivé. Tout le monde reprit un peu espoir. Le commandant, un homme très peu intelligent avec un uniforme d’un bleu clair grotesque, avait une dame à son bras. Il l’amena jusqu’à la glissière qui faisait office de frontière, lui baisa galamment la main et se tourna vers nous. Maman s’adressa à lui en français et lui expliqua notre situation : nous devons traverser le pont, nous attendons depuis trois heures, nous sommes complètement glacés et ainsi de suite. Il commença à faire des simagrées et dit que la frontière était fermée, qu’il était impossible de la franchir ; finalement, il s’écria avec un geste tragique en levant les bras au ciel : Eh bien, pour vous, madame, je ferme les yeux !
À ce moment-là, Tatiana commença à parler italien avec l’un des soldats roumains – la langue roumaine a un son très voisin. Le commandant fit un bond et un flot d’italien jaillit de sa bouche : il raconta qu’il avait étudié en Italie, combien il aimait l’Italie, et nous questionna sur ce pays. La glace était rompue. Accompagnés par son bavardage, nous traversâmes le pont, libérâmes les domestiques et respirâmes profondément. Comme nous nous installions dans un fiacre, Lissner, Krassowski et le directeur de la fabrique de Benditchany traversaient également le pont : Bonsoir, mon Prince, nous voici donc à l’étranger, s’écria Krassowski. Immédiatement nous nous sentîmes mieux. En riant, nous nous saluâmes. Maintenant, avec la compagnie d’autrui, toute cette aventure nous apparut plutôt comme un événement divertissant qui allait durer au maximum deux à trois jours.
Krassowski raconta qu’il avait été informé de l’existence d’une liste d’après laquelle Papa, lui-même et Lissner auraient dû être arrêtés aujourd’hui. Nous rîmes du plan avorté des camarades et partîmes à la recherche d’un appartement. Nous allâmes directement chez le prêtre du lieu, lui exposâmes notre situation et lui demandâmes l’hospitalité pour un jour. Là, on nous accueillit de façon inattendue : on nous permit de nous réchauffer, on nous pria de rester et en outre on nous donna un repas copieux et une chambre pour passer la nuit. Nous fûmes très touchés par la bonté du prêtre et de sa femme. Nous passâmes chez eux le reste de la journée ; entre-temps, Papa et Boba trouvèrent chez le notaire un appartement, le meilleur d’Ataki. Krassowski loua lui aussi trois pièces minuscules, Lissner disparut.
Le soir, nous eûmes du mal à parvenir jusqu’à la maison du notaire. Ataki n’est pas éclairée du tout, les rues ne sont pas pavées. Dans une profonde obscurité et à travers une saleté indescriptible, nous atteignîmes notre but. Là aussi on nous accueillit avec la plus grande amabilité; la maîtresse de maison nous céda même sa chambre à coucher parce que la chambre à nous destinée n’était pas chauffée. Nous nous installâmes sur les lits incommodes, Olga dut se coucher par terre sur un matelas. La nouvelle aventure révolutionnaire cessa d’être amusante ; maintenant chacun n’avait plus qu’une pensée : rentrer le plus rapidement possible à Moguilev. Papa et André s’installèrent chez le prêtre, Oba dans une des pièces de Krassowski. Ce fut le premier jour de notre fuite.
Catherine Sayne Wittgenstein. La fin de ma Russie. Journal 1914-1918. Phébus. Libretto
9 11 1918
L’empereur Guillaume II abdique. Le lendemain, la République est proclamée par Philipp Scheidemann et un nouveau gouvernement constitué avec Ebert comme chancelier en remplacement de Max de Bade, à forte connotation révolutionnaire : il se nomme Conseil des commissaires du peuple, composé de trois socialistes majoritaires et de trois socialistes indépendants, le tout approuvé par les Conseils d’ouvriers et de soldats berlinois. Plus à gauche, le leader du mouvement révolutionnaire Karl Liebknecht proclamait une république socialiste. Les conseils d’ouvriers et de soldats gagnent Metz, Mulhouse, puis Strasbourg, Colmar le lendemain. Un conseil national d’Alsace Lorraine – Nationalrat – est constitué , soutenu par la grande majorité de la population. Le drapeau rouge est hissé au clocher de la cathédrale de Strasbourg : il faudra attendre le 21 novembre pour qu’il soit remplacé par le drapeau tricolore. Ce grand bouleversement dans le gouvernement de l’Allemagne sera mis à profit par le haut commandement allemand pour ne pas se sentir obligé d’avouer et de signer la défaite des armées allemandes, et, plus tard, la responsabilité de la défaite sera imputée au coup de poignard dans le dos qu’avait été l’infiltration révolutionnaire, mise en œuvre par Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Ce soupçon de trahison restera une plaie sur le corps de la nouvelle République, dont elle ne parviendra jamais à se laver complètement.
La première image, tremblante, qui anima l’écran, fût celle d’une plaque connue de tous les Strasbourgeois, Rue du 22 Novembre, puis un long travelling filmé depuis une portière de voiture remonta la voie jusqu’à la place Kléber, accompagnant un homme de soixante-dix ans, habillé d’un uniforme d’un cadet de la marine impériale allemande. Une voix off s’interrogeait d’abord sur l’étrangeté de la date portée dans le bleu de la plaque émaillée, les villes de France célébrant ordinairement l’Armistice, le 11 du même mois de 1918, puis le vieil homme se tournait vers la caméra pour expliquer que, le 9 novembre, plusieurs milliers de soldats allemands venus de Kehl, des marins mutinés pour la plupart, s’étaient rassemblés sur la place Kléber pour y dégrader des dizaines d’officiers et proclament la création du Conseil des Soviets de Strasbourg ! Une partie de la population et des paysans des campagnes environnantes fraternisent avec ceux qui ont planté des drapeaux rouges jusque sur la flèche de la cathédrale. La même fièvre s’empara de toutes les villes des deux provinces annexées en 1870 : Mulhouse, Haguenau, Sélestat, Sarrebruck, Forbach. À Colmar, on bafoue l’autorité du futur maréchal Rommel qui doit composer avec un soviet de soldats. À Metz, on ne trouve pas de drapeau écarlate, et c’est la communauté turque qui prête son emblème, masquant le croissant à l’aide d’une couche de minium. À Thionville, c’est un acteur qui dirige un conseil, un aumônier à Sarrebourg, un pasteur à Neuf-Brisach. Les mines et les usines comme De Wendel sont occupées, on y instaure des conseils de travailleurs qui décident d’augmentation de salaires, de droits syndicaux, d’autogestion. Le 22 novembre 1918, les régiments bretons font leur entrée dans Strasbourg, libérant la ville non des troupes d’un empire allemand évanoui, mais des éphémères soviets de soldats, d’ouvriers et de paysans.
Didier Daeninckx. Mort au premier Tour. Denoël 1997
Pour Guillaume II, alors déposé, il dira bien clairement dans ses Mémoires que le premier responsable de la victoire des Alliés, ce ne sont ni les Américains, ni les chars d’assaut ni les camions français, c’est Clemenceau : La cause principale de la défaite allemande ? Clemenceau. […] Non, ce ne fut pas l’entrée en guerre de l’Amérique, avec ses immenses renforts […] Aucun de ces éléments ne compta auprès de l’indomptable petit vieillard qui était à la tête du gouvernement français. […] Si nous avions eu un Clemenceau, nous n’aurions pas perdu la guerre.
*****
Si nous avons pu tenir de 1914 à 1918, c’est grâce à Clemenceau. Il a été président du Conseil dans le moment le plus difficile. Il a dû faire face à la paix de Brest-Litovsk en 1917 et à l’ultime offensive allemande en 1918, ce moment dramatique où les troupes d’élite allemandes sont revenues en force à l’ouest jusqu’aux portes de Paris. À l’époque, les Américains n’étaient pas assez nombreux. Clemenceau, c’est l’énergie qui tient la France à un moment où celle-ci n’a plus son allié russe et n’a pas encore son allié américain.
Jean-Pierre Chevènement. Le Monde hors série : 14-18, les leçons d’une guerre
Mort de Guillaume Apollinaire, polonais d’origine : gravement blessé au front, il est emporté par la grippe espagnole. Du 6 octobre au 9 novembre, la grippe aura emporté 210 personnes par jour à Paris. Ses obsèques, suivies par Blaise Cendrars, Picasso, Max Jacob, Fernand Léger… auront lieu le 13, au milieu des vivats de la foule célébrant l’armistice… Arrivés en retard au Père Lachaise, Cendrars et Fernand Léger ne purent savoir où était sa tombe : vous comprenez, leur dit un fossoyeur, avec la grippe, avec la guerre, on ne nous dit pas le nom des morts que nous descendons dans le trou. Il y en a trop. Adressez-vous à l’administration. On n’a pas le temps. On est fourbus. Mais, dit Cendrars, c’est un lieutenant, le lieutenant Guillaume Apollinaire ou Kostrowitzky. On a du tirer une salve sur sa tombe. Mon pauvre monsieur, on a tiré deux salves. Ce sont deux lieutenants. Nous, on ne sait pas lequel vous cherchez. Regardez vous-mêmes ! La grippe va emporter aussi Edmond Rostand un mois plus tard.
___________________________________________________________________________________________
[1] Si l’on parle couramment de révolution d’octobre, c’est que l’on garde pour cette célébration le calendrier Julien, en vigueur en Russie jusqu’en 1918, en retard de treize jours sur notre calendrier grégorien.
[2] Les Parisiens le nommeront La grosse Bertha : les usines Bertha Krupp ont adapté trois obusiers de marine de trente mètres de long au combat terrestre.
Il s’agit du surnom donné à une pièce d’artillerie allemande (de son vrai nom 42-cm Kurze Marine-Kanone 12) utilisée lors de la Première Guerre mondiale. Ce canon faisait 10 mètres de long et pesait 42,6 tonnes.
La Grosse Bertha pouvait envoyer des obus de 800 kilos à plus de 9 kilomètres. Son surnom est née en Allemagne (on y évoquait la Dicke Bertha) et lui vient de Bertha Krupp, fille unique et héritière de Friedrich Alfred Krupp, fondateur du groupe Krupp, un géant de l’acier qui existe encore, au sein de l’actuel groupe ThyssenKrupp.
Le terme a été popularisé en France lors de la Grande Guerre, car cette arme construite en masse donna un avantage considérable aux troupes allemandes. Le fort de Manonviller, en Lorraine, a été dévasté par 59 tirs en une seule journée.
Mais la célébrité de la Grosse Bertha vient du bombardement de Paris, en 1918. Sauf que… il s’agit d’une confusion. Aucune n’a servi lors de cette opération. Il s’agissait de canons longs , des Ferngeschütz, également appelés par les Allemands Pariser Kanonen, les canons de Paris. Ils faisaient 21 mètres de long pour un poids de 750 tonnes et propulsaient des obus de plus de 100 kilos à plus de 125 kilomètres de distance. des capacités hors normes qui correspondaient davantage à l’image que les Parisiens se faisaient d’une Grosse Bertha. Ces canons ont terrorisé les Français, mais ils n’ont envoyé que 367 obus en près de six mois, faisant 256 morts. Mais, en raison de leur portée, ils ont amené la guerre dans la capitale, alors que le front était à plus de 100 kilomètres.
Journal Du Dimanche du 19 mars 2023