| Publié par (l.peltier) le 10 septembre 2008 | En savoir plus |
8 01 1934
À Chamonix, Alexandre Stavisky, grand escroc devant l’Éternel, pathologiquement fainéant comme tous les voyous mais beaucoup plus malin que la moyenne d’entre eux, se suicide d’une balle tirée à trois mètres. Voilà ce que c’est d’avoir le bras long ( il a été atteint à la tempe droite quand c’est à la main gauche que l’on a trouvé le pistolet ! ) – dixit le Canard Enchaîné. Le lascar, qui avait essentiellement escroqué des crédits municipaux – les fameux chez ma tante – en leur fourguant des faux bijoux acceptés comme des vrais, avait des appuis : il avait été remis 19 fois en liberté provisoire par le procureur de la République Pessard, beau-frère de Chautemps, président du conseil ! Le conseiller à la cour d’appel de Paris, Albert Prince, qui transportait ces preuves, tomba malencontreusement du train en se trompant de porte à la Combe aux fées le 21 février.
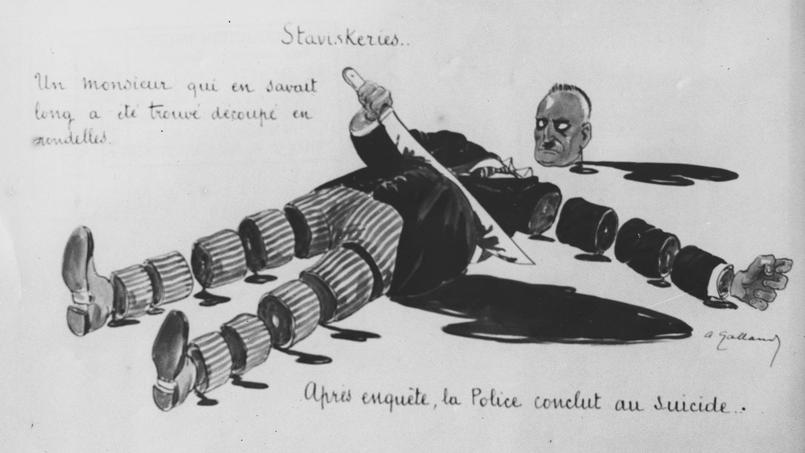
17 01 1934
Le Jakob Ruppert, le bateau de l’amiral Byrd mouille dans la baie des baleines, en Antarctique. La logistique comprend trois Citroën : André Citroën avait reçu en septembre 1933 un courrier de Vincent Bendix (qui donna son nom à un élément du démarreur), l’informant des projets de l’amiral Byrd en Antarctique. Vincent Bendix connaît les Citroën à chenille de la Croisière Jaune et de la Croisière Noire et propose à André Citroën d’en offrir une à Byrd, étant donné l’importance des retombées publicitaires d’une telle expédition. André Citroën accepte, et envoie même deux véhicules, plus puissants d’ailleurs que ceux des deux croisières, avec moteurs de rechange ; les deux véhicules sont peints aux couleurs Citroën : rouge et bandes jaunes. Peu avant le départ, Byrd demande un troisième véhicule… et va pour un troisième véhicule. Les trois véhicules vont participer au débarquement entre la côte et la base la Petite Amérique. Pendant trois semaines, ils vont parcourir 11 000 km. Vu leur bon comportement, Byrd va les utiliser pour l’approvisionnement de sa base avancée, puis de sa base de dépôts sur la Terre de Mary Byrd. Les crevasses seront leur plus gros problème. L’une d’elles brûlera. Les deux autres resteront opérationnelles jusqu’à la fin de l’expédition. En août 1934 un télégramme est reçu à Paris : Vos tracteurs font date dans l’histoire de l’Antarctique ; leur dernier succès a été de traverser 275 miles par des températures de -20 à -70°degrés. Byrd
Malgré les appels d’André Citroën, il n’y aura plus aucun échange de courrier.
Nous vous demandons quand et comment vous envisagez le retour en France des voitures qui ont été mises à votre disposition.
Nous vous serions particulièrement reconnaissants si vous nous faisiez parvenir au moins une de ces machines, afin que nous puissions vérifier, comme nous vous le disions dans notre lettre précitée, la tenue des différents organes, après le dur travail qu’ils ont fourni.
André Citroën.
Il n’y aura jamais de réponse, pas de publicité, pas de film, aucun remerciement. Vous avez dit amiral ? Tout juste pirate !
26 01 1934
À Moscou s’ouvre le XVII° congrès du parti communiste. Sergueïev Mironovitch Kostrikov, alias Kirov, est à la tête du parti de Leningrad. Il est entré au politburo en 1930 ; c’est l’un des rares amis de Staline. Le congrès compte 1 966 délégués et, aux élections des membres du Comité Central, c’est Staline qui a obtenu le moins de voix, 266 délégués ayant voté contre lui. Kirov, lui, a fait quasiment l’unanimité – seulement trois voix contre lui -. Staline n’est élu que parce le nombre de postes à pouvoir est égal au nombre de candidats ! Mais il n’oubliera pas l’affront : Kirov sera assassiné sur son ordre le 1° décembre suivant par Leonid Nikolaev quand il arrivait à l’Institut Smolny, où se trouvait son bureau ; sur les 1 966 délégués au XVII° congrès, 1 108 seront exécutés au cours des années suivantes. Le procès des Seize va éliminer Kamenev et Zinoviev.
01 1934
Rudolf Roessler, né en Bavière, donc allemand, s’est réfugié en Suisse à l’arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne. Il ouvre à Lucerne la librairie maison d’édition Vita Nova, où il va accumuler quantité de coupures de presse sur la vie politique en Allemagne et encore des informations transmises par ses amis restés en Allemagne. C’est ainsi qu’il annonce avec un mois d’avance l’occupation de la Rhénanie par la Wehrmacht qui aura lieu le 7 mars 1936. Xavier Schnieper, diffuseur de la revue suisse Entscheidung (Décision), et d’autres catholiques de gauche, le mettent en contact avec le major Hans Hausamann, qui dirige un réseau de renseignement qui travaille pour l’armée suisse : le Bureau Ha. Roessler, à qui les services suisses attribuent le nom de code Ligne Viking lui transmettra 4 000 télégrammes d’informations, soit l’équivalent de 12 000 pages dactylographiées. Le 13 octobre 1939, Roessler indique au Bureau Ha que l’offensive allemande contre la Belgique et la Hollande aura lieu le 12 novembre. L’offensive est ajournée à plusieurs reprises ; Roessler informe les services suisses de chaque ajournement et indique le 1° mai 1940 que l’offensive aura lieu dix jours plus tard. Le 8 mars 1940, Roessler communique au Bureau Ha les plans d’Hitler pour attaquer le Danemark et la Norvège. Les autorités suisses transmettent ces informations aux gouvernements danois et norvégiens, qui n’en tiennent pas compte, alors qu’elles sont corroborées par d’autres sources. L’offensive allemande aura lieu le 9 avril.
Au printemps 1941, Roessler est mis en contact par Christian Schneider (alias Taylor) avec l’espionne soviétique Rachel Dübendorfer (nom de code Sissy), qui travaille pour Alexandre Radó (pseudonyme Dora), le chef de l’antenne des services secrets soviétiques (le GRU) à Genève. Radó nommera Roessler Lucy. Contre rémunération, il commence à fournir à Sissy (exclusivement par l’intermédiaire de Taylor) des renseignements sur la logistique et la stratégie de la Wehrmacht en URSS. Il dit obtenir ces renseignements de quatre sources, qui resteront inconnues mais il s’agissait probablement d’officiers supérieurs de la Wehrmacht.
Lucy, qui ne communique avec Sissy que par l’intermédiaire de Christian Schneider, fournit tellement de renseignements que leur codage et leur transmission à Moscou occupe presque 24 heures par jour les opérateurs des 3 puissants émetteurs TSF appelés Rote Drei, les 3 Rouges par les services de contre-espionnage allemands qui, au nord de la frontière germano-helvète, voient et écoutent passer leur trafic.
L’un des renseignements les plus précieux fournis par Lucy aux services du GRU alors dirigé par Fiodor Fedotovich Kouznetsov : la préparation par les Allemands de l’opération Citadelle, – la bataille de Koursk – dont le déclenchement est prévu pour début juillet 1943. Prévenue, l’Armée rouge pourra organiser sa résistance, et même contre-attaquer vers Orel et Kharkov. Les plans et détails techniques du char Panzekampfwagen V Panther, apparu lors de l’opération Citadelle, ont aussi fait partie des livraisons de Lucy aux Soviétiques.
Il aurait ainsi apporté aux Soviétiques les informations recueillies par les services secrets britanniques, qui avaient cassé le code secret allemand grâce à Ultra mais ne voulaient pas le faire savoir. Par ailleurs, les Alliés pensaient que Staline accorderait plus de confiance à des renseignements obtenus par une voie mystérieuse et en payant cher : celui-ci avait en juin 1941, avant l’entrée en guerre de l’Allemagne contre l’URSS, refusé de croire les nombreux avertissements le prévenant de l’imminence de l’opération Barbarossa.
Pressé par les Allemands, le gouvernement suisse arrêtera Roessler et l’enverra en prison pour deux ans, à l’issue desquels il s’installera à Kriens près de Lucerne, jusqu’à la fin de ses jours en 1958.
Résumé de Wikipedia
6 02 1934
Le cabinet Chautemps a démissionné le 27 janvier, remplacé par Daladier. Sur fond d’affaire Stavisky et du limogeage par Daladier du préfet de police Jean Chiappe, très en cours auprès des Ligues, des milliers de manifestants convergent vers la Concorde : Daladier se présente à l’investiture des députés. Communistes, membres d’associations d’Anciens Combattants, Ligues de droite, provoquent une nuit d’émeutes à Paris : 19 morts, 1 435 blessés : plus que de rasoirs coupe jarrets, on y fit grandement usage de billes sur lesquelles chutaient les chevaux des policiers. Les conséquences en firent une journée de dupes : Daladier va renoncer au pouvoir et trois politiciens chevronnés y reviennent : l’ancien président de la république Doumergue, – Gastounet – le radical Herriot et le conservateur Tardieu ; trois non parlementaires les accompagnent : parmi eux, le maréchal Pétain comme ministre de la guerre, qui déclare quelques jours plus tard : Je viens de découvrir la politique. C’est bien amusant. Il devait croire encore que l’armée française était la meilleure du monde puisqu’il ne jugera pas utile de dépenser la totalité du budget du ministère de la Guerre pour l’année en cours. Il avait ses marottes : en plus de la Guerre, il avait demandé – il ne l’eût pas – la tutelle sur l’Éducation Nationale, avec un programme limpide : Je m’occuperai des instituteurs communistes. À la fin de l’année, il s’exprimera dans la Revue des deux mondes : Avant de se jouer sur un champ de bataille, les destinées d’un peuple s’élaborent sur les bancs de la classe et de l’amphithéâtre. L’instituteur, le professeur, l’officier participent à la même tâche, ont à s’inspirer des mêmes traditions et des mêmes vertus.
Le gouvernement Doumergue tombera en novembre 1934 et l’opinion se montrera de plus en plus favorable au maréchal Pétain. Gustave Hervé, directeur de La Victoire, titrera un article en février 1935, C’est Pétain qu’il nous faut. En avril 1935, Léon Daudet écrira dans l’Action Française : Le véritable Président du Conseil, à l’heure actuelle devrait être le maréchal Pétain, avec les pleins pouvoirs. Le 1° juin 1935, Pétain acceptera un poste de ministre d’État dans le ministère Fernand Buisson, qui réclamera des pouvoirs exceptionnels pour résoudre la crise, mais tombera le jour même.
12 02 1934
La réponse du berger à la bergère, ou en moins bucolique, de la Gauche à la Droite ne se fera pas tout à fait comme prévue par les chefs, mais se fera : Le 9 février, le PCF et la CGTU avaient organisé un grand rassemblement place de la République, contre le fascisme et pour dénoncer les ambiguïtés du gouvernement. La SFIO préfère, elle, relayer par une manifestation l’appel de la CGT à la grève générale pour le 12 février.
Ce jour là, le PCF décide de se joindre à la manifestation et il place des groupes et des orateurs tout le long du cortège, espérant attirer à lui les militants socialistes. Mais c’est un tout autre scénario qui va s’imposer. Le peuple de gauche a d’autres priorités que la préoccupation des dirigeants des partis d’exercer le rapport de forces. Il a sans doute une conscience plus aigue du danger et de la nécessité d’imposer une autre politique. On voit alors la base communiste se joindre au cortège socialiste et, aux cris de Unité ! Unité ! , les militants des deux partis défilent côte à côte.
C’est donc un mouvement populaire puissant qui s’impose, contre la volonté des états-majors et des dirigeants des deux grands partis, malgré les ressentiments profonds qui se sont accumulés depuis près de 15 ans entre socialistes et communistes et malgré de réels désaccords idéologiques et politiques. La manifestation unitaire du 12 février 1934 préparera les esprits à l’idée du rassemblement de la gauche, des partis et, bien au-delà, des associations, des syndicats, de personnalités et d’intellectuels. C’est ainsi que le terme de Front populaire prendra tout son sens.
Médiapart
Nous briserons la serrure et la clé
Et encore la porte
Et tout sera simple et facile
Et si nous ne réalisons pas ces projets
D’autres hommes dans les années futures les réaliseront
Robert Desnos, février 1936
13 02 1934
Dans l’été 1932, le brise-glace Sibiriakov, avec pour chef d’expédition Otto Schmidt et pour capitaine V.I. Voronine avait réussi à relier Mourmansk à Vladivostok en une seule saison. Fort de ce succès, Schmidt et Voronine souhaitaient démontrer qu’un navire classique (non brise-glace) pouvait effectuer le même trajet, dans le même temps. Il n’est pas inutile de situer le contexte historique de cette époque : il aide à comprendre que tout cela n’était pas qu’un challenge pour la beauté du geste. En 1879, il s’en était fallu de 24 heures pour que le baron suédois Adolf Erik Nordenskjöld franchisse le passage du nord-est d’une seule traite, en profitant des 70 jours d’eau libre qu’offrait alors l’océan arctique ; à deux jours de navigation du détroit de Behring, il avait dû hiberner pendant 294 jours.
Vingt six ans plus tard, le 27 mai 1905, la marine russe avait subi de la part des Japonais une cuisante défaite : 36 navires envoyés par le fond, 5 000 marins et officiers tués, 6 000 prisonniers ; l’humiliation russe avait été immense. Et, pour rejoindre les eaux du Pacifique, cette flotte avait fait route par le Cap : huit mois de voyage. Cette route du nord-est fait moins de 10 000 km, qui peut être faite en moins de 70 jours ; comparée au huit mois en passant par le Cap ou même aux 19 000 km en passant par Suez, il n’y a pas photo. Donc, si les Russes continuaient à vouloir envoyer une flotte de guerre sur le Pacifique, il fallait absolument réaliser cela d’une traite, sans hivernage, c’est-à-dire en moins de 70 jours.
Parti de Mourmansk le 2 août 1933, avec 102 personnes à bord – 90 hommes, 10 femmes et 2 enfants -, le Tchéliouskine [dont les tôles avaient tout de même été renforcées sans pour cela devenir un brise-glace] avait rencontré des conditions plus difficiles que l’année précédente, mais réussi néanmoins à gagner la mer des Tchouktches, à quelques encablures du détroit de Béring. Là, cerné par une banquise compacte, le navire n’était plus libre de ses mouvements et avait commencé à dériver en larges boucles, à l’est de l’île Wrangell. Au cours d’une des boucles, le bateau avait même atteint le détroit de Béring et, à bord, on s’était mis à espérer une délivrance prochaine, mais le mouvement de la banquise l’avait renvoyé dans l’océan Arctique. En décembre 1933, le chef d’expédition avait ordonné un débarquement des vivres et des équipements sur la banquise, mais des crevasses s’étaient ouvertes tout autour du site et il avait fallu tout rembarquer rapidement.
Le 13 février 1934, par 68°16’ Nord, et 174° Ouest, à 170 km de la côte de Sibérie, et à proximité de l’île Kolyuchin [67°28’N, 174°37’ O] par une température de -30°, une crête de pression particulièrement grosse, [nom donné à une vague de glace] assaille le Tchéliouskine qui coule en une demi-heure, emportant avec lui le quartier-maître qui tentait, jusqu’au dernier moment de récupérer quelques denrées. Le chef d’expédition Otto Schmidt et le capitaine Vladimir Voronine ont ordonné l’évacuation immédiate et le sauvetage des approvisionnements. Les naufragés s’installent sur la glace dans l’attente de secours, y construisant des abris de fortune. Un poste de TSF a pu être sauvé et permet d’envoyer des appels de détresse à la base d’aviation du cap Vellen [le cap ouest du détroit de Behring]. Un secours par voie de mer était exclu : la glace était trop épaisse pour les brise-glaces de l’époque.
À l’aide de quelques pelles et de deux pieds de biche, ils aplanissent une piste d’atterrissage de 450 m x 150 m qu’ils vont reconstruire treize fois. Le 5 mars, par un froid de – 40°, un bi-moteur ANT-4 piloté par Anatoly Vasilyevitch Liapidevski, se pose, leur laisse de la viande fraîche de renne, excellent remède contre le scorbut et repart avec les 10 femmes et les 2 enfants. Le 7 mars, leur morceau de banquise se coupe en deux, engloutissant la cuisine. La radio, toujours en service, permet de joindre la station du cap Vellen et un avion, dans l’impossibilité de se poser, va leur larguer des vivres. Au cours du deuxième vol, le pilote doit faire un atterrissage de fortune sur la glace après qu’un de ses moteurs ait pris feu et il endommage l’appareil. Les Américains mettent alors à la disposition des russes deux avions et leur mécanicien, que pilotent Nikolaï Kamanine et Vasili Molokof. Un atterrissage en plein brouillard a raison du premier ; le second parvient à atterrir sur camp Schmidt le 7 avril, mais finit dans les blocs de glace en fin de piste et casse son train d’atterrissage. Il ne pourra redécoller que cinq jours plus tard, emmenant 5 hommes. Des cinq monomoteurs biplace russes partis de Vladivostok, seuls deux arrivent sur la zone. Ce même 7 avril ils réussissent à se poser sur camp Schmidt, l’un d’eux abîmant légèrement son train, vite réparé par les mécanos du camp. Ils ne peuvent malheureusement évacuer que trois naufragés chacun. Les jours suivants il fait mauvais et le 9 avril, la piste se coupe en deux. Il faut en bâtir une autre. Enfin les 10 et 11 avril, les deux monomoteurs russes effectuent 13 rotations, évacuant jusqu’à 6 personnes à la fois : certains voyagent dans les cylindres à parachute attachés sous les ailes.
Au prix d’un peu de casse, c’est un véritable exploit que les soviétiques viennent de réaliser dans une des régions les plus hostiles de la planète. Les pilotes et le deux mécaniciens américains reçoivent l’Ordre de Lénine et sont faits héros de l’Union Soviétique par Staline ; l’aviation a prouvé toute son utilité pour assurer la sécurité et le déploiement des futures missions polaires. Les opérations de sauvetage avaient été retransmises pratiquement en direct par les radios Soviétiques et diffusées par haut-parleurs dans les squares, les bureaux et les usines. Leur déplacement à travers l’URSS donna lieu aux premières ticket-parades Soviétiques. Il fallu attendre 2006 pour que l’on retrouve l’épave du Tcheliouskine par 50 mètres de fond.



Le Polikarpov R-5 piloté par Vasili Molokov, a transporté des hommes sous ses ailes
17 02 1934
Albert I°, roi des Belges escalade un rocher à Marches les Dames, dans la vallée de la Meuse près de Namur… c’est la chute… mortelle. Quatre ans plus tôt, le 29 août 1930, il avait inauguré le refuge du glacier du Tour, dans le massif du Mont Blanc, qui portait son nom, construit par le Club Alpin Belge et offert au Club Alpin Français.
Il est un héros sans le désirer, sans chercher à le devenir ; il est le héros le plus grand et le plus sympathique de tout le vingtième siècle. Il est le roi-chevalier.
Vicente Blasco Ibáñez
Lui-même ne goûtait pas trop ce roi chevalier, et l’histoire se mettra à ses cotés pour le nommer de préférence le roi soldat. Il laisse une veuve Elisabeth, la reine infirmière, plus tard, la reine démocrate, qui lui survivra plus de 30 ans.
Vénérée Reine
Il ne m’est pas arrivé souvent d’être bouleversé comme je le fus après la nouvelle du coup si lourd qui a subitement ruiné votre harmonieuse existence […] Je sais ce qu’éprouvent ceux qui voient l’objet de leur amour appartenir irrévocablement au passé. Mais je sais aussi que pour les êtres forts, dont vous êtes […] se consacrer aux arts emplit d’une douceur qui échappe dans une certaine mesure, à la brutalité des coups que porte l’aveugle destin.
Albert Einstein
Adulée de son peuple, on lui connaissait des idées avancées, parfois opposées aux principes monarchiques… mais de là à découvrir le contenu de ses carnets, aux mains de sa petite fille Marie Gabrielle de Savoie et portés en 2014 à la connaissance de la presse, il y a de quoi faire un patatou : ainsi, on peut y lire au 21 août 1944 : Tout, tout sera détruit en Europe, pourvu que le nouvel esprit sorte des cendres, le communisme purifié. Elle ne marqua pas la moindre hésitation à rencontrer Tito, Khrouchtchev, Mao, Chou En lai… Mao … charmant, Chou En lai … beau, agréable et simple.
En 1961, le roi Baudouin, son petit-fils, s’inquiétera auprès d’elle de son projet de voyage en Chine communiste :
- Grand’mère, vous allez froisser bien des personnes
- Je sais. Les bien-pensants ne me le pardonneront pas. Mais, grâce à Dieu, ils sont de moins en moins nombreux.
Une reine communiste… comment, pourquoi ? Peut-on imaginer cela ? Sur ce chapitre au moins, elle sera loin d’être la seule à avoir eu tout faux.
10 04 1934
Hitler embarque à Wilhelmshaven sur le croiseur Deutschland. Va s’y jouer une partie décisive : le vieux maréchal Hindenburg a une santé déclinante et il est raisonnable d’envisager la suite. Hitler se voit bien assumer les deux fonctions ; mais le président du Reich est aussi le chef suprême de l’armée ; il lui faut donc avoir le soutien de l’armée, dominée par une élite d’officiers de grande qualité, très énervés par les trois millions de braillards de la SA, avec Ernst Röhm en tête, dont on lui rapporte les propos de plus en plus extrémistes. Il y a peu, Rudolf Diels, chef de la police de Berlin a fait évacuer d’une prison clandestine des SA des prisonniers torturés avec un sadisme inimaginable et l’affaire a fait grand bruit. Ernst Röhm devient de plus en plus une gêne, voire une menace.
À bord du navire se trouvent l’amiral Raeder, les généraux von Blomberg, ministre de la guerre et von Fritsch, chef de la Heeresleitung, section de perfectionnement de l’armée : le pacte est passé : l’armée donnera son appui à Hitler pour la succession de Hindenburg, mais Hitler mettra à la raison Röhm et les SA.
12 04 1934
Sur le Mont Washington, dans le New Hampshire, au nord de Boston, le vent souffle à 372 km/h : parmi les vitesses enregistrées par l’homme, c’est la plus grande connue. Le Mont Ventoux prend la seconde place, avec 320 km/h enregistré le 15 février 1967.
19 04 1934
Sortie en fanfare, sur le parterre de la Tour Eiffel, de la première Traction Citroën : 7 chevaux, traction avant, 3 vitesses au tableau de bord, 17 700 Fr, soit un peu moins de 10 000 €. On comptera 300 clients par jour. C’est André Lefèbvre, ingénieur licencié par Renault qui l’a conçue, et le carrossier italien Bertoni, dessiné.
Ton livre me plaît beaucoup jusqu’ici, me dit Lacy pendant que nous allions au club des officiers avec sa voiture, une Citroën noire et basse qu’il avait rapporté de France. C’était le célèbre modèle des années trente qu’on ne fait plus aujourd’hui, avec un long capot arrogant et des ailes évasées, la première que j’ai jamais vue et sans doute l’une des premières à apparaître en Amérique. Avec son allure française et sexy, elle détonnait parmi les Ford et les Oldsmobile de la base et elle avait suscité plus d’un regard soupçonneux.
William Styron. À tombeau ouvert Marriot le Marine. Gallimard 2011
[…] Les automobiles sont alors lourdes, carrées, hautes, difficiles à conduire. La Traction est tout le contraire. Citroën n’a inventé ni la transmission aux roues avant, ni la carrosserie autoporteuse en acier, ni la suspension par barres de torsion, ni les roues indépendantes, pas plus que le moteur flottant monté sur des supports en caoutchouc, les freins hydrauliques ou la direction à crémaillère. La firme est, en revanche, la première à concentrer toutes ces innovations sur un seul modèle.
L’innovation la plus marquante, ce sont les roues avant motrices (c’est une traction, en opposition à une propulsion, dont le moteur agit sur les roues arrière) qui induisent une répartition des masses plus équilibrée. Cela en allégeant l’arrière et en améliorant considérablement le comportement, surtout dans les courbes ou sur chaussée humide. Il suffit de conduire tour à tour une Traction et une Rosalie, le modèle qu’elle remplace, pour réaliser les progrès extraordinaires qu’introduit la Traction en matière de tenue de route, insiste Thierry Astier, rédacteur en chef de Chevronnés, le magazine des amateurs de Citroën anciennes.
Non seulement la voiture tient mieux le pavé, mais la disparition de l’arbre de transmission permet d’installer un plancher plat et de libérer de l’espace à l’arrière tout en abaissant le centre de gravité. Revers de la médaille : le très large diamètre de braquage ne facilite pas les manœuvres. La 7 CV – dont l’un des hardis slogans est remettons les bœufs avant la charrue – sera vite rebaptisée Traction.
Mais ce n’est pas seulement une voiture d’ingénieur. Son style, lui aussi, est différent. Aux arêtes, la carrosserie, surbaissée, préfère les courbes. À l’intérieur, l’instrumentation a été regroupée sur un élégant tableau de bord pourvu d’une petite montre, sur lequel a été implanté le levier de vitesses. En option, il est même possible d’installer un poste de TSF.
Voiture aux 100 brevets, la nouvelle Citroën a nécessité de gros investissements (l’usine du quai de Javel, à Paris, a été rénovée à grands frais pour rivaliser avec celle, toute proche, de Billancourt, édifiée par le grand rival Louis Renault), qui ont miné les finances d’une entreprise endettée dont le patron n’est pas un modèle de rigueur gestionnaire.
En décembre 1934, quelques mois après le début de la commercialisation de la Traction, le dépôt de bilan est prononcé faute du soutien des banques. André Citroën, qui mourra en juillet 1935, doit céder le contrôle de l’entreprise à Michelin. Le nouvel actionnaire considère avec circonspection le nouveau modèle, dont la courte période de gestation (dix-huit mois) se paie par de multiples et agaçants défauts de jeunesse. N’en déplaise aux apparences, la maison de Clermont-Ferrand comprend vite que la Traction est une voiture bien née, mais il faudra moult ajustements techniques pour assurer sa fiabilité.
La 11-Légère du gang des Tractions, qui sème la police lancée à ses trousses, et la 15-Six de 1938, plus longue et plus puissante, vont écrire l’histoire d’un modèle dont la carrière durera vingt-trois ans et qui fera la gloire posthume d’André Citroën. Les autres constructeurs finiront par adopter la traction aux roues avant (Renault et Peugeot ne s’y résoudront que dans les années 1960) et décideront eux aussi d’alléger et d’abaisser leurs véhicules.
Après la Libération, la Traction renoue avec le succès. Elle accueillera une nouvelle malle arrière en 1952, se dote sur le tard d’une suspension hydropneumatique, et les présidents de la République commandent des voitures d’apparat réalisées sur son châssis. La production cesse en 1957 pour laisser place à un autre mythe, la DS 19. […]
Jean-Michel Normand. Le Monde 13 juin 2014

Et, à côté de cette 11 qui va vite devenir légende, il en est une autre, modèle de luxe, plus grande, plus puissante, qui va rester à l’état de prototype… – une vingtaine d’exemplaires -, tous aujourd’hui disparus… la Traction 22. Alors déjà aux mains de Michelin, ce dernier ne voulut pas consacrer trop d’argent à la difficile mise au point d’un moteur 8 cylindres. On peut en voir une en service au 23 juillet 1945 de ce site dans la video INA : Le procès Pétain -.




vous me voyez noire, mais je suis rouge
28 04 1934
Romain Rolland, 68 ans, épouse en seconde noces – il avait été marié de 1892 à 1901 à Clotilde Bréal – Maria Koudacheva, russe que d’aucuns disent espionne de Staline, d’autres simplement femme d’influence, à même de peser sur les orientations d’un mari, [classé par Lénine dans la catégorie des idiots utiles]. Si, en 1917, il avait refusé une invitation de Lénine à l’accompagner dans son retour en Russie, en 1935, il acceptera une invitation de Gorki à se rendre en Russie, où il rencontrera Staline le 25 juin, se faisant ainsi le représentant officieux des intellectuels français communistes, même s’il n’était pas encarté : on trouve le compte-rendu de l’entretien, bel étalage de langue de bois, sur http://classiques.chez-alice.fr/staline/rolland.pdf
23 05 1934
C’est la fin pour Bonnie and Clyde. La police n’était pas à court de munitions, c’est le moins qu’on puisse dire.

31 05 1934
Maurice Wilson, un Anglais beaucoup plus excentrique et original que la moyenne de ses compatriotes, – c’est peu dire -, meurt à 6 920 m d’altitude, sur les pentes nord de l’Everest, dont l’accès passe par le monastère de Rongbuk : il n’avait aucune expérience de la montagne et voulait aller sur le toit du monde tout seul ! Il lui fallait un sacré pet au casque … Découvre-t-il une paire de crampons d’une expédition précédente, il les regarde et les laisse… il en ignorait probablement l’usage ! En 1935, Eric Shipton découvrira son corps au pied du col Nord, entouré des restes d’une tente déchirée par le vent ; à proximité le sac à dos contenant son journal.

The North Face of Mount Everest, seen from the Rongbuk Monastery
1 06 1934
Ouverture au trafic de la ligne de chemin de fer du Congo-Océan.
9 06 1934
Charles et Yvonne de Gaulle, achètent en viager à Alice Bombal, veuve d’un architecte parisien, la Boisserie à Colombey les Deux Églises. C’est en fait La Brasserie [le bâtiment avait commencé par être la brasserie du village] qu’ils achètent ; aussi, pour ne pas voir fleurir des plaisanteries douteuses dans les états-majors, il la rebaptisera La Boisserie. Le bouquet était de 45 000 francs (à une époque où une voiture 7 CV Citroën valait 17 000 francs) accompagné d’une rente annuelle de 6 000 francs. En juin 1936, Alice Bombal se noiera dans sa baignoire. Donc de Gaulle avait déjà le nez creux.
10 06 1934
À Rome, la finale de la coupe du monde de foot oppose l’Italie à la Tchécoslovaquie. Il y a 65 000 spectateurs, mais la moitié d’entre eux, des militaires, sont là sur ordre de Mussolini : le sport roi n’est pas encore le foot, mais le vélo.
14 06 1934
Hitler décide d’arrêter de payer les réparations.
26 06 1934
Inauguration de l’Institut du cancer de Villejuif.
30 06 1934
Sur ordre d’Hitler auprès duquel les ennemis des SA se sont livrés à une bonne intox, les SS – Shutz Stappel – assassinent plusieurs dirigeants nazis, dont Ernst Röhm lui-même, chef des SA : c’est la Nuit des longs couteaux. Nombre de responsables catholiques en seront aussi victimes, dont Erich Klausener, responsable de l’Action catholique. La SS, avait été créée en 1925, transformée en milice en 1929 sous les ordres de Heinrich Himmler, assisté de Heydrich, chef du SD – Sicherheitsdienst : service de sécurité de la Gestapo -.
La SA, c’est la troupe, la SS, c’est la garde. Il y a toujours eu une garde, depuis les Perses jusqu’à Napoléon. La garde de la nouvelle Allemagne, c’est la SS.
[…] Chaque État a besoin d’une élite. L’élite de l’État national-socialiste, c’est la SS. Elle est le lieu où se perpétuent, sur la base de la sélection raciale, conjuguée aux exigences du temps présent, la tradition militaire allemande, la dignité et la noblesse allemande et l’efficacité de l’industriel allemand.
Heinrich Himmler
Parlant de la croix gammée, Mauriac évoquera une araignée gorgée de sang.
1 07 1934
Congrès féministe à Paris. La cause n’est pas entendue et le poids des traditions encore bien lourd : Louise Weiss, évoquant une conférence en province : Les paysannes restaient bouche bée quand je leur parlais du vote (des femmes). Les ouvrières riaient, les commerçantes haussaient les épaules, les bourgeoises me repoussaient, horrifiées.
En province, on sait encore ce que c’est que la peine : mère et fille, toutes deux institutrices racontent leurs débuts à l’école de Gouts, dans la vallée de l’Adour : J’ai pleuré quand je suis arrivée. L’école était au milieu des champs. Il n’y avait alentour qu’une maison de résinier. Le logement était vaste mais en piteux état. Les fenêtres étaient recouvertes de paille. Quand nous l’avons quitté, vingt et un ans plus tard, j’ai encore pleuré….
On insistait beaucoup sur la propreté. On n’entrait en classe qu’après la revue des mains et des dents. Chaque petit avait son sac, sa brosse à dents, son dentifrice suspendu à une pointe sous le préau. On se servait de l’arrosoir pour remplir les gobelets…
Ma mère (elle aussi institutrice) faisait elle-même la soupe. Elle posait la grande marmite sur le poêle à colonne, au milieu de la classe. Le boulanger qui ne passait que trois fois par semaine, nous livrait un pain de quatre, une miche de deux kilos. Les jours de froid, les élèves prenaient leur repas dans la classe : en général deux tranches de pain entre lesquelles les parents avaient glissé un œuf frit, un bout de ventrèche sèche, une sardine de baril, dessalée et grillée à l’aube sur les charbons de l’âtre. Les mieux lotis venaient avec des gamelles qu’ils réchauffaient sur la plaque en fonte. D’autres n’avaient en tout et pour tout qu’une barre de chocolat. Certains n’avaient rien dans leur musette, je leur donnais des tartines avec des graisserons (rillettes). Les plus pauvres ne se plaignaient jamais… Je n’ai jamais donné de devoirs écrits le soir. J’estimais qu’ils vivaient dans de trop mauvaises conditions : une seule table, dans la cuisine, très peu de lumière. Certains n’avaient pas l’électricité, ils lisaient à genoux devant le feu de cheminée.
Etiennette Loustau. Télérama N° 2 482 – 6 Août 1997.
4 07 1934
Marie Curie décède au sanatorium de Sancellemoz, au Plateau d’Assy, en Haute Savoie. Constamment exposée à la radioactivité, elle avait développé une anémie aplasique, grave maladie de la moelle osseuse. Elle a 67 ans.
La seule personne que la gloire n’ait pas corrompue.
Albert Einstein
7 07 1934
Willy Merkl, cheminot munichois de 32 ans, a monté une expédition pour le Nanga Parbat – 8 125 m -, avec Peter Aschenbrenner, Fritz Bechtold, Willo Welzenbach, Peter Mulritter, Willy Bernard, Alfred Drexel, Erwin Schneider et Uli Wieland. Alfred Drexel meurt d’un œdème pulmonaire dès le début. Fin juin, la progression était bonne, le sommet en vue et le beau temps au rendez-vous. Le 7 juillet, isolés du monde sur le plateau du Silberzacken à 7 712 m, 9 hommes se reposent, assurés du succès pour le lendemain quand surgit la tempête, soudaine, violente. Wieland, Merkl, Welzenbach et 6 sherpas moururent là-haut ; nombre de rescapés eurent les membres gelés. Trois ans plus tard, le 15 juin 1937, 16 hommes mourront sur les pentes du même Nanga Parbat, sept Allemands, neuf sherpas.
24 07 1934
Colette évoque dans Le Journal les colonies de vacance qu’elle a pu encadrer : Sur mille enfants de Paris qui devraient passer les vacances à la campagne, se peut-il que deux tiers courent le risque de rester sous nos murs étouffants ? Il faudrait, chaque été, que ni l’argent ni les cœurs ne défaillissent à leur tâche. Qui ne sait, aujourd’hui, que deux mois de plein air, pour un enfant citadin…. Mais je vous fais grâce des vérités cliniques. Pour avoir guidé, dans mon pays, la première colonie de petites filles que la Vie envoya aux champs, je n’ai pas encore perdu le souvenir de la faible, de l’émouvante cohorte qui me suivit à travers les bois serrés, les ravins sablonneux et les prés, mouillés de sources secrètes, coupés de rus, qui étaient l’honneur et la grâce de ma Puisaye natale.
Dans un village tel que fut le mien où la gare neuve, plantée en pleins champs, voyait passer tous les jours quatre trains qui s’arrêtaient une minute, crachaient un sac postal sur le quai et repartaient vides, l’annonce d’une colonie de vacances alluma toutes les curiosités. Quarante enfants des écoles primaires de Paris, trois institutrices, allaient envahir notre groupe scolaire pendant deux mois…
J’avoue que sous le soleil de juillet, à l’arrivée, le lot ne payait pas de mine. All’ n’ont point de mollets ! jeta une voix poyaudine, et le mot jeta un froid. C’est qu’autrefois, dans mon pays, le lard, le lait, le pain noir, l’huile de noix et le très révéré haricot rouge pourvoyaient les enfants de joues, de fesses et de mollets rebondis…
Traînant leurs petites pattes de grillons et leurs grosses galoches, les quarante élues prirent le chemin de la gare, et sans délai notre institutrice, Mlle Terrain, me promut guide local, avec mission de mener les Parisiennes, par beau temps, de bruyères en bois taillis, d’étangs en chemins couverts, de choisir les clairières pour le jeu et le goûter – sous le contrôle des mentors, bien entendu. Car je n’étais qu’une fille de quinze ans et demi, entraînée à marcher, grimpeuse, et mes pupilles – huit à onze ans – voulaient des ménagements.
Des ménagements ? Sur quarante, les médecins d’aujourd’hui auraient ordonné, à vingt d’entre elles, la chaise longue sous les arbres. Je crois me souvenir que la plupart de ces enfants pauvres n’avaient pas dépassé l’enceinte fortifiée de Paris. Croyez-vous que nous eûmes affaire à des gosses enivrées de liberté, ruant comme poulains à même l’herbe ? Point. Paris et la misère les avaient déjà trop endommagées. Nous vîmes des fillettes d’abord contractées, muettes, revêches à la verdure, qui avaient peur des arbres et de la pénombre verte. Elles pleuraient brusquement au crépuscule, et disaient – oiseaux effarés hors de la cage – qu’elles voulaient s’en retourner… Nous eûmes les colères nerveuses, les rires qui creusaient des joues maigres. Plongées toutes vives dans un été rural, jaune de sable, bleu d’eaux, à grosses cocardes de géraniums rouges, elles redemandaient, blessées par tant de feux, leurs logis étouffants…
Je regardais, avec stupeur, ces petites filles dépéries ; j’écoutais leur grasseyement, leur accent des lointains faubourgs. Sauvages à leur manière, et intolérantes, aucune n’était timide à proprement parler, et elles savaient à merveille se moquer, d’un air supérieur, avec des mots inconnus de nous. Habillées de rien, les boutonnières éclatées et les chemises trop courtes, elles tournaient leurs mèches de cheveux sur du papier journal la nuit, et nouaient d’une main adroite le vieux ruban de leur natte. Les premiers jours, quelques-unes se battirent, toutes griffes dehors, comme des chattes. Il y eut de grands drames à cause de l’usage, imposé, des brosses à dents…
Et puis la détente vint, et le charme opéra, mais lentement. Les nuits fraîches descendirent sur les lits des dortoirs, sur les petits corps plats, abreuvés de lait qui coûtait quatre sous le litre. Des gosses apathiques devinrent vives, tandis que d’affreuses petites rigolotes surexcitées se calmaient peu à peu. Surgis de leur propre désordre comme d’un miroir déformant, des traits délicats, envahis enfin par la fraîche couleur sanguine, se révélaient à nous…
Ce n’est pas que j’aimasse beaucoup les enfants, à cette époque là. Mais déjà curieuse, et difficile, et sensible à une certaine sorte de louange, la confiance progressive de la colonie me flatta, à mesure que je prenais, aux yeux de quarante critiques sévères, de l’importance. Les institutrices m’appelaient à la rescousse contre les petites qui ne mangeaient pas, contre celles qui mangeaient trop, contre celles qui, reprises par les vieux démons, mentaient, trépignaient, blasphémaient comme des possédées. Une autorité de cheftaine – le mot n’existait pas, ni la tâche – m’exaltait. N’étais-je pas celle qui savait le nom de la fleur et du caillou, celui de la bête, qui connaissait le sentier de traverse et la source où l’on pouvait boire ? À qui n’a pas enseigné comment on siffle dans un noyau d’abricot percé, dans un tuyau d’herbe, comment la demi-noix vidée devient crécelle moyennant une aiguillée de fil et une allumette de bois ; – comment la branche de sureau se mue en seringue et la fleur du pavot en danseuse, – je n’essayerai pas de faire comprendre l’enivrement de régner.
Comme une reine j’eus mes favoris. En l’espèce, c’était une favorite de dix ans, qui n’en paraissait guère que huit, une petite fille très jolie et fragile, grands yeux parlants, bouche frémissante, qui ne put jamais s’habituer au coucher du soleil. Muette, elle assistait, en croisant ses mains sur sa poitrine comme font les écureuils, à l’immersion de l’astre, bu par les brumes de Moutiers, au noircissement des longues nues ardentes, et elle tremblait. Je n’ai rien connu d’aussi amèrement touchant, d’aussi fier, d’aussi réservé que cette enfant de Paris, qui n’était pas une enfant malheureuse. Elle me montrait sa petite vareuse, taillée dans une ancienne capote de soldat: C’est maman qui fait ça. C’est bien piqué, dites ? Je lui demandais :
Qu’est -ce qu’elle fait, ta mère ?
Elle pique à la machine.
Et ton père ?
Elle écartait ses mains minuscules, levait les épaules en signe d’ignorance :
Pas …
Tout m’est resté, de cette petite Léone exceptionnelle. Mais son souvenir ne masque pas celui des quarante autres échantillons de misère citadine, des méchants, des gentils, des ténébreux, des cruels, des pétris de grâce… Il a changé, depuis si longtemps, le sort des enfants de Paris, mais pas assez changé. Ils aspirent toujours à la campagne, comme l’antilope languit après l’eau claire. Quand j’évoque, comme je viens de le faire ici, ceux que j’appelle les miens, je me rappelle qu’au bout de leur première semaine de vacances les quarante fillettes durent écrire à leurs familles. Ma petite Léone leur donnant l’exemple, cinq ou six enfant fendirent proprement le haut de leur feuille de papier à lettres et, dans la fente glissèrent la merveille, l’objet rare, émouvant, que le ruisseau, la rue étroite, la cour moisie, la gouttière, le toit de zinc torride ne leur avaient jamais, jamais découvert : cinq ou six brins d’herbe…
25 07 1934
Depuis l’instauration à la fin de la guerre d’une république, l’Autriche a un parlement où les deux partis majoritaires se sont équipés de forces paramilitaires et donc, à quoi bon avoir des forces armées qui ne se servent jamais de leurs armes ? Les conservateurs ont créé l’Heimwehr et les sociaux démocrates la Republikanischer Schutzbund – ligue de défense républicaine -. Le 4 mars, Engelberg Dollfuss, chancelier au pouvoir depuis mai 1932, chrétien conservateur et nationaliste avait dissout le parlement, puis interdit le Parti social démocrate, mettant ainsi fin à la démocratie. Il ne manquait plus qu’une étincelle : ce sera le salaire des employés des chemins de fer : le 12 février 1934, les ouvriers se mettent en grève, grève réprimée pendant quatre jours par la police, la gendarmerie et la Bundesheer – l’armée fédérale, au prix de presque 2 000 morts. Soutenu par Mussolini, il a contré Hitler qui ne peut plus supporter cette opposition et envoie 150 SS déguisés en militaires autrichiens pour prendre la chancellerie. Prévenu, Dollfüss s’est enfui mais rattrapé par les SS, il est touché de deux balles. Il mourra deux jours plus tard, se refusant à nommer un chancelier nazi.
La mort de Dollfus ouvrira la porte au parti national socialiste, le NSDAP – National Socialist Deutsche Arbeiterpartei in Österreich -. Interdit depuis juillet 1933, celui-ci s’était réfugié dans la clandestinité, formant une légion autrichienne en Allemagne, avec pour devise : Unir toutes les terres peuplées d’Allemands dans une seule nation, et pour chef incontesté Ernst Kaltenbrunner, jeune avocat, fier de toutes les balafres que lui avaient valu ses nombreux duels, ivre d’un antisémitisme virulent : Adolf Eichmann sera envoyé à Vienne en mars 1938 pour la libérer de ses Juifs – ils représentaient 10 % de la population – les obligeant à acheter l’autorisation d’émigrer. La plupart d’entre eux seront déportés en Pologne ; c’est l’Autriche qui, instaura le camps de concentration, dès le 8 août 1938, de Mauthausen, à la confluence de l’Enns et du Danube, au sud-est de Linz, avec les premières chambres à gaz de l’Histoire, fonctionnant au monoxyde de carbone. Cette politique connaitra non seulement l’assentiment populaire, mais aussi l’adhésion d’assez nombreuses célébrités : Herbert von Karajan, Konrad Lorenz etc…
28 07 1934
Les Américains Orvil A. Anderson et Albert W. Stevens et W. E. Kepner, montent à près de 20 000 mètres d’altitude à bord du ballon stratosphérique Explorer quand celui-ci se déchire, et c’est la chute : le dernier des trois hommes ne pourra s’extirper de la nacelle qu’à 100 mètres du sol, vers lequel elle filait à 1.6 km/mn. !
3 08 1934
Éliaou Kalifa, maître-tailleur juif de 46 ans, commissionné dans un régiment de zouaves, rentre vers 20 h 30 à son domicile situé près de la mosquée Sidi Lakhdar, à Constantine, Algérie. Saoul, il injurie des Musulmans aperçus par une fenêtre en train de procéder à leurs ablutions et, selon ceux-ci, il urine sur eux et sur la mosquée. Entre les Musulmans qui viennent lapider les fenêtres de son logement et les locataires juifs des immeubles voisins qui les bombardent avec des projectiles divers, c’est bientôt la bataille. Le Dr Bendjelloul, le leader musulman alors le plus populaire, se met en vedette par ses interventions auprès des policiers ; il frappe aussi un inspecteur de police musulman, ce qui lui vaut une inculpation. Lorsque la police et les soldats eurent rétabli l’ordre vers trois heures du matin, on comptait 15 blessés dont 3 agents de police : un Musulman, blessé au ventre par une balle de revolver, devait décéder un peu plus tard. Six magasins de bijouterie appartenant à des commerçants israélites avaient été enfoncés, quelques voitures lapidées.
5 08 1934
Pogrom arabe contre les Juifs de Constantine, en Algérie. On dénombrera 26 morts, dont 23 Juifs et 3 Musulmans : parmi eux 5 enfants (âgés de quelques mois à 10 ans), 6 femmes,15 hommes, et 81 blessés, dont 38 juifs, 35 Musulmans, 7 militaires et un pompier.
Que s’est-il passé ? Le 3 août des rumeurs incontrôlables mettent en cause un soldat juif ivre qui aurait uriné contre une mosquée, et diffusent la nouvelle de l’assassinat d’un chef nationaliste arabe par des juifs : le chef en question, le Dr Bendjelloul était en fait […] bel et bien vivant…. Entre le 3 et le 5 août, une foule d’émeutiers arabes, venus des environs de Constantine, déferle sur le quartier juif de la ville, pille un grand nombre de magasins, cambriole des logements, assiège et égorge dans leur maison des familles juives et blessent à l’arme blanche des dizaines de juifs qui tentent d’échapper au massacre. Pendant tout le temps de l’émeute, l’administration française n’intervient pas, ou peu. Soldats et officiers, en nombre plus faible que d’habitude (beaucoup étaient en permission) munis d’armes dépourvues de cartouches, jouèrent les spectateurs… L’officier le plus gradé pendant la durée de l’émeute, est un sous-officier, qui ne peut donner l’ordre de tirer cela relevant, dans l’armée française, du pouvoir des seuls officiers. Le maire, Émile Morinaud, était fort opportunément absent de la ville, ainsi que le commissaire principal. Le carnage ne s’arrêta qu’après le retour du maire et la reprise en main de la situation par l’armée. L’administration mit en cause des provocations juives (des groupes d’autodéfense juifs avaient tenté de s’interposer entre les émeutiers et la population), le gouverneur général de l’Algérie n’assista pas aux obsèques des victimes (dont plusieurs enfants en bas âge), le pouvoir colonial ordonna à la population juive de s’abstenir de toute provocation et de montrer moins de morgue.
Robert Attal, survivant de ce pogrom ; il avait alors huit ans ; Les Émeutes de Constantine. 5 août 1934 Paris, Romillat, 2002
8 08 1934
Aux commandes d’un Caudron-Renault monoplan de 140 ch, Hélène Boucher enlève d’une part le record international de vitesse toute catégorie sur 100 km à 412 km/h et, d’autre part, le record des 1 000 km à la moyenne de 409 km/h. Le , elle s’adjugera le record du monde féminin à 445 km/h. Elle se tuera le , lors d’un vol d’entraînement sur l’aérodrome de Guyancourt aux commandes d’un Caudron C430 Rafale : elle avait 26 ans.
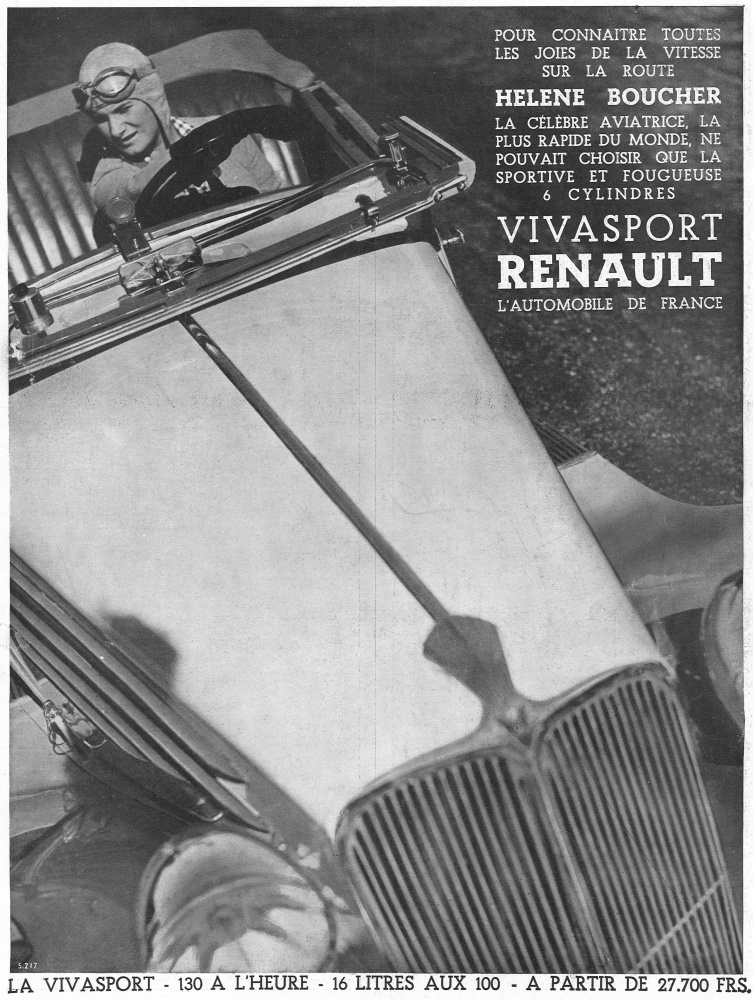
Les sportifs savaient déjà trouver des sponsors : Hélène Boucher au volant de la Vivasport à 6 cylindres, en 1934

15 08 1934
Les Américains Williams Beebe et Otis Barton atteignent à bord de leur sous-marin de poche – 2 500 mètres dans les fosses de la mer des Bermudes.
18 08 1934
Second vol stratosphérique du Pr Piccard et Max Cosyns qui partent de la cuvette de Dübendorf, près de Zürich. Ils embarquent 6 tonnes de lest. Ils atteignent 16 940 mètres au-dessus du lac des Quatre Cantons. Ils amorcent la descente au dessus de la Bernina pour se poser sur la commune de Monzambano, près de Dezenzano.
21 08 1934
Les États-Unis évacuent Haïti.
27 08 1934
Les surveillants du bagne pour enfants de Belle-Île punissent l’un d’eux pour une entorse bénigne au règlement, et c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase : les 55 enfants se révoltent, s’échappent sans pouvoir aller bien loin : comment quitter une île sans bateau ? Et ce n’est pas une chasse à l’homme qui s’organise, mais une chasse à l’enfant : la récompense promise pour toute capture vient cristalliser toute la méchanceté, la bêtise, la perversion qui imprégnait l’encadrement et l’environnement social de ce bagne pour enfants. La renommée et l’entêtement d’un homme, Alexis Danan, journaliste à Paris Soir vont déclencher une salutaire campagne de presse qui aboutira, bien des années plus tard, en 1941, à une prise de conscience de l’administration pénitentiaire : Les récents incidents qui se sont produits à la colonie pénitentiaire de Belle Ile ont attiré une fois de plus l’attention sur le sort réservé à l’enfance malheureuse, sur la situation faite aux petits déshérités de la vie, orphelins n’ayant personne pour les recueillir, enfants trouvés dans le ruisseau ou au coin d’une porte ; enfants que les mères, souvent lâchement abandonnées, ont laissé à l’Assistance publique après leur délivrance survenue à la maternité, sans espoir de les revoir jamais mais aussi parfois, le cœur gros, les yeux pleins de larmes à la pensée de ne pouvoir élever le petit être né d’une faute mais dont l’existence constituerait pour un maigre budget une charge trop lourde à moins qu’il ne soit un jour, le trop vivant témoignage d’un passé qu’il convient parfois de faire oublier…
A. Valérie paru dans Le Courrier du soir, le 12 novembre 1934
J’ai travaillé comme une bête. J’ai reçu des coups de poing, des coups de bâton. J’ai jeûné et tourné en rond dans ma cellule des jours et des jours. J’ai connu le supplice de la camisole de force, les bras remontés derrière le dos, comme ça, vers l’omoplate. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait mal… Non, voyons, laissez-moi pleurer tranquille : ça soulage. Une fois, je suis restée camisolé cinq heures. Je criais, j’implorais grâce. Personne ne venait. J’ai vu camisoler et battre des pupilles enceintes. Je l’ai vu. Je vous jure.
Alexis Danan. Paris Soir, le 26 octobre 1934
Au cours des années 1936 et 1937, au moment où l’effort de modernisation des maisons d’éducation surveillées étaient les plus vigoureux, le moindre incident était démesurément grossi et la vérité odieusement travestie. Rien n’a été épargné, même pas les photos truquées… Qu’importe la véracité des faits pourvu que les midinettes s’arrachent la sixième édition à cause de son gros titre émouvant sur trois colonnes.
[…] Mais il faut avoir le courage de reconnaître que ceux qui prétendaient que les colonies pénitentiaires étaient des écoles de contamination morale et un bouillon de culture, où se développaient les plus mauvais instincts, n’avaient pas toujours tort… Il faut maintenant prononcer la déchéance de l’administration pénitentiaire.
Jean Bancal, inspecteur général de l’administration
Au-dessus de l’île on voit des oiseaux
Tout autour de l’île il y a de l’eau
Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !
Qu’est-ce que c’est que ces hurlements
Bandit ! Voyou ! Voyou ! Chenapan !
C’est la meute des honnêtes gens
Qui fait la chasse à l’enfant
Il avait dit j’en ai assez de la maison de redressement
Et les gardiens à coup de clefs lui avaient brisé les dents
Et puis ils l’avaient laissé étendu sur le ciment
Maintenant il s’est sauvé
Et comme une bête traquée
Il galope dans la nuit
Et tous galopent après lui
Les gendarmes les touristes les rentiers les artistes
C’est la meute des honnêtes gens
Qui fait la chasse à l’enfant
Pour chasser l’enfant, pas besoin de permis
Tous les braves gens s’y sont mis
Qu’est-ce qui nage dans la nuit
Quels sont ces éclairs ces bruits
C’est un enfant qui s’enfuit
On tire sur lui à coups de fusil
Tous ces messieurs sur le rivage
Sont bredouilles et verts de rage
Rejoindras-tu le continent rejoindras-tu le continent !
Au-dessus de l’île on voit des oiseaux
Tout autour de l’île il y a de l’eau.
Jacques Prévert La chasse à l’enfant
5 10 1934
La participation au gouvernement espagnol de la Confédération des droites autonomes, catholique et conservatrice, dirigée par Jose Maria Gil Robles entraîne une insurrection dans les Asturies et la Generalitat de Catalogne : le général Franco sera chargé de mater les Asturies : cela ne durera que deux semaines mais fera mille morts.
9 10 1934
Le roi Alexandre I° de Yougoslavie est assassiné à Marseille par un oustachi (société secrète d’extrême droite sous les ordres d’Ante Paveli) croate : Vlada Gueorguiev ; la voiture est une vieille Delage avec un beau marche pied qui permet au terroriste de bien ajuster son coup ; blessé par le lieutenant colonel Piollet, il sera lynché par la foule et mourra avant d’avoir été évacué sur l’hôpital. Le trouble qui s’ensuit immédiatement donne lieu à une fusillade très désordonnée de la police, dont l’une des balles va atteindre le ministre français des Affaires Étrangères Louis Barthou, lui coupant l’artère humérale du bras gauche au-dessus du coude ; comme les premiers soins qui lui sont données consistent en un garrot fait au poignet [oui, au poignet pour une blessure au-dessus du coude ! ! !] , il perd beaucoup de sang et meurt sur la table d’opération une bonne demi-heure après l’attentat.


15 10 1934
La République soviétique du Jiangxi créée en 1931 par Mao Zedong s’est effondrée sous les coups des troupes de Chang Kai-Chek : commence la longue marche de vingt cinq mille lis [12 500 km] : traversée de la Chine d’ouest en est, avec une armée sous-équipée. Ils partirent 86 000 du Kiang-si… un an plus tard, en arrivant au pays des Ordos, ils n’étaient plus que 8 000. De ce qui était bel et bien une débandade, puis une fuite, d’abord décidée par les vingt-huit bolchéviques, des communistes chinois ayant étudié à l’Université Sun Yat Sen, Mao fit une épopée qui en faisait une marche vers le nord pour résister au Japon ; au départ, à la direction de cette débandade, si tant est qu’il y eut alors une direction, Bo Gu et Li De. Mao avait été écarté au départ, envoyé loin de là en mission d’investigation. En janvier 1935, lors de la conférence de Zunyi, ils furent destitués et remplacés par Zhang Wentian comme secrétaire général du Parti, Zhou Enlai devenant le commandant militaire assisté de Mao en second. Puis viendra le triumvirat militaire composé de Zhou Enlai, Mao Zedong et Wang Jiaxiang. L’habileté de Mao et son charisme le mèneront assez vite au premier rang ; sa théorie de la révolution portée par les masses paysannes n’avait rien de personnel : ce n’était que la répétition de thèmes chers à Nicolas Boukharine, membre influent du Politburo de l’URSS. Les 25 000 lis ne sont pas la distance totale effectuée par une armée, mais la somme des distances effectuées par plusieurs armées, aux parcours entrecroisés et parfois très différents.
Changzeng : Quand le Guomindang nous a chassés, nous avons pris la fuite, et c’est comme ça que nous nous sommes retrouvés à gravir ces montagnes et à traverser ces marécages trois fois de suite. Ce fut une expérience terrible, abominable, je n’oublierai jamais…
Après la traversée du col de Lazi, nous sommes arrivés au mont Jiajing. En bas il faisait beau, mais plus nous grimpions plus le vent soufflait fort. Et là, il pleuvait, un mélange de pluie et de grêle, et quand nous avons atteint le sommet, le froid est vite devenu insupportable. Nous portions alors nos casquettes, car quand ces gros grêlons vous tombaient sur la tête, ça faisait un mal de chien ! Grimper était pénible pour chacun d’entre nous, mais quand il nous fallait redescendre, c’était encore bien pire. Certains de nos camarades ne faisaient pas assez attention à la descente, alors ils dégringolaient dans le ravin et se tuaient ! Quand je repense à tout ça, ça me rend vraiment triste. Nous ne savions jamais qui serait le prochain… Il y avait d’ailleurs une chanson sur le mont Jiajing :
Mont Jiajing, mont Jiajing !
Aucun oiseau ne peut te survoler
Ni aucun singe t’escalader
Seuls les Immortels qui t’habitent
En sont descendus nous rendre visite !
Le mont Jiajing s’élève à plus de 4 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, il fallait surpasser les Immortels pour le franchir ! Beaucoup d’entre nous y ont péri, il n’y avait pas de chemin dans la montagne. Nous avancions en suivant les pistes des animaux.
Quand nous avons traversé les marécages, il ne nous restait plus de nourriture déshydratée, nous n’avions plus rien à manger. Alors nous avons arraché l’herbe et nous l’avons mangée. Et quand nous n’avons plus rien trouvé d’autre à nous mettre sous la dent, nous avons mastiqué le cuir de nos ceintures. C’était affreux, vraiment affreux ! La nuit venue, nous dormions à même le sol. Certains s’endormaient même dans des bourbiers. Et comme on n’arrivait pas à les réveiller le lendemain matin, on les accrochait à la queue des chevaux et on les tirait derrière nous. On aurait dit des somnambules ! Je l’ai vu, de mes yeux vu !
Après les montagnes et les marécages, il a fallu nous battre… Nous étions affamés, exténués, et il fallait nous battre, c’est invraisemblable, non ? Et pourtant, nous avons aussi gagné cette bataille !
Comme nous nous étions bien battus, nous avons eu droit à de la nourriture et du repos. Ensuite, nous sommes partis pour le Gansu. Arrivés là, nous avons encore dû livrer bataille au mont Wuliang. Le Guomindang y avait installé une division de cavalerie et à la veille des combats, mon instructeur politique m’a dit : Prends un groupe avec toi et pars en reconnaissance ! La nuit venue, je suis parti repérer la configuration du terrain. La nuit suivante, munis d’échelles de corde, nous avons lancé notre attaque. La division du Guomindang avait installé son campement dans les hauteurs et nous les avons tous massacrés ! Cela fait, nous avons pris la direction du sud, vers Guilin où nous avons rejoint les soldats de la I° armée. C’était en 1936, et à ce moment-là, j’ignore combien d’entre nous étaient dans la détresse ; les officiers, eux aussi, étaient mal en point, c’était pitoyable. Quiconque verrait ces troupes aujourd’hui ne pourrait les croire capables de conquérir toute la Chine !
Xinran : Et vous, vous y croyiez ?
Changzeng : À cette époque, je ne voyais pas tellement plus loin que le bout de mon nez. Nos chefs nous traitaient bien, et où que nous allions les petites gens aussi nous traitaient bien : c’étaient de braves gens ! Dès que nous avons eu rejoint la I° armée, nous sommes directement partis pour Yan’an.
Xinran : Savez-vous pourquoi l’Armée rouge est allée à Yan’an ? Pourquoi elle a choisi d’y installer sa base ?
Changzeng : Personne n’habitait dans cette région du Grand Nord-Ouest, et l’ennemi n’y était pas présent non plus. Ainsi nous avons pu nous reposer et réorganiser nos troupes. Tant d’hommes avaient péri durant la Longue Marche, cela était nécessaire. Nous avions une chanson :
Pour la base du Nord-Ouest construire,
Nous vaincrons les difficultés sans faiblir
Et nous vaincrons aussi notre ennemi
Oui, nous exterminerons notre ennemi !
Arrivés à Yan’an, [le 19 octobre 1935] aucune aide ne nous a été apportée par les locaux, il a bien fallu que nous trouvions les moyens de nous en sortir. Yan’an était si pauvre que même Tchang Kaï-chek et le Guomindang refusaient de venir s’y battre. Nous avons commencé à produire notre propre nourriture et à faire nos vêtements. Tous les matins, les troupes grimpaient dans la montagne avec leurs houes et défrichaient le terrain pour les futures plantations. Le sol était très dur et il fallait parfois s’y mettre à deux pour arracher certaines plantes. Le jour nous défrichions, le soir nous filions et tissions le coton. Notre chanson disait :
Défrichons, défrichons,
Il faut de quoi manger pour les soldats du front !
Tissons, tissons,
Il faut des vêtements pour les soldats du front !
Aujourd’hui, personne ne croirait que nous avons traversé de telles épreuves !
À Yan’an, j’ai souffert d’un furoncle anal qui n’arrivait pas à guérir, alors je suis allé voir le médecin canadien Norman Bethune. [Chirurgien canadien, né en 1890, en Ontario. Il a rejoint le Parti communiste après une visite en Union soviétique. En 1938, il est allé en Chine où il est devenu un héros pour son dévouement exemplaire dans son travail. Il est mort en 1939]. Je lui ai dit que je ne voulais pas d’anesthésie générale pour ne pas être inconscient trop longtemps. Pas de problème, m’a-t-il dit, je vous opérerai à huit heures et à neuf heures vous serez réveillé. Je n’étais qu’un simple soldat et pourtant il s’est montré plein de sollicitude : il m’a soigné et grâce à lui je souffrais beaucoup moins. Nombre de mes compagnons d’armes ont été guéris par le docteur Béthune. C’était un homme bon.
Xinran : Avez-vous vu Mao Zedong à Yan’an ?
Changzeng : À l’époque, les troupes voyaient souvent les grands chefs, alors je ne me souviens pas avec précision des lieux et des dates. Mais je me souviens du discours prononcé par Mao aux futurs gardes qui faisaient leurs classes. Il leur a dit : En tant que gardes, vous avez de grandes responsabilités. Aujourd’hui vous protégez le comité central du Parti, les populations du Shaanxi et du Gansu, mais à l’avenir, c’est toute la Chine que vous protégerez ! À la fin des classes, Zhou Enlai, lui aussi, est venu s’adresser à nous. Un jour, pendant les classes, plus d’une trentaine d’avions ennemis ont lancé sur nous un raid aérien. Nous étions trois ou quatre cents et nous nous sommes tous entraidés pour courir jusqu’aux abris. Quand nous en sommes ressortis, Yan’an avait été complètement rasée, et quantité de pauvres gens et d’enfants s’étaient retrouvés sans abri.
Devenue l’image symbole de la Longue Marche, cette photo de Mao a été prise en réalité en 1947, au cours de la guerre civile qui opposa les communistes aux nationalistes de Chiang Kai-shek. XINHUA/Photo by XINHUA / AFP



Debout sur le pic le plus élevé des six montagnes
Le drapeau rouge flottant au vent d’ouest
Aujourd’hui, une longue corde à la main,
Je me demande quand nous pourrons lier le monstre [1]
Mao Zedong
L’Armée Rouge ne s’effraie pas de la Longue Marche.
Dix mille rivières, mille monts ne sont rien pour elle.
Les Cinq Pics sinueux sont de petites vagues,
Le vaste Wu Mong est une motte de terre qu’on foule aux pieds.
Tièdes étaient les rochers où se brisait la rivière aux Sables d’or,
Glacées étaient les chaînes de fer du pont de la Tatu.
Passé le mont Mien aux mille pieds de neige,
La joie de toute l’armée fut immense.
Notre enfance a été plongée dans un océan de misère,
À travers toute la Chine, avec l’Armée rouge, nous avons fait la guerre !
Nous avons traversé des forêts de fusils,
Nous avons couru sous les balles et la pluie,
Des montagnes et des marécages, nous avons franchi,
Nous avons tissé et confectionné ensemble tous nos habits,
Dans les flammes et la poudre, nous passions nos jours et nos nuits !
Notre ferveur, intacte, ne s’est jamais tarie !
Et toujours immortels resteront nos fusils !
Voici venu le renouveau de la Chine et de sa nation
En route elle s’est lancée dans les Quatre Modernisations
Partout l’amour est en Chine, et nous n’oublierons pas
La bonté qu’a eue pour nous le Parti communiste !
Le Fleuve Jaune
J’entends le vent gémir,
Et les chevaux hennir,
Les grondements du fleuve Jaune, j’entends retentir !
Les soldats pliés sous le poids de leurs armes, foncent droit devant !
Contre les Japonais, se lancent tant de nos combattants !
Nous protégeons le fleuve Jaune, nous protégeons la Chine,
Nous protégeons les montagnes, nous protégeons la Chine !
*****
Le bilan de la Longue Marche est sans appel : grâce à la longue marche et à tous les bénéfices qu’il en retira, fort de sa nouvelle confiance en lui, le PCC réorganisa entièrement sa structure et prît le temps d’entraîner les troupes de l’armée régulière. Tous les principaux dirigeants de la République populaire de Chine, tels que Mao Zedong, Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Zhu De, Chen Yun et Deng Xiaoping participèrent à la Longue Marche, tout comme neuf des dix maréchaux de l’armée, à l’exception de ChenYi. Durant les deux ans que dura la Longue Marche, les différentes troupes qui constituaient l’Armée rouge sillonnèrent au fil de leurs combats près de quatorze provinces et couvrirent une distance totale d’environ 25 000 lis. Les soldats traversèrent plusieurs régions reculées peuplées de minorités nationales et de Chinois Han, affrontèrent une nature hostile et périlleuse : de grands fleuves, des pics enneigés et des steppes marécageuses ; ils échappèrent aussi à l’encerclement de centaines de milliers de soldats du Guomintang et d’armées locales, parvinrent à éviter les scissions qu’auraient pu produire les frictions entre Mao Zedong et Bo Gu, ainsi que celles entre l’Armée rouge et Zhang Guotao. Un nouveau noyau de dirigeants de PCC émergea alors progressivement avec Mao à sa tête.
Xinran. Mémoire de Chine. Éditions Philippe Picquier. 2009
Si les communistes s’étaient contentés d’être des résistants, la mobilisation des paysans n’aurait pas beaucoup progressé. Autrement efficace, l’octroi d’avantages matériels leur a-t-il du moins valu un soutien populaire aussi massif et enthousiaste qu’on l’assure généralement ? Rappelons tout d’abord que les communistes ne peuvent, comme à l’époque des soviets de Jiangxi, procéder à la confiscation et à la redistribution des terres des propriétaires fonciers. Le front uni le leur interdit et, même quand ce front uni est devenu une pieuse fiction (les armées nationalistes établissent dès 1939 un cordon sanitaire autour des bases communistes de Chine du Nord ; en Chine centrale, où le PCC est moins bien implanté, elles encerclent et écrasent une armée communiste en janvier 1941), il faut encore faire semblant de l’observer et, nous l’avons vu, ne pas jeter l’élite locale dans les bras des Japonais. Les communistes se contentent donc, pour l’essentiel, de diminuer les taux d’intérêt et le montant des fermages (en quoi ils reprennent habilement le programme de Sun Yat Sen, très tôt abandonné par le Guomindang), et d’instaurer un impôt progressif qui remplace une multitude de taxes et de surtaxes moins lourdes qu’arbitraires et inéquitables. Cette politique réformiste n’est pas toujours synonyme de modération: à certaines époques l’extrême progressivité de l’impôt eut pour but, et pour résultats, de contraindre maint propriétaire foncier à vendre une partie de ses terres.
À l’exception d’une ou deux phases bien définies, les obstacles rencontrées dans la mobilisation des paysans paraissent donc avoir tenu moins à l’insuffisance des avantages octroyés qu’à l’énormité des risques encourus du fait de l’ennemi, mais aussi de l’élite rurale et de ses agents. Les communistes se sont employés, avec prudence mais ténacité, à saper non seulement la puissance économique, mais aussi l’autorité et le prestige de cette élite afin d’établir leur propre pouvoir sur les ruines du sien. Pour impliquer les paysans dans la lutte, il fallait d’abord, et ce n’était pas une mince affaire, les affranchir de la soumission, voire de la déférence qui, tout autant que le ressentiment, caractérisait leur attitude à l’égard des puissances et des privilégiés. Prudents ou sceptiques, de nombreux paysans ont dans un premier temps boudé les élections destinée à conférer à leurs représentants une légitimité supérieure à celle des notables villageois (il leur est aussi arrivé d’être ces notables ou leurs homes de paille). Maint fermier a continué à verser en cachette à son propriétaire la différence entre un loyer officiellement réduit et celui qu’il acquittait avant l’arrivée des communistes. À partir du moment, en revanche, où ils eurent surmonté leur crainte et où, bon gré mal gré, ils se furent engagés publiquement dans la critique et l’intimidation des exploiteurs et autres despotes locaux, leur comportement changea parfois du tout au tout : des fermiers se mirent à refuser de verser quelques loyer que ce fût, y compris le loyer réduit fixé par les autorités communistes, et ces dernières furent assez souvent contraintes de modérer l’activisme de paysans dont les exigences ne connaissaient plus de bornes.
Il n’ a donc pas été facile pour les agitateurs (et administrateurs) communistes de susciter et de canaliser la révolte paysanne. Leur politique en faveur des plus démunis leur a assuré, outre le soutien permanent d’une petite minorité d’inconditionnels prêts à épouser tous les méandres de leur stratégie le soutien occasionnel de groupes ou d’individus favorables à telle ou telle des mesures des mesures qu’ils adoptaient ou des campagnes qu’ils déclenchaient. Les autres, – la grande majorité – ont tout simplement obéi : tantôt parce qu’en contrepartie des avantages obtenus ils se soumettaient sans trop rechigner aux livraisons de grains, aux travaux et aux transports effectués pour l’armée, etc, tantôt, plus souvent peut-être, en raison des risques inhérents à toutes tentative de désobéissance ou de sabotage des mouvements de masse décrétés par des autorités populaires appuyées, comme les autres, sur la force militaire.
Peut-on au moins considérer que la majorité attentiste, puis obéissante, regroupait surtout des villageois aisés et que la minorité d’activistes, puis de membres du parti, s’est recrutée surtout chez les paysans pauvres ? Remarquons d’abord que les pauvres, majoritaires dans chaque village ou presque, ne pouvait pas ne pas être largement représentée parmi les tièdes et les prudents. Élucider la seconde partie de la question requiert plus de temps. À l’origine, à l’heure où presque tous les paysans se tenaient sur la réserve, les grande majorité des alliés ou partisans sur lesquels les communistes pouvaient compter se situaient aux deux bouts de l’échelle sociale. D’une part des vétérans communistes surgis de la clandestinité, les intellectuels modernes mais aussi des lettrés traditionnels et des propriétaires fonciers soucieux de résister à l’envahisseur… ou désireux de s’infiltrer dans les organes du nouveau pouvoir afin de l’espionner ou d’infléchir sa politique dans un sens moins défavorable aux possédants. D’autre part, des vagabonds ou des voyous qui n’avaient rien à perdre et comptaient bien gagner quelque chose en aidant les nouveaux maîtres. Si ça donne du lait, c’est une mère pour nous : cette fortune lapidaire de Feng Zhen, l’un des principaux dirigeants d’une importante base de Chine du Nord, résume les motivations des marginaux et aventuriers que le parti est bien aise d’utiliser, faute de disposer d’autres appuis parmi les couches populaires mieux intégrées à la société villageoise. Le lait, ce n’est pas seulement le riz servi à tout combattant volontaire, c’est aussi une part du bulletin prélevé sur des propriétaires fonciers que les paysans n’osent pas encore affronter ou rudoyer en public.
La tâche délicate consistant à faire le tri entre les mauvais propriétaires fonciers, traîtres ou despotes exploiteurs (et donc cibles toutes désignées des attaques publiques et des spoliations), et des bons, patriotes ou simplement enclins – ou résignés – à collaborer avec les communistes (et qu’il faut donc provisoirement ménager), illustre les contradictions et les difficultés de la politique du PCC, surtout à l’époque héroïque où son autorité est encore mal implantée. Pour l’instant, bornons-nous à retenir le handicap d’avoir à démarrer un mouvement paysan sans paysans, en s’appuyant sur un étrange (et explosif) assortiment : des déclassés et des membres de l’élite, y compris de l’élite que la stratégie communiste vise à renverser et supplanter.
Aussitôt que le ralliement d’un nombre suffisant de paysans, et aussi l’accroissement de la force militaire et de l’autorité politique du PCC dont ce ralliement est un corollaire autant qu’une cause, le permettent (vers la mi-mai 1939 en Chine du Nord, mais la date varie d’une base à l’autre), une campagne d’épuration exclut du parti, de la milice ou des organisations de masse les éléments indésirables en raison de leur opportunisme, de leur indiscipline, de leur propension au racket… ou de leur appartenance aux classes privilégiées. Autrement dit, c’est la parti qui sélectionne ceux qu’il conserve parmi les activistes ou les adhérents (non paysans) de la première heure, c’est sous son égide que le mouvement paysan se paysannise. Plus tard, l’enracinement moins précaire du parti lui permettra d’être plus sélectif encore et de rejeter de nombreux paysans aisés. À la fin de la guerre, les cadres sont souvent des paysans moyens, plus souvent encore des paysans pauvres : tout simplement parce qu’ils ont été cooptés et promus de préférence aux autres. Les pauvres sont encore plus nombreux parmi les soldats et les miliciens : le parti évite, autant qu’il le peut, d’armer les membres de classes plus favorisées. Bref, une politique délibérée, dont on a interprété à tort les résultats comme la simple expression des clivages préexistants au sein de la société rurale.
Lucien Bianco. La Chine au XX° siècle. D’une révolution à l’autre 1895-1949
Un représentant du gouvernement Kouo-min obtient de Lhassa la reconnaissance de la position politique spéciale de la Chine au Tibet : l’influence de la Chine est de retour au Tibet. Le gouvernement nationaliste jette les bases d’une planification d’État à même de satisfaire partiellement les besoins de l’industrie de guerre ; l’amélioration des transports routiers – 1 000 km en 1921, 120 000 km en 1936 -, ferroviaires – 8 000 km en 1928, 13 000 km en 1937 -, et aériens, avec la compagnie sino-allemande Eurasia qui dessert des lignes du Xinjiang à Pékin et Canton -, permet un début d’intégration économique. La Monnaie est unifiée, le tael étant remplacé par le dollar d’argent – yuan -. La civilisation urbaine se développe sur la côte, surtout à Shangaï. On nommera ces dix ans de gouvernement nationaliste – 1927-1937 – la décennie de Nankin.
Un fossé énorme sépare, d’une part, les espérances de la population et les intentions du gouvernement, et, de l’autre, ce qui a été effectivement réalisé pendant la décennie de Nankin. Mais pour dresser le bilan des succès et des échecs du régime nationaliste, il ne faut pas oublier de prendre en compte les conséquences de la crise économique mondiale et, surtout, les conflits armés incessants en Chine et les menées expansionnistes du Japon qui contraignirent le gouvernement à affecter une grande partie de ses ressources tant humaines que matérielles à des tâches militaires improductives. Le cœur de la politique nationaliste de développement reposait sur la mise en place des conditions technologiques de la croissance ; une telle stratégie ne permettait pas de résoudre à court terme les grands problèmes économiques du pays. Or, la période entre l’accession au pouvoir et le début de la guerre contre les Japonais fut trop courte pour que les mesures gouvernementales aient pu prendre pleinement effet.
Lucien Bianco. La Chine au XX° siècle. Fayard 1989
M’étant mêlé d’écrire, j’ai été puni de mon impudence ;
Rebelle aux modes, j’ai offensé la mentalité de mon époque.
Les calomnies accumulées peuvent bien avoir raison de ma carcasse ;
Tout inutile qu’elle soit, ma voix n’en survivra pas moins dans ces pages.
Lu Xun. Poème de 1933
Octobre 1934
En Allemagne, l’Église (protestante) confessante (ayant refusé l’adhésion au régime nazi) se proclame seule Église authentique : elle est inspirée par le théologien Karl Barth, et les pasteurs Martin Niemöller, qui sera arrêté le 1° juillet 1937 et Dietrich Bonhoeffer, qui sera exécuté à Flossenbürg en avril 1945. En janvier 1934, la Ligue, noyau de l’Église confessante, comptait déjà 7 000 pasteurs.
11 1934
Jean Giono a 39 ans. Il ne peut oublier la guerre : Vingt ans ont passé. Et depuis vingt ans, malgré la vie, les douleurs et les bonheurs, je ne me suis pas lavé de la guerre. L’horreur de ces quatre ans est toujours en moi. Je porte la marque. Tous les survivants portent la marque. […] Nous avons fait les Éparges, Verdun-Vaux, Noyon-Saint-Quentin, le Chemin des Dames, l’attaque de Pinon, Chevrillon, le Kemmel. […] La 6° compagnie était un petit récipient de la 27° division comme un boisseau à blé. Quand le boisseau était vide d’hommes, enfin, quand il n’en restait plus que quelques-uns au fond, comme des grains collés dans des rainures, on le remplissait de nouveau avec des hommes frais. On a ainsi rempli la 6° compagnie cent fois et cent fois. Et cent fois, on est allé la vider sous la meule.
Jean Giono. Je ne peux pas oublier. Europe. Novembre 1934
2 12 1934
Johnny Weissmuller, ancien champion olympique de natation, incarne Tarzan à l’écran.
_05.jpg)
19 12 1934
En Espagne, les Cortes suspendent le statut d’autonomie de la Catalogne.
21 12 1934
La Société des Automobiles Citroën est mise en liquidation judiciaire : André Citroën avait le goût du jeu par trop prononcé pour que cela ne nuise pas à sa société.
24 12 1934
On a mis un temps certain – à peu près 50 ans – pour s’apercevoir qu’au sein des plants hybrides importées d’Amérique pour sortir de la crise du phylloxéra, il en était quelques uns qui tapaient un peu trop sur le système, la faute en revenant à l’acide anthranilique que contient leur raisin : les députés interdisent dès lors le Clinton, l’Isabelle, le Jacquez, le Noah et l’Othello, les deux derniers étant des cépages charentais. Ils ne disparaîtront pas tous du jour au lendemain, le très puissant Parti communiste soutenant cette vigne du pauvre et du paysan.
28 12 1934
Sous le ministère Tardieu, ancien journaliste, un arrêté dresse une liste de 110 professions qui bénéficiaient jusqu’à présent d’un abattement de 10 % sur leur impôt sur le revenu, car censés avoir des frais professionnels supérieurs aux autres : ils vont voir cet abattement augmenter de 30 %, soit 40 % au total. Un décret-loi en date de 30 octobre 1935 sous le ministère Laval viendra conforter cet arrêté. On trouvait dans cet inventaire à la Prévert des métiers délicieusement surannés : les ouvrières de la bonneterie dans la région de Ganges, exonérées de 5% supplémentaires, les limeurs de cadres de bicyclettes du département de la Loire (15 %), les tisseurs non propriétaires de leur métier (40 %), ou encore les journalistes, exonérés de 30 % supplémentaires pour compenser la faiblesse ou l’absence de remboursement des frais professionnels par les éditeurs.
Dans la V° république, l’avantage sera supprimé par Juppé en 1996, puis rétabli par Jospin en 1998, qui transformera les 30 % d’abattement en un forfait de 7 650 € de déduction du revenu imposable, ce qui représente un gros avantage pour les plus petits salaires des journalistes – autour de 3 000 € -, et un avantage moindre pour les gros salaires. En fait c’est un moyen comme un autre de soutenir la Presse, qui ne peut augmenter le prix de vente sous peine de les voir s’effondrer, qui a bien du mal à trouver plus de publicité. Si l’allocation est supprimée, les journalistes réclameront une compensation à leur employeur qui, n’ayant pas les moyens, demandera de l’aide à l’État.
François Boissarie du SNJ –Syndicat National des Journalistes
1934
1 500 km. d’autoroutes en Allemagne. Ann Wallace H. Carothers, américain, invente le Polymer 66 : c’est le nylon. Enrico Fermi, physicien italien qui a émigré aux États-Unis nomme neutrino une particule découverte deux ans plus tôt par Carl Anderson, qu’il avait nommé positron. Le neutrino avait été inventé l’année précédente pour des raisons théoriques par le physicien suisse Wolfgang Pauli. Le neutrino n’a pas de charge électrique et pas davantage de masse ; il possède un mouvement de rotation nécessaire à la conservation du mouvement angulaire lors du processus d’émission de particules bêta. Mais ce n’est qu’en 1956 que des expériences conduites aux États-Unis dans des réacteurs nucléaires permirent d’obtenir la confirmation expérimentale de son existence.
Mise en service à Grenoble du téléphérique de la Bastille, un fort qui domine la ville. En 2011, il transportera 350 000 passagers. Et Grenoble formera alors le projet d’un autre téléphérique, ou télécabine, peu importe, reliant sa banlieue Fontaine à Lans en Vercors, 1 380 mètres plus haut, à même de transporter 2 400 personnes par heure, à 20 km/h, réduisant ainsi le trafic automobile de 9 000 véhicules par jour ; mise en service prévue pour fin 2014.
Le constructeur d’avion italien Savoia-Marchetti fait voler un hydravion à réaction. L’allemand Werhner von Braun, au service de l’armée depuis deux ans, – il a 22 ans – lance Max et Moritz, deux petites fusées de 500 kg depuis l’île de Borkum en mer du nord : elles atteignent 2 500 mètres d’altitude ; le traité de Versailles interdisait à l’Allemagne de reconstituer une aviation militaire, tout comme des canons à longue portée : mais aucun article ne mentionnant l’existence de fusées, l’armée allemande s’était engouffrée dans la brèche. C’est Von Braun qui, sur les conseils de sa mère, choisira l’année suivante le site de Peenemünde, à 200 km au nord de Berlin, sur le littoral de la Baltique, proche du village de Karlshagen, pour poursuivre le programme, désormais sous les ordres du général Walter Dornberger. Les pères de von Braun se nommaient Konstantin Tsiolkovski -1857-1935 – russe d’origine polonaise, qui inventa le principe de la fusée à étages et de sa propulsion par combustion d’oxygène et d’hydrogène liquides, Robert Esnault-Pelterie – 1881-1957 – ingénieur français qui publiera l’Astronautique et testera sa première fusée en 1931, Robert Goddard -1882-1945 -, américain passionné de fusées : avant 1930, il en enverra une à 2 700 m d’altitude et Hermann Oberth – 1894-1989, allemand d’origine roumaine qui effectuera des tirs pour le compte des Roumains en 1930 et 1935, puis travaillera à Peenemünde de 1941 à 1943 avec son ancien élève von Braun. Ces quatre hommes avaient déterminé les trois règles de l’astronautique :
- Atteindre la bonne vitesse de propulsion : pour un simple satellite de communication en orbite basse, elle sera de 28 440 km/h. Mais, pour échapper à la force gravitationnelle de la terre et aller à la conquête des planètes du système solaire, il faudra une vitesse de 40 320 km/h. Et, pour sortir du système solaire, – ce qui sera les cas des sondes Pioneer et Voyager – il faudra atteindre 59 800 km/h.
- Concevoir un lanceur multi-étages : une fusée à un seul étage sera handicapée par son poids, qui, une fois en orbite, ne servira plus à rien. Avec une fusée multi-étages, elle se libérera par étapes des étages inférieurs pour laisser au dernier étage le soin de donner au satellite le supplément de vitesse dont il a besoin pour se mettre en orbite. Pour Saturne V, 3 000 tonnes seront nécessaires au départ pour lancer à proximité de la lune les 30 tonnes d’Apollo. Pour Ariane V, les 750 tonnes du départ mettront en orbite géostationnaire – 36 000 km d’altitude – une charge utile de 10 tonnes, porté par le dernier étage qui fera, satellite compris, 16.5 tonnes.
- Choisir le bon carburant : le meilleur est le couple hydrogène-oxygènes liquides ; mais comme c’est aussi le plus dangereux, on ne l’utilisera que pour les derniers étages, le carburant de base étant un mélange kérosène-oxygène liquide, ou même la poudre, préférée par les militaires, car évitant les longues et délicates opérations de remplissage des réservoirs.
Résumé de Espace, de la Lune à Mars Le Monde/ Histoire Juin 2013
Il faut bien souligner le rôle majeur de Wernher von Braun dans l’affaire : c’est lui qui a mis au point le V2, dernier né de la série des fusées allemandes de la deuxième guerre mondiale : et c’est ce V 2 qui servira de base à l’élaboration de tous les programmes spatiaux de l’après-guerre, qu’ils soient russes, américains ou français. Avec un avantage aux Américains, c’est qu’ils sauront convaincre – sans se donner beaucoup de mal, semble-t-il – Von Braun de venir travailler pour eux. Mais les Russes s’empresseront de mettre au panier le dossier Korolev pour l’envoyer à Pennemünde sitôt le site libéré en 1944 et les Français ne seront pas en reste en emmenant dans leur centre de recherches de Vernon 123 ingénieurs allemands de l’équipe de Von Braun.
En Russie, les fonctions de la Guépéou, la police politique, sont transférées au NKVD, qui deviendra le KGB, avec Valentin Beria à sa tête ; toutes les tâches de basse police y sont regroupées, que ce soit pour l’intérieur, procès truqués ou pour l’étranger : espionnage etc… On estimera ses effectifs à 700 000 agents, auxquels on peut ajouter six millions d’informateurs. Andreï Vychinski, le procureur de Staline, dira de la façon la plus concise qui soit, sa déontologie : Donnez-moi l’homme, je trouverai l’article de loi.
La Suisse met en place le secret bancaire.
Aux États-Unis, création du National Labor Relations Board à la suite de l’adoption du National Labor Relations Act.
13 01 1935
Les Sarrois n’ont pas peur d’Hitler : sous mandat SDN depuis 1919, ils demandent leur rattachement à l’Allemagne par référendum qui devient plébiscite, – 90.8 % de oui -. L’histoire ne dit pas s’ils le regretteront. Problèmes de mémoire ? La suppression des libertés individuelles et civiques en Allemagne remontait au 28 février 1933, les autodafés de Berlin au 10 mai 1933, la nuit des longs couteaux au 30 juin 1934…
30 01 1935
Au Québec, 10 000 spectateurs pour la première du film Maria Chapdelaine, de Julien Duvivier, inspiré du roman de Louis Hémon. Il obtiendra le grand prix du cinéma français. Maria Chapdelaine, à peu près vingt ans après la première édition, c’est déjà un triomphe littéraire : on va compter jusqu’à 250 éditions à ce jour, des traductions dans plusieurs langues, d’abondantes illustrations : Suzor-Côté, Clarence Gagnon, Thoreau MacDonald, Jean Lébédeff, Fernand Labelle ; tourné trois fois au cinéma : Julien Duvivier en 1934 avec Jean Gabin et Madeleine Renaud, Marc Allegret en 1950 dans une libre interprétation de l’œuvre et Gilles Carle en 1983 avec Carole Laure, réécrit en BD, en pièce de théâtre, en roman illustré, en radio-roman, en série télévisée. On publiera des suites au roman. Le village de Péribonka sera doté d’un musée à la mémoire de l’auteur en 1938.
Louis Hémon n’aura pas pu assister au triomphe du film, pas plus d’ailleurs qu’à celui de son roman, publié en 1914 au Québec, sans grand succès, puis en 1921 par Grasset, qui va alors lui donner une célébrité posthume : en juin 1913, il avait quitté Montréal pour l’Ouest canadien où il comptait participer aux moissons : le 8 juillet, marchant sur le rail en guise de route, il s’était fait happer par un train, aux cotés de son compagnon de voyage australien : un fort vent de face l’avait empêché d’entendre le train qui arrivait derrière lui. Né à Brest, il était parti au Canada en 1911, laissant à Londres une petite fille de 2 ans dont la mère avait été internée peu après la naissance.
1 02 1935
L’Action française manifeste contre les médecins étrangers installés en France : l’événement prendra le nom de manifestation contre les Métèques. On y voit un certain François Mitterrand.

François Mitterrand est au centre, entre deux policiers, portant un dossier sous le bras gauche
6 03 1935
Paul Reynaud présente et défend à la Chambre des députés les thèses de de Gaulle sur les forces blindées : le ministre de la guerre reste muet, socialistes et communistes sont contre : Si la France néglige ses chances de créer une armée de métier, nous verrons l’Allemagne détruire la Pologne, tendre la main à l’Armée Rouge, puis la France envahie.
*****
Si le système de de Gaulle avait prévalu, la France aurait eu deux années au moins d’avance, au lieu de quatre années de retard, dans l’organisation des grandes unités mécaniques et dans la mise au point de la tactique nouvelle.
Léon Blum Mémoires, écrites en 1940
15 03 1935
Nous ne permettrons pas qu’on entraîne la classe ouvrière dans une guerre dite de défense de la démocratie contre le fascisme. Les communistes ne croient pas au mensonge de la défense nationale.
Maurice Thorez, à la Chambre des Députés.
16 03 1935
Hitler rétablit le service militaire obligatoire, et ce, en violation du traité de Versailles.
22 03 1935
En Europe, l’Allemagne est le premier pays à diffuser un programme régulier de télévision.
30 03 1935
Nous invitons nos adhérents à pénétrer dans l’armée afin d’y accomplir la besogne de la classe ouvrière, qui est de désagréger cette armée.
Maurice Thorez. L’Humanité.
5 04 1935
Song Ziwen, ministre des finances diplômé de Harvard, beau-frère du président de la république de Chine, Sun Yat Sen, abolit le thaler d’argent pour le remplacer par le $ d’argent dont une face porte le portrait de Sun Yat Sen. En dépit de l’opposition farouche des banquiers chinois, il aura mené à son but son projet de réforme, le principal inconvénient du thaler d’argent étant de ne pas avoir la même valeur sur tout de territoire chinois : il en existait 170 différents ! Après 1911, toutes les recettes douanières auront été versées à la HSBC et la ville de Shanghai concentrait 80 % de tout l’argent chinois. Shanghai était certes chinois, mais l’activité commerciale et le droit y était occidental. Jusqu’au début des années 1930, l’argent chinois était plutôt bon marché sur le marché mondial, ce qui favorisait les exportations. Puis la grande dépression avait elle aussi atteint, et très durement, la Chine et, fin 1935, après six siècle d’utilisation, la Chine avait abandonné l’étalon argent
8 04 1935
En URSS, la peine de mort est étendue aux enfants de douze ans. Un rapport secret du Guépéou du printemps 1932 dressait un tableau catastrophique du monde paysan :
En deux ans à peine, les paysans semblent avoir totalement désappris leurs gestes ancestraux : les soins aux bêtes sont totalement négligés maintenant qu’elles n’appartiennent plus à personne, les harnais et les selles traînent dans la boue, la campagne de labours est faite n’importe comment, la terre est à peine retournée et les herbes parasites ne sont plus enlevées tant et si bien qu’une grande partie des semences est perdue.
La suite : l’immense famine des années 1931-1933 et ses six millions de morts, contraignent Staline à autoriser les kolkhoziens à conserver un petit lopin de terre : ceux-ci vont représenter 3 % de la surface ensemencée, mais 45 % de la production agricole et 80 % des revenus paysans ! Staline, en visite sur un kolkhoze, s’étonne : Comment se fait-il que sur une même terre, carottes, navets, poireaux etc… soient beaux, appétissants sur les lopins de terre individuels, et rachitiques, maigrichons sur les terres du kolkhoze ?
Que veux-tu, camarade Staline, il n’y a qu’une seule chose qui grossisse mieux dans la main d’autrui que dans la sienne.
9 04 1935
L’antisémitisme s’affiche en France sans retenue aucune, un sommet dans le fiel haineux : Ce [Léon Blum] juif allemand naturalisé, ou fils de naturalisé […] n’est pas à traiter comme une personne naturelle. C’est un monstre de la République démocratique. Et c’est un hircocerf [animal fabuleux, moitié bouc, moitié cerf] de la dialectique heimatlos [apatride en allemand], détritus humain, à traiter comme tel. […] L’heure est assez tragique pour comporter la réunion d’une cour martiale qui ne saurait fléchir. Un député demande la peine de mort contre les espions. Est-elle imméritée des traîtres ? Vous me direz qu’un traître doit être de notre pays : M. Blum en est-il ? Il suffit qu’il ait usurpé notre nationalité pour la décomposer et la démembrer. Cet acte de volonté, pire qu’un acte de naissance, aggrave son cas. C’est un homme à fusiller, mais dans le dos.
Charles Maurras. Action Française
11 04 1935
À Stresa, la France [Laval], l’Italie [Mussolini] et la Grande Bretagne [Mac Donald], s’engagent à ne plus tolérer une seule violation du traité de Versailles.
29 04 1935
Antoine de Saint-Exupéry arrive à Moscou pour Paris-Soir,– le plus gros tirage de la presse française – pour couvrir le voyage de Pierre Laval.
printemps 1935
Aux États-Unis, l’Emergency Relief Appropriation Act accorde 5 milliards $ au gouvernement pour mettre en œuvre de nouveaux projets. C’est ainsi que naquit le 6 mai la Works Progress Administration, qui prit le relais de la FERA – Federal Emergency Relief Administration –, et succéda avec succès à la Civil Works Administration, devenant ainsi l’une des agences clés du New Deal.
2 05 1935
Pierre Laval signe à Paris un traité d’assistance mutuelle avec l’URSS, puis se rendra à Moscou du 13 au 15 mai.
19 05 1935
Le colonel Lawrence (la postérité lui avait rendu son grade, mais en fait il était retourné dans l’anonymat au sein de l’armée dès 1923), Lawrence d’Arabie, meurt des suites d’un accident de moto. Le manuscrit des Sept piliers de la Sagesse a été perdu, brûlé avec une lampe à souder, réécrit trois fois, imprimé à huit exemplaires, publié en abrégé pour financer une autre version réservée à 200 souscripteurs !
Lawrence était vraiment l’habitant des cimes, là où l’air est froid, vif et raréfié, et d’où l’on domine, les jours clairs, tous les royaumes du monde et leur gloire.
Winston Churchill
29 05 1935
La Normandie [alors au féminin] relie Le Havre à New York en 4 jours et 3 heures, à la vitesse de 29,7 nœuds : le paquebot peut accrocher à son pavois le fameux ruban d’étamine bleue, long de 30 mètres, qu’il vient de ravir au paquebot italien Rex. Pour la croisière inaugurale, mille invités triés sur le volet ; parmi eux, Colette, pour le Journal.

Le Normandie par Albert Sébille 1935-1936


Toute la décoration du Normandie est de René Prou (1887-1947) ; il a décoré 15 paquebots, aménagé les cabines de l’Orient-Express, celles des trains de nuit de la Compagnie internationale des Wagons-Lits, pour le Calais-Méditerranée-Express ou le Rome-Express.

J’ai voulu avoir la Normandie pour moi toute seule. Je reconnais que ce n’est pas facile, même en quittant dès l’aube le lit et la cabine. Par ces longs jours, l’aube est sans mystère. Le rouge profond, austère, la sanguine et déchirante couleur de presque toutes les naissances qui dénonce l’approche du soleil se change vite en or, et les nuages fuselés, immobiles au ras de la mer, réchauffés, s’allègent et s’envolent.
Je voulais que l’heure ambiguë me donnât la Normandie pendant que tout dormait à bord ; mais un bateau ne dort jamais. La bordée de nettoyage, trente-neuf hommes silencieux, commence son travail à deux heures du matin, et les lumières intérieures du navire ne s’éteignent ni jour ni nuit.
N’importe !
À cinq heures et demie, les fauteuils de satin noir, en rond dans le hall du pont, n’assemblent qu’un concile d’ombres présidé par le paladin d’émail et le grand salon est rigoureusement vide. Comparons vite, pour n’être point tenue de voguer, la garde-meuble et son mobilier trop nombreux à un champ de coquelicots.
Au jardin d’hiver, un silence étrange règne encore chez les oiseaux qui, cependant, ne sont pas tous morts. Mais c’est un sort précaire que d’être bengali à bord et si près de l’avant, et soumis au vent impétueux que crée notre vitesse.
Personne à la piscine bleue et personne à son bar. La salle de culture physique offre aux athlètes fantômes sa selle de cheval, sa bicyclette sur place, sa bosse de chameau, la glissière du rowing [rameur], tout ce qui bouge, oscille, bondit, n’avance point et trompe le silence du muscle entraîné. Tous feux allumés, la Normandie donne une fête aux invisibles.
C’est un beau spectacle qu’un corridor vide quand il est assez long pour que ses lignes parallèles, plancher et plafond, semblent, à force de lointain, converger et se joindre. Pas un seul passager. Parfois, le dos bleu d’un de ces hommes de la bordée fond sitôt aperçu. Si je perdais mon chemin, pourrais-je, en courant, atteindre l’homme bleu et l’interroger ? C’est sans doute un homme de songe, et ces hommes-là ne répondent jamais.
Montons, descendons. Rien ne m’arrête. Les portes m’obéissent avec une douceur hallucinante.
Des écureuils, des chats et des chiens peints sur les murs d’une salle de jeux font le beau depuis la veille et dorment debout en attendant le réveil des enfants.
Me voici, essoufflée, sous le plafond bas et accueillant de la classe touriste. Mais, après, je m’égare. Je croie : Hep ! … S’il vous plaît ! à un homme bleu que j’entrevois, ou bien à son ombre, qui bute devant moi contre les rideaux entrebâillés du théâtre, s’y faufile. À sa suite, je m’y glisse, et j’ai tôt fait d’en sortir seule. Ce n’est pas pour moi, à coup sûr, qu’une unique étoile de lumière faible et fixe brille dans le noir, juste au milieu de la scène. L’odeur des lis blancs qui fêtent le fin de la nuit tourne un peu le cœur, et si je rencontrais un homme bleu, un vrai, un qui ne fut pas sa silhouette fallacieuse et reflet glissant sur des parois de métal poli, je lui demanderais où est la plus proche coursive. Mais, s’il n’y a même plus l’apparence du moindre homme bleu, du moins la grande haleine froide me guide et me délivre.
Gaîté du matin encore neuf, à peine mordu. Au-delà des plages d’arrière élargies, l’ample jupe du sillage s’épanouit et marque notre trace sur la mer. Mais la Normandie n’est plus à moi seule : je la partage avec quelques hommes de la bordée de nettoyage, toujours muets et furtifs. Mais, ceux-là, bien réels, par quatre. Coryphées, ils semblent danser la toilette du navire avec minutie et amour, en cadence. Sur la plage la plus basse, douce aux pieds nus, un menuisier prosterné se sert d’une doloire pour racler une imperceptible verrue du plancher. Après chaque coup léger de doloire, il tâte du doigt la place, gratte, cherche l’induration comme un médecin, attentif. Il ne quittera la place que lorsqu’il sera sûr de l’avoir guérie.
Soleil et vent du matin creusent et conseillent l’estomac. Aussi bien, il est l’heure de rendre à ses hôtes le beau domaine que m’a prêté l’aube. Dans la salle à manger aux murailles translucides, un bataillon impeccable de stewards a retrouvé la vie, sinon le mouvement, sous un plafond de basilique, au soleil d’une futaie de colonnes lumineuses. À perte de vue, des icebergs givrés et géants, orgues de cristal … Je suis seule et j’hésite à commander ce qui me paraît être, par contraste, le plus petit café au lait du monde.
Colette. Le Journal 3 juin 1935
Et, un peu plus tard, Je n’ai jamais osé raconter la vérité sur les trois jours et demi que j’ai passés à New York. J’ai parlé du beau paquebot Normandie, qui accomplissait sa première traversée. J’ai décrit ses salons dorés, ses jardins d’hiver, ses statues monumentales, ses salles de jeu, son théâtre, ses restaurants, ses oiseaux exotiques et ses magasins de nouveautés – un peu plus, j’oubliais, qu’il s’agissait d’un bateau… Et j’ai décrit, aussi bien que je l’ai pu, notre arrivée à New York : la lumière et la brume d’un beau jour découvrant et voilant tour à tour les édifices géants, que la photographie et l’écran nous ont montrés cent fois, et qui, pourtant, ne sont ni pareils, ni égaux à leurs froids portraits : l’heure et la ville étaient si belles que j’ai eu les yeux humides. Ce choc, cette conquête immédiate, est-ce que cela ne s’appelle pas, dans tous les pays du monde, le coup de foudre ? J’ai eu le coup de foudre pour New York. J’aurais bien voulu que, jusqu’au débarcadère, on me laissât à mon admiration. Mais j’avais encore à découvrir les reporters des journaux américains envoyés à la rencontre de Normandie. Lorsqu’ils sont montés à bord, je me suis heureusement rappelé que la sagesse conseille de se laisser ballotter par les tempêtes, faute de pouvoir les maîtriser. Ainsi fis-je, quand le reporterphotograph’s storm s’abattit sur moi. Jamais vague d’assaut ne trouva victime plus docile. Bloquée dans un coin, à l’arrière du Normandie, face aux assaillants et à leurs appareils, je tournais légèrement la tête à leurs commandements de Left ! Right ! Left ! Right ! et je leur livrais mon sourire le plus avantageux – quand je m’aperçus qu’ils s’occupaient, pour la plupart, de photographier mes pieds, qui sont toujours nus dans des sandales de cuir. J’ai eu une petite déception – mais j’ai continué à sourire. Tout était si beau autour de nous.
Il y eut bien, tout de suite après l’arrivée, l’affaire de la douane et des bagages… Une petite affaire sans importance, en somme, quatre ou cinq, ou six heures d’une confusion de malles ouvertes, de valises béantes sur de fragiles lingeries, sur des combinaisons en crêpe-satin dispersées par le vent de mer. Mais on me dit qu’il n’y avait là rien que d’habituel. Je n’en pris donc pas trop de souci et je n’en conservai dans ma mémoire que le souvenir que garde un chat de la première pelote de laine inextricable où il se trouva enchevêtré. Mon mari et moi nous finîmes par faire appel à la Providence d’abord, puis à un de ses envoyés, qui promit de nous apporter les bagages à l’hôtel. Le temps pressait, car nous étions conviés le soir même à un dîner de huit cents couverts, présidé par Madame Lebrun qui était du voyage, et par Monsieur La Guardia. Le Waldorf-Astoria, 35e étage, la brise légère par les fenêtres, le panorama grisant de la ville, la délicieuse eau glacée de New York… J’allais de plaisir en plaisir, mais … mais les bagages n’arrivaient pas. Vint l’heure d’aller nous asseoir devant nos 799 et 800° couverts… Et les bagages n’arrivaient pas. La nuit descend tard au mois de juin. Mais elle vient tout de même, et New York, sous nos yeux, alluma sa parure nocturne… Ces feux, ces guirlandes, ces monuments construits et soulignés par la lumière, ces disques tournoyants, ces lettres qui palpitent, la couleur du rubis flambant, du phosphore bleu et vert, le jaune solaire, un blanc pur presque insoutenable, certain violet incandescent, tout un jardin de couleurs étalé au fond de la ville qu’il fleurissait, jusqu’au faîte de ses chapiteaux, je vous jure qu’il y eut ce soir-là, à un 35° étage d’hôtel, deux Français qui ne marchandaient pas leur admiration. Il n’ était plus question de bagages, de robe du soir, de dîner de gala ! En peignoir de bain, penchée sur le bord de la fenêtre, je contemplai la féerie nocturne de New York jusqu’à ce que le sommeil me prît. Cette première infraction à un programme officiellement fixé me donna de mauvais conseils, que je suivis d’un cœur allègre. Mes trois jours francs furent mieux que francs : ils furent libres, à peu d’heures près. Non, je ne suis pas allée à un grand dîner littéraire. Non, je ne suis pas allée au banquet international des journalistes. Non, je n’ai pas été voir les musées de peinture. Oui, j’ai décliné l’honneur de visiter une splendide collection particulière. Qu’ai-je donc fait, pendant trois jours ? Rien, parfaitement rien. Ç’a été merveilleux. Rien, que des choses inutiles, enfantines, dépouillées de toute intellectualité. J’ai pris un taxi pour aller au diable acheter des stylos – on trouve les mêmes à Paris, rue de Rivoli.
J’ai passé trois heures dans le Woolworth bazar – ma cabine, au retour, était pleine. Je suis allée dans un cinéma qui contient 6 000 places, voir un film anodin de Mae Wese et 48 girls superbes, si pareilles l’une à l’autre qu’on pouvait croire qu’il n’y en avait qu’une. J’ai gravi l’Empire State Building pour le plaisir de manger là-haut des ice-cream soda couleur de savon rose et de nous faire photographier, mon mari et moi, bras dessus bras dessous, sur des cartes postales ! Quelle école buissonnière ! L’air léger de New York me grisait. Je mangeais du canard frigorifié à tous mes repas sans même m’en apercevoir. Vint trop tôt le dernier soir, justement le soir de ce grand dîner très, très intellectuel. J’y pensais depuis le matin. Je pensais que je dînerais en compagnie de brillants cerveaux de toutes les nations, et que je devrais soutenir ma petite part du prestige littéraire français. Sur le coup de sept heures du soir, je sentis que j’allais faire de grandes choses. En effet, j’entraînai mon mari en bas des trente-cinq étages, nous montâmes dans un taxi et nous nous fîmes conduire au Central Park, en pleine poussière, en pleine belle fin d’après-midi. Quel bonheur, j’avais enfin découvert quelque chose de petit à New York : un tout petit Bois de Boulogne ! Après quoi, nous nous replongeâmes dans le canard frigorifié et le cinéma, et nous rentrâmes à l’hôtel à pied voluptueusement par Broadway, multicolore, j’achetai tous les bonbons qu’on vend chez les pharmaciens, et nous les mangeâmes assis au bord d’un trottoir en causant avec un chat. Mon mari crut devoir afficher quelques remords au sujet du fameux dîner international-intellectuel. Mais pendant qu’il blâmait notre équipée, je consultai son visage : il semblait parfaitement heureux. . .
Si je retourne à New York, je sais bien que des séductions plus humaines, plus réfléchies, me prendront le cœur. Mais c’est un cœur encore vaste et sensible que le mien, quand il s’agit d’aimer. Et rien n’empêchera que, certains soirs, je redeviendrai, ne fût-ce que par gratitude, la passante enchantée de flâner au gré de ses pieds nus, poudrés de poussière, sous le joyeux incendie de Broadway, en mangeant des maïs éclatés, des bonbons à la menthe, et je mettrai encore à ma boutonnière un clip étincelant acheté pour ten cents au bazar.
Colette. Conférence sur Radio Mondial, le 18 novembre 1939
On a souvent dit que New York n’est pas une ville faite pour y vieillir. La vérité de ce brin de sagesse populaire frappe instantanément le visiteur de passage. New York, bouillonnante d’énergie, est une ville âpre, peu raffinée, inachevée, non policée, bien plus proche du Berlin de la république de Weimar que du Boston ou du Baltimore d’aujourd’hui. Elle est totalement dépourvue de l’antique grandeur de Rome ou de la morgue actuelle de Paris. Si le visiteur daigne toutefois s’y attarder un moment, il découvrira que, sous son indifférence excessive au rang ou à la position, son dédain hybride pour l’ancien et le démodé, sa soif insatiable de divertissement, de nouveauté et d’avenir, New York est l’équivalent sur terre de la fontaine de jouvence. New York peut mettre votre patience et votre intelligence à rude épreuve. Elle peut vous hisser au pinacle comme vous exiler dans vos provinces. Mais elle ne vous laissera jamais vous encroûter.
Ian Anderson. World Traveler Magazine
À l’opposé, quelques milliers de kilomètres à l’est, mais beaucoup plus loin dans le temps, aux confins de l’Europe Centrale, la Roumanie reste hors d’atteinte de cette course au confort et de l’invasion du matérialisme : Bucarest est-il une jolie ville, une jolie fille ? Nullement ; les traits du voyageur novice se contractent de désillusion, au sortir de la gare. Est-ce une très antique cité ? Encore moins ; le roi de France et ses douze pairs logeaient déjà au Châtelet du Louvre que le légendaire paysan Bucur commençait à peine à pétrir les murs de sa chaumière. Bucarest est-il un de ces nœuds vitaux internationaux où se jouent les destins des empires ? Non, car il tourne le dos aux Hongrois et par conséquent à l’Europe occidentale, met le Danube entre lui et les Bulgares, donc se coupe de l’Europe méridionale et oppose aux Moscovites un glacis de plaines qui n’arrêtent ni le vent ni les hommes et sont un véritable couloir à invasions. Bucarest jouit-il au moins, comme Vienne ou Stamboul, de privilèges géographiques qui l’imposeront à l’histoire ? Même pas ; ses princes ont essayé trois autres résidences avant de s’y fixer ; il aurait pu, il aurait dû naître ailleurs. Bucarest est-il une de ces capitales qui résument et expriment tout un peuple ? Les Roumains vous diront que Bucarest n’est pas la Roumanie, qu’il en est même souvent le contraire.
Bucarest, c’est l’auto et la radio, le cinéma et le gratte-ciel; la Roumanie ce sont les fleurs brodées, les poteries archaïques, la nature sauvage, les merveilleux costumes paysans que la voie ferrée est en train de tuer comme les étincelles de la locomotive brûlent l’herbe.
Bucarest, c’est le plâtre gâché hâtivement, la mode, le dernier cri ; la Roumanie c’est le bois et la plus précieuse des richesses humaines, le temps, père de l’ancienne foi et des anciennes techniques ; c’est le pays où rien n’est trompe-l’œil, où la fourrure se porte au-dedans et non au-dehors, où le culte de Mithra si longtemps vivace a arrosé à jamais la terre du sang des taureaux, et, laissant aux femmes l’admirable et compliqué drapé des fichus de tête, coiffe encore les hommes de ces tiares d’astrakan, de ces mitres dont l’Église hérita et que portaient déjà les prêtres de Mithra ; c’est la terre païenne qui se souvient de son passé thracique : la nouvelle lune y est célébrée comme par les sorciers vaudous des Antilles ; des hommes se costument en bêtes, à la Noël, rappelant les fresques d’Altamira ou les tam-tams sur le Niger ; les filles enterrent rituellement au printemps des figurines de glaise, perpétuant ainsi le culte d’Adonis ; les morts, on les ensevelit avec une pièce de monnaie dans la main ; aux saisons de la chasse, des danses de magie imitative, – la danse de l’ours, la danse du corbeau, – évoquent celles de la Colombie britannique ou du Mexique ; en période de sécheresse, les tziganes nues se vêtent de feuilles, courent dans la grand-rue du village et les maisons se vident de leurs habitants qui sortent arroser cet arbre humain en marche, avide de pluie.[…]
Longtemps Bucarest et la Roumanie ont été en retard, retard historique, retard artistique. À l’âge où Louis XIV dînait avec Molière, les princes de Valachie et de Moldavie ressemblaient encore à d’étranges rois de cartes qui vivaient leurs chansons de geste. La Renaissance n’arriva à Bucarest, toute essoufflée, que vers la fin du XVII° siècle; les encyclopédistes ne font sentir leur influence qu’en 1830 ; le style Louis-Philippe apparaît peu avant 1900. Mais aujourd’hui, la civilisation ne chemine plus péniblement à travers la Dalmatie ou la Serbie ; le Danube ne l’arrête plus ; elle vient par les airs, elle tombe à Bucarest, elle y fait du néo-byzantin, de l’américain, du soviétique, du collectif ; elle rattrape d’un coup le temps perdu, mais à Bucarest seulement ; elle n’a pas encore touché à l’art paysan ; celui-là n’a rien de collectif, il est individuel tout en restant anonyme (à peine une date, un nom, çà et là sur un tapis, comme en Espagne) ; il reflète la sérénité d’âme des isolés et des simples bergers, contemplateurs d’étoiles. Il a créé et il créera encore des objets qui savent mourir, mais des formes qui restent. Adorables maisons paysannes d’Olténie ou de Bukovine, blanches comme une lessive. Elles ont cinq mille ans, disions-nous ? En fait, leur durée ne dépasse pas la vie d’un homme ; faute de pierre, elles sont faites de boue et de paille hachée : mais, coulées et recoulées dans un moule éternel, celui d’une foi et d’une tradition, elles bravent les siècles mieux que ne l’ont fait les palais de Bucarest.
Si Bucarest n’est pas la Roumanie, comme le répètent les Roumains qui cherchent et trouvent dans la vie agreste et dans l’art rustique la source unique du génie moldo-valaque, c’est cependant un merveilleux carrefour de races, de figures, de mœurs et d’aventures. Les chapeaux hauts de forme et les bonnets d’astrakan scythes, les autos américaines et les charrettes ostrogothes y défilent allègrement. Mille fois dévasté, pillé, brûlé, secoué par les tremblements de terre, les pestes et les armées, mille fois relevé, son histoire fut celle d’une battue ; les voisins attendaient au débucher le gibier roumain : ils l’ont blessé, mais sans l’achever. Ce peuple de vingt millions d’âmes est difficile à détruire et le lecteur a pu se rendre compte que les divers fléaux que Dieu lui envoya, d’Attila à Lénine, n’y ont pas réussi. Son élan vital est tel qu’en moins d’un quart de siècle il avait fait d’un pays quasi anéanti et à peine conscient de lui-même, une nation parfaitement outillée, prospère et sage et que l’Europe se plaisait à donner en exemple aux peuples balkaniques.
Au sein d’une nature généreuse, le Roumain a appris à ne rien posséder, puisqu’on lui a toujours tout pris. Bâtir ? Il n’a jamais pu élever sa maison plus haut que le premier étage sans qu’une invasion ou une catastrophe géologique vinssent le rappeler à la modestie. Un Grec des temps passés donnait à son fils ce conseil : Ne construis jamais dans les principautés. Valachie, pays de malheur ! écrit Paul d’Alep. De tous les princes qui régnèrent sur le pays, on n’en connaît qu’un seul dont la tombe n’ait pas été violée. Si le Roumain a dédié à Dieu tant d’églises, ce ne peut être que pour le remercier de lui avoir laissé la peau sur les os. Mais le Roumain ne périt pas. Il tombe sans se casser. Le frappe-t-on, il se relève et sourit, avec cette politesse naturelle qui jaillit d’un bon cœur et non d’une bonne éducation. Il est le dernier représentant de la gentilezza.
Bucarest, qui n’est plus une ville de plaisirs, a conservé toute sa bonne humeur et n’a pas cessé de signifier : joie. Au plus fort de la crise mondiale, on y voit rire les gens ruinés et chacun s’installer en pleine infortune pour y vivre commodément. Occidental au front ridé de soucis, j’y ai appris que le malheur peut parfois sourire. C’est l’enseignement que nous donne ce peuple, un de ceux que ses conquérants traitèrent le plus mal ; peuple élastique qui possède au plus haut point l’expérience de l’éphémère et le fatalisme du transitoire, peuple bon nageur qui se laisse flotter et descendre à vau-l’eau en gémissant doucement et sans trop d’inquiétude, car il sait qu’il reprendra pied au bon moment ; peuple réaliste que le destin a installé aux frontières de l’Asie comme la sentinelle du bon sens, ce frère cadet de la raison raisonnante. Les Roumains ne se bornent pas à parler notre langue latine, ils entendent notre langage français, celui de l’ironie, l’ironie qui s’arrête au Dniester (en avançant vers l’est, il faudra, pour la retrouver, pousser jusqu’en Chine). Le Roumain, le Moldave surtout a de nombreux traits communs avec les Russes ; comme eux il n’est pas bourgeois, pas mesquin, il est tout impudeur, sincérité crue, élans pitoyables ; mais jamais il ne tourne comme eux, brusquement, à la bête féroce ; est-ce pour cela que Keyserling a dit qu’il est un Russe sans vie intérieure ? En effet, vous ne le verrez pas souvent s’agenouiller devant des prostituées ou rechercher la débauche comme le plus court chemin du paradis, mais vous le verrez tout le temps excuser le vol, faute vénielle : corruption, concussion, pillages, cambriolages, dettes de jeu, dettes criardes, escroqueries, tout cela n’est pas bien grave dans un pays où le parasitisme est de tradition, où les maisons ne sont pas très closes, où le mien et le tien ne sont pas, comme chez nous, rigoureusement définis et sévèrement protégés. Il avait besoin d’argent, il a volé, le pauvre, dit-on en soupirant.
Le Roumain n’est pas bourgeois, c’est vrai, dit-on, mais il est commun ! D’abord les Latins le sont tous et souvent plus que lui et puis quand il est distingué, c’est beaucoup moins bien ; son grand charme c’est justement son naturel, cette franchise qu’on pourrait croire cynique si elle n’était si simple, si bonhomme et jaillie spontanément. À mesure que les peuples vieillissent, ils perdent cette innocence édénique qui rehaussait l’éclat de leurs vertus et enlevait à leurs défauts toute acidité. La Roumanie n’est pas un pays toxique ; ses plaies sont offertes au soleil ; la pluie du ciel, la pleine lumière, la poussière des grands chemins sont ses meilleurs pansements ; sa guérison est confiée à la grâce de Dieu et à l’indulgence du diable.
Le Roumain en a tant vu qu’il ne craint plus grand-chose. Il est parfois émerveillé, mais épaté, jamais. Les préfets de Trajan lui prêchaient que si l’Empire était envahi par les Barbares ce serait la fin du monde ; Trajan est mort, les Barbares ont passé, lui est encore là. Il y a peu d’années tout le pays vivait de l’exportation des céréales et le prix du wagon de blé réglait son existence ; aujourd’hui l’exportation est arrêtée, mais la Roumanie vit toujours, et même la faim y sévit moins qu’ailleurs.
Quand le fils du Danube et des Carpathes ne peut plus satisfaire à ses besoins, il les réduit ou les supprime. Il peut attendre de pied ferme le fisc et la révolution : il n’est pas comme nous âprement et désespérément attaché aux objets. (Il est amusant sous ce rapport de le comparer aux Saxons de Transylvanie ou même aux Roumains influencés par ces Saxons ; ce sont des Suisses égarés dans les Carpathes : vie bourgeoise, fleurs aux fenêtres, poêles à l’allemande, assiettes peintes au mur et des armoires, véritables chalets historiés, pleines de beau linge). Le Roumain pur est un nomade ; comme le paysan russe il saute dans chaque train en partance, heureux de s’en aller n’importe où, d’obéir à son antique instinct de fuite devant l’invasion ; il sait que la possession attire la spoliation et que le seul meuble sans danger est son coffre léger en forme de sarcophage, rappel du grand départ, – ce coffre que les femmes du peuple travaillent toute leur vie, au fur et à mesure de leurs économies, à garnir des accessoires de leur futur enterrement – et cependant, en proie comme tous les hommes à une contradiction fondamentale, il aspire par-dessus tout à être propriétaire de la terre qu’il cultive ; mais il n’est pas l’esclave de sa terre au point où notre paysan est asservi à la sienne, où notre hobereau appartient à son château. Le fond de sa nature est une sorte de fatalisme qui lui permet de dominer avec humour les divers fléaux humains : la conscription, la tuberculose, la guerre, la syphilis, la ruine, tout en leur payant un large tribut.
Nous irons donc à Bucarest pour faire, au déclin de notre civilisation capitaliste, une cure d’insouciance. Nous apprendrons à n’attacher aux choses qu’une valeur passagère et un prix relatif, ce qui, à notre époque saturée de préoccupations financières et économiques, est la seule école de maintien aristocratique. Nous y verrons pratiquer ce dédain, qui va jusqu’à l’inconscience, vis-à-vis du doit et avoir, bases solides de notre civilisation mercantile. Le Roumain s’est toujours reposé sur autrui du soin de ses affaires. Que les Grecs, les Allemands, les Belges, les Français, les Anglais lui construisent des égouts, des routes, des fabriques, c’est leur affaire (ils en seront d’ailleurs souvent pour leurs frais) mais il n’est pas l’esclave du confort, il peut se passer de machinisme et il connaît l’art de vivre dans une éphémère opulence recouvrant une permanente pauvreté. De grandes fortunes lui sont passées par les mains ; il ne lui en reste rien. Des premières familles de boyards qui, aux XVI° et XVIIe siècles possédèrent Bucarest, aucune n’en a conservé la moindre parcelle. Il existe trois classes de Roumains, me disait un de leurs descendants : les pauvres, les très pauvres et les excessivement pauvres.
Plutôt qu’une capitale, Bucarest est un lieu de rencontre. C’est une place publique où l’on vient régler ses affaires, protester ou quémander, frapper à la porte, hier, du prince, aujourd’hui de l’État. On y vide sa bourse et on s’y emplit des idées et des mœurs d’Occident. Les plus belles résidences n’y furent longtemps que des pied-à-terre de ruraux. Vous y avez cherché en vain les mosaïques du mont Athos, les voûtes de Sainte-Sophie, les dorures de Kiev, les coupoles de cuivre vert de Vienne. Vous n’y avez pas retrouvé notre urbanisme français, nos avenues rectilignes, nos places semblables à des salons de bonne compagnie où les monuments sont comme des meubles de famille dont les siècles n’ont pas dérangé l’ordonnance. Des gratte-ciel s’y rencontrent, à côté de la désolation ruineuse de l’Orient. Ces fils de Rome n’ont pas hérité de la rigidité romaine ; chez eux rien n’est droit, tout va de travers, la politique et les rues, les habits et les autos ; les trottoirs se gondolent, les chaussées se soulèvent comme les dalles du Jugement dernier ; édifications et écroulements se succèdent parmi les quartiers inertes ou exaltés.
Bucarest n’eut jamais non plus l’esprit de cité, avec libertés et traditions corporatives bien défendues au-dedans et au-dehors ; pour posséder une ceinture de forts, d’ailleurs inutiles, il lui a fallu attendre l’arrivée d’un roi allemand. La trépidation occidentale, les figures crispées des spéculateurs en sont absentes : les brasseurs d’argent de Bucarest, chacun les connaît, il y en a deux et ils sont étrangers. Ce rythme de bourse qui nous a passé à tous dans le sang ne s’est pas transmis jusqu’ici et si le Bucarestois parcourt d’un coup d’œil la page financière des journaux, c’est pour gémir un instant sur l’anémie du change et le coma des valeurs pétrolifères. Ce n’est pas ici que les gens vivent sur leurs nerfs. Le Bulevard s’enflamme de toutes ses enseignes lumineuses et ressemble un moment à la Quarante-Deuxième Rue, mais c’est pour rire : il a voulu, sur cent mètres, jouer à être New York. À Bucarest, hier est vite oublié, aujourd’hui est sans valeur et le seul mot qu’on vous réponde et que finissent par apprendre la rage au cœur, après de longues stations dans les ministères, l’Américain ou le Suédois qui s’y sont égarés dans l’espoir de quelques concession ou de quelque adjudication, c’est maîne, c’est-à-dire : demain.
La leçon que nous offre Bucarest n’est pas une leçon d’art mais une leçon de vie ; il enseigne à s’adapter à tout, même à l’impossible. Il incarne bien sous ce rapport l’âme d’un peuple dont la patience est infinie, sublime comme celle des bêtes, et dont l’indulgent optimisme a inventé ce dicton : Grand est la jardin du Bon Dieu. Capitale d’une terre tragique où souvent tout finit dans le comique, Bucarest s’est laissé aller aux événements sans cette raideur, partant sans cette fragilité que donne la colère. Voilà pourquoi, à travers la courbe sinueuse d’une destinée picaresque, Bucarest est resté gai.
Paul Morand. Bucarest 1935
3 07 1935
André Citroën meurt d’un cancer : il était encore en pleine gloire industrielle. Inventeur avant la grande guerre d’un engrenage à doubles chevrons, il avait relancé la Société des autos Mors en Pologne, puis crée sa propre usine du quai de Javel et était devenu le grand concurrent de Renault. Citroën avait été racheté par Michelin en 1934, puis le sera, en 1974, par Peugeot.
5 07 1935
Le National Labour Relations Act, ou Wagner Act, autorise les syndicats, reconnaît le droit de grève, encourage les conventions collectives, peu de temps après l’abrogation par la Cour Suprême du National Industrial Recovery Act ; le Wagner Act en reprend une partie, tout en réalisant l’objectif de contrebalancer les pouvoirs entre les employés et leurs employeurs.
Rapidement, les taux de syndicalisation augmentèrent : ils passèrent de 9 % en 1930 à plus de 33 % en 1940 dans l’industrie manufacturière, et de 51 % en 1930 à plus de 75 % en 1940 dans les industries minières. Dans les autres secteurs, les chiffres furent similaires. Cette expérience fut suivie de près en France par Célestin Bouglé alors sous-directeur de l’École Normale Supérieure qui demanda à Robert Marjolin, futur commissaire au Plan, un rapport sur l’évolution du syndicalisme aux États-Unis.
On eut encore un Consumer’s Advisory Board, chargé de recueillir les plaintes des consommateurs, contre les prix élevés. Un Guide du consommateur (Consumer’s Guide) vit rapidement le jour, pour fixer un prix théorique des biens de consommation de base, et permettre aux acheteurs de signaler les écarts de prix entre les prix théoriques et les prix réels. Le mouvement des consommateurs contribua ainsi également, mais dans une moindre mesure à contrebalancer l’influence du patronat. Rexford Tugwell poussa à l’adoption de normes sanitaires et à la lutte contre les produits dangereux.
07 1935
Dans le quartier latin, les Africains mélangent allègrement panafricanisme et surréalisme : Nous voulons retrouver notre indépendance politique et ressusciter, à sa faveur, notre antique civilisation nègre. Le retour aux usages de nos ancêtres, à leur philosophie, à leurs organisations sociales est une nécessité vitale […] Nous voulons un État nègre unique englobant toute l’Afrique noire et les Antilles, et, au sein de cet État, nous ferons de la question des races ce qu’elles étaient avant, un élément de joyeuse diversité, d’agréments et de compétition joyeuse et non un prétexte à des antipathies bilieuses.
La Race nègre. Juillet 1935
On peut toujours rêver !
3 08 1935
Les Autrichiens inaugurent la route du col du Groβglockner dont la construction a commencé 5 ans plus tôt : à 2 504 m d’altitude, il relie le pays de Salzbourg à la Carinthie. Le chantier est allé jusqu’à employer 3 200 ouvriers.

14 08 1935
Aux États-Unis, le Social Security Act établit un système de protection sociale au niveau fédéral : retraite pour les plus de 65 ans, assurance-chômage et aides diverses pour les handicapés, la maladie et l’invalidité n’étant pas couvertes. Les aveugles et les enfants handicapés reçurent des aides financées par des subventions fédérales accordées aux États. Le New Deal posa ainsi les bases de l’État Providence (Welfare State). Progressivement, le système de Welfare State couvrit une part plus large de la population, notamment grâce aux amendements de 1939 puis 1950, mais au départ, il resta cantonné aux limites initialement imposées par Roosevelt. La retraite par répartition (en anglais Social Security) fut ainsi initiée pendant le New Deal des années 1930, dans le but de protéger les personnes âgées contre la misère. En 2005, ce système donnait toujours plus de la moitié de leurs revenus aux deux tiers des retraités du pays.
18 08 1935
En Allemagne, interdiction est faite à tout officier d’état civil de marier une aryenne et un non aryen ; l’inverse vaut aussi.
22 08 1935
S’il faut en croire Colette, les adeptes du camping étaient déjà plutôt nombreux sur les plages de la mer Mé Mé Méditerranée, sans même avoir attendu les congés payés.
Quand j’écrivais ici même, l’été dernier: Ils y viendront, au camping ! je ne prévoyais pas qu’ils y viendraient si vite, et en tel nombre. Par familles, par groupes, par camps, par villages, par nationalités, les tentes ont poussé sur la côte comme champignons d’août. Nous avons les Tchécoslovaques rouges, les Russes Blancs, les Français jaunes… Je ne parle, bien entendu, que de la couleur des corps nus, qui permet un sûr diagnostic : les blancs ne font que d’arriver, les rouges ont huit jours de brûlures, les derniers ne sont pas tout à fait cuits.
Sur tel terrain de camping où les tentes se serrent, chapiteau contre chapiteau, les campeurs peuvent goûter les plaisirs de certaines plages américaines congestionnées. Aux abords de Sainte Maxime, de Pampelonne et du Pinet, sur Cavalaire et sur La Croix, La Foux, et dans la zone boisée qu’on nomme ici, avec considération vers chez l’ancien monsieur Guitry les toits coniques de toile alternent avec les remorques dételées.
Un groupe de jeunes filles, fourbues, cherchant le gîte, échouèrent dans une demeure ruinée, où elles tremblèrent de frayeur, elles que pourtant je connais pour hardies… Nous n’avons pas peur des rôdeurs, ni de l’orage, ni des fourmis, me dirent-elles. Mais justement il n’y avait ni rôdeurs, ni vent, ni rien… C’est peut-être pour ça que nous avions si peur …
Elles ont acquis, à Cannes ou à Nice, deux tentes pour quatre. Elles sont allées grossir un camp des environs. Car le dissident, le campeur solitaire, reste l’exception. Il existe. Vous le rencontrez ici et là, seul ou flanqué d’enfants farouches, dressés à faire la corvée de bois et à récurer les deux casseroles avec du sable. Puis il se fatigue, s’amende, s’inféode, et vous le retrouvez dans un de ces camps où deux cents ennemis déclarés de la foule et de la ville sont venus s’agréger plus étroitement que dans un immeuble citadin. Vous le retrouvez parmi des insociables qui lui ressemblent comme des frères et qui ne se quitteront plus de quinze jours, de quinze nuits. Que pèse l’insociabilité, au prix des plaisirs que dispense une solidarité vaguement militaire, au prix du temps occupé, perdu en commun, et d’une sorte de poésie robinsonne : Viens voir mon île déserte, où j’invite tous les copains !
Je ne fais rien pour ôter au campeur ses illusions, l’idée ingénue et contradictoire qu’il se fait de la solitude et de l’entr’aide. Je nourris pour lui un sentiment analogue à celui qu’il éprouve pour moi. Par le beau matin du quinze août, je me réjouissais que les fêtes n’eussent apporté, dans les tamaris maigres et salés qui ont les pieds dans la mer, aucun campeur. Le temps d’aller remplir, à la prise d’eau, mes deux arrosoirs, et de revenir, une tente avait poussé, en bordure de mon enclos, à côté d’une motocyclette et d’un homme jeune à lunettes fumées.
C’est permis de camper ici ? demanda le campeur.
Je n’en sais rien, dis-je jésuitiquement. Le terrain sur lequel vous êtes ne m’appartient pas.
Bon, dit le campeur.
Il s’assit sur son sac de couchage et contempla la mer. Il avait l’air las, et sa petite tente, assujettie à la diable, battait des ailes. Je me dis, en regardant cet homme solitaire, que le loisir du campeur, dans un pays où l’on n’a guère encore pensé à lui, où rien n’est prévu pour son agrément et son repos, n’est pas très gai. Et, pardessus ma clôture quasi idéale, j’ouvris des pourparlers de paix :
Monsieur, vous avez l’air de le faire exprès! Planter votre tente en plein nord quand le mistral se lève ! Il ne manque pourtant pas d’endroits meilleurs. Cent mètres plus loin, derrière cette espèce de dune, tenez…
Mais la faveur, cette année, va nettement à l’ attirail léger et sommaire, à la tente individuelle, de même forme et pas beaucoup plus grande qu’un journal mi-plié. Contraint d’économiser, le campeur, qui roule son abri sur une bicyclette, suspend sa casserole au guidon et endosse son rücksack 2, parle sans respect – non peut-être sans envie – de la confortable remorque-roulotte : Ça fait vieux, ce bazar ! Cette année, il met sa maison au vestiaire, chaque fois qu’il a le caprice de danser une nuit à Saint-Tropez, se baigner à la Nartelle, voir le gala de Saint-Raphaël, acclamer le feu d’artifice de Cannes. D’ailleurs, où voulez-vous qu’il couche ? Tout est plein.
Inquiets des chances d’incendie, les propriétaires des pinèdes clouent aux troncs l’avertissement : Camping interdit.
Le mistral grandissant, comme je parlais, enleva l’un des piquets de la tente, qui ressembla encore davantage à une mouette, retenue par une patte. Et il fallut bien que j’aidasse l’homme à lunettes, qui poursuivait sa couverture échappée et ses deux casseroles, et cherchait son petit maillet … Je ne pouvais faire moins, après, que de mettre l’eau douce et le vin rosé à la disposition du maudit, du paria, de l’exécré – du campeur enfin – , qui n’avait déjà plus, quand je m’en allai, l’air si fatigué, la mine si orpheline …
Le soir, les feux des phares tirent de l’ombre, au passage, les villages blancs aux murs de toile, qui dorment. Les dormeurs n’y sont pas très bien couchés. Mais sur leurs têtes, mais à leurs pieds, murmurent les pins, et la mer. Et dans le camp, un insomnieux tousse, sa femme rêve haut, un enfant roule à bas de son hamac, une tarente en chassant renverse la bouteille de lait : qu’importe, pourvu que murmurent la mer, et les pins. Songez au long espoir de ceux qui gisent là, songez au chemin qu’ils ont couvert. Faites cet effort amical de mesurer, à sa patience, à son optimisme, à sa résignation, la vivace poésie du campeur : il est venu de très loin pour entendre murmurer les pins de Provence, et la mer.
Colette. Le journal 22 août 1935
29 08 1935
La Reine Astrid de Belgique, princesse de Suède, meurt dans un accident de voiture à Küssnacht, au bord du lac des Quatre cantons, en Suisse.
08 1935
Dust Bowl – tempêtes de poussière – aux États-Unis : c’est en fait toute la décennie des années 1930 qui a connu cette catastrophe écologique, touchant les États des grandes plaines centrales, dont le principal responsable serait le surlabourage.
Eté 1935
Vitale Bramani, dans le civil petit industriel de la banlieue milanaise – il fabrique des tubes et tuyaux d’irrigation – est aussi alpiniste chevronné ; il emmène une collective, ils sont 19, faire l’ascension de la Punta Rasica, 3 300 mètres, au sud-ouest de Saint Moritz, dans l’Engadine italienne. À cette époque, l’usage est de marcher en grosses chaussures à clous jusqu’au pied de la paroi et de faire l’escalade elle-même en espadrilles à semelles de corde. Mais ils sont pris dans une tempête de neige combinée avec un brouillard épais, qui coûte la vie à 6 d’entre eux. Et Vitale se dit que si tous avaient eu pour l’ensemble de la course de bonnes chaussures qui protègent le pied du froid et qui adhèrent bien au rocher, ce drame n’aurait probablement pas eu lieu. Il est dans le caoutchouc … il se procure du caoutchouc vulcanisé breveté par Gooyear et commence à faire des essais avec ce matériau résistant à l’abrasion et à la traction. Pirelli lui apporte son concours ; la mise au point du produit est longue et évidemment retardée par la guerre, mais en 1947, Vitale Bramani sort la semelle Vibram – les premières syllabes de ses prénom et nom -. La conquête du K2 en 1954 par une équipe italienne lui donnera une notoriété bien méritée. Finis les godillots à clous dont on perçoit très vite les inconvénients, essentiellement le glissement sur les surfaces rocheuses lisses, surtout mouillées, et dont a bien du mal à voir les avantages !
Billy Butlin, forain de son état, achète une vaste prairie en bordure de mer, non loin de Skegness, sur la côte est de l’Angleterre : il y construit un vaste camp de vacances offrant à la fois hébergement et distractions de toutes sortes à un large public populaire : il avait observé que la formule du Bed and Breakfast ne pouvait satisfaire les familles, les logeurs ayant l’habitude d’interdire l’accès de leur maison pendant la journée. Le Butlin Luxury Holiday Camp est construit en six mois : 600 chalets de taille variable, en béton et en bois, regroupés par îlots ; eau et électricité partout, les sanitaires étant pour deux chalets : pour l’ouverture, à Pâques 1936, le camp affiche complet. Il forme un corps d’animateurs avec pour mission essentielle de mettre de la bonne humeur. Le coût d’une semaine de séjour, dans les périodes les plus creuses, est identique à ce que gagne dans le même temps un ouvrier. Butlin double la capacité de son camp et en construit un autre à Clacton. Son slogan : Holidays with pay, holidays with play. A week’s holiday for a week’s wage. En septembre 1939, lorsque la guerre éclate, la capacité de Shegness a été portée à 5 000 personnes, celle de Clacton à 2 000, et un 3° camp est en construction à Filey, dans le nord. L’activité repart en 1946, en s’orientant vers une clientèle un peu plus argentée : en 1960, on comptera 9 camps Butlin, avec une capacité de 48 000 lits.
En 1951, le Français Gérard Blitz, en créant le Club Méditerranée, n’inventera rien : l’idée lui était venue en lisant un reportage enthousiaste sur les villages de la joie.
Résumé de Bernard Kapp. Un créneau astucieux : le village de vacances. Le Monde 27 06 200
1 09 1935
La Pravda annonce qu’à Irmino, dans le centre du Donbass, le mineur Alexeï Stakhanov a battu, dans la nuit du 30 au 31 août, tous les records de productivité en sortant 105 tonnes de charbon en 6 heures alors que la norme théorique et jamais atteinte ne dépassait pas 7 tonnes ! Alexeï Stakhanov va devenir très vite héros national, élevé au sommet de la morale prolétarienne. La légende tiendra jusqu’en 1989, inscrite dans tous les manuels scolaires ! L’escroquerie, – car c’en était une -, avait été montée par son chef d’équipe : les 105 tonnes avaient bien été extraites en 6 heures… mais par une équipe de 15 hommes !
3 10 1935
Mussolini envahit l’Éthiopie : De Bono, puis Badoglio partent de l’Érythrée, Graziani de Somalie. Contre de vieux fusils, les Italiens n’avaient pas seulement mis en action des chars et de l’aviation, mais aussi de l’ypérite [C₄H₈Cl₂S] ! L’Italie est sanctionnée par la Société des Nations : le front de Stresa est rompu.
13 10 1935
Des parlementaires de gauche ont signé un manifeste contre l’invasion de l’Éthiopie par Mussolini. L’extrême droite bien sur s’insurge : Ceux qui poussent à la guerre doivent avoir le cou coupé. Comme la guillotine n’est pas à la disposition des bons citoyens, ni des citoyens logiques, il reste à dire à ces derniers : vous avez quelque part un pistolet automatique, un revolver ou même un couteau de cuisine ? Cette arme, quelle qu’elle soit, devra servir contre les assassins de la paix, dont vous avez la liste.
Charles Maurras. Action Française
L’article lui vaudra huit mois de prison, qu’il passera à la Santé, tout en continuant à écrire ses éditoriaux sous le pseudonyme de Pellison. Il recevra fréquemment la visite de Robert Brasillach qui décrira ses conditions de détention dans Notre avant-guerre : On passait plusieurs grilles, on montait un escalier en colimaçon très théâtral, et on arrivait à l’étage des condamnés politiques. Charles Maurras y était seul. Il avait tapissé le mur de sa chambre de photographies de Martigues et de Grèce, d’images, et même, on voyait épinglée au mur une caricature de lui- même à la Santé par Jean Effel. La pièce voisine, qui lui servait de réfectoire, était pleine de fleurs. Nous descendîmes dans une cour étroite, ornée de quelques arbres. N’est-ce pas que je suis bien me dit-il sincèrement. C’est délicieux. Il me semblait ne voir que les fleurs, les images, les livres amoncelés en tas géants. Pourtant, on venait tous les jours, dans cette prison qui n’était plus un asile, l’entretenir de toutes choses et des querelles du monde.
31 10 1935
S’il avait de son côté la Chambre des représentants et le Sénat, Roosevelt se heurta à la Cour suprême qui refusa plusieurs textes. Mais il parvint à la réformer. Dans un discours au Madison Square Garden, il en appela pour être réélu à la présidence à ses électeurs de 1932. Tous les instituts de sondage le donnaient alors perdant, tant avaient été nombreuses et rudes les oppositions au New Deal. Il remporta en fait une victoire écrasante : 46 États sur 48, avec un écart de 11 millions de voix.
11 11 1935
Les américains Orvil A. Anderson et Albert W. Stevens, montent à 24 013 mètres d’altitude à bord du ballon stratosphérique Explorer II : le record allait tenir 21 ans.
10 12 1935
Frédéric Joliot et Irène Curie obtiennent le Nobel de chimie pour leur découverte de la radioactivité artificielle. On ne sait pas très précisément si Frédéric était un saboteur du PC, ou un cynique, ou un candide, ou quelqu’un qui ne pouvait consacrer la moindre parcelle d’intelligence à une activité autre que la science… toujours est-il que cela ne le gênait pas du tout de déclarer : Je suis communiste parce que cela me dispense de réfléchir.
17 12 1935
Premier vol du bimoteur DC 3, de Douglas ; ce sera le Dakota de l’armée française en Indochine, quinze ans plus tard, bon pour toutes les missions. Aux approches de l’an 2000, on en trouvait encore quelques uns en service.
30 12 1935
La benne descendante de Planpraz, à Chamonix, heurte la plate forme du second pylône. On arrête tout, et les passagers descendent par la dite plate forme. Mais ceux de la benne montante sont plus ennuyés : ils ne sont pas arrêtés à un pylône et les employés ont oublié les équipements de secours : ils se libéreront en utilisant en guise de corde leurs chemises, ceintures, pantalons.
1935
L’Anglais Alan Turing, 21 ans, expose dans un article destiné aux spécialistes de logique mathématique les fondements de la théorie informatique moderne. Les artilleurs de la Royal Navy ont pour cible à l’entraînement le drone Queen Bee. Les Penguin Books, premiers livres de poche, apparaissent en Angleterre. Sortie des Temps modernes de Charlie Chaplin. La Gaumont fait faillite. Exposition Universelle à Bruxelles. Pour 12,5 M. de salariés, la France compte 2 M. de chômeurs. L’Anglais Robert Watson Watt découvre le radar, et l’Américain Edward C. Kendall la cortisone.
Messali Hadj, algérien de Tlemcen immigré à Paris, est un des leaders les plus en vue de sa communauté ; dès 1927 il s’est mis à parler de l’indépendance totale de l’Algérie. Il a adhéré jusqu’alors à l’Étoile nord-africaine, proche du parti communiste français. Souhaitant s’en affranchir, en donnant la prépondérance à sa fibre nationaliste, il fonde le PPA – Parti Populaire Algérien – qui va devenir très proche du PPF – le Parti Populaire Français, de Jacques Doriot qui sera un des plus solides partisans du régime de Vichy pendant la guerre. Sa popularité lui vaudra un semi-exil pendant la guerre et jusqu’au début de la guerre d’Algérie. Il perdra le contact avec ses partisans, fondera le MTLD – Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques -, puis le MNA – Mouvement National Algérien -. Quand arrivera la perspective des accords d’Évian il cherchera à se faire inviter à la table des négociations, mais sera mis sur la touche par le FLN.
Fuyant les persécutions nazies, 59 000 juifs émigrent en Palestine.
Salvador Dali écrit à André Breton. Du grand délire, qui aurait justifié l’internement. En 2022, on enverra les gens en prison pour beaucoup moins que cela. Extraits…
Cette religion sera physique dans le moral, psychologique dans le cérémoniel, biologique dans les mythes et le social, fanatique dans le rationnel marxiste matérialiste, dialectique dans l’irrationnel, délirante et hitlérienne dans l’affectivité, scientifique dans les dogmes
[…] Je crois de plus en plus que nous, surréalistes, en fin de compte, allons devenir des curés. Il y a longtemps que cette idée me travaille, à tel point que je place parmi mes projets urgents celui d’inventer une religion
[…] l’anéantissement de l’inflation scandaleuse de l’altruisme chrétien, […] on ne veut pas le bonheur de tous les hommes, mais le bonheur de certains au détriment de certains autres, car la souffrance de ceux-ci est la condition psychologique, biologique et physique première pour le bonheur des autres. […] Les sacrifices humains seront l’apothéose de l’injustice au sens chrétien du mot.
[…] le matériel des sacrifices humains parmi les hiérarchies expansives et imaginatives, car le luxe de l’angoisse, et pourtant de plaisir que doit leur procurer la possibilité de la peine de mort est essentiel à tout épanouissement vital. […] la domination ou la soumission à l’esclavage de toutes les races de couleur (chose peut-être pas impossible si tous les Blancs s’unissaient fanatiquement) pourrait procurer d’immenses possibilités de plaisirs immédiats aux hommes blancs.
Je rêvais souvent d’Hitler comme s’il s’agissait d’une femme. Sa peau, que j’imaginais blanche, me séduisait. […] Hitler incarnait pour moi l’image parfaite du grand masochiste qui déchaînait une guerre mondiale pour le seul plaisir de la perdre et de s’enterrer sous les ruines d’un empire, un acte gratuit par excellence qui aurait dû susciter l’admiration surréaliste.
Très cher Breton, voici quelques notes qui pourront peut-être nous servir pour le laboratoire secret de Contre-Attaque. Je ne doute pas qu’on peut tirer de cela au moins une atmosphère antichrétienne et biologique, climat conditionnel de toute nouvelle idéologie subversive de mon point de vue.
Salvador Dali à André Breton
J’ai peint L’Enigme d’Hitler qui, en dehors de toute intention politique, résumait les symbolismes de mon extase. Breton s’est senti outragé. Il n’a pas voulu admettre que le maître des nazis n’était pas pour moi autre chose qu’un objet de délire inconscient, une force d’autodestruction et de cataclysme prodigieux, expliquera Dali dans ses Confessions inconfessables (1973).

L’Énigme d’Hitler. Salvador Dalí. 1939. 51.2 cm x 79.3 cm. Musée National. Centre d’art Reina Sofia, Madrid. La photo dans l’assiette est celle d’Hitler.
Le baron de Coubertin déclare à la radio de Berlin : Une olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. […] Le véritable héros olympique est à mes yeux, l’adulte mâle individuel. Je n’approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie pas qu’elles doivent s’abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux Olympiques, leur rôle des femmes devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs.
L’India Act accorde une forme d’autonomie à l’Inde. Mais le parti du Congrès, représentant quelque 260 millions d’Hindous, avec à sa tête, Nehru et Gandhi, exige l’indépendance complète du pays.
Dans le Massif du Mont Blanc, les Allemands Meier et Peters réussissent la première de la face nord des Grandes Jorasses. Louison Bobet a dix ans : fils de boulanger, il livre le pain à vélo dans la campagne bretonne, avec des chargements de 40 kg. Il lui faudra parfaire son entraînement, mais c’est là que s’est forgée la volonté.
Ella Maillart, Suisse, est en Asie Centrale, au sud de la mer d’Aral. Elle y apprend l’existence d’une colonie allemande de Mennonites et emprunte un vélo pour s’y rendre depuis Khiva.
Je pars vers le sud, vers Ak-Metchet, la deuxième oasis, où est la colonie allemande . On me disait à la poste :
- Vous savez, ils ont leurs fêtes à eux : tout d’un coup, on les voir arriver avec de beaux habits, endimanchés. Ils viennent tous les trois jours au marché avec leur beurre et leurs fruits.
- Et quand ils sont arrivés dans le pays, ils ont dû promettre au khan qu’ils n’élèveraient pas de cochons pendant cinquante ans !
- Ils ont de la chance : ils reçoivent des paquets de riz et de pharmacie d’Allemagne.
Champs desséchés, fermes-fortins, pistes encombrées par les déblais d’aryks. Je pédale depuis longtemps : deux fois j’ai cru toucher au but et maintenant je vois des arbres très très loin, de l’autre côté du désert !
[…] Je me dirige vers une ferme de belle apparence entourée de peupliers jaunissants, aux fenêtres à rideaux blancs. J’entends :
- Maria, wer kommt dort ?
En allemand, je demande à un jeune homme où habite Otto Theuss. Je m’attends à une explosion d’étonnement. Pas du tout ; discret, grave et blond sous son bonnet fourré, il m’indique un groupe d’habitations dont je ne vois que les cours de ferme. Des vaches boivent à une fontaine couverte, conduites par un Ouzbek. Deux jeunes filles s’occupent de moi, timidement. De l’eau dans un seau, une cuvette blanche, un savon, un essuie-mains ; table de cuisine, fourneau en briques, tous est net, comme les angles de la maison.
- Oh oui ! disent-elle, cela donne beaucoup de travail, il faut réparer le pisé chaque année : il se fend, s’émiette, laisse passer la pluie
Dans la chambre – les filles posent leurs sabots avant d’entrer – une grande table et des bancs, un poêle en terre, des versets bibliques aux murs, un buffet de campagne, deux tantes à lunettes qui tricotent dans leur fauteuil droit. Sur un guéridon, la Vossische Zeitung qui arrive ici en dix-huit jours. Les tantes ne cachent pas leur étonnement.
- En bicyclette vous êtes venues ? Et seule ! Vous n’avez pas peur ?
- Ah, vous venez de Kirghizie ? Moi aussi : j’ai quitté Aoulié-Ataoù la vie devenait trop difficile pour nous. De la Volga, nous avons aussi des parents qui arrivent ; maintenant nous sommes trois-cent quarante dans la colonie. On se serre pour nous faire place.
- Oui, je lisais dans Ali Suavi que Khiva si isolée a toujours été une terre de refuge ; mais dites-moi, les Ouzbeks voisins doivent prendre exemple sur votre colonie, si bien dirigée ?
- Cela les laisse indifférents : ils n’ont pas besoin de tout ce qui nous est indispensable. Un turkmène a vécu deux ans dans notre famille, un garçon intelligent qui, pour finir, parlait notre dialecte platt-deutsch comme un des nôtres. Savez-vous ce qu’il nous a dit quelques jours avant son départ ? Vous êtes des drôles de gens compliqués, vous autres ; pourquoi faut-il qu’une personne passe son temps trois fois par jour pour laver quinze assiettes, et des couteaux et des fourchettes, alors que seul un plat est nécessaire ?
Le souper est prêt, on s’assied. Otto Theuss fait une courte prière à haute voix dans laquelle il veut bien mentionner l’étrangère de passage.
Ici, l’âge seul importe. Et même les fils mariés parlent à voix basse, un œil louchant vers le père. Je retombe en enfance, tourne sept fois ma langue avant de poser une question et mâche lentement pour n’avoir pas fini avant les autres. Nous mangeons des œufs à la coque avec du pain bis beurré et du café au lait. Il y a du miel pour les aînés. Les visages sont honnêtes, propres, avec des tâches de rousseur. Les fronts carrés montrent l’obstination qui a sauvé leur groupe, il y a cinquante ans. Les femmes ont les cheveux tirés avec une raie au milieu et des tresses en chignon.
- Oui, j’ai fait un bon voyage; à Karakol et à Tourkoul, j’ai observé les meilleures conditions de vie, dans les deux villes les plus éloignées du chemin de fer que j’ai visitées.
- Les nouvelles que nous lisons dans notre journal allemand au sujet de l’Europe ne sont guère réjouissantes.
- Oui, on croirait que les hommes se provoquent mutuellement à commettre des erreurs…
- Chaque jour, nous remercions Dieu de ce que nous n’avons pas oublié nos principes…
Otto Theusse est petit, yeux bleus, moustaches rousses ; son crâne osseux est chauve. Il donne avant tout l’impression d’être pratique et décidé. J’ose enfin lui confier l’ignorance où je suis de ce que sont des mennonites.
Notre secte a été fondée en Hollande par Menno Simons au début du XVI° siècle; elle réunit ceux qui croient aux doctrines des anabaptistes et s’oppose à la violence, à la guerre et aux autorités civiles. Il y eut tout de suite des adeptes à Zurich et à Bâle aussi. Nous sommes un demi-million dans le monde. Nous avons trois principes : ne jamais toucher une arme, ne pas prêter serment, parce que notre oui doit être oui, et recevoir le baptême seulement après avoir appris et cru.
Autrefois, le roi de Pologne nous fit venir de Frise pour assécher les marais du Dantzig. Plus tard, après la révolution de 1848, le service militaire devint obligatoire pour les habitants de la Prusse. Alors nous demandâmes asile au tzar pour une centaine de nos familles. Il y avait déjà des colonies prussiennes en Russie, mais, grâce au train, les dernières venues s’installèrent avec beaucoup d’objets en fer de chez nous.
D’après nos écrits, nous savions que notre migration vers l’est n’était pas terminée. On annonça que le service militaire serait obligatoire en Russie en 1881. Alors, encouragés par le général Kaufmann, gouverneur du Turkestan, qui nous promettait des terres et nous garantissait la liberté, nous quittâmes la Volga le 3 juillet 1880 en route pour Tachkent. Dix mille des nôtres sont aussi partis pour l’Amérique.
Il paraît qu’à ce moment-là, le mouton valait un rouble trente à Ouralsk. Mais le voyage fut très pénible, nous faisions quatre verstes à l’heure. À Aktioubinsk, il n’y avait plus d’avoine pour nos chevaux. À travers le désert, il fallut faire transporter nos chars démontés par quatre cents chameaux. Regardez : les montants de cette porte sont faits avec un brancard.
Nous passâmes l’hiver près de Tachkent et quelques uns s’établirent à Aoulié-Ata. En 1881, Alexandre II assassiné, Kaufmann fut victime d’une attaque, sans que rien n’ait été fixé par écrit à notre sujet.
Décidés à demander asile à l’émir de Boukhara, nous repartîmes, passant par Samarcande. Les nôtres ont alors vu de curieuses mœurs sous les yourtes ; ils s’étonnèrent de voir manger de la viande de chameau, et qu’un seul bol fit le tour de l’assemblée. On dépeçait un mouton en soufflant sous la peau par une patte, répandant ainsi les microbes.
Les beks locaux n’étaient pas d’accord avec l’émir et, pour finir, ce fût Asfendiar, Khan de Khiva, qui nous donna des terres.
La khan avait besoin de nos charpentiers très habiles qui polissaient bois et parquets ; il apprit par eux que les Turkmènes avaient volé nos chevaux et nos vaches. Il envoya des Djiguites pour nous protéger. Et c’est alors que nous avons reçu Ak-Metchet où il avait cent trente-neuf abricotiers.
Kahn et dignitaires étaient Ouzbeks ; ils abusaient de leur position avantageuse, en amont sur l’Amou-Daria, pour couper parfois l’eau d’irrigation destinée aux Turkmènes. C’est ce qui motivait les incursions de ces derniers.
Chacun était déjà parti lorsque je me lève, et je déjeune seule. Une jeune fille me conduit chez le vieux Riesen.
[…] Emil Riesen, le vieux maître d’école, barbu et édenté, aux beaux yeux gris, porte en lui un monde de souvenirs, tous les événements de cette époque originale.
- Nos débuts ici furent difficiles : nous arrivions sans un sou. Nous vendions pour quatre-vingt kopecks au marché des petites lanternes que nous fabriquions, et puis des chaussettes, des blouses. L’un de nous a réparé le phonographe du khan. Sur tous les meubles que nous faisions pour lui, il y avait des décalcomanies qu’il aimait beaucoup.. Comme je savais l’ouzbek, c’était toujours moi qui étais chargé des démarches officielles. Au moment du couronnement de Nicolas II, le khan Seid Mouhammed Rahim me prit avec lui comme interprète à Moscou où il loua un palais pour trois cents roubles par mois. Comme la tsarine lui demandait ce qu’il pensait de Moscou, il répondit qu’il se sentait mieux dans son trou de lièvre à Khiva. Il n’était à vrai dire qu’un paysan intelligent, à l’opposé d’Ispendal qui mangeait avec nos instruments et pouvait être l’égal du tsar. Riesen me montre une série de photographies où les dignitaires de la cour sont tous revêtus de splendides khalats brochés.
- Le khan nous aimait mieux que ses sujets et nous donnait des khalats quand nous devions apparaître à sa cour. Il était prêt à me payer très cher pour que je devienne musulman.
- Mais cette photo ? C’est une ferme américaine
- Oui, c’est chez ma sœur au Kansas, où j’ai passé six mois après avoir été déporté à Angora : j’avais été accusé d’espionnage pour le compte de l’Allemagne et je fus libéré à la chute de Kerenski [dernier premier ministre du tsar avant l’arrivée au pouvoir de Lénine].
Pendant que nous bavardons, sa femme, douce petite souris, remplit ma musette de biscuits à l’anis et me fait signe que je peux continuer à vider le plat posé sur la table.
Chez la voisine, les femmes filent avec un grand rouet.
Au milieu de la place, deux cubes en pisé, nets, avec des fenêtres blanches : l’école et la maison de prière. Cette dernière, ici au centre d’une République soviétique, est émouvante dans sa simplicité ensoleillée. Des rangées de chaises, séparées par un couloir qui mène au pied de trois marches : là, un pupitre noir se détache devant le mur blanchi à la chaux. Sur le pupitre je lis : Herr ! hilf mir !
Un harmonium, un beau candélabre, c’est tout.
- Nous n’avons pas de pasteur, mais plusieurs de nos frères sont appelés tour à tour à lire et à commenter régulièrement la Bible.
Dans la classe règne une bienfaisante chaleur quand on vient du dehors. Côté filles, côté garçons ; des cartes de géographie, une mappemonde, un tableau noir entre les deux fenêtres. Un paquebot de la Hamburg, Amerika Linie.
On se lève quand nous entrons et on entonne un cantique, puis la leçon de lecture reprend dans un récit biblique. Ce sont les même livres qui servent depuis vingt ans.
Ella Maillart Des monts célestes aux sables rouges Paris, Grasset 1934

Church and school (Ella Maillart – Musée d’Elysee)
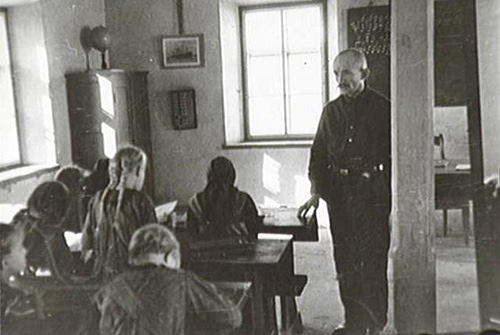
Johann Toews teaches class in Ak Metchet, 1932

Church interior, 1932
Un peu plus tard, elle va s’associer à Peter Fleming, correspondant du Times, pour traverser la Chine d’est en ouest : Qu’on soit historien, philologue, mystique ou voleur de chevaux, cette lente traversée de la côte chinoise à l’Inde mogole est sans doute le plus beau trajet de pleine terre qu’on puisse faire sur cette planète. Prenez la mappemonde et trouvez-moi mieux ! On y passe du grouillement chinois à la solitude et au silence, des plaines côtières à des cols si hauts qu’il faut saigner les chevaux aux naseaux pour qu’ils puissent respirer. Même à travers les steppes du Tsaïdam où l’homme est plus rare que l’antilope, cet inconnu démesuré n’est jamais monotone. Même sur une piste qui paraît déserte, il a passé depuis trop longtemps trop de monde et il s’est passé trop de choses pour qu’un œil exercé n’en décèle pas la trace, ou un de ces changements imperceptibles tels ceux si bien sentis par Ella Maillart, qui annoncent le passage du bouddhisme au monothéisme islamique. Un soir, du haut d’une dune, les voyageurs aperçoivent vers l’ouest quelques queues de yak qui claquent sous le vent. C’est une tombe musulmane. Nous sommes au bord d’un nouveau versant de l’Asie… les cadavres n’y seront plus abandonnés aux oiseaux de proie comme ceux des Mongols, la farine sera cuite au four au lieu d’être mélangée au thé, les prières monteront vers l’invisible Allah au lieu d’être marmottées devant les bouddhas de terre cuite.
… Enfin quand il n’y a vraiment rien que les montagnes, la carcasse des bêtes abandonnées et le sable, le seul cheminement quotidien, la grande dérive du voyage prend son sens véritable et, pour celui qui s’y abandonne, sécrète une sorte de bonheur.
… Sur l’exemplaire qu’elle m’a donné, l’auteur a écrit un voyage où il ne se passe rien, mais ce rien me comblera toute ma vie.
Nicolas Bouvier, préface du livre d’Ella Maillart : Oasis interdites.1989
Kumbum est le plus grand monastère du pays d’Amdo et abrite en ce moment 3 000 moines ou lamas tibétains, mongols ou chinois, de toute espèce. Chaque année, les pèlerins s’y rendent en très grand nombre, apportant les riches offrandes qui leurs assurent une place au ciel après leur mort. Il y a tant d’or à Kumbum qu’on a pu en couvrir les toitures du grand temple ! Il est seul à étinceler comme un joyau au milieu des terrasses incolores des maisonnettes environnantes.
Le plus grand pèlerinage de l’année a lieu en février au moment de la fête des fleurs ; à cette occasion les lamas font d’admirables fleurs sculptées et des panneaux décoratifs coloriés, en beurre par le froid solidifié.
Contrairement aux autres lamaseries, toute l’architecture des temples de Kumbum est chinoise, aux toits incurvés ; seules les fenêtres des bâtiments officiels, rouge sombre, sont bizarrement entourées d’un cadre clair qui va s’élargissant vers la base et des étages de poutrelles symétriquement superposées de la terrasse supérieure reposent sur les fascines et tondues pour ne pas dépasser le mur.
Ella Maillart. Oasis interdites. 1935
Suivant en cela les recommandations de la SDN, la France refuse de transporter par son chemin de fer de Haïphong à Kun-Ming, capitale du Yunnan l’opium qu’on y produit : qu’à cela ne tienne, les Chinois le transporteront à Canton à dos d’hommes et de bêtes, par les pistes des deux Kouang.
Smedley D. Butler, militaire américain à la tête de nombreuses expéditions lors de sa vie active, maintenant en retraite, fait un bilan de sa vie professionnelle : J’ai passé 33 ans et 4 mois comme militaire dans la force la plus efficace de ce pays : l’infanterie de marine. J’ai franchi tous les échelons de la hiérarchie, du grade de sous-lieutenant à celui de général de division. Et, durant toute cette période, j’ai passé la plupart du temps comme sicaire de première classe pour le haut négoce, pour Wall-Street et les banquiers. En un mot, j’ai été un tueur à gages au service du capitalisme… Par exemple, en 1914, j’ai aidé à ce que le Mexique, et plus spécialement Tampico, soit une proie facile pour les intérêts pétroliers américains. J’ai aidé à ce qu’Haïti et Cuba deviennent des lieux convenables pour le recouvrement des rentes de la National City Bank… En 1909-1912, j’ai aidé à épurer le Nicaragua pour la Banque internationale Brown Brothers. En 1916, j’ai apporté la lumière à la République Dominicaine, au nom des intérêts sucriers nord-américains. En 1903, j’ai aidé à pacifier le Honduras, au bénéfice des compagnies fruitières nord-américaines.
13 02 1936
Après l’agression dont a été victime Léon Blum, le gouvernement dissout l’Action Française et les Camelots du Roi.
____________________________________________________________________________________________
[1] Le monstre… c’est le Japon