| Publié par (l.peltier) le 30 août 2008 | En savoir plus |
15 02 1954
Le FNRS III, – Fonds National pour la Recherche Scientifique – un bathyscaphe, reconstruit selon un projet franco-belge par le Commandant Houot et l’ingénieur Pierre Willm, descend à 4 050 m. L’un des ingénieurs présent sur la campagne de plongée s’appelle Henri Delauze… qui n’a pas fini de faire parler de lui.
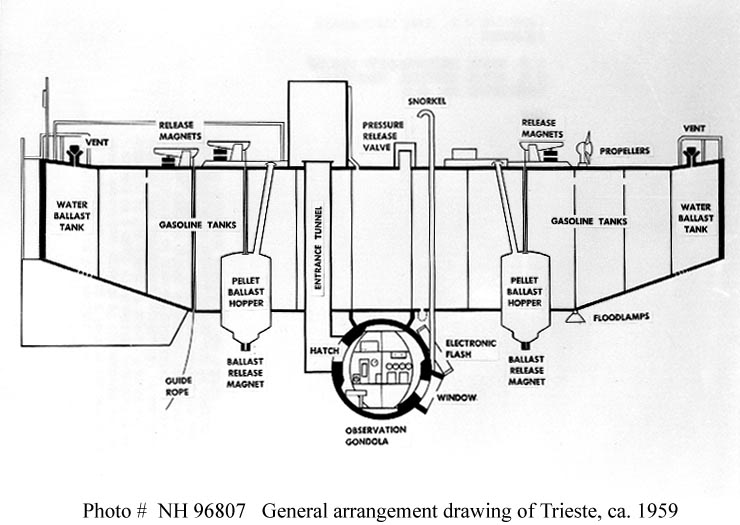
17 02 1954
Le Canard Enchaîné donne sa Une aux sanctions prises à l’endroit des Dominicains sur la question des prêtres ouvriers :
Sanctions dans l’Eglise : Ange épure, ange radié
Rappel à l’Ordre de saint Dominique
Il y a de l’eau bénite dans le gaz chez les révérends-pères au lendemain du raid sur Paris du maître général des Dominicains, l’Espagnol Suarez, qui a délicatement fendu l’oreille de quelques frangins de haute bure.
Et remis de l’ordre pontifical dans l’ordre dominicain.
Rapport – toujours – à l’histoire des prêtres ouvriers.
Inutile de préciser que les décisions suareziennes ont provoqué un certain chabanals dans la catholicité ambiante.
Où l’on constate que les constitutions des Frères prêcheurs ont été violées jusqu’aux derniers outrages.
Vu que les nouveaux Provinciaux de Paris, de Lyon et de Toulouse auraient dû être élus par la base et non cavalièrement mis en place d’en haut par le Maître Suarez.
Il y a mieux. D’habitude, quand l’Eglise balance des coups de tiare sur la tête de ses fidèles, elle explique pourquoi.
Cette fois, rien de tel. Les théologiens mis à l’ombre des couvents, comme le Père Congar, le Père Boisselot ou le Père Chenu, ont été estourbis comme au coin d’un bois.
Sans motif avoué.
Il parait qu’ils doivent s’estimer satisfaits de s’en être tirés à si bon compte. D’après ce que leur aurait dit Suarez, cela aurait pu être beaucoup plus grave. L’état d’esprit est tel à Rome qu’on envisageait rien de moins que l’interdiction totale de l’ordre des Dominicains en France.
Ledit ordre, qui a déjà eu l’affaire de Sept sur le dos avant la guerre, étant considéré comme un repaire de dangereux révolutionnaires [nommés plutôt progressistes ndlr] par les Intégristes – les non théologiens disent : les réactionnaires du Saint-Office.
Il y a longtemps que les Eglises d’Italie, d’Espagne et du Canada – celle des Etats-Unis, quoi qu’on prétende, a moins d’influence cherchaient à faire leur affaire aux libéraux de l’Eglise de France. Maintenant, l’instant est propice. Il règne à Rome une atmosphère de fin de pontificat. Tout à ses visions et à ses hoquets. Pie XII laisse les bureaux gouverner, plus particulièrement celui du Saint-Office qui est truffé d’intégristes. Il suffit que Rivarol ou Aspects de la France écrive un libelle contre tel ou tel catholique vaguement libéral pour que l’article soit pris pour argent comptant, versé au dossier et serve de pièce à conviction.
Tout accusé, pourvu qu’il soit libéral, est déjà un coupable.
Comme sous l’Inquisition.
Et on s’attend maintenant que les foudres apostoliques s’abattent sur des laïcs.
Contrairement à ce qu’on croit, l’épiscopat français ne serait pas tout à fait innocent non plus dans l’histoire des Dominicains.
Les mesures disciplinaires qui ont atteint lesdits auraient été décidées en partie à la suite d’une pétition dont aurait pris l’initiative Mgr Richaud, archevêque de Bordeaux.
Qui fait de la démagogie ouvriériste dans ses mandements. Mais n’en pense pas moins. En tout cas, il souffle un de ces petits vents d’ultramontane chez les enfants français du Bon Dieu.
François Mauriac vire au gallicanisme et réclame un nouveau Concordat.
Des tas de catholiques prient tous les soirs pour que Pie XII soit rapidement convoqué devant l’Éternel.
Tout ça annonce un joyeux conclave le jour où il s’agira de désigner le prochain pape.
Les nus de la Sixtine s’en frottent déjà les saints.
Le Canard Enchaîné du 17 février 1954 [300 000 exemplaires]
19 02 1954
Voulant marquer le tricentenaire du rattachement de l’Ukraine à la Russie par le Rada de Pereïaslav, en 1654, et soucieux de faire un cadeau à cette Ukraine dont il se sentait proche, Khrouchtchev lui offre la Crimée : quinze minutes de discussion, pas plus ! C’est en ce mois de février que Khrouchtchev est enfin parvenu à neutraliser sinon éliminer ses rivaux, le dernier d’entre eux étant Malenkov. Il doit en grande partie son succès à son orientation marquée en faveur d’un plan de développement agriculture-industrie lourde : nécessité d’accroître la production agricole afin d’assurer en priorité le ravitaillement d’une population urbaine en forte croissance. Pour cela, il faut relever massivement les prix d’achat, par l’État, des productions des kolkhoze, au bord de la faillite, et étendre considérablement les emblavures, seule façon d’assurer une croissance rapide de la production agricole : ce sera la mise en valeur des terres vierges du Kazakhstan ; ces terres vierges sont en fait les terres abandonnées après la collectivisation forcée des campagnes dans les années 30.
La tempête déclenchée par l’interdiction touchant les prêtres ouvriers fait des vagues jusqu’en Suisse Romande, dans le Valais précisément ; la Suisse accueille volontiers des révolutionnaires mais à la condition qu’ils choisissent comme terrain d’exercice un pays autre que le leur. Donc, on ne peut raisonnablement pas leur demander de pencher du coté des prêtres ouvriers… néanmoins ils exposent correctement le contexte général.
Bien des chrétiens sont actuellement préoccupés par ce qui est devenu la Question des prêtres-ouvriers. La répercussion des derniers événements à ce sujet a été grande et s’est produite dans bien des consciences individuelles, y créant un certain malaise. La discussion s’est ouverte à ce sujet et cela non seulement dans les cercles catholiques, mais également dans certains milieux protestants ou même non-chrétiens. La presse chaque jour en apporte des échos qui, venant des horizons les plus divers, témoignent d’une grande confusion. C’est cette confusion même qui est pénible, voire douloureuse. Il n’est point de notre ressort d’interpréter ou même de discuter les décisions de la Hiérarchie ecclésiastique. Par contre, nous avons pensé qu’il pouvait être bon d’essayer, pour nos lecteurs, de mettre un peu de clarté dans une affaire où, malheureusement, certaine presse et certaines agences ont voulu produire du sensationnel ou provoquer, dans un but bien défini, le trouble dans les consciences. Tenons-nous en aux faits. C’est le Cardinal Suhard qui est l’initiateur de la Mission des Prêtres-ouvriers. Effrayé par la déchristianisation presque complète d’une grande majorité du monde ouvrier français, il estima qu’une tentative devait être faite de le regagner au Christ par un apostolat agissant par l’intérieur. Des expériences avaient déjà été faites par des prêtres isolés et avaient été, par certains côtés, assez concluantes. Le cardinal Suhard en mettant sur pied la Mission de Paris donnait à ces prêtres une organisation, une hiérarchie, assurait un contrôle, une mise en commun des enseignements acquis, et parait au danger de l’isolement. Il ne s’agissait et il ne pouvait s’agir en l’occurrence que d’une expérience. La mission de ceux qu’on a appelé les commandos de l’Eglise dans les masses ouvrières était une action de reconnaissance qui comportait de sérieux dangers. C’est la raison pour laquelle le cardinal-archevêque voua à ses prêtres-ouvriers une constante sollicitude, tant pour les soutenir dans les difficultés écrasantes au sein desquelles ils devaient œuvrer pour le Christ, que pour suivre attentivement le développement de cette entreprise délicate. A sa mort, son successeur Mgr Feltin décida la continuation de la Mission de Paris. Cette action des prêtres-ouvriers devait, pour garder son efficacité et permettre qu’on en tire toutes les leçons, se dérouler dans le silence. Malheureusement certains événements vinrent lui donner une publicité malencontreuse. De plus, et fait assez grave, certains jeunes prêtres s’y engagèrent en francs tireurs. Sans contrôle, sans soutien communautaire comme cela existait dans la Mission de Paris sans préparation sérieuse et surtout sans présenter les qualités requises pour un apostolat aussi difficile, ils commirent certaines erreurs dont immédiatement s’emparèrent les ennemis du catholicisme. Le Vatican s’en émut à juste titre et les cardinaux Gerlier. Liénart et Feltin se rendirent à Rome pour examiner avec Sa Sainteté Pie XII toute la situation et les mesures à adopter. Une décision fut prise. Tels avaient été concluants certains résultats acquis qu’il ne pouvait être question d’abandonner le principe de l’apostolat de prêtres au sein des masses ouvrières, mais les expériences faites permettaient également d’en fixer les méthodes et les limites. La Hiérarchie donnait ainsi un statut et une organisation aux prêtres-ouvriers. Ceci procédait de la logique même. Etant donné les difficultés et les périls courus par ceux qui faisaient œuvre d’apôtres au sein des masses sans Dieu et agitées par certaines idéologies matérialistes, il était nécessaire que leur action, soit suivie et qu’on évite que leur entreprise puisse être menacée d’anarchie. Ce souci de la Hiérarchie de procéder dans ce domaine combien délicat avec calme et raison a été, bien évidemment, exploité par ceux dont l’intérêt était de semer le trouble dans les consciences. Ils se sont empressés de proclamer que l’Eglise mettait fin à l’expérience des prêtres-ouvriers, alors qu’elle se contentait simplement de la coordonner, de lui donner de nouvelles bases. L’action des prêtres-ouvriers n’est pas suspendue. Le texte de l’Épiscopat français, publié il y a quelque temps, déclarait d’ailleurs en toutes lettres qu’il faut consacrer des prêtres à un apostolat spécial en milieu ouvrier. Simplement les modalités de cet apostolat ne sont plus tout à fait les mêmes. L’Eglise, dans sa sagesse et disposant de tous les éléments d’information nécessaires, en a décidé ainsi. Ce n’est point à nous de juger et encore moins à ceux qui la combattent Il convient donc de se méfier de toutes les informations qu’on répand à propos des prêtres-ouvriers tant qu’elles ne proviennent pas de la Hiérarchie elle-même. Le caractère sensationnel qu’on cherche à leur donner est d’ailleurs bien le signe évident qu’on ne vise qu’à saper la confiance des croyants dans le Magistère de l’Église.
[…] Dans un article paru dans le Figaro du 16 février, M. François Mauriac se demande s’il ne faudrait pas signer un nouveau Concordat entre la France et le Saint Siège pour délimiter les droits imprescriptibles de l’Eglise et ceux, non moins imprescriptibles, de la nation. L’éditorialiste du Figaro écrit : Mais c’est dans la mesure où des catholiques de France sont des catholiques de tout repos, dans la mesure où ils se trouvent liés de toute leur foi et de tout leur amour au Siège de Pierre, dans la mesure enfin où le risque de schisme, en ce qui les concerne, n’est même pas imaginable, qu’ils se sentent plus pressés de trouver un recours… Ce Concordat que la III° République a détruit, la IVe République, dans l’intérêt de l’Eglise et de la France, n’aurait-elle pas raison de le rétablir en l’adaptant aux exigences de notre époque ? Je pose la question. Une dépêche d’agence annonçait en outre qu’une question orale avec débat serait posée au Sénat : M. Edmond Michelet, sénateur de la Seine, a posé une question orale avec débat, demandant à M. le ministre des affaires étrangères si tout en respectant les lois fondamentales de la République,… il ne serait pas de son devoir d’attirer l’attention du Saint-Siège sur les conséquences regrettables qui risquent d’atteindre, à travers l’Eglise de France, le prestige et le rayonnement de notre pays dans le monde, à la suite des circonstances qui ont entouré les décisions frappant des prêtres et des religieux français.
Compte tenu de l’émotion que ces mesures ont suscitée dans notre opinion publique, il lui demande s’il ne lui apparaît pas nécessaire de se faire l’interprète de ces inquiétudes auprès de S. Exe. le nonce apostolique. De son côté, M. Deixonne, député socialiste a adressé par la voix du Journal Officiel, au ministre des affaires étrangères, une question écrite sur le même sujet. L’opinion publique s’emparera certainement de ces faits et elle les commentera, écrit le 17 février, dans La Croix, de Paris, le R. P. Gabei, et il donne les très judicieuses précisions suivantes :
- L’Église est une société parfaite supranationale ; tous ses fidèles sont en même temps citoyens d’un Etat. Chaque fois que l’Eglise intervient auprès de ses membres, elle touche en même temps des citoyens, cela est inéluctable.
- L’Église intervient en des domaines différents : un premier où les affaires sont spécifiquement et uniquement religieuses, un deuxième qui est mixte, c’est-à-dire où les matières elles-mêmes sont simultanément de l’Eglise et de l’Etat – le mariage par exemple : sacrement et cellule sociale ; un troisième qui est en lui-même temporel, mais qui par un biais, tombe sous le jugement de l’Eglise dans la mesure où la morale est engagée.
- Les rapports de l’Église et de l’Etat sont différents suivant que le problème soulevé appartient à l’un ou l’autre de ces trois domaines. Dans le premier l’Eglise est souveraine ; elle légifère et gouverne en toute indépendance jusque dans les cas les plus concrets. Son intervention ne touche alors le citoyen d’aucune manière, mais seulement le fidèle, laïc, religieux ou prêtre, et nul pouvoir temporel, en tant que tel, ne peut demander des comptes à l’Eglise à ce sujet.
- L’État, ou plutôt la nation, peuvent-ils s’estimer atteints dans leur honneur par certaines mesures prises par l’Eglise ? Remarquons d’abord que cette crainte est pour la France révélatrice d’une transformation profonde survenue dans l’opinion publique : celle-ci se sent plus ou moins solidaire de certaines tendances du catholicisme français. Mais remarquons aussi que cette crainte peut être inspirée par des préoccupations très diverses et il ne nous semble pas que M. Deixonne passe par la même crise de conscience que M. Michelet. Certes, la distinction entre catholique et français est facile à établir dans l’abstrait ; dans le concret, c’est bien la même personne qui est les deux à la fois. C’est si vrai que l’on entend souvent dire dans certains milieux ecclésiastiques, à propos de nos problèmes religieux : Ah ces Français ! ! Et, si la nation française peut s’estimer honorée par le prestige de ses théologiens, de ses philosophes, de ses sociologues, de ses pionniers de l’apostolat populaire, etc., ce n’est pas elle pourtant qui est qualifiée pour déterminer si l’orthodoxie de ces hommes est encore entière, si leurs propos et leurs méthodes dans le domaine religieux sont opportuns. C’est l’affaire de l’Eglise. L’Eglise doit examiner essentiellement la question en fonction de sa Constitution et de sa mission surnaturelles, non pas en fonction du prestige ou de l’honneur de la nation à qui appartiennent les fidèles qu’elle touche. On peut en tenir évidemment compte. On peut surtout tenir compte des problèmes et du génie propre d’une nation et l’Eglise n’y manque pas dans la plupart des cas.
- Deux solutions sont proposées : une démarche du ministre des Affaires étrangères : un Concordat : Que pourra dire le ministre au nonce puisque les questions ne sont manifestement pas du domaine temporel ou politico-religieux, mais ressortent à la vie intérieure de l’Eglise : méthodes d’apostolat et gouvernement d’un ordre de droit pontifical ? Le Concordat !… L’Etat deviendrait, suivant ce que l’on souhaite, le défenseur de l’originalité de l’Eglise dans un pays en face des règles uniformes édictées pour toute la catholicité. Certes, il ne faudrait pas de standardisation, en ce domaine comme en tous les autres, des méthodes et des solutions, car les problèmes sont divers à travers l’Église. L’unité de l’Église est par elle-même, assez haute et assez souple pour s’adapter d’une manière vivante à de multiples situations. Mais est-ce le rôle de l’État de sauvegarder cette diversité dans l’Église ?
- Pour ce qui est du rôle du nonce, nous avons déjà eu l’occasion de dire ce que nous pensions. M. Jean Lacroix a, avec noblesse, signalé dans le numéro d’Esprit ceci : Il est certain qu’en s’occupant des prêtres-ouvriers le nonce n’est pas sorti d’un domaine purement religieux. Le droit canon prévoit que le nonce entretient les relations diplomatiques avec le pays où il est accrédité et que, dans le territoire qui lui est assigné, il veille à l’état des Églises et informe le Pontife romain à ce sujet. S’il lui faut voyager pour s’informer de la situation ou informer la hiérarchie des directives pontificales, il fait son métier de nonce. Nous avons distingué, depuis des années, avec un soin jaloux, l’Église de l’Etat. Après avoir écarté de notre vie publique les intrusions des clercs dans le domaine temporel, gardons-nous de provoquer l’État à intervenir dans le domaine propre et exclusif de l’Église.
Nouvelliste Valaisan. 9 Février 1954. [articles signés d’une seule initiale]
02 1954
Gamal Abdel Nasser est nommé premier ministre de l’Égypte. Il en deviendra le président deux ans plus tard. Très rapidement est prise la décision de construire un nouveau barrage à Assouan, qui noiera nombre de villages et aussi de nombreux sites archéologiques majeurs de Nubie, tels Abou Simbel, – temple de Ramsès II -, Philae, – sanctuaire d’Isis -, les temples d’Amada, Derr, Ouadi Es Sebouah, Dakka, Maharaqqah, Taïmis, le kiosque d’At Kartassi, le temple de Beit El Ouali, … 32 temples et chapelles … et les carrières de granit d’Assouan. Christiane Desroches Noblecourt est alors pensionnaire de la prestigieuse École du Caire ou Institut français d’archéologie orientale – IFAO -. Elle va voir Nasser pour qu’il lui laisse carte blanche pour sauver ces merveilles, à défaut de pouvoir en financer le sauvetage. Il tiendra parole et cette femme de quarante ans, passionnée d’Égypte, va remuer ciel et terre pour que l’UNESCO prenne en charge le déplacement de ces temples, un travail de titan, sur l’île d’Agilka, qui, elle, restera toujours hors d’eau. Et le fabuleux pari sera tenu. Le 16 novembre 1963, l’Égypte et l’Unesco attribueront les travaux au consortium Joint Venture Abu Simbel, qui rassemble le français GTM – Grands Travaux de Marseille -, l’Allemand Hochtief, l’Italien Impreglio, les Suédois Skanska et Santab, l’Égyptien Atlas, avec le français Jean Bourgain comme directeur des travaux, pour l’Unesco. Les merveilles auront été déplacées et rehaussées de 80 m sur une colline artificielle, en fait une voûte de béton, avant l’inauguration du barrage d’Assouan en 1970 : 1 036 blocs découpés, pesant chacun de 20 à 30 tonnes, qu’il s’agit de saisir et de poser en respectant le centre de gravité de chacun pour qu’il reste à la verticale ; les travaux commenceront en avril 1964 pour finir le 22 septembre 1968, avant la mise en eau du barrage d’Assouan en 1970.
Il n’est qu’un acte sur lequel ne prévale ni l’indifférence des constellations ni le murmure éternel des fleuves : c’est l’acte par lequel l’homme arrache quelque chose à la mort.
André Malraux

Vue du Grand Temple à partir de la droite, photo créditée à William Henry Goodyear (avant 1923)

1966 : les têtes de trois des quatre statues colossales de l’entrée du Grand temple de Ramsès II à Abou Simbel attendent de retrouver leur corps.

réassemblage des colosses de la façade du grand temple d’Abou Simbel

Temple de Ramsès II, photo prise en 2007

Façade du petit temple d’Abou Simbel.

Les temples de l’île de Philae reconstruits sur l’île toute proche d’Aguilkia. La reconstruction prit fin en 1979

Christiane Desroches Noblecourt. 1913-2011
1 03 1954
L’Église catholique met (presque) fin à l’expérience des prêtres ouvriers. Grande affaire quant à la seconde des deux grandes fonctions de l’Eglise : la prière et l’apostolat : laisser venir à soi ou aller vers ? Cette condamnation des prêtres ouvriers ne s’est pas faite en un jour : la date retenue ici est celle de la prise d’effet de la décision de mettre fin à l’expérience des prêtres ouvriers. Mais cela avait commencé le 23 septembre 1953 par l’envoi de la Sacrée Congrégation des Religieux, via la Curie généralice de Rome, d’un courrier communiquant aux trois provinciaux dominicains de France, la décision de mettre fin à l’expérience des prêtres ouvriers. Copie de ce courrier avait été envoyée à tous les supérieurs généraux des tous les ordres religieux.
À la fin du pontificat de Pie XII (1939-1958), la partie la plus vivante et la plus dynamique de l’Église de France a vécu dans un climat de suspicion et de délation qui s’apparente à une véritable terreur intellectuelle. Des prêtres et des religieux, suspectés de progressisme ou tout simplement d’imprudence dans l’expression de leur pensée, furent alors l’objet de mesures disciplinaires brutales, prises sans la moindre concertation et sans la moindre explication. Principales victimes de cette persécution intellectuelle : les dominicains, les éditions du Cerf qu’ils dirigent ainsi que les revues qu’ils animent, dont la Vie intellectuelle. Persécution d’autant plus injuste qu’elle frappe des hommes d’une grande rigueur intellectuelle et morale qui deviendront quelques années plus tard de véritables autorités théologiques au Concile Vatican II : on pense ici notamment aux PP. Chenu et Congar. Du reste, la parfaite dignité avec laquelle ils se soumirent à des décisions injustes permet de mesurer la profondeur de leur attachement à l’Église.
Autres victimes de marque d’une bureaucratie romaine bornée et réactionnaire : les prêtres-ouvriers, qui sont alors une centaine, et qui entendent relever le défi que représente pour l’Église une classe ouvrière à peu près totalement déchristianisée. Si la France, selon l’expression célèbre de Y. Daniel et H. Godin, est devenue pays de mission, que dire alors des milieux ouvriers. L’arrêt brutal de l’expérience au début de l’année 1954 marque dans l’Église de France un véritable retournement de conjoncture. Les raisons de la décision romaine tiennent sans doute d’abord à des divergences sur la conception même du sacerdoce. Qu’est-ce qu’un prêtre ? Un professionnel des sacrements, un homme à part, ou bien au contraire un témoin de Jésus-Christ dans un milieu qui l’ignore ? Mais on ne saurait séparer ce débat théologique de l’environnement politique et intellectuel de l’époque : nous sommes encore en pleine guerre froide ; Pie XII et ses conseillers vivent dans la hantise d’une contamination de ses prêtres par le marxisme : débat qu’on retrouvera un quart de siècle plus tard, en Amérique latine, à propos de la théologie de la libération. Tout n’est pas faux dans les appréhensions des membres de la Curie. Mais le point fondamental, celui autour duquel s’opère le clivage, ce sont les méthodes de la Curie romaine, et tout spécialement du Saint-Office. L’inspiration intellectuelle de l’Inquisition n’est pas loin : longues enquêtes secrètes, surveillance quasi policière des suspects, dénonciations, refus de tout dialogue, obligation du secret faite aux victimes elles-mêmes. L’Église fonctionne comme un appareil autoritaire, triomphaliste et sûr de son bon droit. Les remises en cause ne viendront qu’ensuite. La double affaire des prêtres ouvriers et des dominicains de la Province de France est un des moments les plus chauds de l’histoire religieuse contemporaine, le plus important sans doute depuis la condamnation du modernisme et de l’abbé Loisy par Pie X en 1907. Du reste, le rapprochement entre Pie X et Pie XII, que tant de choses séparent par ailleurs, s’impose. Sans doute, les prêtres-ouvriers ont-ils eu tendance à surestimer la spécificité de la classe ouvrière et le caractère quasi universel de la conscience de classe. Reste que l’absence de l’Évangile chez les pauvres et les exploités était le scandale majeur auquel ils se sont attaqués avec courage. Cette défaite n’est que provisoire : à bien des égards, Vatican II leur donnera raison.
Jacques Julliard, Directeur d’Études, Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, lors de la publication de Quand Rome condamne, de François Leprieur. Terre Humaine Plon/Cerf 1989
3 03 1954
Christian PINEAU, député SFIO, ancien ministre, publie une tribune libre dans Paris Presse l’intransigeant. De septembre 1940 à février 1942, Christian Pineau a assuré à lui seul la parution de 190 numéros de Libération. Déporté à Buchenwald.
De la Charité à la Justice
De temps à autre, les hommes s’avisent que tout ne va pas pour le mieux dans un monde dont ils ont crée, sinon la nature, du moins les institutions. À l’occasion d’une catastrophe, ils découvrent soudain ce qu’ils connaissent parfaitement. C’est ainsi que les grands froids ont révélé, à des gens qui ne pouvaient l’ignorer, la grande misère des sans-logis.
L’initiative de l’abbé Pierre, la publicité donnée par la grande presse à ses randonnées nocturnes, ont satisfait le goût du public pour la pitié et suscité des gestes de solidarité dans des milieux généralement assez fermés à l’émotion.
Est-ce à dire que les événements de ces dernières semaines aient apporté, comme on l’a écrit, un souffle nouveau à notre pays et qu’il y ait quelque chose de profondément changé dans notre approche de l’injustice sociale ?
Quitte à choquer certains esprits, j’avouerai franchement que je ne le crois pas.
La charité comporte, à la fois, le meilleur et le pire ; le meilleur, quand elle donne à chaque être humain conscience de sa solidarité profonde avec son espèce ; le pire dans la mesure où elle constitue un alibi pour des consciences facilement satisfaites.
Comme il est aisé de se décharger de tout devoir social, de toute réprobation contre l’ordre établi, au prix d’un menu sacrifice volontairement consenti !
On imagine fort bien un contribuable moyen, fraudeur du fisc comme tant de Français, envoyant à l’abbé Pierre un petit mandat, représentant le centième de la somme dont il a frustré l’Etat et avec laquelle on aurait peut-être pu construire une maison. Le voilà fort satisfait de lui ! Il n’a aucun remords à l’égard de la collectivité ; sa vanité est agréablement chatouillée par l’élégance de son geste individuel. Il demeure pourtant socialement un coupable.
Quand règne la tartuferie…
Combien d’exemples pourrait-on citer de cette attitude d’esprit : le patron qui paie mal ses ouvriers, mais dont la femme va faire des visites dans les foyers pauvres ; la maîtresse de maison qui réduit sa servante à l’esclavage, mais lui donne ses vieilles robes ; l’égoïste qui n’a jamais pensé à la souffrance humaine, mais donne 10 francs par jour au joueur d’orgue de barbarie, parce qu’il aime les complaintes et l’agréable frisson des gestes peu coûteux.
Certes, je ne condamne pas en soi la Charité. Inspirée souvent par des motifs nobles, métaphysiques ou autres, elle peut apporter aux rapports entre les hommes un élément de douceur et de confiance. Mais je ne la crois valable que si elle est un complément de la justice et non sa caricature.
Un médecin peut administrer un calmant à un malade. Il ne fait qu’adoucir sa souffrance ; mais s’il veut le guérir, il lui faut aller à la racine même du mal.
Ainsi la charité atténue la douleur ; seule la Justice en supprime la cause.
Dans le cas douloureux des sans-logis, il est bien de soigner et de réconforter des malheureux. Mais cela ne doit pas conduire à accepter un ordre social qui comporte, par sa structure même, d’aussi criantes injustices.
Le drame de cet hiver, ce n’est pas celui d’un homme qui découvre la misère, c’est celui d’un État qui la tolère, d’une opinion qui s’en émeut superficiellement, mais n’est pas prête aux mesures qui pourraient la supprimer. C’est celui de l’égoïsme social, plus fort que jamais dans certains milieux, et qui est le responsable de la haine inexpiable et muette de la grande foule des opprimés.
13 03 1954
Déclenchement de la bataille de Dien Bien Phû. Elle va durer 56 jours.
À 17 heures les canons du Vietminh pilonnent le piton Béatrice, formé de trois môles distincts, puissamment fortifiés et défendus. Les officiers sont tués et, peu à peu, les bunkers tombent aux mains de l’ennemi. A minuit, Béatrice ne répond plus. C’est la consternation chez les Français : ils n’imaginaient pas que les Viets disposeraient d’une telle force de frappe, cela grâce au soutien des Chinois et, dans une moindre mesure, des Soviétiques : vingt canons de 105 mm, 24 canons de montagne de 75 mm, des mortiers lourds, de la DCA… Giap pouvait en outre engager trente bataillons réguliers, soit une quarantaine de milliers de soldats, sans compter l’intendance et les volontaires. En face, les Français disposaient d’unités d’infanterie, appuyées par les paras du 1er bataillon de parachutistes coloniaux et les légionnaires du 1er bataillon étranger de parachutistes. En tout, 15 700 hommes, dont de nombreux tirailleurs africains et marocains.
Bruno Philip. Le Monde 7 mai 2014
Personne n’avait cru que les Viets pouvaient posséder de l’artillerie : par quel itinéraire auraient-ils amené leurs pièces et gagné les crêtes sans que notre aviation les ait vues ? Le colonel Piroth qui commandait l’artillerie de la citadelle était si sûr que ses batteries ne risquaient rien qu’il les avait établies à découvert. Quand, le 13 mars, les 105 ennemis ouvrirent le feu et, en quelques minutes, détruisirent ses canons et la piste aérienne, Piroth se fit sauter la cervelle. Dans la citadelle assiégée, l’héroïsme et la lâcheté devinrent le pain quotidien. A l’hôpital souterrain, les médecins opéraient dans l’ébranlement des coups de mortier, de rares avions sanitaires se posaient encore et repartaient sous les obus, puis toute liaison devint impossible. Je pus étudier les ordres et les contrordres, les télégrammes échangés avec Hanoi, le procès-verbal des incidents qu’on avait tus, la correspondance impitoyable des généraux. Napoléon a écrit : A la guerre, un grand désastre désigne toujours un grand coupable. Tous les arguments du général Navarre se trouvaient déjà, à quelques nuances près, dans un plaidoyer qu’il avait publié en 1956. Personne ne lui avait imposé quoi que ce soit, mais la responsabilité du gouvernement était immense : la guerre d’Indochine n’avait jamais été conduite.
Les responsabilités de cette bataille, j’ai conscience de les avoir justement traduites. Je crois avoir approché de près la vérité, et si, parfois, de ma plume s’échappe un jugement acéré pour certains politiques et certains militaires, je n’ai mesuré ni mon admiration ni ma pitié pour ceux qui combattirent dans ce lac de boue devenu un charnier. J’en disais de cruelles. Cette bataille aurait pu être évitée, elle aurait pu aussi être gagnée. Il me parut utile et nécessaire de savoir pourquoi et comment, alors que ses conséquences pesèrent si lourd par la suite, elle avait été perdue. Tout l’état-major se trompa et raisonna comme un état-major occidental et archaïque face à des gens qui ne possédaient ni avions ni camions, mais des canons et qui n’avaient pas peur de la mort. Honte, désespoir, stupeur, trahisons et mésentente. Les avions ne pouvaient plus se poser, et la moitié du ravitaillement parachuté tombait chez l’ennemi. Au plus profond de l’inquiétude, il fut envisagé, pour faire lâcher prise à l’ennemi, d’employer une bombe atomique. Le colonel Brohon, alors directeur de cabinet du général Ely, chef d’état-major de la défense nationale, fut chargé de solliciter cette extrémité du Pentagone. Finalement, les Américains et les Britanniques refusèrent, le gouvernement chuta, et Mendès arriva au pouvoir.
Jules Roy. Mémoires barbares. Albin Michel 1989
La vallée de Diên Biên Phu, avait dans doute déjà vu passer bien des hommes : troupes françaises, japonaises peut-être, chinoises sûrement, les cornacs du Siam, la caravane de Marco Polo. Mais à présent, depuis longtemps, la vallée était paisible, on y cultivait le riz, les épinards, la papaye. Les bœufs paissaient autour de la rivière, compagnons fidèles et bonasses. Et voici que brusquement, parce qu’un général français né dans le Rouergue avait décidé de donner ici rendez-vous au fantôme des batailles, on allait ratisser toute cette vallée, la truffer de bunkers, y détruire des dizaines de villages, chasser un millier d’habitants vers les collines, couper les arbres et brûler les cultures. On allait anéantir bien des souvenirs, des habitudes, des sentiers où les amoureux se retrouvaient, de fragiles murets où les enfants cachaient de minuscules trésors.
Le vendredi 20 novembre 1953, on vit tomber du ciel des poignées de corolles, petits cercles de toile bleues, méduses légères, voletant au-dessus de la luxuriante vallée. Les paysans regardèrent tomber les pétales d’œillets, quelque mille huit cents pétales, avec deux batteries d’artillerie aéroportées et deux compagnies de mortiers lourds. Le lendemain, un bulldozer tomba du ciel… Aussitôt, on se mit au travail. Il s’agissait d’aplanir l’ancien terrain d’aviation que le Viêt Minh avait démoli. Sur un film militaire, on peut voir les soldats torse nu conduire à travers champ une petite pelle à chenille en s’amusant. La bataille venait pourtant de commencer le jour précédent : onze morts pour les Français, cent du côté viêt minh.
Fin janvier, tout est prêt. Le PC est enterré. On a creusé des abris, tracé des tranchées, et déroulé tout autour d’immenses rouleaux de barbelés. Dix mille hommes vivent déjà ici. Et, chaque jour, on livre des tanks, des jeeps, des camions, des antennes chirurgicales, des exemplaires de Playboy et des tombereaux de conserves.
Éric Vuillard. Une sortie honorable. Actes Sud 2022


15 03 1954
Pour la première fois un Noir – Ernest Wilkins -, devient ministre (du travail) aux États-Unis.
20 03 1954
De Pierre Peltier à M. Christian Pineau.
Monsieur,
Dans votre article de la charité à la Justice publié par Paris-Presse le 3 mars 54, vous vous indignez de ce qu’un contribuable n’éprouve aucun remords à frustrer l’État et éprouve une satisfaction d’envoyer à l’abbé Pierre le centième de ce qu’il n’a a pas versé à votre motte de beurre. Avez-vous songé qu’avec ce centième l’abbé Pierre fera un bout de maison, alors qu’avec les 100 centièmes votre État ne fera rien, au contraire il empêchera de faire quoi que ce soit. Vous l’avouez d’ailleurs ingénument en glissant ce délicieux peut-être dans votre affirmation de ce que l’État aurait pu utiliser ces miettes. Les seuls services du M.R.L. (Ministère de la Reconstruction et du Logement) coûtent 13 Milliards (200 millions € 2000) par an aux contribuables et ne font que mettre des bâtons dans les roues de la construction. Combien de Français seraient logés chaque année avec cette somme remise à l’abbé Pierre ? Combien d’autres vivraient à l’aise dans les nombreux locaux occupés par ce ministère et ses services dans toute la France ? Combien de manœuvres seraient rendus disponibles pour la construction avec la liquidation de ce parasite, avant l’existence duquel on a construit et après la disparition duquel on construira encore.
Mais c’est bien là que le bât vous blesse, Monsieur le membre de l’Internationale ouvrière. De quoi vivrez-vous alors, cher Pou du Lion ?
Faut-il que vous soyez inconscient ou sans vergogne pour écrire pareilles absurdités. Vous vivez de ce désordre, mais la France en crève ; alors, Monsieur de l’Internationale, ayez la pudeur de ne pas réclamer davantage et contentez-vous de la part déjà trop belle qui vous est faite sur la misère des Français.
Agréez, Monsieur, mes salutations bien réticentes.
Christian Pineau lira ce courrier et le retournera avec la mention : Lettre idiote, à retourner
10 04 1954
L’inspecteur des finances Maurice Lauré 37 ans, que Raymond Aron, qualifiera de prince de l’esprit, – excusez du peu – met en application son invention : la TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée perçue sur les affaires. Il s’inspire d’une idée d’un homme d’affaires allemand, Wilhelm von Siemens, qui, dans les années 1920, voulait taxer la valeur supplémentaire d’une production. La TVA qu’il invente propose un nouveau mécanisme selon lequel les entreprises paieront désormais la taxe sur leurs ventes, l’État leur remboursant la taxe payée sur leurs achats, afin que la valeur ajoutée soit prise en compte et favorise l’investissement. L’imposition globale d’une marchandise ne varie pas quel que soit le nombre d’entreprises qui l’ont manipulée, et c’est le consommateur final qui la paie tout entière. Simple et cohérent. Facile à collecter, difficile à frauder, la TVA a aussi l’avantage d’être neutre vis-à-vis des exportations puisque les acheteurs étrangers n’ont pas à l’acquitter.
Elle sera d’abord limitée au secteur de la production, puis au commerce de gros – 300 000 industriels et grossistes, soit 15 % des entreprises enregistrées auprès du fisc -, et finalement touchera à partir de janvier 1968 l’ensemble des biens et services vendus par les quelque trois millions de commerçants, artisans, agriculteurs, et entrepreneurs, suscitant la fronde : taxe de la vorace administration ou encore tout va augmenter. Ces derniers collectent la TVA, la reversent à l’État, après avoir déduit la TVA qu’eux-mêmes ont du payer en amont pour leurs achats.
Maurice Lauré lui-même, à la veille de sa mort, en 2001, défendra son bébé : Je ne suis pas sûr que la véritable nature de la TVA ait bien été assimilée. Beaucoup de professionnels, d’hommes politiques, et même de fiscalistes, s’imaginent que la TVA est assise sur la valeur ajoutée de chaque entreprise. C’est faux. La TVA est assise sur la valeur ajoutée de sa nation et les entreprises servent seulement de percepteurs, avec la certitude qu’elles ne supportent pas l’impôt tant que le produit est chez elles, pourvu qu’elles le perçoivent dès qu’il les quitte.
Le principe connaîtra le succès, puisque adopté dans plus de 150 pays, où elle représente en moyenne jusqu’à un cinquième du total des recettes fiscales. Et l’Union européenne en a fait un des éléments du passeport que les pays candidats doivent accepter pour y entrer. Son grand avantage : être un impôt indolore, au quotidien, applicable à tous les consommateurs, c’est à dire tout le monde. Dans les années 2000, en France, ajoutée à la TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers, qui dans le principe peut être assimilé à une TVA), la TVA représente 53 % des recettes de l’État, quand l’Impôt sur le Revenu n’en représente que 19 %…de quoi apporter quelques bémols à tous ceux qui bombent le torse d’un moi, Monsieur, je paye des impôts.
14 04 1954
Début de l’ultime assaut des Viet Minh contre Dien Bien Phû. Sortie de la 4 L de Renault. La gendarmerie l’adoptera car c’était la seule voiture française à l’intérieur de laquelle un gendarme pouvait garder son képi sur la tête.
29 04 1954
Geneviève de Galard, infirmière de 28 ans à Dien Bien Phû, se voit remettre par le colonel de Castries, commandant en chef, Légion d’honneur et Croix de guerre :
Vous êtes la plus pure incarnation des vertus héroïques de l’infirmière française.
Elle devient en quelques jours le modèle parfait de la sainte laïque, otage d’un siège implacable, légende qui atténuera le traumatisme de la défaite, l’horreur du sacrifice. Après sa libération le 24 mai, des agences de presses américaines et un journal anglais lui proposeront des ponts d’or pour avoir l’exclusivité de ses interviews. Elle refusera : J’étais là-bas pour soigner des blessés, non pour gagner de l’argent en racontant leurs souffrances.
Comme dit Julios Beaucarne : le monde a bien changé, sais-tu.
Pendant la chute des obus, je la regardais et je fus étonné de son calme. Elle allait de blessé en blessé comme si de rien n’était. Elle avait les gestes qu’il fallait, la douceur, la précision, les mots qu’on attendait avec sa pure et fraîche voix de jeune fille.
Paul-Henri Grauwin, chirurgien à Dien Bien Phû. Il la dépeint aidant les blessés à manger et à boire, les mutilés à fumer leur cigarette. Voilà encore une piqûre. Vous ai-je fait mal ?
Vous avez été pour moi, dans cet enfer, l’image de la charité chrétienne.
Courrier de Pierre Schoendoerffer, écrivain, cinéaste, un de ces anciens soldats.
Elle nous quittera en mai 2024, à 99 ans.

7 05 1954
La chute de Dien Bien Phû, en Indochine, marque la fin d’un conflit de 9 ans. On compte 3 420 tués et autant de blessés parmi les assiégés. Le vainqueur, le général Giap, fait 11 721 prisonniers, parmi lesquels Marcel Bigeard, commandant les parachutistes, Pierre Schoendoerffer, cinéaste. Quatre mois plus tard, quand ils seront libérés, il n’en restera plus que 3 290 : 8 431 hommes étaient morts dans les geôles vietnamiennes par manque volontaire de soins, malnutrition ou sévices.
Au sein des troupes françaises, on comptait en fait seulement 13 % de combattants de nationalité française : la très grandes majorité était composée de troupes coloniales : comment donc auraient-ils pu éprouver une quelconque motivation là où elle devait déjà être problématique pour les français ?
La seule bataille rangée et perdue par une armée européenne durant toute l’histoire des décolonisations
Jean-Pierre Rioux
Le fond du stade est à nous, les gradins des montagnes tout autour sont aux Viets.
Capitaine Chevallier
Une vallée d’une vingtaine de kilomètres de long sur sept ou huit de large comme un grand corps allongé dans la rivière, une déesse aux multiples mamelons, Gabrielle ou Béatrice, Isabelle ou Claudine, tous les prénoms des collines hérissées des tourelles de canons entre lesquelles escadronnent les blindés. Les casemates reliées par des boyaux que protègent les sacs de sable. Chaque nuit les tranchées des deux camps se rapprochent, les bodoïs au casque de latanier neutralisent les clochettes suspendues aux barbelés qu’ils cisaillent. Lueur aveuglante des grenades à effet de souffle. On creuse sous Eliane-2 qui résiste la dernière, entasse les centaines de kilos d’explosifs au fond de la galerie de mine. Le film revient au Technicolor pour la grande explosion orange sur le lieu toujours en l’état, où se voit le cratère, et au sommet le char repeint en vert olive, où scintille l’étoile rouge du vainqueur.
Loin dans la montagne, près d’une cascade d’eau fraîche, le PC du général Vô Nguyên Giâp où les cartes du camp sont étalées. L’ancien professeur d’histoire, admirateur de Bonaparte, répète à ses officiers la phrase de l’Empereur, pointe l’écheveau des pistes dans la forêt : Là où une chèvre passe un homme peut passer ; là où un homme passe un bataillon peut passer.
La Chine fournit les mortiers, les orgues de Staline, les canons de 105 transportés sur des vélos alignés, hissés en haut des forêts à dos d’hommes, camouflés au fond des grottes. Pendant des mois soixante-dix mille porteurs et trente-cinq mille combattants. Plus de cent mille hommes en encerclent dix mille qui ne s’échapperont plus, pris dans la nasse sous le déluge de flammes. L’artillerie vietminh vide le ciel. Plus d’avions, plus de relève. Français volontaires, Marocains et Algériens qui n’avaient pas choisi leur affectation, Allemands de la Wehrmacht qui dix ans plus tôt combattaient l’Armée rouge, partisans vietnamiens, Thaïs descendants de Deo Van Tri. Fin avril deux mille Hmongs se mettent en route dans les montagnes du Laos, armés de machettes et de vieux fusils, les pieds nus, les amulettes autour du cou. A leur arrivée le camp est silencieux, la morne plaine labourée par les combats et jonchée de cadavres.
Les Hmongs sauvent quelques soldats échappés des colonnes de prisonniers. Parmi eux le capitaine Pham Van Phu, qui rejoint Luang Prabang, devient général de l’armée du Sud-Vietnam, reprendra Hué aux Viêt-congs, se suicidera après la chute de Saigon. Les autres rejoignent des camps dans la forêt à des centaines de kilomètres, meurent pour beaucoup de maladie ou d’épuisement. Des Hmongs sont capturés par le Viêt-minh. Les Tchèques et les Polonais sont expédiés en Union soviétique et disparaissent au goulag.
Demeurent les épaves rouillées des deux camps, américaines et chinoises. La table et la chaise du colonel de Castries promu général pendant la bataille. Sa baignoire à quatre pieds en signe du confort décadent du chef des impérialistes. L’armée française est oublieuse de Valmy, des jeunes généraux de la République menant à la victoire le peuple ivre de liberté. Des hommes qui sortent des maquis de la Résistance se retrouvent du mauvais côté de l’Histoire. La dernière bataille du colonialisme, le baroud, est devenu au fil des semaines le premier affrontement brûlant de la Guerre froide et l’avenir de tous les pays de la zone en est bouleversé. C’est à Paris que les jeunes amis khmers rouges apprennent la victoire du Viêt-minh.
Seul Saloth Sâr est déjà de retour au Cambodge.
On lui a confié une mission clandestine. Il contacte les opposants à Sihanouk, les Khmers issaraks, puis les communistes vietnamiens qui s’installent à Hanoi, rédige un rapport, l’envoie en France. La victoire est au bout du fusil. La preuve est faite.
Il lui faudra plus de vingt ans pour s’emparer de Phnom Penh.
Patrick Deville. Kampuchéa. Le Seuil 2011
Il nous a fallu transporter les canons en les faisant tirer à dos d’homme sur les montagnes dominant la vallée après les avoir démontés et transportés sur des radeaux. Vous imaginez le labeur ! Tout cela dans la chaleur, la progression à travers les chutes d’eau, la jungle. Mais on l’a fait, car on voulait l’indépendance, on était avant tout une force de soldats-paysans qui savaient que la victoire changerait la vie. Une telle force morale, c’était inimaginable pour les Français…
Nguyen Phuong Nam, qui cumulait les fonctions de commandant d’un régiment de 800 hommes et de commissaire politique.
Nguyen Dung Chi, un vieux monsieur espiègle et plein d’humour, se souvient des premières heures de la victoire. S’il n’a pas été le premier à entrer dans le PC du commandant en chef, il y a pénétré peu après la chute : Le silence est tombé sur Dien Bien Phu ; ça pue. L’odeur des morts, mais aussi celle des blessures en putréfaction de tous les soldats français qui gisent çà et là. Il croise Geneviève de Galard, surnommée l’ange de Dien Bien Phu, l’infirmière restée jusqu’à la fin pour s’occuper des blessés et des mourants. Je vais vers elle, elle lève les mains, elle dit : Ne tirez pas ! Je lui demande : Où est le PC ? Elle fait un geste de la main : Là-bas ! Je me dirige vers le poste de commandement. Il est vide. Sur la table du général, je vois un atlas ouvert à la page d’une carte de l’URSS ainsi qu’un stylo Parker et un couteau de parachutiste. J’ai pris le stylo et le couteau en souvenir…
Bruno Philip. Le Monde 7 mai 2014
Un de mes amis qui avait tenté de s’échapper à plusieurs reprises et qui, chaque fois, s’était fait reprendre, a été complètement enterré, seulement sa tête sortait. Il a péri attaqué par les fourmis rouges. Comment oublier ?
Michel Carreau. Midi Libre du 7 mai 2008
Je ne pourrai jamais oublier ce spectacle : dès l’entrée, nous croisons une troupe de fantômes, de cadavres debout. Ces yeux immenses sur ces visages parcheminés, ces torses décharnés et ces jambes déformées par les ulcères purulents… Ils n’avaient pas le droit de parler. L’un a articulé à grand peine. Ils étaient les derniers rescapés de cet antichambre de la mort. Les rats seuls s’engraissaient : ils dégringolaient sur les bat-flancs de bambou crasseux où sommeillaient les prisonniers. Notre camp à nous, comparé à ce cloaque immonde, faisait figure d’hôtel de luxe… Et nos commissaires politiques, au moins, étaient viêtnamiens. Là, au 113, […] ils avaient un Français comme eux.
Capitaine Jean Pouget, parlant des camps vietnamiens de prisonniers, 113 et 42. L’express 21 03 1991
Ce jour-là, – le hasard est seul en cause -, Mouloudji chante à Paris Le Déserteur de Boris Vian : Boris Vian la chantera aussi, mais c’est une première devant un public nombreux. Une forte odeur de soufre lui collera à la peau pour le restant de ses jours. On l’attendait probablement au tournant, car elle avait déjà valu nombre d’ennuis à son auteur, fils d’un aristocrate ruiné par la crise de 29, mystérieusement assassiné en 1944. Et pourtant Mouloudji, pour mettre Boris Vian dans le camp des non-violents lui avait déjà demandé de changer les deux derniers vers, devenus : que je n’aurai pas d’armes, et qu’ils pourront tirer, quand ils étaient à l’origine : que je tiendrai une arme [ou bien : que j’ai aussi une arme, ou encore : que je tiendrai mon arme] et que je sais tirer.
Je vous fais une lettre
Que vous lirez peut-être
Si vous avez le temps
Mes papiers militaires
Pour partir à la guerre
Avant mercredi soir
Je ne veux pas la faire
Je ne suis pas sur terre
Pour tuer des pauvres gens
Il faut que je vous dise
Ma décision est prise
Je m’en vais déserter
J’ai vu mourir mon père
J’ai vu partir mes frères
Et pleurer mes enfants
Qu’elle est dedans la tombe
Et se moque des bombes
Et se moque des vers
On m’a volé ma femme
On m’a volé mon âme
Et tout mon cher passé
Je fermerai la porte
Au nez des années mortes
J’irai sur les chemins
Sur les routes de France
De Bretagne en Provence
Et je dirai aux gens
Refusez de la faire
N’allez pas à la guerre
Refusez de partir
Allez donner le vôtre
Vous êtes bon apôtre
Monsieur le Président
Si vous me poursuivez
Prévenez vos gendarmes
Que je n’aurai pas d’armes
Et qu’ils pourront tirer
La chanson fera scandale et, à la demande de Paul Faber, conseiller municipal des Hauts-de-Seine sera censurée jusqu’en 1962. Boris Vian lui répondra le 1 février 1955 par une Lettre ouverte à Monsieur Paul Faber, qui sera publiée par France Dimanche.
Cher Monsieur,
Vous avez bien voulu attirer les rayons du flambeau de l’actualité sur une chanson fort simple et sans prétention. Le Déserteur, que vous avez entendue à la radio et dont je suis l’auteur. Vous avez cru devoir prétendre qu’il s’agissait là d’une insulte aux anciens combattants de toutes les guerres passées, présentes et à venir.
Vous avez demandé au préfet de la Seine que cette chanson ne passe plus sur les ondes. Ceci confirme à qui veut l’entendre l’existence d’une censure à la radio et c’est un détail utile à connaître.
Je regrette d’avoir à vous le dire, mais cette chanson a été applaudie par des milliers de spectateurs et notamment à l’Olympia (3 semaines) et à Bobino (15 jours) depuis que Mouloudji la chante ; certains, je le sais, l’ont trouvée choquante : ils étaient très peu nombreux et je crains qu’ils ne l’aient pas comprise. Voici quelques explications à leur usage.
De deux choses l’une : ancien combattant, vous battez-vous pour la paix ou pour le plaisir ? Si vous vous battiez pour la paix, ce que j’ose espérer, ne tombez pas sur quelqu’un qui est du même bord que vous et répondez à la question suivante : si l’on n’attaque pas la guerre pendant la paix, quand aura-t-on le droit de l’attaquer ? Ou alors vous aimiez la guerre – et vous vous battiez pour le plaisir ? C’est une supposition que je ne me permettrais pas même de faire, car pour ma part, je ne suis pas du type agressif. Ainsi cette chanson qui combat ce contre quoi vous avez combattu, ne tentez pas, en jouant sur les mots, de la faire passer pour ce qu’elle n’est pas : ce n’est pas de bonne guerre.
Car il y a de bonnes guerres et de mauvaises guerres – encore que le rapprochement de bonne et de guerre soit de nature à me choquer, moi et bien d’autres, de prime abord – comme la chanson a pu vous choquer de prime abord. Appellerez-vous une bonne guerre celle que l’on a tentée de faire mener aux soldats français en 1940 ? Mal armés, mal guidés, mal informés, n’ayant souvent pour toute défense qu’un fusil dans lequel n’entraient même pas les cartouches qu’on leur donnait (Entre autres, c’est arrivé à mon frère aîné en mai 1940.), les soldats de 1940 ont donné au monde une leçon d’intelligence en refusant le combat : ceux qui étaient en mesure de le faire se sont battus – et fort bien battus : mais le beau geste qui consiste à se faire tuer pour rien n’est plus de mise aujourd’hui que l’on tue mécaniquement ; il n’a même plus valeur de symbole, si l’on peut considérer qu’il l’ait eu en imposant au moins au vainqueur le respect du vaincu.
D’ailleurs mourir pour la patrie, c’est fort bien : encore faut-il ne pas mourir tous – car où sera la patrie ? Ce n’est pas la terre – ce sont les gens. La patrie (Le général de Gaulle ne me contredira pas sur ce point, je pense.). Ce ne sont pas les soldats : ce sont les civils que l’on est censé défendre – et les soldats n’ont rien de plus pressé que de redevenir civils, car cela signifie que la guerre est terminée.
Au reste si cette chanson peut paraître indirectement viser une certaine catégorie de gens, ce ne sont à coup sûr pas les civils : les anciens combattants seraient-ils des militaires ? Et voudriez-vous m’expliquer ce que vous entendez, vous, par ancien combattant ? Homme qui regrette d’avoir été obligé d’en venir aux armes pour se défendre ou homme qui regrette le temps ou l’on combattait – Si c’est homme qui a fait ses preuves de combattant, cela prend une nuance agressive. Si c’est homme qui a gagne une guerre, c’est un peu vaniteux.
Croyez-moi… ancien combattant, c’est un mot dangereux ; on ne devrait pas se vanter d’avoir fait la guerre, on devrait le regretter – un ancien combattant est mieux placé que quiconque pour haïr la guerre. Presque tous les vrais déserteurs sont des anciens combattants qui n’ont pas eu la force d’aller jusqu’à la fin du combat. Et qui leur jettera la pierre ? Non… si ma chanson peut déplaire, ce n’est pas à un ancien combattant, cher monsieur Faber. Cela ne peut être qu’à une certaine catégorie de militaires de carrière ; jusqu’à nouvel ordre, je considère l’ancien combattant comme un civil heureux de l’être. Il est des militaires de carrière qui considèrent la guerre comme un fléau inévitable et s’efforcent de l’abréger. Ils ont tort d’être militaires, car c’est se déclarer découragé d’avance et admettre que l’on ne peut prévenir ce fléau – mais ces militaires-là sont des hommes honnêtes. Bêtes mais honnêtes. Et ceux-là non plus n’ont pas pu se sentir visés. Sachez-le, certains m’ont félicité de cette chanson. Malheureusement, il en est d’autres. Et ceux-là, si je les ai choqués, j’en suis ravi. C’est bien leur tour. Oui, cher monsieur Faber, figurez-vous, certains militaires de carrière considèrent que la guerre n’a d’autre but que de tuer les gens. Le général Bradley par exemple, dont j’ai traduit les Mémoires de guerre, le dit en toutes lettres. Entre nous, les neuf dixièmes des gens ont des idées fausses sur ce type de militaire de carrière. L’histoire telle qu’on l’enseigne est remplie du récit de leurs inutiles exploits et de leurs démolitions barbares ; j’aimerais mieux – et nous sommes quelques-uns dans ce cas – que l’on enseignât dans les écoles la vie d’Eupalinos ou le récit de la construction de Notre-Dame plutôt que la vie de César ou que le récit des exploits astucieux de Gengis Khan. Le bravache a toujours su forcer le civilisé à s’intéresser à son inintéressante personne ; où l’attention ne naît pas d’elle-même, il faut bien qu’on l’exige, et quoi de plus facile lorsque l’on dispose des armes. On ne règle pas ces problèmes en dix lignes : mais l’un des pays les plus civilisés du monde, la Suisse, les a résolus, je vous le ferai remarquer, en créant une armée de civils ; pour chacun d’eux, la guerre n’a qu’une signification : celle de se défendre. Cette guerre-là, c’est la bonne guerre. Tout au moins la seule inévitable. Celle qui nous est imposée par les faits.
Non, monsieur Faber, ne cherchez pas l’insulte où elle n’est pas et si vous la trouvez, sachez que c’est vous qui l’y aurez mise. Je dis clairement ce que je veux dire : et jamais je n’ai eu le désir d’insulter les anciens combattants des deux guerres, les résistants, parmi lesquels je compte bien des amis, et les morts de la guerre – parmi lesquels j’en comptais bien d’autres. Lorsque j’insulte (et cela ne m’arrive guère) je le fais franchement, croyez-moi. Jamais je n’insulterai des hommes comme moi, des civils, que l’on a revêtus d’un uniforme pour pouvoir les tuer comme de simples objets, en leur bourrant le crâne de mots d’ordre vides et de prétextes fallacieux. Se battre sans savoir pourquoi l’on se bat est le fait d’un imbécile et non celui d’un héros ; le héros, c’est celui qui accepte la mort lorsqu’il sait qu’elle sera utile aux valeurs qu’il défend. Le déserteur de ma chanson n’est qu’un homme qui ne sait pas ; et qui le lui explique ? Je ne sais de quelle guerre vous êtes ancien combattant – mais si vous avez fait la première, reconnaissez que vous étiez plus doué pour la guerre que pour la paix ; ceux qui, comme moi, ont eu 20 ans en 1940 ont reçu un drôle de cadeau d’anniversaire. Je ne pose pas pour les braves : ajourné à la suite d’une maladie de cœur, je ne me suis pas battu, je n’ai pas été déporté, je n’ai pas collaboré- je suis resté, quatre ans durant, un imbécile sous-alimenté parmi tant d’autres – un qui ne comprenait pas parce que pour comprendre, il faut qu’on vous explique. J’ai trente-quatre ans aujourd’hui, et je vous le dis : s’il s’agit de tomber au hasard d’un combat ignoble sous la gelée de napalm, pion obscur dans une mêlée guidée par des intérêts politiques, je refuse et je prends le maquis. Je ferai ma guerre à moi. Le pays entier s’est élevé contre la guerre d’Indochine lorsqu’il a fini par savoir ce qu’il en était, et les jeunes qui se sont fait tuer là-bas parce qu’ils croyaient servir à quelque chose – on le leur avait dit- je ne les insulte pas, je les pleure ; parmi eux se trouvaient, qui sait, de grands peintres, de grands musiciens, et à coup sûr, d’honnêtes gens.
Lorsque l’on voit une guerre prendre fin en un mois par la volonté d’un homme qui ne se paie pas, sur ce chapitre, de mots fumeux et glorieux, on est forcé de croire, si l’on ne l’avait pas compris, que celle-là au moins n’était pas inévitable. Demandez aux anciens combattants d’Indochine – à Philippe de Pirey, par exemple (Opération Sachis, chez Julliard.) – ce qu’ils en pensent. Ce n’est pas moi qui vous le dis – c’est quelqu’un qui en revient – mais peut-être ne lisez-vous pas. Si vous vous contentez de la radio, évidemment, vous n’êtes pas gâté sur le chapitre des informations. Comme moyen de progression culturelle, c’est excellent en théorie la radio ; mais ce n’est pas très judicieusement employé.
D’ailleurs, Je pourrais vous chicaner. Qui êtes-vous, pour me prendre à partie comme cela, monsieur Faber ? Vous considérez-vous comme un modèle ? Un étalon de référence ? Je ne demande pas mieux que de le croire – encore faudrait-il que je vous connusse. Je ne demande pas mieux que de faire votre connaissance mais vous m’attaquez comme cela, sournoisement, sans même m’entendre (car j’aurais pu vous expliquer cette chanson, puisqu’il vous faut un dessin). Je serai ravi de prendre exemple sur vous si je reconnais en vous les qualités admirables que vous avez, je n’en doute pas, mais qui ne sont guère manifestes jusqu’ici puisque je ne connais de vous qu’un acte d’hostilité à l’égard d’un homme qui essaie de gagner sa vie en faisant des chansons pour d’autres hommes. Je veux bien suivre Faber, moi. Mais les hommes de ma génération en ont assez des leçons ; ils préfèrent les exemples. Jusqu’ici je me suis contenté de gens comme Einstein, pour ne citer que lui – tenez, voici ce qu’il écrit des militaires, Einstein…
… Ce sujet m’amène à parler de la pire des créations : celle des masses armées, du régime militaire, que je hais ; je méprise profondément celui qui peut, avec plaisir, marcher en rangs et formations, derrière une musique : ce ne peut être que par erreur qu’il a reçu un cerveau ; une moelle épinière lui suffirait amplement. On devrait, aussi rapidement que possible, faire disparaître cette honte de la civilisation. L’héroïsme sur commande, les voies de faits stupides, le fâcheux esprit de nationalisme, combien je hais tout cela : combien la guerre me paraît ignoble et méprisable ; j’aimerais mieux me laisser couper en morceaux que de participer à un acte aussi misérable. En dépit de tout. Je pense tant de bien de l’humanité que je suis persuadé que ce revenant aurait depuis longtemps disparu si le bon sens des peuples n’était pas systématiquement corrompu, au moyen de l’école et de la presse, par les intéressés du monde politique et du monde des affaires.
Attaquerez-vous Einstein, Monsieur Faber ? C’est plus dangereux que d’attaquer Vian, je vous préviens… Et ne me dites pas qu’Einstein est un idiot : les militaires eux-mêmes vont lui emprunter ses recettes, car ils reconnaissent sa supériorité, voir chapitre atomique. Ils n’ont pas l’approbation d’Einstein, vous le voyez- ce sont de mauvais élèves ; et ce n’est pas Einstein le responsable d’Hiroshima ni de l’empoisonnement lent du Pacifique. Ils vont chercher leurs recettes chez lui et s’empressent d’en oublier le mode d’emploi : les lignes ci-dessus montrent bien qu’elles ne leur étaient pas destinées. Vous avez oublié le mode d’emploi de ma chanson, monsieur Faber : mais je suis sans rancune : je suis prêt à vous échanger contre Einstein comme modèle à suivre si vous me prouvez que j’y gagne. C’est que je n’achète pas chat en poche.
Il y a encore un point sur lequel j’aurais voulu ne pas insister, car il ne vous fait pas honneur ; mais vous avez déclenché publiquement les hostilités ; vous êtes l’agresseur. Pour tout vous dire, je trouve assez peu glorieuse – s’il faut parler de gloire – la façon dont vous me cherchez noise.
Auteur à scandale (pour les gens qui ignorent les brimades raciales), ingénieur renégat, ex-musicien de Jazz, ex-tout ce que vous voudrez (voir la presse de l’époque), Je ne pèse pas lourd devant monsieur Paul Faber, conseiller municipal. Je suis une cible commode ; vous ne risquez pas grand-chose. Et vous voyez, pourtant, loin de déserter, j’essaie de me défendre. Si c’est comme cela que vous comprenez la guerre, évidemment, c’est pour vous une opération sans danger ? mais alors pourquoi tous vos grands mots ? N’importe qui peut déposer une plainte contre n’importe qui – même si le second a eu l’approbation de la majorité. C’est généralement la minorité grincheuse qui proteste -et les juges lui donnent généralement raison, vous le savez ; vous jouez à coup sûr. Vous voyez, Je ne suis même pas sûr que France-dimanche, à qui je l’adresse, publie cette lettre : que me restera-t-il pour lutter contre vos calomnies ? Ne vous battez pas comme ça, monsieur Faber, et croyez-moi : si je sais qu’il est un lâche, je ne me déroberai jamais devant un adversaire, même beaucoup plus puissant que moi ; puisque c’est moi qui clame la prééminence de l’esprit sur la matière et de l’intelligence sur la brutalité, il m’appartiendra d’en faire la preuve – et si j’échoue, j’échouerai sans gloire, comme tous les pauvres gars qui dorment sous un mètre de terre et dont la mort n’a vraiment pas servi à donner aux survivants le goût de la paix. Mais de grâce, ne faites pas semblant de croire que lorsque j’insulte cette ignominie qu’est la guerre, j’insulte les malheureux qui en sont les victimes : ce sont des procédés caractéristiques de ceux qui les emploient que ceux qui consistent à faire semblant de ne pas comprendre ; et plutôt que de vous prendre pour un hypocrite j’ose espérer qu’en vérité, vous n’aviez rien compris et que la présente lettre dissipera heureusement les ténèbres. Et un conseil : si la radio vous ennuie, tournez le bouton ou donnez votre poste ; c’est ce que j’ai fait depuis six ans ; choisissez ce qui vous plaît, mais laissez les gens chanter, et écouter ce qui leur plaît.
C’est bien la liberté en général que vous défendiez quand vous vous battiez, ou la liberté de penser comme monsieur Faber ?
Bien cordialement,
Boris Vian
Quand l’État t’enseigne à tuer, il se fait appeler patrie.
Friedrich Dürrenmatt
13 05 1954
Accord États-Unis – Canada pour la construction d’un canal des Grands Lacs à l’Atlantique.
18 05 1954
Pierre Mendès France devient Président du Conseil. Il sera écolo avant la lettre : distribution des surplus de lait dans les écoles, extinction progressive du privilège des bouilleurs de crus. Il s’engage à conclure la paix en Indochine pour le 20 juillet au plus tard.
Du 19 mai au 26 juin 1954 Les prisonniers du goulag de Kenguir, au Kazakhstan se révoltent et tiendront tête au pouvoir soviétique pendant presqu’un mois : il faudra faire venir 5 chars pour en venir à bout : il y eut de 6 à 700 tués et blessés.
3 06 1954
Il a beaucoup plu ces quatorze derniers jours sur l’Est de l’Allemagne, dans tout le bassin du Danube : près de 9 000 personnes doivent être évacuées et l’on compte douze morts. On a relevé un niveau du Danube de trois mètres plus haut que la moyenne habituelle !

18 06 1954
Mendès-France est investi à la présidence du Conseil. Il choisit de confier le ministère de l’Intérieur à François Mitterrand, lequel sitôt donné son accord, ajoute : Je m’absente un moment ; je serai de retour dans la soirée. Il s’agissait d’un rendez-vous avec une maîtresse, du monde du cinéma, non identifiée par la presse people. Sacrément gonflé, le bonhomme, et prenant son temps, ayant horreur de jouer les hommes pressés, pas comme Chirac, un demi siècle plus tard : cinq minutes, douche comprise.
24 06 1954
Décision est prise d’accepter le principe du partage du territoire du Vietnam. Le 26, Pham Van Dong, chef de la délégation du Viet-minh déclare : la ligne de démarcation sera placée entre le 13° et le 14° parallèle.
30 06 1954
Éclipse totale du soleil en Amérique du Nord, Europe et Asie.
4 07 1954
La finale de la coupe du monde de football oppose la Hongrie, archifavorie à l’Allemagne fédérale : dès la 2°minute, les Hongrois mènent 2 à 0. Puis les Allemands parviennent à égaliser, et, à cinq minutes de la fin inscrivent le but de la victoire. Les Allemands parleront longtemps du miracle de Berne et 1954 sera l’année du début du spectaculaire redressement allemand, avec l’impulsion du Plan Marshall.
L’Etat ouest-allemand devait alors se créer une nouvelle identité, car ses symboles classiques – l’armée, par exemple – étaient devenus inutilisables après l’expérience nazie. La République fédérale devait se réinventer comme société civilisée et pacifique. Le football est venu combler ce vide.
Wolfram Pyta
Après la seconde guerre mondiale, les associations ont permis de recréer des communautés locales avec les nombreux déplacés. Depuis, les clubs de football sont restés des espaces de rencontre privilégiés entre des gens très différents, qu’ils soient étrangers ou de classes sociales diverses. Que l’on veuille jouer sur le terrain ou encourager depuis les tribunes, le club de football reste la meilleure adresse pour s’intégrer, y compris, de plus en plus, pour les femmes,
Nils Havemann

6 07 1954
La chute de Dien-Bien-Phu a rendu disponible les gros des forces de campagne du Viet-minh en même temps qu’elle a surpris ce qui restait des nôtres dans un état de dispersion et d’usure extrême du fait de l’accomplissement des autres tâches du Plan Navarre…
L’heure n’est plus à la temporisation, quelles que soient les raisons morales et politiques que l’on puisse invoquer. Il faut savoir faire la part du feu…
Maréchal Juin
13 07 1954
John Foster Dulles, secrétaire d’Etat américain s’entretient une heure et demi avec Pierre Mendès France. Il rapportera à ses collaborateurs : This guy is terrific [formidable].
19 07 1954
Premier vol d’un Boeing 707 à Seattle. Les tubes font leur apparition, et le Rock’n roll avec : Chuck Berry, Rock Around The Clock, de Bill Haley, et Heartbreak Hôtel, Love me tender, That’s all right, mama, d’Elvis Presley.
*****
Le déclic, ce fut un concert de Janis Joplin à Montréal, en 1968. Ce jour-là, j’ai réalisé ce qu’était le rock : une attitude frondeuse, une colère, une manière de se donner entièrement. Quitte à se briser la voix. Entre Gréco la française, et Janis l’américaine, j’avais trouvé mon chemin. Moi aussi, je me suis mise à crier. Cela me libérait.
Diane Dufresne. Télérama 3375. 20 au 26 septembre 2014
La liberté des corps entre dans la danse, jusque là plutôt confinée dans un espace régi par des codes… oh, il y avait bien eu le charleston avant guerre, mais dans son extravagance, il avait un petit air de ghetto d’intellectuels où la gymnastique tenait une part aussi importante que la danse… avec le rock, c’est une nouvelle relation entre fille et garçons qui s’exprime : elle existait, enfouie, mais c’est bien Elvis Presley qui la fit remonter à toute allure en surface et exploser en plein air comme une grosse et belle bulle multicolore : filles et garçons se disent : tu me plais et je sais que je te plais, mais fais gaffe, arrange-toi pour ne pas dilapider ce magnifique capital de jeunesse. Nous sommes faits l’un pour l’autre, mais je garde malgré tout ma réserve. Le vernis que donne la bonne éducation saute, le plaisir et la pleine santé parlent en toute liberté. La fille tourbillonne, lancée et rattrapée sans cesse par le garçon… il y a du rituel joyeux dans l’air… où chacun prend son bonheur dans ce balancement permanent entre le viens donc près de moi et le va-t-en.
Le romantisme, et ses promesses d’amour éternel sont à terre. Le plaisir s’installe durablement au premier rang des préoccupations : de belles années sont en perspective… jusqu’à ce que se manifestent le revers de la médaille, une bonne vingtaine d’années plus tard, mai 68 aidant, quand il apparaîtra que la déroute en rase campagne de l’autorité entraînait des désastres, quand il apparaîtra que l’augmentation des divorces et donc des familles monoparentales est mère de la délinquance, qu’un enfant sans père est un enfant sans repère, quand les comportements de zappeurs deviendront la règle, du christianisme au bouddhisme, du marxisme au marketing, quand, au procès d’Outreau, ce ne sera pas en premier lieu la Justice qui sera mise en faillite, mais bien le jugement individuel de chacun, le simple bon sens tant méprisé par les intellos de tout poil, ce qu’autrefois, on appelait dans les livres le discernement et dans la rue la jugeote… Toutes ces faillites familiales, ces renoncements quotidiens à s’assumer auront aussi leur traduction à l’échelle politique ; à un de Gaulle qui payait de sa poche le Noël de l’Elysée, on passera à des gouvernants qui trouveront de plus en plus normal de dépenser plus que le montant des entrées, pour finir par être de véritables flambeurs en fabriquant des dettes abyssales, dont les seuls intérêts forment le poste budgétaire le plus important. Mais qu’importe, notre civilisation mettait enfin en place le tout à l’Ego, et cela seul compte, n’est-ce pas ?
Bientôt personne pour bâiller ne mettrait plus sa main devant la bouche. Bientôt la réussite serait aussi estimée que la rectitude, la fantaisie mieux aimée que l’esprit de sérieux, le lâcher-prise plus recherché que l’autorité, le matérialisme mieux partagé que la spiritualité, et la liberté au-dessus de tout. Déjà l’injonction à jouir habitait le présent, le plaisir prévalait sur le devoir.
Alice Ferney. Les Bourgeois Actes sud 2017
Helmut Kohl résumera fort bien le tout, après son départ de la chancellerie : Une nation industrielle n’est pas un parc de loisirs où les retraités sont de plus en plus jeunes, les étudiants de plus en plus âgés, les horaires de travail de plus en plus réduits, et les congés de plus en plus longs.
Sociologiquement, c’est l’arrivée des jeunes sur le marché : les stars gagnent très vite plus d’argent que leurs parents, le parallèle est frappant entre l’arrivée de la couleur à la télévision et l’arrivée de la couleur dans la vie des jeunes, le plaisir – sexuel à l’avant-scène : à tout seigneur, tout honneur – les boums, les concerts très animés etc… Leur musique n’est plus celle de papa, maman.
Un entrepreneur à la veille de la retraite auquel les ans ont appris à ne pas s’en laisser conter noue des liens avec l’amant de sa fille, mariée au demeurant :
Vous connaissez bien ma fille ?
Assez bien.
Il paraît que vous l’accompagnez partout quand Grégoire n’est pas là.
C’est à peu près ça.
Qu’est-ce que vous pensez d’Elias ?
C’est quelqu’un qui fait du ski en hiver et de la voile en été.
Ah ! Ah ! Ça ma plaît bien. C’est exactement ça. Un vrai con, quoi.
Jean-Paul Dubois. Une vie française Éditions de l’Olivier 2004
La primauté [plus tard, on parlera même de tyrannie] de l’émotionnel sur le rationnel, de l’instant sur la durée, va faire partout des ravages, mais en tout premier lieu dans la presse :
L’écrit fait-il travailler les mêmes neurones que l’image ? Je n’ai rien lu de convaincant sur le sujet, mais mon hypothèse est que ce n’est pas le cas. Quand nous sommes aux prises avec un texte écrit, la première démarche est de prendre du temps, la deuxième est de relire quand on ne comprend pas, de se lever pour aller chercher un atlas ou un dictionnaire, bref de tenter de maîtriser le texte. Mais, avec l’image, la réception va si vite qu’on n’a pas le temps de faire toutes ces démarches de maîtrise. Et puis l’image parle autrement, elle est plus agressive, elle occulte beaucoup. C’est un constat expérimental aisé à faire : l’image est tellement prégnante pour notre cerveau que, afin de continuer à lui rester fidèle, il faut qu’elle nous apporte de l’émotif ou de l’affectif de manière permanente. Il ne semble pas qu’elle soit compatible avec des analyses de concepts, de contextes, des statistiques, une histoire, une prospective, des essais… A-t-elle un effet narcotique ? Il faudrait que l’université fasse des recherches sur ce point et conclue. Je constate simplement qu’il existe une différence entre l’écrit et l’image, et que cette différence joue aux dépens du factuel, du contextuel, de l’historique, du sociologique, et au profit de l’affectif, du dramatique. Avec, comme conséquence, une disparition de la durée longue dans le message de l’image. En dehors de l’horizon d’une campagne électorale nationale, notre monde n’est plus gérable ; dans le cas de l’action internationale, l’horizon se réduit à une ou deux semaines. Le long terme a disparu de nos façons de penser, l’image ayant pris le pas sur l’école, sur l’éducation parentale et sur l’écrit. Ces trois choses ne sont pas sur le même plan, mais de toute façon toutes les trois sont débordées. Je l’écris avec beaucoup d’inquiétude parce que je suis quinze fois grand-père : mon interrogation permanente est de me demander quel monde je vais leur laisser, à ces petits.
Qu’il soit bien clair que je questionne un système, bien plus que des personnes. Et c’est précisément cet effet de système qui me paraît redoutable. Il y a un deuxième aspect de la vie médiatique. Le premier portait sur la différence entre l’image et l’imprimé, le son n’étant qu’un intermédiaire : la radio n’a pas eu le temps de créer une culture et de transformer les mentalités, elle n’a dominé que pendant trente ans ; elle est un relais, elle a un peu de pouvoir explicatif, mais elle ne fait pas une sensibilité collective. Le deuxième aspect, c’est la vitesse. On a désormais les moyens de transmettre les images et les informations à la vitesse de la lumière. Un événement politique majeur se produit : trente mille micros se tendent à trente mille museaux de personnalités, hommes ou femmes politiques, dans les cinq minutes.
[…] À l’origine, la presse avait un formidable respect des faits et s’adressait aux 5 % du public lettré et exigeant. Cela nécessitait une qualité de contenu. Par la suite, et après un combat difficile pour la liberté de la presse, les journaux ont pu élargir leur champ. La presse s’est alors construite contre le pouvoir, contre le gouvernement, et enfin sur un principe de suspicion automatique. La presse s’érige désormais à la fois en juge, voire en policier pour traquer les erreurs, se focaliser sur les personnes. Mais, surtout, elle traite le chef du gouvernement comme un trapéziste solitaire et pas du tout comme un chef d’orchestre.
Je crois que la presse écrite a fait fausse route, mais qu’elle n’a pas su trouver sa place ni dans le système médiatique, ni dans le jeu démocratique.
Les médias sont dans une course à l’information sans recul. Ils privilégient la petite phrase, le scoop, la réaction rapide. Leur temps n’est pas en adéquation avec celui de la société. Les décisions politiques essentielles peuvent mettre des années, parfois des dizaines d’années, avant de produire leurs effets, j’en ai fait régulièrement l’expérience, c’est un délai qui ne correspond pas à celui des médias, ni d’ailleurs à celui des échéances électorales. À trop vouloir du sensationnel, ils passent à côté de l’information proprement dite, se contenant de reproduire des réactions sans les restituer et sans les confronter à la réalité.
Pour confirmer cette accusation lourde, il faut des exemples ; en voici deux :
Un jour, à la descente d’une tribune après une conférence (qui devait porter sur l’Europe), je suis abordé par une jeune journaliste talentueuse de RTL qui me dit :
Monsieur Yitzhak Rabin vient d’être assassiné, qu’est-ce que vous en pensez ?
Elle disposait de la nouvelle depuis cinq minutes, et, moi, je la découvrais. Tout individu en politique éprouve un besoin vital de survie qui se traduit par la nécessité que son nom sorte et que l’on parle de lui. Il se trouve qu’il n’y a plus de moyens de communication propres au monde politique en interne (l’information interne au PS et à ses membres, ce sont les médias qui la donnent…). Donc tout homme politique qui a l’aubaine d’avoir un micro sous le nez aura la chance que son nom soit prononcé. Aussi il faut avoir derrière soi une autorité bien établie (c’était mon cas), pour mettre la main sur son micro, tancer la journaliste et lui dire :
De qui vous moquez-vous ? Vous me donnez une nouvelle, mais vous n’êtes pas capable de me dire si c’est un juif ou un Arabe qui a assassiné Yitzhak Rabin. Ce n’est tout de même pas pareil ! Comme il s’agit en outre d’un de mes amis, j’ai besoin de réfléchir aux mots… On ne travaille pas comme ça.
J’ai écarté la journaliste d’un geste. Elle a eu du mal à s’en remettre… Les journalistes en ont vu d’autres… C’est leur travail. Mais, bien entendu, tout le monde politique s’empresse de répondre à ce genre de questions.
En voici un deuxième tout aussi révélateur.
Six mois après mon départ de Matignon, Jacques Chirac, alors chef de l’opposition, m’accuse, avec son culot habituel, d’avoir vidé les caisses de l’État. Dans la demi-journée, je reçois de cinquante à soixante demandes de réaction de la part de journalistes de l’écrit, de la TV ou de la radio. Je réponds que j’irai partout où le média, quel qu’il soit, aura pris la responsabilité de donner la vérité les chiffres. C’est d’autant plus simple qu’ils sont accessibles au Journal officiel. Or, aucun média n’a accepté de faire ce travail minimal consistant à aller voir l’évolution du déficit budgétaire sur les années correspondant à mes responsabilités. Chacun aurait pu constater que j’avais réduit le déficit de 45 milliards de francs par rapport au dernier budget préparé par Jacques Chirac lorsqu’il était Premier ministre. Le Monde m’a proposé un débat avec Jacques Chirac : ainsi était-ce à moi de défendre mon bilan et d’assumer les chiffres ! Ce qui, bien sûr, leur eût conféré un aspect partisan qu’il n’avait pas à avoir. Bref, aucun journal ou média n’a voulu faire l’effort de regarder, de comparer, de mettre en perspective. Il est clair que la publication des vrais chiffres éteignait le débat en mettant en évidence le procès d’intention mensonger de Jacques Chirac. Chacun préférait une longue suite d’engueulades entre lui et moi, chacun partial derrière ses chiffres sans qu’on pût savoir quels étaient les vrais… même Le Monde. Du coup, je n’ai répondu nulle part, et ce mensonge calomnieux est resté sans démenti !
Un débat de société sur le caractère nuisible des médias sur la politique doit être ouvert. Mais un gouvernement ne peut courir le risque de lancer une telle étude, il y aurait immédiatement les médias contre lui. C’est à l’université de prendre cette initiative. Il faudrait chercher les instruments permettant de mesurer les effets de l’image et de l’écrit, de comprendre la prééminence de l’émotion et du drame à laquelle l’image donne lieu par rapport à l’explication. Les blocages de société auxquels nous devons faire face durent depuis trop longtemps pour que nous ne voulions pas cette piste. Cette prédominance de l’émotion se traduit notamment en France par le fait que, depuis vingt-cinq ans, toutes les majorités sortantes ne sont pas reconduites.
Michel Rocard. Si ça vous amuse. Flammarion 2010
L’instant : il était là, et hop, le voilà parti ; un néant le précède, un néant lui succède. […] Attaché court au piquet de l’instant…
Nietzsche
Soixante ans plus tard, dans l’émission de France Culture Le Tour du monde des idées, des 28 et 29 septembre 2020 Brice Couturier racontera ce qui se passe depuis 2015 sur les campus américains, plus précisément sur celui du Clermont McKenna College of Los Angeles où des étudiants, de plus en plus nombreux, récusent et donc refusent les enseignements qui portent atteinte à leurs sentiments profonds et viennent semer le trouble en leur esprit, et en viennent donc à refuser la venue de conférencier(e)s du calibre de Condolezza Rice, ex-secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères des Etats-Unis d’Amérique, ou de Christine Lagarde, alors à la tête du FMI ! Jennifer Pearson, professeure de droit public à Harvard s’en alarmera. Tous ces chers petits ont grandi auprès de parents qui n’ont eu de cesse de leur répéter que la vie est dangereuse et qui les ont donc dorloté et surprotégé, avec sous-tendu, le postulat que le plaisir prime sur tout autre principe. On ne peut pas dire que l’on est aux portes de la folie, car on est déjà en plein dedans par simple mais totale démission de l’intelligence : le déni de la réalité, le refus d’en parler. George Orwell avait déjà parlé de cela dès 1945 dans La ferme des animaux. Jonathan Hardt et Greg Lukianoff reprendront le thème en 2015 avec The codding of American mind.
21 07 1954
L’engagement de Pierre Mendès France courait jusqu’au 20 juillet. Le 20 juillet à 17 h 10, on annonce une signature en séance solennelle au Palais des Nations de Genève pour 21 h. À 21 h, rien… une heure plus tard, toujours rien. On apprend que Tet Phan, délégué du Cambodge vient de faire savoir qu’il refuse de signer l’accord. Les négociations reprennent, les délégués du Viêt-minh se méfient : pas de dissolution des trois armistices vietnamien, laotien et cambodgien. À minuit, Mendès France, fait unique dans les annales, fait arrêter les pendules, et un accord fini par être signé à 3 h 50, mais les pendules affichent la date du 20 juillet. Satisfaction un brin scolastique pour le président du Conseil, mais amère victoire. Le Viêt Nam est provisoirement divisé en 2 États, en attendant un référendum sur une réunification. Mais les États-Unis vont s’empresser d’empêcher cette réunification, en plaçant à la tête du gouvernement de Saïgon un vietnamien qui avait vécu dans le New-Jersey : Ngo Dinh Diem, catholique dans un pays en grande partie bouddhiste, proche des grands propriétaires terriens dans un pays essentiellement peuplé de petits paysans, il va de lui-même assurer le développement d’une opposition, très largement soutenue par le gouvernement de Hanoï.
C’est la première fois dans l’Histoire qu’on voit le vaincu poser un ultimatum au vainqueur et l’emporter.
André Siegfried
Alors s’abattit sur le nord Vietnam pour des décennies la chape de plomb du tout puissant Parti Communiste, enrégimentant tout un peuple ; point n’était besoin de barbelés, la toute puissance du président de la section locale du Parti suffisait. Les héros de la guerre furent fêtés, et c’est ainsi que l’on vit désignées d’office des jeunes femmes pour devenir les épouses d’invalides : c’est le Parti qui le demande. La jeune femme arrivait dans la maison de l’heureux bénéficiaire, et faisait sa connaissance quand il entrait dans la pièce sur un brancard manipulé par des proches… souvent plus de jambes, parfois plus de bras, et l’on consolait la jeune femme atterrée avec un mais rassurez-vous, son truc marche très bien, c’est le médecin qui l’a dit. On apprend cela dans Terre des oublis, un très beau livre de Duong Thu Huong. Sabine Wespieser, éditeur. 2006
Certes on a vu chez nous bien des infirmières épouser le malade qu’elles soignaient, mais c’était leur libre choix, cela n’était jamais imposé, et, beaucoup plus que le degré du handicap, c’est cela qui fait la différence.
26 07 1954
Des centaines de milliers de New-Yorkais acclament Geneviève de Gallard [1], dispersant du sommet des gratte-ciel des tonnes de confettis. Elle est reçue à la Maison Blanche par le président Dwight Eisenhower ; les membres du Congrès lui réservent une standing ovation.
Pendant ce temps-là, Federico Bahamontes, qui n’est pour l’instant que l’Aiglon de Tolède, en attendant d’en devenir l’Aigle, passe en tête le col de Romeyère en Isère, à 1069 mètres, avec 5 » d’avance sur le suivant et en attendant la voiture de son directeur pour lui changer son vélo qui a deux rayons cassés, s’offre -, ou se fait offrir un cornet de glace. La légende prendra le pas sur la réalité en le disant en tête avec 20 ‘ d’avance, et sans mentionner l’incident mécanique. L’âge se sa mort – 95 ans – 1928-2023 – est le meilleur garant de l’absence de toute prise de drogue sa vie durant.
30 07 1954
Les Italiens Lino Lacedelli et Achille Compagnoni arrivent au sommet du K2 : ses 8 616 m. en font le deuxième sommet du monde.
Les nations vivaient encore sur les sentiments de l’après guerre qui, en Italie, étaient ceux d’un pays défait ; et le désir était grand de redonner des motifs de fierté à ce peuple : on en était resté à un retentissant Shut up Malaparte ! [né Kurt Suckert, de père allemand, Malaparte n’est qu’un pied de nez de potache contre Buonaparte] venu des Américains à la sortie de la guerre ; la conquête d’un sommet prestigieux était au nombre des entreprises susceptibles de redonner de la vigueur à un pays diminué ; et ce qui avait été vrai pour l’Annapurna en France le fût aussi en Italie pour l’expédition au K2, entreprise d’intérêt national, avec les exigences de l’époque, très rapide à bétonner l’information : chaque participant avait signé un engagement par lequel il se refusait au retour à toute interview, à l’exception du seul chef d’expédition.
Walter Bonatti, 24 ans, était de la partie ; il attendit plus de 40 ans avant de dire dans quelles conditions ce sommet avait été conquis ; encore jeune mais déjà connu dans le monde de l’alpinisme, – il avait déjà à son actif la face est du Grand Capucin, un exploit en rocher pur, à 21 ans, en 1951 – il se révéla être au cours de l’expédition l’un de ceux qui avaient la meilleure condition physique au moment de l’assaut final : mais ce dernier fût réservé à de plus anciens, lui-même se voyant confiée la tâche de monter deux bouteilles d’oxygène jusqu’au dernier camp, vers 7 950 m, avec le Hunza Mahdi.
Bonatti et Mahdi vont chercher Lacedelli et Compagnoni de la tombée du jour jusqu’à la nuit bien installée, hurlant leurs noms dans la paroi de neige et de glace… sans réponse. Ils ne sont pas à l’endroit estimé… ce n’est qu’une fois la nuit tombée, alors que Bonatti avait déjà creusé une banquette en se résignant à y bivouaquer aux cotés d’un Mahdi rendu fou par l’approche du drame, que Lacedelli finit par sortir de sa tente, pour répondre au dernier appel de Bonatti :
Bonatti : Lino ! Achille ! Nous sommes ici ! Pourquoi vous ne vous êtes pas montrés plus tôt ?
Lacedelli : Tu ne voudrais quand même pas qu’on reste dehors toute la nuit à se geler pour toi !
Vous avez l’oxygène ?
Oui
Bon, laisse-le là et redescendez tout de suite !
C’est impossible, Mahdi n’est pas en état de le faire.
Comment ça ?
J’ai dit que Mahdi n’était pas en état ; tout seul, je peux me débrouiller, mais lui, il a perdu la tête. En ce moment, il est en train de traverser la paroi !
Le dialogue se termina ainsi, Lacedelli rentrant sous sa tente, et Bonatti parvenant à faire faire demi-tour à Mahdi pour bivouaquer et attendre le jour pour redescendre. La nourriture sera faite de trois bonbons, vite recrachés, tant ils étaient incapables de fournir la moindre salive. Bonatti sortira meurtri de cette tentative d’homicide, mais sans dommage physique. Mahdi subira plusieurs amputations aux mains et aux pieds : Cela marque d’une façon indélébile l’âme d’un jeune homme et déstabilise son assiette spirituelle encore insuffisamment affermie. L’homme tirera sa révérence le 13 septembre 2011, à 81 ans, en étant parvenu à ce que la vérité sur l’affaire soir dite haut et fort : en 1993 le Club Alpin Italien acceptera que la vérité fasse surface et il gagnera en 2004 le procès pour que justice lui soit rendue.
Quand Puchoz, originaire du Val d’Aoste, est mort, le chef de l’expédition, Ardito Desio, a interdit à ses compagnons de descendre au camp de base pour rendre hommage à sa dépouille et cela parce qu’il ne voulait pas retarder d’une seule minute la course au sommet, lequel devait à tout prix être vaincu par les Italiens. Desio avait sur l’équipe un pouvoir absolu et il avait été préféré au plus prestigieux Riccardo Cassin, qui était à l’époque le meilleur alpiniste italien. Quelqu’un s’est rebellé contre cet oukase, on en est même venu aux poings, on a frôlé des sanctions de cour martiale, mais ensuite la victoire de Lacedelli et Compagnoni a fait le silence sur toute l’affaire. Y compris sur la mort à laquelle Bonatti a échappé de justesse.
Paolo Rumiz La légende des montagnes qui naviguent. Flammarion 2017
31 07 1954
LE DISCOURS DE CARTHAGE
Déclaration faite au nom du gouvernement français à S. A. le bey de Tunis,
Après les accords de Genève, c’est à la recherche d’une solution aux problème tunisien que le Président du Conseil va s’attacher en priorité.
Désireux de stopper au plus tôt le tragique processus qui s’est engagé dans ce pays, Pierre Mendès France, tout en assurant la conduite de la négociation indochinoise, a consulté les responsables civils et les chefs militaires, écouté les hommes politiques et les journalistes informés des problèmes tunisiens. A Genève, il s’est entretenu avec le général Boyer de Latour, commandant supérieur des troupes de Tunisie, et a rencontré Mohammed Masmoudi, un des proches de Habib Bourguiba.
Dès son retour à Paris, après le débat sur les accords de Genève, Pierre Mendès France décide de mettre en œuvre la politique qu’il avait définie dans son premier discours d’investiture du 3 juin 1953 et qu’il a rappelée le 17 juin 1954. Il s’agit, dans le cadre du traité de protectorat, d’accorder à la Tunisie l’autonomie interne dont l’exercice serait défini, en même temps que la garantie des intérêts de la France et des Français, par de conventions négociées entre les deux pays.
Au cours du conseil des ministres du 30 juillet, les projets du Président du Conseil sont approuvés par le gouvernement. Le général Boyer de Latour remplace Pierre Voizard au poste de résident général.
Le lendemain, 31 juillet, Pierre Mendès France, accompagné du maréchal Juin, de Christian Fouchet, son ministre des Affaires marocaines et tunisiennes, et d’André Pélabon, son directeur de cabinet, se rend à Tunis pour informer officiellement le bey des intentions du gouvernement français.
Monseigneur,
C’est un ami qui vient vous voir, ami de votre Altesse et ami de votre pays. C’est aussi le chef du gouvernement de la France, de la France qui a tant fait pour la Tunisie.
Je sais, Altesse, vos soucis et votre tristesse devant la situation actuelle de votre royaume. Ces soucis, cette tristesse, sont également les miens.
J’ai donc tenu à venir vous exposer moi-même aujourd’hui, avec M. le ministre Christian Fouchet et M. le maréchal Juin, les propositions du gouvernement français à l’égard des problèmes que posent les relations entre nos pays et nos peuples.
Ces problèmes ont été compliqués beaucoup plus par la violence des attentats et par l’opposition de thèses purement doctrinales que par un antagonisme réel et profond des intérêts en présence. C’est pourquoi il nous appartient de faire un effort, non seulement de conciliation mais aussi de réalisme et de clarté. Le gouvernement français, unanime, y est décidé pour sa part, tout comme le général Boyer de Latour qui vient d’être chargé des fonctions de résident général et qui a toute notre confiance comme il aura certainement la vôtre. Nous faisons cordialement appel à tous ceux qui entendent s’engager dans la voie du progrès et des réformes nécessaires en ce siècle.
Notre politique est une politique libérale, conforme aux traditions de notre histoire aussi bien qu’aux aspirations profondes du peuple tunisien et aux promesses qui lui ont été faites.
L’autonomie interne de l’État tunisien est reconnue et proclamée sans arrière-pensée par le gouvernement français qui entend tout à la fois l’affirmer dans son principe et lui permettre dans l’action la consécration du succès. Le degré d’évolution auquel est parvenu le peuple tunisien – dont nous avons lieu de nous réjouir d’autant plus que nous y avons largement contribué -, la valeur remarquable de ses élites justifient que le peuple soit appelé à gérer lui-même ses propres affaires.
C’est pourquoi nous sommes prêts à transférer à des personnes et à des institutions tunisiennes l’exercice interne de la souveraineté.
Dès maintenant, et tel est votre désir, un nouveau gouvernement peut être constitué qui, outre la gestion des affaires de la régence, sera chargé de négocier en votre nom avec le gouvernement français les conventions destinées à fixer clairement les droits des uns et des autres. Ces conventions préciseront les obligations réciproques des deux pays et les garanties reconnues à la France et aux Français habitant en Tunisie.
Je tiens à cet égard à préciser la pensée du gouvernement français sans aucune équivoque afin que l’accord se dégage dans une parfaite loyauté et qu’aucune interprétation déraisonnable ne puisse être donnée à mes intention
Il est sans aucun doute de l’intérêt commun que la France reste présente en Tunisie. Les services qu’elle rend à votre pays, l’aide culturelle, économique, technique et financière qu’elle lui fournit, la place qu’un grand nombre de Français y occupent et le travail qu’ils ont accompli sont des réalités dont aucun patriote tunisien ne songerait à faire bon marché.
Au surplus, la sauvegarde de la paix dans cette région du globe qui est la nôtre exige l’unité de la défense ; de là découle aussi la nécessité d’une commune politique étrangère. C’est bien pourquoi vos illustres prédécesseurs ont tenu, comme vous tenez aussi, à ce que la France assure la sécurité de votre pays et ses relations internationales, conformément au traité du Bardo
L’apport de la France à la prospérité de la Tunisie repose, dans une large mesure, sur la présence d’un grand nombre de Français dont le rôle, dans les branches d’activité les plus diverses, a puissamment contribué au développement et à l’enrichissement de la Tunisie.
Les Français, en échange de leurs services passés et présents, du rôle qu’ils peuvent et doivent jouer dans l’avenir, ont acquis le droit de vivre et de travailler en Tunisie, droit dont personne ne songe à les priver. Il ne s’agit pas seulement de défendre les situations qu’ils se sont acquises. En vérité, ils doivent continuer, eux, leurs fils et les fils de leurs fils, une tâche qui répond à l’intérêt du pays et de tous ses habitants.
Leur action doit, non seulement se poursuivre, mais se développer dans un climat de confiance et d’amiti
Vous continuerez de trouver parmi eux tous les concours pour moderniser et développer votre royaume et pour vous aider à satisfaire les immenses besoins économiques et sociaux résultant de l’expansion démographique de votre peuple. Vous penserez comme moi que le gouvernement tunisien souhaitera trouver en leur expérience économique le concours de consultations utiles.
Outre la part qu’ils pourront prendre notamment à la vie municipale, la représentation et la défense de leurs intérêts au sein d’assemblées qui leur seront propres, les Français doivent avoir les moyens pratiques de faire assurer le respect des règles de droit inscrites en leur faveur dans les conventions. Ils ne devront supporter aucun préjudice discriminatoire de droit ou de fait. En cas de violation des conventions ou d’abus de pouvoir, la France, comme la Tunisie, devront pouvoir recourir à une procédure arbitrale franco-tunisienne dont la saisine aura une valeur suspensive selon des conditions à déterminer.
Aussitôt après la conclusion de nos conventions, l’autonomie interne sera définitivement acquise sans aucune restriction ni limitation que celles qui résulteront de ces conventions elles-mêmes. Nous sommes certains, connaissant les sentiments de Votre Altesse, et les aspirations de son peuple, que les réformes marqueront un progrès démocratique dans les institutions. On peut également souhaiter qu’elles comportent toutes les mesures assurant à ce pays les garanties qu’offre, dans un Etat moderne, le contrôle d’un tribunal administratif suprême.
Nous n’avons pas le droit d’oublier non plus que les réformes politiques seraient de peu de portée si elles ne s’accompagnaient d’une action administrative, économique et sociale destinée à améliorer les conditions d’existence du pays et à tirer tout le parti possible de ses ressources matérielles et humaines. Vous ne pouvez pas douter que, pour cette grande tâche de progrès et de justice, le concours de la France vous soit toujours acquis.
Encore faut-il, pour que nous puissions nous y attacher utilement, que le calme revienne dans les esprits. Faisons appel au concours et à la compréhension de tous ceux qui, comme nous-mêmes, souhaitent une solution prochaine à nos problèmes. Demandons à tous ceux qui détiennent une autorité et une influence, demandons à la presse, aux groupements et aux associations de toutes sortes, de faire entendre autour d’eux la voix de la sagesse et de l’amitié entre des hommes qui doivent collaborer et qui ont été malheureusement divisés.
Au cours de ces dernières semaines, les violences ont redoublé comme si elles voulaient gagner de vitesse nos décisions et creuser un fossé entre les populations appelées à s’entraider fraternellement
Comme vous-même, j’ai le droit d’espérer qu’un terme sera mis maintenant à ces violences. S’il fallait affecter plus de moyens pour les maîtriser, le gouvernement français n’hésiterait pas à envoyer tous les renforts nécessaires ; s’il fallait recourir à des mesures draconiennes d’ordre public, à son regret, il les prendrait.
Si de nouveaux attentats venaient endeuiller ce pays, les sanctions, je dois le dire loyalement, seraient d’une rigueur que ne mitigerait aucun ménagement car notre devoir consiste, n’est-il pas vrai, à hâter l’heure de la conciliation et des réformes sur le sens desquelles aucun désaccord n’a plus lieu de subsister entre nous.
De toute manière, le terrorisme n’atteindra pas le but qu’il poursuit, il n’entravera pas les déterminations politiques que nous avons prises. Tout au plus, il risque d’en retarder le succès, tout en imposant à votre peuple des souffrances imméritées.
Vous n’ignorez pas, Altesse, que vous pouvez compter sur la bonne volonté entière du gouvernement français. C’est pourquoi j’ai tenu à venir, dans cette circonstance qui doit être heureuse pour nos deux pays, vous apporter moi-même le message amical du peuple français. Je regrette vivement que mon séjour auprès de vous soit trop bref, en raison d’affaires pressantes qui me rappellent à Paris. J’espère pouvoir revenir prochainement pour une durée moins limitée. J’espère surtout que notre entretien d’aujourd’hui aura pu contribuer à une meilleure compréhension entre nos deux peuples, qui doivent reprendre la route sur laquelle ils ont ensemble réalisé tant de progrès déjà en trois générations.
La meilleure garantie des intérêts des uns et des autres, la meilleure chance d’avenir pour la Tunisie entière et pour tous ceux qui contribuent à sa vie, n’est-elle pas, en effet, une intime coopération qui ne peut manquer de se confirmer entre Français et Tunisiens, réunis par tant de profondes affinités et de réelle sympathie ?
Pierre Mendès France. Œuvres complètes, tome 3 Gouverner, c’est choisir 1954-55, Paris, Gallimard, 1986, p. 181-185.
07 1954
Découverte de pétrole à Parentis en Born, dans les Landes. D’excellente qualité, le brut qu’il renferme est à proximité du chemin de fer et de l’océan. Déjà, certains imaginent que le Sud-Ouest va devenir un Texas français, et non des moindres puisque même la Bourse et le président du Conseil attrapent la fièvre :
Les gisements du Sud-Ouest nous procureront d’ici quatre ou cinq ans de quoi couvrir le cinquième au moins de nos besoins et soulageront d’autant notre balance commerciale.
Pierre Mendès France. Le Monde du 27 10 1954
Le Time Magazine de New York de mai 1955 y consacrera même un article, titré Le boom. Mais, pour atteindre cet objectif, avec une consommation de l’ordre de 15 millions de tonnes de pétrole, nos puits auraient dû donner de 3 à 4 millions de tonnes. Or, en 1953, leur production a été de 388 000 tonnes. En 1956, du pétrole sera découvert dans le sous-sol algérien : les compagnies réorienteront leurs investissements vers le Sahara.
08 1954
Au cours de sa première tournée, Jacques Brel chante dans la salle d’un restaurant de Megève, où la clientèle l’énerve foutrement.
23 08 1954
Getulio Vargas, à nouveau président du Brésil depuis 1950, mais abandonné par l’élite militaire, est certain d’être renversé dans les jours suivants : il se suicide d’un tir dans la poitrine dans le palais présidentiel de Catete, à Rio de Janeiro. Il laisse une lettre à son peuple :
Une fois de plus, les forces et les intérêts hostiles au peuple se sont associés et se sont à nouveau déchaînés contre moi. Ils ne m’accusent pas, ils m’insultent ; ils ne me combattent pas, ils me calomnient, en ne m’accordant pas le droit de me défendre. Ils ont besoin d’étouffer ma voix et d’empêcher mon action, pour que je cesse de défendre, comme je l’ai toujours fait, le peuple et surtout les humbles. […] Et à ceux qui pensent m’avoir vaincu, je réponds par ma victoire. J’étais esclave du peuple et aujourd’hui, je me libère pour la vie éternelle. Mais ce peuple dont j’ai été l’esclave ne sera plus l’esclave de personne. Mon sacrifice demeurera pour toujours dans son âme et mon sang sera le prix de son sauvetage. J’ai lutté contre la spoliation du Brésil. J’ai lutté contre la spoliation du peuple. J’ai lutté à cœur ouvert. La haine, les infamies, la calomnie n’ont pas éteint ma flamme. Et je vous ai donné ma vie. Maintenant, je vous offre ma mort. Je ne regrette rien. Je fais sereinement le premier pas sur le chemin de l’éternité et je sors de la vie pour entrer dans l’histoire.
*****
Malgré ses accointances évidentes avec les autoritarismes du cœur du XX° siècle, l’ère Vargas demeure, dans la mémoire populaire, le symbole d’une confiance possible des masses dans leurs dirigeants et d’un État attentif aux plus modestes.
Maud Chirio. L’Histoire Juillet-Août 2011
30 08 1954
Après une longue et très dure bataille, le parlement refuse la CED.
29 09 1954
À Genève, création du CERN : Centre Européen pour la Recherche Nucléaire.
7 10 1954
Présentation au Salon de l’Auto, au Grand Palais, de la Dyna 54 – 55.
23 10 1954
Les accords de Paris donnent naissance à l’UEO : Union de l’Europe de l’Ouest, qui comprend l’Allemagne de l’Ouest, Angleterre, Italie, Belgique, Pays Bas, Luxembourg et France.
Le commissaire Carcenac, chef de la PRG – Police des Renseignements Généraux – pour l’Algérois, envoie au ministère de l’Intérieur un rapport qui parle de groupe autonome d’action directe… Ces irrédentistes […] sont tous des hommes de la clandestinité, anciens dirigeants de l’OS – Organisation Spéciale [créée en 1947] – qui ont demandé de pousser l’activité du groupe pour allumer la mèche en Algérie.
26 10 1954
Pierre Mendès-France crée la Commission Supérieure des Applications militaires de l’Energie Atomique – CSMEA -, puis 15 jours plus tard le 4 novembre, le Comité des Explosifs Nucléaires, qui ne se réunira… jamais :
Sans la bombe, on n’a pas voix au chapitre.
29 10 1954
Jean Vaujour, directeur de la Sureté en Algérie, réunit à Constantine toutes les autorités civiles et militaires pour leur faire part de ses appréhensions ; un colonel myope le moque. Il les convoque à Alger pour le 1° novembre : trop tard !
Il existe alors trois services s’occupant de renseignements, tous jaloux de leurs prérogatives et donc parfaitement cloisonnés, sans collaboration aucune d’un service à l’autre : la PRG, le SLNA – Service Liaisons Nord Afrique – et la DST : Direction de la Sureté du Territoire. Le SLNA avait appris en mars 1954 l’existence d’une CRUA – Comité Révolutionnaire Unité Action -, ancêtre du FLN – Front de Libération Nationale -. Dès le début octobre, Abdelkader Belhadj Djillali, ancien instructeur militaire de l’OS – l’organisation spéciale dont sont issus la plupart des neuf chefs historiques du FLN [Hocine Aït Ahmed, Ahmed Ben Bella, Mostapha Ben Boulaïd, Larbi Ben M’hidi, Rabah Bitat, Mohamed Boudiaf, Mourad Didouche, Krim Belkacem, Mohamed Khider] -, arrêté par la France puis retourné, avait averti de la préparation des attentats. Toutes ces informations, envoyées place Beauvau, tombaient dans le vide : des coups de poing dans un oreiller ! réactivité nulle. Siégeait alors au ministère de l’Intérieur un certain François Mitterrand. Faute d’ordres reçus de Paris, Jean Vaujour avait fait ce qu’il pouvait, en faisant remplacer la poudre des bombes par du chlorate de potasse, parfaitement inoffensif : et de fait, nombre de bombes à Alger le 1° novembre ne seront que des pétards mouillés !
10 1954
Le patron du Salon des Arts Ménagers est dénué de flair… puisqu’il refuse à Frédéric Lescure, PDG de la SEB (Société d’Emboutissage de Bourgogne), d’exposer sa Cocotte Minute. Ce dernier ne se démonte pas et fait distribuer par ses enfants à l’entrée du Salon le poème suivant :
Je suis une pauvre Cocotte
Le Salon m’a fermé ses portes
Pourtant je suis sûre et fidèle
Et puis, de beaucoup, la plus belle.
7 ans plus tard, la First Lady Jacky Kennedy rendra à la SEB un service plus qu’appréciable en se faisant photographier dans un magazine, une poêle Tefal en main, ainsi légendée qui-n’attache-vraiment-pas. De 4 500/semaine, les commandes américaines passèrent immédiatement à 250 000 ! Et 44 ans plus tard, la SEB fêtait sa dix millionième Cocotte : les qualités du produit sont donc plus évidentes que celles de versificateur de Frédéric Lescure.
À peu près en même temps, la société lyonnaise Deom sortait le camping-gaz Bleuet.
__________________________________________________________________________________________________
[1] qui mettra un certain nombre d’années pour admettre qu’elle n’était pas la seule femme présente à Dien Bien Phû, comme le voudra la légende, puisqu’il y avait aussi les BMC – Bordels Militaires de Campagne – prostituées vietnamiennes et arabes – qui, dans les derniers jours, seront très fréquemment plus infirmières que prostituées ; mais, bien évidemment, elles ne reçurent aucune distinction pour cela.