| Publié par (l.peltier) le 24 août 2008 | En savoir plus |
14 09 1986
Attentat contre le Pub Renault. Le patron de Renault est alors Georges Besse, qui vient d’Eurodif, auquel l’Iran avait prêté de l’argent, du temps du Shah, et que la France refusait de rembourser après l’arrivée de Khomeiny au pouvoir.
22 09 1986
Accord sur le désarmement, dans la ligne des accords d’Helsinki de 1975 ; droit d’inspection sur un territoire par un tiers.
09 1986
Chimamanda Ngozi Adichie, née à Enugu en 1977, va à l’école de Nsukka, dans le sud-est du Nigeria : elle y fait un devoir dont l’enjeu est de devenir chef de classe pour celui qui obtiendra la meilleure note ; et cette meilleure note est pour elle. Toute heureuse de devenir chef de classe, elle déchante quand la maîtresse s’excuse : cela me semblait tellement évident que j’avais oublié de vous dire que le gagnant ne peut être qu’un garçon. L’affaire lui restera en travers de la gorge, même si le garçon gagnant était en or. 26 ans plus tard : elle se retrouvera poussée par la famille, par ses amis sur l’estrade de TEDx-Euston, à Londres, sans savoir très précisément quoi dire, et elle fait un tabac. Vue sur You Tube par 2.5 millions de personnes. Beyonce introduit des extraits dans sa chanson Flawless. Le discours paraît au Royaume-Uni et aux États-Unis sous le titre We Should All Be Feminists. En France, Marie-Pierre Gracedieu, éditrice de l’œuvre de Chimamanda Ngozi Adichie chez Gallimard, décide d’une parution dans la collection Folio 2 €, pour qu’il circule comme un pamphlet. Le petit livre rouge Nous sommes tous des féministes aura une très belle réception, notamment lors d’une soirée à la Maison de la poésie à Paris. Elle publiera chez Gallimard en 2008 L’Autre Moitié du soleil.
12 10 1986
Lancement au Havre du paquebot à voile Wind Star : 130 m de long, 4 mats, 150 passagers. C’est le père des futurs Club-Med 1 et 2.

17 11 1986
Georges Besse est assassiné par Action Directe. Deux heures plus tard, un communiqué des Affaires Étrangères annonce qu’un accord partiel sur le règlement du contentieux Eurodif avec l’Iran a été signé. Encore deux heures plus tard, les islamistes promettent la libération d’un otage.
21 11 1986
Richard Buckland, tout juste 17 ans, se trouve au tribunal de Leicester. Il est présumé coupable du viol, puis du meurtre de deux jeunes adolescentes, à trois ans d’écart. Il a reconnu le meurtre de la première, pas de la seconde. Il est apprenti cuisinier, muni d’un QI bien faiblard. Les deux meurtres se ressemblent trop pour avoir été commis par deux personnes différentes. Et là, que dit le juge : Monsieur Richard Buckland, vous êtes libre, vous pouvez rentrer chez vous ! C’était la première fois au monde qu’on utilisait à des fins de justice l’ADN et celui de Richard Buckland prouvait qu’il ne pouvait être le violeur et l’assassin, puisqu’on connaissait celui de l’assassin.
Col roulé, barbe et cigarettes artisanales, Alec Jeffreys, 36 ans, chercheur au laboratoire de génétique de l’université de Leicester, s’est familiarisé en Hollande avec les techniques récentes de la biologie moléculaire, qui permettent d’étudier l’ADN avec une précision jamais atteinte auparavant. Dès la fin des années 1970, il cherche à détecter les variations individuelles de l’ADN, utiles par exemple dans l’identification de maladies héréditaires. Or, le matin du 10 septembre 1984, ayant passé aux rayons X une expérience réalisée à partir de l’ADN de plusieurs membres de la même famille, il voit émerger une série d’images ressemblant à des codes-barres, ou à des échelles garnies de barreaux irréguliers. Il s’agit de régions non codantes de l’ADN, qui ne servent pas à la fabrication de protéines et sont formées de répétitions de séquences variant d’une personne à l’autre. Chacun des clichés révèle donc des similitudes et des différences entre les individus mais, surtout, chacun est absolument unique. Ce glorieux accident, comme l’appellera par la suite le professeur Jeffreys, vient d’accoucher des toutes premières empreintes génétiques. Aussitôt, le scientifique et son équipe se mettent à inventorier les domaines où ce nouveau profil pourrait être important. Comme une longue liste de courses, dira-t-il plus tard. Ils pensent à diverses applications, notamment aux problèmes de filiation – c’est d’ailleurs le premier secteur où la technique sera mise en œuvre -, mais absolument pas à l’identité judiciaire. Il faudra attendre deux ans et cette affaire de double meurtre, pour que la police du Leicestershire fasse appel aux services du professeur, avec le résultat que l’on sait.
raphaëlle rérolle. Le Monde du 6 08 2019
Restait à la police à découvrir le coupable : ils vont en baver et faire longtemps choux blanc. 3 500 personnes convoquées, plus 1 000 autres en élargissant aux personnes ayant fourni un alibi. Le laboratoire est débordé, demande que l’on suspende les envois… Et voilà qu’un jour d’août 1987, la gérante d’un pub rapporte la conversation d’un jeune client qui aurait subi le test sanguin en lieu et place d’un autre moyennant 200 livres, avec le passeport trafiqué de Colin Pitchfork, marié, un enfant, qui reconnaîtra rapidement les viols et meurtres des deux jeunes filles.
11 1986
Étienne Léandri provoque le jumelage de Megève avec la station Japonaise Uranbandaï. Cette dernière appartient à Rékigi Kobari, principal soutien du Liberal Democratic Party. Étienne Léandri est un fameux lascar : né en 1916 à Gap, de famille corse, il se fait gigolo avant la guerre, craquant en compagnie de Renée Néal les millions que son mari, Virgile, a gagné dans le parfum. Les Allemands occupent la France et Léandri s’occupe de leurs loisirs : cela lui vaudra d’obtenir une carte d’officier de la Gestapo… fort utile pour quitter la France, direction Berlin, quand les vents tourneront. Mais Berlin n’est pas le bon choix, et il passe plusieurs années en Italie, vivant d’escroqueries diverses et de trafic d’armes. La justice française le recherche, mais il a déjà ses entrées qui lui permettent de faire annuler tout ça : il avait mis à profit une loi de Mussolini qui accordait aux Corses la double nationalité, italienne et française. Copain avec Pasqua, pas fâché avec Mitterrand, serrant la main sans en être gêné de Lucky Luciano, bref un spectre de relations large, très large. Drogue, trafic d’armes, intermédiaire quasiment incontournable d’opérations véreuses, crapule de très, très haute volée, toujours tiré à quatre épingles, au cœur du système de corruption française, à la tête d’une colossale fortune, il finira par mourir en janvier 1995, à 79 ans.
C’est à cette période que surgit, dans le cercle de Carbone et Spirito, Etienne Léandri (1915-1995), Corse grandi à Marseille. Un personnage trouble à l’itinéraire incroyable que l’on retrouve tout au long de la série documentaire. Gigolo, trafiquant d’héroïne et gestapiste notoire qui n’hésitait pas à se promener dans Paris en uniforme nazi, il fut condamné à la fin de la guerre à vingt ans de travaux forcés pour intelligence économique avec l’ennemi. Léandri échappa à sa condamnation en se réfugiant en Italie, où il devint un des relais corses de la French Connection auprès des mafieux italiens. Protégé par la CIA, qui appréciait son anticommunisme, Léandri participa à un tas de trafics avant de rentrer en France où il fut déclaré non coupable de l’accusation de haute trahison. Un vrai miracle…
Daniel Psenny. Le Monde du 7 02 2017
1 12 1986
Inauguration du musée d’Orsay, dans l’ancienne gare d’Orsay de Victor Laloux : les aménagements intérieurs ont été confiés à Gae Aulenti.
5 12 1986
La contestation de la loi Devaquet – une nième réforme universitaire – n’en finit pas. La police a reçu mission d’évacuer la Sorbonne et de nettoyer les environs et pour cela met en service des voltigeurs montés à deux sur des petites cylindrées trial, la passager arrière étant muni d’une longue matraque en bois dur. Malik Oussekine, étudiant de 22 ans, sort d’un club de Jazz de la rue Monsieur le Prince et rentre chez lui à pied ; se trouvant au milieu d’un des endroits les plus chauds, il prend la fuite et s’engouffre dans le hall d’un immeuble au numéro 20 où se trouve Paul Bayzelon, 26 ans, fonctionnaire aux Finances, qui lui a ouvert. Rattrapé par trois voltigeurs, il est battu à mort à grands coups de matraque. Il sera emmené à l’hôpital, mais ce n’était qu’une manœuvre policière pour masquer la réalité. Deux des trois policiers n’auront que de la prison avec sursis. Souffrant d’une insuffisance rénale, Malik Oussekine était sous dyalise.
Le bataillon des voltigeurs est dissous, Devaquet démissionne, son projet de loi retiré, les manifestations de deuil innombrables en province comme à Paris. Les adaptations au cinéma comme à la télévision seront nombreuses.
16 12 1986
La veille, des techniciens sont venus installer le téléphone dans l’appartement d’Andreï Sakharov et Elena Bonner à Gorki. Gorbatchev appelle pour leur annoncer la fin de leur exil à Gorki ; ils rejoindront Moscou six jours plus tard, faisant face à une meute de journalistes russes comme étrangers. Ils mettront près d’une heure à rejoindre la sortie : la célébrité de Sakharov tenant pour une bonne part aux médias, il lui était difficile de fendre la foule avec un laconique no comment. Sakharov mourra à Moscou, trois ans plus tard, le 14 décembre 1989, à 68 ans. Elena Bonner, ayant des enfants aux États-Unis, s’installera alors à Boston, où elle mourra en 2011, à 88 ans.
25 12 1986
Dirk Rutan et Jeana Yeager ont fait le tour du monde sans escale avec l’avion Voyager : 40 000 km à 150 km/h, 2 moteurs de 150 CV ; 9 jours.

30 12 1986
En représailles à l’entrée dans la communauté européenne de l’Espagne et du Portugal, Ronald Reagan augmente de 200 % les droits d’entrée aux États-Unis des produits européens.
1986
Arianespace détient 50 % du marché du lancement spatial ; dès 1973, le premier lanceur européen est la fusée Ariane. De 1979 à 1986, on comptera 18 tirs dont 14 avec succès. 30 lancements sont programmés jusqu’en 1991, pour mettre en orbite 45 satellites. Gorbatchev met fin à l’exil de Sakharov.
Christopher Knight est un jeune homme de 21 ans, intelligent et réservé qui a vécu jusqu’alors dans le Maine, aux États-Unis.. Il a reçu une éducation plutôt rigide avec des principes rigoureux. Il n’a jamais passé une seule nuit à la belle étoile et n’est pas un spécialiste de la débrouille. À la sortie de ses études ses premiers emplois lui ont permis de s’acheter une Subaru Brat avec laquelle lui prend un jour l’envie de… se perdre. Il attend de tomber en panne d’essence, abandonne sa belle petite auto et s’en va, à pied vers … l’inconnu, sans équipement aucun. Et l’aventure va durer … vingt-sept ans ! Vingt-sept ans dans une solitude totale, à l’exception d’un randonneur croisé auquel il a dit bonjour, et rien de plus.
Pour ne pas être rapidement retrouvé, il s’est fixé une ligne jaune infranchissable, en s’interdisant le feu, dont la fumée vous fait rapidement repérer. Mais comme il faut bien manger, s’habiller, se laver etc… il n’y a qu’une solution : prendre le nécessaire là où il se trouve, essentiellement dans les très nombreux cabanons de week-end au bord des deux étangs du Nord et petit étang du Nord, près du site du campement sur lequel il s’est finalement fixé, après en avoir testé plusieurs. Il fait preuve de la plus grande prudence, ne s’y aventurant que de nuit, en milieu de semaine après de longs repérages. Il entre bien sur par effraction, sauf quand le cabanon n’est pas fermé à clef, ce qui arrive, mais en faisant le moins de dégâts possibles. Et tout est bon, bonbonnes de gaz, piles électriques, conserves, plats cuisinés, duvets, vêtements, toiles de tente, savon, mousse à raser, outils, boissons etc etc… Il se fera finalement prendre en flagrant délit de cambriolage en 2013, fera quelques années de prison pour que suite soit donnée aux plaintes de quelques unes – pas toutes – des victimes. Il ne s’y trouvera bien que lorsqu’il pourra avoir une cellule pour lui seul. Il ne tirera aucune leçon particulière de cet incroyable quart de siècle dans une solitude intégrale, aucune dénonciation de la société de consommation, comme de ses négations dans la drogue, autant de thèmes tellement ressassés qu’ils en sont devenus des tartes à la crème.De toutes façons, il aurait été malvenu de sa part de dénoncer une société de consommation puisqu’il aura vécu pendant 27 ans à ses crochets en volant très régulièrement des consommateurs consommés ! il se contentera d’affirmer que l’on s’épanouit bien mieux quand on ne travaille pas que lorsqu’on travaille, et surtout que son plus grand ennemi n’est pas l’humanité, mais le froid. Michael Finkel est le seul journaliste avec qui il ait accepter de parler, qui en fera un livre : Le Dernier ermite 10/18 J.C. Lattès 2019

18 01 1987
Isabelle Adjani est invitée dans le 20 heures de TF1, moment d’audience au plus haut. Elle amène avec elle, à son corps défendant, une insistante rumeur qui la voudrait atteinte du sida. L’avocate Karen Berreby gère le dispositif de près, soit dix minutes d’émission face au présentateur Bruno Masure. Isabelle Adjani arrive dans les bureaux de la chaîne dès l’après-midi. Nous n’avons pratiquement pas parlé avec elle. Elle voulait être interrogée sur la seule rumeur, dira plus tard Bruno Masure.
Le téléspectateur découvre d’abord un micro-trottoir à Marseille, où des passants assurent que l’actrice est morte – Ce sont des gens dans la rue qui me l’ont dit – avant que le directeur des hôpitaux de la ville démente formellement son hospitalisation. Suit une intervention du président de l’ordre des médecins, qui a eu connaissance des tests négatifs au sida de la comédienne. Adjani peut ensuite arriver sur le plateau en toute majesté.
Isabelle Adjani a le sida ! Ce n’est pas une rumeur, ce n’est pas non plus une casserole : c’est un véritable boulet dont il lui faudra impérativement parvenir à couper le lien, sous peine d’être entrainé dans les grands fonds.
Le 20 octobre 1986, elle s’était rendue chez son dentiste. Pendant les soins, elle avait entendu à la radio : Isabelle Adjani a été transportée d’urgence à l’hôpital. Elle avait alors demandé à Karen Berreby, son avocate de l’époque, d’organiser une riposte. Quarante-huit heures plus tard, elle avait été invitée au journal de 20 heures de France 2, vêtue d’un pull en V noir, à peine maquillée, arborant des cheveux très longs. Le téléspectateur connaît la star, il découvre une femme mal à l’aise devant les caméras.
Comment allez-vous ? lui demande d’emblée Claude Sérillon.
– Et vous ?
La réponse, adressée avec un air de défi, synthétise l’absurdité du moment. Sérillon, pour expliquer la présence de la vedette face à lui, explique qu’une radio a annoncé son hospitalisation. Et Isabelle Adjani enchaine : C’est simple. Imaginez que vous vous trouvez dans votre voiture, à 18 heures. Vous vous dirigez ici pour présenter le journal télévisé et vous entendez les informations annoncer que vous êtes hospitalisé. Imaginez deux secondes l’effet que ça produit sur vos amis, votre famille et vous-même. C’est terrible !
Un assistant tend alors un papier à Claude Sérillon. Le présentateur se tourne vers l’actrice, qui sent venir une catastrophe imminente. Il annonce : Nous venons d’apprendre que Thierry Le Luron vient d’être emmené à l’hôpital. Quelques jours plus tôt, alors qu’il multipliait les galas dans toute la France, l’humoriste ironisait autour des rumeurs sur sa santé. La France découvre son affection d’un cancer des voies respiratoires, dont il mourra en novembre 1986 – la conséquence de son infection par le VIH, apprendra-t-on des années plus tard. Je vais à la télévision pour démentir une rumeur, analyse Isabelle Adjani aujourd’hui, et une information survient qui, indirectement, me décrédibilise à la seconde même. J’ai eu l’impression que mon sang se figeait. Je n’existais plus.
L’aboutissement de la rumeur survient peu avant le réveillon du 31 décembre 1986. Un soir, alors qu’elle est revenue un peu plus tôt de la montagne en compagnie d’Isabelle Adjani, Karen Berreby reçoit un appel téléphonique d’une amie de la comédienne travaillant à France 3. Elle lui raconte que les rédactions annoncent l’actrice mourante et préparent sa nécrologie. L’avocate a pourtant parlé à sa cliente cinq minutes plus tôt et elle est en pleine forme. Puis on la dit morte à Marseille, Toulouse ou Montpellier.
Mon cabinet, se souvient Karen Berreby, recevait chaque jour des centaines d’appels téléphoniques d’hôpitaux, de prétendus témoins, de médecins, d’infirmières qui assuraient l’avoir soignée, d’anonymes qui l’avaient vue mourante ou morte à l’hôpital à Marseille. Les télévisions, les radios, les journaux du monde entier se pressaient et prétendaient détenir le scoop, mais personne n’osait écrire quoi que ce soit. Françoise Sagan m’a téléphoné, car elle voulait écrire pour crever l’abcès. J’ai décliné. Ce n’était pas le moment.
L’avocate donne une consigne à son assistante : dire à la presse qu’elle n’a plus aucune nouvelle d’Isabelle Adjani. Elle demande à l’actrice de disparaître totalement. Il fallait que la rumeur enfle un peu plus chaque jour pour mieux la faire exploser, prendre le contrepied de la stratégie de Thierry Le Luron, dont nous savions qu’il était réellement malade. Surtout ne rien démentir. Finalement, un quotidien a accepté d’annoncer sa mort. Nous avons trouvé une formule suffisamment ambiguë pour qu’il ne soit pas attaquable. Une fois sa mort annoncée, elle pouvait ressusciter.
Avec son avocate, l’actrice met à profit cette hibernation pour travailler avec Jean-Noël Kapferer, le spécialiste de la rumeur. Pour la première fois, Isabelle Adjani cherche à comprendre par quels mécanismes concrets une telle folie a pu se propager, seule façon de la combattre et d’en finir avec sa culpabilité.
Le fait qu’Isabelle Adjani passe beaucoup de temps à Los Angeles avec Warren Beatty alimente aussi la rumeur. L’acteur américain a la réputation d’un homme à femmes depuis longtemps, ce qui prend une dimension particulière quand on affirme que la multiplication des partenaires sexuels accroît les risques d’être contaminé par le VIH. Adjani est prise dans cette spirale, d’autant qu’elle entreprend, à l’hôpital à Los Angeles, des séances de désensibilisation au pollen – rien de mieux pour attiser la rumeur. Les paparazzis sont là, dont les images volées sont associées aux interprétations les plus graves.
Je vis alors avec un homme absolument passionnant dont la sexualité libertine est légendaire, connue de tous, alors que je l’ai rencontré au moment le plus monogame de sa vie, raconte aujourd’hui Isabelle Adjani. Le fait que le frère de l’actrice et son épouse soient toxicomanes – dans les boîtes de nuit, le nom Adjani est souvent paraphé en bas d’ardoises que la comédienne doit éponger – noircit davantage le tableau. Si son frère est toxico…
Un élément imprévu s’invite dans la rumeur. Le 10 novembre 1986, Isabelle Adjani dialogue avec le président de SOS Racisme, Harlem Désir, dans le magazine Globe. L’actrice s’étend sur ses origines algériennes avec force et colère. Je me suis toujours sentie beur, confie-t-elle. Harlem Désir prend d’emblée la mesure d’une mutation, dit-il aujourd’hui : Cette icône française, qui n’était alors pas du tout perçue comme une enfant de l’immigration, passe du statut de star à celui de personnalité engagée.
Cet engagement vient d’un peu plus loin, du début des années 1980, au moment où la France interroge son modèle d’intégration, notamment lors de la Marche pour l’égalité (connue sous le nom de Marche des beurs), en 1983. Isabelle Adjani met résolument en avant, la même année, lors de la sortie de L’Eté meurtrier, ses origines algériennes, et s’en prend à Jean-Marie Le Pen. Le Front national la cible pour cela.
En lâchant, en guise de première question Pourquoi cette rumeur ?, Bruno Masure dit à sa façon que le sujet est ailleurs. Ce n’est pas à moi de répondre. Les gens ont très peur et les artistes ont souvent servi de bouc émissaire aux peurs. Ce qui est terrible aujourd’hui pour moi est de venir ici dire Je ne suis pas malade comme si j’avais à dire Je ne suis pas coupable d’un crime. Puis elle se lève et se dirige vers Bruno Masure, l’embrasse et quitte le plateau. Embrasser son interlocuteur est une façon de dire un peu plus l’absurdité de la rumeur. C’est son idée à elle, tout comme le fait de quitter le plateau, racontera le journaliste. L’actrice a pensé sa mise en scène dans les moindres détails.
Pendant l’entretien, Isabelle Adjani garde une main sur sa joue, ce qui fera imaginer à certains qu’elle cache la marque de la maladie sur la peau. Mais cette éventualité fait pschitt et la rumeur peut enfin retomber et mourir.
La veille de cet entretien cathodique, Michèle Halberstadt, alors rédactrice en chef du magazine Première, se rend au domicile d’Isabelle Adjani pour réaliser avec elle le premier entretien post-rumeur. Il sera publié dans le numéro de février 1987, porté par un portrait de l’actrice en couverture, qui deviendra, avec 580 000 exemplaires, la plus grosse vente de l’histoire du magazine. Lorsque la journaliste arrive au domicile parisien de la comédienne, il neige. Une meute de journalistes et de paparazzis attendent dans la rue.
Samuel Blumenfeld Le Monde 20 août 2025
Trente huit ans plus tard, Brigitte Macron, épouse du président de la République, devra aller devant les tribunaux américains pour dire qu’elle n’est pas transgenre. Il n’est désobligeant pour personne de dire qu’Isabelle Adjani aura eu la chance d’être là avant l’arrivée des réseaux sociaux, fantastique machine à amplifier la malveillance, pour ne pas dire la bêtise.
Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose.
Voltaire
28 01 1987
Le chocolat Côte d’Or, belge jusqu’alors, devient suisse, racheté par le groupe Jacobs Suchard, lui même faisant partie du groupe Interfood Phillip Morris.
5 02 1987
C’est l’anniversaire de l’attentat de la Fnac. Michel Baroin, le patron de la FNAC, et de GMF, premier financier d’Eurodif, fermement opposé au remboursement de l’emprunt de 6 milliards à l’Iran, est à Brazzaville et décolle dans un Lear Jet de la Compagnie Aéro France immatriculé F-GDHR pour Paris après avoir annulé au dernier moment une escale à Libreville : son avion s’écrase près de Jakiri, petite ville de 10 000 habitants entre Bafoussam et le frontière avec le Nigéria, au Nord-Cameroun : tous les passagers sont carbonisés. Il y aurait eu des problèmes de givre sur l’extérieur de l’avion ; les 9 passagers conscients de l’issue fatale, auraient jetés par un hublot leurs passeports et autres pièces officielles.
22 02 1987
À la demande du Liban, les Syriens reviennent dans ce pays qu’ils avaient quitté en 82.
24 02 1987
Apparition d’une Supernova à 170 000 années lumière. Il faut remonter à 1604 pour avoir souvenir de la précédente.
30 03 1987
Un groupe d’assureurs japonais achète les Tournesols de Van Gogh pour 225 MF.
4 04 1987
TF 1 est privatisé, et c’est M. Bouyghes qui emporte le morceau.
2 05 1987
Dalida, née Yolanda Cristina Gigliotti, italienne, au Caire en 1933 quitte définitivement la scène d’une overdose de barbituriques. Elle avait 54 ans.
De son vivant, Dalida aura vendu 120 millions de disques. Depuis sa disparition, 20 millions supplémentaires seront écoulés. Seul Claude François aura connu un tel engouement post-mortem, jusqu’aux pistes de danse des discothèques, comme Dalida. D’une ahurissante présence sur scène, elle n’avait pas son pareil pour faire naître cette transe avec le public, avec des chansons pour faire pleurer Margot, le mélo à fleur de peau avec le léger accent comme cerise sur le gâteau..
J’ai aimé mon métier comme un amant. Je me réveillais avec lui, dormais avec lui, faisais l’amour avec lui. Elle mourra de n’avoir pas voulu voir combien cet état fusionnel la menait au néant, combien le strass et les paillettes 24 h sur 24 finissent par aveugler et faire prendre le chemin opposé de celui de la vie ; enceinte d’un jeune admirateur amoureux fou d’elle – il venait d’avoir dix-huit ans – elle s’aveugle au point de réagir à chaud, en urgence en le congédiant grossièrement avec un gros chèque et en se faisant avorter dans de mauvaises conditions. Un enfant, maintenant, en pleine gloire ? me mettre en retrait de la scène pendant deux, trois ans ! impossible ! Il aurait fallu des changements autrement plus radicaux que les pilules roses d’un ashram aux Indes pour prendre de la distance avec ce showbiz qui n’est que l’antichambre de l’hôpital psychiatrique.
En 1958, à l’issue d’un concert de Dalida à l’Olympia, Piaf lui avait dit: Après moi, ce sera toi ! Mais Piaf ne réalisait pas combien elle-même avait la vie chevillée au corps et combien Dalida avait une fêlure remontant à l’enfance qui l’aura fragilisée jusqu’à la fin.
Mais je crois pourtant que les hommes
pourraient bientôt manquer
et surtout pour qui en consomme
autant dans une année.
Anne Sylvestre
Autant être franc. Je fais partie de ces iconoclastes et de ces rieurs qui, pendant longtemps, n’ont vu en Dalida qu’une sculpture drapée de paillettes, qu’une fausse Cléopâtre très joliment momifiée, éternellement dressée sous une tignasse de vieille lionne amidonnée, hyper-coquette et hyper-laqué.
Certes, cette sirène préfabriquée par un habile imprésario dans les années 50 avait appris à travailler sérieusement. Elle connaissait l’art de durer. Ses chansonnettes ne faisaient pas tourner la tête qu’à des midinettes. 85 millions de disques, c’est un phénomène social qui commence à intriguer. Quelques suicides manqués et d’autres drames autour d’elle me faisaient bien penser que ce monument avait une âme. Mais tant et tant de gens simples, moins gâtés par la vie, auraient tant et tant de prétextes pour se supprimer que je refusais de prendre le malheur de Dalida au sérieux.
Puis, voilà qu’en 1986, j’ai eu l’occasion de me pencher sérieusement sur son cas, sur sa vie et ses contradictions. Elle venait de faire un retour en arrière pour tourner, en Egypte, un film de Youssef Chahine intitulé Le Sixième Jour. Un mélodrame dans lequel Dalida joue les mère Courage et les grand-mères sacrifiées. Elle s’acharne à lutter pour la survie de son petit-fils dans la ville du Caire frappée par une épidémie de choléra. Remarquable sujet pour elle qui a toujours souffert de n’avoir pas d’enfant. Dans ce film, quelqu’un lui dit : Personne n’a ton sourire. Elle répond : Ce n’est plus un sourire, c’est une cicatrice. Elle y est superbe d’émotion. Comme dévoilée dans sa nature profonde. Son sens de la tragédie populaire y est mis à nu avec un éclat inattendu.
À l’époque donc, j’ai écouté toutes ses confidences, en coulisse, et j’ai scruté son passé. Plus possible de la snober dans sa sincérité ringarde. Plus possible de négliger sa quête secrète. La mépriser ce serait faire injure aux multitudes qui l’adorent. Ce serait nier la valeur des roucoulades et des douleurs qu’elle catalysa ou qu’elle exorcisa pendant trente ans. Dalida avait une passion pour la psychanalyse. Elle avait lu Freud tout entier. Elle y avait puisé un certain réconfort pendant quelques années. Et à ses proches elle avouait : Je n’ai toujours trouvé qu’une petite fille qui pleurait en moi. Une petite fille que j’ai prise par la main et que j’ai essayé de faire grandir.
Elle se cherchait désespérément au fil des ans. Au cinéma, à plusieurs reprises, elle avait tenté de toucher à tout : à Yves Montand, par exemple, comme à Gainsbourg, avec lesquels elle avait tourné deux films qui sont loin d’être inoubliables. En politique aussi elle tâtonnait. Elle a soutenu, par deux fois, la campagne de Mitterrand. Mais on l’a vu tomber aussi dans les bras de Chirac un soir au Paradis Latin. Ne voyez aucune signification politique à cela. Je suis artiste et à ce titre j’appartiens à tout le monde. A M. Chirac comme aux autres, précisait-elle après avoir embrassé le maire de Paris.
Voilà bien les racines du drame qui ronge les stars de la chanson et d’ailleurs. Elle appartient à tout le monde et personne ne lui appartenait. Même pas un bambino à qui se raccrocher. Les hommes lui avaient échappé. Tout filait entre ses doigts hormis la gloire qui est une sale compagne en tête à tête. Avec son dernier film que nous évoquions plus haut, elle a pourtant terminé en beauté. En revenant au Caire, là où elle était née. En forçant le respect de chacun et même de ceux qui n’aimaient pas ses simagrées. Elle a retrouvé la grâce de ses débuts dans les quartiers pauvres de l’Egypte. Mais le plus grand malheur qui puisse arriver, c’est de n’être utile à personne, disait Eluard. Et ça ne pardonne jamais.
Gérard Fénéon. Le Républicain Lorrain du 4 mai 1987
Dalida était une grande dame mais une petite femme. Tous ceux qui l’ont côtoyée ou simplement rencontrée l’attestent et sa carte d’identité, qui fut visible à l’exposition Dalida, une vie, à la mairie de Paris en 2007, le confirme : 1,68 m sur la pointe des pieds. D’où vient le sentiment physique inverse ? Sans doute de ses innombrables apparitions à la télé qui, comme le cinéma, cadre toujours bigger than life. Mais aussi de son allure, entre coiffure à la lionne et mâchoires carrées. Avec un visage aussi sculptural et une chevelure aussi prégnante, on ne peut imaginer qu’une stature d’importance. Le paradoxe, pourtant, n’est pas que physique, il est surtout moral : du début de sa carrière, au commencement des années 1950, jusqu’à sa disparition en mai 1987, Dalida n’a chanté qu’une seule et même chanson : celle de la vie à pleins poumons, de l’amour à fond, de la gaieté d’être heureuse. Laissez-moi rêver, répétait-elle au refrain d’un de ses plus grands succès. Une rengaine à double détente : rêver sa vie quand la vie ne donne vraiment pas de quoi rêver. Mais les mantras ne suffisent plus à conjurer un sort qui s’acharne avec une opiniâtreté vicieuse : amants suicidés, amitiés défuntes ou trahies, abus d’anxiolytiques. En 1986, Dalida a 54 ans et le sentiment, déjà, de ne plus rien avoir à perdre. Cette année-là, elle croit enfin saisir la chance de se refaire. Comme à la roulette. Le cinéaste égyptien Youssef Chahine lui offre un rôle dans son nouveau film Le Sixième Jour. Elle y est Saddika, une grand-mère Courage qui veut sauver son petit-fils dans l’Égypte de 1947 ravagée par une épidémie de choléra.
Pour Dalida, les retrouvailles sont intenses, mais à plusieurs tranchants : née Yolanda Gigliotti le 17 janvier 1933 au Caire, dans une famille d’émigrés italiens d’origine calabraise, elle retrouve ses racines de pied-noire égyptienne. Mais les racines ont été arrachées et, lors d’une visite dans le quartier de son enfance, le faubourg de Choubra, les larmes coulent de ne rien reconnaître de l’appartement où elle est née et qu’elle partagea avec ses deux frères et ses parents – surtout son père adoré, Pietro, violoniste à l’opéra du Caire, disparu quand elle était gamine. Mais plus que le chagrin, ce qui remonte, ce sont les souvenirs de l’adolescence quand la jeune Yolanda, brune au regard charbonneux à la façon d’une Jane Russell orientale, rêvait de devenir actrice de cinéma. Ce ne fut pas le cas malgré son trophée de Miss Égypte en 1954 et quelques utilités dans des séries B dont les titres sont tout un programme : Le Masque de Toutankhamon et autres facéties pharaoniques. Sur les plateaux de son Hollywood-sur-le-Nil, elle croise Chahine (déjà !) et un jeune Michel Demitri Chalhoub, bientôt célèbre sous le pseudonyme d’Omar Sharif. Mais pour Yolanda, la gloire cinématographique ne vient pas et en décembre 1954, elle s’envole pour Paris et la carrière que l’on sait.
C’est dire si pour Dalida, 32 ans plus tard, l’enjeu est de taille. À raison de quinze heures par jour pendant trois mois, le tournage du Sixième Jour, qui a lieu dans les studios du Caire et en extérieurs à Alexandrie, s’avère long et difficile. Bosseuse acharnée, Dalida s’y donne à corps perdu. Pour Chahine, non seulement elle apprend l’arabe égyptien afin de jouer en VO, mais elle accepte de se vieillir, de réduire son maquillage et surtout, de cacher sa fameuse crinière sous deux couches de voile noir.
Le Sixième Jour sort en salles en 1986 et le succès critique est fulgurant. Des Cahiers du cinéma à Libération, tout ce que la planète cinéphile compte d’aficionados sévères et parfois acariâtres s’incline devant l’excellence du film et surtout, devant la performance de son actrice principale. Sous la plume d’Isabelle Potel, critique à Libération, on peut lire : À chaque plan, elle change d’âge, visage d’infante, de madone, icône… De dos, silhouette drapée de noir contemplant l’abîme comme dans un tableau de Böcklin. De face, sphinge au regard perçant défiant le temps. Pour la promotion du Sixième Jour, Dalida, nouvelle amorosa du cinéma, court les plateaux de télévision et, de Poivre d’Arvor en Christophe Dechavanne, les dithyrambes pleuvent, le même avenir semble se dessiner : celui d’une actrice de qualité, promise aux grands rôles de la tragédie méditerranéenne, rejoignant ainsi quelques figures iconiques à fort tempérament, de l’italienne Anna Magnani aux grecques Irène Papas et Maria Callas. Mais là encore, la magie tourne au vinaigre. Dans les coulisses du succès, Dalida confie qu’elle a mal supporté de se voir prématurément vieille à l’écran et les directives de Chahine pendant le tournage n’en finissent plus de tinter à ses oreilles comme une prophétie lugubre : Tu vas me donner les blessures que la vie t’a faites.Le Sixième Jour, portrait d’une femme sacrifiée, réalisé, disait-elle, par un voleur d’âme, peut aussi se regarder comme un biopic de la star au destin cerné de morts et assiégé de solitudes. Comme tout un chacun, Dalida voyageait avec les spectres du passé et les fantômes du présent. Mais au fil du temps, cette armée des ombres l’a peu à peu envahie jusqu’à la coloniser tout entière.
Trois dates clefs, comme des croix dans un cimetière :
27 janvier 1967 : le festival de la chanson de San Remo bat son plein. Dalida y participe parce qu’elle est déjà une star dont chaque disque se solde par des millions d’exemplaires vendus. Mais elle a surtout entrepris le voyage en Italie parce qu’elle est folle amoureuse du chanteur Luigi Tenco, beau brun ténébreux de 28 ans qui, lui aussi, participe au festival. Avant le spectacle retransmis en direct par la RAI, Luigi le traqueur avale un cocktail d’alcool et d’anxiolytiques censé le galvaniser. Quand il monte sur scène, c’est la catastrophe : il titube, chante à contretemps, balbutie les paroles de sa chanson intitulée – comme une voyance tragique – Ciao amore, ciao. Zéro plus que pointé. En fin de soirée, Luigi Tenco rentre à l’hôtel Savoy et, dans la chambre qu’il partage avec Dalida, il se tire une balle dans la tête. C’est Dalida qui découvre le cadavre de son amant peu après. Revenue à Paris, une horde de paparazzis à ses trousses, elle décide à son tour de mettre fin à ses jours. Elle loue une chambre dans un palace parisien et ingurgite une dose extrême de barbituriques. Une femme de chambre la découvre agonisante. Elle restera plusieurs jours dans le coma avant de se rétablir.
11 septembre 1970 : dans son appartement du 7 rue d’Ankara, à Paris, Lucien Morisse se suicide par arme à feu à l’âge de 41 ans. Responsable de la programmation musicale d’Europe 1, il avait été à la fin des années 1950 le fiancé au long cours, puis le mari de Dalida qu’il avait épousée le 8 avril 1961, usant de sa position clef à Europe 1 pour exalter et jouer les pygmalions pour la carrière de la chanteuse. Dalida est de nouveau à terre et ne peut s’empêcher de voir le rapport entre la mort de Luigi et celle de son mentor, son beau Lucien. Si elle n’avait pas fait le lien, la presse à scandale s’en serait chargée à sa place, titrant, entre autres gracieuseté, Dalida, la maudite !
21 octobre 1972 : Richard Chanfray entre dans la vie de Dalida. Play-boy interlope, beau gosse à la mode de l’époque comme une vague réminiscence de Gunter Sachs, le mari de Brigitte Bardot, apparemment jamais en retard d’une mythomanie, il se vit comme la réincarnation du comte de Saint-Germain, aventurier de la fin du XVIII° siècle qui prétendait environ 3 000 ans d’âge et avait, à ce titre, très bien connu Jésus Christ dont il aurait été le conseiller média sur maints miracles. Il savait aussi fabriquer des diamants comme on rigole et, bien évidemment, se rendre invisible. Avec le comte de Saint-Germain réincarné en Richard Chanfray, Dalida est convaincue d’avoir trouvé la pierre philosophale qui transformera en or son existence de plomb. Leurs nombreuses apparitions publiques font sensation, le comte de Saint-Germain ne mégotant pas sur la cape en satin noir et le jabot en dentelle. À l’école, pour ne pas dire aux crochets, de sa fiancée, le comte va même enregistrer des disques, notamment, en duo avec elle, Et de l’amour… de l’amour en 1975. Le couple fait sourire dans les chaumières de la télé et ricaner sur la scène des cabarets. Fallait-il qu’elle soit amoureuse, ou éperdue, pour s’attacher à un tel paumé ! Leur liaison durera neuf ans jusqu’à la rupture en 1981. Mais deux ans plus tard, en juillet 1983, l’immortel se suicide à son tour et Dalida en conçoit une infinie tristesse qui lui fait déclarer : Je commence à croire que je porte malheur aux hommes.
Qui pourrait survivre à cette roulette russe truquée dont le barillet est comme chargé de toutes ses balles ? Dalida, oui ! Dalida, si ! Elle avance le malheur à la boutonnière et ses chansons, qui multiplient les disques d’or, pulvérisent les sommets du hit-parade mondial. S’empilant au fil du temps comme autant de gris-gris homéopathiques dans sa pharmacie sentimentale, ils en font une femme riche. Variétoche et parfois variétoc, Dalida a traversé à peu près toutes les phases de la chanson française : mambo, cha-cha-cha, twist (qu’elle prononçait délicieusement le dviste, yéyé et antiyéyé (à l’été 1962, Dalida triomphe avec Petit Gonzales)… En août 1970, c’est de nouveau le succès populaire avec Darla dirladada, coécrit par Boris Bergman, le futur parolier de Bashung. À l’automne de la même année, elle rencontre Léo Ferré sur un plateau de télévision. Dans la foulée, elle enregistre Avec le temps, chanson dite à texte qu’elle entend populariser. De fait, sa version fait un tabac. En 1973, c’est Il venait d’avoir 18 ans, écrite par Pascal Sevran, Serge Lebrail et Pascal Auriat. Le titre est le mieux vendu l’année suivante dans neuf pays, dont l’Allemagne où il atteint 3,5 millions d’exemplaires.
Toujours en 1973, duo surprise avec Alain Delon, un de ses anciens amants : Paroles, paroles devient lui aussi en quelques semaines numéro un en Europe puis au Japon. Le 15 janvier 1974, nouveau coup d’éclat : elle est sur la scène de l’Olympia et présente à la fin du récital une nouvelle chanson, Gigi l’Amoroso. Elle dure sept minutes trente. À la fois chanté, parlé et interprété comme un impromptu théâtral, ce titre reste son plus grand succès mondial. À l’orée des années 1980, pour Dalida, tous les jeux semblent faits. Comme une flambeuse qui n’a plus rien à perdre, elle mise tout sur le double rouge : celui de la vague disco et celui, plus inattendu, de la politique. Dans le premier registre, c’est le coup de tonnerre de Laissez-moi danser -Monday, Tuesday-, chanson devenue l’un des hymnes obsessionnels de l’été 1979 et qui sera l’acmé de son show à l’américaine au Palais des sports à Paris du 5 au 20 janvier 1980, sorte de glam rock revu et très corrigé par Las Vegas, avec douze changements de costumes en plumes et strass, une palanquée de danseurs et trente musiciens. Les dix-huit représentations font salle comble et Dalida se couronne disco queen à la française, mettant le feu aux discothèques où les premières notes de Monday, Tuesday jettent sur la piste tout ce que le nightclubbing d’alors compte de folles dingues : même les chauves miment la chorégraphie capillaire de l’idole. Consécration suprême, Dalida devient for ever and ever une icône gay dans un panthéon à facettes où elle rejoint, à équidistance, la blonde Marlène Dietrich et la noire Gloria Gaynor. Ce n’est pas faire preuve d’on ne sait quelle homophobie que de constater que, visible ou invisible, proche ou lointaine, Dalida est alors de plus en plus cernée par toute une théorie d’hommes à hommes et de garçons sensibles qui, du fond d’une misogynie larvée et le plus souvent inavouée car inavouable, préfèrent les femmes malheureuses aux filles épanouies. Mais, bien entendu, ça n’est pas aussi simple, grossier et rabat-joie. Pas besoin d’avoir révisé son Freud pour détecter que, du point de vue de bien des gays, cette tendresse pour la star malheureuse, qui peut s’avérer étouffante voire mortelle, est une aussi une identification à l’impossible femme qui est en eux. Telle madame Bovary, mère porteuse de bien des drama queen, le gay romantique autant que romanesque l’avouera désormais sans détour : Dalida, c’est moi ! Aujourd’hui encore, bien des anniversaires entre garçons se concluent par l’apparition d’un jeune homme perruqué de blond et moulé dans un fourreau doré qui entonne Mourir sur scène, sous vos applaudissements et avec force roulements de r : Je voudrais mourir fusillée de lasers…
Le rouge de la politique n’est pas moins brûlant et assassin. Au début des années 1970, on prête à Dalida plus qu’une aventure avec un certain François Mitterrand, à l’époque premier secrétaire du Parti socialiste, dont on dit qu’elle le surnomma, pour mémoire et par fidélité, Mimi l’amoroso. D’autres noms de la Mitterrandie vont se fédérer autour d’elle, participant régulièrement aux pasta parties de son hôtel particulier de la rue d’Orchampt sur la butte Montmartre : Pascal Sevran, son compagnon Dominique Lozach, avec qui Sevran créa à la télévision la célébrissime Chance aux chansons, le jeune provençal et très physique Max Guazzini, fan parmi les fans de Dalida, bientôt attaché de presse de la chanteuse et futur patron de NRJ, et bien entendu Orlando, le frère cadet de Dalida, à la fois secrétaire, producteur et chef de sa garde rapprochée. Mais aussi le journaliste Henri Chapier, alors grande plume du Quotidien de Paris, Jacques Attali, qu’elle sollicitera dans les années 1980 pour défendre les radios libres et, singulièrement, NRJ. Grimpée sur une camionnette, Dalida sera l’héroïne de la manifestation parisienne qui a rassemblé des dizaines de milliers de jeunes le 8 décembre 1984 pour défendre la plus belle des radios. À l’occasion, on croise aussi, rue Orchampt, l’historien Claude Manceron et surtout, au début des années 1980, un jeune élu du XVIII° arrondissement (celui de Dalida), promis à un certain avenir politique : Bertrand Delanoë, qui deviendra un de ses plus sincères amis.
Ce méli-mélo, c’est la bande à Dali en compagnie de qui, entre champagne et interminable parties de gin-rummy, défile un Tout-Paris follement gay et pas forcément de gauche, souvent escorté de jeunes et beaux garçons plus ou moins gigolos. Sa maison de Montmartre devient un genre de clandé. Nous sommes dans les années 1970 et l’homosexualité est encore un délit, au mieux un dérangement mental, qui exprime sa clandestinité dans certains jardins publics (entre autres ceux des Tuileries), une poignée de bars confidentiels ou encore, pour les plus rencardés, le 7 (au 7 de la rue Sainte-Anne, derrière la Comédie-Française), le petit restaurant-boîte de nuit de Fabrice Emaer qui allait bientôt inventer le Palace. À pas d’heure et surtout le dimanche, on passe chez Dali, à la fois havre de liberté, voire de libertinage, cadre de fiestas mémorables, et asile pour les naufragés de la nuit. Elle est la mamma à qui on peut confier toutes ses peines, de cœur comme de cul, Dalida n’ayant apparemment ni froid aux yeux ni peur d’un langage cru. À un ami qui s’inquiétait qu’elle fréquente un type louche, elle répondit : Qu’est-ce que tu veux, il me fait jouir.
C’est dans cet intermonde que va naître la vocation socialiste de Dalida. Pas vraiment un engagement, plutôt une vieille tendresse pour Mimi l’amoroso et, par ricochet, pour le parti qu’il incarne. Jack Lang entre alors en scène. Engagé dès 1974 au côté de François Mitterrand, l’homme de théâtre devient le monsieur culture du PS et participe activement à la campagne pour la présidentielle de 1981. Il lui faut dénicher une personnalité culturelle qui symbolisera le renouveau. Moins confidentielle que Barbara (qui chantera plus tard L’Homme à la rose), Dalida fait amplement l’affaire, sa surface de popularité ratissant plus que large. Diva du disco, Dalida devient une sorte de Marianne rose et, début 1981, son salon devient un des PC de campagne des plus courus. Sa participation au triomphe de Mitterrand sera récompensée lors de l’investiture du nouveau président.
Le 21 mai 1981, lors de la fameuse cérémonie au Panthéon, Dalida est au premier rang de la foule des célébrités qui remontent la rue Soufflot, au bras de Gaston Defferre et en robe rose, cela va de soi. Mais comme une transpiration de la vie privée sur la vie publique, le mariage va très vite tourner au divorce. Même si, après son élection, François Mitterrand ne boude pas encore certains dîners mondains organisés par Pascal Sevran et dont Dalida est la reine, peu à peu, à l’exception notable de Bertrand Delanoë, les socialistes la boudent et les portes des palais de la République se referment ; l’ingratitude croît et le malaise s’installe, d’autant plus qu’une bonne partie de son public, du genre conservateur, n’a pas bien compris l’engagement gauchiste de son idole. La rupture sera consommée en avril 1983 quand, le temps d’une photo en couverture de Jours de France (le magazine hebdomadaire de Marcel Dassault), on voit Dalida sauter au cou de Jacques Chirac alors tout-puissant maire de Paris, ce qui fut interprété comme une trahison par bon nombre des sectateurs de Mitterrand, dont Roger Hanin, le beau-frère du président.
De remix en remix, les disques continuent à bien s’écouler, Dalida devient même la marraine enchantée de l’équipe de France de football pour la Coupe du monde de 1982 (Allez la France / Et bonne chance / Pour le Mundial / Emmène-nous jusqu’aux étoiles) et le fan-club est toujours sur la brèche à la moindre de ses apparitions, dont une sidérante publicité pour le désodorisant Wizard Sec, où Dalida, en fourreau lamé argent à la limite du sapin de Noël, spray dans une main et éventail dans l’autre, virevolte parmi les fastes néo-égyptiens d’une déco de Néfertiti sous acides, voire dans les invendus du mausolée de Mae West.
En 1985, nouvelle stupeur : suite à une intervention de chirurgie ophtalmique destinée à corriger un strabisme de plus en plus convergeant, Dalida ne supporte les feux de la rampe que coiffée d’une sorte de casque intergalactique créé par le lunetier Alain Mikli et strassé par Swarovski. Même les thuriféraires de Star Trek restent sans voix.
Encensé par la critique, Le Sixième Jour aurait dû marquer le retour en grâce de Dalida. Mais après la pluie d’éloges, les propositions d’autres films tournent court et la perspective de retourner à la case chanson ressemble à une impasse. La fêlure invisible creuse un peu plus son sillon, l’étau de la dépression resserre son étreinte. Dans la nuit du 2 mai 1987, Dalida organise son ultime adieu. Elle congédie ses domestiques, ment à ses proches sur son emploi du temps de la soirée, s’allonge sur le lit de sa chambre dans l’hôtel particulier de la rue d’Orchampt et avale une dose mortelle de somnifères. Sur la table de nuit, on retrouvera un dernier message de sa main, lapidaire et implacable : Pardonnez-moi. La vie m’est insupportable. Dalida n’est pas morte comme elle l’avait chanté ; elle n’est pas morte sur scène. Par la porte étroite du suicide, elle vient de rejoindre le paradisco des stars foudroyées, comme pour donner une nouvelle consistance à une formule macabre mais pertinente que l’on doit à madame de Staël : La gloire n’est que le deuil éclatant du bonheur.
Gérard Lefort. Vanity Fair France. Février 2016.
15 05 1987
Les ministres de la CEE condamnent tout dépistage systématique du Sida.
28 05 1987
Mathias Rust pose son avion sur la Place Rouge, après avoir déjoué tous les systèmes de surveillance : il sera condamné à 4 ans de travail le 4 09 1987.
05 1987
En URSS, entrée en vigueur de la loi sur la libre entreprise : cela va permettre le cadre légal par lequel les guébistes – membres du KGB – vont systématiquement dépouiller les entreprises d’État, rachetant pour un kopeck symbolique des biens valant des milliards, pillant les caisses du Parti en virant tout cela sur des comptes numérotés à l’étranger… On découvrira ainsi en septembre 1991 la disparition de 2 000 tonnes d’or, réserves de l’État soviétique !
5 06 1987
Création d’un programme d’échange d’étudiants entre universités : Erasmus – EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students – qui permettra à plus de 16 millions d’Européens, – chiffre de 2025 – dont deux millions de Français d’en bénéficier, pour des séjours allant de deux à douze mois. Le programme concerne désormais les 27 États membres de l’Union européenne aux côtés de l’Islande, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Norvège, Serbie et Turquie. C’est l’italienne Sofia Corradi qui en est l’initiatrice. Née à Rome en 1934, elle y avait fait des études de droit et obtenu à 23 ans une bourse Fulbright pour les prolonger à l’université Columbia en 1957 – 1958, où elle avait eu un master de droit. De retour en Italie, elle n’avait pas obtenu d’équivalence. Elle avait alors écrit plusieurs mémorandums, au delà de son cas personnel, pour faciliter financièrement les études à l’étranger et bénéficier de leur équivalence, au retour.
C’est l’espagnol Manuel Marin qui le mettra en œuvre. En 1977, après la mort de Franco, il avait été nommé secrétaire d’Etat aux relations avec les Communautés européennes, et avait alors participe à la phase finale des négociations d’adhésion de l’Espagne, qui s’étaient achevé le 12 juin 1985. Il avait alors intégré la Commission européenne de Bruxelles : il sera successivement commissaire aux affaires sociales, commissaire au développement et, enfin, commissaire aux relations extérieures sous les présidences de Jacques Delors et de Jacques Santer.
12 06 1987
Ronald Reagan, président des Etats-Unis d’Amérique, est en visite à Berlin, plus précisément à la Porte de Brandebourg : il lance à l’adresse du dirigeant de l’URSS : Monsieur le Secrétaire général Gorbatchev, si vous voulez la paix, si vous voulez la prospérité de l’Union soviétique et de l’Europe de l’Est, si vous voulez la libéralisation, présentez-vous à cette porte ! Monsieur Gorbatchev, ouvrez cette porte ! Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur ! […] Et Berlin deviendra une ville ouverte à toute l’Europe, celle de l’Est, comme celle de l’Ouest […] dotée de meilleures liaisons aériennes, et pourra devenir l’une des principales plate-forme aéroportuaires du centre de l’Europe.
Chacun sait qu’il est infiniment plus facile de détruire, casser, que de construire. Le mur sera détruit, mais la construction de l’aéroport, ce sera une autre paire de manches : avec un budget initial de 2.7 milliards d’€ pour cinq ans de travaux, il faudra finalement quinze ans pour un budget de 5.4 milliards d’€ et un bon petit paquet de scandales en tous genres. Les lumières, par exemple, restaient allumées nuit et jour, parce que personne ne savait comment les éteindre ! On est tellement impressionné par la réussite économique allemande que l’on serait presque tenté de se réjouir de ce plantage énorme : Ah bon, parfois ils sont capables d’aussi grosses conneries que nous ! Il sera inauguré sans tambours ni trompettes, le 1 novembre 2020, surdimensionné face à la chute du trafic aérien à cause de la Covid 19 : comme le dira un responsable : au moins on pourra pratiquer la distanciation sans difficulté !
23 06 1987
Le pétrolier grec Vitiria explose sur la Seine, entre Rouen et Le Havre, après avoir heurté un pétrolier japonais. Il transportait 17 500 m³ d’essence.
06 1987
À Paris, inauguration de l’Institut du Monde Arabe, de l’architecte Jean Nouvel.

19 07 1987
3 000 bébés brésiliens ont été vendus à l’étranger au prix de 10 000 $ chacun.
1 10 1987
Dans l’affaire Greenpeace, le Tribunal International de Genève condamne la France à payer 50 MF à Greenpeace.
9 10 1987
Jean- Pierre Bely, atteint d’une sclérose en plaques, est à Lourdes. Il en repart guéri. Le miracle sera reconnu comme tel douze ans plus tard. C’est la 66° guérison miraculeuse à Lourdes.
15 10 1987
Thomas Sankara président du Burkina Faso est assassiné avec douze de ses proches. On ne saura pas qui a donné l’ordre de les tuer. Blaise Compaoré, son successeur ? Peut-être, mais il n’y pas de preuves. Par sa femme, – on est tenté de dire sa bourgeoise, tant elle suintait l’ambition – Blaise Compaoré est proche de Félix Houphouet-Boigny, qui ne se réjouit pas de voir Thomas Sankara à la tête d’un pays voisin. Charles Taylor, Prince Johnson présidents du Liberia et de la Sierre Leone ? Il tranche trop. À mon avis, il va plus loin qu’il ne faut avait déclaré François Mitterrand, moins d’un an plus tôt, en visite le 17 novembre 1986. Sankara lui-même avait déclaré quelques mois plus tôt : Je me sens comme un cycliste qui est sur une crête et ne peut s’arrêter de pédaler sinon il tombe. C’est lui qui avait rebaptisé son pays – ex Haute Volta – Burkina Faso : le pays des hommes intègres ; intègre, il l’était, qui lui faisait tenir en piètre estime la prudence.
Dans les jours suivants, le Burkina Faso aura la visite de Paul Baril, patron du GIGN, venu là pour effacer toute trace téléphonique existant qui aurait risqué de donner l’identité des commanditaires. Paul Barril ne craint plus grand chose : depuis 2014 il est atteint de la maladie de Parkinson, suivi d’un cancer de la thyroïde. En novembre 2020, Emmanuel Macron fera déclassifier des documents jusque-là secret défense, qui laisseraient apparaître un véritable complot visant à éliminer Thomas Sankara, où l’on retrouve Charles Taylor, du Libéria, Kadhafi le Libyen, Houphouet-Boigny de la Côte d’Ivoire, et les services secrets de la France, sous la présidence de François Mitterrand. En l’absence de Blaise Compaoré, son procès se tiendra à Ouagadougou, à partir du 11 octobre 2021 devant un tribunal militaire. Il sera dès lors probablement jugé par contumace. Mais, sitôt ouvert, le procès sera reporté au 25 octobre, certains avocats n’ayant reçu les dernières pièces qu’un mois plus tôt, délai jugé insuffisant.
*****
Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté.
Guy Béart
21 10 1987
Boris Eltsine fait partie de la direction du parti communiste de Moscou depuis presque deux ans. À sillonner la ville dans tous les sens, à prendre les transports en commun, à bien connaître, évidemment, les débits de boisson, il s’est forgé une popularité qui le fera revenir dans le jeu chaque fois qu’on voudra l’en écarter. Ce jour-là, il dénonce les lenteurs de l’appareil du comité central en pleine séance de ce comité et forge son destin avec un éclat : Les corrompus, les pourris sont ici même, parmi nous et vous le savez parfaitement !
Premier visé : Ligatchev, n° 2 du Parti.
Avec Boris Eltsine, il est bien difficile de savoir si une telle audace vient d’un bien beau courage, ou tout simplement d’une bonne cuite… une parmi tant d’autres. Mais retenons-nous d’être trop rapidement mauvaise langue : du courage, il en fera encore preuve pour venir à bout de la tentative de putsch d’août 1991, et là, c’est sur, il n’était pas ivre.
11 11 1987
Boris Eltsine est démis de ses fonctions. La traversée du désert ne sera pas trop longue : une bonne année… Les Iris de Van Gogh sont vendus 325 MF au Musée Getty de Los Angeles. Ils seront une des plus belles pièces du Centre Getty qui sera inauguré 10 ans plus tard.
18 11 1987
Mise en vente des actions Eurotunnel : les bonnes langues disent que les mauvaises affaires d’Eurotunnel tiennent pour beaucoup à une clause de leur statuts qui leur interdit de vendre des produits hors taxe, ce que les ferrys font à grande échelle.
29 11 1987
Attentat nord-coréen contre l’avion de Korean Airlines Air 858, Bagdad-Gimpo, via Abou Dhabi : 104 morts chez les passagers, 11 pour l’équipage. Les deux agents nord-coréens étaient descendus à l’escale d’Abu Dhabi.
2 12 1987
Thierry Paulin avoue l’assassinat de 21 vieilles dames depuis 1984. Fiché à Toulouse en 1985 pour un petit délit, et à Alfortville pour l’agression d’un dealer en 1986, ses empreintes digitales avaient donc été déjà enregistrées en Haute Garonne et au Val de Marne ; mais comme il existait à ce niveau des compartiments étanches entre départements, la Brigade Criminelle de Paris n’en eut pas connaissance ; cela aurait tout de même permis d’éviter les meurtres de dix vieilles femmes. Pierre Joxe, ministre de l’Intérieur, lancera alors le FAED : Fichier Automatisé des Empreintes Digitales.
8 12 1987
Les États-Unis et l’URSS s’accordent sur l’élimination des missiles intermédiaires (500 à 5 500 km).
20 12 1987
Le ferry philippin Doña Paz entre en collision avec le pétrolier Vector, chargé de plus de 8 000 barils de carburant. Les deux navires prennent feu. Le ferry, qui faisait route sur Tacloban, était particulièrement surchargé à quelques jours de Noël. Officiellement, plus de 1 500 personnes périrent quand les sources officieuses font état de plus de 4 000 morts.
21 12 1987
Dans le détroit de Tablas, aux Philippines, le Doña Paz, un ferry de 2 324 tonnes et de 93 mètres de long construit en 1963, se heurte de nuit au pétrolier Vector qui transporte 8 800 barils de pétrole raffiné. Le pétrole s’enflamme et provoque un incendie qui s’étend rapidement au Doña Paz. Des 13 membres d’équipage du Vector, seuls 2 survécurent. 58 membres d’équipage du ferry périrent. Le Doña Paz coula deux heures après l’impact sans qu’aucune embarcation de sauvetage ait pu être mise à l’eau. 21 ou 24 personnes seulement survécurent dans le brasier, mais on dénombrera 4 375 victimes [dont 1 565 seulement, dûment enregistrées]. Il fallut attendre huit heures avant que les autorités soient informées de l’accident et huit autres heures avant que les secours n’arrivent sur place. L’équipage du Vector n’était pas assez qualifié, la licence du navire était périmée. Quand un pays ne peut pas, ou ne veut pas, se doter d’institutions suffisamment puissantes pour faire respecter les règlements, la porte est ouverte à ce type de drame.
22 12 1987
Les Chantiers de l’Atlantique lancent le Sovereign of the Seas : 2 600 passagers qui iront en croisière à Miami ; la construction a duré 29 mois.

29 12 1987
Youri Romanenko passe 326 j. 11 h. 40’ dans l’espace : il a grandi de 10 cm.
12 1987
Début de l’Intifada – guerre des pierres -.
Les autorités sanitaires anglaises reconnaissent la forme épidémique de l’ESB : Encéphalite Spongiforme Bovine, dont le premier cas est apparu dans une ferme du Sussex en 1986 : une mutation aurait transformé dans les années 70 la protéine normale du prion présente dans le cerveau de l’animal, en protéine infectieuse. L’incubation est de 5 ans. On n’a jamais reconnu la présence d’un prion chez le poisson, qui, en élevage, est nourri de farines en provenance exclusive d’autres poissons de mer. La maladie a des ancêtres : la Scrapie, ou tremblante du mouton, apparue à la fin du XVII° siècle, – qui se répandra partout, à l’exception notoire de la Nouvelle Zélande ; dans le Colorado et le Wyoming, bon nombre de cerfs – 6 à 15% – et d’élans – 1%, sont atteints d’une affection analogue : la cachexie chronique.
La maladie de Creutzfeldt Jakob, chez l’homme, apparue au début du XIX° siècle et décrite par Gerstman Straüssler, elle aussi répandue dans le monde entier, sans lien avec les conditions de vie, et toujours mortelle, le Kuru en Papouasie Nouvelle Guinée, apparue dans la première moitié du XX° siècle : 80 % des femmes en seront atteintes en 1956 : les études montreront que la maladie était étroitement liée à l’anthropophagie, laquelle cessa en 1950, entraînant peu après la disparition de la maladie. La maladie de Creutzfeldt Jakob peut avoir trois origines : acquise : exemple du Kuru en Papouasie Nouvelle Guinée ; intervention chirurgicale utilisant des tissus humains contaminés (greffe de cornée, neurochirurgie) ; médicaments d’origine humaine (par exemple injection d’hormone de croissance chez des enfants de petite taille, préparée à partir d’hypophyse prélevée sur des cadavres ; consommation de morceaux d’animaux contaminés par le prion infectieux.
1987
Au titre d’une convention signée à New-York et entrée en vigueur en France en cette années 1987, la France a l’obligation d’intercepter tout individu suspecté de torture de passage sur son territoire.
Création de la Fondation Bettencourt-Schueller avec pour but de promouvoir les métiers d’art en décernant des prix d’intelligence de la main. La Fondation va ainsi contribuer à donner ou redonner vie aux 281 métiers d’art recensés.
4 03 1988
Inauguration de la Pyramide du Louvre, due à Ieoh Ming Peï, américain d’origine chinoise, assisté de Michel Macary et de Georges Duval. Les proportions sont à peu près celles de la pyramide de Gizeh. Le nombre de losanges de verre formant les quatre cotés de la pyramide est de 603 plus 70 triangles en verre, et non 666 comme le diront certains opposants qui se complaisent dans l’ésotérisme à 3 balles, 666 étant un chiffre démoniaque. Les deux pyramides ne sont en fait que la partie aérienne d’une très importante réorganisation des espaces en sous-sol. Le Grand Louvre sera terminé en 1993 : il a fallu laisser le temps aux employés du ministère des finances de vider les lieux pour s’installer à Bercy.


13 03 1988
Inauguration du plus long tunnel sous-marin : le Honshu, au Japon : 53 km pour aller à Hokkaïdo.
18 03 1988
Les Irakiens utilisent le gaz moutarde contre les Kurdes à Halabja : 5 000 morts.
28 03 1988
Air France reçoit son 1° Airbus A 320.
Février-Mars 1988 La Comex – Compagnie Maritime d’Expertise – a mis en œuvre Hydra 8, une plongée profonde qui a emmené 6 plongeurs à travailler sur 2 chantiers à 520 et 534 mètres de profondeur : jamais l’homme n’était descendu aussi profond en pleine eau. Pour la Comex : Thierry Armold, Régis Peilé, Patrick Raul, et Louis Schneider ; pour la Marine : Serge Icart et Jean-Guy Marcel-Auda.
12 04 1988
Abou Jihad, numéro 2 de l’OLP, est assassiné près de Tunis par un commando de Césarée – une branche du Mossad. Au sein de l’OLP, il était plutôt un élément modérateur et, plutôt que d’affaiblir l’OLP, son assassinat l’aurait plutôt radicalisé : Israël pensait ainsi étouffer l’Intifada, alors que cette disparition renforcera les comités populaires chez les Palestiniens.
4 05 1988
Libération de Marcel Carton et Marcel Fontaine, détenus au Liban depuis le 22 05 1985, et de Jean Paul Kaufmann, détenu aussi au Liban depuis le 22 06 1985. Michel Seurat est mort d’un cancer.
5 05 1988
Les forces de l’ordre donnent l’assaut à la grotte d’Ouvéa : 19 morts parmi les Kanaks pour une île qui en compte à peine 2 000 et 2 parmi les gendarmes.
Mathieu Kassovitz réalisera en 2011 L’Ordre et la Morale, qui dit l’histoire de l’assaut des troupes militaires françaises en avril 1988, après l’assassinat de quatre gendarmes, à la gendarmerie, puis la prise d’otages par des indépendantistes Kanak de vingt-sept gendarmes mobiles. Le film, jugé caricatural et polémique, ne sera pas diffusé en Nouvelle-Calédonie au moment de sa sortie. L’armée française quant à elle, refusera de reconstituer certains décors. Pour réaliser son film, le réalisateur se rendra auprès du peuple Kanak au début des années 2000.
8 05 1988
Mitterrand succède à Mitterrand : Jacques Chirac est le premier ministre sortant, Michel Rocard le premier ministre entrant ; les deux hommes liés par une vieille amitié qui date de leur années communes à l’ENA, se croisent : Fais bien attention à Mitterrand quand il s’approche de toi pour te donner l’accolade, cela signifie aussi que le couteau qu’il a en main se rapproche de ton dos.
*****
Quand je suis auprès de vous, je sens l’homme choisi par Dieu, l’incarnation de la France, j’aimerais vous avoir comme père.
Gérard Depardieu
Sans que cela entraîne la France au bord du gouffre, Michel Rocard utilisera 28 fois l’article 49.3 de la Constitution, qui lui permet de se passer de l’accord de l’Assemblée nationale pour faire passer des lois.
À peu près à cette période, la langue bretonne se mêle d’espionnage économique, et c’est justement Michel Rocard qui le raconte : Quatre ou cinq ans avant ma nomination à Matignon, la Marine française avait reçu des nouveaux sonars, appareils d’écoute et d’identification ayant quelques rapports avec le radar mais destinés à travailler sous l’eau. On en équipe trois frégates pour aller faire des essais dans l’Atlantique et leurs commandants reviennent ivres de joie : Quel outil magnifique ! On n’a jamais vu ça. On détecte absolument tout, du moindre sous-marin à moins de deux cent cinquante mètres de profondeur ou des bancs de poisson, rien ne nous échappe. Ces services sont au service de la République, bien entendu, et la Marine décide que cette information doit être transmise aux pêcheurs français. L’État donne son accord. Durant quatre ou cinq mois, l’information remonte selon laquelle chaque fois que la Marine française fournit l’information qu’un banc de poissons est repérable à telle distance et tel lieu, les chalutiers poussent les feux pour arriver à temps. Puis, au bout de peu de semaines, ils ont la surprise, quand ils arrivent vers le banc de poissons annoncé, de trouver toujours systématiquement arrivés avant eux des bateaux japonais. La Marine française, régionalisée assez fortement, décide de répliquer en donnant la consigne que les messages contenant des informations de pêche destinés aux chalutiers seront désormais transmis en breton. Entre parenthèses, par conviction intrinsèque, je suis un vieux décentralisateur, et j’ai été créateur du Deug de Corse et du Deug de breton sur la demande du ministre Le Pensec en 1989. Bref, que croit-on qu’il arrivât ? À la rentrée scolaire suivante, trois étudiants japonais s’inscrivirent à l’université de Rennes…. en Deug de breton.
Michel Rocard. Si ça vous amuse. Flammarion 2010
15 05 1988
Début du retrait d’Afghanistan des 115 000 soldats soviétiques. L’opération sera terminée un an plus tard. La guerre aura fait 1,5 million de victimes.
19 05 1988
Inauguration du Pont de l’Ile de Ré, qui n’aura jamais eu de permis de construire.
26 06 1988
Michel Rocard a conduit les négociations entre les métro et les kanaks : et c’est l’accord à Matignon entre Lafleur et Tjibaou. Les deux étaient hommes de bonne volonté : Jacques Lafleur : Il est temps d’apprendre à donner, il est temps d’apprendre à pardonner. Jean-Marie Tjibaou : La souveraineté, c’est la capacité de négocier les interdépendances. Ils arriveront à la conclusion de l’Évangile : Paix sur terre aux hommes de bonne volonté.
Un Airbus A 320 d’Air France s’écrase en forêt d’Habsheim, sur les pentes du Mont Sainte Odile, au cours d’un vol de démonstration : 3 morts et 120 blessés. En avril 98, la justice condamne le pilote Michel Asseline, à vingt mois de prison, dont dix fermes. En juin 98, le rapport d’un expert suisse mondialement reconnu assure qu’il y a eu substitution des boites noires : celles qui ont été remises à la justice ne sont pas les boites de l’avion accidenté. En 2004, l’affaire revient encore sur le devant de la scène, avec une expertise concluant à un dysfonctionnement d’un récepteur qui apprécie la distance…
Norbert Jacquet, pilote de ligne sur Boeing à Air France créera le Syndicat de pilotes de ligne d’Air France, mettant en cause la certification de l’A 320 : un mois après la catastrophe, il sera suspendu de vol, puis encore un mois plus tard, déclaré inapte pour raisons psychiatriques par la Direction Nationale de l’Aviation Civile. Il fera de la prison préventive, écrira en 1994 : Airbus : l’assassin habite à l’Elysée. Les crashs à venir lui donneront raison :
- Le crash d’Habsheim en 1988
- Le crash du vol IC605 d’Indian Airlines le 14 02 1990, Bengalore, Inde
- Le crash du Mont Sainte Odile en 1992
- Le crash de l’Airbus, Rio Paris le 1° juin 2009
- Le crash du Boeing 737 MAX 8 en octobre 2018 à Djakarta, en Indonésie
- Le crash du Boeing 737 MAX 8 en mars 2019 en Ethiopie
Doté d’un tempérament passablement agité, il finira par s’en prendre par écrit à des juges qui n’apprécieront pas, proférera des propos négationnistes sur la Shoah : le tout lui vaudra en 2012 trois mois de prison après quoi il disparaître des radars. Il est regrettable que sa rage contre Airbus l’ait aveuglé au point de l’opposer avec Boeing, quand on réalise que ses mises en garde valaient finalement pour tout le monde !
27 06 1988
Accident de chemin de fer à la gare de Lyon : 56 morts. Suite à un arrêt imprévu près de Maison Alfort dû au déclenchement du signal d’alarme, les freins se mirent aux abonnés absents et le train vint percuter à 80 km/h un autre convoi de banlieue qui n’était pas à son quai de départ habituel. Le conducteur, Daniel Saulin, fut condamné le 14 12 1992 à 4 ans de prison, dont 6 mois ferme, ce qui déclencha une grève des cheminots. La peine fut ramenée le 18 11 1993 à 2 ans avec sursis… pour 56 morts.
30 06 1988
Monseigneur Lebebvre qui a fondé la Fraternité Saint Pie X, sacre 4 évêques à Écône, dans le Valais. C’est la rupture avec l’Église catholique. Il meurt le 25 mars 1991, mais, dix ans plus tard la Fraternité se porte plutôt bien, forte de 350 prêtres, six séminaires… .
3 07 1988
Le golfe Persique, et plus précisément le détroit d’Ormuz sont devenus depuis longtemps zone à risques : il y passe tant de pétrole ! Un croiseur américain, l’USS Vincennes, pourchassant, au mépris des consignes de sa hiérarchie, des vedettes de pasdarans dans les eaux iraniennes, ouvre le feu sur un Airbus d’Iran Air, reliant Bandar Abbas à Dubaï, qu’il a confondu avec un avion de chasse hostile. Le tir provoque la mort des 290 passagers, dont 66 enfants, qui se rendaient au pèlerinage de La Mecque. Huit ans plus tard, les États-Unis se résoudront à verser 132 millions de dollars (117 millions d’euros) de dommages au gouvernement iranien, dont 62 millions de dollars destinés aux familles des victimes, mais refuseront de présenter leurs excuses. Téhéran considère encore à ce jour ce tir comme volontaire.
Aux confins de l’Arabie et aux portes de la Perse, nimbé d’exotisme et de danger, le détroit d’Ormuz est à la fois le bout et le centre du monde, passage obligé et coupe-gorge. Cette image saturée de soleil, d’embruns et d’or noir, façonnée par la fameuse guerre des tankers des années 1980, à l’époque du conflit Iran Irak, a été ranimée, depuis le mois de mai, par la soudaine escalade des tensions entre Washington et Téhéran. Six navires mystérieusement sabotés à l’entrée du golfe Persique, un drone américain abattu par un missile iranien, une avalanche de déclarations belliqueuses : Ormuz, le cap Horn des capitaines de pétrolier, est repassé en rouge sur la carte des points géopolitiques à risque.
En 2018, 21 millions de barils de brut ont transité chaque jour par ce couloir, soit un cinquième de la consommation mondiale d’or noir et un tiers du pétrole acheminé par voie maritime sur la planète. Un quart de la consommation mondiale de gaz naturel liquéfié a aussi circulé par cet étroit goulet. En plus d’être l’épine dorsale du système énergétique international, Ormuz se trouve sur la ligne de faille entre l’Iran et l’Arabie saoudite, deux puissances à couteaux tirés, qui se disputent la suprématie régionale.
La guerre économique décrétée par les Etats-Unis contre la République islamique, menée à coups de sanctions contre son industrie pétrolière, et les rituelles menaces de fermeture du détroit, proférées en riposte par les dirigeants de Téhéran, ont redonné au lieu son cachet sulfureux. Ultrasurveillé, ultramilitarisé, Ormuz est une boîte de Pandore géostratégique. Cette autoroute maritime, en forme de chicane, est dessinée par la péninsule de Mussandam, une enclave omanaise à l’intérieur des Emirats arabes unis (EAU), et la baie de Bandar Abbâs, un port iranien entouré d’îles. Parmi celles-ci, Ormuz, qui a donné son nom au détroit. Ce territoire volcanique fut, aux XIV° et XV° siècles, un important comptoir sur la route des Indes et la capitale d’un petit royaume, rayonnant sur le Golfe et la côte d’Oman. Long de 45 km, le passage fait 38 km de large à l’endroit le plus resserré. Les eaux territoriales iraniennes étant peu profondes, les navires sont obligés de circuler dans des chenaux très étroits, de 2 milles nautiques (3,7 km), passant entre les îlots omanais de Quoin et Ras Dobbah. Un espace interdit à la navigation d’une distance équivalente sépare le couloir entrant du couloir sortant. Quand on entre dans le détroit, il faut prendre un virage à gauche à 90 degrés, explique le Français Bertrand Derennes, commandant de tanker à la retraite. On prend alors le rail de navigation obligatoire et, surtout, on ne doit pas dévier, un peu comme quand on passe au large de Calais, il y a un rail et on le suit. Une fois le détroit effacé, le chenal s’élargit à 3 milles nautiques (5,5 km) mais passe entre trois îles (Grande Tomb, Petite Tomb et Abou Moussa) occupées depuis 1971 par l’Iran, au grand dam des EAU, qui les revendiquent. La zone est extrêmement étroite et, en plus, elle est sillonnée par des petites embarcations de pêcheurs ou de contrebandiers, raconte Hubert Ardillon, un autre ancien de la marine marchande française. Le passage est compliqué en raison de la brume de chaleur qui restreint la visibilité. J’ai beaucoup joué de la corne de brume sur le détroit.
Longtemps méconnu, Ormuz émerge sur la carte du fret maritime mondial durant la seconde moitié du XX° siècle, en raison de trois événements successifs : le début de l’exploitation, en 1951, de Ghawar, le plus vaste gisement d’or noir du globe, découvert trois ans plus tôt, sur la côte est de l’Arabie saoudite ; le choc pétrolier de 1973, conséquence de la guerre israélo arabe du Kippour, qui multiplie le prix du baril par trois et ébranle les économies occidentales ; et la révolution khomeyniste de 1979, qui propulse au pouvoir à Téhéran un régime islamiste prosélyte, dans un pays chiite, suscitant l’inquiétude des Etats sunnites du Golfe, notamment l’Irak, qui entre en guerre contre son voisin l’année suivante. Ormuz devient cinq ans plus tard un mot familier dans les bulletins d’information occidentaux. En avril 1984, plusieurs navires faisant le plein de brut au terminal de l’île de Kharg, par lequel transitent 90 % des ventes de pétrole iraniennes, sont attaqués, à coups de missiles Exocet, par les Super Etendard de l’armée irakienne. Le président Saddam Hussein, confronté à l’échec répété des offensives terrestres lancées par ses troupes, a décidé de porter le conflit dans les eaux du Golfe. L’ambition du despote irakien est double : saper l’effort de guerre iranien en affaiblissant l’économie du pays, très dépendante des exportations d’hydrocarbures d’une part ; et pousser le régime de Téhéran à la faute, en l’incitant à bloquer le détroit d’Ormuz, ce qui provoquerait une intervention occidentale immédiate, d’autre part. Le 16 mai 1984, Akbar Hachémi Rafsandjani, le président du Parlement iranien et futur président de la République (1989 – 1997), a en effet lancé : Nous ne tolérerons pas qu’il soit difficile d’exporter notre pétrole par l’île de Kharg, tandis que d’autres pays continuent d’exporter le leur facilement. Le golfe Persique sera accessible à tous ou à personne. Pour tenter de mettre les clients de son industrie pétrolière à l’abri, Téhéran aménage des terminaux flottants, plus au sud du Golfe, donc plus loin de la frontière irakienne, qui sont ravitaillés par navettes. Mais grâce à l’aide de la France, qui l’équipe en Mirage F1, le rayon d’action de l’aviation irakienne s’étend, ce qui lui permet de poursuivre ses raids jusqu’à l’île de Larak, en face de Bandar Abbas. Des dizaines de tankers sont coulés ou irrémédiablement endommagés. En mai 1987, des missiles irakiens touchent même une frégate américaine, très probablement par erreur, tuant 37 marins. L’Iran, qui dispose de chasseurs Phantom et Tomcat datant de l’époque du chah (1941 – 1979), réplique en attaquant les pétroliers qui viennent s’approvisionner au Koweït, au Qatar et aux Emirats, trois monarchies solidaires de l’Irak. La République islamique pose aussi des mines, plante des batteries de missiles antinavires le long de ses côtes et élabore une stratégie de harcèlement du trafic maritime confiée aux pasdarans, les gardiens de la révolution. Le 16 septembre 1986, des membres de cette force naissante et désordonnée, mêlant patriotes et fanatiques du régime, mitraillent un tanker koweïtien depuis des vedettes ultrarapides parties des îles Tomb et Abou Moussa. C’est le premier d’une longue série de raids maritimes menés par la future garde prétorienne du régime.
En réaction, les États-Unis lancent en juillet 1987 l’opération Earnest Will (ferme volonté). Les pétroliers koweïtiens sont rebaptisés et placés sous pavillon américain. Un croiseur, un destroyer et deux frégates de l’US Navy les accompagnent toutes les deux semaines, jusqu’à la sortie d’Ormuz. Il s’agit de la plus importante opération d’escorte navale depuis la fin de la seconde guerre mondiale, rappelle Pierre Razoux, directeur de recherche à l’Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire, à Paris, dans La Guerre Iran Irak (Perrin, 2013).
La confrontation, inéluctable, éclate en trois temps : dans la nuit du 21 septembre 1987, un hélicoptère américain surprend le navire Iran Ajr en flagrant délit de pose de mines sur les voies commerciales. La scène est filmée à la caméra infrarouge. Les soldats américains donnent ensuite l’assaut au bateau – une opération qui coûte la vie à cinq marins iraniens – avant de l’envoyer par le fond.
Téhéran crie aussitôt à l’agression. Depuis le podium de l’Assemblée générale des Nations unies, où il est le premier dirigeant iranien à se rendre depuis la révolution, Ali Khamenei, alors président, soutient que l’Iran Ajr était un navire commercial. Mais, dans ses Mémoires, son successeur Akbar Hachémi Rafsandjani confesse la faute du régime. Notre navire commercial emportait deux mines à destination de Bushehr, écrit-il. Nous étions convenus de rejeter l’accusation [américaine] et de ne rien dire sur l’existence de ces deux mines. Le deuxième affrontement intervient le 19 octobre 1987, peu après qu’un missile antinavire a percuté un supertanker récemment passé sous la bannière étoilée, blessant grièvement le commandant et plusieurs officiers, tous américains. En représailles, des destroyers pilonnent deux plates formes offshore qui servaient de repaire aux pasdarans, à proximité du terminal de Lavan. La troisième confrontation, une bataille aéronavale de grande ampleur, baptisée Praying Mantis (mante religieuse), survient en avril 1988, après l’explosion d’une mine au passage d’un navire américain. En réaction, l’US Navy anéantit deux frégates iraniennes et des bases des pasdarans situées dans les champs pétroliers de Sirri et Sassan.
En tout, entre 1984 et 1988, plus de 500 vaisseaux ont été détruits et endommagés, pour la grande majorité du fait de tirs irakiens. Le trafic n’a jamais cessé à travers le détroit, les Iraniens n’ayant pas voulu prendre le risque de le fermer complètement et n’ayant de toute façon pas les moyens de le faire durablement. Davantage que les dommages causés à son industrie pétrolière, c’est la baisse du dollar et du prix du baril qui a mis l’économie de l’Iran à terre. L’opération Praying Mantis a aussi accéléré la fin du conflit, survenue le 20 août 1988, en convainquant l’ayatollah Khomeyni (guide de la révolution de 1979 à 1989) qu’il ne pouvait pas mener deux guerres en même temps.
Le Golfe retrouve alors son calme, mais des incidents se produisent à intervalles réguliers, signe que la tension couve. En 1991, pour éviter que la coalition internationale venue libérer le Koweït n’envahisse son territoire par la mer, l’Irak mouille des centaines de mines. L’opération de nettoyage par des dragueurs allemands, italiens, français, belges et néerlandais durera plusieurs mois. En mars 2007, des marins britanniques occupés à fouiller un boutre, au large de la frontière irako iranienne, sont arrêtés par les gardiens de la révolution, au motif qu’ils se trouvent dans les eaux de leur pays. Ils sont libérés deux semaines plus tard. En juillet 2010, une vedette suicide endommage un tanker japonais, une opération attribuée aux Brigades Abdallah Azzam, un groupe affilié à Al Qaida. En janvier 2016, les pasdarans interceptent deux bateaux américains qui s’étaient égarés dans les eaux iraniennes et retiennent leurs dix marins pendant quelques heures. Les images des militaires, agenouillés, les mains sur la tête, tournent en boucle dans les médias iraniens et américains. En mai 2018, la décision de la Maison Blanche de se retirer de l’accord sur le nucléaire iranien, signé trois ans plus tôt, renvoie Ormuz, vieille connaissance occidentale, au premier plan de l’actualité. A la politique de pression maximale mise en œuvre par Donald Trump pour l’obliger à accepter un accord plus contraignant, l’Iran répond par de nouvelles menaces de fermeture du corridor maritime. Si notre pétrole ne peut pas passer par ce détroit, sans doute le pétrole des autres pays n’y passera pas non plus, clame, en mai 2019, le général Mohammad Bagheri, le chef d’état-major iranien. Le remake de la déclaration de Rafsandjani, trente-cinq ans plus tard.
Entre ces deux dates, la planète pétrole a changé, et Ormuz aussi. Grâce à l’huile de schiste, les Américains sont devenus les premiers producteurs mondiaux d’or noir, devant les Saoudiens et les Russes. En 2019, les États-Unis n’importent plus que 16 % de leur pétrole du Proche-Orient – contre 26 % six ans plus tôt. Les plus gros acheteurs de pétrole sont désormais asiatiques. Selon l’Agence d’information sur l’énergie du ministère de l’énergie américain (EIA), 76 % des exportations de brut ayant transité par Ormuz en 2018 étaient destinées à l’Inde et aux puissances extrême-orientales, surtout la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Intimement lié à l’essor industriel des grands pays occidentaux dans la seconde moitié du XX° siècle, le détroit est devenu l’auxiliaire de la modernisation de l’Asie.
Autre constat : malgré les attaques de tankers au mois de juin, la destruction d’un drone américain par un missile iranien et les imprécations de Téhéran, le cours du baril n’a pas flambé. La guerre commerciale entre Donald Trump et son homologue chinois, Xi Jinping, suscite tellement plus d’inquiétude qu’elle a relégué au second plan sur les marchés pétroliers le vieux risque géopolitique d’Ormuz.
Le détroit compte d’ailleurs quelques concurrents, ce qui n’était pas le cas il y a trente ans. Soucieux de garantir l’écoulement de leur production en toutes circonstances, les Etats du Golfe se sont offert des alternatives au passage par Ormuz. Le pipeline Est Ouest, qui traverse l’Arabie saoudite pour déboucher au port de Yanbu sur la mer Rouge, a une capacité de 5 millions de barils par jour. Les EAU disposent d’un oléoduc qui mène à Foujeyra, dans le golfe l’Oman, d’une capacité de 1,5 million de barils. Enfin, l’Irak possède une voie vers le nord, à travers le Kurdistan irakien vers le port turc de Ceyhan, d’une capacité théorique de 1,4 million de barils par jour. L’Iran, lui, cherche à développer, malgré les sanctions américaines, son port de Chabahar, ouvert à l’océan Indien, et à le relier à Bandar Abbas par un pipeline. Mais ces réseaux de contournement ne sont pas aussi efficaces qu’espéré. Une grosse partie du pétrole qui circule dans l’oléoduc saoudien est en fait destiné aux raffineries situées dans l’ouest du royaume. Le mauvais état du pipeline irakien ne permet pas d’exporter plus de la moitié du volume promis. A l’heure actuelle, les monarchies du Golfe n’exportent qu’environ 3,2 millions de barils par jour par oléoduc. Si toutes ces voies terrestres fonctionnaient à plein régime, le total pourrait passer à 7 millions ou 8 millions. Ce qui laisserait tout de même plus de 12 millions de barils sans autre option qu’Ormuz. Ces oléoducs ne sont d’ailleurs pas sans risque : le pipeline irakien a été attaqué à plusieurs reprises et, en mai, des drones s’en sont pris à la route Est Ouest, endommageant deux stations de pompage. Au même moment, quatre navires au mouillage à Foujeyra étaient la cible de mystérieux sabotages. L’auteur de ces attaques n’a pas été formellement identifié. Mais celles-ci s’apparentent aux provocations soigneusement calculées dont l’Iran a fait sa spécialité, à l’image de la destruction du drone américain, le 20 juin 2019, revendiquée, elle, par Téhéran.
L’appareil d’observation a été abattu de nuit, à haute altitude, alors qu’il évoluait sur un parcours régulier et éminemment prévisible. Téhéran soutient que l’appareil avait pénétré dans son espace aérien. Les autorités iraniennes ont aussi pris soin de souligner qu’un avion de reconnaissance américain qui volait à proximité, avec 35 personnes à bord, a été épargné, afin de ne pas provoquer de pertes irréparables. Les sabotages de tankers en mer d’Oman, en mai et juin, obéissent à la même logique, estime l’historien Pierre Razoux. Il n’y a pas eu de morts, les dégâts matériels sont limités. Les Iraniens se contentent de signaler que si les sanctions américaines les empêchent d’exporter leur pétrole, c’est tout le trafic dans la région qui souffrira avec eux. Téhéran sait qu’il n’a pas les moyens de verrouiller Ormuz. La disproportion des forces est encore plus nette que dans les années 1980. Les États-Unis ont ouvert, en 1995, une base navale permanente, à Bahreïn, où stationne leur V° flotte, et déménagé le quartier général de leur commandement central au Qatar, au début des années 2000. L’armée française s’est installée à Abou Dhabi en 2009. La Royal Navy britannique est présente à Oman et à Bahreïn. Ces marines effectuent des exercices conjoints de déminage du détroit tous les deux ans, pour la dernière fois en mai 2019, et demeurent convaincues qu’un minage d’Ormuz n’est pas à l’ordre du jour.
À supposer que l’Iran parvienne à damer le pion à toutes ces marines et à paralyser Ormuz pendant quelques jours, cela ne suffirait pas à créer une pénurie dommageable sur le plan financier. La plupart des pays disposent en effet de réserves stratégiques de pétrole pour affronter ce genre de situation. Face à l’armada américaine, et à Riyad, qui s’est doté de la première force maritime régulière de la région, Téhéran ne peut miser que sur ses capacités de nuisance et de dissuasion, testées durant la guerre des tankers. La marine iranienne s’est bien équipée de sous-marins de poche auprès de la Russie et de la Corée du Nord. Mais elle n’a pas cherché à acquérir de bâtiments de surface de gros tonnage. La fierté des gardiens et du régime reste leur flotte de vedettes rapides, équipées pour certaines de missiles, et pour d’autres d’une simple mine prête à glisser sur son rail. Les jeunes gardiens embarqués sur ces coquilles de noix s’entraînent sur des simulateurs à se lancer à l’assaut de bâtiments américains. Nous n’avons pas les moyens de la marine américaine, c’est évident. Mais, en cas de conflit, il est certain que nous coulerons quelques-uns de ses navires, et peut-être un porte-avions, veut croire un responsable iranien. C’était l’objectif d’un exercice militaire iranien très médiatisé, en 2015, durant lequel les gardiens avaient fait exploser une maquette flottante de l’USS Nimitz, mastodonte des mers. A Téhéran, on garde aussi en tête un autre exercice militaire, américain celui-ci, organisé dans les eaux du Golfe en 2002 : une puissance armée à l’iranienne avait fictivement détruit 16 bâtiments américains, dont un porte-avions. Dans son bras de fer asymétrique avec les États-Unis et leurs alliés, l’Iran s’appuie aussi sur l’effet dissuasif de son arsenal balistique. Par temps clair, depuis les gratte-ciel d’Abou Dhabi, la vue porte sur la petite île d’Abou Moussa, équipée par Téhéran de batteries de missiles capables de frapper toute la côte des Emirats. Parmi les cibles probables en cas de conflit : des usines de dessalement, des aéroports, des installations pétrolières et gazières. De quoi mettre ces micro monarchies à genoux en quelques frappes. Pour l’heure, la stratégie de Téhéran est davantage économique que militaire. Créer des troubles dans le détroit, avec des mines par exemple, ou faire peur aux transporteurs, ça fait monter le prix des assurances, et donc, in fine, le prix du baril, expose un bon connaisseur du marché pétrolier. Exsangue du fait des sanctions américaines, qui entravent ses exportations d’hydrocarbures, l’Iran a besoin de vendre le peu de barils qu’il arrive encore à écouler au prix le plus élevé possible. L’impact sur les coûts de transport est déjà sensible. Selon l’agence Bloomberg, les primes de risque dans le Golfe peuvent maintenant s’élever à 500 000 dollars, contre 50 000 dollars en début d’année. Cette hausse ne se reflète que timidement dans les cours actuels, elle ne représente pas plus de 25 cents par baril. Mais, si la tendance s’accentue, l’effet se fera sentir. Pour les Iraniens, cette stratégie haussière est aussi une manière de mettre les Américains sous pression : les premiers à souffrir d’un pétrole cher seraient les Asiatiques et les Européens, qui seraient alors incités à se retourner contre la politique de Donald Trump, espèrent les dirigeants de Téhéran. A ses capitaines qui croisent dans la zone, l’un des acteurs majeurs du secteur donne la consigne suivante : Élever sa vitesse lors du passage dans le chenal iranien afin d’effacer le détroit le plus rapidement possible tout en assurant une veille visuelle et radar très attentive. Et, une fois le détroit passé, naviguer en priorité au large des côtes des Emirats arabes unis et d’Oman, de façon à laisser les côtes iraniennes le plus loin possible.
benjamin barthe, ghazal golshiri, louis imbert (à paris), avec philippe jacqué et nabil wakim Le Monde du 14 07 2019



25 08 1988
Incendie d’une grande partie du Chiado dans le vieux Lisbonne.
08 1988
Cessez le feu de la guerre Iran Irak. Khomeiny dira que l’épreuve avait été assez dure pour qu’il accepte de boire ce poison.
17 09 1988
Ouverture des XXIV° Jeux Olympiques d’été jusqu’au 22 octobre à Séoul, capitale de la Corée du Sud. Pour ce pays d’Asie, c’est la consécration de son appartenance au club des pays les plus développés : avant même le début des compétitions, ils détiennent un nombre ahurissant de premières places dans le classement des grandes entreprises privées.
3 10 1988
Nîmes est sous 2.5 m. d’eau : 9 morts ; en quelques heures, chaque m² aura reçu 228 l d’eau. 90 millions de m³ d’eau se déversent en moins de 6 heures. 2 000 logements sinistrés, 6 000 voitures endommagées, 41 écoles fermées, 90 km de réseau d’eau et 15 km de voirie détruits. Dieu merci, le préfet, sur l’autoroute A 9 avant la catastrophe, avait suivi les météorologues qui lui conseillaient de fermer l’autoroute, dans les deux sens ; ce qui fut fait, contraignant 4 000 voitures à se détourner ; une heure et demi plus tard, l’autoroute était sous 1.6 m d’eau ! Il est bien d’être informé par ceux dont c’est le métier, encore faut-il être en mesure d’entendre ce qu’ils disent … car cela n’est pas donné à tout le monde !
15 10 1988
L’ex URSS livre ses secrets de famille : les prouesses de Stakhanov en 1935 étaient fausses.
6 11 1988
La participation au référendum sur l’avenir du territoire de la Nouvelle Calédonie a été de 37 % : le Oui [oui au maintien de la Nouvelle Calédonie à la souveraineté française] l’emporte avec 80 %.
15 11 1988
1° Navette russe Bourrasse.
26 11 1988
Jean Loup Chrétien part à bord de Mir, jusqu’au 21 décembre 88, pour la mission Aragatz, au cours de laquelle il effectuera une sortie dans l’espace de 5 h 56’.
30 11 1988
Loi sur le RMI : Revenu Minimum d’Insertion.
7 12 1988
Tremblement de terre en Arménie : entre 25 000 et 35 000 morts.
21 12 1988
Vladimir Titov et Moussa Manarov ont passé un an dans l’espace.
Les services secrets libyens font exploser au-dessus de Lockerbie, en Ecosse, un Boeing 747 de la Panam : 270 morts, pour la plupart américains et britanniques. 15 ans plus tard, la Libye reconnaîtra sa responsabilité et proposera de verser 10 millions de $ par victime. Ali Mohamed Al-Megrahi, reconnu seul coupable en 2001, sera condamné à 27 ans de prison. Atteint d’un cancer de la prostate, il sera libéré en août 2009 et accueilli en héros chez les siens.
1988
Inauguration du ministère des finances dû aux architectes Paul Chemetov et Borja Huidrobo.

Interdiction des CFC : Chlorofluorocarbones, qui ont servi, un peu rapidement, de boucs émissaires, pour expliquer les trous dans la couche d’ozone.
Création du GIEC – Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat – [IPCC en anglais] : c’est un organisme ONU, né d’une nervosité certaine des responsables onusiens à se voir de plus en plus court-circuités par les grands de ce monde lorsqu’ils se retrouvent aux G8, G20, sommet de Davos, etc…
La climatologie est une science quasiment nouvelle par rapport à la météorologie, de par la masse d’informations qui lui viennent des satellites, et de par la puissance de calcul qu’offre l’ordinateur, qui permet de traiter des masses d’informations donnant lieu à des modèles, c’est-à-dire des projections dans l’avenir qui permettent de dire quelle va être l’évolution du climat dans le futur. Et parler de l’avenir, ne serait-ce qu’un peu plus loin que le court terme, c’est un sujet bigrement intéressant pour les politiques. Mais encore faut-il pour cela se montrer attirant et leur présenter un front commun, des analyses, des conclusions qui ne soient plus le reflet de la diversité des avis scientifiques, mais des affirmations catégoriques nées d’un consensus.
Les rapports du GIEC, ce sont trois documents, dont la longueur et le style sont profondément différents. Le premier est un rapport de près de 1 000 pages qui rassemble des articles de mise au point sur les divers sujets touchant au climat, et aux conséquences que pourrait avoir telle ou telle modification du climat sur la faune, la flore, l’océan et sur l’économie. Les articles sont bien documentés, écrits dans un style propre aux articles scientifiques et expriment, en général honnêtement, les incertitudes qui pèsent sur telle ou telle interprétation. Le deuxième document, d’une centaine de pages, est un résumé du premier. Le ton est nettement plus affirmatif. C’est déjà un document de consensus, c’est-à-dire qu’il gomme les opinions minoritaires. Il est rédigé par un comité très restreint d’une quarantaine de personnes, et déjà fortement biaisé. Enfin, le troisième document s’intitule Recommandations pour les décideurs. Ce document de trente pages est celui que tout le monde lit. Il est à chaque page affirmatif, tranchant, catégorique. Qui plus est, il n’est pas rédigé par un groupe de scientifiques, mais par un groupe de personnes choisies par les Etats. Certains sont des scientifiques mais la majorité ne le sont pas. Ce sont des administratifs désignés par les Etats : ce sera le cas pour la France pendant dix ans ! On dit que lorsqu’ils n’arrivent pas à se mettre d’accord sur tel ou tel aspect, ils votent ! Et c’est le groupe de décideurs qui accepte ou non la publication des articles dans le volume scientifique de 1 000 pages. C’est la science soumise à la politique !
[…] Nous devons trouver entre nous un terrain d’entente, un point commun et, au final, parler d’une seule voix. C’est la condition nécessaire si nous voulons avoir un impact sur le monde politique, dit Bert Bolin, un des fondateurs. L’idée qui justifie cette attitude est la suivante : lorsque les scientifiques expriment des opinions variées et nuancées, les hommes politiques – tous rivaux permanents – en profitent pour se contredire et, au total, l’opinion des scientifiques ne pèse pas ou presque pas. Du coup, depuis vingt ans, pour éviter cet écueil, on entendra sans cesse cette petite phrase : Le consensus est que… Il y a consensus pour dire que... Et le GIEC va jouer cette carte à fond : le consensus pour tous, tous pour le consensus !…
[…] Il s’agit – au sens scientifique – d’une distillation destinée à faire émerger une opinion, et une seule. Toujours le consensus !… Conformément aux recommandations premières de Houghton, le document doit être exagérément alarmant pour qu’on lui prête attention. Cette méthode est à l’opposé de la démarche scientifique véritable qui doit impérativement protéger les opinions minoritaires, car ce sont elles qui conduisent aux nouvelles découvertes. Ce sont les hérétiques qui font avancer la Science, dit Freeman Dyson. Ce véritable viol de la pratique scientifique habituelle est le résultat d’un mélange ambigu entre science et politique.
Claude Allègre. L’imposture climatique ou la fausse écologie. Plon 2010
Un ami lui dira : Tu n’as pas été critiqué, tu as été excommunié.
*****
On ne peut pas prévoir le temps plus de trois ou quatre jours à l’avance. Davantage, c’est illusoire, car mathématiquement impossible.
Edward Lorenz, 1917-2008, professeur de météorologie au MIT, promoteur de l’effet papillon.
Le gène de la différence sexuelle est isolé sur les chromosomes X et Y. On découvre le prion dans les farines animales, fabriquées à partir d’animaux morts : les Anglais, pour réaliser des économies d’énergie, avaient baissé la température de chauffage de ces farines. Le gouvernement anglais interdit alors l’utilisation de farines animales pour l’alimentation des bovins… chez eux, mais continuent à exporter les dites farines dans l’Union Européenne jusqu’en 1996.
L’Américaine Florence Griffith-Joyner a décroché deux records du monde, qui vont rester inaccessibles : le 100 m en 10’’49 et le 200 en 21’’34. On la soupçonne alors de s’être préparée en prenant des stéroïdes anabolisants. Elle mourra dix ans plus tard, à 38 ans, d’une attaque cérébrale.
La Chine livre bataille au large des îles Spratleys pour les reprendre au Vietnam.
13 01 1989
La société Pomagalsky procède aux ultimes essais d’un téléphérique à Vaujany, au pied des Grandes Rousses dans l’Isère : les prospectus le disent déjà le plus grand téléphérique du monde : avec 4 300 m. de long et une gare intermédiaire à 2 050 m d’altitude il permettra un accès direct à l’Alpe d’Huez. Des galets cassent et la cabine chute de 200 m : 8 techniciens y trouvent la mort : en septembre 1996, le procès intenté par les familles des victimes commence seulement car il a fallu attendre janvier 1995 pour qu’un dernier rapport d’expertise soit notifié aux parties civiles. En réponse à l’appel d’offres, un autre constructeur avait proposé de réaliser le téléphérique en deux ans. Pomagalski l’a livré en 10 mois.
14 01 1989
Début de campagne électorale à Moscou pour des élections au congrès des députés du peuple du Soviet Suprême : Boris Eltsine, favorable au multipartisme est quasiment contraint par la foule d’un district à se porter candidat. Il est de plus en plus populaire. Sa traversée du désert n’aura pas été bien longue.
16 01 1989
En compagnie de quelques intellectuels dissidents, Vaclav Havel vient déposer des violettes devant la statue de Saint Venceslas, en hommage à Jan Palach, qui s’est immolé à cet endroit 20 ans plus tôt. La police arrive, embarque tout ce monde. Vaclav Havel sera condamné à neuf mois de prison ferme le 21 février 1989.
12 02 1989
L’Église Épiscopalienne américaine sacre évêque une femme noire : Barbara Harris, 55 ans.
14 02 1989
L’Iran condamne à mort, par contumace, Salman Rushdie, pour avoir écrit Les versets sataniques, une charge virulente contre les extrémistes musulmans. C’est son père, grand érudit musulman, qui avait choisie le nom de Rushdie en référence au philosophe musulman Averroes, Ibn Rushd, en arabe.
25 02 1989
Le Brésil a entrepris des travaux pharaoniques sur le Xingu, un affluent de la rive droite de l’Amazone pour y construire ce qui devra être dans les années 2010 le troisième barrage hydroélectrique du monde : Kararao, rebaptisé Belo Monte. Jose Antonio Muniz Lopes est le directeur d’Eletronorte, l’entreprise en charge de la construction. Les Indiens Kayapo sont concernés par ces travaux et une réunion d’information a été organisée à Altamira. L’atmosphère est chaude et tout à coup, une indienne vêtue d’un seul petit cache-sexe s’en vient à la tribune, et menace du tranchant de sa machette la joue de Jose Lopez, en lui intimant l’ordre de déménager avec toute son entreprise : Je me nomme Tuira et viens te dire que nous n’avons pas besoin de ton barrage. Nous n’avons pas besoin d’électricité, elle ne nous donnera pas notre nourriture. Tu es un menteur. Les photographes sont plus de cent à prendre la scène, et la photo va bien vite faire le tour du monde : probablement le premier grand succès politique d’Internet.

4 03 1989
Au théâtre de l’Empire, on joue, comme chaque année à la même époque les Césars : que du beau monde.
Depuis plusieurs semaines, Isabelle Adjani échange avec le philosophe André Glucksmann (1937 – 2015, père de Rafael ) sur la fatwa lancée contre Salman Rushdie par l’ayatollah Khomeini.
Depuis l’automne 1988, ils suivent le sort réservé à Rushdie après la publication de son roman : le fait que l’écrivain soit contraint d’être accompagné d’un garde du corps puis de se cacher, les autodafés d’exemplaires des Versets sataniques dans les villes britanniques de Bolton puis de Bradford, les manifestations contre le livre à Islamabad, la capitale du Pakistan, ou à Londres…
Par coïncidence, en décembre 1988, sort Camille Claudel, de Bruno Nuytten, le premier film depuis L’Eté meurtrier (1983) dont Isabelle Adjani est la vedette, soit une éclipse de plus de cinq ans. Cinq ans ! De quoi la remettre sous les projecteurs, quand Salman Rushdie se trouve réduit à la clandestinité.
Une condamnation à mort pour crime d’apostasie, prononcée par un État, l’Iran, contre un artiste qui n’est pas citoyen de ce pays, constitue un précédent. Adjani y voit le signe d’un affrontement entre l’Occident et l’islamisme – qui, pour elle, n’a rien à voir avec l’islam. Comment se révolter contre cette fatwa ? , demande-t-elle.
La réponse d’André Glucksmann est évidente. Avec près de 3 millions d’entrées, Camille Claudel constitue un nouveau succès pour l’actrice. Les Césars auront lieu le 4 mars 1989, deux bonnes semaines après la fatwa, et le film est nommé dans les principales catégories, dont celles de meilleur film, meilleur acteur pour Gérard Depardieu et meilleure actrice pour Adjani.
Vous allez connaître un moment d’exposition avec les Césars. Si vous l’avez, suggère André Glucksmann, vous devriez faire ça.
– En quoi consiste ce “ça” ?, demande l’actrice.
– Juste sortir du silence, et le sortir, lui, du silence dans lequel on trouve convenable de l’abandonner. Il faut aller à l’encontre du péril.
L’éventuel César devient un enjeu. Il lui faut cette tribune pour affirmer son soutien à Rushdie. Et pour signer sa propre résurrection artistique après la rumeur sida. Adjani porte le projet Camille Claudel depuis le début des années 1980. Cette sculptrice au destin tragique s’inscrit parmi les femmes écorchées vives devenues, depuis L’Histoire d’Adèle H.(1975), l’ADN de la comédienne. C’est elle qui se tourne vers Bruno Nuytten, alors directeur de la photo très en vue, pour lui demander : François Truffaut est mort, est-ce que tu veux bien passer à la mise en scène ?

Autodafé des Versets sataniques, le roman de Salman Rushdie, à Bradford (Royaume-Uni), le 14 janvier 1989. Guzelian News Agency / Sipa
Défendre Rushdie est un engagement pris en un instant, à ne pas confondre avec ces engagements instantanés que la société du spectacle aime multiplier. Ce sera sa première prise de position politique, mais son opposition au fondamentalisme religieux vient de loin – c’est sa colonne vertébrale idéologique.
Quelques mois avant la fatwa contre Rushdie, fin octobre 1988, Isabelle Adjani découvre sur France 2 un reportage sur l’Algérie. La jeunesse du pays, minée par le chômage et les pénuries, manifeste dans la plupart des villes. Des émeutes sont sévèrement réprimées par l’armée, l’état de siège est proclamé à Alger. Ce que l’on nommera les massacres du 5 octobre fait officieusement 500 victimes. Un jeune Algérien témoigne devant la caméra des tortures qu’il vient de subir. Il décrit le lieu de son martyre en détail : une salle d’interrogatoire puis une autre salle où se pratiquent la sodomie et le supplice de la baignoire. D’autres adolescents exhibent les marques des sévices. L’actrice, d’origine algérienne par son père, est secouée. Comment ?, s’étonne-t-elle. On torture aujourd’hui en Algérie ?
Le président de la République, François Mitterrand, a déjà la tête au bicentenaire de la Révolution française. […] La tragédie algérienne est loin, et l’Hexagone y répond par le silence. Ce silence criait aux oreilles, juge aujourd’hui Adjani. Pour l’actrice, il crée des devoirs qui, souvent chez elle, se traduisent par des actes. Personne ne s’engageait dans ce combat et une signature en bas d’une éventuelle pétition n’aurait pas suffi, confiera-t-elle au Point, le 28 novembre 1988.
Isabelle Adjani se rend à Alger le 1° novembre 1988. André Glucksmann a demandé à Patrick Aeberhard, président de Médecins du monde, d’emmener l’actrice. Cette dernière n’émet qu’une condition : ne pas être photographiée. Elle le sera quand même, certes discrètement. Le 2 novembre, veille d’un référendum diligenté par le président algérien, Chadli Bendjedid (1979 – 1992), l’actrice dialogue avec des étudiants de l’université de Bouzareah, près d’Alger. Elle leur dit son bonheur de voir en eux les militants d’une démocratie naissante.
Elle rencontre Ali Yahia Abdennour (1921 – 2021), président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme, et des militants de cette organisation indépendante du pouvoir algérien. C’est notre droit de nous ingérer dans vos affaires pour vous soutenir, leur déclare-t-elle. Patrick Aeberhard se souvient aujourd’hui d’une situation difficile à appréhender : Nous nous trouvions face à une révolte estudiantine contre le gouvernement qui était telle qu’on pensait à Mai 68.
Mohammed Chérif Adjani est mort en 1983, cinq ans plus tôt. Le voyage de sa fille a une valeur initiatique. Il ne possède pas les saveurs du passé, ne témoigne pas de la douceur du souvenir, mais il scelle les retrouvailles d’une femme avec son histoire, écrite en lettres de sang, qui la propulse dans le présent, les yeux bien ouverts. Le sentimentalisme, c’est avant, ou après, assène l’actrice aujourd’hui.
De ce voyage, Adjani tire un long récit publié dans le mensuel Actuel en février 1989, quelques jours à peine avant la cérémonie des Césars. Le titre est clair : Adjani enquête sur les droits de l’homme en Algérie. Le long chapô, écrit par l’actrice, est encore plus limpide : À Alger, je me suis trouvée en face de gens beaux et d’histoires horribles. J’en ai vu des dizaines. On m’a emmenée partout. Que voulez-vous, c’est la chance monstrueuse de s’appeler Isabelle Adjani. Les gens veulent voir comment vous êtes et ils veulent se raconter. À Paris, c’est souvent fatigant. À Alger après les événements tragiques que l’on sait, c’est bouleversant. Cela devient une responsabilité que je veux assumer.
Dans Actuel, on apprend qu’Adjani a pu se rendre clandestinement dans les hôpitaux algérois Mustapha-Pacha et Saint-Bernard pour y rencontrer des victimes de la répression sanglante du 5 octobre 1988. Les infirmiers la laissent entrer avec réticence, mais, quand elle veut pousser la porte du service de traumatologie, elle se voit opposer un refus martial. L’actrice rend visite au chanteur, musicien et poète Lounès Matoub – Kabyle comme son père. Ce militant de la cause berbère, combattant pour la démocratie et la laïcité en Algérie, est hospitalisé après avoir été atteint de cinq balles par un gendarme lors d’une manifestation appelant la population à une grève générale. Le lien tissé par l’actrice avec le musicien et sa famille restera vivace, jusqu’à son assassinat près de son village natal, en 1998 – attribué au Groupe islamique armé, et dont la responsabilité pourrait s’étendre bien au-delà de cette organisation terroriste.
Une autre rencontre marque Patrick Aeberhard : Adjani face à d’anciennes résistantes du Front de libération nationale, devenues des opposantes résolues aux dirigeants algériens. L’actrice découvre dans le quotidien Ech-Chaab (le peuple) que l’avocat des droits de l’homme lui servant de guide, Ali Yahia Abdennour, serait un complice des sionistes qui importent des putains. Discréditer est un classique des dictatures. À Alger ou ailleurs, hier comme aujourd’hui, sioniste est cette insulte utilisée pour camoufler son antisémitisme, faire diversion, cacher ses propres maux.
André Glucksmann, alerté par des opposants algériens réfugiés en France, avait demandé à Adjani de porter attention à l’essor du mouvement islamiste à Alger. Durant son voyage, l’actrice croise bien quelques personnes radicalisées, mais dans des actions de charité, pour donner à manger aux pauvres, s’occuper des enfants ou administrer un club de football. Quatre ans plus tard commencera la décennie noire (1992 – 2002), ces années où les islamistes et l’armée s’affronteront dans une violence inouïe – le conflit fera 150 000 morts et plus de 10 000 disparus.

Isabelle Adjani rend visite au chanteur kabyle Lounès Matoub, blessé lors d’une manifestation, à l’hôpital de Bab El-Oued, dans la région d’Alger, le 2 novembre 1988. Jean-Louis Bersuder/SIPA
L’Adjani qui rentre d’Alger n’est plus la même. Lorsqu’elle apprend, début 1989, qu’une fatwa a été lancée contre Salman Rushdie, c’est décidé : elle parlera pour lui à la tribune des Césars – si elle obtient la récompense. Camille Claudel m’a permis de pousser un cri après les neuf mois de douleur que la rumeur du sida m’avait infligés. La moindre des choses était de relayer ce cri pour un homme qui, lui-même, était condamné au mutisme.
Le 3 mars 1989, veille de la cérémonie des Césars, Michèle Halberstadt, rédactrice en chef de Première, dîne avec Adjani. L’actrice ouvre le coffre de sa voiture pour lui montrer son habit de soirée, une robe orientalisante irisée prêtée par la maison Yves Saint Laurent, rehaussée d’une étoffe ornée d’un collier de perles rosées. Elle confie à la journaliste : Si je gagne, je sais exactement ce que je vais dire. Huit ans plus tôt, en 1981, au Festival de Cannes, l’actrice avait reçu le prix d’interprétation féminine pour Quartet, de James Ivory, et Possession, d’Andrzej Zulawski. Deux films pour un prix, c’est inédit. À presque 26 ans, elle devient une star mondiale, entre dans une autre dimension. Mais elle était si peu préparée à ce triomphe qu’elle n’avait pas de robe pour la cérémonie. Elle en avait emprunté une en urgence à l’actrice canadienne Francine Racette, épouse de Donald Sutherland.
Si une récompense cannoise tolère un certain niveau d’improvisation, la perspective d’un grand oral, un soir de Césars, où une actrice tout aussi algérienne qu’allemande et française, encore guère reconnue pour ses engagements politiques, décide de parler de Salman Rushdie, se prépare avec minutie. Elle a écrit son texte et elle en était fière, se souvient Michèle Halberstadt. Elle avait préparé son coup et savait que c’était bien.Pour Karen Berreby, l’avocate de l’actrice, l’une des très rares à savoir ce que la comédienne trame pour les Césars, Isabelle ne pouvait pas ne pas agir. Une force la poussait. Elle était sereine et déterminée à la fois.
Le soir du samedi 4 mars, Adjani foule le tapis rouge du Théâtre de l’Empire, à Paris. Les photographes l’interpellent. Le protocole l’installe, en tant que nominée et habituée des lieux, au centre de la salle, au deuxième rang. Elle se trouve près de Simone Veil, ancienne ministre et députée européenne. Lorsque la comédienne Claudia Cardinale, sur scène avec Jean-Pierre Aumont, prononce le nom d’Adjani pour Camille Claudel, l’actrice est comme tremblante avant un examen, devenant ainsi la récipiendaire d’une quatrième statuette. Elle pose aussitôt le César sur le pupitre et déclare : J’ai envie de vous parler et j’ai peur de jurer avec le ton de la soirée. Mais j’ai envie de vous dire des choses tragiques, alors j’espère que vous m’excuserez.
Puis elle enchaîne, dans ce qui est une référence claire à Camille Claudel et une autre, plus masquée, à l’épisode de la rumeur : D’où vient une pareille férocité ? Vous qui connaissez mon attachement à mon art, vous devez savoir ce que j’ai dû souffrir ! Du rêve que fut ma vie, ceci est le cauchemar.Ces paroles sont celles de Camille Claudel, qu’elle prononce dans le film. Une artiste, ajoute-t-elle, qui a été trop vite exclue par les autres, tuée trop tôt et il est vrai que dans la condition de l’artiste il y a quelque chose d’extrême.
Adjani enchaîne par un trait d’union qui prend la salle à revers : Comme on croyait révolue l’exclusion de l’artiste et sa condamnation à mort, permettez-moi de vous lire quelques lignes d’un texte.À cet instant, se souvient Isabelle Adjani, la salle est pétrifiée. Je voyais les gens se figer. Le texte donc : Les anges sont faciles à calmer… Les êtres humains sont plus coriaces. Ils peuvent douter de tout, même de la preuve qu’ils ont sous les yeux. Les anges, eux, quand il s’agit de volonté, ils n’en ont pas beaucoup. Qu’est-ce que la volonté ? C’est de ne pas être d’accord, de ne pas se soumettre, s’opposer. Et cette conclusion : Salman Rushdie, écrivain, Versets sataniques.
Lorsque l’actrice retourne à son fauteuil, Simone Veil lui glisse dans le creux de l’oreille : C’était très brave. Isabelle Adjani est adoubée, admise dans le cénacle des femmes courageuses. Regardant la cérémonie devant sa télévision, la scénariste Danielle Thompson est surprise de recevoir un coup de fil de l’actrice sitôt la retransmission terminée. Il est d’usage que les gagnants et les nommés aux Césars se retrouvent pour un dîner au Fouquet’s, sur les Champs-Elysées. Adjani préfère passer la suite de la soirée chez son amie, en robe de soirée, César à la main. Je n’ai jamais été très attirée par ce type de fête, dit-elle. Je suis un peu asociale de ce côté-là.
Partie ensuite présenter Camille Claudel à Londres, Isabelle Adjani reçoit un message à son hôtel qui commence par : Bienvenue dans ce triste pays… Son auteur ? Daniel Day-Lewis. Le comédien britannique veut rencontrer cette star française qui a transformé la soirée des Césars en plaidoyer pour Salman Rushdie. La curiosité pour l’actrice du héros de My Left Foot (1989) puis de Gangs of New York (2002) se transformera en histoire d’amour, avec un enfant à la clé. Pour l’instant, Day-Lewis est le premier à lui donner des nouvelles de l’écrivain, qu’il connaît par les réseaux littéraires de son père, le poète et romancier Cecil Day-Lewis (1904 – 1972). Salman Rushdie deviendra un fil rouge dans l’histoire du couple franco-britannique.
Dans les années qui suivent la fatwa, Salman Rushdie vit dans la clandestinité la plus totale, pour en sortir, peu à peu, à la fin des années 1990. La rencontre entre Adjani et Rushdie, plusieurs fois envisagée et même planifiée, n’aura pourtant jamais lieu. J’ai reçu quelques messages de lui, note l’actrice. Mais, finalement, il n’était pas essentiel de le rencontrer. J’ai rencontré ce qu’il écrit. Cela me suffit.
En 1989, Salman Rushdie se trouve à la fois seul et très entouré. La solidarité en Occident est très forte chez les intellectuels et les écrivains. En revanche, dans le monde du spectacle, le geste théâtralisé d’Adjani devant des millions de téléspectateurs est unique. Aujourd’hui, en portant le regard sur les trente-cinq ans passés, c’est son engagement qui est atypique, croisant sa fidélité à Rushdie, la dénonciation des fondamentalismes et son aversion pour la dictature algérienne. Et puis ces combats, elle les mène seule. Celui qui a tout cristallisé, c’est Rushdie avec Les Versets sataniques. Depuis, l’islamisme est devenu le prosélytisme le plus monstrueux qui puisse exister. C’est devenu l’attribut de l’extrême droite d’en faire cas, ce qui est un comble. En Algérie, pareil, on me disait de ne pas faire attention à l’islamisme. Ce n’est rien, m’expliquait-on, et on a vu ce qui s’est passé…
L’actrice ne donnera pas plus suite aux propositions des présidents Chirac, en 2001, Nicolas Sarkozy, en 2007, François Hollande, en 2012, Emmanuel Macron, en 2018, de les accompagner en Algérie. Elle refusera également, au début des années 2000, de servir d’égérie pour le conglomérat dirigé par l’homme d’affaires algérien Abdelmoumen Rafik Khalifa. Elle s’écarte de stars françaises comme Gérard Depardieu ou Catherine Deneuve, qui ont tous deux accepté une rémunération de l’entrepreneur pour assister, en 2003, à Marseille, à un match de football entre l’OM et la sélection nationale algérienne. On les aurait invités en Thaïlande, soupire l’actrice, cela aurait été la même chose.
C’est aussi sur la durée qu’il faut examiner l’attitude d’Isabelle Adjani vis-à-vis de Salman Rushdie. Les années passant, l’élan de solidarité autour de l’écrivain s’étiole inexorablement. C’est peu de le dire. Rushdie agace ceux qui estiment qu’on ne doit pas insulter les religions et d’autres pour qui le vaste monde arabo-musulman n’a pas à être stigmatisé.
Il y a surtout la peur, qui tétanise les soutiens, notamment depuis l’attentat sanglant, en 2015, contre la rédaction de Charlie Hebdo. Adjani est une des rares à le reconnaître, qui déclare alors au Point, à propos de son intervention aux Césars : À moins de mettre volontairement ma tête sur le billot, je ne pourrais plus faire ce genre de provocation symbolique. Nous sommes condamnés à une forme de réserve, c’est un terrible aveu d’impuissance.
Mais, passé ce moment de fragilité, l’Adjani résolue est de retour. En 2018, Rushdie se trouve sur le plateau de La Grande Librairie pour la publication de son roman La Maison Golden (Actes Sud), qui suit l’ascension de Donald Trump. La comédienne adresse une lettre à l’écrivain, lue dans l’émission : « Cher Salman Rushdie, vous ne vous êtes jamais résigné au silence : depuis quelques décennies, dans les couloirs d’une mort annoncée, proférée, vociférée, vous continuez à écrire, malgré la fatwa, malgré les menaces. (…) Cher Salman, avec Les Versets sataniques vous avez ouvert nos yeux sur l’imminence du danger d’un règne de la terreur, mais nous n’avons pas voulu le regarder en face.
Quand on lui pose la question, elle concède qu’aujourd’hui il est effectivement plus dangereux d’afficher son soutien. Mais je n’allais pas l’ouvrir une fois aux Césars pour me taire ensuite. Pas question d’être là pour un moment et de m’absenter à un moment encore plus dramatique. Ce qui m’importe se passe de la crainte. Il fallait parler de Rushdie, surtout quand aucune personnalité du spectacle n’en parle. Comme aujourd’hui il faut parler de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, dont elle ne cesse de réclamer la libération. Isabelle Adjani est loin d’avoir dit son dernier mot.
Samuel Blumenfeld. Le Monde du 22 août 2025
7 03 1989
Le gouvernement polonais attribue à l’armée rouge le massacre de Katyn, en avril-mai 1940 : 15 000 tués.
12 03 1989
Robert Caillau, belge et Tim Berners-Lee, anglais, tous deux chercheurs au CERN de Genève ont développé la conception de l’hypertexte (analogue à la structure des encyclopédies, faite de multiples renvois) en créant les premiers codes informatiques qui donnent naissance au navigateur World Wide Web, appelé aussi Web, WWW ou W3, utilisable grâce à un feuilleteur (browser). Le Web prendra le dessus sur les autres logiciels avec la sortie du logiciel feuilleteur Mosaïc. Ce réseau de réseaux offre trois fonctions de base très simples : le courrier, le transfert de fichiers et la connexion à distances ; vers 1990, Peter Deutsch, de l’université Mc Gill à Montréal crée le premier catalogue de recherche dans Internet : Archie ; en 1991, sortie d’un autre logiciel de recherche : Gopher (petit rongeur des plaines de l’Amérique du Nord).
25 ans plus tard, en 2014, le Web sera utilisé quotidiennement par 2.7 milliards d’individus, soit 40 % de la population mondiale. Il existerait près d’un milliard de sites et 260 millions d’adresses internet. Les sites les plus visités en France : Google, Wikipédia, Orange et Leboncoin. Facebook se dit fort de 3 milliards d’amis dans le monde et Tweeter compte 300 millions d’utilisateurs actifs.
J’ai toujours voulu qu’il soit plus qu’un outil destiné aux scientifiques. Je voulais lier tout à tout. Depuis mon enfance, je pensais que les ordinateurs n’étaient pas bons pour faire des liens, contrairement au cerveau humain. Si vous avez une discussion dans un café et que vous y retournez cinq ans après, votre cerveau fera la connexion et vous vous souviendrez de la discussion. Je voulais construire quelque chose qui avait la propriété de lier n’importe quoi. Je ne m’attendais pas à ce qu’il soit utilisé pour tout lier ! Le point fort du Web, c’est qu’il est neutre, il a pu être utilisé pour poster des articles, des images, des vidéos, des données, des cartes… C’est pour cela que tout est en ligne désormais.
Tim Berners-Lee, au Monde en 2019
Moi, j’ai toujours rêvé d’une république de citoyens responsables, mais où est elle? Les géants du Web sont des impérialistes qu’on distingue à peine des États totalitaires, qui décident de ce qui est acceptable ou non, Le Web, c’est Facebook et du commercial, rien d’autre. Je ne veux plus y aller.
Robert Caillau, en 2018
En 1994, nous avions un rêve immense, qui était de connecter le monde. Ce rêve, on peut dire que, techniquement, nous l’avons réalisé. Mais nous avons aussi connecté la merde.
Ben Segal, 88 ans, ex-directeur de l’informatique de l’Organisation et mentor de Tim Berners-Lee.
Mais comment toutes ces grosses têtes ont-elles donc pu faire preuve d’une aussi ahurissante naïveté, sans deviner une seconde que ce faisant ils ouvraient la boite de Pandore et donnaient un micro à tous les frustrés, à tous les imbéciles, les incultes, qui se saoulent aujourd’hui d’être entendus, et trop souvent même craints. Cette adhésion au premier degré à l’idéologie de Jean Yanne : Le monde est beau, tout le monde il est gentil est consternante. Science sans conscience etc… Ce qui leur a manqué : pas une bonne guerre, que non, mais bien une bonne culture générale.
24 03 1989
L’Exxon Valdez s’échoue sur les récifs de Bligh Island, dans la baie du Prince Guillaume, au sud de l’Alaska : 180 000 tonnes de brut se répandent sur les côtes : Exxon paiera 2,2 milliards $ pour le nettoyage des côtes et 1,3 milliard $ en amendes civiles et pénales ou au titre d’accords à l’amiable. Mais les procès ne seront pas tous terminés dix ans plus tard.
26 03 1989
L’interdiction de fumer est mise en service sur les vols d’Air France. Mikhaïl Gorbatchev crée une nouvelle assemblée : le congrès des députés du peuple de l’Union soviétique. Boris Eltsine est élu, ainsi qu’Andreï Sakharov, parmi les 269 autres, député du Soviet suprême.
15 04 1989
Demi-finale de la coupe d’Angleterre de foot, Nottingham contre Liverpool. Six minutes après le coup d’envoi, un grand mouvement de foule se produit. Certains essaient d’escalader les grilles du stade, contre lesquelles ils sont bloqués, pour trouver un peu d’air. D’autres se hissent jusqu’à la tribune supérieure. La rencontre est arrêtée. Bilan : 96 morts et 766 blessés. Il faudra attendre 2012, 23 ans après les faits, pour que David Duckenfield, commissaire de la police du Yorkshire du Sud admette avoir menti quand il niait jusqu’alors avoir donné l’ordre d’ouverture d’une grille, principale cause du drame.
2 05 1989
Jusqu’à la fin de l’été, ce sont des milliers de Hongrois et d’Allemands de l’Est qui sont accueillis à bras ouverts par les Autrichiens. Le gouvernement hongrois avait tenu une conférence de presse à Hegyeshalom, le village frontière avec l’Autriche sur la route de Vienne à Budapest lors de laquelle le système d’alarme et de surveillance tout au long de la frontière avait été débranché. Auparavant, le gouvernement hongrois s’était assuré de la non-intervention de la Russie qui, tout comme la Hongrie, n’avait plus les moyens d’entreprendre les indispensables réparations de ce rideau de fer, pour qu’il reste opérationnel.
Les Autrichiens ont tout d’abord manifesté une incroyable sollicitude pour eux, multipliant les dons, et ils les accueillaient avec des pancartes en hongrois et en tchèque pour leur souhaiter la bienvenue.
Emil Brix, ambassadeur autrichien en Hongrie
Lors de la répression de l’insurrection de Budapest en 1956, l’Autriche, bien que neutre, avait accueilli 180 000 fugitifs hongrois, une décision à haut risque car il n’était pas évident que l’Armée rouge soviétique, qui n’avait quitté Vienne que depuis un an, s’arrêterait à la frontière.
Stéphane Karner, historien
Et il en avait été encore de même lors de la répression du Printemps de Prague, en accueillant 210 000 réfugiés tchèques.
05 1989
Le plus grand tunnel du monde – 15 km – est inauguré sous le Mont Mc Donald, au Canada.
15 05 1989
Mikhaïl Gorbachev commence une visite en Chine ; un journaliste lui demande son avis sur la muraille de Chine : Très bel ouvrage, dit-il, mais il y a déjà trop de murs entre les hommes. Le journaliste enchaîne : Voudriez-vous qu’on élimine celui de Berlin ? Gorbatchev répond, sérieusement : Pourquoi pas ?

Islande 10 octobre 1986
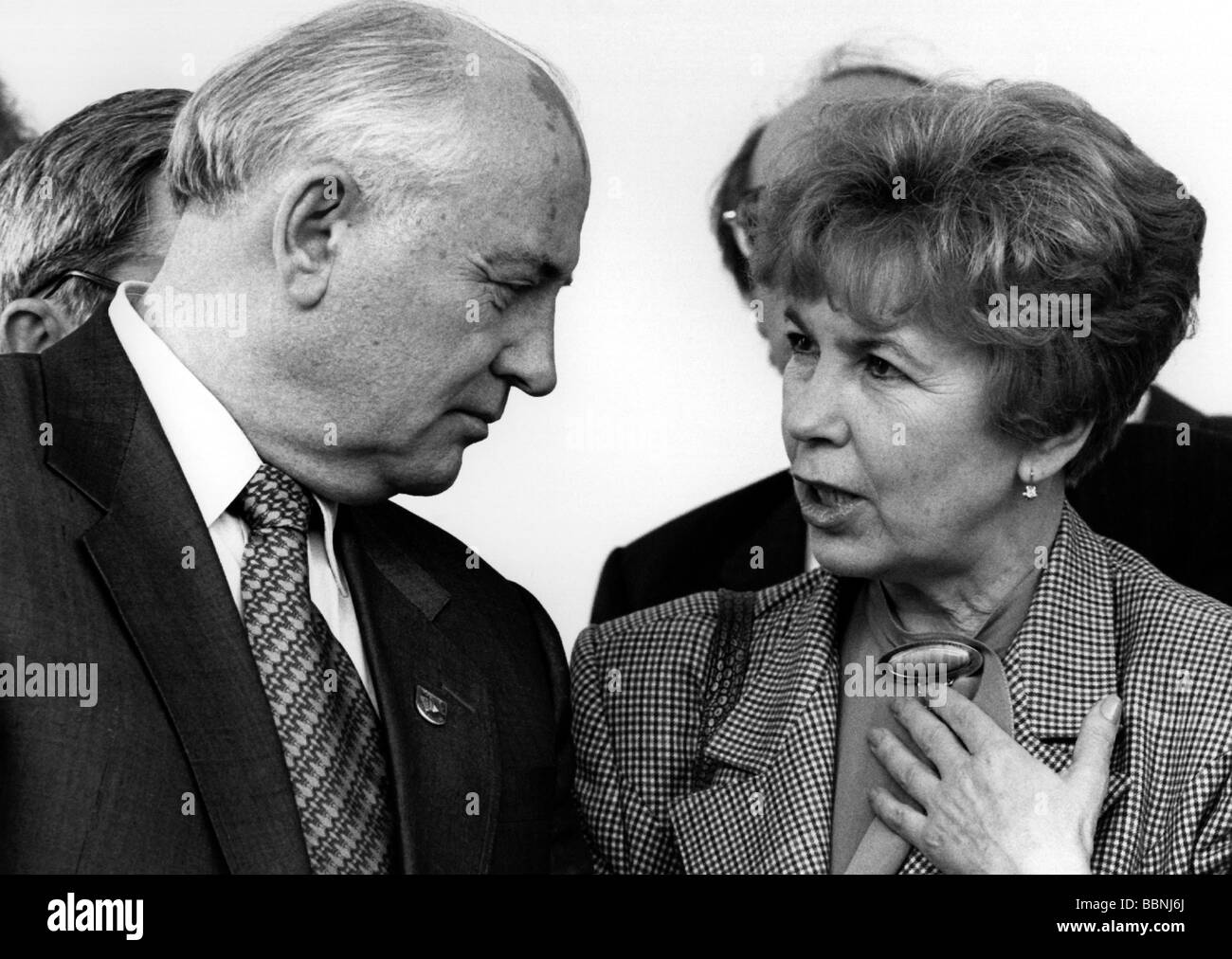
On a dit qu’elle me menait par le bout du nez ; en un sens c’est vrai… et c’est très bien comme ça. Une leucémie foudroyante l’emportera en 1999, à 67 ans. Son soleil éteint, Mikhaïl deviendra prisonnier de son chagrin. Elle avait fait entrer au Kremlin la moitié du monde qui l’avait jusque là ignorée : les femmes.
17 05 1989
Les interventions internationales font sortir Vaclav Havel de prison. Il lance une pétition, quelques phrases, qui rassemble plusieurs dizaines de milliers de signatures.
La montagne à vache peut réserver quelques mauvaises surprises et d’autres très bonnes : l’auteur de ce site, Laurent Peltier, fait le Tour du Mont Blanc. Pour ceux qui ne connaissant pas bien la montagne, il faut préciser que le Tour du Mont Blanc, c’est de la randonnée et que l’équipement nécessaire se limite à de bonne chaussures ; des bâtons aident bien les choses aussi. C’est affaire de huit à dix jours. On fait le tour du Massif du Mont Blanc, on n’est jamais dans le Massif, et donc on n’est jamais en haute montagne. Le plus haut des cols est à 2 671 m. Sur son versant italien, le Mont Blanc est encadré par deux vals, de part et d’autre de Courmayeur ; au sud-ouest, le Val Veni, au nord-est, le Val Ferret, lui-même entre le versant du Mont Blanc, dominé par l’aiguille du Géant et les Grandes Jorasses, et sur son versant sud, la Montagne de la Saxe. Sur cette montagne, le refuge Bertone. À Courmayeur, Laurent demande si le refuge est ouvert. Oui, lui dit-on. Donc, il y va. Il est nécessaire de préciser quelle est alors la situation en matière de balisage. En France, la FFRP a adopté depuis longtemps le balisage des sentiers de Grande Randonnée en rouge et blanc. Mais l’adoption de ces règles à l’international n’est pas chose rapide et il se trouve qu’en Italie, le rouge et le blanc sont encore utilisés pour marquer des accès aux coupes de bois. Et donc, ce qui devait arriver arriva : Laurent suit les balisages rouge et blanc et finit par se perdre… Plus de balisage. Que faire ? Redescendre au départ du sentier pour retrouver le bon : plus d’une heure de marche… trop loin… trop d’efforts. Donc, il continue vista de naso. Et cela l’emmène dans de très grandes pentes bien raides où alternent les grandes herbes et des dalles de rocher lisse en pente forte vers Courmayeur. En s’aidant souvent des mains qui agrippent les touffes d’herbe, il finit par arriver en vue du refuge où il trouve une vieille qui garde quelques chèvres. En s’approchant, la vieille ne le paraît pas tant que ça, avec des jambes d’une fille de vingt ans. On se salue. Évidemment, elle parle français. Ah, le refuge, il est fermé !
Laurent lui raconte ses mésaventures… et elle conclue : c’est curieux, il y a beaucoup de Français qui se perdent par ici ! Mais ne restez donc pas ici, vous allez prendre froid. Entrez. C’est mon fils qui tient le refuge et il n’est pas encore là. Moi, je fais la cuisine. Donc, vous ferez les comptes vous-même. Laurent s’adapte rapidement à la situation de ce refuge, ouvert dans le bas de la vallée, fermé officiellement en haut mais ouvert officieusement. Il prend un bon repas, passe une bonne nuit et le lendemain au petit-déjeuner : Vous payez en lires ou en argent français ? En argent français, si c’est possible. Attendez, je vais chercher la boite. Et elle apporte une boite métallique d’1 kg de sucre, pleine d’argent français : Tenez, mettez dedans ce que vous me devez et prenez votre monnaie. Sur un grazie mille qui ne disait pas combien il voulait en dire plus, Laurent s’en alla doucement, comme à regret… hésita… puis revint sur ses pas pour embrasser la vieille, en fléchissant le genoux pour se mettre à sa taille ; la vieille ne dit rien, songeuse : décidément, ces Français… attendit qu’il disparut derrière la première crête, haussa les épaules et s’en retourna à ses affaires et à ses chèvres.
À partir de 2003, le même parcours sera emprunté annuellement – on n’arrête pas le progrès, n’est-ce pas ? – par l’UTMB : l’Ultra Trail du Mont-Blanc. 171 km, plus de 10 000 m. de dénivelé positif. Les milliers de participants inscrits doivent boucler l’affaire en moins de 48 h. Le vainqueur, fait cela en 19 h. Le Tour du Mont Blanc en randonnée, c’est une rupture avec notre monde de vitesse, de stress, de compétition permanente, c’est l’adoption du pas du paysan, du berger ; l’UTMB, c’est l’esprit de compétition qui fait main basse sur un circuit d’où il aurait dû être banni… deux approches parfaitement antinomiques. Et l’UTMB, on ne peut pas vraiment dire que ça marche, puisqu’en fait, ça court plutôt. Quelques années plus tard encore, dans le même registre, mais en VTT arrivera la MB Race – course du Mont Blanc : 140 km, 7 000 de dénivelé, 450 bénévoles, 1 340 participants dont 260 terminent la course. Ah, le fun !

La Maxi Race, en 2019, autour du lac d’Annecy. Quand il n’y a de passage que pour un seul concurrent, il faut bien attendre … et, en attendant, on peut toujours réfléchir à l’insondable stupidité de tout ce cirque. On voit la même chose sur l’Everest, à quelques centaines de mètres du sommet.

Faut-il donc venir sur les flancs de la plus haute montagne du monde pour mesurer combien la société de consommation peut être absurde !

Camp de base de l’Everest, versant népalais. 5364 m.
Inès Benazzouz, plus connu sous son nom de scène Inoxtag, rappeur, sortira en 2024 Kaizen, le film tourné lord de son ascension de l’Everest, avec un succès phénoménal, sans craindre une seconde la contradiction qu’il y a à décrier les méfaits d’un surtourisme tout en y participant très activement. Mais les règles en vigueur dans le monde médiatique igorent cela superbement.
Le camp de base est devenu le plus grand merdier – au sens sale – du monde. Une honte. Pourtant, si les autorités népalaises avaient pris au départ les seules décisions efficaces, on n’en serait pas là : en même temps qu’elle percevaient les droits liés à l’autorisation de gravir ce sommet, elles auraient pu exiger le versement d’une importante caution, qui ne serait restituée au retour que sur accord d’un agent du gouvernement détaché sur ce camp de base le temps de la fenêtre d’ascension permise par la météo ; un garde-champêtre, en quelque sorte, avec un important pouvoir : Tu n’emportes pas tes déchets : j’encaisse la caution, ce qui me permettra de payer quelqu’un pour le faire. Salut.
4 06 1989
Li Peng mate les contestataires à Pékin, principalement étudiants : la photo du garçon, seul contre les chars près de la place Tian’ Anmen fera le tour du monde : la photo est du 5 juin, au lendemain d’une répression qui, selon la Croix-Rouge Chinoise, a dû faire entre 2 600 et 3 000 morts, lorsque, pour en finir, le pouvoir envoie les chars. C’en est bien fini du rêve d’une démocratie pluraliste qui avait pu naître avec l’arrivée au pouvoir de Deng Ziaoping
La journaliste venait d’apprendre la réalité du soulèvement de Tian’anmen, trente ans après les faits. Ce n’était pas deux cents étudiants qui avaient été tués lors des échauffourées avec les forces de l’ordre, ni mille comme les autorités chinoises l’avaient concédé plus tard sous la pression de l’opinion internationale : d’après le rapport britannique déclassifié qu’elle venait de dénicher sur internet, les chars avaient cerné dix mille jeunes réunis sur la place et les avaient massacré à tirs tendus, avant de passer les rescapés sous les chenilles des blindés, plusieurs allers-retours, jusqu’à ce qu’ils ne forment plus qu’une mélasse de chair humaine sur la place de Pékin. Les bulldozers avaient alors pelleté ce qu’il restait des étudiants pro-démocratie et jeté le tout dans les égouts de la ville, poussé à coups de jets d’eau et nettoyé jusqu’à ce qu’il ne reste plus aucune trace.
Caryl Férey. Paz. Série Noire Gallimard. nrf. 2019

Il se nommerait Wang Weilin, étudiant de 19 ans. Nul ne sait avec certitude ce qu’il adviendra de lui.
12 06 1989
Helmut Kohl reçoit Mikhaïl Gorbatchev à Bohn : Voyez ce fleuve [le Rhin] qui coule devant vous. Il va vers la mer. On pourra dresser tous les barrages que l’on voudra […] il continuera de couler vers la mer. Eh bien, c’est comme ça pour l’unité allemande.
Alors, poursuit le chancelier, Gorbatchev s’est mis à me parler pour la première fois des énormes problèmes d’approvisionnement qu’il rencontrait en URSS. Et il m’a demandé si l’Allemagne pouvait l’aider.
27 06 1989
À Sopronköhida, près de la ville hongroise de Sopron, le ministre des Affaires étrangères autrichien, Alois Mock et son homologue hongrois, Gyula Horn coupent le fil du rideau de fer pour marquer la décision hongroise de démanteler progressivement ce rideau de fer, au processus engagé le 2 mai 1989. Les organisateurs de l’événement avaient distribué des tracts pour célébrer l’occasion. Erich Honecker, dans un entretien avec le Daily Mirror, relate sa vision de l’histoire : Habsburg avait distribué des tracts jusqu’à la frontière polonaise invitant les vacanciers d’Allemagne de l’Est à participer à un piquenique. Quand ils sont arrivés, on leur a donné des cadeaux, de la nourriture, des deutschemarks avant de les inciter à rejoindre l’Ouest… Imra Pozgay relate avoir, de son côté, fait courir le bruit, dans les jours précédant la manifestation, que les Allemands de l’Est pourraient traverser la frontière sans être inquiétés.
30 06 1989
À l’ouest de l’Oural, 2 transsibériens se croisent : l’onde de choc fait exploser le gazoduc voisin : 600 morts.
13 07 1989
Inauguration de l’Opéra Bastille, dû au Canadien Carlos Ott : le jury de sélection faisait son choix sur maquette, les auteurs restant inconnus. La majorité se porta sur un projet où elle croyait avoir reconnu la patte de Richard Meier : erreur, c’était celle de Carlos Ott, complètement inconnu alors, sur le plan international. De 2014 à 2021, Stéphane Lissner dirigera les deux structures – Garnier et Bastille. Il sera longuement interviewé en Janvier 2021 par Télérama :
L’Opéra de Paris est le plus gros producteur d’opéra et de ballet au monde – trente sept spectacles dont dix-neuf créations en 2018-2019 -.
[…] L’Opéra national de Paris, composé de deux salles, Bastille et Garnier, compte 1 881 salariés dont quatre cents CDD. Or, malgré un taux de remplissage de 92 % et neuf cent mille spectateurs pour 2018-2019, les recettes plafonnent. Si les subventions stagnent, le coût de la masse salariale – 100 millions d’€ – augmente de 2% par an. Et, chaque année, je dois arbitrer des 10 à 13 millions d’€ de travaux d’entretien et de sécurité – il en faudrait 20 – sur les deux sites. Les frais de fonctionnement s’alourdissent constamment. Pourtant l’Opéra marche bien, le public suit. En témoignent ces chiffres: si les spectacles lyriques et chorégraphiques coûtent en production 40 millions par an, ils en rapportent 75 en billetterie ! la jauge pleine, de Bastille – deux mille sept cent places – permet des recettes de 350 000 € par soirée ; celle de Garnier, deux mille places, de 150 000 € avec un prix moyen de 100 € la place – et bien moins pour les jeunes de 28 ans, les moins de 40 ans et les familles.
[…] On y dirige deux salles aux histoires très différentes, et qui ne se fréquentent guère. Plutôt dévolu au ballet, Garnier est un vieux théâtre artisanal à l’italienne ; Bastille, une entreprise de spectacle dynamique de trente ans. À son ouverture, on a voulu y mettre les salariés les plus compétents. Le minimum aurait été de faire tourner les équipes dans les deux lieux pour mutualiser certaines tâches, faire coïncider certains horaires, mais surtout fonder un esprit commun. Il n’en a jamais été question. Et quand je suis arrivé, il était trop tard. Or, bien diriger deux théâtres – c’est à dire gérer le personnel tout en produisant et soutenant les artistes -, c’est trop pour un seul homme. C’était pure mégalomanie d’imaginer qu’on pouvait le faire ! On vit dans une maison, pas dans deux. Chaque théâtre est une aventure singulière. Le même soir, il peut y avoir la première d’un spectacle à Garnier et d’un autre à Bastille. J’ai été constamment frustré de ne pas donner assez de temps aux uns et aux autres. Surtout que mon cœur inclinait davantage à l’esprit théâtral plus familial, amical, vital, et chargé d’histoire. Comme à la Scala de Milan, mon plus beau souvenir de patron d’Opéra. On se sent à l’abri dans ces lieux-là. On y ressent que l’opéra, comme le théâtre, est avant tout une aventure humaine où des êtres humains s’investissent les uns à côté des autres pour faire spectacle.
Stéfane Lissner, directeur de l’Opéra de Paris, Interview de Télérama 3654 du 25 au 31 janvier 2020
En octobre 2020, lorsque les milliards dus à la crise de la Covid 19, se seront mis à tomber comme pluie à Gravelotte, Roselyne Bachelot, la nouvelle ministre de la Culture, fera preuve à l’égard de l’Opéra d’une exceptionnelle mansuétude en le cadeautant de 81 millions €, quand le Louvre par exemple n’en aura que 40 etc… Eh, c’est comme ça, quand on est accro à l’Opéra ! Quand l’honnêteté a affaire à la passion, elle est est bien rarement gagnante. Qui plus est, il vaut mieux avoir jeté la rancune à la rivière, face à des syndicats qui n’auront pas hésité à déclencher une grève le samedi 21 décembre 2020, une demi-heure avant une représentation, face à une salle déjà pleine ! grève qui va durer un mois et demi ! Le statut spécial du personnel de l’opéra qui leur donne accès à une retraite pleine à 42 ans, remonte à 1698 !
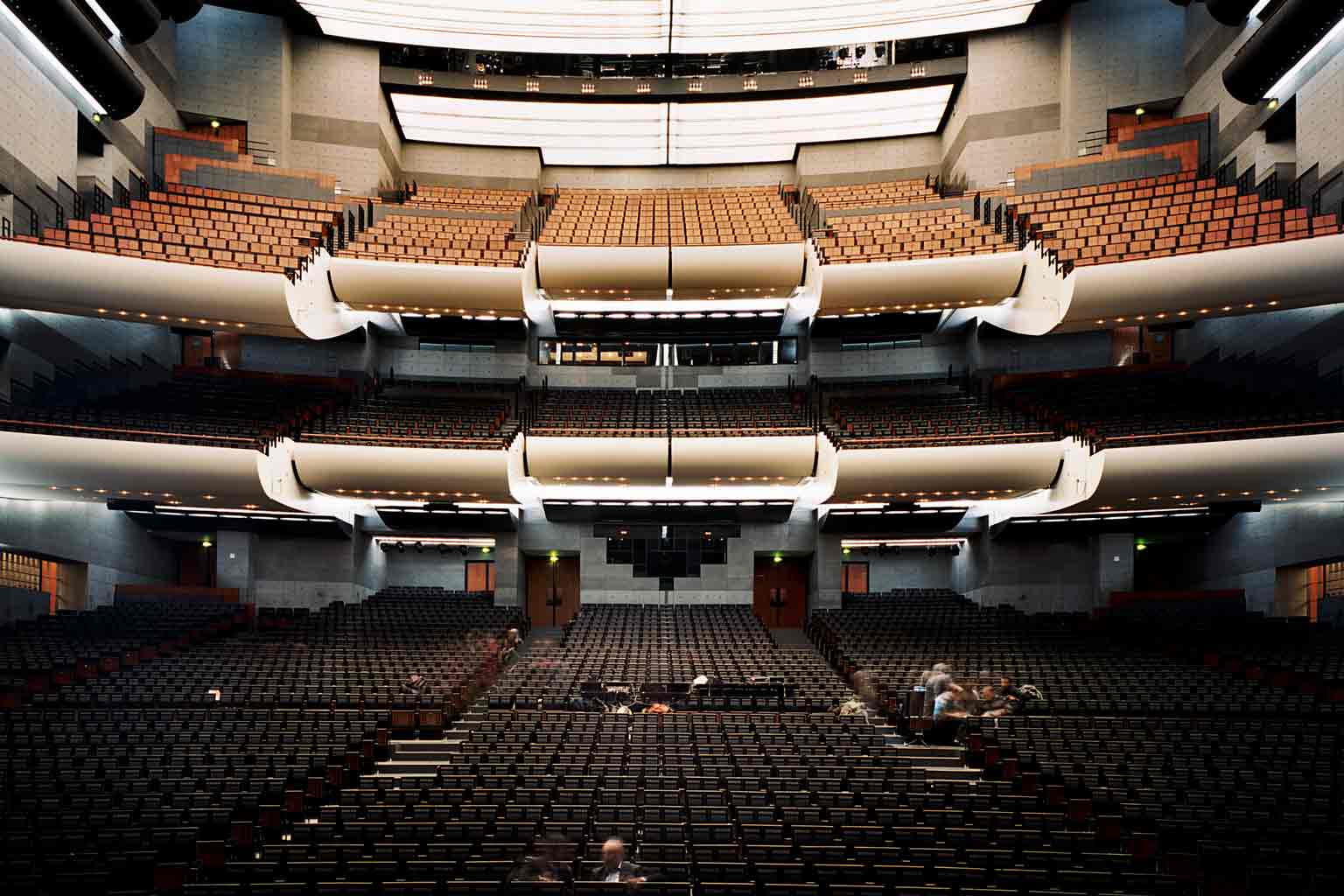
![]()
14 07 1989
Fêtes du Bicentenaire de la Révolution Française. Deux jours plus tard, 22 des plus grands voiliers du monde descendront la Seine.
19 08 1989
Walburga Habsburg Douglas, secrétaire de l’Union paneuropéenne internationale de Otto de Habsbourg Lorraine et la République hongroise représentée par Imre Pozsgay, se retrouvent à Sopronköhida, près de la ville hongroise de Sopron et coupent le fil de fer barbelé du rideau de fer – coupez et prenez – pour une durée de trois heures, ce qui permet à 600 allemands de l’Est, en vacances en Hongrie, de passer la frontière : c’est le pique-nique paneuropéen.
Helmut Kohl dira plus tard : C’est en Hongrie qu’a été enlevée la première pierre du rideau de fer.

Dirk Eisermann. Laif/Rea.
23 08 1989
Un tiers de la population balte – à peu près deux millions – forme une chaîne humaine de 687 km à travers les trois pays, entre les trois capitales, Tallinn, Riga et Vilnius, revendiquant ainsi l’indépendance vis-à-vis de l’URSS.


et il en est ainsi sur 687 km !
24 08 1989
Tadeus Mazowiecki devient le 1° premier ministre non communiste de Pologne.
29 08 1989
La sonde américaine Voyager II se trouve à 4,4 milliards de km de la Terre, à 6,72 milliards de km au-delà de Neptune. Elle a parcouru 7,2 milliards de km depuis 1977, soit une vitesse de 68 500 km/h. Elle a croisé Jupiter en 1979, Saturne en 1981, Uranus en 1986, et Neptune en 1989, découvert 6 lunes autour de Neptune. Elle est en retard sur son programme de 1″4 /10°. Elle pèse 1 tonne et a coûté 6 milliards F, le centième du prix du programme Apollo. Avec Voyager I, elle a communiqué 80 000 clichés. Le contact sera perdu en 2014, mais le trajet a été calculé jusque vers le milieu du VIII° millénaire. Soyons clairs : il n’y a qu’un bon chien pour être aussi brave que ça…

Août 1989
La France interdit l’usage de FVO importées du Royaume Uni, sauf dérogation précise. En décembre, l’interdiction est étendue aux FVO irlandaises avant d’être levées pour ce pays en mars 1993. Mais d’autres pays européens continuent à autoriser les importations britanniques jusqu’à la fin de 1990.
14 09 1989
Frédéric de Klerk arrive au pouvoir en Afrique du Sud.
19 09 1989
Un DC 10 d’UTA, vol UT 772 Brazzaville-Paris Charles de Gaulle, via N’Djamena, explose au-dessus du Sahara : 171 morts : l’affaire est à mettre au compte des services secrets libyens : 6 responsables seront jugés en 1998, par contumace, la Libye ayant refusé de les livrer. Acceptant tout de même sa responsabilité, la Libye acceptera le principe de versement de 206 000 $ par victime : un passager d’un vol UTA vaudrait donc 50 fois moins qu’un passager de la PANAM. (10 millions de $ proposés aux parents des victimes de l’attentat de Lockerbie).
Pierre Péan, faute de trouver un mobile solide à la patte libyenne dans cette affaire, donnera sa préférence à une autre thèse, en attribuant l’attentat à l’Iran en représailles d’une dette de 3 millions $ promise mais jamais payée au cheikh Zein, porte parole de la communauté chiite libanaise au Sénégal et qui aurait joué un rôle de premier plan dans la libération de ces otages.
Mais 11 ans plus tard, l’attentat de Ben Laden sur les Twin Towers amèneront Kadhafi à la révision de ses offres : Georges Bush, impuissant à capturer le n° 1 des terroristes, mettra fin à la dictature de Saddam Hussein en Irak et Kadhafi se mettra à craindre d’être le suivant sur la liste… il va mettre à jour ses offres et proposera 1 million de $, négociés côté français par Guillaume Denoit de Saint Marc, dont le père était mort dans l’avion, à chacune des familles des victimes de l’attentat, organisé par son beau-frère Abdallah Senoussi, qui rencontrera en 2005 Claude Guéant et Brice Hortefeux. Les relations seront ainsi apaisées et Chirac, président de la République pourra se fendre d’une visite officielle en novembre 2004.
Maryvonne Raveneau, veuve de Georges Raveneau, le commandant de bord, sera la seule des parents des morts à refuser le million $ donné à chacun en échange de l’omission du terme attentat : effacer le mot attentat et s’engager à se taire, c’était faire passer ça pour un accident. Et cela lui laisse la possibilité de se constituer partie civile dans d’autres éventuels procès relatifs à cet attentat. Les relations avec les journaliste seront bonnes, parfois très bonnes, celles avec les plus hautes autorités de l’État inexistantes puisque ses nombreux courriers à l’Élysée, quel qu’en soit l’occupant resteront lettre morte.
22 09 1989
Inauguration de la plus grande écluse du monde : 500 m de long, 68 m de large, 17,75 m de profondeur : c’est à Zandviet, en Belgique.
25 09 1989
À Cap Canaveral, 448° et dernière fusée Atlas Centaure ; après les Américains ne lanceront plus que des navettes.
28 09 1989
6,4 M ha brûlent dans le Manitoba.
6 et 7 10 1989
À l’occasion des 40 ans de la RDA, la foule acclame l’homme fort de l’Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev et conspue ses propres dirigeants, au premier rang desquels, Erich Honecker, qui quittera le pouvoir le 18 octobre.
16 10 1989
La Hongrie est le 1° pays d’Europe de l’Est à demander son adhésion au Conseil de l’Europe.


Laisser un commentaire