| Publié par (l.peltier) le 15 octobre 2008 | En savoir plus |
2 03 1845
Première grève générale des ouvriers de l’arsenal de Toulon.
printemps 1845
Le vétéran – 59 ans – de l’Arctique, Sir John Franklin, prend le commandement d’une expédition pour à nouveau rechercher le passage du nord-ouest : ses deux navires, l‘Erebus et le Terror, ont déjà emmené James Ross en Antarctique, où il avait ainsi baptisé les deux volcans découverts. L’équipage comptait 138 membres rompus à la navigation polaire, Franklin commande l’Erebus et Francis Crozier le Terror. Le 27 juillet 1845, Franklin arrive au détroit de Lancaster où il rencontre deux baleiniers, qui seront les derniers à l’avoir vu. Il avait 4 ans de vivres, et pouvait compter tenir 5 ans grâce à la chasse, mais on avait commis une grave erreur de logistique : l’impasse avait été faite sur un rendez-vous annuel, indispensable même si ce n’est que pour information, à la limite de la zone normalement fréquentée par les navires. En 1847, l’absence de nouvelles met en branle la fine fleur de l’amirauté, et ce ne sont pas moins de 30 expéditions, coûtant 20 millions de livres, qui seront formées pour savoir ce qui s’est passé, pendant près de 15 ans. James Ross, flirtant avec la soixantaine, hivernait en 1848-1849 dans le détroit de Barrow : il mit tout en œuvre pour informer Franklin : largage de barils contenant des messages, coups de canon, renards capturés puis relâchés munis d’un collier gravé, cairns, fusées, le tout en vain. L’Amirauté offrit une prime de 20 000 livres à qui retrouverait sir John.
En 1850, le baleinier Penny partit pour le détroit de Barrow à bord du Sophia et du Lady Franklin. Ommaney, son lieutenant, trouva les premiers indices sur l’île Beechey, à la pointe sud-est de Devon : des caisses de vivres avaient été abandonnées, des huttes construites, un potager aménagé et trois tombes pour les premiers morts : John Torrington, William Braine et John Hartnell. Mais, inexplicablement, aucun message n’avait été laissé [1]. Le 27 août 1850, Elisha Kent Kane, à bord d’un navire de secours, la première expédition Grinnel, vit aussi les trois tombes et en rapporta une aquarelle. En mai 1851, le capitaine William Kennedy repartait avec son Prince Albert, embarquant un jeune enseigne de vaisseau, français, Joseph René Bellot, qui se noiera en 1854 au large du cap Bowden, à l’ouest de l’île Devon. J’ai rencontré son égal, jamais son supérieur, dira de lui Sabine, un explorateur anglais. Ils ne trouvèrent rien. En 1852, l’Enterprise, commandé par Richard Collison, venu de Behring, hibernera dans le golfe de la Reine Maud, à proximité de l’hivernage de l’Erebus et du Terror en 1846-1847, recueillant chez les esquimaux quelques reliques et les rumeurs d’un naufrage. Le Dr Raë, qui voyageait pour le compte de la Hudson Bay Company, trouvera en 1854 de l’argenterie de Franklin et un reste de gilet de flanelle à ses initiales chez des eskimos de la rivière Back ; des témoignages des esquimaux des environs, interrogés par deux agents de la Compagnie, Stewart et Anderson en 1855 confirmèrent qu’un des deux navires aurait sombré près de la terre du Roi Guillaume, tandis que l’autre s’échouait. En 1859, Mac Clintock, géant irlandais, véritable inventeur de la logistique des raids en traîneau, financé par la veuve de Franklin, confirmera l’hypothèse. Le 8 mai 1859, il rencontre des Inuits en possession de reliques, qui lui confirment que des hommes sont morts le long de la rivière Back. Le 24 mai il trouve le cadavre de Des Vœux aux alentours du cap Hershell. Sur le chemin du retour, il découvre deux autres cadavres dans un canot-traîneau avec de la vaisselle deux fusils et leurs munitions et quelques maigres aliments. Son compagnon Hobson trouve au cap Félix, pointe sud de l’île Sommerset un abri léger et quelques vêtements. Le 6 mai, à la pointe Victory, il découvre enfin un cairn qui abrite une boîte en fer blanc dans laquelle un document traduit en six langues, déposé par les lieutenants Gore et Des Vœux, le 28 mai 1847 indique que tout allait bien à bord :
Les navires de Sa Majesté Erebus et Terror ont hiverné dans les glaces au point lat. 70°05′ nord par long. 98° 23′ ouest. Hiverné en 1845-1846 à l’île de Beechey, lat. 74° 43’28 » nord par long. 91° 51′, après avoir remonté la passe de Wellington jusqu’au 77° nord et descendu la côte de Cornwallis. Sir John commandant l’expédition, tout va bien. Déposé par un groupe de deux officiers et six hommes ayant quitté les navires lundi 24 mai 1847.
Dans les marges de l’imprimé, des indications avaient été reportées un an plus tard, d’une écriture différente : Les navires de Sa Majesté Terror et Erebus ont été abandonnés le 22 avril (1848) à 5 heures de ce point, étant prisonniers des glaces depuis le 12 septembre 1846. Officiers et équipages sous les ordres du capitaine de vaisseau F. R. M. Crozier, ont atterri ici par lat. 69°37’42 », long. 98° 41′. Sir John Franklin est mort le 11 juin 1847 et le total des décès s’élève à ce jour à neuf officiers et quinze hommes. Signé : James Fitzjames, commandant du H. M. S. Erebus, et Crozier d’ajouter : Départ demain 26 (avril 1848 ?) pour la rivière Back.
Rejoignant son yacht Fox après 25 jours d’absence, Mac Clintock en repartit le 5 avril 1859 et, au cap Victoria, d’autres esquimaux lui apprirent que vers la même époque un autre navire avait été brisé à la côte : il retrouvera des morceaux entiers du Terror, convertis en charpentes de cabanes. Le 8 mai, au cap Norton, une femme eskimo, lui dira que le lieu du naufrage était à cinq journées de marche au nord, dont une sur la glace ; les hommes, en marchant au sud, vers la rivière du Gros Poisson – la rivière Back -, tombaient et mouraient en marchant.
En 1923, Rasmussen recueillit dans la région l’histoire suivante : deux frères chasseurs de phoque avaient trouvé au large un navire bloqué et abandonné ; ils montèrent à bord, prirent les fusils qu’ils voulaient transformer en harpon, récupérèrent cordes et toiles dont ils connaissaient l’usage. Puis ils se risquèrent dans le navire. Ils y trouvèrent beaucoup d’hommes morts dans leur couchette ; puis ils descendirent dans un grand espace qui occupait le fond du bateau ; mais il faisait très sombre et ils voulurent ouvrir à coups de hache une fenêtre pour éclairer les lieux, trou par lequel l’eau se mit à pénétrer, et bientôt l’Erebus emporta par le fond ses cadavres et ses secrets. En 1981, des scientifiques décèleront des concentrations anormales de plomb dans le sang d’un marin : les boites de conserve étaient alors fermées par une soudure au plomb. Enfin, le 7 septembre 2014, après 6 campagnes majeures du National Parcs Canada, on retrouvera une épave, plus probablement l’Erebus que le Terror, qui aurait été cannibalisé, dans le détroit de Victoria, au large de l’île du Roi Guillaume, près du village Inuit de Cambridge Bay, sur le territoire Nunavut.

Paul Émile Victor s’étonne vivement de l’absence quasi totale, si singulière, de documents, quand les explorateurs guettés par la mort se sont révélés généralement prolixes. Mac Clintock aurait-il reçu une consigne de silence ?
L’épave de l’Erebus sera retrouvée en 2014, celle du Terror en 2016 :
Surpris par le froid, les 129 marins présents sont restés coincés un an et demi dans les glaces avant de mourir de faim, de froid et de saturnisme. Les circonstances de la plus grande tragédie de l’exploration arctique, qui a fait l’objet d’une série télévisée américaine The Terror, sont restées floues depuis. Le premier navire, le HMS Erebus, a été retrouvé en 2014 dans la même zone. Les images prises par les plongeurs et le robot submersible téléguidé de l’agence Parcs Canada révèlent des artefacts intacts de la vie sur le navire. L’épave a été retrouvée en 2016 à 24 mètres de profondeur au large de l’île King William, dans le passage du Nord-Ouest, à l’est de Cambridge Bay dans le territoire du Nunavut.
Nous avions l’impression, en explorant le HMS Terror, qu’il s’agissait d’un navire récemment abandonné par son équipage, semblant avoir échappé au passage du temps, a expliqué dans un communiqué Ryan Harris, directeur du projet archéologique et pilote du véhicule utilisé pour les fouilles.
Au cours de 48 plongées, dont sept avec le robot, dans une eau qui avoisinait le 0 °C ou moins, l’équipe a obtenu des images de plus de 90 % du pont inférieur du bateau. Le navire a été retrouvé posé droit sur sa quille au fond de la mer, l’hélice toujours en place, l’ancre levée, et les fenêtres de toit non couvertes, ce qui suggère un abandon rapide, a remarqué Harris.
Les sédiments qui ont recouvert la chambre du capitaine Francis Crozier, ont permis la préservation de son bureau, dans lequel les chercheurs s’attendent à trouver des instruments scientifiques et des cartes.
Seuls les quartiers personnels du capitaine demeurent inaccessibles, en raison d’une porte close. Les chercheurs espèrent y trouver des documents écrits et scellés que l’eau froide et les sédiments pourraient avoir conservés. Les écrits pourraient éclaircir ce qui s’est passé, la chronologie des événements, quand les bateaux se sont séparés et comment ils sont arrivés là où ils ont été abandonnés, a expliqué M. Harris.
Le Terror et l’Erebus sont partis de Grande-Bretagne équipés d’une coque recouverte de fer pour la glace, de machines à vapeur et de provisions pour trois ans dans l’Arctique. Un bateau commandité par la veuve de Franklin, Lady Jane, a retrouvé en 1859 sur l’île King William un message qui a levé le voile sur une partie du mystère.
Selon celui-ci, l’explorateur et 23 membres de l’équipage sont morts, le 11 juin 1847, dans des circonstances inconnues. Le 22 avril 1848, 105 survivants auraient quitté les navires à pied pour rejoindre la terre ferme par la glace, toujours selon ce message. Aucun n’a survécu.
Les recherches archéologiques ont été menées en partenariat avec des organisations inuits, dont les témoignages oraux transmis de génération en génération ont permis de localiser les épaves. Les communautés de l’Arctique seront les premières à voir les artefacts du Terror, dont elles sont légalement les copropriétaires.
Ryan Harris et son équipe espèrent retourner continuer les recherches l’année prochaine, notamment pour explorer la cabine du capitaine Crozier. On ne sait jamais ce qu’on va trouver dans ce dernier espace inexploré.
Le Monde du 30 août 2019

Photo Ryan Harris AFP

Photo Ryan Harris AFP

Photo Ryan Harris AFP
C’est à un groupe de chercheurs issus de deux universités canadiennes que l’on doit la découverte en 2024 de l’identité de l’un des restes d’ossements ; c’est le fruit d’un important travail effectué sur l’ADN prélevé sur une molaire. Par comparaison avec le patrimoine génétique de certains de ses descendants, cette simple dent a permis d’établir que l’un des corps était effectivement celui de l’officier de marine et explorateur britannique : James Fitzjames. Second explorateur identifié après John Gregory, ingénieur à bord de l’Erebus, il a contribué à la rédaction du tout dernier message reçu de la part de ses participants. Celui-ci annonçait notamment la mort de John Franklin, le 11 juin 1847, ainsi que celle d’autres hommes. Le site où James Fitzjames et au moins une douzaine d’autres personnes ont péri a été localisé par des chercheurs dans les années 1860. Les vivres venant à manquer, il semblerait que les survivants aient peu à peu cédé à la tentation de se nourrir des corps de leurs camarades récemment décédés : certains os présentaient des traces de coupures artificielles, preuve qu’ils avaient été tranchés à dessein. Des traces de coupures sur sa mandibule peuvent laisser croire que James Fitzjames aurait lui aussi fait partie de ceux qui ont fini en partie mangés par leurs camarades.

James Fitzjames
27 04 1845
Première liaison télégraphique électrique entre Paris et Rouen.
05 1845
Chez les Flaubert, les voyages de noces se font en famille : sa sœur Caroline vient d’épouser Emile Hamard : Gustave et leurs parents les accompagnent en Italie ; au palais Balbi de Gênes, Gustave tombe en arrêt devant La Tentation de Saint Antoine du flamand Bruegel : c’est là que naît le projet de la pièce de théâtre éponyme qu’il publiera quatre ans plus tard.
08 1845
Théophile Gautier est de retour d’un voyage de six semaines en Algérie : il publiera l’année suivante Voyage pittoresque en Algérie.
[…] Le chameau est l’animal le plus étrange qu’on puisse imaginer. Il semble appartenir à quelques unes de ces créations disparues dont les géologues ont refait l’histoire. Sa construction, si bizarrement gauche dans sa difformité, indique les tâtonnements de la nature encore à ses premiers pas. La gibbosité de son dos, la longueur de son col, la soudure grossière de ses articulations qu’on croirait luxées, les calus qui les couronnent ont quelque chose de monstrueux et de ridicule, d’effrayant et de risible, on dirait une charge géologique modelée avec le limon primitif par quelque Dantan antédiluvien.
Il y en avait deux mêlés à un troupeau de ces malheureux petits ânes dont nous avons parlé. Ils étaient accroupis, tout chargés, dans le sable brûlant. Leurs jambes repliées formaient des sortes de moignons rugueux hideux à voir. Leurs flancs, goudronnés, luisaient sous le lacis de cordelettes et de bâtons destinés à retenir les ballots. L’un d’eux allongeait dans la poussière ce long cou fauve, qui rappelle celui de l’autruche et du vautour, et se termine par une petite tête aplatie comme celle d’un serpent, où brille entre de grands cils jaunes un œil de diamant noir, où se dessinent des nasaux velus et coupés avec une obliquité sardonique. L’autre, gravement rengorgé, brochait les babines et paraissait plongé dans les voluptés de la digestion. Il ruminait. Quelques touffes de poil roussâtre floconnaient aux environs de la bosse, et faisaient avec les parties basses un contraste qui donnait à l’honnête chameau une vague apparence de volaille à moitié plumée. Un Arabe, immobile sous le déluge de feu, attendait appuyé sur son bâton que les animaux fussent reposés pour se remettre en route : quelle rêverie occupait cet homme dans sa pose de statue ? À quoi pensait-il ? Nous aurions bien voulu le savoir : à rien sans doute ; car les Orientaux, disent ceux qui les connaissent, ont la faculté de rester des heures entières à l’état purement végétatif, enveloppés par l’air tiède comme par un bain et ne conservant de la vie que la respiration.
En continuant notre descente vers la mer du coté de Bab-Azoum, en dehors de la porte, nous rencontrâmes des haltes de caravanes, des campements et des hôtelleries arabes : c’est tout ce qu’on peut rêver de plus simple et de plus sauvage. Les hôtelleries sont des espèces de bouges creusés dans la déchirure d’un ravin, de caves déchaussées où l’on grimpe par des degrés chancelants et dont les rebords, suprême magnificence, sont plaqués de quelques poignées de crépi à la chaux ; un bout de tapis éraillé et troué à jour comme un crible, jeté sur une corde tendue en travers, un flambeau de sparterie qui s’effile ou s’échevèle, procurent aux voyageurs qui viennent de Biskara, de Touggourt ou de plus loin une ombre pailletée de points lumineux, qui leur parait fraîche encore après les intolérables ardeurs du Sahara. C’est là qu’ils déchirent avec les ongles le mouton rôti et qu’ils hument à petite gorgées la tasse de café trouble, accompagné de la pipe obligatoire.
Ces établissements somptueux sont réservés à l’aristocratie des voyageurs, aux négociants considérables. Le commun des martyrs se loge sous des cahutes de roseaux, sous une natte ou une couverture soutenue par deux piquets ; d’autres, moins sensuels encore, se contentent pour abri de l’ombre projetée par leur chameau ou leur cheval, et tout cela, bêtes et gens pêle-mêle, broute, mange, rumine et dort dans la plus fraternelle confusion.
Plus bas encore et de l’autre coté de la route, sous les arbres poudreux qui la bordent, fument des cuisines en plein vent, où de veilles négresses, à figure de strygges, à mamelles de harpies, accommodent le kouskoussou sacramentel. Les Biskris, les Mozabites et les Bédouins se régalent à qui mieux mieux de ces préparations primitives.
2 12 1845
Le docteur Parisot crée la Société Protectrice des Animaux. Il avait en tête de lutter contre la maltraitance des chevaux de trait, surtout à Paris, d’améliorer les conditions de transport des veaux venus de Normandie pour être abattus à Paris : toutes ces barbaries mettent sous nos yeux des tableaux offensants pour la décence publique, et elles nourrissent dans le cœur du peuple ce fond d’insolente et noire méchanceté qui le porte à nuire pour le seul plaisir de mal faire.
1845
Création des compagnies de chemin de fer du Nord, de l’Est, du Centre. Le vélo s’enrichit de pédales fixées sur les roues. Réunion d’artistes, modèles et écrivains à l’hôtel Pimodan pour fumer du haschisch… sous contrôle médical.
Les enfants naissent dans les choux, racontait-on aux enfants du temps où la sexualité était tabou et les gens éclairés tenaient cela pour stupidité, quand ce n’était en fait que dégénérescence d’une très vieille tradition, venue probablement des Romains, récupérée par notre Moyen Âge, et dissimulée sous le masque du grotesque pour résister à la toute puissance du christianisme : Lorsque le christianisme s’introduisit dans les campagnes de France, il n’y put vaincre le paganisme qu’en donnant droit de cité dans son culte à diverses cérémonies antiques pour lesquelles les paysans avaient un attachement invincible
George Sand. Promenade autour d’un village. Le Berry
On remonta à cheval et on revint très vite à Belair. Le repas fut splendide, et dura, entremêlé de danses et de chants, jusqu’à minuit. Les vieux ne quittèrent point la table pendant quatorze heures [Le mariage est la seule grande fête de la vie d’une paysanne. Il y a encore ce généreux amour-propre qui consiste à faire manger la subsistance d’une année dans les trois jours de la noce. G. Sand, Promenades autour d’un village, Le Berry, p. 151]
Le fossoyeur fit la cuisine et la fit fort bien. Il était renommé pour cela, et il quittait ses fourneaux pour venir danser et chanter entre chaque service. Il était épileptique pourtant, ce pauvre père Bontemps ! Qui s’en serait douté ? Il était frais, fort, et gai comme un jeune homme. Un jour nous le trouvâmes comme mort, tordu par son mal dans un fossé, à l’entrée de la nuit. Nous le rapportâmes chez nous dans une brouette, et nous passâmes la nuit à le soigner. Trois jours après il était de noce, chantait comme une grive et sautait comme un cabri, se trémoussant à l’ancienne mode. En sortant d’un mariage, il allait creuser une fosse et clouer une bière. Il s’en acquittait pieusement, et quoiqu’il n’y parût point ensuite à sa belle humeur, il en conservait une impression sinistre qui hâtait le retour de son accès.
Sa femme, paralytique, ne bougeait de sa chaise depuis vingt ans. Sa mère en a cent quatre, et vit encore. Mais lui, le pauvre homme, si gai, si bon, si amusant, il s’est tué l’an dernier en tombant de son grenier sur le pavé. Sans doute, il était en proie au fatal accès de son mal, et, comme d’habitude, il s’était caché dans le foin pour ne pas effrayer et affliger sa famille. Il termina ainsi, d’une manière tragique, une vie étrange comme lui-même, un mélange de choses lugubres et folles, terribles et riantes, au milieu desquelles son cœur était toujours resté bon et son caractère aimable.
Mais nous arrivons à la troisième journée des noces, qui est la plus curieuse, et qui s’est maintenue dans toute sa rigueur jusqu’à nos jours. Nous ne parlerons pas de la rôtie que l’on porte au lit nuptial; c’est un assez sot usage qui fait souffrir la pudeur de la mariée et tend à détruire celle des jeunes filles qui y assistent. D’ailleurs je crois que c’est un usage de toutes les provinces, et qui n’a chez nous rien de particulier.
De même que la cérémonie des livrées est le symbole de la prise de possession du cœur et du domicile de la mariée, celle du chou est le symbole de la fécondité de l’hymen. Après le déjeuner du lendemain de noces commence cette bizarre représentation d’origine gauloise, mais qui, en passant par le christianisme primitif est devenue peu à peu une sorte de mystère, ou de moralité bouffonne du moyen âge.
Deux garçons (les plus enjoués et les mieux disposés de la bande) disparaissent pendant le déjeuner, vont se costumer, et enfin reviennent escortés de la musique, des chiens, des enfants et des coups de pistolet. Ils représentent un couple de gueux, mari et femme, couverts des haillons les plus misérables.
Le mari est le plus sale des deux : c’est le vice qui l’a ainsi dégradé ; la femme n’est que malheureuse et avilie par les désordres de son époux.
Ils s’intitulent le jardinier et la jardinière, et se disent préposés à la garde et à la culture du chou sacré. Mais le mari porte diverses qualifications qui toutes ont un sens. On l’appelle indifféremment le peilloux, [le peilloux, parce qu’il est couvert de peilles, guenilles, en vieux français; Rabelais dit peilleroux et loqueteux quand il parle de mendiants. G. Sand, Promenades autour d’un village, Le Berry, p. 153], parce qu’il est coiffé d’une perruque de paille et de chanvre, et que, pour cacher sa nudité mal garantie par ses guenilles, il s’entoure les jambes et une partie du corps de paille. Il se fait aussi un gros ventre ou une bosse avec de la paille ou du foin cachés sous sa blouse. Enfin, le païen, ce qui est plus significatif encore, parce qu’il est censé, par son cynisme et ses débauches, résumer en lui l’antipode de toutes les vertus chrétiennes.
Il arrive, le visage barbouillé de suie et de lie de vin, quelquefois affublé d’un masque grotesque. Une mauvaise tasse de terre ébréchée, ou un vieux sabot, pendu à sa ceinture par une ficelle, lui sert à demander l’aumône du vin. Personne ne lui refuse, et il feint de boire, puis il répand le vin par terre, en signe de libation. À chaque pas, il tombe, il se roule dans la boue ; il affecte d’être en proie à l’ivresse la plus honteuse. Sa pauvre femme court après lui, le ramasse, appelle au secours, arrache les cheveux de chanvre qui sortent en mèches hérissées de sa cornette immonde, pleure sur l’abjection de son mari et lui fait des reproches pathétiques.
Malheureux ! lui dit-elle, vois où nous a réduits ta mauvaise conduite ! J’ai beau filer, travailler pour toi, raccommoder tes habits ! tu te déchires, tu te souilles sans cesse. Tu m’as mangé mon pauvre bien, nos six enfants sont sur la paille, nous vivons dans une étable avec les animaux ; nous voilà réduits à demander l’aumône, et encore tu es si laid, si dégoûtant, si méprisé, que bientôt on nous jettera le pain comme à des chiens. Hélas ! mes pauvres mondes (mes pauvres gens), ayez pitié de nous ! ayez pitié de moi ! Je n’ai pas mérité mon sort, et jamais femme n’a eu un mari plus malpropre et plus détestable. Aidez-moi à le ramasser, autrement les voitures l’écraseront comme un vieux tesson de bouteille, et je serai veuve, ce qui achèverait de me faire mourir de chagrin, quoique tout le monde dise que ce serait un grand bonheur pour moi.
Tel est le rôle de la jardinière et ses lamentations continuelles durant toute la pièce. Car c’est une véritable comédie libre, improvisée, jouée en plein air, sur les chemins, à travers champs, alimentée par tous les accidents fortuits qui se présentent, et à laquelle tout le monde prend part, gens de la noce et du dehors, hôtes des maisons et passants des chemins pendant trois ou quatre heures de la journée, ainsi qu’on va le voir. Le thème est invariable, mais on brode à l’infini sur ce thème, et c’est là qu’il faut voir l’instinct mimique, l’abondance d’idées bouffonnes, la faconde, l’esprit de répartie, et même l’éloquence naturelle de nos paysans.
Le rôle de la jardinière est ordinairement confié à un homme mince, imberbe et à teint frais, qui sait donner une grande vérité à son personnage, et jouer le désespoir burlesque avec assez de naturel pour qu’on en soit égayé et attristé en même temps comme d’un fait réel. Ces hommes maigres et imberbes ne sont pas rares dans nos campagnes, et, chose étrange, ce sont parfois les plus remarquables pour la force musculaire.
Après que le malheur de la femme est constaté, les jeunes gens de la noce l’engagent à laisser là son ivrogne de mari, et à se divertir avec eux. Ils lui offrent le bras et l’entraînent. Peu à peu elle s’abandonne, s’égaie et se met à courir, tantôt avec l’un, tantôt avec l’autre, prenant des allures dévergondées : nouvelle moralité, l’inconduite du mari provoque et amène celle de la femme.
Le païen se réveille alors de son ivresse, il cherche des yeux sa compagne, s’arme d’une corde et d’un bâton, et court après elle. On le fait courir, on se cache, on passe la femme de l’un à l’autre, on essaie de distraire et de tromper le jaloux. Ses amis s’efforcent de l’enivrer. Enfin il rejoint son infidèle et veut la battre. Ce qu’il y a de plus réel et de mieux observé dans cette parodie des misères de la vie conjugale, c’est que le jaloux ne s’attaque jamais à ceux qui lui enlèvent sa femme. Il est fort poli et prudent avec eux, il ne veut s’en prendre qu’à la coupable, parce qu’elle est censée ne pouvoir lui résister.
Mais au moment où il lève son bâton et apprête sa corde pour attacher la délinquante, tous les hommes de la noce s’interposent et se jettent entre les deux époux. Ne la battez pas ! ne battez jamais votre femme ! est la formule qui se répète à satiété dans ces scènes. On désarme le mari, on le force à pardonner, à embrasser sa femme, et bientôt il affecte de l’aimer plus que jamais. Il s’en va bras dessus, bras dessous avec elle, en chantant et en dansant, jusqu’à ce qu’un nouvel accès d’ivresse le fasse rouler par terre; et alors recommencent les lamentations de la femme, son découragement, ses égarements simulés, la jalousie du mari, l’intervention des voisins, et le raccommodement. Il y a dans tout cela un enseignement naïf, grossier même, qui sent fort son origine moyen âge, mais qui fait toujours impression, sinon sur les mariés, trop amoureux ou trop raisonnables aujourd’hui pour en avoir besoin, du moins sur les enfants et les adolescents. Le païen effraie et dégoûte tellement les jeunes filles, en courant après elles et en feignant de vouloir les embrasser, qu’elles fuient avec une émotion qui n’a rien de joué. Sa face barbouillée et son grand bâton (inoffensif pourtant) font jeter les hauts cris aux marmots. C’est de la comédie de mœurs à l’état le plus élémentaire, mais aussi le plus frappant.
Quand cette farce est bien mise en train, on se dispose à aller chercher le chou. On apporte une civière sur laquelle on place le païen armé d’une bêche, d’une corde et d’une grande corbeille. Quatre hommes vigoureux l’enlèvent sur leurs épaules. Sa femme le suit à pied, les anciens viennent en groupe après lui d’un air grave et pensif puis la noce marche par couples au pas réglé par la musique. Les coups de pistolet recommencent, les chiens hurlent plus que jamais à la vue du païen immonde, ainsi porté en triomphe. Les enfants l’encensent dérisoirement avec des sabots au bout d’une ficelle.
Mais pourquoi cette ovation à un personnage si repoussant ? On marche à la conquête du chou sacré, emblème de la fécondité matrimoniale, et c’est cet ivrogne abruti qui, seul, peut porter la main sur la plante symbolique. Sans doute il y a là un mystère antérieur au christianisme, et qui rappelle la fête des Saturnales, ou quelque bacchanale antique. Peut-être ce païen, qui est en même temps le jardinier par excellence, n’est-il rien moins que Priape en personne, le dieu des jardins et de la débauche, divinité qui dut être pourtant chaste et sérieuse dans son origine, comme le mystère de la reproduction, mais que la licence des mœurs et l’égarement des idées ont dégradée insensiblement. [G. Sand idéalise quelque peu ce dieu, fils de Dionysos et d’Aphrodite. Priape était en effet considéré comme la personnification de la virilité féconde et de l’amour dans l’expression de ses instincts physiques. Il symbolisait aussi la fertilité du sol, surtout au regard de la culture des jardins et de la vigne.]
Quoi qu’il en soit, la marche triomphale arrive au logis de la mariée et s’introduit dans son jardin. Là on choisit le plus beau chou, ce qui ne se fait pas vite, car les anciens tiennent conseil et discutent à perte de vue, chacun plaidant pour le chou qui lui paraît le plus convenable. [G. Sand décrit la même scène dans Promenades autour d’un village : Ce jour-là, les noceux quittent la maison avec les mariés et la musique ; on s’en va en cortège arracher dans quelque jardin le plus beau chou qu’on puisse trouver. Cette opération dure au moins une heure. Les anciens se forment en cortège autour des légumes soumis à la discussion qui précède le choix définitif : ils se font passer, de nez à nez, une immense paire de lunettes grotesques, ils se tiennent de longs discours, ils dissertent, ils consultent, ils se disent à l’oreille des paroles mystérieuses, ils se prennent le menton ou se grattent la tête comme pour méditer ; enfin ils jouent une sorte de comédie à laquelle doit se prêter quiconque a de l’esprit et de l’usage parmi les graves parents et invités de la noce.]
On va aux voix, et quand le choix est fixé, le jardinier attache sa corde autour de la tige, et s’éloigne autant que le permet l’étendue du jardin. La jardinière veille à ce que, dans sa chute, le légume sacré ne soit point endommagé. Les Plaisants de la noce, le chanvreur, le fossoyeur, le charpentier ou le sabotier (tous ceux enfin qui ne travaillent pas la terre, et qui, passant leur vie chez les autres, sont réputés avoir, et ont réellement plus d’esprit et de babil que les simples ouvriers agriculteurs), se rangent autour du chou. L’un ouvre une tranchée à la bêche, si profonde qu’on dirait qu’il s’agit d’abattre un chêne. L’autre met sur son nez une drogue en bois ou en carton qui simule une paire de lunettes [la drogue était une sorte de jeu usité parmi les soldats et qui se jouait avec des cartes. Dans ce jeu le perdant portait sur le nez un petit morceau de bois fendu pinçant le nez et dit drogue] : il fait l’office d’ingénieur, s’approche, s’éloigne, lève un plan, lorgne les travailleurs, tire des lignes, fait le pédant, s’écrie qu’on va tout gâter, fait abandonner et reprendre le travail selon sa fantaisie, et, le plus longuement, le plus ridiculement possible dirige la besogne. Ceci est-il une addition au formulaire antique de la cérémonie, en moquerie des théoriciens en général que le paysan coutumier méprise souverainement, ou en haine des arpenteurs qui règlent le cadastre et répartissent l’impôt, ou enfin des employés aux ponts et chaussées qui convertissent des communaux en routes, et font supprimer de vieux abus chers au paysan ? Tant il y a que ce personnage de la comédie s’appelle le géomètre, et qu’il fait son possible pour se rendre insupportable à ceux qui tiennent la pioche et la pelle.
Enfin, après un quart d’heure de difficultés et de mômeries, pour ne pas couper les racines du chou et le déplanter sans dommage, tandis que des pelletées de terre sont lancées au nez des assistants (tant pis pour qui ne se range pas assez vite ; fût-il évêque ou prince, il faut qu’il reçoive le baptême de la terre), le païen tire la corde, la païenne tend son tablier, et le chou tombe majestueusement aux vivat des spectateurs. Alors on apporte la corbeille, et le couple païen y plante le chou avec toutes sortes de soins et de précautions. On l’entoure de terre fraîche, on le soutient avec des baguettes et des liens, comme font les bouquetières des villes pour leurs splendides camélias en pot ; on pique des pommes rouges au bout des baguettes, des branches de thym, de sauge et de laurier tout autour ; on chamarre le tout de rubans et de banderoles ; on recharge le trophée sur la civière avec le païen, qui doit le maintenir en équilibre et le préserver d’accident, et enfin on sort du jardin en bon ordre et au pas de marche.
Mais là quand il s’agit de franchir la porte, de même que lorsque ensuite il s’agit d’entrer dans la cour de la maison du marié, un obstacle imaginaire s’oppose au passage. Les porteurs du fardeau trébuchent, poussent de grandes exclamations, reculent, avancent encore, et, comme repoussés par une force invincible, feignent de succomber sous le poids. Pendant cela, les assistants crient, excitent et calment l’attelage humain. Bellement, bellement, enfant ! Là, là, courage ! Prenez garde ! patience! Baissez-vous. La porte est trop basse ! Serrez-vous, elle est trop étroite ! un peu à gauche ; à droite à présent ! allons, du cœur, vous y êtes !
C’est ainsi que dans les années de récolte abondante, le char à bœufs, chargé outre mesure de fourrage ou de moissons, se trouve trop large ou trop haut pour entrer sous le porche de la grange. C’est ainsi qu’on crie après les robustes animaux pour les retenir ou les exciter, c’est ainsi qu’avec de l’adresse et de vigoureux efforts on fait passer la montagne des richesses, sans l’écrouler, sous l’arc de triomphe rustique. C’est surtout le dernier charroi, appelé la gerbaude, qui demande ces précautions, car c’est aussi une fête champêtre, et la dernière gerbe enlevée au dernier sillon est placée au sommet du char, ornée de rubans et de fleurs, de même que le front des bœufs et l’aiguillon du bouvier. Ainsi, l’entrée triomphale et pénible du chou dans la maison est un simulacre de la prospérité et de la fécondité qu’il représente.
Arrivé dans la cour du marié, le chou est enlevé et porté au plus haut de la maison ou de la grange. S’il est une cheminée, un pignon, un pigeonnier plus élevé que les autres faîtes, il faut, à tout risque porter ce fardeau au point culminant de l’habitation. Le païen l’accompagne jusque-là, le fixe, et l’arrose d’un grand broc de vin, tandis qu’une salve de coups de pistolet.
George Sand. La Mare au diable. 1845
Fille d’instituteur, institutrice elle-même, Eugénie Luce crée à Alger une école pour jeunes musulmanes : J’avais cette intime conviction que toutes nos tentatives de fusion civilisatrice resteraient sans effet, tant que nous ne pourrions faire pénétrer nos mœurs, nos habitudes, nos sentiments dans l’intérieur même de la famille. Mais comment atteindre ce but autrement que par l’éducation de la femme, pierre angulaire de la famille, destinée comme fille, comme épouse et comme mère à inspirer l’amour ou la haine du nom français ?
Je veux changer les mœurs, les préjugés, les habitudes indigènes, de la manière la plus rapide et la plus sûre, en initiant le plus grand nombre possible de jeunes musulmanes aux bienfaits d’une éducation européenne.
5 ans plus tard, au cœur de la casbah, son école accueille environ 130 jeunes musulmanes ; elle sert de modèle aux quatre écoles arabes-française dont la création est décidée par Napoléon III le 14 juillet 1850. À nos yeux du XXI° siècle, le propos semble outrageusement colonialiste, il n’empêche que la scolarisation se faisait en arabe, qu’étaient données des leçons sur le Coran et qu’on y respectait les fêtes religieuses musulmanes. Dix ans plus tard, sur la demande de notables musulmans, voyant d’un très mauvais œil cette éducation, mère de l’émancipation, une commission sera mise sur pied pour procéder à une inspection de l’établissement : on lui cherchera des poux dans la tête, et l’école fermera en 1861. Elle avait scolarisé 1 065 jeunes filles, dont 6 étaient devenues elles-mêmes sous- maîtresses.
En Irlande, la maladie noire de la pomme de terre – le mildiou : phylophtora infestans ou peronospora, venu d’Amérique du Sud – provoque une effroyable famine : 700 000 morts de 1846 à 1851, qui entraîne le début d’une émigration massive, surtout vers les États-Unis : 1.5 million, pour un pays qui en comptait au total 8.6 millions en 1841 ! En 1901, on ne comptera plus que 4.5 millions d’habitants et en 2017, le pays ne comptera encore que 6.8 millions d’habitants, chiffre inférieur à celui d’avant la grande famine ! On nommait coffin ships – les bateaux cercueils – les navires qui transportaient ces émigrés : 1847, l’année la plus noire, verra 100 000 migrants partir au Québec : plus de 16 000 d’entre eux mourront soit à bord des navires, soit à l’hôpital de Grosse-Île où ils étaient retenus en quarantaine. La différence de niveau de vie entre un sud paysan, majoritairement catholique et pauvre et un nord majoritairement protestant qui s’est déjà attelé à la révolution industrielle et est devenu riche ne va faire que s’accentuer.
Ne demandez pas aux Irlandais pourquoi leurs aïeux ont alors superbement dédaigné les immenses ressources alimentaires vivant dans les eaux très poissonneuses de leurs mers, langouste et homards compris, ils vous répondront probablement que ce n’est pas le sujet. Manger du poisson ? Plutôt crever !
Comment expliquer que, dans une période d’abondance, dans le pays le plus prospère de notre époque, un peuple meure de faim ?
Gladstone
Qu’un million de personnes soient mortes dans une nation qui comptait alors parmi les plus riches et les plus puissantes est toujours source de douleur quand nous nous le remémorons aujourd’hui. Ceux qui gouvernaient alors ont manqué à leurs devoirs.
Tony Blair, premier ministre. 1997
Il y avait plusieurs raisons à cette quasi monoculture de la pomme de terre : l’humidité et les sols acides du pays lui convenaient particulièrement bien. Très nutritive [elle ne manque que de vitamine A], ses forts rendements permettaient aux grands propriétaires – la noblesse possède 95 % des terres – de continuer à consacrer le maximum de surface à l’élevage, qui avait leur préférence. On arrivait à des consommations frôlant les 6 kg/personne/jour.
Tout le monde s’accordera sur la cause de la maladie : le mildiou, mais nombre d’Irlandais accuseront les Anglais d’avoir organisé la famine, en continuant à exporter des céréales d’Irlande durant la famine. C’était alors la naissance du libéralisme : nul ne peut subvenir aux besoins des autres. Le premier ministre Robert Peel mit tout de même en place des secours, qui se traduisirent essentiellement par des distributions de soupes populaires, (auxquelles il sera mis fin en décembre 1847), mais à peu près en même temps, l’Angleterre demande à l’Irlande de prendre à sa charge les secours, d’où augmentation de la fiscalité auprès des propriétaires, qui pour diminuer leurs charges, expulsent leurs locataires : 500 000 expulsions au total ! Pour maintenir l’ordre menacé, les Anglais doublent leur effectif militaire en Irlande : 15 000 soldats en 1843, 27 000 en 1847. Des dons affluent du monde entier, y compris des tribus d’Indiens d’Amérique. Des maisons du travail verront le jour : nourriture et logement contre un travail d’intérêt public : infrastructures routières, ponts, ports etc, qui se verront souvent contraintes de refuser du monde. L’anthropophagie réapparaîtra.
Certes le Tout Puissant nous a frappés du mildiou mais ce sont les Britanniques qui ont provoqué la famine.
John Mitchel. La dernière conquête de l’Irlande. 1860
La pomme de terre de Bretagne elle aussi est touchée, mais, avec une alimentation un peu plus diversifiée, les Bretons ne connaîtront pas pareil drame ; il y aura tout de même des distributions de pain.

au village de Skibbereen

Dublin. Mémorial de la grande famine -Un Gorta Mor -.
Massacres entre Druzes et Chrétiens maronites au Liban.
Deux hommes de la vallée de l’Ubaye, affluent de la rive gauche de la Durance, reviennent du Mexique, la sacoche emplie de 200 000 francs : c’est une fortune, et la nouvelle va à la vitesse d’une traînée de poudre : ainsi naquit un important courant d’émigration, celui des Barcelonnettes, improprement nommé, car en fait, il englobait non seulement les habitants de la vallée de Barcelonnette mais aussi ceux du pays basque, alors aussi nombreux à émigrer en Amérique Centrale ou du Sud.
L’affaire avait commencé en 1821, quand Arnaud, d’une filature à soie de Jausiers en mauvaise santé, était parti s’installer à la Nouvelle Orléans, où son premier client en draps et autres textiles était l’armée américaine. Il avait alors fait venir ses deux frères et les trois étaient partis à Mexico où ils avaient monté le Cajon de ropa de las siete Puertas, un magasin de détail de drap. Deux des trois hommes étaient revenus en 1845, fortune faite. Un an plus tôt, la vallée avait dû supporter deux grandes inondations, qui avaient provoqué le départ de dix hommes pour le Mexique. Alors, ceci ajouté à cela, prit naissance un mouvement d’émigration important de la vallée de l’Ubaye vers le Mexique, dont le maximum fût atteint dans les années 1880 et qui se prolongea jusque dans les années 1920, [le dernier départ eut lieu en 1955] enlevant au pays jusqu’à la moitié des hommes de quinze à trente ans : une véritable saignée démographique.
Il s’agit parfois de vraies démarches industrielles, nées d’une volonté opiniâtre de faire fortune, en s’appuyant sur la solidarité clanique et une endurance hors du commun au travail, le tout coexistant avec une honnêteté quasi héréditaire, dans un secteur d’activité toujours le même : le commerce de détail de textile : tissus communs pour vêtements et linge de corps. Et dans un pays qui depuis son indépendance en 1821, avait connu en l’espace de trente-trois ans, trente et un présidents effectifs, au lieu de neuf si les mandats de chacun n’avaient pas été interrompus par d’incessants pronunciamiento, dans un pays où pour gagner de l’argent on préférait enlever et rançonner ceux qui en avaient plutôt que travailler, ce sont là des vertus qui, parce que rares, sont plutôt bien payées.
Chacun partait avec, en poche, le nom d’un pays bien installé déjà à Mexico, qui le prenait en charge dès son arrivée, quitte à être payé pendant deux trois ans avec un lance-pierre ; mais la promotion finissait par arriver. Chaque vendeur était libre du prix de la pièce vendue au client, au-dessus du prix plancher fixé par le patron. Et là où aujourd’hui on pourrait penser que la fraude était la règle, ce n’était en fait que l’exception qui venait confirmer la règle : une honnêteté à toute épreuve.
C’est ainsi qu’au Mexique en 1864, on pouvait compter 45 commerces de textiles, employant 400 Barcelonnettes ; en 1890, ils seront 110.
Le 28 juin 1889 sera créée la CIDOSA – Compagnia Industrial de Orizaba Sociedad Anonima, qui construira en 1892 l’usine de Rio Blanco, qui emploiera jusqu’à 6 000 ouvriers ! On verra aussi une CIVSA – Compania Industrial Veracruzana Sociedad Anonima, à Santa Rosa -.
Voici ce qu’ont fait des paysans de la montagne qui mangeaient du pain de seigle et buvaient de l’eau claire.
Paul Reynaud, originaire de Barcelonnette
Pour ce qui est du pain de seigle, il n’est pas inutile de citer un petit historique du pain, à l’heure où les rouleaux d’acier se mirent à remplacer les meules d’antan : Au XVIII° siècle, le pain blanc, fait de farine dont on a pratiquement ôté tout le son, était considéré comme un symbole de privilège. Tout à fait ignorante des fondements scientifiques de telles choses, la population de l’Europe entière considérait le pain bis comme grossier et coloré. En 1800, le pain blanc, devenu partout disponible, apparaissait comme le symbole de l’égalitarisme, même s’il ne s’agissait en réalité que d’égalité face à un choix restreint. Partout en Europe, les armées napoléoniennes arboraient leur pain blanc comme un étendard de libération par rapport aux ternes pains de son ou de seigle. Le fait que ce pain ait conquis l’Angleterre prouve qu’il ne s’agissait pas seulement d’un legs de la gloire.
Ce goût universel pour le pain blanc précéda de près d’un siècle la mécanisation de la mouture. Partout en Europe et en Amérique du Nord, on continuait de moudre les céréales dans de petits moulins à eau ou à vent. On obtenait des farines plus fines par réglage de la meule. À l’époque, toutefois, la saleté, la transpiration et l’huile pénétraient même dans le pain le plus pur. En partie pour cette raison, ce nouveau pain semblait moins frais que ceux d’autrefois, et se conservait moins longtemps. Il y avait aussi d’autres problèmes. La demande de blé était sans précédent, et pas seulement à cause de la fabrication du pain : la poudre à cheveux, si populaire autour de 1800, était à base de blé, tout comme l’amidon, avec lequel on empesait les chemises blanches immaculées de l’ère victorienne. Dans presque tous les pays d’Europe, on tenta de persuader les pauvres de revenir au pain d’orge et de seigle. Mais même ces derniers dirent avoir perdu le goût du seigle. On tenta par ailleurs d’encourager la consommation de riz. En vain. Au début du XIX° siècle, des pénuries de blé provoquèrent partout des crises de panique, surtout en Grande-Bretagne où l’on importait régulièrement du blé depuis 1755, même si ce ne fut jamais à grande échelle. Cette appréhension ne disparut qu’à la fin du XIX°, quand la chute du coût des transports maritimes ou ferroviaires à longue distance permit à l’Europe d’importer du blé russe ou américain. Au XIX° siècle, ces deux géants politiques du XX° étaient déjà les greniers à blé de l’Europe.
L’introduction de rouleaux métalliques pour le broyage du blé avait commencé en Autriche-Hongrie dans les années 1840. Ce fut probablement la seule invention technologique de l’empire Habsbourg, mais ce n’est pas une innovation dont les Habsbourg puissent s’enorgueillir. Les rouleaux de fer (puis d’acier) assuraient une qualité constante à la farine. Ils s’entretenaient facilement. Le pain blanc ainsi produit était plus blanc que jamais car le rouleau d’acier échauffé chassait l’endosperme de son enveloppe. Il ne restait donc du germe qu’un minuscule flocon, qui partait du tamis avec le son. Même le pain noir fabriqué à la machine se conservait mieux, puisque son germe était tué lui aussi. Pendant plusieurs générations, cette farine eût donc la faveur des boulangers et des clients. Les fabricants de biscuits préféraient eux aussi un produit standard. Mais l’élimination du germe supprimait la véritable valeur nutritive du grain. Au fur et à mesure que les rouleaux de fer et d’acier se répandaient en Europe, supplantant l’emploi pluriséculaire de la meule de pierre, la qualité de l’alimentation déclinait : ceux qui dépendaient le plus du pain – les pauvres – furent les plus touchés.
En cette fin du XX° siècle, se dessine une réaction contre ces pains artificiels nocifs. Malgré tout, la plupart des pains de son actuels diffèrent, en général, du pain complet d’autrefois. La plupart des pains noirs européens sont faits de farine blanche à laquelle on ajoute du son (ou même de la mélasse) en guise de colorant ! La conséquence principale a été l’abandon du pain en tant qu’élément de base dans la plupart des pays riches. Aux États-Unis, par exemple, la consommation de céréales est passée de 136 kilogrammes par personne et par an à 60 environ.
Hugh Thomas. Histoire inachevée du monde. Robert Laffont 1986
La solidarité entre expatriés avait amené la création d’une Société de bienfaisance dès 1842, qui commença par ne concerner que les Français, puis s’étendra aux Suisses en 1848 et aux Belges en 1860 : distribution de secours aux nécessiteux, mutuelle pour l’indemnisation des malades, et Caisse d’épargne. La situation financière de ladite société passera de la bonne santé à l’opulence avec le legs de la fortune d’un richissime mexicain à cinq sociétés de bienfaisance, qui se partageront treize millions de francs.
Le développement économique l’époque, particulièrement important au Mexique, l’ouverture de nouvelles lignes maritimes permettant un approvisionnement en gros depuis la France entraînèrent le développement des affaires des Barcelonnettes, mais c’est surtout l’expédition militaire de Napoléon III au Mexique qui leur donna un gros coup de fouet : directement, l’armée française se fournit prioritairement chez eux, et la belle tenue vestimentaire du soldat français fût à l’origine d’un engouement pour le vêtement qui emballa les affaires.
Pareil État dans l’État ne pouvait tenir que face à des pouvoirs faibles ; mais à la veille de la première guerre mondiale, le président Caranza prendra ombrage de cette puissance et y mettra fin en 1917 : la puissance de l’Empire Barcelonnette était stoppée et alla en déclinant.
Les décisions d’un président sont une chose, la mémoire d’un peuple en est une autre : et c’est ainsi que l’on verra des Mexicains volontaires pour combattre aux côtés des Français lors de la première guerre mondiale, disant en quelque sorte : quand nous étions sans travail dans notre pays, vous nous en avez fourni ; nous venons aujourd’hui nous battre à vos côtés pour vous en remercier.
Ceux-là ignoraient tout de la lutte des classes, et auraient bien été capables de gifler celui qui aurait osé leur dire que tout patron est un salaud.
On peut voir une plaque à Barcelonnette : Aux citoyens mexicains morts pour la France pendant la Grande Guerre. Cette plaque a été offerte à la ville de Barcelonnette par la colonie française du Mexique. Sur cette plaque figurent onze noms, tandis qu’au pied du monument aux morts de Jausiers une plaque commémore aussi les héros mexicains morts pour la France.
De toute cette success story, on aurait pu attendre la création de grosses et solides sociétés de commerce comme les Anglais surent en bâtir en Inde à la même époque, ou encore le développement d’une industrie dans le pays d’origine, avec le retour de ces émigrés aux poches pleines, voire même les deux en même temps… En fait, rien de tout cela n’eut lieu : les Barcelonnettes étaient trop attachés à leur terre d’origine pour s’implanter durablement au Mexique, qui resta pour eux une simple possibilité d’enrichissement ; ceux qui n’étaient pas morts sur place, ceux qui n’avaient pas été vaincus par la vie, rentraient au pays – on estime à 10 % leur nombre, par rapport à cent partis – entre quarante et cinquante ans, souvent célibataires et s’y mariaient alors sans grand espoir de nombreuse descendance ; ils s’y faisaient surtout construire de grosses maisons bourgeoises que l’on voit plutôt d’habitude plutôt dans les quartiers huppés de nos grandes villes, que dans un pays de montagne comme Barcelonnette, et ils se faisaient enterrer dans des tombes très m’as-tu-vu, débordant de marbre de Carare. La solidarité n’était pas morte : les vieux parents pouvaient ainsi bénéficier d’une vieillesse confortable à l’abri du besoin, mais on ne connaît pratiquement pas de cas où l’argent gagné au loin ait été réinvesti dans l’agriculture, grande perdante de l’affaire.
Ainsi, à moins de deux cents kilomètres de distance à vol d’oiseau, l’industrialisation de la vallée de l’Arve à 500 mètres d’altitude dans un relief de circulation facile se réalisait lentement mais sûrement en milieu paysan, avec une fabrication au départ à la tâche dans chaque ferme, puis de plus en plus centralisée en usine avec l’arrivée de la fée électricité, mais sans apport important d’argent de l’émigration, quand, à Barcelonnette, à 1100 mètres d’altitude, dans une vallée éloignée des grands centres, de communication difficile, les embryons d’industrialisation (soierie à Jausiers) périclitaient et le retour des Mexicains enrichis n’entraînait aucun développement si ce n’est celui, momentané des entrepreneurs en bâtiment !
Autant les colporteurs et émigrés saisonniers qui avaient précédé aux XVII° et XVIII° siècles les Barcelonnettes, en allant vendre dans nos grandes villes, en France comme à l’étranger, les draps de laine et de serge fabriqués à la ferme avaient une activité parfaitement complémentaire de l’agriculture de montagne, évidemment en sommeil en hiver, et donc contribuaient ainsi au développement économique de leur vallée, autant l’enrichissement des Barcelonnettes ne resta qu’un épisode stérile de la vie de la vallée, contribuant plus à son appauvrissement par la déprise agricole qu’à son développement. Bien des fermes furent reprises par des Piémontais qui, eux non plus ne réinvestissaient pas sur place l’argent gagné.
La morale de cette histoire sera laissée à François Arnaud, notaire à Barcelonnette, qui a écrit le premier ouvrage sur la question, en 1891 : Les Barcelonnettes au Mexique. C’est une bonne sagesse domestique qui s’exprime, avec suffisamment de hauteur pour savoir que le cœur ne doit pas se laisser étouffer par l’argent : Mariez-vous jeunes, à l’âge où la nature le demande ; vous aurez des enfants robustes et vous les verrez grandir. Si l’un d’eux veut aller chercher fortune, ne le retenez pas, mais n’y poussez pas les autres ; gardez les auprès de vous. Faites en de bons citoyens, de bons républicains, de bons soldats.
Vous aurez les joies saines de la famille et ses fortifiantes douleurs aussi. La fièvre de l’or n’aura pas brûlé votre vie ; votre vieillesse sera plus heureuse au milieu de vos petits-enfants, et croyez bien qu’il ne faut pas tant d’argent pour vivre heureux et que, pour mourir, les deux bras d’une fille adorée et aimante sont un plus doux oreiller qu’un sac de piastres.

Las Fabricas de Francia à Guadalajara.

Usine SIGNORET à Santa Rosa , Veracruz

les propriétaires : Edouard Gassier, Alexandre Reynaud et Joseph Tron, en 1891



La « Ciudad de Mexico » à Puebla, 1895, lithographie
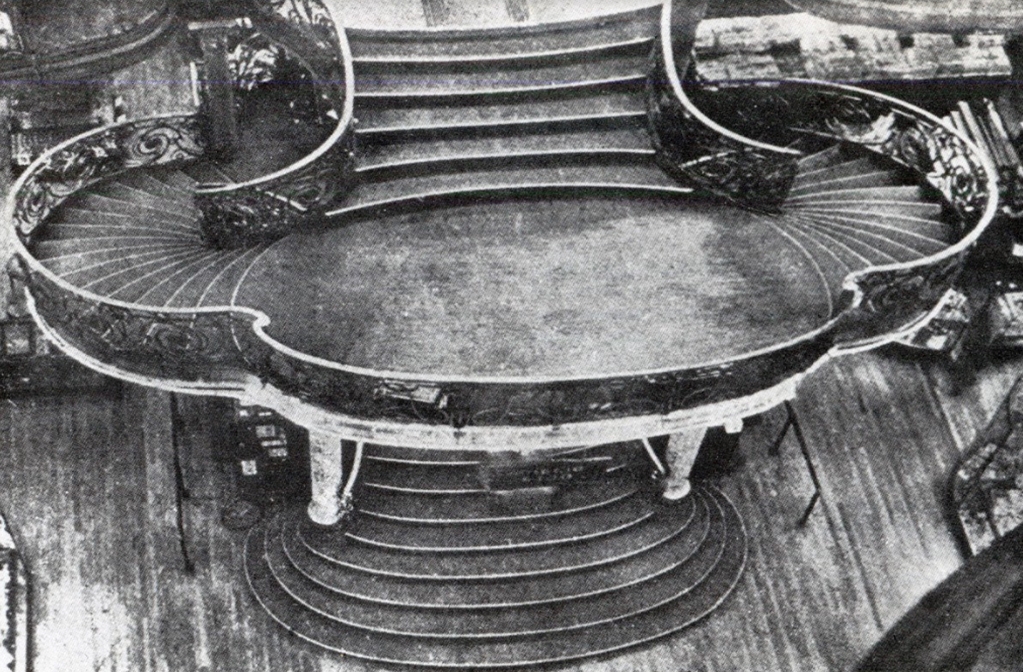
El centro mercantil, de Sébastien Robert, en 1896

Verrière zénithale du magasin « Centro Mercantil » à Mexico, par Jacques Gruber (détail), aujourd’hui Grand Hôtel de la Ciudad de Mexico

L’usine de Rio Blanco, inaugurée en 1892, est alors la plus grande fabrique textile du Mexique.
En Argentine, les volontés politiques de protectionnisme pour développer la production locale tournent court, mises en coupe réglée par la toute puissante Angleterre qui ne peut en aucun cas accepter une restriction quelconque à la liberté du commerce : Le gouvernement de Juan Manuel de Rosas avait édicté en 1835 un règlement douanier fortement protectionniste. La loi interdisait l’importation d’objets de fer et de fer-blanc, de harnachements, de ponchos, de ceinturons, d’écharpes de laine ou de coton, de paillasses, d’instruments agricoles, de roues de charrettes, de bougies et de peignes, et taxait très lourdement l’importation des voitures, des chaussures, de la passementerie, des vêtements, des harnais, des fruits secs et des boissons alcoolisées. La viande transportée sous pavillon argentin n’était pas frappée d’impôts, et l’on encourageait la bourrellerie nationale et la culture du tabac. Les effets se firent sentir sans attendre. Jusqu’à la bataille de Caseros, qui renversa Rosas en 1852, les goélettes et les bateaux qui naviguaient sur les fleuves étaient construits dans les chantiers de Corrientes et de Santa Fe, Buenos Aires comptait plus de cent fabriques prospères et tous les voyageurs reconnaissaient l’excellence des tissus et des chaussures de Côrdoba et de Tucumân, des cigarettes et des produits artisanaux de Salta, des vins et eaux-de-vie de Mendoza et de San Juan. L’ébénisterie de Tucumân exportait vers le Chili, la Bolivie et le Pérou. Dix ans après le vote de la loi, les bateaux de guerre anglais et français rompirent à coups de canon les chaînes barrant le Paranâ afin d’ouvrir la navigation sur les fleuves argentins que Rosas maintenait solidement fermés. Le blocus succéda à l’invasion. Dix requêtes des centres industriels du Yorkshire, de Liverpool, Manchester, Leeds, Halifax et Bradford, signées par mille cinq cents banquiers, commerçants et industriels avaient pressé le gouvernement anglais de prendre des mesures contre les restrictions imposées au commerce dans le Rio de la Plata. Le blocus mit en évidence les limites de l’industrie nationale, qui, malgré les progrès apportés par la loi de protection douanière, se révéla incapable de satisfaire la demande intérieure. En réalité, à partir de 1841, le protectionnisme languissait au lieu de s’accentuer ; Rosas défendait comme personne les intérêts des estancieros de la province de Buenos Aires, et aucune bourgeoisie industrielle capable de donner de l’impulsion à un capitalisme national authentique et puissant n’existait ni ne naquit alors : la grande propriété occupait le centre de la vie économique du pays, et aucune politique industrielle ne pouvait s’affirmer avec indépendance et vigueur sans amoindrir la toute-puissance du latifondo exportateur. Rosas demeura toujours, au fond, fidèle à sa classe. Le plus grand cavalier de toute la province, guitariste et danseur, expert dans l’art de dresser les chevaux, qui savait s’orienter dans l’obscurité des nuits d’orage rien qu’en mâchonnant quelques brins d’herbe, était un important estanciero producteur de viande séchée et de cuir, dont ses semblables avaient fait leur chef.
Eduardo Galeano. Les veines de l’Amérique Latine. Terre humaine. Plon
29 01 1846
Les pères Huc et Gabet arrivent à Lhassa, 18 mois après avoir quitté la Vallée des Eaux Noires, au nord de Pékin : Les femmes thibétaines se soumettent dans leur toilette à un usage, ou plutôt à une règle incroyable, et sans doute unique dans le monde : avant de sortir de leurs maisons, elles se frottent le visage avec une espèce de vernis noir et gluant, assez semblable à de la confiture de raisin. Comme elles ont pour but de se rendre laides et hideuses, elles répandent sur leur face ce fard dégoûtant à tort et à travers, et se barbouillent de manière à ne plus ressembler à des créatures humaines.
Voici ce qui nous a été dit sur l’origine de cette pratique monstrueuse [2] : Il y a à peu près deux cents ans, le Nomekhan, ou Lama-Roi qui gouvernait le Thibet antérieur, était un homme rigide et de mœurs austères. À cette époque, les Thibétaines, pas plus que les femmes des autres contrées de la terre, n’étaient dans l’habitude de s’enlaidir ; elles avaient au contraire, dit-on, un amour effréné du luxe et de la parure ; de là naquirent des désordres affreux, et une immoralité qui ne connut plus de bornes. La contagion gagna peu à peu la sainte famille des Lamas ; les couvents bouddhiques se relâchèrent de leur antique et sévère discipline, et furent travaillés d’un mal qui les poussait rapidement à une complète dissolution. Afin d’arrêter les progrès d’un libertinage qui était devenu presque général, le Nomekhan publia un édit, par lequel il était défendu aux femmes de paraître en public, à moins de se barbouiller la figure de la façon que nous avons déjà dite. De hautes considérations morales et religieuses motivaient cette loi étrange, et menaçaient les réfractaires des peines les plus sévères, et surtout de la colère et de l’indignation de Bouddha. Il fallut, sans contredit, un courage bien extraordinaire, pour oser publier un édit semblable ; mais la chose la plus étonnante, c’est que les femmes se soient montrées obéissantes et résignées. La tradition n’a pas conservé le plus léger souvenir de la moindre insurrection, de la plus petite émeute. Conformément à la loi, les femmes se noircirent donc à outrance, se rendirent laides à faire peur, et l’usage s’est religieusement conservé jusqu’à ce jour ; il paraît que la chose est considérée maintenant comme un point de dogme, comme un article de dévotion. Les femmes qui se barbouillent de la manière la plus dégoûtante, sont réputées les plus pieuses. Dans les campagnes, l’édit est observé avec scrupule, et de façon à ce que les censeurs ne puissent jamais y trouver rien à redire ; mais à Lhassa, il n’est pas rare de rencontrer dans les rues, des femmes qui, au mépris des lois et de toutes les convenances, osent montrer en public leur physionomie non vernissée, et telle que la nature la leur a donnée. Celles qui se permettent cette licence, ont une très mauvaise réputation, et ne manquent jamais de se cacher quand elles aperçoivent quelque agent de la police.
*****
On voyait aussi accourir à Tchogortan une certaine classe de lamas non moins intéressante que celle des Mongols. Ils arrivaient par grandes troupes dès la pointe du jour. Habituellement, ils avaient leur robe retroussée jusqu’aux genoux, et le dos chargé d’une grande hotte d’osier ; ils parcouraient la vallée et les collines environnantes pour recueillir, non des fraises, ni des champignons, mais la fiente que les troupeaux des Si-Fàn disséminaient de toutes part. À cause de ce genre d’industrie, nous avons nommé ces lamas lamas bousiers, ou , plus honorifiquement, lamas argoliers, du mot tartare argol, qui désigne la fiente des animaux, lorsqu’elle est séchée et propre au chauffage. Les lamas qui exploitent ce genre de commerce sont en général des personnages paresseux et indisciplinés, qui préfèrent à l’étude et à la retraite les courses vagabondes à travers les montagnes ; ils sont divisés en plusieurs compagnies, qui travaillent sous la conduite d’un chef chargé des plans et de la comptabilité. Avant la fin de la journée, chacun apporte ce qu’il a pu ramasser de butin au dépôt général, situé au pied d’une colline ou dans l’enfoncement d’une gorge. Là, on élabore avec soin cette matière première, on la pétrit et on la moule en gâteaux qu’on laisse exposés au soleil jusqu’à dessication complète ; ensuite, on arrange symétriquement tous ces argols les uns au-dessus des autres ; on en forme de grands tas, qu’on recouvre d’une épaisse couche de fiente, pour les préserver de l’action dissolvante de la pluie. Pendant l’hiver, ce chauffage est transporté à la lamaserie de Kouboum et on le livre au commerce.
Le luxe et la variété des matières combustibles, dont jouissent les nations privilégiées de l’Europe, ont dû probablement les dispenser de faire des études approfondies sur les diverses qualités d’argol. Il n’en a pas été ainsi parmi les peuples pasteurs et nomades ; une longue expérience leur a permis de classifier les argols avec un talent d’appréciation qui ne laisse rien à désirer. Ils ont établi quatre grandes divisions, auxquelles les générations futures n’auront, sans doute, à apporter aucune modification.
En première ligne, on place les argols de chèvre et de mouton ; une substance visqueuse, qui s’y trouve mêlée en grande proportion, donne à ce combustible une élévation de température vraiment étonnante. Les Thibétains et les Tartares s’en servent pour travailler les métaux ; un lingot de fer plongé dans un foyer de ces argols est dans peu de temps chauffé au rouge blanc. Le résidu que les argols de chèvre et de mouton laissent après la combustion, est une espèce de matière vitreuse, transparente, de couleur verdâtre, et cassante comme le verre ; elle forme une masse pleine de cavités et d’une légèreté extrême : on dirait de la pierre ponce. On ne trouve pas dans ce résidu la moindre quantité de cendres, à moins que le combustible n’ait été mélangé de matières étrangères. Les argols de chameau constituent la seconde classe ; ils brûlent facilement en jetant une belle flamme ; mais la chaleur qu’ils donnent est moins vive et moins intense que celle des précédents. La raison de cette différence est qu’ils contiennent en combinaison une moins grande quantité de substance visqueuse. La troisième clase renferme les argols appartenant à l’espèce bovine ; quand ils sont très secs, ils brûlent avec beaucoup de facilité, et ne répandent pas du tout de fumée. Ce genre de chauffage est presque l’unique qu’on rencontre dans la Tartarie et dans le Thibet. Enfin, on place au dernier rang les argols de chevaux et des autres animaux de la race chevaline. Ces argols n’ayant pas subi, comme les autres, le travail de la rumination, ne présentent qu’un amas de paille plus ou moins triturée ; ils brûlent en répandant une fumée épaisse, et se consument à l’instant. Ils sont pourtant très utiles pour commencer à allumer le feu : ils font en quelque sorte l’office d’amadou, et aident merveilleusement à enflammer les autres combustibles
Nous comprenons que cette courte et incomplète dissertation sur les bouses est peu propre à intéresser un grand nombre de lecteurs. Cependant, nous n’avons pas cru devoir la retrancher parce que nous nous sommes imposé l’obligation de ne négliger aucun des documents qui pouvaient être de quelque utilité pour ceux qui voudront après nous essayer la vie de nomade. […]
*****
Sandara nous servit du thé au lait, des raisins secs et des gâteaux frits au beurre. Pendant que nous étions occupés à déjeuner, il ouvrit une petite armoire, et en tira un plat en bois, proprement vernissé, et où des dorures et des fleurs se dessinaient sur un fond rouge. Après l’avoir bien nettoyé avec un pan de son écharpe, il étendit dessus une large feuille de papier rose, puis, sur le papier, il arrangea symétriquement quatre belles poires, qu’il nous avait fait acheter à Tang-Keou-Eul. Le tout fut recouvert d’un mouchoir en soie, de forme oblongue, et qu’on nomme khata. C’était avec cela, dit-il, que nous devions aller emprunter une maison.
Le khata ou écharpe de bonheur, joue un si grand rôle dans les mœurs thibétaines qu’il est bon d’en dire quelques mots. Le khata est une pièce de soie dont la finesse approche celle de la gaze. Sa couleur est d’un blanc un peu azuré. Sa longueur est à peu près le triple de sa largeur ; les deux extrémités se terminent ordinairement en frange. Il y a des khatas de toute grandeur et de tout prix ; car c’est un objet, dont les pauvres, pas plus que les riches, ne peuvent se passer. Jamais personne ne marche sans en porter avec soi une petite provision. Quand on va faire une visite d’étiquette, quand on veut demander à quelqu’un un service, ou l’en remercier, on commence d’abord par déployer un khata ; on le prend entre ses deux mains, et on l’offre à la personne qu’on veut honorer. Si deux amis, qui ne se sont pas vus depuis quelques temps, viennent par hasard à se rencontrer leur premier soin est de s’offrir mutuellement un khata. Cela se fait avec d’autant d’empressement et aussi lestement qu’en Europe lorsqu’on se touche la main. Il est d’usage, aussi, quand on s’écrit, de plier dans les lettres un petit khata. On ne saurait croire combien les Thibétains, les Si-fàn, les Houang-Mao-Eul, et tous les peuples qui habitent vers l’occident de la mer Bleue, attachent d’importance à la cérémonie du khata. Pour eux, c’est l’expression la plus pure et la plus sincère de tous les nobles sentiments. Les plus belles paroles, les cadeaux les plus magnifiques, ne sont rien sans le khata. Avec lui, au contraire, les objets les plus communs acquièrent une immense valeur. Si l’on vient vous demander une grâce, le khata à la main, il est impossible de la refuser, à moins d’afficher le mépris de toutes les convenances. Cet usage thibétain s’est beaucoup répandu parmi les Tartares, et surtout dans leurs lamaseries. Les khatas forment une importante branche de commerce pour les Chinois de Tang-Keou-Eul. Les ambassades thibétaines ne passent jamais sans en emporter une quantité prodigieuse.
*****
La lamaserie de Kouboum jouit d’une si grande réputation, que les adorateurs de Bouddha s’y rendent en pèlerinage de tous les points de la Tartarie et du Thibet ; il n’est pas de jour qui ne soit signalé par l’arrivée ou le départ de quelques pèlerins. Cependant, il est des fêtes solennelles où l’affluence des étrangers est immense. On en compte quatre principales dans l’année ; la plus fameuse de toutes est celle qui a lieu le quinzième jour de la première lune ; on la nomme la fête des Fleurs. Nulle part elle ne se célèbre avec autant de pompe et de solennité qu’à Kounboum : celles qui ont lieu dans la Tartarie, dans le Thibet, à Lha-Ssa même, ne peuvent pas lui être comparées. Nous nous étions installées à Kounboum le 6 de la première lune, et déjà on pouvait remarquer les nombreuses caravanes de pèlerins qui arrivaient par tous les sentiers qui aboutissent à la lamaserie. De toute part, il n’était question que de la fête : les fleurs étaient, disait-on, d’une beauté ravissante. Le conseil des beau-arts, qui les avait examinées, les avait déclarées supérieures à toutes celles des années précédentes. Aussitôt que nous entendîmes parler de ces fleurs merveilleuses, nous nous hâtâmes, comme on peut penser, de demander des renseignements sur une fête inconnue pour nous. Voici les détails qu’on nous donna, et que nous n’écoutâmes pas sans surprise.
Les Fleurs du 15 de la première lune consistent en représentations profanes et religieuses, où tous les peuples asiatiques paraissent avec leur physionomie propre et le costume qui le distingue. Personnages, vêtements, paysages, décorations, tout est représenté en beurre frais. Trois mois sont employés à faire les préparatifs de ce singulier spectacle. Vingt lamas, choisis parmi les artistes les plus célèbres de la lamaserie, sont journellement occupés à travailler le beurre, en tenant toujours les mains dans l’eau, de peur que la chaleur des doigts ne déforme l’ouvrage. Comme ces travaux se font en grande partie pendant les froids les plus rigoureux de l’hiver, ces artistes ont de grandes souffrances à endurer. D’abord, ils commencent par bien brasser et pétrir le beurre dans l’eau, afin de le rendre ferme. Quand la matière est suffisamment préparée, chacun s’occupe de façonner les diverses parties qui lui ont été confiées. Tous ces ouvriers travaillent sous la direction d’un chef, qui a fourni le plan des fleurs de l’année, et qui préside à leur exécution. Les ouvrages étant terminés, on les livre à une autre compagnie d’artistes, chargés d’y apposer les couleurs, toujours sous la direction du même chef. Un musée tout en beurre nous paraissait une chose assez curieuse pour qu’il nous tardât un peu d’arriver au 15 de la lune.
La veille de la fête, l’affluence des étrangers fut inexprimable. Kounboum n’était plus cette lamaserie calme et silencieuse, où tout respirait la gravité et le sérieux de la vie religieuse ; c’était une cité mondaine, pleine d’agitation et de tumulte. Dans tous les quartiers, on n’entendait que les cris perçants des chameaux et les grognements sourds des bœufs à long poil, qui avaient transporté les pèlerins. Sur les parties de la montagne qui dominent la lamaserie, on voyait s’élever de nombreuses tentes où campaient tous ceux qui n’avaient pu trouver place dans les habitations des lamas. Pendant toute la journée du 14, le nombre de ceux qui firent le pèlerinage autour de la lamaserie fut immense. C’était pour nous un étrange et pénible spectacle que de voir cette grande foule se prosternant à chaque pas, et récitant à voix basse son formulaire de prières. Il y avait, parmi ces zélés bouddhistes, un grand nombre de Tartares-Mongols, tous venant de fort loin. Ils se faisaient remarquer par une démarche pesante et maussade, mais surtout par un grand recueillement et une scrupuleuse application à accomplir les règles de ce genre de dévotion. Les Houng-Mao-Eul, ou Longues-Chevelures, y étaient aussi, et nous ne leurs trouvâmes pas meilleure façon qu’aux Tang-Keo-Eul ; leur sauvage dévotion faisait un singulier contraste avec le mysticisme des Mongols. Ils allaient fièrement, la tête levée, le bras droit hors de la manche de leur habit, toujours accompagnés de leur grand sabre et d’un fusil en bandoulière. Les Si-Fàn du pays d’Amdo étaient les plus nombreux de tous les pèlerins. Leur physionomie n’exprimait ni la rudesse des Longues-Chevelures, ni la candide foi des Tartares. Ils accomplissaient leur pèlerinage lestement et sans façon. Ils avaient l’air de dire : Nous autres, nous sommes de la paroisse ; nous sommes au courant de tout cela.
Régis-Ēvariste Huc, prêtre missionnaire de la Congrégation de Saint-Lazare. Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie et le Thibet (1844-1846), annoté par J.M. Plancher, Librairie d’Adrien Le Clere 1853
La mode des petits pieds est générale en Chine, et remonte, dit-on, à la plus haute antiquité. Les Européens aiment assez à se persuader que les Chinois, cédant à l’exagération d’un sentiment très avouable ont inventé cet usage afin de tenir les femmes recluses dans l’intérieur de leur maison, et de les empêcher de se répandre au dehors. Quoique la jalousie puisse trouver son compte dans cette étrange et barbare mutilation, nous ne croyons pas cependant qu’on doive lui en attribuer l’invention. Elle s’est introduite insensiblement et sans propos délibéré, comme cela se pratique, du reste, pour toutes les modes. On prétend que, dans l’antiquité, une princesse excita l’attention de tout le monde par la délicate exiguïté de ses pieds. Comme elle était d’ailleurs douée des qualités les plus remarquables, elle donna le ton à la fashion chinoise, et les dames de la capitale ne tardèrent pas à en faire le type de l’élégance et du bon goût. L’admiration pour les petits pieds fit des progrès rapides, et il fut admis qu’on avait enfin trouvé le critérium de la beauté ; et, comme il arrive toujours qu’on se passionne pour les futilités nouvelles, les Chinoises cherchèrent, par tous les moyens imaginables, à se mettre à la mode. Celles qui étaient déjà d’un âge rassis eurent beau user d’entraves et de moyens de compression, il leur fut impossible de supprimer des développements légitimes de la nature, et de donner à leur base la tournure mignonne tant désirée. Les plus jeunes eurent la consolation d’obtenir quelques succès ; mais vagues, assez médiocres et de peu de durée. Il n’était réservé qu’à la génération suivante d’assurer complètement le triomphe des petits pieds. Les mères les plus dévouées à la mode nouvelle ne manquaient pas, s’il leur naissait une fille, de serrer et de comprimer avec des bandelettes, les pieds de ces pauvres petites créatures, afin d’empêcher tout développement. Les résultats d’une pareille méthode ayant paru satisfaisants, elle fut généralement admise dans tout l’empire.
Les femmes chinoises, les riches comme les pauvres, celles des villes et celles de la campagne, sont donc toutes estropiées ; elles n’ont, en quelque sorte, à l’extrémité de leurs jambes que d’informes moignons, toujours enveloppés de bandelettes, et dont la vie s’est retirée. Elles chaussent des petites bottes très gracieuses et richement brodées ; c’est là dessus qu’elles se soutiennent en se balançant presque continuellement. Leur démarche a quelque chose de sautillant, et ressemble beaucoup à celle des Basques lorsqu’ils sont montés sur des échasses.
Les femmes chinoises, avec leurs petits pieds de chèvre, n’éprouvent pas pour marcher autant de difficulté qu’on se l’imagine. Comme elles y sont habituées dès leur naissance, elles n’ont pas plus d’embarras que certains boiteux qu’on voit souvent courir avec assez d’agilité. Lorsqu’on les rencontre dans les rues, on dirait, à leurs petits pas chancelants, qu’elles peuvent à peine se soutenir ; mais c’est là quelquefois une affectation et une manière de se donner de la grâce. Elles sont, en général, si peu embarrassées, que, si elles pensent n’être pas vues, elles courent, sautent et folâtrent avec une admirable aisance. L’exercice favori des jeunes filles chinoises est le jeu de volant ; mais, au lieu de se servir de raquettes, c’est avec le revers de leur petit brodequin qu’elles reçoivent et se renvoient mutuellement le volant. Elles sont donc toujours à cloche-pied, et, comme il leur arrive de passer des journées entières à ce jeu, il est permis de présumer que leurs moignons ne leur causent ni beaucoup de douleur ni une grande fatigue.
Tous les habitants du céleste empire raffolent des petits pieds des femmes. Les jeunes filles qui, dans leur enfance ne les ont pas eu serrés, trouvent très difficilement à se marier. Aussi les mères ne manquent-elles pas de porter sur ce point toute leur sollicitude. Les femmes tartares mantchoues ont conservé l’usage des grands pieds ; mais les mœurs du pays conquis ont eu sur elles une telle influence, que, pour se donner une démarche à la mode, elles ont inventé des souliers dont la semelle extrêmement élevée se termine en cône. Elles vont ainsi d’une manière peut-être plus chancelante encore que les femmes chinoises.
M. Huc, ancien missionnaire apostolique en Chine. L’empire Chinois. Librairie De Gaume 1854
La coutume des pieds bandés a été pratiquée en Chine pendant plus de mille ans. Son origine remonterait à la fin des Tang, au X° siècle, quand l’empereur demanda à sa jeune concubine de se bander les pieds pour exécuter la traditionnelle danse du lotus et ainsi accroître son désir. Un siècle plus tard, la coutume entre dans les mœurs et devient à la mode chez toutes les femmes de l’empire, devenant ainsi une tradition familiale qui symbolise la richesse et la distinction. En effet, les femmes aux pieds bandés ne peuvent travailler qu’à des tâches domestiques simples, ce que ne peuvent se permettre les familles pauvres. Le statut d’une femme dépend en grande partie de ses talents de brodeuse exercés dans la fabrication de minuscules souliers et de jambières qu’elle coud pour sa famille et pour elle-même. Les chaussures, finement brodées, témoignent de l’importance donnée à l’esthétique féminine.
L’importance donnée à la petite taille des pieds et l’opportunité de marier leurs filles à des familles plus fortunées répandit la coutume et, à la fin de la dynastie Qing, on pouvait voir des femmes aux pieds bandés dans toutes les classes sociales de la société Han, à l’exception des plus misérables et du groupe des Hakka, chez qui les femmes assumaient une partie des travaux dévolus aux hommes dans les autres ethnies.
Les femmes mandchoues et mongoles, elles, ne pratiquaient pas le bandage des pieds (alors qu’elles occupaient le sommet de la hiérarchie sociale sous la dynastie mandchoue des Qing), et surprenaient aussi bien les Chinois Han que les occidentaux de passage par leur vie beaucoup plus active et leurs capacités équestres. Elles prirent en revanche l’habitude de confectionner des chaussons destinés à leur donner la démarche chaloupée des femmes aux pieds bandés.
Au XIX° siècle, quelques empereurs, dont l’impératrice Cixi, tentèrent sans succès de bannir la pratique. En 1912, après la chute de la dynastie Qing, le gouvernement de la République de Chine, interdit le bandage des pieds et força les femmes à ôter leurs bandelettes, ce qui s’avéra presque aussi douloureux et traumatisant à l’égard des tabous dont les pieds nus faisaient l’objet. La pratique se poursuivit dans la clandestinité, parallèlement à l’émergence de sociétés progressistes dont les membres s’engageaient à ne pas bander les pieds de leurs filles et à ne pas marier leurs fils à des femmes aux pieds bandés. L’interdiction fut réellement effective après 1949, sous la République populaire de Chine. Le nombre de femmes à avoir vu leurs pieds ainsi mutilés est estimé à un milliard.
Le bandage commençait à l’âge de cinq ou six ans, parfois plus tôt, et nécessitait environ deux ans pour atteindre la taille jugée idéale de 7,5 centimètres, ou lotus d’or. Après avoir baigné les pieds dans de l’eau chaude ou du sang animal mélangés à des herbes médicinales, les orteils, à l’exception du gros orteil, étaient pliés contre la plante du pied, et la voûte plantaire, courbée, pour réduire sa longueur et donner au pied la forme d’un bouton de lotus. Le pied était ensuite placé dans une chaussure pointue, de plus en plus petite au fil des semaines. Les fractures, volontaires ou accidentelles, étaient fréquentes, en particulier si le bandage commençait à un âge tardif. Les bandes devaient être quotidiennement changées, ainsi que les pieds lavés dans des solutions antiseptiques. Malgré cela, le taux de mortalité des suites de septicémie est estimé à 10 %.
Il existait un second procédé, demandant des compressions encore plus fortes, qui générait de nombreuses lésions de l’articulation tarsienne, et impliquait un déplacement du calcanéum, qui passait sa position naturelle horizontale à une position verticale. Dans les deux cas, des plaques métalliques étaient quelquefois ajoutées sous la plante du pied ainsi bandé.
Les orteils, privés d’une grande partie de l’irrigation nécessaire, se nécrosaient rapidement. Les voir tomber n’était pas une mauvaise nouvelle, car cela permettait d’obtenir un pied encore plus petit. De manière générale, la circulation sanguine était largement perturbée et rendait les pieds particulièrement douloureux en hiver. En été, le profond pli qui apparaissait entre le talon et la plante du pied était le siège de multiples infections.
Certains, dont Sigmund Freud, considèrent cette pratique comme du fétichisme, car elle était pratiquée pour des raisons esthétiques, comme en peuvent témoigner les manuels érotiques chinois qui cataloguaient toutes les manières possibles d’utiliser les pieds bandés, considérés comme des zones érogènes.
Embaumant le parfum, elle esquisse des pas de lotus ;
Et malgré la tristesse, marche le pied léger.
Elle danse à la manière du vent, sans laisser de trace physique.
Une autre, subrepticement, tente gaiement de suivre le style du palais,
Mais grande est sa douleur sitôt qu’elle veut marcher !
Regarde-les dans le creux de ta main, si incroyablement petits
Qu’il n’est de mot pour les décrire.
Su Shi – 1036-1101-
Zhu Xi (1130-1200), alors magistrat dans la province du Fujian, voyait dans le bandage des pieds, outre un moyen de préserver la chasteté féminine, un moyen de répandre la culture chinoise et d’enseigner la séparation entre l’homme et la femme.
Wikipédia 2015
8 02 1846
Giuseppe Garibaldi, né à Nice en 1807 – alors française -, s’est très tôt senti l’ami de tous les démunis et donc opposant à tous les nantis. Intellectuellement, il s’est naturellement placé dans la mouvance de la tête pensante du Risorgimento, Giuseppe Mazzini, mais sa personnalité le maintiendra toujours à distance du maître, la distance allant parfois jusqu’à une franche opposition ; cela lui a collé à la peau une odeur de souffre, qui l’a amené à s’exiler en Amérique du Sud, où il mène depuis dix ans une vie de condottiere/corsaire désintéressé au service des opprimés.
Politiquement, la situation de la péninsule italienne est celle héritée du Congrès de Vienne en 1815 : un éclatement encore très réel entre de multiples duchés, issus en droite ligne des Trecento et Quattrocento : Parme, Modène, Massa, Lucques, Toscane ; trois royaumes : Lombardie-Vénétie, avec Milan, Venise, domaine des Habsbourg d’Autriche, les Deux Siciles qui occupent toute la botte avec Naples pour capitale et Ferdinand I° de Bourbon [1816-1825], François I° [1825-1830], Ferdinand II [1830-1859] et François II [1859-1860] pour rois ; le royaume de Sardaigne qui comprend la Savoie, Nice, le Piémont, la Ligurie et la Sardaigne, est le plus à même de réaliser l’unité avec Turin pour capitale et Victor Emmanuel I° [1802-1821], Charles Félix [1821-1831], Charles Albert [1831-1849], Victor Emmanuel II [1849-1861, puis roi d’Italie à partir de mars 1861] pour rois. Les Habsbourg comme les Bourbons ne visent qu’au statu quo et se sont occupés jusqu’alors à mater toute velléité d’unification. Et encore, eux aussi sortis d’une époque où l’absence d’un territoire conséquent générait systématiquement l’insécurité – cela avait été le principal motif du départ de la papauté en Avignon en 1309 -, les États Pontificaux, à la tête desquels a été élu Pie IX en juin 1846, occupant toute le milieu de la botte, de la Romagne au Latium à travers les Marches et l’Ombrie, d’une taille comparable à celle des royaumes.
Je suis fait pour casser les pieds à la moitié de l’humanité et j’ai juré ; oui ! j’ai juré par le Christ ! de consacrer ma vie à la perturbation d’autrui, et j’ai déjà accompli quelque chose, qui n’est rien en comparaison de ce que j’espère, si on me laisse faire, ou si on ne peut m’empêcher de le faire.
Il a défendu ainsi pendant plusieurs années à partir de 1839, une République du Rio Grande do Sul, partie intégrante du Brésil, frontalière avec l’Uruguay, avec un bel exploit en faisant franchir toute une langue de terre à des navires pour contourner un blocus naval à l’embouchure du Lagos de Patos. Faute de liquidités, la République l’a gratifié de 1 000 bœufs qu’il a emmené, plutôt mal que bien à Montevideo [3], capitale de l’Uruguay : 400 bêtes se sont noyées en traversant le Rio Negro ; bien d’autres ont servi à payer les gauchos ; au bout de 50 jours de voyage, il lui restait 300 peaux en tout et pour tout. Sa renommée est déjà grande et il retrouve vite à s’employer aux cotés de l’Uruguay dans sa Guerra grande contre l’Argentine : il s’illustre particulièrement à San Antonio del Salto, sur les rives du fleuve Uruguay en repoussant des forces ennemies bien supérieures en nombre. Courage, audace, rapidité d’exécution : les vertus du Condottiere sont chantées au-delà des frontières et des mers. Il a eu le coup de foudre pour Aniña Ribeiro da Silva, Anita, plantureuse brésilienne au naturel jaloux : elle ne le lâchera plus d’une semelle, pour autant que cela puisse se faire avec de genre de gaillard.
Bartolomeo Mitre, alors âgé de 22 ans, qui deviendra président de la République argentine, l’a rencontré à quelques reprises : Sous une apparence modeste et pacifique, il cachait un génie ardent et un esprit peuplé de rêves grandioses. En ce temps-là, son rêve était de débarquer sur les côtes de la Calabre avec sa légion de volontaires, de donner le signal de la résurrection italienne et de mourir au combat s’il n’avait pas réussi à planter le drapeau de la rédemption sur le Capitole de Rome. Quand il en parlait, son langage était passionnée et haut en couleur, révélant un homme instruit, doué de sentiments plus que d’idées… Sa parole, bien qu’empreinte de modération, était impérative et dogmatique. Il me fit l’impression d’un esprit et d’un cœur qui s’accordaient mal, d’une âme embrasée par un feu sacré, voué à la grandeur et au sacrifice. J’en tirai la conviction que c’était un vrai héros en chair et en os, doté d’un idéal sublime, de théories de liberté exagérées et mal digérées, possédant pourtant les qualités requises pour accomplir de grandes choses.
Bartolomeo Mitre. Journal militaire
25 04 1846
L’armée américaine est en expédition le long du Rio Grande, face à la ville mexicaine de Matamoros. La veille, on a retrouvé le corps du colonel Cross, le crâne défoncé. Une patrouille de soldats américains se fait surprendre par des Mexicains, qui tuent 11 soldats en blessent plusieurs autres et font des prisonniers. Le gouvernement fédéral n’en attendait pas plus pour déclencher la guerre contre le Mexique et ainsi s’emparer de la Californie tant convoitée. Mexico sera prise en septembre 1847. La guerre ne suscita pas auprès de la troupe un réel engouement : on comptera 9 207 déserteurs !
16 06 1846
Le cardinal Giovanni Maria Mastai Feretti est élu pape : il sera Pie IX, qui mettra rapidement en œuvre des réformes allant dans le sens d’une libéralisation profonde des États Pontificaux : amnistie des condamnés politiques, création d’un Conseil d’État, d’un Conseil des ministres, d’une junte municipale à la tête de la ville de Rome, suppression des dispositions infamantes imposées aux Juifs romains, destruction de l’enceinte du ghetto, adoption de l’éclairage au gaz dans la capitale… autant de mesures qui lui assurèrent une popularité de pape libéral, qui dépassera largement les frontières des États Pontificaux. En réalité, il était surtout pragmatique et partisan du juste milieu, nullement désireux de dresser les Italiens contre la toute puissante Autriche. Les Italiens mettront un moment avant de s’en apercevoir, trop long pour empêcher la naissance d’un puissant mouvement d’opinion.
13 08 1846
À l’opéra de Bologne, on donne Ernani de Verdi. Pour l’air final O sommo Carlo, le chœur remplace Carlo – Charles Quint – par Pio : et c’est l’ovation du public, tant et si bien qu’il y aura trois bis de cet air, et les vivats de repartir au tous seront pardonnés. Première d’une longue série de manifestations qui allaient pousser les maîtres autrichiens à la répression.
19 09 1846
La Vierge apparaît à deux jeunes bergers, Mélanie Calvat, 15 ans et Maxime Giraud, 11 ans, dans les alpages de La Salette, près de Corps, 30 km au SE de La Mure, en Dauphiné. L’évêque du lieu reconnaîtra officiellement l’apparition 5 ans plus tard.
1846
Première médicale à Londres : un opéré est endormi à l’éther par Robert Liston : à son réveil, il demandera quand devait commencer l’opération ! la méthode va rapidement faire le tour du monde, balayant les réticences des chirurgiens qui trouvaient jusqu’alors l’anesthésie dégradante.
Quand la solidité de la réputation d’une théorie, en l’occurrence celle de la gravitation universelle formulée par Newton, vient heurter l’observation astronomique, il arrive que ce soit la théorie qui dise vrai, et que ce soit la vision de la réalité qui soit à réviser : Dès les années 1840, les astronomes se rendirent compte que le comportement d’Uranus n’était pas ce qu’il aurait dû être si la théorie de la gravitation universelle de Newton était exacte. À l’époque, la théorie de Newton était si solidement établie que la seule explication satisfaisante des anomalies dans le comportement d’Uranus parut être l’existence d’une autre planète, encore plus éloignée du Soleil et qui perturbait Uranus par gravitation. Le problème qui consistait à calculer l’existence de cette planète hypothétique paraissait insoluble à la plupart des astronomes ; toutefois deux d‘entre eux s’en saisirent : John Couch Adams, un jeune mathématicien de Cambridge qui venait d’obtenir sa licence, et l’astronome et mathématicien français, Urbain Le Verrier, de huit ans son aîné. Adams s’attaqua au problème en 1842 et, trois ans plus tard, en 1845, il avait calculé la position de la planète hypothétique ; il recourut alors à l’aide de l’astronome royal, George Airy, pour la situer, mais il semble qu’Airy ait douté de la solution présentée et les mesures qui furent prises, à Greenwich et à Cambridge pour observer la présumée planète manquèrent singulièrement d’ardeur. Quant à Le Verrier, il aborda lui aussi le problème avec méthode et parvint à sa solution en 1846, quelque dix mois après Adams. En France, cette solution fut elle aussi accueillie avec une certaine réserve et, finalement, ce fut Johann Galle, directeur de l’observatoire de Berlin, que Le Verrier persuada d’entamer une recherche. La chance voulait que l’observatoire de Berlin eût précisément terminé peu avant une carte de la zone précise du ciel où Le Verrier avait calculé que devait se situer la planète ; ses calculs se révélèrent exacts. Comme les calculs d’Adams désignaient la même zone céleste, on disputa quelque temps de la priorité de la découverte ; il est clair aujourd‘hui que les deux hommes se partagent également le mérite de ce triomphe de la gravitation de Newton. En vertu d’un accord international, la nouvelle planète fut baptisée Neptune.
Colin Ronan. Histoire mondiale des sciences. Seuil 1988
Crise agricole : les prix flambent ; crise industrielle : chute des prix de gros : 20 % de chômeurs dans les houillères, 35 % dans le textile de Normandie et de Champagne.
À Beaumont en Périgord, au sud de Périgueux, création d’une quincaillerie-droguerie qui portera en 1932 le nom de sa repreneuse : Maison Bariat, arrière grand-mère des propriétaires actuels. Le magasin propose une quantité ahurissante d’articles qui n’a rien à envier au BHV parisien – Bazard de l’Hôtel de Ville -. On y éprouve une excitation de la curiosité à l’égal de celle d’un musée des Arts et Métiers : mais à quoi donc cela peut-il bien servir ? et ça, qu’est-ce que c’est ? le plus souvent il s’agit d’outils à usage agricole ou d’élevage. C’est extraordinaire, tout un pan de l’histoire d’une France rurale.
Louis Napoléon Bonaparte, exilé en Angleterre y rencontre Elizabeth Ann Harriet Howard, danseuse fortunée de 23 ans qui va devenir sa maîtresse… et sa banquière, pour les nombreuses conspirations et campagnes qu’il va mener avant d’accéder à la présidence de la république puis au trône d’empereur. Elle sera alors bien logée… à proximité – Quand pourrais-je traverser la rue ? demandait-elle parfois – jusqu’à ce qu’il épouse Eugénie de Montijo. Son château sera alors fracassé par la police qui n’oubliera pas d’emporter toutes les lettres de Louis Napoléon. Cherchant à renouer avec elle, Napoléon III lui offrira quelques privilèges et finira même pas rembourser ses dettes. Je la quitte ; je m’acquitte ; nous sommes quittes. Elle avait une autre ennemie farouche : la princesse Mathilde, fille de Jérôme Bonaparte et de Catherine de Wurtenberg, qui avait été fiancée à Louis Napoléon en 1835, dont le mariage n’avait pu se réaliser, le beau-père de Jérôme s’y opposant.
Les sœurs Brontë, Charlotte 1816-1855, Anne 1820-1849, Emily 1818-1848 ont trouvé il y a un an un éditeur qui accepte de publier Poems dont il vendra deux exemplaires en un an. C’est modeste, certes, mais c’est un début de quelque chose. Charlotte publie chez Smith et Elder son deuxième roman Jane Eyre : le succès est immédiat, et la première édition épuisée en quelques jours. Emily, qui n’aura jamais pu se détacher longtemps de Haworth, son petit village du Yorkshire a du mal à trouver un éditeur pour Les Hauts de Hurlevent : finalement Newby en tire 250 exemplaires ; les critiques l’éreintent… grossier est le mot qui revient le plus souvent. Il faudra attendre 1877 pour que Swinburne parle des pages magiques des Hauts de Hurlevent, mais surtout Virginia Woolf 1882-1941 : regardant vers un monde divisé en un gigantesque désordre, elle sentit en elle le pouvoir de l’unir en un livre. Georges Bataille ne se montrera pas pingre non plus sur la louange : elle eut de l’abîme du mal une expérience profonde. Encore que peu d’êtres aient été plus rigoureux, plus courageux, plus droits, elle alla jusqu’au bout de la connaissance du mal. Les Hauts de Hurlevent est le plus grand roman d’amour de tous les temps.
13, 14 01 1847
Deux conducteurs de chariot chargées de blé se sont arrêtés à l’auberge du père Poulet, à Buzançais, dans le Berry. Des journaliers et des ménagères confisquent le convoi, sans provoquer de réaction du maire, pas plus que des gendarmes ni du préfet. Le petit peuple se décide alors à faire passer les gros à la caisse, les contraignant à signer un engagement de livraison de blé à mi-tarif pendant six mois. L’affaire tient plutôt du carnaval, mais la mort d’un réquisiteur va la transformer en insurrection ; le meurtrier, traqué à travers la ville, est tué à coup de masse ; fermes et châteaux environnants sont alors réquisitionnés au nom du tocsin. Il faut faire appel à l’armée pour rétablir l’ordre. Vingt et un prévenus seront condamnés à diverses peines de travaux forcés.
30 06 1847
Mise en service de l’aqueduc de Roquefavour, élément principal du Canal de Marseille, sur la commune de Ventabren, à l’ouest d’Aix en Provence, qui permet d’amener l’eau de la Durance à Marseille. Les travaux ont commencé en 1841, et ils se sont déroulé sous la direction d’un jeune ingénieur de 26 ans : Franz Mayor de Montricher. Il mesure 393 m. de long, 83 m. de haut, – dimensions nettement supérieures à celle du Pont du Gard : 273 de longueur, 49 de haut – qui en font le plus long aqueduc du monde. Des améliorations sur la capacité des conduites faites en 1971, permettront de faire passer le débit de 10 m³/sec à 44 m³/sec. Il sera classé monument historique en 2001. Ainsi, une partie des eaux de la Durance retrouvait à peu près sa destination d’origine lorsque, quelques 10 000 ans plus tôt, elle était encore fleuve et se jetait, via son delta de la Crau, directement dans la Méditerranée.
24 07 1847
Brigham Young, à la tête de plusieurs milliers de Mormons partis vers l’ouest, fatigués d’être en butte aux tracasseries des gens de l’Est, s’arrêtent dans l’Utah, après avoir parcouru 2 000 km : ils vont fonder Salt Lake City. Par un travail d’irrigation acharné, ils vont fertiliser 60 000 ha. Ils garderont leur attachement à la polygamie jusqu’en 1896 : le renoncement à cette tradition leur permettra de rejoindre l’Union, devenant alors le 45° État.
Come, come, ye saints de William Clayton, poète mormon, 1848
ou bien
26 07 1847
Indépendance du Liberia : les anciens esclaves étaient à peu près 22 000, et ils ne feront que répéter ce qu’ils ont toujours connu : l’esclavage, en instituant l’apartheid, bien avant les Afrikaners d’Afrique du sud : ils prendront le rôle du maître et les esclaves seront les communautés indigènes : et il ne s’agissait pas seulement de comportements sans fondement légal : il était écrit dans la Constitution que n’étaient reconnus comme citoyens de plein droit que les descendants d’esclaves affranchis… ils copiaient ainsi la législation américaine qui refusait tout droit aux Indiens. En 1869, ils inventeront encore la dictature du parti unique, bien avant Lénine. La situation ne sera à nouveau inversée qu’avec le coup d’État de Samuel Doe, de l’ethnie des Krahn, qui tuera William Tolbert en 1980. Par la suite, une bonne part du peuplement se fera via les navires de la France : ces derniers, forts de l’abolition de l’esclavage décrété en 1848 par la République, arraisonnaient les bateaux de ceux qui continuaient à participer à la traite ; Anglais, Espagnols, Portugais, embarquaient les esclaves et les libéraient sur le sol du Libéria. Le mouvement abolitionniste fût essentiellement mené par les Quakers.
1 10 1847
Werner Siemens révolutionne la télégraphie en inventant le télégraphe à index électrique. Il fonde avec son ami Johann Georg Halske (1814–90) et son cousin Johann Georg Siemens (1805-79), l’entreprise Telegraphen Bau-Anstalt von Siemens & Halske et installe le 12 octobre 1847 le premier atelier au numéro 19 de la Schönberg Strasse à Berlin. À la fin de l’année 1848, le petit atelier compte déjà 10 employés. En 2015, Siemens, première entreprise allemande, emploiera 405 000 personnes, réalisant un CA de 73 milliard d’€.
12 11 1847
L’Anglais James Young utilise du chloroforme, beaucoup plus puissant que l’éther, comme anesthésiant pour une opération chirurgicale.
29 11 1847
Narcissa et Marcus Whitman, originaires de l’État de New York, ont ouvert voilà plus de 11 ans une mission évangélique à Waiilatpu, sur le territoire des Indiens Cayuse, proche de Fort Walla Walla, où se trouve un bureau de la compagnie de la Baie d’Hudson, à l’ouest des Rocheuses. Ils ont perdu une petite fille de 2 ans, en ont recueilli sept autres. Ils n’ont pas pris la peine d’apprendre la langue des Cayuse, les rivalités avec les missionnaires catholiques sont vives, les conversions plutôt rares. Survient une épidémie de rougeole qui voit Marcus se dévouer tant et plus envers tous les malades, tant Indiens que Blancs ; mais les Indiens, dont l’organisme découvre la maladie, possèdent beaucoup moins de défenses et donc, meurent beaucoup plus facilement : de là à accuser Marcus de ne pas les soigner aussi bien que les Blancs, il n’y a qu’un pas, franchi par Tiloukaikt, le chef de la tribu, qui ordonne l’attaque de la mission. Le couple Whitman et onze autres personnes sont massacrés. Le docteur Marcus est démembré et mutilé atrocement. Narcissa meurt alors qu’elle tente de fuir la maison avec plusieurs balles dans le corps. Un charpentier parvient à aller chercher de l’aide au fort Walla Walla. Mais les Indiens prennent 54 autres femmes et enfants en otages et demandent rançon. Un mois plus tard, les 49 otages survivants sont échangés contre des fusils, munitions, couvertures, chemises, tabac et pierres à feu. Finalement, cinq Indiens, dont Tiloukaikt, acceptent de se rendre pour passer en jugement pour le massacre, plaidant pour leur défense que la loi tribale leur permet de tuer l’homme de médecine qui distribue de mauvaises médecines. Ils sont pendus tous les cinq.
1847
Aux États-Unis, des immigrants dont le convoi est bloqué par la neige au Donner Pass, ne doivent leur survie qu’à la consommation de la chair de leurs compagnons morts.

Création du base-ball. À Thiers, le prix du pain était en 1845 de 0.25 franc ; il passe à 0.47. La France compte 35 000 km de routes nationales et 1 832 km de voies ferrées. Publication du Chaix (horaires des trains). La route connaît alors une désaffection croissante pendant une quarantaine d’années, due à l’expansion du trafic ferroviaire. Il faudra attendre l’apparition de l’automobile, en 1885, pour que le trafic routier recommence à se développer. En Angleterre, où le premier train circulait depuis 1830, les compagnies ferroviaires se concertent pour établir que les horaires de train seront désormais établis sur l’heure de Greenwich, abandonnant ainsi les heures locales qui devenaient ingérables pour un moyen de transport aussi rapide : jusqu’alors, chaque ville avait son heure : quand il était midi à Londres, il pouvait être midi et demi à Liverpool et midi moins dix à Canterbury. Il faudra attendre encore treize ans – 1880 -, pour que le gouvernement s’aligne sur les compagnies ferroviaires en imposant à tous de se référer à l’heure du méridien de Greenwich.
Autre mesure, celle de la différence de niveau entre la Méditerranée et la Mer Rouge : Jean-Marie le Père avait estimé en 1808, au cours de l’expédition en Egypte de Bonaparte que le niveau de la Mer Rouge était plus élevé de 9,918 m. que celui de la Méditerranée ; à sa décharge rappelons que ses instruments avaient sombré avec Le Patriote, six mois plus tôt. Paul Adrien Bourdalouë prouve que cette différence est en fait insignifiante.
Environ 2 millions de déshérités, 9 200 institutions de bienfaisance. Les Suisses se font la guerre : 7 cantons catholiques et conservateurs se sont unis – le Sonderbund – pour suivre la décision du canton de Luzern de confier aux Jésuites la direction de l’enseignement ; les cantons protestants craignent que le pouvoir des Jésuites s’étendent à leurs cantons et les catholiques du Sonderbund sont mis au pas par les troupes fédérales du général Dufour.
Baldo et Cavour fondent le journal le Risorgimento. L’Italie du sud s’agite contre les Bourbons de Naples et celle du nord contre les Autrichiens.
Huit ans de guerre en Algérie entre l’émir Abd el Kader et le maréchal Bugeaud se terminent par la reddition de l’émir : grand religieux, philosophe, le personnage ne se battit pas tant au nom d’un nationalisme algérien que d’une religion qui voulait tout simplement faire repasser la mer aux Roumis. En faisant la guerre, l’émir ne faisait certes pas dans la dentelle, mais Bugeaud non plus qui, avec ses généraux Pélissier, Lamoricière, Cavaignac, pratiquaient les enfumades : on enferme un village entier dans une grotte et on y met devant un bon feu ! Huit ans de guerre ! car, pour le principal, chaque camp combattait à armes égales : les fusils étaient de la même génération : ce n’est que quinze ans plus tard que les fusils Chassepot qui se rechargent par la culasse donneront une écrasante supériorité aux troupes coloniales sur les troupes indigènes.
C’est peu de traverser les montagnes et de battre une ou deux fois les montagnards ; pour les réduire, il faut attaquer leurs intérêts […] ; il faut s’appesantir sur le territoire de chaque tribu ; il faut […] rester le temps nécessaire pour détruire les villages, couper les arbres fruitiers, brûler, ou arracher, les récoltes, vider les silos, fouiller les ravins, les rochers et les grottes, pour saisir les femmes, les enfants, les vieillards, les troupeaux et le mobilier ; ce n’est qu’ainsi qu’on peut faire capituler ces fiers montagnards.
Général Bugeaud De la stratégie, de la tactique, des retraites et du passage des défilés dans les montagnes des Kabyles. 1845
Je crois que notre nouvelle conquête est chose heureuse et grande. C’est la civilisation qui marche sur la barbarie. C’est un peuple éclairé qui va trouver un peuple dans la nuit. Nous sommes les Grecs du monde : c’est à nous d’illuminer le monde. Notre mission s’accomplit, je ne chante qu’hosanna.
Victor Hugo. Choses vues, publié à titre posthume sous la forme de 2 séries, en 1887, puis 1900
Gustave Flaubert est au château d’Amboise, où il dit le plus grand bien de pas mal de choses, puis commence à changer d’humeur en pénétrant à l’intérieur, et là, la montée d’adrénaline devient irrépressible et c’est un tir à boulets rouges sur toutes les méchancetés, imbécillités, que l’homme peut faire à la nature… un vrai festival de vacheries.
Dans le jardin, au milieu des lilas et des touffes d’arbustes, s’élève la chapelle, bijou d’orfèvrerie lapidaire du XVI° siècle, plus travaillé encore au-dedans qu’au dehors, taillé à jour comme un manche d’ombrelle chinoise. Sur la porte, un bas-relief très réjouissant représente la rencontre de saint Hubert avec le cerf mystique qui porte un crucifix entre les cornes. Le saint est à genoux ; plane au-dessus un ange qui va lui mettre une couronne sur son bonnet ; à côté, son cheval regard de sa bonne figure d’animal ; ses chiens jappent, et, sur la montagne dont les tranches et les facettes figurent des cristaux, le serpent qui rampe avance sa tête plate au pied d’arbres ressemblant à des choux fleurs. C’est l’arbre qu’on rencontre dans les vieilles bibles, sec de feuillages, gros de branches et de tronc, qui a du bois et du fruit, mais pas de verdure ; l’arbre symbolique, l’arbre théologique et dévot, presque fantastique dans sa laideur impossible. Non loin de là, saint Christophe porte Jésus sur ses épaules et saint Antoine est dans sa cellule, bâtie sur un rocher ; le cochon rentre dans son trou ; on n’en aperçoit que son derrière et sa queue terminée en trompette, tandis que près de lui un lièvre sort les oreilles de son terrier.
Ce bas-relief sans doute est un peu lourd et d’une plastique qui n’est pas rigoureuse. Mais il y a tant de vie et de mouvement dans ce bonhomme et ses animaux, tant de gentillesse et de bonne foi dans les détails, qu’on donnerait beaucoup pour emporter ça et pour l’avoir chez soi. Ça vaudrait bien les statuettes genre moyen âge qu’on trouve chez les coiffeurs, les sujets équestres d’Alfred de Dreux qu’on trouve chez les filles entretenues, et la Putiphar de M. Steuben qu’on ne trouve, Dieu merci, nulle part.
Dans l’intérieur du château, l’insipide ameublement de l’Empire se reproduit dans chaque pièce avec ses pendules mythologiques ou historiques et ses fauteuils de velours à clous dorés. Presque toutes sont ornées des bustes de Louis-Philippe et de Madame Adélaïde. La famille régnante actuelle a la rage de se reproduire en portraits. Elle peuple de sa figure tous les pans de murs, toutes les consoles ci les cheminées où elle peut l’y établir ; mauvais goût de parvenu, manie d’épicier enrichi dans les affaires et qui aime à se considérer avec du rouge, du blanc et du jaune, avec ses breloques au ventre, ses favoris au menton et ses enfants à ses côtés.
[…] La plupart des sujets intermédiaires ont du teste été enlevés, au grand désespoir des chercheurs de fantaisies drolatiques, enlevés de sang-froid, exprès, par décence, et comme nous le disait, d’un ton convaincu, le domestique de Sa Majesté, parce qu’il y en avait beaucoup qui étaient inconvenants pour les dames.
Personne ne peut m’accuser de m’avoir entendu gémir sur n’importe quelle dévastation que ce soit, sur n’importe quelle ruine ni débris ; je n’ai jamais soupiré à propos du ravage des révolutions ni des désastres du temps ; je ne serais même pas fâché que Paris fût retourné sens dessus dessous par un tremblement de terre ou se réveillât un beau matin avec un volcan au beau milieu de ses maisons, comme un gigantesque brûle-gueule qui fumerait dans sa barbe : il en résulterait peut-être des aquarelles assez coquettes et des ratatouilles grandioses dans le goût de Martins. Mais je porte une haine aiguë et perpétuelle à quiconque taille un arbre pour l’embellir, châtre un cheval pour l’affaiblir ; à tous ceux qui coupent les oreilles ou la queue des chiens, à tous ceux qui font des paons avec des ifs, des sphères et des pyramides avec du buis ; à tous ceux qui restaurent, badigeonnent, corrigent, aux éditeurs d’expurgata, aux chastes voileurs de nudités profanes, aux arrangeurs d’abrégés et de raccourcis ; à tous ceux qui rasent quoi que ce soit pour lui mettre une perruque, et qui, féroces dans leur pédantisme, impitoyables dans leur ineptie, s’en vont amputant la nature, ce bel art du bon Dieu, et crachant sur l’art, cette autre nature que l’homme porte en lui comme Jéhovah porte l’autre et qui est la cadette ou peut-être l’aînée. Qui sait ? C’est du moins l’idée d’Hegel que l’école empirique a toujours trouvée fort ridicule – et moi ?
Moi, j’ai des remords d’avoir eu la lâcheté de n’avoir pas étranglé de mes dix doigts l’homme qui a publié une édition de Molière que les familles honnêtes peuvent mettre sans danger dans les mains de leurs enfants ; je regrette de n’avoir pas à ma disposition, pour le misérable qui a sali Gil Blas des mêmes immondices de sa vertu, des supplices stercoraires et des agonies outrageantes ; et quant au brave idiot d’ecclésiastique belge qui a purifié Rabelais, que ne puis-je dans mon désir de vengeance réveiller le colosse pour lui voir seulement souffler dessus son haleine et pour lui entendre pousser sa hurlée titanique !
Le beau mal, vraiment, quand on lui aurait laissé intactes ces pauvres consoles où l’on devait voir de si jolies choses ! Ça faisait donc venir bien des rougeurs au front des voyageurs, ça épouvantait donc bien fort les vieilles Anglaises en boa, avec des engelures aux doigts et leurs pieds en battoirs, ou ça scandalisait dans sa morale quelque notaire honoraire, quelque monsieur décoré qui a des lunettes bleues et qui est cocu ! On aurait pu au moins comparer ça aux coutumes anciennes, aux idées de la Renaissance et aux manières modernes, qu’on aurait été retremper aux bonnes traditions, lesquelles ont furieusement baissé depuis le temps qu’on s’en sert. N’est ce pas monsieur ? Qu’en dit madame ?
L’origine de ces roboratives volées de bois vert contre tout l’univers des trafiquants, des faussaires, des embellisseurs, des costumeurs ? Un appétit rabelaisien de connaissances, l’émerveillement de l’enfant à essayer de deviner comment ça marche, l’enchantement devant la beauté de la création… – et tant pis si le second s’en retourne dans sa tombe -, mais il est bien vrai qu’il y a du François d’Assise dans cet homme-là.
Donc nous partîmes en avant, au-delà, sans nous soucier de la marée qui montait, ni s’il y aurait plus tard un passage pour regagner terre. Nous voulions jusqu’au bout abuser de notre plaisir et le savourer sans en rien perdre. Plus légers que le matin, nous sautions, nous courions sans fatigue ; sans obstacle, une verve de corps nous emportait malgré nous et nous éprouvions dans les muscles des espèces de tressaillements d’une volupté robuste et singulière. Nous secouions nos têtes au vent, et nous avions du plaisir à toucher les herbes avec nos mains. Aspirant l’odeur des flots, nous humions, nous évoquions à nous tout ce qu’il y avait de couleurs, de rayons, de murmures : le dessin des varechs, la douceur des grains de sable, la dureté du roc qui sonnait sous nos pieds, les altitudes de la falaise, la frange des vagues, les découpures du rivage, la voix de l’horizon ; et puis c’était la brise qui passait, comme d’invisibles baisers qui nous coulaient sur la figure, c’était le ciel où il y avait des nuages allant vite, roulant une poudre d’or, la lune qui se levait, les étoiles qui se montraient. Nous nous roulions l’esprit dans la profusion de ces splendeurs, nous en repaissions nos yeux ; nous en écartions les narines, nous en ouvrions les oreilles ; quelque chose de la vie des éléments émanant d’eux-mêmes, sous l’attraction de nos regards, arrivait jusqu’à nous, s’y assimilant, faisait que nous les comprenions dans un rapport moins éloigné, que nous les sentions plus avant, grâce à cette union plus complexe. À force de nous en pénétrer, d’y entrer, nous devenions nature aussi, nous sentions qu’elle gagnait sur nous et nous en avions une joie démesurée ; nous aurions voulu nous y perdre, être pris par elle ou l’emporter en nous. Ainsi que dans les transports de l’amour on souhaite plus de mains pour palper, plus de lèvres pour baiser, plus d’yeux pour voir, plus d’âme pour aimer, nous étalant sur la nature dans un ébattement plein de délire et de joies, nous regrettions que nos yeux ne pussent aller jusqu’au sein des rochers, jusqu’au fond des mers, jusqu’au bout du ciel, pour voir comment poussent les pierres, se font les flots, s’allument les étoiles ; que nos oreilles ne pussent entendre graviter dans la terre la formation du granit, la sève pousser dans les plantes, les coraux rouler dans les solitudes de l’océan et, dans la sympathie de cette effusion contemplative, nous eussions voulu que notre âme, s’irradiant partout, allât vivre dans toute cette vie pour revêtir toutes ses formes, durer comme elles et, se variant toujours, toujours pousser au soleil de l’éternité ses métamorphoses.
Gustave Flaubert. Par les champs et par les grèves Voyages. Arléa 2007
La même année, il est en compagnie de son ami Maxime du Camp à la pointe du Raz : Grandes ondulations arides et augmentant d’aridité en s’approchant de la pointe du Raz. Touffe de joncs marins très courts, le sol est pelé par places […] Ciel bleu, cormorans […]. Trou satanique, bouleversements, replis, indescriptible couleur des roches sous-marines. L’homme n’est pas fait pour vivre là, pour supporter la nature à haute dose.
Où se trouve la frontière entre dose normale dont il fait son bonheur dans la lande bretonne et haute dose, qui est insupportable à la Pointe du Raz… on peut rester dubitatif.
Le portrait qu’il dresse des Bretons est très proche de ceux du livre de Jean Marie Deguignet : Mémoires d’un paysan bas breton écrit 30 ans plus tard, mais qu’on pourrait soupçonner d’outrance tant son auteur est écorché vif, peu enclin à l’objectivité. Mais c’est bien la même misère, morale, physique, la même lourdeur des pieds qui collent à la glaise.
Au village de Rosporden nous avons revu les hommes que nous venions de quitter à Quimperlé : mêmes allures, mêmes habits, grand chapeau, grand gilet, veste bleue ou blanche, large ceinture de cuir, bragow-brass, galoches, mêmes aspects de visage, mêmes tournures de corps.
C’était jour de marché, la place était pleine de paysans, de charrettes et de bœufs ; on entendait sonner les rauques syllabes celtiques, mêlées au grognement des animaux et au claquement des charrettes, mais pas de confusion, d’éclats, ni rires dans les groupes, ni bavardages sur le seuil des cabarets, pas un homme ivre, pas de marchand ambulant, point de boutique de toile peinte pour les femmes ou de verroterie pour les enfants, rien de joyeux, de heurté, d’animé. Ceux qui veulent vendre attendent résignés et sans bouger le chaland qui vient à eux. Dans la place se promènent des couples de bœufs avec quelque enfant qui les retient par les cornes, ou bien trotte une maigre rosse au milieu de la foule qui s’écarte, sans jurer ni se plaindre. Puis on se regarde un instant, la convention se conclut et l’on s’en retourne chez soi sans s’attarder davantage. En effet le village est éloigné, la lande est grande, le soir arrive, il n’y a personne au logis, la mère est partie dans les tamarins couper des bourrées pour l’hiver, l’enfant est sur la côté à ramasser le varech ou à garder les moutons. Quant au valet de ferme, le plus souvent il n’y en a pas, chaque cultivateur ayant d’ordinaire un petit coin de terrain qu’il égratigne tout seul tant bien que mal et dont il est le maître, l’esclave plutôt ! puisqu’il s’use vainement dessus. L’homme ne pouvant engraisser la terre, la terre ne pouvant nourrir l’homme, pourquoi donc ne la quitte-t-il pas ? Pourquoi ne se vend-il pas comme le Suisse ? Ne s’exile-t-il point comme l’Alsacien ? Pourquoi y demeure-t-il avec un amour si opiniâtre ? Qui le sait ? Le sait-il lui-même ?
Nulle part donc vous ne rencontrez comme chez nous de ces gros fermiers cossus, ventrus, à la face avinée, à la sacoche bourrée d’argent, qui s’en viennent aux foires de campagne, y font grand bruit, y marchandent longuement, se disputent en criant, se tapent dans la main, maillent dans les cafés en jouant aux dominos, s’emplissent de viandes et d’eau-de-vie, boivent jusqu’à trente demi-tasses en un jour, et ne s’en retournent que bien tard dans la nuit, tout en s’endormant sur leur bidette qui trottine lentement le long du chemin jusqu’à ce qu’elle s’arrête d’elle-même à la barrière de la cour, en reconnaissant la bonne écurie où elle a de la litière jusqu’au ventre. Mais le paysan breton repart à jeun, il eût été trop cher de manger dehors ; il va retrouver sa galette de sarrasin et sa jatte de bouillie de maïs cuite depuis huit jours dont il se nourrit toute l’année, à côté des porcs qui rôdent sous la table et de la vache qui rumine là, sur son fumier, dans un coin de la même pièce.
D’ailleurs pourquoi serait-il gai ? Qu’a-t-il rapporté du bourg ? S’il a vendu son cheval, il lui faudra maintenant porter les fardeaux et traîner lui-même la charrue, belle avance ! À quoi lui sert le peu d’argent qu’il en a retiré ? Est-ce que tout à l’heure, ou demain, ou la semaine qui s’approche on ne va pas venir le lui demander dans une langue qu’il n’entend pas, au nom de la loi qu’il ignore ? Est-ce la peine d’en gagner ? Aussi travaille-t-il peu, mal, d’une façon ennuyée et sans s’inquiéter s’il pourrait mieux faire.
Méfiant, jaloux, ahuri par tout ce qu’il voit sans comprendre, il s’empresse donc bien vite de quitter la ville, le bourg, et de regagner sa chaumière cachée sous des arbres touffus, derrière la haie compacte, et là il se resserre étroitement dans la famille, à son foyer, auprès de son recteur, aux pieds du saint de l’église, et il y concentre son cœur qui, condensé sur lui-même, se double d’énergie. De tout ce qui se passe il ne sait rien, si ce n’est qu’à vingt ans son fils s’en ira se battre, puis qu’il y a une ville qui s’appelle Paris et que le roi de France est Louis-Philippe, dont il vous demandera des nouvelles, par interprète, en s’informant s’il vit encore, si vous le voyez souvent, et si vous dînez chez lui.
Quoi qu’il soit, l’étranger pour eux est toujours quelque chose d’extraordinaire, de vague et de miroitant dont ils voudraient bien se rendre compte ; on l’admire, on le contemple, on lui demande l’heure pour voir sa belle montre, on le dévore du regard, d’un regard curieux, envieux, haineux peut-être, car il est riche, lui, bien riche, il habite Paris, la ville lointaine, la ville énorme et retentissante.
Dès que vous arrivez quelque part, les mendiants se ruent sur vous et s’y cramponnent avec l’obstination de la faim. Vous leur donnez, ils restent ; vous leur donnez encore, leur nombre s’accroît, bientôt c’est une foule qui vous assiège. Vous aurez beau vider votre poche jusqu’au dernier liard, ils n’en demeurent pas moins acharnés à vos flancs, occupés à réciter leurs prières, lesquelles sont malheureusement fort longues et heureusement inintelligibles. Si vous stationnez, ils ne bougent ; si vous vous en allez, ils vous suivent ; rien n’y remédie, ni discours ni pantomime. On dirait un parti pris pour vous mettre en rage, leur ténacité est irritante, implacable. Comme on se prend à regretter alors les bonnes bassesses facétieuses du mendiant italien, faisant la roue devant votre carriole en vous traitant d’excellence, et l’aimable gueuserie insolente du gamin de Paris qui vous demande votre bout de cigare en vous appelant général et qui le ramasse dans la boue en vous riant au nez !
La pauvreté du Midi n’a rien qui attriste, elle se présente à vous pittoresque, colorée, rieuse, insouciante, chauffant ses poux à l’air chaud et dormant sous la treille ; mais celle du Nord, celle qui a froid, celle qui grelotte dans le brouillard et patauge nu-pieds dans la terre crasse, semble toujours humide de pleurs, engourdie, dolente, et méchante comme une bête malade. Ils sont si pauvres ! La viande pour eux est un luxe rare. Un de nos guides nous disait : C’est mon plus grand bonheur, comme je tape dessus quand j’en attrape ! Pour le pain, on n’en mange pas non plus tous les jours. Notre postillon de Locminé n’en avait point goûté depuis huit mois. Une telle existence n’embellit pas les races ; aussi rencontre-t-on quantité d’estropiés, de manchots, d’aveugles-nés, de bossus, de dartreux, de rachitiques ; ainsi que les chênes dont les chétifs s’étiolent au vent de la mer et dont les robustes n’en poussent que mieux, se durcissent aux gelées, ceux qui ont traversé toute cette misère sans y rien laisser n’en paraissent que plus sains, plus droits et plus solides. Ce sont ceux-là que vous voyez passer devant vous, si austères et si forts, taciturnes sous leurs longs cheveux comme leur pays sous sa sombre verdure.
Dans les villes, quoique la langue persiste, le caractère s’efface, le costume national devient plus rare, refoulé qu’il est dans la campagne par l’envahissement progressif du tailleur et de la couturière, dont la petite boutique du rez-de-chaussée étale à son vitrail quelque belle gravure de mode qui fait envie. L’habitant de la ville voit s’arrêter tous les soirs la diligence au bureau des messageries, il en retire bien quelque nouvelle, soit du postillon qui a causé avec le conducteur, ou du commissionnaire qui porte les paquets ; à la tombée du jour, il converse sur sa porte avec l’huissier, le commis de la mairie ou l’employé de la sous-préfecture, lesquels lisent les journaux et savent ce qui se passe dans le monde. Petit à petit, ainsi, il se désenbretonne et arrive à s’écarter du paysan qu’il méprise de plus en plus et qui s’éloigne de lui davantage, à mesure qu’ils se comprennent moins.
Ce qu’il y a encore de plus breton dans les villes, ce sont les pauvres filles qu’on fait venir pour servir comme domestiques. Confinées dans leur service, avec qui communiqueraient-elles pour perdre le caractère natal ? Voyez-les s’arrêter dans la rue avec l’homme qui apporte chaque semaine de la campagne les œufs et le beurre. Que leur dit-il ? Il leur parle de leur village, de leurs parents ; leur frère leur envoie pour cadeau de noces une belle paire de boucles d’argent, il faudra bien les porter ; il y aura bientôt un pardon, il faudra y venir. Elles iront donc et s’y retremperont à tout ce que la patrie a de plus distinctif, le langage et le costume ; aussi quand elles seront de retour chez leurs maîtres, leur cœur restera là-bas, et elles en causeront ensemble en se promenant comme elles font, par bandes de dix ou vingt, sur les places et à l’entrée de la grande route, le dimanche après les vêpres.
Ainsi se conserve au milieu d’une population déjà bâtarde ce petit peuple entêté, qui tournoie dans l’autre sans y perdre ses angles. À Quimper, à table d’hôte, en regardant la servante, fille large d’épaules, de visage âpre et d’une tenue rigide, avec son bonnet blanc, ses bouts de manche et son bavolet carré, qui servait des œufs à la neige à un gros monsieur à lunettes d’or, inspecteur des contributions indirectes, je me disais : Voilà donc les deux sociétés face à face et le rapport final d’un siècle à l’autre ! Le vieux portrait s’humilie devant la caricature moderne. D’où j’ai tiré cet axiome : le Présent fait cirer ses bottes par le Passé et ne l’en remercie même pas.
Gustave Flaubert. Par les champs et les grèves. Voyages. Arléa 2007
Qu’en est- il d’un pardon breton ?
On appelle Pardon en Bretagne une chapelle, une fontaine, un lieu consacré par le souvenir de quelques saint, de quelque miracle.
On s’y confesse, on communie, on y donne l’aumône, on se soumet à quelques pratiques superstitieuses, on achète des croix, des chapelets et des images qu’on fait toucher à la statue d’un demi-dieu ; on frotte son front, son genou, son bras paralysé contre une pierre merveilleuse, on jette des liards et des épingles dans les fontaines, on y trempe sa chemise pour guérir, sa ceinture pour accoucher sans peine, son enfant pour le rendre inaccessible à la douleur.
On se retire après avoir dansé, après s’être enivré, vidé d’argent mais riche d’espérance.
Jacques Cambry. Voyage dans le Finistère ou l’état de ce département en 1794 et 1795.
Autrefois, les femmes qui avaient leur mari en mer allaient balayer la chapelle voisine et en jetaient la poussière en l’air dans l’espérance que cette cérémonie procurerait un vent favorable à leur retour. On fouettait, jetait à l’eau les saints qui n’accordaient pas la demande qu’on leur faisait.
sur la plaque émaillée de la chapelle de Languidou, en pays bigouden.
Naissance de l’hymne national italien : Il Canto degli Italiani (ou Il Canto degl’Italiani), connu en Italie sous le nom d’Inno di Mameli – Hymne de Mameli -, il est nommé ailleurs par son incipit Fratelli d’Italia – Frères d’Italie -.
Son auteur, Goffredo Mameli, est étudiant, patriote et Génois, de 20 ans. Le texte sera mis en musique peu après par un autre Génois, Michele Novarro. Le Chant des Italiens est né dans le climat de ferveur patriotique qui précédait la guerre contre l’Autriche. Le caractère immédiat des vers et la vigueur de la mélodie en firent le chant préféré de l’unification italienne, non seulement pendant le Risorgimento mais également dans les décennies qui suivirent. Ce n’est pas un hasard si Giuseppe Verdi, dans son Inno delle Nazioni de 1862 attribuera justement au Canto degl’Italiani – et non à la Marcia Reale (Marche royale, alors hymne officiel du royaume italien) – le rôle de symbole italien.
Fratelli d’Italia,
L’Italia s’è desta,
Dell’elmo di Scipio
S’è cinta la testa.
Dov’è la vittoria ?
Le porga la chioma,
Che schiava di Roma
Iddio la creò. (2x)
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò !
Sì ! Noi fummo da secoli
Calpesti, derisi
Perché non siam Popolo
Perché siam divisi
Raccolgaci un’Unica
Bandiera una Speme
Di fonderci insieme
Già l’ora suonò
Uniamoci, amiamoci
L’unione e l’amore
Rivelano ai Popoli
Le vie del Signore
Giuriamo far Libero
Il suolo natìo
Uniti, per Dio,
Chi vincer ci può ?
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò.
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò !
Sì!Dall’Alpi a Sicilia
Dovunque è Legnano,
Ogn’uom di Ferruccio
Ha il core, ha la mano,
I bimbi d’Italia
Si chiaman Balilla
Il suon d’ogni squilla
I Vespri suonò
Son giunchi che piegano
Le spade vendute
Già l’Aquila d’Austria
Le penne ha perdute
Il sangue d’Italia e
Il sangue Polacco
Bevé col cosacco
Ma il cor le bruciò
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò
Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
Siam pronti alla morte
L’Italia chiamò! Sì!
Frères d’Italie
L’Italie s’est levée,
Du heaume de Scipion
Elle s’est ceint la tête.
Où est la Victoire ?
Qu’elle lui tende sa chevelure,
Car esclave de Rome
Dieu la créa. (2x)
Serrons-nous en cohortes
Nous sommes prêts à la mort
Nous sommes prêts à la mort
L’Italie appelle.
Serrons-nous en cohortes
Nous sommes prêts à la mort
Nous sommes prêts à la mort
L’Italie appelle !
Nous avons été depuis des siècles
Piétinés, moqués,
Parce que nous ne sommes pas un Peuple,
Parce que nous sommes divisés.
Que nous rassemble un Unique
Drapeau, un Espoir :
De nous fondre ensemble
L’heure a déjà sonné.
Unissons-nous, aimons-nous
L’union, et l’amour
Révèlent aux Peuples
Les voies du Seigneur ;
Jurons de Libérer
Le sol natal :
Unis par Dieu
Qui peut nous vaincre ?
Serrons-nous en cohortes
Nous sommes prêts à la mort
Nous sommes prêts à la mort
L’Italie appelle.
Serrons-nous en cohortes
Nous sommes prêts à la mort
Nous sommes prêts à la mort
L’Italie appelle !
Des Alpes à la Sicile
Partout est Legnano
Chaque homme de Ferrucio
A le cœur, a la main
Les enfants d’Italie
S’appellent Balilla,
Le son de chaque cloche
A sonné les Vêpres.
Sont des joncs qui ploient
Les épées vendues
L’Aigle d’Autriche
A déjà perdu ses plumes
Il a bu le sang d’Italie,
Le sang Polonais,
avec le cosaque,
Mais cela lui a brûlé le cœur.
Serrons-nous en cohortes
Nous sommes prêts à la mort
Nous sommes prêts à la mort
L’Italie appelle.
Serrons-nous en cohortes
Nous sommes prêts à la mort
Nous sommes prêts à la mort
L’Italie appelle !
__________________________________________________________________________________________________
[1] L’habitude était d’enfermer les documents écrits dans des tubes étanches et de les déposer soit dans un cairn, soit sous terre à une distance convenue, afin de prévenir la curiosité des esquimaux.
[2] Il paraît que cet usage est bien plus ancien, car le moine Rubrouck, envoyé en 1252 par saint Louis au grand Khan des Tartares, dit en parlant des femmes de la Haute Asie : Deturpant se turpiter pingendo facies suas. – Recueil de voyages et de mémoires publié par la Société de géographie. tom, IV. Page 233,(1852)
[3] Ceux qui ont trouvé ce nom ne se sont pas cassé le bonnet : il n’est autre que la transcription, en prenant les chiffres romains pour les lettres qu’ils sont à l’origine ; le lieu était ainsi défini sur les cartes marines, quand l’on vient du Brésil par la mer : c’était le sixième mont, d’Est en Ouest : Monte VI de E à O.