| Publié par (l.peltier) le 4 octobre 2008 | En savoir plus |
Janvier 1883
Howard Blackburn, 25 ans, marin américain de Gloucester, Massachussetts, est embarqué sur la Grace L. Fears, une goélette à doris, petit canot à fond plat, manié par deux marins, embarqué en plusieurs exemplaires sur ces goélettes pour poser et relever les lignes de fond. Restant quasiment à vue du navire, ils ne sont dotés d’aucun équipement de secours pas plus que de réserve d’eau ou de vivre. Ce jour-là voit se cumuler les pires conditions météorologiques : sautes de vent, tempête de neige, grosse mer et pour finir, le brouillard, autant d’éléments qui majorent les risques de se perdre et c’est ce qui se produit.
Il ne reste plus qu’une chose à faire : fixer un cap et ramer dans cette direction. La mort rapide de son compagnon va le laisser seul. Pendant quatre jours, pendant quatre nuits, il va ramer, sans boire, sans manger, sans dormir – les risques de ne jamais se réveiller étaient trop grands -, dans le froid, le vent, le canot rempli d’eau. Ses doigts gèlent : il les maintient tout de même recourbés sur le manche des avirons. Au bout des quatre jours, il touche Terre Neuve où les habitants le rétabliront de leur mieux : il va mettre trois mois pour récupérer : amputé des doigts et des orteils, il gardera une partie du pouce. L’argent gagné de son récit lui permettra d’ouvrir un tabac, puis un débit de boisson. Il créera la Gloucester Mining Company pour approvisionner la 2° ruée vers l’or, celle du Klondike, au Canada. En 1899, il construira le Great Western, un sloop de 9.10 m de long, avec lequel il traverse l’Atlantique de Gloucester E-U, à Gloucester G.B. Il fera encore construire le Great Republic, avec lequel il traversera encore l’Atlantique, de Gloucester au Portugal, en 39 jours.


The gaff-rigged Great Western was not an easy boat for a man with no fingers to sail
1 02 1883
Le procédé Thomas de déphosphoration de la fonte permet d’obtenir la première coulée d’acier, aux usines Wendel à Hayange. Robert de Wendel, qui avait refusé la nationalité allemande, se retrouvera en 1898 à la tête du Comité des forges français, alors que son frère Henri siégeait au Reichstag allemand.
6 02 1883
Marcel Deprez parvient à transporter à distance – 20 km pour commencer – de l’électricité.
29 03 1883
Ernest Renan donne une conférence à la Sorbonne : L’islamisme et la science : Toute personne un peu instruite des choses de notre temps voit clairement l’infériorité actuelle des pays musulmans, la décadence des États gouvernés par l’islam, la nullité intellectuelle des races qui tiennent uniquement de cette religion leur culture et leur éducation. Tous ceux qui ont été en Orient ou en Afrique sont frappés de ce qu’a de fatalement borné l’esprit d’un vrai croyant, de cette espèce de cercle de fer qui entoure la tête, la rend absolument fermée à la science, incapable de rien apprendre ni de s’ouvrir à aucune idée nouvelle.
Et ce n’est pas là divagation accidentelle d’un jour… quelque trente ans plus tôt, on pouvait déjà lire sous sa plume : Une nation qui ne colonise pas est irrévocablement vouée au socialisme, à la guerre du riche au pauvre. La conquête d’un pays de race inférieure par une race supérieure n’a rien de choquant […] Autant les conquêtes entre races égales doivent être blâmées, autant la régénération des races inférieures par les races supérieures est dans l’ordre providentiel de l’humanité […]. Une race de maîtres et de soldats, c’est la race européenne.
Ernest Renan. La réforme intellectuelle et morale. Paris Calmann-Levy 1850
9 05 1883
Pour lutter contre les pavillons noirs qui pillent le sud de la Chine, la France a envoyé en 1880 des troupes au Tonkin, entrant ainsi en conflit avec Tu-Duc, l’empereur d’Annam. À Hanoï, le commandant Rivière tombe dans une embuscade : il est décapité par les Pavillons noirs. Jules Ferry demande une riposte énergique à la division navale commandée par l’amiral Courbet en attaquant la capitale impériale, Hué.
26 05 1883
Pour le sacre du Tsar Alexandre III, les Russes consacrent la Cathédrale du Christ Sauveur à Moscou, construite en souvenir de la grande guerre patriotique contre Napoléon ; Constantin Thon en a été l’architecte et Tchaïkovski voit jouer pour la première fois son Ouverture solennelle 1812, composée aussi en mémoire de cette guerre. Elle sera détruite, sur ordre de Staline, le 5 décembre 1931, puis reconstruite à partir de 1995 et consacrée le 22 août 2000.

par Fiodor Klages, 1883
16 06 1883
Les Assomptionnistes créent le journal La Croix.
21 07 1883
Au siège de la Société historique du Cercle Saint Simon, le diplomate Paul Cambon réunit une brochette très éclectique d’esprits éclairés, pour créer l’Alliance Française. Elle fondera et subventionnera à l’étranger des écoles françaises, formera des maîtres, offrira bourses et récompenses, organisera des conférences.
Il fallait réparer l’échec des armées par la séduction de la culture. Les fondateurs de l’Alliance ont eu le génie de faire appel aux amoureux de la langue française, à des étrangers influents dans leur pays, qui ont crée des structures locales animées par des bénévoles. Un cas unique dans le monde des associations culturelles.
Jean-Pierre de Launoit, président belge de l’Alliance Française en 2008.
Au début du XXI° siècle, l’Alliance affiche une bien belle santé : 1 070 antennes dans 133 pays, animées par 12 000 personnes, principalement bénévoles, dont environ 8 000 enseignants, s’adressant à 442 000 élèves, l’activité culturelle plus large atteignant 6 millions de personnes. Mais, les budgets subissent une cure d’amaigrissement, et en 2013, on ne comptera plus que 857 Alliances françaises, dont 445 reçoivent une dotation de l’État. En parallèle, le réseau diplomatique de la France reste le troisième du monde, derrière les États-Unis et la Chine, avec 163 ambassades, dont le service culturel anime les Instituts Français qui assurent eux aussi l’enseignement du français.
18 08 1883
Émile Trélat fait adopter le système anglais de la chasse d’eau : quatre ans plus tard, Eugène Poubelle l’imposera à Paris.
20 08 1883
Les Français prennent Hué, capitale de l’Annam : Les Français sont entrés par deux cotés à la fois dans le grand fort circulaire que les obus de l’escadre ont déjà rempli de morts. Les derniers Annamites qui s’y étaient réfugiés se sauvent, dégringolent des murs, absolument affolés ; quelques uns se jettent à la nage, d’autres essaient de passer la rivière, dans des barques, ou à gué, pour se réfugier sur la rive sud. Les Français , qui sont montés sur les murailles du fort, tirent sur eux, de haut en bas, presque à bout portant, et les abattent en masse. Ceux qui sont dans l’eau essaient de se couvrir naïvement avec des nattes, des boucliers d’osier, des morceaux de tôle ; les balles françaises traversent le tout. Les Annamites tombent par groupes, les bras étendus ; trois ou quatre cents d’entre eux sont fauchés en moins de cinq minutes par les feux rapides et les feux de salve. Les marins cessent de tirer, par pitié, et laissent fuir le reste ; il y aura bien assez de cadavres dans le fort à déblayer ce soir avant l’heure de se coucher.
Pierre Loti, attaché à l’escadre d’Extrême Orient, grand reporter pour le Figaro, le 28 septembre 1883
L’absurde et folle expédition du Tonkin, venait d’être décrétée par l’un des plus néfastes de nos gouvernants : on envoyait là-bas, pour un but stérile, des milliers d’enfants de France qui ne devaient jamais revenir. Lieutenant de vaisseau à bord d’un de nos cuirassés d’escadre, j’allais prendre part au bombardement de Hué en Annam.
Pierre Loti. Prime jeunesse 1919.
27 08 1883
Entre Java et Sumatra, dans les îles de la Sonde, le volcan Krakatoa [1] est en éruption depuis le 20 mai. Depuis deux jours, l’éruption est à son point culminant… détonations et explosions sont entendues à Singapour et en Australie… un panache de fumée s’élève à quinze km de haut… poussières et fragments de ponce, projetées de 70 à 80 km de hauteur, se satellisent, devenant plusieurs fois visibles depuis la France. À 18 000 km de là, des lueurs rougeoyantes embrasent le ciel des États-Unis. Les effondrements provoquent un raz de marée, avec des vagues de 46 mètres de haut : un bateau de guerre hollandais, le Berouw, et une canonnière sont emportés à plus de 3 km à l’intérieur des terres ; on comptera trente six mille quatre cents dix sept morts. On va ressentir jusque dans le golfe de Gascogne et dans la Manche une oscillation anormale des eaux. Le nuage de poussière qui voile le soleil abaisse d’un demi-degré Celsius la température moyenne du globe pendant un an. On enregistrera dans le monde entier des chutes de neige record durant l’hiver suivant. Les esprits en seront durablement marqués en France au point d’assurer le succès dans les années 1950 de la bande dessinée Jo et Zette (et leur singe Jocco) dont l’action se passe sur les lieux.
30 08 1883
En France, 614 magistrats hostiles au régime républicain sont exclus de la magistrature.
8 10 1883
Albert et Gaston Tissandier s’envolent à bord d’un dirigeable à moteur électrique, d’Auteuil à Croissy sur Seine.
4 10 1883
Georges Nagelmackers, belge de 38 ans, a décidé d’importer en Europe le principe des wagons de luxe que George Pullman a crées aux Etats-Unis. En 1872, il a crée la Compagnie des wagons-lits, et, succès aidant, il poursuit et inaugure le premier Orient Express, appelé alors Direct d’Orient : il relie Strasbourg à Giurgiu en Roumanie, via Vienne, Budapest, Bucarest. Pour avoir un réseau international, il fallait que l’écartement des rails soit partout le même : il y parviendra. Et ce sera le début de ces grands trains de rêve : la Flèche d’or, la Transsibérien, l’Étoile du nord, le Train Bleu. Ils deviendront support d’inspiration pour nombre d’artistes : un ballet de Darius Milhaud, des textes de Jean Cocteau, des costumes de Coco Chanel, des rideaux de Picasso. Sidney Lumet y tournera son Crime de l’Orient Express. Il emmènera à Constantinople des riches qui ne peuvent se contenter d’un hôtel classique : cela donnera naissance au Pera Palace de Constantinople, inauguré en 1892. Ce train va devenir l’emblème d’une Europe qui s’est faite avant l’heure. Nous reste en France aujourd’hui Le Train Bleu, l’excellent restaurant de la gare de Lyon, à Paris.

à la fin de la première guerre mondiale, les Alliés imposeront à la Compagnie d’éviter l’Allemagne, ce que rendra possible la récente ouverture du tunnel ferroviaire du Simplon : le train passera alors par l’Italie du Nord, Venise, Trieste, Belgrade.

L’Orient Express

Le salon de l’Orient-Express.

Le Venise-Simplon-Orient-Express

Pera Palace Hôtel Istanbul.
22 10 1883
Premier tramway électrique à Annemasse.
20 11 1883
La loi essaie de clarifier les rapports complexes entre l’État et les compagnies ferroviaires. L’État offre la concession, il impose les parcours et les conditions d’établissement… il, en fait, ce sont les ingénieurs des Ponts et Chaussées. À partir du Second Empire, moment où la puissance publique exige la construction de lignes de moins en moins rentables, l’État peut offrir des subventions avec sa garantie d’intérêt aux nouveaux capitaux investis. La balance des transferts sera progressivement défavorable aux sociétés concessionnaires durant la seconde partie du XIX° siècle. La compagnie la plus fragile, celle du Chemin de fer de l’Ouest, devient structurellement déficitaire : elle sera nationalisée en 1908.
1883
200 000 chômeurs à Paris. Procès à Lyon de 66 anarchistes.
À l’issue d’une guerre de quatre ans perdue contre le Chili, la Bolivie perd sa façade océanique. En 2009, elle projettera un tunnel pour retrouver un accès au Pacifique, par-dessous les 150 km de la frontière entre le Chili et le Pérou.
L’américain Watermann crée le premier stylo à plume. À Chicago, on utilise pour la première fois une ossature métallique pour la construction d’un immeuble de dix étages ; à New York, un pont suspendu relie Brooklyn à Manhattan, et à l’autre bout du pays, à San Francisco, on termine le Golden Gate Bridge, long de 2 737 m.
William Frederik Cody – alias Buffalo Bill – a été jusqu’alors un des meilleurs représentants de la conquête de l’Ouest. Il a commencé par encadrer les convois de chariots, puis est devenu, pour le compte de la compagnie de chemin de fer Kansas Pacific chasseur de bisons : ce sont les employés du chemin de fer qui lui donneront son surnom : au bout de dix-sept mois, le bonhomme se targuait d’en avoir abattu 4 280 ! Rapporté aux carcasses des 31 millions de bisons, vendues comme fertilisants dans le Kansas de 1868 à 1881, le chiffre paraît vraisemblable. 31 millions sur 13 ans, cela signifie une moyenne de plus de 6500 bisons abattus par jour ! Fallait-il que la bêtise soit seule à occuper la cervelle de ces gens pour expliquer pareil massacre qu’aucun barbare n’avait jamais été en mesure de commettre !
Buffalo Bill est déjà connu du général Sheridan, le chef des tuniques bleues, de Gordon Bennet, le patron du New York Herald, de Stanley, mais son coup de génie va consister à faire du spectacle ambulant qu’il avait monté depuis 1872, un spectacle beaucoup plus ambitieux, faisant de sa propre vie une véritable saga : Wide West Show ; il s’entourera de vrais Indiens, pas rancuniers ni vraiment fiers – Sitting Bull, Geronimo -, deviendra héros national à New York, ira, sur les conseils de Mark Twain, le représenter en Europe, devant la reine Victoria à Londres, devant le président Sadi Carnot à Paris, en 1905, où il aura pour spectateur enthousiaste Jean de Baroncelli, père de la Camargue contemporaine revisitée par l’industrie touristique. Il est l’inventeur du cow-boy [2], l’homme de la conquête de l’Ouest.

L’original de Ghost riders in the sky, chanté pour la première fois par Burl Ives en février 1949, est de Stan Jones en 1948, paroles et musique ; Les Cavaliers du Ciel, avec les paroles de Louis Amade et Jo Frachon et la musique de Stan Jones en 1949, est une traduction, qui aura comme interprètes André Breton, un chanteur québécois, Armand Mestral, les Compagnons de la chanson.
| Ghost riders in the sky | Les cavaliers du ciel | |
| An old cowboy went riding out one dark and windy day | Dans le grand vent qui court le long de la plaine endormie | |
| Upon a ranch he rested as he went along his way | Un vieux cowboy sur son cheval avance dans la nuit | |
| When all at once a mighty herd of red eyed cows he saw | Tandis qu’il va sous le brouillard poursuivant son chemin | |
| A plowing through the ragged sky and up the cloudy draw | Il voit surgissant des ravins des chevauchées sans fin. | |
| Their brands were still on fire and their hooves were made of steel | De noirs taureaux les yeux brillants, les sabots en argent, | |
| Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel | Crachant par leurs naseaux des jets de feu des jets de sang | |
| A bolt of fear went through him as they thundered through the sky | Ils vont criant la peur troupeau maudit de Lucifer | |
| For he saw the Riders coming hard and he heard their mournful cry | Surgi dans un galop de fer des portes de l’enfer. | |
| Yippie yi yaaaay Yipie yi ooooh |
Yippie ah eh ! yippie ah oh ! | |
| Ghost Riders in the sky |
Les cavaliers du ciel. | |
| Their faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat |
Alors courant ivres de sang après tous ces troupeaux | |
| He’s riding hard to catch that herd, but he ain’t caught ’em yet |
Les cavaliers de tous les temps saisissant leurs lassos | |
| ‘Cause they’ve got to ride forever on that range up in the sky |
Couverts de boue couverts de pluie vont courant l’infini | |
| On horses snorting fire as they ride on hear their cry |
Leurs vies ressemblent à l’agonie de vieux mourants maudits. | |
| As the riders loped on by him he heard one call his name |
Le vieux cowboy entend son nom crié par une voix | |
| If you want to save your soul from Hell a-riding on our range |
La voix d’un cavalier disant : Copain prends garde à toi | |
| Then cowboy change your ways today or with us you will ride |
Il faut changer ta vie pour ne pas poursuivre avec nous | |
| Trying to catch the Devil’s herd, across these endless skies |
Couvert de sang couvert de boue l’éternité des fous. | |
| Yippie yi yaaaay Yipie yi ooooh |
Yippie ah eh ! yippie ah oh ! | |
| Ghost Riders in the sky |
Les cavaliers du ciel. |
*****
Je me souviens encore de la première fois que je l’ai vu, au printemps 1881. C’était dans les collines des Gabilan, près du Rancho Rincôn de la Puente del Monte, où j’étais parti seul camper. J’avais un très bon cheval en plus de deux autres bonnes montures et je m’apprêtais à me faire à dîner sous un chêne vert quand ces quatre types sont arrivés sur leurs canassons. Le premier était très grand, mal rasé, la trentaine, avec une voix de stentor ; il y en avait deux autres, de taille moyenne, l’allure de cowboys tout ce qu’il y a de plus ordinaire, sauf pour leurs vêtements crasseux et leurs chevaux couverts de sueur ; le quatrième était un tout jeune gars, pas bien grand, aux cheveux blonds avec des reflets roux. Tous avaient des Winchesters posées en travers du pommeau de leur selle et une paire de revolvers aux hanches. Accroupi devant mon feu de bois de manzanita je pensais au souper solitaire qui s’annonçait, et j’étais en train de me dire que ça aurait été rudement bien d’avoir de la compagnie, de dîner avec quelqu’un de confiance qui ne me trouerait pas la peau dès que j’aurais le dos tourné. J’étais resté à jouer avec le feu en me félicitant du beau pays que c’était, avec ces collines dorées piquetées de mesquites et de chênes verts, ce ciel bleu et clair et ce soleil bien jaune, et je me sentais dans une telle forme que je me faisais déjà toute une idée du bon repas que j’allais manger, lorsque j’ai entendu les chevaux approcher. Je me suis retourné et j’ai vu quatre cavaliers qui venaient de l’est et trottaient dans ma direction. Ils ont approché sans faire un signe. Ils sont montés jusqu’à mon bivouac et m’ont fixé en silence. Une drôle de sensation m’a parcouru l’échiné, comme si j’avais commis une erreur fatale, et j’ai senti une amertume dans ma bouche qui commençait à se dessécher.
Salut, j’ai dit. Venez donc casser la croûte avec moi.
Ils lorgnaient mes chevaux sans rien dire. Le plus grand a mis pied à terre, a craché sur le feu et s’est adressé à moi, les pouces coincés dans son ceinturon.
T’en as pas besoin de ces chevaux.
Vous faites erreur, j’ai répondu.
Il s’est dirigé vers mes deux bourrins et s’est emparé des rênes. Je l’ai attrapé par l’épaule pour le faire tourner sur lui-même et il a tenté de saisir son arme, mais elle était encore à moitié dans son étui qu’il m’entendait déjà armer la mienne dans un cliquetis, et il s’est empressé de tout lâcher. Il a levé les yeux vers ses compagnons. Le jeune gars avait le sourire aux lèvres. Puis il a parlé :
Vas-y, Bob. Descends-le.
L’un des deux autres types s’est mis à rire.
Vas-y, Bob a répété le plus jeune.
Le grand a laissé échapper un grognement et le cadet de la bande a eu un drôle de rire tramant. Je les regardais, persuadé qu’ils allaient me tomber dessus et que ma dernière heure était venue. Le feu de bois de manzanita produisait une épaisse fumée ; le grand gars a toussé et le jeune s’est remis à rire avant de s’adresser à moi d’une voix calme.
On n’en a pas après tes chevaux.
Remontez en selle monsieur, j’ai dit.
T’as dégainé rudement vite, a fait l’un d’eux.
T’en veux combien ? m’a demandé le grand gars de sa voix râpeuse.
Ils ne sont pas à vendre.
Allons-y, a dit le jeune, en tournant la bride de son cheval.
C’est d’bons chevaux Kid, a protesté le grand gars.
Allons-y, a répété le plus jeune.
L’homme est remonté en selle.
C’est toi le Kid ? j’ai dit.
Il a souri et a lorgné mon arme.
Tu peux ranger ça. On n’te cherche pas d’histoires.
Il a sauté à terre et s’est approché de moi.
J’ai rengainé mon pistolet en me disant que c’était peut-être maintenant qu’ils allaient me faire la peau. Il était petit, imberbe, avec des yeux d’enfant et un corps svelte d’adolescent. Il marchait du pas souple d’un félin, ses éperons sonnaient et les grosses molettes pivotaient lentement. Il avait ce drôle de rictus ; sa bouche s’étirait pour découvrir ses dents et former un tas de petites rides bien serrées, elle faisait comme ça, sa bouche, à chaque fois qu’il parlait, et c’était à se demander si elle souriait de la même façon pendant son sommeil. Les rides étaient incrustées dans son visage et visibles même quand il ne souriait pas. À l’époque, j’étais loin de me douter qu’il arborerait ce sourire jusque sur son lit de mort, et que je serais à ses côtés pour veiller son corps – son dernier et son meilleur ami -.
Si t’as rien d’autre à faire, pourquoi ne pas te joindre à nous ? il a fait.
Qu’est-ce qui te fait penser que je te serais utile ?
T’en fais pas pour ça, Doc.
Et comment tu connais mon nom ?
Entendu dire que t’étais dans le coin. On m’a décrit à quoi tu ressemblais. Difficile de se méprendre sur un type qui dégaine comme ça.
Marché conclu.
On s’est serré la main et le Kid s’est adressé au grand costaud :
Bob, trouve-nous de quoi manger, mais j’ai vu que le type n’appréciait pas trop et j’ai dit :
Laisse donc, Kid, je m’en occupe. Venez casser la croûte, les gars.
Et c’est comme ça que tout a commencé.
[…] Qu’il était doux aussi de descendre à cheval jusqu’à la ville depuis la Punta en traversant au pas les pins de Devil’s Hill, à jouir de la vue sur l’arrondi de la baie qui se déployait sous nos yeux, avec les maisons en adobe luisant au soleil, les dunes jaunes qui s’étalaient vers le nord, piquées de pins maritimes, les nuages au-dessus de Santa Cruz là-bas au loin, et les bandeaux de brouillard gris qui s’attardaient ou filaient rapidement, assombrissant l’ensemble. Et c’était bon de s’appuyer sur l’arrière de sa selle, d’étirer ses jambes contre les étriers de bois, de fumer une cigarette fraîchement roulée et de sentir nos montures sous notre poids, l’allure tranquille, qui scrutaient les alentours comme pour examiner quelque chose et agitaient leurs oreilles en hennissant, laissant de temps à autre échapper un soupir comme si elles avaient trimé toute la journée, et exhalant une forte odeur de sueur, de champ, et de cuir usé.
Comprenez bien qu’à l’époque quand on se pointait en ville, ce n’était pas sur invitation. Pour vous dire à quel point celle-ci avait de la classe, sachez que là-bas, les gens ne s’enfuyaient pas, ne se cachaient pas, mais continuaient simplement à vaquer à leurs occupations, habitués qu’ils étaient à commercer avec tout le monde, même les hommes armés. La loi disait qu’il fallait laisser ses armes à feu en dehors de la ville, mais on les portait sur les hanches et on les fourrait sous nos selles. Sans ça, on aurait risqué l’embuscade ou carrément de se faire descendre sur la Calle Principal. Je parle de l’époque d’avant l’évasion du Kid ; après ça on n’aurait pas pu y retourner à moins d’avoir un canon avec nous.
On arpentait la Calle Principal ou la Calle de Alvarado et on passait en revue les boutiques. On aimait descendre au bureau des Douanes et paresser sous le portique, ou se rendre à l’Hôtel Washington pour dîner avec tout le tralala – linge de table, argenterie, rince-doigts – ou chez Simoneau pour manger à la française, et parfois on avait l’impression d’être les seuls à marcher dans cette ville car presque tout le monde était à cheval, même quand ils n’allaient qu’à deux rues de là. On savait que ce n’était pas une grande cité. On avait été à Frisco et on voyait la différence. Mais c’était une chouette bourgade qui avait connu son heure de gloire, du temps des Espagnols. La ruée vers l’or l’avait ruinée mais ce qu’on entend par ruine, c’est toujours une question de point de vue. Pour certains, les commerçants par exemple, c‘avait causé sa perte, mais pour d’autres, comme les gens du cru, ça l’avait sauvée. Une ville paisible, même si de temps en temps quelqu’un comme Tiburcio Vasquez, Joaquin Murietta ou le Kid venait y mettre un peu d’animation.
Charles Neider. La véritable histoire de la mort d’Hendry Jones. Passage du Nord-Ouest 2014
Monterey…. Salinas, on est au sud, sud-est de San Francisco. Lorsque cette fine équipe après la spectaculaire évasion du Kid de la prison de Monterey se dirigera à marche forcée vers le Mexique puis fera demi-tour pour régler des affaires en suspens, elle passera dans des villages qui avaient pour nom Malibu, Santa Monica, aujourd’hui essentiellement résidences de stars de la jet set : donc, à cette époque, Los Angeles n’existait pas.
De ses origines jusqu’à nos jours, l’histoire des États-Unis fût surtout l’histoire de la colonisation du Great West. L’existence d’une zone de terres vacantes, son recul continu et la progression des pionniers vers l’ouest expliquent l’expansion américaine. […]
Pour étudier la colonisation de l’Amérique, il faut d’abord rechercher comment le mode de vie européen a pénétré en terre américaine et comment l’Amérique l’a modifié ensuite en le développant et en influençant l’Europe à son tour. Notre histoire doit commencer par l’analyse des germes européens et de leur éclosion en milieu américain. Ceux qui s’intéressent à nos institutions accordent trop d’importance aux origines germaniques au détriment des facteurs américains. La frontière est le facteur d’américanisation le plus rapide et le plus efficace. La nature sauvage s’impose au colon. Elle accueille un homme aux vêtements, aux activités, aux instruments, aux modes de transport et de pensée européens, le fait passer du wagon de chemin de fer au canot d’écorce, le dépouille des divers attributs de la civilisation pour lui faire porter des mocassins et des vêtements de chasse. Puis, elle l’installe dans la cabane de rondins des Cherokees ou des Iroquois et dresse autour de lui une palissade indienne. Le colon sème bientôt du maïs et laboure le sol avec un bâton pointu. Il ne tarde pas à pousser un cri de guerre et à scalper de la façon la plus orthodoxe. Bref, la frontière constitue d’abord un milieu trop hostile pour l’homme, qui doit en accepter les conditions ou périr. Aussi celui-ci s’installe-t-il dans les clairières et suit-il les pistes tracées par les Indiens. Peu à peu, il transforme cette nature sauvage. Il n’en résulte pas pour autant un reproduction de la vieille Europe ou une simple éclosion des germes allemands initiaux, mais un produit nouveau, typiquement américain. La première frontière fût la côte atlantique, qui était pour ainsi dire la frontière de l’Europe. En se déplaçant vers l’Ouest, la frontière s’est progressivement américanisée. Telles des moraines frontales qu’entraînent des glaciations successives, les frontières laissent des traces derrière elles. Et lorsque la zone frontière est colonisée, elle conserve ses anciennes caractéristiques. Cette progression de la frontière a correspondu à une libération progressive vis-à-vis de l’Europe et à un essor continu de l’indépendance sur des bases américaines.
Etudier le déplacement de la frontière, avec ses incidences politiques, économiques et sociales, et la condition des hommes qui vécurent à cette époque, c’est étudier la partie véritablement américaine de notre histoire.
Frederick J. Turner. Discours à l’exposition universelle de Chicago en 1893.
Pourtant, aujourd’hui encore, on comprend mal comment des hommes aient pu songer à s’établir en contrebas d’un causse rouge si salement cabossé, dans le fond plat d’une vallée aux flancs asymétriques où descendaient à l’aube hyènes et lynx aux incisives encore ensanglantées. Oui, on comprend mal comment des crève-la-faim fanatiques, portés par la seule mission de donner une terre à leur culte, un culte à leur dieu, un dieu à leur trépas, avaient réussi à traverser le continent dans toute sa largeur, à tailler la prairie et les montagnes, trouvant en chemin une herbe assez haute pour nourrir leurs bêtes, à se frayer un passage dans la forêt de cactus qui ceinturait la plaine – des plantes aux ramures aiguisées comme des coupe-choux ou tout autre sabre d’abattis – frontière de barbelés de la hauteur d’un homme à cheval, comment ils avaient étranglé à mains nues les serpents à sonnette, passé par le fond des canyons, comment ils avaient contourné les étangs glauques mués en lac gelé l’hiver, en réserve à moustiques mortifères l’été. Comment ils avaient bravé la chaleur de bête et le froid de gueux. Chassé le daim, piégé le lièvre, harponné les tanches. Tué des Indiens. Comment ils y avaient traîné les leurs entassés à bord de chariots crasseux, construit des maisons, élevé des bisons, engraissé des porcs, enclos des champs de patates et de maïs pour nourrir le tout. Combien de cadavres et combien de dingues au bout de la route ? Combien de chevaux dépecés en steaks sur des feux primitifs ? Combien de scalps ? Comment ils avaient pu y rester surtout, et continuer à y prendre femme, à y faire des enfants, à y enterrer leurs morts, printemps été automne hiver, une année, puis deux, puis dix, printemps été automne hiver, continuer à y brûler des cervelles et à y trouer des poitrines, à y éviscérer des corps, printemps été automne hiver, comment ils avaient fait, oui, on se le demande vraiment, car demeurer là, sur cette langue de terre évasée comme un jupon sur le bord du fleuve, grandir entre les hautes plaines et la forêt hurlante, y prendre racine, c’était tout de même défier le Ciel et la Création, prétendre à tutoyer le coyote et enfumer le grizzly, à boire de la neige fondue jusqu’à se coller la chiasse, à faire rôtir les scorpions accroupis épaule contre épaule, à cracher du sable et frotter du silex. Ils l’ont fait pourtant, ces hommes barbus aux cheveux de chanvre, ces femmes en bonnet, ces enfants fiévreux, tous sales et morts de peur psalmodiant des cantiques la main sur la gâchette, tous meurtriers : ils ont fondé une ville.
Or ils ne s’étaient pas trompés. Le coin valait le coup et plus encore la peine – les crevasses de larmes et les cloques putrides, les engelures marteaux à fendre leurs pieds pâles : la vallée est large de sept kilomètres frayée entre les plateaux et le maquis géant, plate, une paume, et pourvue d’un fleuve sur son flanc ouest. Un climat rude mais loyal, décliné à la régulière solstice après solstice – du papier à musique, la scansion de leur vie, le portant de leurs jours, monotonie dont ils finissaient par mourir -, étés brûlants liquidés en orages avec ciel électrique et grêlons comme des balles de ping-pong, automnes éclatants, hivers glacés, printemps souverains, de la douceur alors, une douceur de clairière, mille nuances de vert, chevaux au pas dans la prairie, jeunesse et force des roseaux, air acide et eau qui bruite. Et il y a ces vents violents surgis par l’est, chargés du lœss qu’ils ramassent sur les plateaux, lequel imprègne le sol, ensemence la vallée, engraisse le bétail comme crème sur beurre. Arrivant, les hommes qui le pouvaient encore avaient mis genou au sol et porté à leur bouche une pincée de terre pour la goûter d’un claquement de langue – puisque là était le geste -, puis ils s’étaient relevés, avaient tournoyé sur eux-mêmes, lancé leur chapeau en l’air et hurlé on y est, c’est là, putain on y est, on est arrivés – de toute manière ils n’avaient plus le choix, c’était là ou jamais, les chevaux avaient la fièvre, les enfants ne parlaient plus, le ventre des femmes se couvrait d’eczéma et eux-mêmes devenaient fous.
Les premiers temps, Coca se ramasse en position de tortue. Les pionniers sont seuls au monde, terrifiés, convaincus de leur supériorité, arc-boutés sur leur élection. Ils s’installent, ils colonisent. Ils procèdent avec méthode, comme les Grecs : délimitent le territoire, placent le sanctuaire, tracent des lignes au sol, fichent des barrières, édifient des maisons, partagent les terres arables. Ils ratent, établie à trente miles au sud, la vieille mission espagnole si régulièrement décimée par les raids indiens, la dysenterie, les fièvres, qu’elle ne compte plus qu’une trentaine de membres, et encore, faut voir l’état des mecs – aucun parmi eux ne saurait raconter ce matin de janvier où, deux cents ans plus tôt, trois caravelles de quarante tonneaux, coriaces coques noires et voiles usées jusqu’à la corde, trouent les brumes océaniques, approchent des côtes, déchargent sur la plage prêtres et soldats, poudre, calices, marmites, barriques, bibles et encensoir ; aucun ne saurait faire ce récit : à peine les hommes posent-ils un pied à terre qu’ils font exactement ce pour quoi ils sont venus, ils s’éparpillent çà et là le long de la côte, érigent des camps cernés de petites murailles entre lesquelles sonnent bientôt de lourdes cloches catholiques, fers de lance et bases arrière de l’évangélisation, cultivent, chassent, chantent, baptisent tout ce qui leur est présenté, les Écritures dans une main, le mousquet dans l’autre, et commencent à crever d’isolement, vraiment ils crèvent, se pendent carrément, ou se noient, se bousillent les entrailles à l’alcool de racine ; et aucun ne saurait plus imaginer le moine franciscain de vingt ans, gosse halluciné au faciès de capucin (le singe) qui vers 1630 s’enfonce dans les terres suivant la rive orientale du fleuve, vingt hommes à sa suite, et qui, au terme de sept semaines de marche, dresse un autel de fortune dans une prairie au pied du causse et célèbre l’eucharistie, le fleuve miroitant un crucifix de bois : mission accomplie, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes à Santa Maria de Coca.
Maylis de Kerangal. Naissance d’un pont. Verticales 2010
Charles de Foucauld, bien avant d’entrer en religion, parcourt le Maroc sous le déguisement d’un marchand juif : il va faire plus de 3 000 km, ramenant une importante moisson de renseignements qui lui vaudront la médaille d’or de la Société de Géographie. Reconnaissance au Maroc sera publié en 1888. Le pays avait alors pour souverain Moulay Hassan [1873-1894] qui avait autorisé la culture du cannabis.
Revenu au pouvoir, Jules Ferry se fait le promoteur d’une politique coloniale et affirme publiquement que le développement de l’industrie passe par la conquête de nouveaux débouchés extérieurs. Il déclenche une campagne au Niger, fait occuper des îles dans le Pacifique, Obock sur la Mer Rouge, ce qui permettre ultérieurement de ravitailler en charbon la base de Djibouti, établit un protectorat à Madagascar, fait investir un immense territoire au Congo à partir des 26 postes crées par Savorgnan de Brazza. Enfin, il amorce la conquête du Tonkin défendu par des forces annamites et chinoises, en faisant débarquer des troupes dans la baie de Haïphong. En mars 1885, une partie des troupes françaises sera anéantie à Lang Son, au Tonkin, au moment où la Chine venait de reconnaître le protectorat français sur l’Empire d’Annam.
Yves Carsalade Les grandes étapes de l’histoire économique. Les éditions de l’Ecole polytechnique. 2009
Savorgnan de Brazza est nommé commissaire de la République dans l’Ouest africain, puis commissaire général au Congo français en 1886, ce qu’on appellera en 1910 l’AEF : Afrique Equatoriale Française : les actuels Gabon, RCA et Congo. Mais on peut être explorateur hors pair et médiocre gestionnaire – de façon générale, un gestionnaire n’est pas un créateur, et vice versa -. C’était le cas : des idées à la pelle, qui heurtaient souvent de front les intérêts des grandes sociétés coloniales, n’étaient de plus pratiquement jamais suivies de bout en bout jusqu’à leur réalisation ; beaucoup plus d’exploration que d’administration depuis son bureau de Brazzaville ; on dénoncera la minceur de son aide, voire son opposition, au colonel Marchand, impatient d’en découdre avec les Anglais. Marchand avait une mission à remplir, et il voulait avoir les moyens de la politique qu’il avait la charge d’appliquer et cela passait par le portage, et si les volontaires n’y suffisaient pas, on avait recours au portage forcé. Brazza refusait par principe le portage forcé et n’acceptait en la matière que le volontariat. Il gardera tout de même son poste jusqu’en janvier 1898, et sera alors envoyé en semi-retraite à Alger.
Les violences de la colonisation ont été bien plus coûteuses en vies humaines dans l’AEF que dans l’AOF. Dans cette dernière, il s’était agi d’une guerre de domination classique. Le Blanc avait gagné, comme d’autres Noirs avant lui. La loi de la guerre imposait aux populations vaincues de se soumettre et de payer un tribut annuel. De cela elles consentaient, comment faire autrement ? C’était le lot des vaincus. Mais en AEF il n’y avait pas eu affrontement de soldats. Nous étions des libérateurs, contre le fléau de l’esclavage, et des émancipateurs. De cela on nous savait gré. Mais pas de plus. Or très vite la coercition s’était imposée comme exigence du développement. Construire des routes, transporter d’incessantes charges de 30 kilos à dos d’hommes, personne n’était volontaire pour le faire. C’est alors que les massacres commencèrent et continuèrent. S’agissant cette fois des recrutements forcés de la Première Guerre mondiale en AOF, les populations concernées avaient alors seulement compris qu’elles étaient colonisées et que cela n’était pas juste. Se soumette parce qu’on a été battu, rien de plus normal. Mais envoyer nos fils au loin dans une guerre qui n’était pas la nôtre, cela changeait notre condition. Nous n’étions plus seulement des vaincus mais vous disposiez de nous comme de biens personnels. Vous êtes comme Samory. Vous n’êtes pas mieux que lui. Et c’est cela qui n’était pas acceptable. Ainsi ce mouvement de recrutement des Noirs dont certains, y compris parmi ceux qui y participèrent, espéraient un accès à la citoyenneté française, avait aussi été le déclenchement du mouvement de rejet de notre autorité qui allait conduire aux indépendances. Jusqu’au bout l’ambiguïté demeurera car deux cultures s’affrontaient et aucune ne comprenait vraiment l’autre.
Francis Simonis, enseignant à Aix / Marseille
Richard Wagner meurt soudainement à Vienne : Wagner n’est ni une bête féroce comme le veulent les puristes, ni un prophète comme le prétendent ses apôtres. C’est un homme de grand talent qui se complait dans les chemins scabreux parce qu’il ne sait pas trouver ceux qui sont aisés et droits. Il ne faut pas que les jeunes se fassent d’illusions, nombreux sont ceux qui font croire qu’ils ont des ailes, parce qu’en fait, ils n’ont pas de jambes pour se tenir debout.
Triste, triste, triste. Wagner est mort !
En lisant la dépêche, j’en fus pour ainsi dire atterré. Ne discutons pas. C’est une grande individualité qui disparaît ! Un nom qui laisse une empreinte très puissante dans l’histoire de l’art !
Berlioz était un pauvre malade, hargneux envers tous, revêche et sournois.
Un talent immense et pénétrant : il avait le sentiment de l’instrumentation et il a précédé Wagner pour nombre d’effets orchestraux (les wagnériens ne l’admettent pas, mais c’est comme ça). Il manquait de mesure et il était dépourvu de cette sérénité et, disons, de cet équilibre qui produit les œuvres d’art achevées.
Il allait toujours trop loin, même quand il écrivait des choses remarquables.
Quand les jeunes s’apercevront qu’il ne faut chercher la lumière ni chez Mendelssohn [sic], ni chez Chopin, ni chez Gounod, alors peut-être ils trouveront.
Giuseppe Verdi
Ernest Renan dit son attachement sans borne à la Grèce : Je n’ai commencé d’avoir des souvenirs que fort tard. L’impérieux devoir qui m’obligea, durant les années de ma jeunesse, à résoudre pour mon compte, non avec le laisser aller du spéculatif, mais avec la fièvre de celui qui lutte pour la vie, les plus hauts problèmes de la philosophie et de la religion, ne me laissait pas un quart d’heure pour regarder en arrière. Jeté ensuite dans le courant de mon siècle, que j’ignorais totalement, je me trouvai en face d’un spectacle en réalité aussi nouveau pour moi que le serait la société de Saturne ou de Vénus pour ceux à qui il serait donné de la voir. Je trouvais tout cela faible, inférieur moralement à ce que j’avais vu à Issy et à Saint-Sulpice ; cependant la supériorité de science et de critique d’hommes tels qu’Eugène Burnouf, l’incomparable vie qui s’exhalait de la conversation de M. Cousin, la grande rénovation que l’Allemagne opérait dans presque toutes les sciences historiques, puis les voyages, puis l’ardeur de produire, m’entraînèrent et ne me permirent pas de songer à des années qui étaient déjà loin de moi. Mon séjour en Syrie m’éloigna encore davantage de mes anciens souvenirs. Les sensations entièrement nouvelles que j’y trouvai, les visions que j’y eues d’un monde divin, étranger à nos froides et mélancoliques contrées, m’absorbèrent tout entier. Mes rêves, pendant quelque temps, furent la chaîne brûlée de Galaad, le pic de Safed, où apparaîtra le Messie ; le Carmel et ses champs d’anémones semés par Dieu ; le gouffre d’Aphaca, d’où sort le fleuve Adonis. Chose singulière ! ce fut à Athènes, en 1865, que j’éprouvai pour la première fois un vif sentiment de retour en arrière, un effet comme celui d’une brise fraîche, pénétrante, venant de très loin.
L’impression que me fit Athènes est de beaucoup la plus forte que j’aie jamais ressentie. Il y a un lieu où la perfection existe ; il n’y en a pas deux : c’est celui-là. Je n’avais jamais rien imaginé de pareil. C’était l’idéal cristallisé en marbre pentélique qui se montrait à moi. Jusque-là, j’avais cru que la perfection n’est pas de ce monde ; une seule révélation me paraissait se rapprocher de l’absolu. Depuis longtemps, je ne croyais plus au miracle, dans le sens propre du mot ; cependant la destinée unique du peuple juif, aboutissant à Jésus et au christianisme, m’apparaissait comme quelque chose de tout à fait à part. Or, voici qu’à côté du miracle juif venait se placer pour moi le miracle grec, une chose qui n’a existé qu’une fois, qui ne s’était jamais vue, qui ne se reverra plus, mais dont l’effet durera éternellement, je veux dire un type de beauté éternelle, sans nulle tache locale ou nationale. Je savais bien, avant mon voyage, que la Grèce avait créé la science, l’art, la philosophie, la civilisation ; mais l’échelle me manquait. Quand je vis l’Acropole, j’eus la révélation du divin, comme je l’avais eue la première fois que je sentis vivre l’Évangile, en apercevant la vallée du Jourdain des hauteurs de Casyoun. Le monde entier alors me parut barbare. L’Orient me choqua par sa pompe, son ostentation, ses impostures. Les Romains ne furent que de grossiers soldats ; la majesté du plus beau Romain, d’un Auguste, d’un Trajan, ne me sembla que pose auprès de l’aisance, de la noblesse simple de ces citoyens fiers et tranquilles. Celtes, Germains, Slaves m’apparurent comme des espèces de Scythes consciencieux, mais péniblement civilisés. Je trouvai notre moyen âge sans élégance ni tournure, entaché de fierté déplacée et de pédantisme.
Charlemagne m’apparut comme un gros palefrenier allemand ; nos chevaliers me semblèrent des lourdauds, dont Thémistocle et Alcibiade eussent souri. Il y a eu un peuple d’aristocrates, un public tout entier composé de connaisseurs, une démocratie qui a saisi des nuances d’art tellement fines que nos raffinés les aperçoivent à peine. Il y a eu un public pour comprendre ce qui fait la beauté des Propylées et la supériorité des sculptures du Parthénon. Cette révélation de la grandeur vraie et simple m’atteignit jusqu’au fond de l’être. Tout ce que j’avais connu jusque-là me sembla l’effort maladroit d’un art jésuitique, un rococo composé de pompe niaise, de charlatanisme et de caricature.
C’est principalement sur l’Acropole que ces sentiments m’assiégeaient. Un excellent architecte avec qui j’avais voyagé avait coutume de me dire que, pour lui, la vérité des dieux était en proportion de la beauté solide des temples qu’on leur a élevés. Jugée sur ce pied-là, Athéné serait au-dessus de toute rivalité. Ce qu’il y a de surprenant, en effet, c’est que le beau n’est ici que l’honnêteté absolue, la raison, le respect même envers la divinité. Les parties cachées de l’édifice sont aussi soignées que celles qui sont vues. Aucun de ces trompe-l’œil qui, dans nos églises en particulier, sont comme une tentative perpétuelle pour induire la divinité en erreur sur la valeur de la chose offerte. Ce sérieux, cette droiture, me faisaient rougir d’avoir plus d’une fois sacrifié à un idéal moins pur. Les heures que je passais sur la colline sacrée étaient des heures de prière. Toute ma vie repassait, comme une confession générale, devant mes yeux. Mais ce qu’il y avait de plus singulier, c’est qu’en confessant mes péchés, j’en venais à les aimer ; mes résolutions de devenir classique finissaient par me précipiter plus que jamais au pôle opposé. Un vieux papier que je retrouve parmi mes notes de voyage contient ceci : Prière que je fis sur l’Acropole quand je fus arrivé à en comprendre la parfaite beauté.
[…] Un immense fleuve d’oubli nous entraîne dans un gouffre sans nom. O Abîme, tu es le Dieu unique. Les larmes de tous les peuples sont de vraies larmes ; les rêves de tous les sages renferment une part de vérité. Tout n’est ici-bas que symbole et que songe. Les dieux passent comme les hommes, et il ne serait pas bon qu’ils fussent éternels. La foi qu’on a eue ne doit jamais être une chaîne. On est quitte envers elle quand on l’a soigneusement roulée dans le linceul de pourpre où dorment les dieux morts.
Ernest Renan. Prière sur l’Acropole
01 1884
L’hiver est bien rude en Grèce, et il n’est pas impossible que ce soit l’une des conséquences de l’éruption du Krakatoa de mai à août 1883, entre Java et Sumatra : L’hiver 1884 fut un des plus terribles qui ait jamais sévi dans la contrée [en Grèce]. Les loups et les ours descendaient des montagnes et décimaient les basses-cours, étranglaient les chiens, se jetaient même sur les gens qui s’aventuraient seuls au dehors. Les chutes de neige ne firent qu’aggraver la situation. La nuit, les bêtes sauvages sillonnaient les routes en hurlant, venaient s’entre-dévorer dans les cours et les jardins, les ours arrivaient jusqu’au seuil des maisons, collaient leur museau sur la porte et reniflaient.
Au comble de leurs malheurs, les hommes se réunirent : il fallait agir, et il n’y avait pas d’autre solution que la guerre. Puisque les bêtes sauvages se rassemblaient la nuit, c’était la nuit qu’ils devaient se rassembler aussi pour se mesurer avec elles. Les fusils n’abondaient pas dans la région, les hommes n’étaient ni guerriers, ni chasseurs. Mais il y avait des couteaux, des haches, des scies, des fourches à fumier. Et la bataille décisive s’engagea en plein cœur d’une nuit glaciale.
Ils avaient choisi un endroit découvert, une terre en friche, avaient égorgé quelques poules et aspergé de leur sang la neige gelée, éparpillant partout les plumes pour accroître l’odeur, et ils attendaient. Pour éviter de s’entre tuer, ils avaient dit aux femmes de se tenir prêtes à allumer des torches sitôt les bêtes attroupées.
La horde affamée ne tarda pas à se montrer, elle se rua sur le sang avec furie, burinant la neige, léchant la terre, grondant, avançant vers les hommes à l’affût sur une même ligne. Soudain, les femmes allumèrent les torches. Dans la nuit, la neige se colora de jaune. Un homme hurla plus fort que les bêtes, l’assaut fut donné. Haches, couteaux, fourches, hommes et fauves se confondirent, le sang fumait sur la terre gelée, tandis que les femmes élevaient leurs torches pour voir si c’était le sang des leurs ou celui de l’ennemi. Mais elles ne distinguaient rien, elles se contentaient d’éclairer, hurlant de temps à autre toutes ensemble, pour effrayer les fauves et soutenir le courage des combattants.
La bataille se poursuivit jusqu’au matin. Les bêtes reculaient, mais pour attaquer à nouveau, plus nombreuses, les hommes commençaient à fléchir. Alors, comme les premières lueurs de l’aube apparaissaient derrière les montagnes, les femmes abandonnèrent leurs torches et s’élancèrent à leur tour dans la guerre, qui redoubla de sauvagerie. Armée d’une scie, Sophie parvint, au milieu du carnage, à discerner Vanguelis qui avait mis un ours à terre et s’efforçait de lui renverser la tête pour lui briser la nuque : elle fondit sur l’animal et de toutes ses forces lui enfonça la scie dans le ventre.
Avec les femmes, la bataille bascula : pris de panique, les loups puis les ours commencèrent à battre en retraite, laissant derrière eux plus de cent compagnons morts et bon nombre de blessés qui se traînaient sur la neige ensanglantée, en gémissant. Le camp des hommes avait perdu deux combattants qui gisaient sur la neige, la chair déchiquetée.
Lorsque Vanguelis et Sophia se retrouvèrent chez eux, ils étaient éclaboussés de sang. Ils firent bouillir de l’eau, nettoyèrent leurs blessures, frottèrent leur peau avec du pain moisi pour éviter l’infection. Puis ils ranimèrent le feu et restèrent l’un contre l’autre.
Aris Fakinos. Récit des temps perdus. Seuil 1982
12 02 1884
Édouard Delamarre Debouteville et Léon Malandin font breveter la première voiture actionnée par un moteur à explosion à 4 temps, bicylindre horizontal fonctionnant d’abord au gaz, ensuite à l’essence de pétrole ; la transmission aux roues arrière se fait par une chaîne, un arbre de transmission et un différentiel. Le carburant est admis par un tiroir et l’évacuation se fait par des soupapes.
23 02 1884
Émile Zola, après l’Assommoir en 1877 a en tête Germinal. L’été précédent, il a rencontré à Benodet Alfred Giard, député socialiste de Valenciennes.
À l’invitation de ce dernier, il se rendra sans hésiter à Anzin quand la grève éclate le 21 février suivant. Il y demeure du 23 février au 3 mars, enquête auprès des ouvriers et des cadres de la Compagnie d’Anzin, descend au fond, prend force notes (Notes sur Anzin). La concurrence des exploitations plus récentes du Pas-de-Calais entraîne la direction des mines d’Anzin à restreindre au maximum le prix de revient de la production, d’où s’ensuivent les baisses de salaires et les licenciements. Les mineurs du bassin se lancent alors dans une grève qui va durer cinquante-six jours. Grève quasi générale, mobilisant 11 000 mineurs. Au bout de six semaines d’arrêt de travail dans le calme, les grévistes, face à l’intransigeance de la direction, entrent dans un cycle de violences qui les met aux prises avec la gendarmerie dans un conflit armé. Renvois et procès se succèdent, jusqu’à la reprise désespérée du travail par des ouvriers vaincus qui n’ont rien obtenu.
La grève de Montsou, nom de lieu imaginaire, que décrit Emile Zola dans son roman se déroule sous le Second Empire, quoique sa description soit directement inspirée par la grève d’Anzin de 1884. Comme à son habitude, l’écrivain accumule la documentation, sur les aspects techniques de la mine, son vocabulaire, ses habitudes, sur le déroulement de la grève suivi par les journaux, sur le mouvement ouvrier en formation, et aussi sur l’anarchisme. L’assassinat d’Alexandre II en 1881 lui avait inspiré un article du Figaro, qui témoignait de sa fascination pour ces nihilistes décidés à la destruction totale de la société pour régénérer la Russie. On en trouvera l’écho dans son roman.
Germinal est conçu comme une grande fresque sociale où coexistent une étude documentée sur le travail des mineurs, leurs conditions de vie impitoyables, leurs mœurs grossières et un exposé de forme épique sur la lutte du Travail contre le Capital. Dans ce combat, Zola voit s’opposer la révolte qui vise à l’amélioration des conditions de travail et d’existence – révolte spontanée, contagieuse, éruption volcanique des hommes et des femmes qui ont trop longtemps souffert en silence et qui, soudain, se livrent à une violence parfois aveugle –, et l’action froide, délibérée, ravageuse de l’anarchisme incarné à lui seul par le nihiliste Souvarine, qui a dû fuir la police de son pays.
Nous voulons seulement la justice, nous sommes las de crever de faim, disent les grévistes au directeur. Le révolutionnaire Souvarine, lui, oppose à ce lamento la stratégie du cataclysme : Allumez le feu aux quatre coins des villes, fauchez les peuples, rasez tout, et quand il ne restera plus rien de ce monde pourri, peut-être en repoussera-t-il un meilleur.
Etienne Lantier, le meneur, a acquis, pour sa part, des convictions socialistes dont le mot d’ordre s’identifie au collectivisme. Contre les exploiteurs, la révolution prolétarienne procéderait à une refonte totale de la vieille société pourrie – les deux partis pris s’entendent sur ce diagnostic de pourriture -. Exaspérés par leur souffrance quotidienne, par l’injustice de leur sort, par la tyrannie des actionnaires siégeant à Paris, les grévistes prêtent l’oreille aux prêches d’Étienne et se mettent à rêver. Une exaltation religieuse les soulevait de terre, la fièvre d’espoir des premiers chrétiens de l’Église, attendant le règne prochain de la justice.
La grève se termine par un double drame, la défaite de la bataille sociale et l’anéantissement de la mine sous l’action de Souvarine. Étienne Lantier échappe miraculeusement à la mort, mais sa méditation à la fin du roman résonne comme un avertissement lancé à tous les profiteurs du système : Les charbonniers s’étaient comptés, ils avaient essayé leur force, secoué de leur cri de justice les ouvriers de la France entière. Aussi leur défaite ne rassurait-elle personne, les bourgeois de Montsou, envahis dans leur victoire du sourd malaise des lendemains de grève, regardaient derrière eux si leur fin n’était pas là quand même inévitable, au fond de ce grand silence. Ils comprenaient que la révolution renaîtrait sans cesse, demain peut-être, avec la grève générale, l’entente de tous les travailleurs ayant des caisses de secours, pouvant tenir pendant des mois, en mangeant du pain. Cette fois encore, c’était un coup d’épaule donné à la société en ruine et ils en avaient entendu le craquement sous leurs pas, et ils sentaient monter d’autres secousses, toujours d’autres, jusqu’à ce que le vieil édifice, ébranlé, s’effondrât, s’engloutît comme le Voreux, coulant à l’abîme. Ces vaincus provisoires s’imaginent le grand coup. Cette bataille finale ne sera pas l’Armageddon des textes apocalyptiques, même si le vocabulaire est le même : un jour viendra du grand affrontement des anges et de la Bête, d’où sortira le règne éternel de la Justice et du Bien.
Sans être explicitement socialiste, Zola est parvenu à un moment de l’Histoire où il a pressenti une lutte finale. Il se défend d’avoir écrit un ouvrage partisan. En bon naturaliste, dit-il, il a décrit ce qui est. Cependant, les accents du roman et ses dernières pages sont d’un ton prophétique qu’il n’avait jamais eu jusque-là. Les groupes, les feuilles socialistes ne s’y trompent pas. À leur demande, l’auteur leur permet de reproduire des passages de son livre gratuitement : Prenez Germinal et reproduisez-le. Je ne vous demande rien, puisque votre journal est pauvre et que vous défendez les misérables. Dans une de ses lettres, il annonce l’avenir qu’il devine : Le siècle prochain garde son secret, il faut ou que la bourgeoisie cède ou que la bourgeoisie soit emportée.
Jamais autant, sans doute, qu’en cette fin de siècle les premiers mots du Manifeste de Marx et Engels de 1848 ont été pris pour article de foi : Un spectre hante l’Europe : c’est le spectre du communisme. La décomposition de la société bourgeoise, voilà le fumier sur lequel devait se lever une armée nouvelle en vue de la victoire finale. L’illusion des uns et la peur sociale des autres composent cette tension permanente, la lutte des classes.
Michel Winock. Décadence fin de siècle. Gallimard 2017
7 03 1884
Arrêt du préfet de la Seine, Eugène Poubelle, instituant des boîtes à ordure ménagères. La postérité leur préférera son propre nom.
21 03 1884
Waldeck Rousseau autorise les syndicats professionnels.
24 03 1884
En reconnaissant les syndicats, la loi autorise la constitution de sociétés mutuelles de crédit. En 1885, la première caisse de crédit purement agricole voit le jour à Poligny, dans le Jura.
Le 5 novembre 1894, Jules Méline – 1838-1925 – fera voter une loi s’inspirant du schéma mutualiste allemand. En donnant un statut aux caisses mutualistes locales, le gouvernement français signe l’acte de naissance du Crédit agricole qui sera, pour reprendre les termes de son fondateur, construit par le bas, et non par le haut. Trois ans plus tard, seules 75 caisses locales auront été créées. Emprunter n’est toujours pas entré dans les mœurs du monde paysan. Sauf exception, l’épargne drainée est insuffisante pour faire des prêts et le mouvement est menacé d’étouffement. Un financement externe devient nécessaire.
Jules Méline se décide alors à faire intervenir l’État. Cette même année, une loi impose à la Banque de France le paiement au Crédit agricole d’une avance de 40 milliards de francs-or et d’une redevance annuelle si elle veut se voir renouveler le privilège d’émission dont elle bénéficiait. Les fonds sont gérés par des caisses régionales. Créées par la loi du 31 mars 1899, celles-ci jouent un rôle d’intermédiaire entre les caisses locales et le ministère de l’agriculture qui délivre les subsides. Cette intervention financière étatique fonde le développement du Crédit agricole.
Charles-Emmanuel Haquet. Le Monde du 27 septembre 1994
20 04 1884
Avec l’encyclique Humanum genus, le pape Léon XIII condamne à nouveau la Franc-maçonnerie, religion occulte de Satan.
07 1884
L’épidémie de choléra qui a touché Toulon puis Marseille, apporté par le navire la Sarthe en provenance de Saigon, arrive en Arles. Jeanne Calment, alors âgée de neuf ans, n’en gardera aucun souvenir : il est vrai qu’au-delà de sa vie familiale, et surtout de sa propre personne, on ne lui connaîtra pas d’intérêt pour quoi que ce soit…
23 10 1884
Quarante ans après les Barcelonnettes au Mexique, des Aveyronnais partent s’installer en Argentine ; mais, contrairement aux premiers, l’émigration sera durable.
Une quarantaine de familles aveyronnaises d’Espalion, Saint Geniez d’Olt, Gabriac, Aurelle, Naucelle montent dans le train en gare, de Rodez. Elles arriveront en bateau à Buenos Aires, eu Argentine, le 30 novembre, puis les 3 et 4 décembre à Pigüe, fondant là, dans la pampa, une ville qui porte toujours en elle ses origines françaises.
À la fin du XIX° siècle la vie dans les campagnes aveyronnaises comme ailleurs est difficile. L’exode est à facettes multiples mais peu nombreux sont ceux qui font le choix d’aller au-delà des mers.
C’est Clément Cabanettes, né en 1851 à Ambec, commune de Lassouts, qui parvient à convaincre ces familles de s’exiler vers l’Argentine. Sous lieutenant, il avait été engagé pour assurer l’entrainement et l’instruction de troupes argentines. Très entreprenant, il développa notamment la première compagnie téléphonique du pays. Devenu propriétaire de vastes terres cédées par le Gouvernement de la province de Buenos Aires, il élabore le projet d’y faire venir des Aveyronnais. Retournant en Aveyron où un ami, François Issaly, a assuré la promotion de la colonie. Clément Cabanettes offre â chacun deux kilomètres² de terre arable pour six ans à condition que la moitié de la récolte soit reversée à la communauté. En échange, à la fin de cette période, les colons recevront un titre de propriété. Par ailleurs, une contribution de 5 000 francs est exigée pour le bétail, les semences et les machines agricoles, contribution qui n’était pas toujours intégralement payée. Parmi ces colons se trouvent une institutrice, un forgeron, un charron, un curé, un commerçant… Pour eux, les premières récoltes sont décevantes : les techniques agricoles utilisées ne sont pas adaptées à la pampa et au cours de la deuxième année, une sécheresse sévit de mars à fin septembre. Heureusement, les fortes pluies d’automne permettent aux plants de maïs et de pommes de terre de pousser suffisamment pour assurer une maigre récolte. Ces difficultés ne dissuadent pas de nouveaux aveyronnais de tenter l’aventure.
Aujourd’hui, Pigüe compte plus de 13 000 habitants qui commémorent chaque armée la fondation de leur ville. Du côté aveyronnais, les liens sont toujours très forts : en témoigne une association Rouerge Pigüe, aux multiples interventions : il s’agit aussi bien de répondre à ceux qui effectuent des recherches sur leur passé tant argentin qu’aveyronnais que d’organiser des voyages touristiques, établir un partenariat avec l’hôpital de Pigüe, monter une pièce de théâtre en occitan ou encore restaurer l’enseignement du français dans les écoles de Pigüe, ceci avec Aveyron International.
Résumé d’Emigration en Argentine, dans l’Aveyron. Magazine du Conseil général. Novembre 2009, N° 143.
Au début des années 1880, la douce euphorie dans laquelle se complaît la France rurale va céder la place au doute, et l’agriculture entre, jusqu’au début du XX° siècle, dans une longue phase de dépression, qui marque les esprits de tous les contemporains. Ces années sombres, difficiles pour la plupart des paysans, dramatiques pour les viticulteurs et certaines catégories de paysans/artisans, sont synonymes de profondes mutations sociologiques, démographiques et politiques. Mais la France rurale en sortira finalement confortée à la veille de la Grande guerre.
La crise, qui touche toutes les grandes puissances européennes, est due d’abord à un mouvement de reflux général des prix des produits agricoles, à l’opposé des la hausse constante des cours lors des trois décennies précédentes. Cette chute des prix est d’autant plus catastrophique que la main d’œuvre est devenue plus rare et plus chère. Le libre échange ouvre les portes à la nouvelle concurrence des pays neufs, comme les États-Unis, le Canada, l’Australie et l’Argentine, dont les blés et les viandes affluent sur les marchés à moindre prix. La France est d’autant plus vulnérable à cette concurrence que ses agriculteurs n’ont pas appris à produire mieux à moindre coût, faute d’investissements pour acquérir des machines et réduire la main d’œuvre. Outre la chute des prix, une partie de la France rurale est durement touchée par la crise du phylloxéra qui détruit l’essentiel des vignobles et la nouvelle concurrence des soies orientales qui condamnent l’élevage du ver à soie.
[…] Ces crises sont d’autant plus dramatiques qu’elles se produisent dans un climat général de chute des prix. Les paysans peuvent déjà accuser la mondialisation puisque le développement des transports maritimes facilite les importations massives en provenance des pays neufs dont l’agriculture mécanisée fournit notamment des céréales ou des pommes de terre à des prix imbattables. Les producteurs français voient ainsi leur revenu diminuer en moyenne d’un tiers entre 1880 et le début du XX° siècle. La France rurale, stupéfaite et désespérée de voir son niveau de vie régresser, en veut à la terre entière, aux nouvelles puissances étrangères qui tuent le marché, aux citadins dont les salaires progressent mais qui se nourrissent à bas prix sur la sueur des paysans, aux patrons qui ferment les usines rurales et bien sûr aux gouvernants qui n’ont pas su les protéger de la concurrence. Et les paysans sont encore plus ulcérés quand les prolétaires les moins bien lotis, notamment les mineurs, les accusent de créer la vie chère et les traitent d’affameurs ou d’accapareurs comme aux jours les plus sombres de la Révolution. On verra ainsi dans le Pas-de-Calais, des bandes de femmes de mineurs intercepter en 1911 les charrettes des paysannes qui vont au marché pour les obliger à leur vendre laitages et volailles à bas prix
Jean-Michel Lecat. Paysans de France. Un siècle d’histoire rurale 1850-1950. Éditions de Lodi
1884
Le marquis de Dion construit la première voiture à moteur à vapeur. John Kemp Starley, qui avait un oncle dans la partie, met sur le marché le Rover Safety Bicycle, ou la bicyclette de sûreté, par réaction à la dangerosité du grand bi : la bicyclette moderne est née. Rétablissement du droit au divorce. Première fibre synthétique : la rayonne. Karl Elsener crée à Zug une firme de couteaux : le fameux couteau suisse Victorinox. À Liverpool, William Lever commence à fabriquer du savon industriellement : après avoir vu ses prix d’achat d’huile de palme dans les colonies britanniques augmenter considérablement, il se tournera vers le Congo belge où il obtiendra en 1911 une concession au Congo, qui couvrait 7.5 millions d’hectares, deux fois et demi la Belgique : sa société, les Huileries du Congo belge deviendra plus tard Unilever.
Le méridien de Greenwich est adopté comme étant la référence : GMT : Greewich Mean Time.
Le Petit Journal tire à 825 000 exemplaires.
La loi Boisseuil, député de Charente, abaisse les droits fiscaux sur le sucre : ce faisant, on favorise les alcools de betterave ainsi que l’utilisation du sucre dans l’élaboration du vin.
Ange Mariani, corse et pharmacien, commercialise un Vin de Mariani, décoction de feuilles de coca dans du vin rouge [les cépages traditionnels sont le Nielluccio, le Sciacarello, le Vermentinu… ] : cette addition d’euphorisants fait de nombreux adeptes : la Reine Victoria, le pape Léon XIII, les présidents américains Grant et Mc Kinley, plus tard, Louis Blériot : son action énergétique m’a grandement aidé lors de ma traversée de la Manche. Même le découvreur du bacille de la peste, Alexandre Yersin sera à deux pas d’investir dans ce business : Yersin mène des tentatives pour substituer le paddy à l’avoine dans l’alimentation des chevaux, fait aménager des cultures en étage sur les collines pour déjouer et rassembler les climats. Après l’échec de l’Arabica, on plante deux mille caféiers Liberia, des plantes médicinales, parmi lesquelles mille pieds d’Erythroxylum coca pour la préparation de la cocaïne alors utilisée en pharmacie.
[…] Yersin développe sa production et concocte un concentré liquide, lequel aurait pu faire de lui le milliardaire inventeur d’une boisson noire et pétillante s’il en avait déposé le brevet. Il donne à celle-ci le nom de Kola-Cannelle qu’il pourrait abréger en Ko-Ca. Depuis Nah Trang il écrit à Roux : Je vous ai expédié, par colis postal, une bouteille de Kola-Cannelle. Prenez-en un centimètre cube et demi environ dans un verre d’eau sucrée lorsque vous vous sentirez fatigué. J’espère que cet élixir de longue vie aura sur vous la même action remontante que sur moi.
Patrick Deville. Peste § choléra. Le Seuil 2012
Les imitateurs sont légion… l’un d’eux, John Smith Pemberton, pharmacien à Atlanta, le vend sous le nom de French Wine Cola : il y a ajouté des feuilles de cola. Les ligues de tempérance bannirent peu après l’alcool sous toutes ses formes, y compris pharmaceutiques. Pemberton enleva donc le vin … il ne resta plus que le Coca et la Cola, dont le mariage fut breveté en 1886. Le produit eut une vie un peu chaotique, avant d’être géré par de solides entrepreneurs qui créèrent une World Company : pendant la dernière guerre mondiale, ils s’engagèrent à pouvoir en fournir à tout soldat américain dans le monde pour la somme de cinq cents, ce qui permit d’obtenir de l’armée les financements pour construire des usines d’embouteillage là où il n’y avait rien, usines qu’ils récupérèrent à la fin de la guerre.
Et pour faire bonne mesure, histoire de mettre un peu d’eau dans le vin, le docteur Louis Perrier achète à Vergèze une source d’eau minérale à laquelle il applique un procédé de regazéification : c’est la Société des eaux minérales de Vergèze.
Les cantons suisses de Genève, du Valais et de Vaud s’entendent sur les cotes maximales et minimales acceptables pour le niveau du lac Léman pour, à une extrémité, assurer aux baigneurs et aux estivants de belles plages, et, à l’autre extrémité, garantir la sécurité des riverains en les protégeant d’éventuelles inondations et permettant la navigation ; l’instrument de régulation est le barrage du Seujet, à Genève dont les vannes permettent de retenir ou évacuer l’eau du Rhône, principal apport en eau du lac. Ces trois cantons se sont comportés comme si le lac Léman était intégralement en territoire suisse alors que toute sa rive sud est française et la France n’a pas été consultée ! C’est le tapis rouge déroulé pour des conflits de voisinage à venir.
15 01 1885
Un rorqual commun mâle, long de 19 mètres, s’échoue sur la plage de Luc sur mer, en Normandie. Les villageois font leur affaire de la chair : ils se souviennent que la langue constitue un mets fort apprécié. Des écrits le mentionnent dès 832 ; aux XI° et XII° siècles, l’abbaye de Cerisy-la-Salle, 80 km à l’ouest de Caen, mentionne des droits et redevances accordées aux moines en nageoires et langues de gras poisson. Le duc de Normandie accorde aux religieux de la Trinité de Caen une taxe sur les baleines prises à l’embouchure de la Dives. On en voit s’échouer dès le début du XVI° siècle, en 1781, en 1794.
26 02 1885
L’Acte Général de Berlin, conférence internationale tenue à l’initiative de Bismarck, s’achève. Les très récentes conquêtes coloniales de l’Allemagne y sont entérinées : Angra Pequeña, dans le sud-ouest africain, Douala, au Cameroun, Porto Seguro, au Togo, l’arrière pays de Zanzibar. C’est le début du déclin de l’empire portugais, dépouillé par les grandes puissances de nombre de ses droits séculaires. Bismarck ne s’est converti que tout récemment à la colonisation, sous l’insistance, voire pression de son ami armateur Adolf Woermann ; plus diplomate qu’aventurier, il préférait jusque-là s’en tenir à son pré-carré, chèrement acquis, entre la Russie, la France et l’Angleterre.
On voit aussi officialisée la naissance de l’État Indépendant du Congo : Léopold II, roi des Belges, en sera proclamé souverain le 19 juillet, à titre personnel, lu et approuvé par le parlement belge. Pour masquer un peu tout cela, il s’abritera derrière l’Association Internationale Africaine. C’est l’explorateur Stanley qui assurera la mise en place de l’exploitation économique et humaine de ce vaste territoire : 10 000 kilomètres de voies d’eau navigables, un réseau fluvial de 54 000 kilomètres², allant de l’embouchure du Congo jusqu’au Tanganika et à la source de la Lualaba. Il parvient à mettre dans son camp le prestigieux marchand d’esclaves et d’ivoire Ahmed ben Mohammed el Murjebi, plus connu sous le nom de Tippu Tib, arabe de Zanzibar, œuvrant dans le Maniema. Les Noirs le surnomment Boula Matari : – celui qui fait sauter les pierres -. Stanley mourra un jour, mais Boula Matari continuera à vivre, nommé par Léopold II gouverneur du district de Stanley Falls – actuelle région de Kisangani -.
Léopold II – le roi caoutchouc – un homme d’affaires, à qui la royauté donnait des moyens d’action exceptionnels – avait mis fin à la traite des Noirs par les marchands arabes… mais c’était pour mettre tous ces hommes au travail forcé dans sa propriété du Congo, pour récolter l’ivoire et le caoutchouc, ce dernier de plus en plus nécessaire aux pays riches qui se mettaient à la fabrication du pneu.
Stanley, instigateur et complice honteux de l’œuvre détestable de Léopold II au Congo.
Claudine Lesage
Aujourd’hui, Stanley fait souvent figure de raciste invétéré, de raciste par excellence, une réputation qu’il doit à son style d’écriture hyperbolique et à son association avec Léopold II. En réalité, son attitude était extrêmement ambigüe. Il avait une haute opinion de nombre d’Africains, il entretenait de profondes et sincères amitiés avec certains d’entre eux et beaucoup avaient pour lui une grande estime. Il avait certes une curieuse manière de mêler kidnapping et shopping, mais il paraissait réellement se soucier du bien-être des enfants qu’il avait rachetés pour les libérer.
David Van Reybrouck. Congo. Actes Sud 2012
Et le sort des esclaves s’avéra finalement plutôt enviable par rapport à celui de ces populations : une armée de seize mille hommes y faisait régner la terreur : quotas de production non respectés, et ce sont mains coupées, cahutes brûlées, tortures, décapitations, mutilations sexuelles ; c’est à peu près la moitié de la population qui va être tuée.
Cela durera jusqu’en 1908, quand couvert de dettes et incapable de continuer à gérer ce territoire, Léopold II l’offrira à la Belgique.
Le colonialisme européen de la fin du XIX° siècle et du début du XX° a beaucoup détruit et a laissé des séquelles dont les descendants des victimes n’ont jamais pu se remettre. La tragédie que connaît actuellement la république démocratique du Congo et la situation critique des petites communautés amazoniennes trouvent leurs racines dans ces années au cours desquelles le monde moderne a profité de façon égoïste de la richesse du caoutchouc.
Mario Vargas Llosa, Nobel de littérature 2010, lors de la présentation de son livre Le songe du Celte, Gallimard 2011
La raison qui avait incité Léopold II à prendre soudain énergiquement en main l’acquisition de ces territoires était une fois encore la rivalité entre les pays européens. Il craignait de se faire devancer. C’était d’ailleurs déjà le cas. Dans le Sud, les Portugais continuaient de faire valoir leurs revendications sur leurs vieilles colonies. Et au nord, Savorgnan de Brazza commença à partir de 1880 à conclure des traités comparables avec des chefs locaux. Brazza, un officier italien au service de l’armée française, était officiellement chargé d’établir des stations scientifiques sur la rive droite du Congo. La France avait un comité au sein de l’Association internationale africaine, dont le roi Léopold était le président, et ses deux stations représentaient la contribution française à l’initiative de Léopold. Mais ce Brazza, qui était aussi un patriote français fanatique, était en train de fonder pour sa chère France, sans y être invité par une quelconque autorité, une colonie qui porterait plus tard le nom de république du Congo-Brazzaville. En Europe, on commença à comprendre en 1882 que quelqu’un était en train d’acheter de sa propre initiative de grands pans de l’Afrique centrale. Cette constatation suscita la consternation. Léopold devait intervenir.
Un Italien achetait de lui-même des parties de l’Afrique pour la France, un Britannique, Stanley, achetait d’autres parties pour le souverain belge : on parlait de diplomatie, mais il s’agissait plutôt d’une ruée vers l’or. En mai 1884, Brazza traversa le Congo avec quatre pirogues pour tenter encore de gagner Kinshasa à sa cause. Il se heurta cependant à Swinburne, l’agent de Stanley. Brazza voulut faire au chef du village local une meilleure proposition en vue d’annuler le précédent accord, mais l’affaire provoqua une dispute. Il y eut une vive discussion avec Swinburne, une bagarre avec les deux fils du chef, et Brazza finit par battre en retraite. Pour l’entreprise de Léopold, la perte de Kinshasa aurait été désastreuse. Il s’agissait non seulement de la meilleure, mais aussi de la plus importante des implantations : elle était située au carrefour des voies commerciales, là où les bateaux s’amarraient et d’où les caravanes partaient, là où l’intérieur des terres communiquait avec la côte. La portée de l’incident avec Brazza fut pour la postérité d’une importance déterminante : la région située au nord et à l’ouest du fleuve allait devenir une colonie française, appelée le Congo français, la région du sud resterait entre les mains de Léopold.
Cet épisode mit en lumière une faiblesse essentielle. Militairement, Stanley pouvait facilement faire face à un personnage comme Brazza – il disposait pour sa part d’hommes et de canons Krupp, tandis que Brazza voyageait pour ainsi dire seul -, mais tant que les implantations de Stanley n’étaient pas reconnues par les puissances européennes, il ne pouvait pas tirer un seul coup de canon. Léopold en prit conscience également. À partir de 1884, il allait se consacrer à une initiative diplomatique sans égale dans l’histoire de la monarchie belge : la quête d’une reconnaissance internationale de son initiative privée en Afrique centrale. Léopold chercha à réaliser un coup de maître. Et il y parvint.
L’Afrique centrale suscitait à l’époque beaucoup de convoitises. Le Portugal et l’Angleterre se disputaient les emplacements sur la côte. À l’est, les commerçants swahilo-arabes gagnaient du terrain. L’Allemagne récemment unifiée cherchait à obtenir une possession coloniale en Afrique (elle finirait par acquérir ce qui devait s’appeler le Cameroun, la Namibie et la Tanzanie). Mais, manifestement, le grand rival de Léopold était tout de même la France. Le pays, qui n’avait pourtant rien demandé, avait, contre toute attente, eu la folie de reprendre à son compte les annexions personnelles de Brazza. Léopold aurait pu, furieux, tourner le dos à la France, Brazza était allé trop loin, mais le roi décida calmement de prendre le taureau par les cornes. Il fit la suggestion suivante : la France était-elle disposée à lui laisser le champ libre dans la région à laquelle Stanley venait de donner accès si, en cas d’échec, elle était prioritaire pour lui reprendre le territoire ? Les Français ne pouvaient pas refuser. La possibilité que Léopold échoue était d’ailleurs réelle. C’était comme si un jeune homme ayant découvert un château abandonné avait eu envie de le rénover lui-même. Et qu’il avait dit aux voisins : Si l’entreprise devient trop coûteuse pour moi, vous bénéficiez automatiquement d’une option ! Les voisins auraient été ravis de la proposition. Ce fut un brillant coup de poker, qui eut aussi des conséquences ailleurs en Europe. Face à cet accord, le Portugal dut baisser le ton, car s’opposer à Léopold signifiait prendre le risque d’avoir soudain pour voisin en Afrique la puissante France. Les Britanniques furent quant à eux très satisfaits de la garantie de libre-échange que Léopold accordait d’un coup de sifflet.
L’exacerbation de la concurrence entre les Etats européens à propos de l’Afrique exigeait de nouvelles règles du jeu. Ce fut la raison pour laquelle Bismarck, à la tête du plus jeune mais du plus puissant État d’Europe continentale, réunit les grandes puissances du moment à Berlin. Du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 eut lieu ce que l’on a appelé la conférence de Berlin. La tradition veut que le partage de l’Afrique se soit décidé là et qu’on y ait fait cadeau à Léopold du Congo. Rien n’est moins vrai. La conférence ne fut pas l’occasion où des messieurs distingués munis de compas et de règles se partagèrent dans la bonne humeur le gâteau de l’Afrique. En fait, ils recherchaient justement le contraire : ouvrir l’Afrique au libre-échange et à la civilisation. Pour cela, il fallait de nouveaux accords internationaux. La querelle prolongée entre le Portugal et l’Angleterre à propos de l’estuaire du Congo l’avait montré assez clairement. Deux principes importants furent posés : tout d’abord, pour qu’un pays puisse revendiquer un territoire, celui-ci devait faire l’objet d’une occupation effective (la découverte de terres, laissées ensuite à l’abandon, comme le Portugal le faisait depuis des siècles, ne comptait plus) ; ensuite, chaque nouveau territoire obtenu devait rester ouvert au commerce international (aucun pays ne pouvait imposer de barrières commerciales, de droits de transit, de taxes à l’importation ou à l’exportation). En pratique, cela rendait la colonisation extrêmement coûteuse, comme Léopold allait s’en apercevoir. Il fallait beaucoup investir dans un lieu que l’on occupait réellement et accorder aux marchands d’autres pays un accès libre et gratuit. Il n’était pas encore question, cependant, d’un partage définitif du continent, même si le critère de l’occupation effective allait accélérer la lutte pour l’Afrique. La conférence se réunit tout au plus une dizaine de fois, sur plus de trois mois. Léopold ne se rendit pour sa part jamais à Berlin.
Pourtant, dans les couloirs et les arrière-salles en marge de la conférence, des affaires se traitaient. Pendant les réunions plénières, on s’essayait à la diplomatie multilatérale, mais pendant les pause-café, la diplomatie bilatérale prévalait. Juste avant le début de la conférence, les États-Unis avaient admis la revendication de Léopold concernant l’Afrique centrale. Ils acceptaient son drapeau et son autorité sur les nouveaux territoires obtenus. Cet événement paraît plus impressionnant qu’il ne l’était en réalité. À l’époque, l’Amérique n’était pas encore le poids lourd qu’elle allait devenir au XX° siècle, ses intérêts en Afrique étaient inexistants. La reconnaissance par l’Allemagne, en revanche, fut une décision bien plus importante. Bismarck considérait le projet de Léopold comme totalement dément. Le souverain belge réclamait un territoire aussi grand que l’Europe occidentale, alors qu’il n’avait tout au plus qu’une poignée d’implantations le long du fleuve. C’était un collier qui ne comptait que quelques perles pour un très long fil, sans parler des gigantesques régions inexplorées de part et d’autre. Pouvait-on parler d’une occupation effective ? Mais bon, souverain d’un petit pays, Léopold ne présentait pas de danger. De surcroît, il ne manquait pas de moyens financiers et il était extraordinairement enthousiaste. Il permettait en outre de garantir le libre-échange (ce dont on ne pouvait jamais être sûr avec les Français et les Portugais) et protégerait les marchands allemands dans la région. D’ailleurs, se disait Bismarck, peut-être cette région constituait-elle une zone tampon idéale entre les prétentions portugaises, françaises et britanniques sur la région. Une sorte de Belgique de 1830, dans une version plus grande. Un certain calme pourrait peut-être ainsi être assuré. Il signa.
Les autres pays présents à la conférence n’eurent guère d’autre choix par la suite que de suivre l’exemple de leur hôte. Ils ne signifièrent pas leur adhésion à l’occasion d’un moment formel pendant une séance plénière, mais à mesure que la conférence progressait. À l’exception de la Turquie, les quatorze États présents donnèrent leur accord, même l’Angleterre, qui avait en vue un accord important sur le Niger et ne voulait donc pas se heurter frontalement à l’Allemagne. Plus ou moins par accident, elle alla même jusqu’à accepter, ultérieurement, les gigantesques frontières dont Léopold avait rêvé. La toute récente Association internationale du Congo (AIC) de Léopold obtint ainsi une reconnaissance internationale en tant qu’autorité souveraine sur un gigantesque territoire en Afrique centrale. L’AIA avait été strictement scientifique et philanthropique, le CEHC commercial, mais l’AIE devint purement et simplement politique. Elle possédait sur l’Atlantique un littoral certes petit mais crucial (l’embouchure du fleuve Congo), une étroite bande menant vers l’intérieur des terres délimitée par les colonies françaises et portugaises, puis une zone s’ouvrant comme un entonnoir, long d’un millier de kilomètres vers le nord et vers le sud, qui s’arrêtait vers la région des Grands Lacs, à mille cinq cents kilomètres à l’est. On aurait dit un clairon muni d’un tuyau très court et d’un pavillon très grand. Le résultat était un territoire gigantesque sans commune mesure avec la présence effective de Léopold sur place. Le grand historien belge Jean Stengers dit : Avec un brin de fantaisie, on pourrait comparer la création de l’État du Congo à l’histoire d’un particulier ou d’une société qui, en Europe, aurait fondé un certain nombre d’établissements sur le Rhin, de Rotterdam jusqu’à Bâle, ce qui lui aurait valu de se voir attribuer la souveraineté sur toute l’Europe occidentale.
Lors de la séance de clôture de la conférence de Berlin, quand Bismarck salua avec satisfaction les travaux menés par Léopold et formula tous ses vœux de réussite pour leur évolution rapide et l’accomplissement des nobles aspirations de leur illustre instigateur, la salle se leva pour acclamer le souverain belge. Sous ces applaudissements fut fêtée la création de l’État indépendant du Congo.
David Van Reybrouck. Congo. Actes Sud 2012
Du côté européen, on prenait la mesure de l’accroissement des résistances africaines, qui rendait les frictions de plus en plus fréquentes. La création en 1870 de deux nouveaux États, l’Italie et l’Allemagne, démultiplia la concurrence. Il fallut donc organiser une réunion diplomatique où pourraient siéger tous les États européens concernés par l’Afrique – y compris l’Empire ottoman, qui supervisait plusieurs provinces en Afrique du Nord -, mais, bien entendu, aucun des pouvoirs politiques africains. Il s’agissait désormais de fixer les règles du jeu pour éviter que ne se déclenche une guerre de rivalité entre grandes puissances. Un partage des zones d’influence, déjà entamé à la conférence de Vienne en 1815 – où, par exemple, la France récupéra Saint-Louis et Gorée -, fut donc décidé. Cela devait permettre de garantir trois points : le premier était de ménager les intérêts économiques de chacune des puissances européennes, en leur garantissant la liberté de commerce sur les grands fleuves africains du Niger et du Congo, quelles que soient les prétentions riveraines des unes et des autres ; le deuxième consistait à adopter une règle commune de colonisation : pour que les autres puissances reconnaissent la possession d’un territoire, il faudrait désormais avoir déjà implanté sur le terrain quelques installations, militaires, administratives ou commerciales. Le troisième, en marge de la conférence, était une initiative du roi des Belges Léopold II, qui rêvait d’une colonie susceptible de remédier aux problèmes causés par les dimensions réduites de son pays. Il se fit reconnaître bilatéralement, par chacun des diplomates présents, le droit de créer l’État indépendant du Congo : un bien personnel dont il assuma la charge en roi absolu grâce à son immense fortune. En effet, le Parlement belge, méfiant, avait refusé d’assumer les risques d’une colonisation aventureuse dans un territoire à peine exploré (sinon par les soins du journaliste américain Stanley engagé par le roi pour descendre le fleuve). Dans les années 1890, Léopold, à qui le territoire coûtait trop cher, essaya sans succès de faire reprendre le Congo par la Belgique qui consentit tout au plus à deux reprises à lui accorder des prêts. Il continua donc seul, jusqu’à ce que la situation se retournât en sa faveur : à partir de 1898, le caoutchouc de cueillette devint rentable grâce à l’essor de la fabrication des pneus automobiles. Mais cela se fit au prix d’une intensification de la cruauté du régime d’exploitation qui donna lieu, en 1905, au scandale international du caoutchouc rouge : sous l’impulsion du journaliste britannique Edmund Morel, le régime léopoldien fut dénoncé dans la presse européenne. On apprit ainsi que les agents du roi, qui cumulaient les fonctions d’administrateur et d’entrepreneur, étaient d’une brutalité inouïe, d’autant que leur promotion dépendait de la quantité de latex produite. Ce scandale obligea le roi à remettre son État indépendant (devenu une affaire rentable) à la Belgique. Ainsi le Congo devint colonie belge en 1907.
La compétition coloniale entérinée par la conférence eut pour effet d’accentuer ce qu’on a nommé la course au clocher (ou scramble for Africa). L’idéologie impériale véhiculait les thèmes de la supériorité raciale et du fardeau de l’homme blanc – voir le poème de Kipling à 1898 – tenu de répandre outre-mer les bienfaits de sa culture (les fameux trois C : Commerce, Christianisme, Civilisation). Chacun voulait sa part du gâteau. En 1900, quinze ans après la conférence, le partage était achevé, à l’exception du petit Liberia, et surtout du très vieil empire d’Éthiopie : l’empereur Ménélik avait mis sur pied une armée de 100 000 hommes qui résista à l’invasion préparée à partir de la province de l’Érythrée, qu’il venait de vendre à l’Italie. La bataille d’Adoua (1896) fut célébrée des années durant par la peinture populaire nationale. C’est en hommage à cette victoire que, à l’indépendance, la plupart des drapeaux des États africains optèrent pour les couleurs du drapeau éthiopien : le rouge, le jaune et le vert [3]
Catherine Coquery-Vidrovitch. Petite Histoire de l’Afrique. La Découverte 2011
23 04 1885
Prophétique, Ernest Renan reçoit Ferdinand de Lesseps à l’Académie Française : […] L’isthme coupé devient un détroit, c’est-à-dire un champ de bataille. Un seul Bosphore aurait suffi jusqu’ici aux embarras du monde ; vous en avez créé un second, bien plus important que l’autre, car il ne met pas seulement en communication deux parties de mer intérieure : il sert de couloir de communication à toutes les grandes mers du globe […] Vous aurez ainsi marqué la place de grandes batailles de l’avenir.
1 05 1885
Jeanne Lombardi, 32 ans, née Deluermoz en Savoie, femme en seconde noces du tailleur Joseph Lombardi vivant au cœur du faubourg Saint Gervais, cher à Rousseau, à Genève, ne peut plus supporter les infidélités et l’ivrognerie de son mari : elle projette d’en finir en commençant par tuer ses quatre enfants : elle parvient effectivement à en égorger trois, 7, 5 et 6 ans. Le dernier, 4 ans survivra au massacre et elle-même ne succombera pas à la dose d’adropine et de curaçao qu’elle avait bue ; l’adropine est un alcaloïde extrait de la belladone, qui, mélangé à de l’alcool, provoque le coma. Dix à douze mille personnes suivront le convoi mortuaire des trois enfants. Le procès se déroulera un an plus tard. Le débat sera virulent quant à la responsabilité de l’accusée. C’est la première fois que l’on fait appel à des psychiatres pour rendre un avis sur la responsabilité de l’accusé(e). Pour finir, le jury se retrouvera à égalité : six voix contre, six pour. Il ne restera plus au juge qu’à appliquer la loi en pareil cas, en imposant la solution la plus favorable à l’accusé : Jeanne Lombardi sera donc acquittée, mais internée tout de même à l’hôpital psychiatrique des Vernets. Devenu muet, le fils survivant sera placé chez un tuteur, maître boulanger, puis deviendra imprimeur, se mariera, mais ne reverra qu’une seule fois sa mère. Le père partira en Algérie où il mourra alcoolique. Jeanne sera libérée le 10 mai 1894 et partira en France sans laisser d’adresse.
22 05 1885
Mort de Victor Hugo, à qui la nation rendra un immense hommage le 1° juin : on parla d’un million de personnes présentes. À 83 ans… ses dernières paroles : C’est ici le combat du jour et de la nuit. Son testament : Je donne 50 000 francs aux pauvres. Je désire être porté au cimetière dans leur corbillard. Je refuse l’oraison de toutes les Églises ; je demande une prière à tous et à toutes. Je crois en Dieu. Le corbillard, celui des pauvres, mais croulant sous les fleurs, conduira le cercueil de l’Arc de Triomphe où il était resté toute la nuit à sa dernière demeure, le Panthéon. Ses enfants étant morts avant lui, ses belles-filles et petits enfants seront à la tête de l’immense cortège.
Je viens d’assister aux funérailles de Victor Hugo, du haut d’une fenêtre donnant sur le boulevard Saint‑Germain. C’était vraiment colossal. […] Je suis ivre de tant de bruit, de foules, de couronnes portées, de musique, de costumes, de manifestations.
Je note ici ce qui m’a causé le plus d’impression. C’était, outre l’armée à pied et à cheval qui encadrait cet immense défilé, qui l’ouvrait et qui le fermait, d’abord cette suite de chars traînés par des chevaux vêtus de housses noires et blanches et portant des montagnes de couronnes. Non, jamais tant de couronnes aux mille couleurs n’ont été jetées au pied d’un défunt. Un Himalaya ! Le corbillard où reposait Victor Hugo était celui des pauvres, triste et noir. Mais quel défilé ! […] J’étais à mon poste à midi : le défilé qui avait commencé à 12 h 40 s’est terminé à 16 h 20. Tout mon pays était là ! Tous les âges, toutes les corporations, toutes les associations étaient représentées. […] Des femmes défilaient avec des hommes qui portaient, elles aussi, leurs couronnes. Et les drapeaux et les bannières flottaient au vent. […] Peut‑être, je dois l’avouer, le caractère de ces obsèques était‑il trop bruyant, trop profane. Il y avait un grossier et lourd parfum de foire qui se dégageait de ces masses.
Abbé Mugnier, Journal, 1879‑1939
Sur la place de l’Étoile, les deux nuits suivantes, la profanation devait être pire. Le catafalque reposait sous l’Arc, gardé par des municipaux à cheval et par des sergents de ville. L’intérieur d’un pilier avait été réservé à la famille. Lockroy, éliminant la parenté directe, notamment Georges Hugo, recevait, en habit et cravate blanche, les députés, sénateurs, conseillers municipaux et journalistes qui se bousculaient dans l’étroit escalier. Sa grande préoccupation était que Vacquerie et Meurice, [Paul Meurice 1818-1905, romancier, dramaturge et ami de Victor Hugo] au jour des funérailles et du transfert au Panthéon, ne figurassent point à part, à une place d’honneur. Il les eût voulu mêlés au reste du cortège, confondus dans la foule, car il leur portait une haine solide, dont j’ai su depuis les raisons. Il désirait surtout apparaître comme l’ordonnateur, le grand organisateur d’une cérémonie qui devait être, dans l’esprit des politiciens, le type des solennelles pompes laïques de l’avenir. On répétait : Le peuple aime les fêtes. Il faut que la démocratie lui donne de belles fêtes. Celle-ci, comme les autres, dégénéra en chienlit.
Je ne me rappelle plus quel était alors le préfet de police. Car je néglige volontairement, pour ces souvenirs, de consulter les documents de l’époque. Fatalement ils fausseraient les empreintes de ma mémoire. Toujours est-il que ce préfet, déconcerté sans doute par la nouveauté des circonstances, perdit la tête. Une consigne de mollesse permit aux apaches, qui s’étaient donné rendez-vous là, de mener impunément leur ignoble saturnale. Ils gobelottaient par groupes, avec leurs compagnes débraillées, à quelques pas du catafalque, sous l’œil bienveillant des gardiens de la paix. Une lie de salons, de cercles, et de cabarets de nuit s’était jointe à cette lie du ruisseau. Les messieurs et leurs dames voisinaient avec les poteaux et les gonzesses, leur passaient des bouteilles, chantaient avec eux des refrains obscènes, se disputaient, hoquetaient, s’embrassaient, vomissaient. La fraternité des grandes soirées révolutionnaires devait ressembler à cela. Les admirateurs de Hugo, écœurés, avaient abandonné la place à cette sarabande, qui fut une honte nationale.
Léon Daudet, [pilier d’Action Française de Maurras, fils d’Alphonse] Souvenirs des milieux littéraires, politiques, artistiques et médicaux.
Maurice Barrès parlera de L’humanité autour d’un cercueil.
Un autre : Ce n’est pas à des funérailles que nous assistons, c’est à un sacre.
Celui en qui elle (La France) s’était depuis longtemps incarnée, celui qui la faisait grande de toute sa gloire, n’est plus ! … Son cœur a cessé de battre, sa tête a cessé de penser…
C’était le soleil le plus beau, le plus éclatant qui disparaît de notre horizon ! Mais il a inondé l’atmosphère de sa lumière incomparable et, lui parti, le jour qu’il a fait naître demeure…
Le souvenir de l’existence de Victor Hugo, son œuvre grandiose, voilà son âme vouée à l’Immortalité, à laquelle il avait raison de croire… Pars, sans regret, noble génie, grand citoyen et grand poète…
Tu as accompli ici-bas une tâche surhumaine, tu as anobli notre siècle, tu as fait meilleure l’Humanité ! Dans l’Histoire, ta figure sera grande parmi les plus grandes, belle parmi les plus belles.
Ta gloire resplendissante couvrira notre époque de ses rayons, ce sera un titre d’avoir été le contemporain de Victor Hugo…
Paul Doumer. Il est alors conseiller municipal de Laon et dirige La Tribune de l’Aisne, dans laquelle il publie cet éloge funèbre le 7 juin. Il sera élu président de la République en 1931.
Sentant sa mort prochaine, Victor Hugo avait fait venir un jour Leconte de Lisle et lui avait parlé sans témoins : Savez-vous à quoi je pense ? Devant l’embarras de son interlocuteur, il avait déclaré avec emphase: Je pense à ce que je dirais à Dieu quand, très bientôt peut-être, je rejoindrai son royaume. Leconte de Lisle, ironique en même temps que respectueux, avait enchaîné : Oh, vous lui direz : Cher confrère…
Les écrivains du futur ne seront pas plus tendres que ses contemporains :
Emile Zola : On le sacre grand poète, grand dramaturge, grand romancier, grand critique, grand philosophe, grand historien, grand politique ; ou, pour mieux dire, on lui donne le siècle de haut en bas, de long en large ; il serait à lui seul tout le XIX° siècle… Eh bien, le respect m’échappe devant cette énormité… À mesure que l’âge est venu, il est tombé davantage dans une humanitairerie de bon vieillard. C’est ce que j’appellerai le gâtisme humanitaire.
André Breton : Un stupide, en dépit de quelques fulgurances surréalistes.
Paul Claudel : Un prêcheur impénitent.
Paul Valéry : Hugo est un milliardaire, ce n’est pas un prince.
Julien Gracq se montrera beaucoup plus nuancé et précis : Les souvenirs de Théophile Gautier sur les Jeune France et la première d’Hernani nous montrent, autour du jeune Hugo, une sorte de garde rapprochée, où Nerval distribuait les rôles, les positions stratégiques et les mots de passe, et où Petrus Borel – en sous-ordre – intronisait. La fraîcheur et la ferveur de ces souvenirs égrenés au temps de la vieillesse sont saisissantes. Le Hugo embourgeoisé et pair de France, le vaticinateur de Guernesey, et le barde national panthéonisé de la III° République ont éclipsé pour nous le jeune dieu des années 20, décoré par Charles X à vingt-trois ans, et invité au sacre de Reims, comme s’il y était venu au coté du roi relever la bannière de la poésie, cependant que les Jeune France pâlissaient à la seule idée de lui être présentés. Aucun autre poète français n’a connu en littérature ces commencements d’Alexandre ou de Bonaparte, cette étoile au front, ce cortège électrisé et un peu fou de jeunesse et de succès. Il dût y avoir là, dans la France tenue en lisière par la Sainte Alliance, et sous l’éteignoir morose de la Restauration, comme un début d’embellie nationale, une ébauche de revanche de Waterloo. Le Napoléon de l’alexandrin arrivait- en retard sur l’Histoire – mais il arrivait.
Verlaine :
Nul parmi vos flatteurs d’aujourd’hui n’a connu
Mieux que moi la fierté d’admirer votre gloire :
Votre nom m’enivrait comme un nom de victoire,
Votre œuvre, je l’aimais d’un amour ingénu.
Depuis, la Vérité m’a mis le monde à nu.
J’aime Dieu, son Église, et ma vie est de croire
Tout ce que vous tenez, hélas ! pour dérisoire,
Et J’abhorre en vos vers le Serpent reconnu.
J’ai changé. Comme vous. Mais d’une autre manière.
Tout petit que je suis, j‘avais aussi le droit
D’une évolution, la bonne, la dernière.
Or, je sais la louange, ô maître, que vous doit
L’enthousiasme ancien ; la voici, franche, pleine,
Car vous me fûtes doux en des heures de peine.
François Forestier : Né en même temps qu’était publié Le génie du Christianisme il apprit la littérature grâce à son beau-père, Lahorie, qui fut l’amant de sa mère. C’était dans les règles de l’époque : cocufiage et belles lettres, doutes sur la paternité et vocation artistique. Jamais Hugo ne se déprendra de cette origine : il aimera les femmes et les livres, fera le grand écart entre la morale et l’immorale. Ah, le bel et bon hypocrite ! Un vrai dessus de cheminée ! Il prend la pose sur un rocher battu par les flots, une main sur le cœur et l’autre sous le jupon de la cuisinière. Et puis, il ne parle que de lui, lui, lui. Comme le dit un commentateur perspicace : C’est le grand moitrinaire.
[…] Il y en a trop. On commence par les Djinns, poème court et rapide, on finit par Choses vues, un fleuve immense charriant gravas et pépites ! Entre les deux, il y a combien ? Trente, quarante, cent volumes selon les éditions ? Parole, cet homme-là écrit au rouleau, comme on fait de la peinture au rouleau ! Pourtant, quelle audace !
Cette immense brume grise faite de pluie, de faim, de vice, de mensonge, d’injustice, de nudité, d’asphyxie et d’hiver, plein midi des misérables…
Voici le XVIII° siècle renversé, la cadence bousculée, la mesure – cette mesure si française! – explosée. Hugo est dans l’avalanche : de mots, de sentiments, de cauchemars. Il invente le siècle de l’overdose.
Le Nouvel Observateur Décembre 2007

par Felix Nadar


Tableau de Georges François GUIAUD (1840 – 1893)
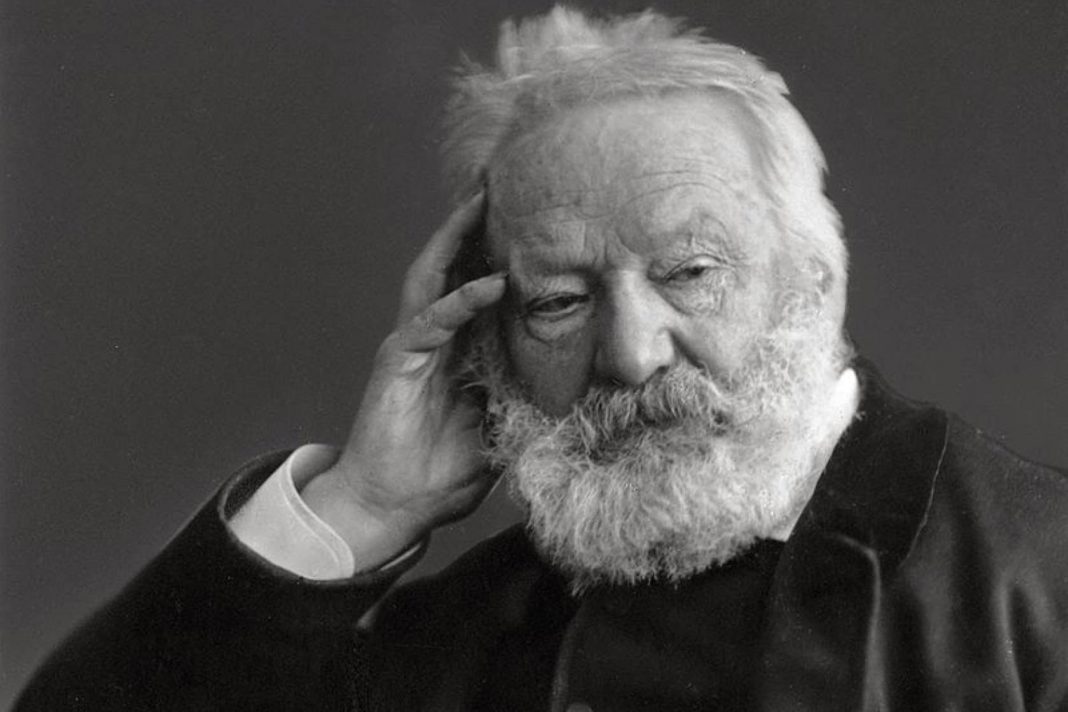
Je ne songeais pas à Rose ;
Rose au bois vint avec moi ;
Nous parlions de quelque chose,
Mais je ne sais plus de quoi.
J’étais froid comme les marbres ;
Je marchais à pas distraits ;
Je parlais des fleurs, des arbres
Son œil semblait dire : Après ?
La rosée offrait ses perles,
Le taillis ses parasols ;
J’allais ; j’écoutais les merles,
Et Rose les rossignols.
Moi, seize ans, et l’air morose ;
Elle, vingt ; ses yeux brillaient.
Les rossignols chantaient Rose
Et les merles me sifflaient.
Rose, droite sur ses hanches,
Leva son beau bras tremblant
Pour prendre une mûre aux branches
Je ne vis pas son bras blanc.
Une eau courait, fraîche et creuse,
Sur les mousses de velours ;
Et la nature amoureuse
Dormait dans les grands bois sourds.
Rose défit sa chaussure,
Et mit, d’un air ingénu,
Son petit pied dans l’eau pure
Je ne vis pas son pied nu.
Je ne savais que lui dire ;
Je la suivais dans le bois,
La voyant parfois sourire
Et soupirer quelquefois.
Je ne vis qu’elle était belle
Qu’en sortant des grands bois sourds.
Soit ; n’y pensons plus ! dit-elle.
Depuis, j’y pense toujours.
Victor Hugo.
Dans tout cela nul avis sur l’autre corde qu’il avait à son arc, le stylo ou l’encre délavée ; il nous a laissé tout de même quelques dessins de bien belle facture :



22 06 1885
Joseph Pasteur est à l’hôpital Saint Denis au chevet de Julie Antoinette Poughon, 11 ans, mordue à la lèvre par son chien six semaines plus tôt. Son vaccin n’a été testé jusqu’alors que sur des animaux, et face à la fatalité, il le tente sur elle, en vain : elle mourra le lendemain. Trop tard… la maladie avait été contractée depuis trop longtemps.
4 07 1885
Joseph Meister se rend à la brasserie de Meissengott – en Alsace, un peu au nord d’une ligne Saint Dié des Vosges-Sélestat- pour y acheter de la levure pour son père boulanger. Il est mordu par un chien : la blessure ne semble par grave mais sa mère l’emmène tout de même voir le Docteur Weber, à Villé, qui désinfecte la plaie mais, soupçonnant la rage sur le chien qui a mordu son fils conseille à Madame Meister d’aller voir Pasteur à Paris…. Paris ? comment vais-je faire, c’est si loin. Mais Théodore Vonné, le maître du chien propose de l’emmener et les voilà partis pour Paris, avec le seul nom de Louis Pasteur. Ils font tous les hôpitaux, en vain et personne ne les aide vraiment… Louis Pasteur n’est pas médecin, qui le considèrent plutôt comme un apprenti sorcier. Madame Meister finit par obtenir une adresse : l’École Normale supérieure de la rue d’Ulm. Le résultat du vaccin que Pasteur lui inocule est positif : l’enfant lui en gardera reconnaissance toute sa vie, puisque, devenu gardien à l’Institut Pasteur, il préféra mourir plutôt que d’ouvrir la tombe de Pasteur aux Allemands en 1940.
Pour autant, est-il certain que Pasteur ait guéri le petit Joseph ? En effet aucun contrôle n’ayant été fait sur le chien de Théodore Vonné, on ne saura jamais si Joseph Meister était réellement atteint de la rage. Par contre il est certain que les injections administrées à Joseph par Louis Pasteur ont établi une réponse immunitaire contre le virus de la rage. Car, pour être sûr de sa réussite, le savant fit ensuite inoculer à Joseph, une préparation pleinement virulente du virus de la rage ! Une folie, car, si la réponse immunitaire n’avait pas été établie ou avait été insuffisante, Joseph aurait succombé sans coup férir.
Au bilan, une seule chose est certaine : si Joseph n’était pas atteint de la rage avant de rencontrer Louis Pasteur, maintenant, il était bien vacciné contre la maladie. Au terme de cette expérience, Louis Pasteur venait de démontrer que les préparations atténuées du virus de la rage déclenchaient un réponse protectrice chez l’homme
Bernard Bourrié. Passeurs d’histoire(s). Mille ans en Languedoc et en Roussillon Le Papillon Rouge Editeur 2016
Il n’est pas inutile de revenir sur sa citation la plus connue, puisque le lobby des viticulteurs s’en est emparé pour en faire son drapeau, en l’amputant du mot alcoolisé, ce qui change bigrement la perspective : donc la version originale est : Le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons alcoolisées.
Louis Pasteur
… avis au demeurant partagé : Un litre de vin contient la huitième partie de la ration alimentaire de l’homme, et les neuf dixièmes de sa bonne humeur.
Professeur Louis Landouzy
Le vin est semblable à l’homme : on ne saura jamais jusqu’à quel point on peut l’estimer et le mépriser, l’aimer et le haïr, ni de combien d’actions sublimes ou de forfaits monstrueux il est capable. Ne soyons donc pas plus cruel envers lui qu’envers nous-mêmes, et traitons-le comme notre égal.
Charles Baudelaire. Les Paradis artificiels
28 07 1885
La reconnaissance de l’égalité des races n’est pas pour maintenant. La toile de fond intellectuel est alors marquée par le théoricien des races, Gobineau, qui a publié en 1853 son Essai sur l’inégalité des races humaines. Le racisme qui fera cent ans plus tard près d’un million de morts au Rwanda est né là : Quand les Allemands pénètrent au Rwanda à la fin des années 1890, ce pays est dirigé par un roi (le wamï) et une aristocratie, appartenant à une catégorie de la société, celle des Tutsi, perçus comme éleveurs de gros bétail par définition, en opposition à la majorité de la population, les Hutu, perçus comme des agriculteurs – s’ajoute aussi la minorité twa, appartenant au peuple pygmée et travaillant souvent dans l’artisanat. La réalité est en fait moins simple, les activités étant généralement associées, dans des proportions très variées selon les régions. Sans oublier que la masse des Tutsi est de condition aussi humble que la masse des Hutu, que des Hutu accèdent aussi à l’aristocratie et que tout le monde parle une seule langue, le kinyarwanda, et partage les mêmes croyances, la même culture, les mêmes clans et une histoire commune depuis des siècles. Les hypothèses sur des origines différentes du peuplement renvoient au moins au début de notre ère et ne reposent sur aucune tradition d’invasion extérieure.
Mais une théorie va marquer l’africanisme jusqu’au milieu du XX° siècle, celle qui distingue les Nègres en tant que tels et des populations africaines jugées supérieures en fonction de métissages avec des envahisseurs venus de l’Orient et qualifiés de Hamites. Cham (ou Ham), qui, selon la Bible, aurait été maudit par son père Noé, et qui avait longtemps été défini comme l’ancêtre des Noirs, voués à l’esclavage, est relocalisé par l’exégèse du XIX° siècle dans un environnement proche-oriental, ce qui explique ce changement de sens. Théoricien des races, Gobineau, dans son Essai sur l’inégalité des races humaines (1853-1855), est un des premiers à évoquer une ancienne coulée blanche venue civiliser l’Afrique tout en s’abâtardissant. Le creuset intellectuel de cette idéologie hamitique est le même que celui où s’est forgée l’opposition Aryens-Sémites.
Les colonisateurs et les missionnaires de l’époque, imprégnés par ce schéma, définissent aussitôt les Tutsi comme une race de conquérants hamites venus d’Éthiopie imposer une féodalité à la paysannerie hutu définie comme bantoue à la manière des Francs devenus les seigneurs des Gaulois réduits en servage selon la vision des médiévistes de l’époque.
Ce discours ne hante pas seulement les publications ethnographiques, il détermine la politique coloniale suivie d’abord par les Allemands, et surtout par les Belges au lendemain de la Première Guerre mondiale (le Rwanda et le Burundi faisaient partie-de l’Afrique orientale allemande jusqu’à ce que la SDN les réunisse en un territoire sous mandat, Ruanda-Urundi, confié à la Belgique après le démantèlement de l’empire colonial allemand). Les Tutsi, jugés d’intelligence supérieure et faits pour gouverner, sont privilégiés dans l’accès aux premières écoles missionnaires et dans le recrutement des auxiliaires de l’administration. Le régime monarchique, refaçonné et épuré, est utilisé-comme une courroie de transmission selon la logique de l’administration indirecte. Le classement racial, considéré comme naturel, est perçu comme traditionnel, même s’il rabote en fait la diversité des situations antérieures. Il est repris sur les livrets d’identité. Surtout, il est peu à peu intériorisé par les premières générations d’élites instruites, les jeunes Tutsi se trouvant ainsi flattés et les jeunes Hutu frustrés.
L’attitude des Européens à l’égard des Tutsi, décrits comme des Européens noirs ou comme les juifs de l’Afrique, est d’ailleurs ambivalente, mêlant globalement une sorte de fascination et de la méfiance à l’égard de leur fourberie, également décrite comme atavique et générale, comme ce fut le cas dans les empires coloniaux à l’égard de tous les groupes suspectés de résistance en sous-main.
Jean-Pierre Chrétien. L’Histoire N° 396 Février 2014.
Ces pays de la région interlacustre qui ont les densités de population les plus fortes de l’Afrique ne doivent pas cette situation au hasard. Enchâssés dans la branche occidentale de la Rift Valley, ils sont à cheval sur la ligne de partage des eaux entre le Congo, qui coule vers l’ouest, l’Atlantique et le Nil, qui coule vers le nord, la Méditerranée. Cela signifie des altitudes élevées – une bonne part de ce territoire est entre 1 500 et 1 800 mètres – altitude où on ne trouve pas la mouche tsé-tsé, porteuse de la trypanosomiase, ou maladie du sommeil, qui touche aussi bien l’homme que le bétail : ceci est une des principales causes, outre un climat particulièrement clément, de leur surpopulation.
Messieurs, il faut parler plus fort et plus vrai ! Il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit vis à vis des races inférieures. Je répète qu’il y a pour les races supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le droit de civiliser les races inférieures.
Jules Ferry, à la Chambres des Députés.
Au XIX° siècle, le Blanc a fait du Noir un homme.
Victor Hugo, lors d’un banquet en 1879 commémorant l’abolition de l’esclavage
Devant la même Assemblée, Clemenceau répondra, employant toute la vigueur de son verbe pour mettre à bas ces concepts de race inférieure et de race supérieure ; mais il n’était alors pas au pouvoir : Les races supérieures ont sur les races inférieures un droit qu’elles exercent, ce droit, par une transformation particulière, est en même temps un devoir de civilisation. Voilà en propres termes la thèse de M. Ferry, et l’on voit le gouvernement français exerçant son droit sur les races inférieures en allant guerroyer contre elles et les convertissant de force aux bienfaits de la civilisation. Races supérieures, races inférieures, c’est bientôt dit. Pour ma part, j’en rabats singulièrement depuis que j’ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande, parce que le Français est une race inférieure à l’Allemand. Depuis ce temps, je l’avoue, j’y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation, et de prononcer : homme ou civilisation inférieur. Race inférieure, les Hindous ! Avec cette grande civilisation raffinée qui se perd dans la nuit des temps ! Avec cette grande religion bouddhiste qui a quitté l’Inde pour la Chine, avec cette grande efflorescence d’art dont nous voyons encore aujourd’hui les magnifiques vestiges ! Race inférieure, les Chinois ! Avec cette civilisation dont les origines sont inconnues et qui paraît avoir été poussée tout d’abord jusqu’à ses extrêmes limites. Inférieur Confucius ! En vérité, aujourd’hui même, permettez-moi de dire que, quand les diplomates chinois sont aux prises avec certains diplomates européens… [rires et applaudissement sur certains bancs], ils font bonne figure et que, si l’on veut consulter les annales diplomatiques de certains peuples, on peut y voir des documents qui prouvent assurément que la race jaune, au point de vue de l’entente des affaires, de la bonne conduite d’opérations infiniment délicates, n’est en rien inférieure à ceux qui se hâtent trop de proclamer leur suprématie […] Et vous verrez combien de crimes atroces, effroyables, ont été commis au nom de la justice et de la civilisation. Je ne dis rien des vices que l’Européen apporte avec lui : de l’alcool, de l’opium, qu’il répand partout, qu’il impose s’il lui plaît. […] Non, il n’y a pas de droits de nations dites supérieures contre les nations dites inférieures ; il y a la lutte pour la vie, qui est une nécessité fatale, qu’à mesure que nous nous élevons dans la civilisation, nous devons contenir dans les limites de la justice et du droit ; mais n’essayons pas de revêtir la violence du nom hypocrite de civilisation ; ne parlons pas de droit, de devoir ! La conquête que vous préconisez, c’est l’abus pur et simple de la force que donne la civilisation scientifique sur les civilisations rudimentaires pour s’approprier l’homme, le torturer, en extraire toute la force qui est en lui au profit du prétendu civilisateur. Ce n’est pas le droit, c’en est la négation. Parler à ce propos de civilisation, c’est joindre à la violence l’hypocrisie. […] Quant à moi, mon patriotisme est en France. Je déclare que je garde mon patriotisme pour la défense du sol national.
Jules Ferry cadrera par la suite son propos, avec cet avertissement destiné aux colons par trop entreprenants : Les lois françaises n’ont pas la vertu magique de franciser tous les rivages sur lesquels on les importe.
Si la colonisation eut ses partisans, elle eut aussi ses détracteurs, nombreux dans le camp des revanchards, qui voyaient dans ces expéditions lointaines un dérivatif face au combat à mener contre le boche pour retrouver l’Alsace et la Lorraine : J’ai perdu deux sœurs et vous m’offrez vingt domestiques, lançait Paul Déroulède.
Anténor Firmin, Haïtien très brillant viendra s’opposer aux thèses développées par Gobineau en publiant en 1885 De L’égalité des races humaines. Anthropologie positive.
Avec près de quatre vingt-ans d’avance, Paul Vigné d’Octon fait ce rêve prémonitoire : J’ai fait ce rêve. Il y avait enfin sur la terre une justice pour les races soumises et les peuples vaincus. Fatigués d’être spoliés, pillés, refoulés, les arabes et les Berbères, chassaient leurs dominateurs du nord de l’Afrique, les Noirs faisaient de même pour le reste de ce continent, et les Jaunes pour le sol asiatique. Ayant ainsi reconquis par la violence et par la force les droits imprescriptibles et sacrés, qui, par la force et la violence lui furent ravis, chacune de ces familles humaines poursuivant la route de sa destinée un instant interrompue. Et oubliant que j’étais Français, ce qui n’est rien, pour ne me souvenir que d’une chose : que j’étais un homme, ce qui est tout, je sentais dans la profondeur de mon être une indicible jubilation.
été 1885
À Rock Spring, dans le Wyoming, des Blancs attaquent 500 mineurs chinois, massacrant de sang-froid 28 d’entre eux.
10 1885
Une grève d’ouvriers italiens de l’entreprise Tonetti met un arrêt définitif au chantier de chemin de fer d’Annecy au Semnoz, mis en route à l’initiative de Marius Vallin et Auguste Defresne.
Les grèves allaient déjà bon train : 110 000 grévistes en 1880, 139 000 en 1890, 223 000 en 1900, 281 000 en 1910, 220 400 en 1913. De 64 000, en 1880, le nombre de syndiqués passera le million en 1910.
7 11 1885
La Canadian Pacific Railway Company opère la jonction des deux voies du chemin de fer transcontinental canadien. L’histoire raconte que, pour le franchissement des Rocheuses, les ingénieurs se seraient laissés guider par les aigles, qui empruntaient le Yellow Head Pass à 1 131m.
1885
À Lorient, lancement du Formidable, cuirassé de cent trois mètres de long.
Premiers vélos Peugeot, produits dans les usines de Valentigney, Terre Blanche et Beaulieu. Étienne Mimard, 23 ans, fils d’un armurier de Sens, rachète, avec l’armurier Pierre Blachon, une modeste affaire de vente d’armes par correspondance à Saint Étienne. Très vite son sens commercial va développer l’affaire : il profite du boom du vélo pour vendre ceux des autres puis les siens sous la marque Hirondelle. Idem avec la machine à coudre Omnia. La vente, exclusivement par correspondance est assurée par le Tarif-Album dont il fera passer le tirage, quatre ans plus tard, de 20 000 à 300 000 dès 1887 ; il deviendra alors Le Catalogue envoyé à tous les chasseurs : il a pu se procurer copie du registre public des licences. Le Chasseur Français détiendra longtemps le quasi monopole des annonces matrimoniales du monde rural. Les deux premiers articles sont le fusil Idéal, dépourvu de chien et la bicyclette Superbe, possédant un cadre courbé et non en triangle comme les bicyclettes anglaises. La première usine sera inaugurée en 1896, employant 3 000 ouvriers. En France, première moissonneuse batteuse. Transport par câble de l’électricité : La Roche sur Foron, dans la vallée de l’Arve, est le premier village, en Europe, à en être équipé. Il s’agit de courant continu qui ne deviendra alternatif qu’en 1923. Etienne Lenoir invente la bougie d’allumage électrique, indispensable au moteur à explosion. La loi autorise le sucrage des marcs.
Les colonies agricoles pénitentiaires, créées il y a trente, quarante ans, n’ont pas donné les résultats escomptés : la très grande majorité des détenus était d’origine urbaine et la valeur rédemptrice du travail de la terre – Mundatur culpa labore : la faute est purifiée par le travail – n’avait pas vraiment prise sur ces gosses réduits en esclavage. L’époque était aussi à l’industrialisation, et on installa dans les locaux de l’abbaye d’Aniane fondée au IX° par Saint Benoît – à cinq km de St Guilhem le Désert, une colonie industrielle, en voulant alors faire de ces détenus des ouvriers plutôt que des paysans. L’atmosphère devint très rapidement empoisonnée par la collusion entre gardiens et population locale, qui s’entendaient pour, d’un coté fermer les yeux sur les évasions et de l’autre coté reprendre les évadés … et ainsi se partager la prime de capture. En août 1937, la révolte sera générale au sein des détenus : incendies, destructions des ateliers, dortoirs, réfectoires, évasions en grand nombre : la répression fût féroce.
Pas bien loin de là, à Campestre et Luc, à proximité des vallées de la Virenque et de la Vis, affluent de l’Hérault, quelques années plus tôt, un agronome invité par les propriétaires d’un domaine sur lequel se trouvait un abîme – l’abîme de Saint Ferréol – avait dit de ce dernier qu’il pourrait faire une excellente cave d’affinage pour le roquefort, production fromagère dominante de tout le causse du Larzac. Ce domaine, anciennement templier, recevra de 1856 à 1884 ces enfants du bagne dont l’effectif était allé jusqu’à 200 ! Ce sont eux qui feront les travaux nécessaires pour que l’exploitation de cette cave devienne opérationnelle : on passera rapidement d’un treuil malcommode à un plan incliné permettant l’installation d’une voie ferrée sur laquelle ces gosses, de 6 à 21 ans poussaient des wagonnets [ce n’est qu’une hypothèse car il ne reste aucune trace des rails]. Mais pour en arriver là, il faudra creuser sur 220 mètres de long une tranchée de 2 mètres de haut pour relier la partie la plus basse de la surface au fond de l’abîme !

Bon nombre de ces enfants étaient abandonnés : on en dénombrait trente mille par an ! – aujourd’hui, le nombre de naissances sous X est de six cents par an. L’adoption légale n’existait pas et ces enfants étaient placés dans des familles, le plus souvent des paysans, ou des institutions qui percevaient un prix de journée de l’administration.
Le jeune abbé Saunières, trente trois ans, est nommé à Rennes le Château, dans l’Aude. Ce n’est pas vraiment une sinécure : le presbytère est inhabitable, le toit de l’église fuit… tout est à refaire. Quelques sermons violemment anti républicains lui attirent les foudres de sa hiérarchie mais aussi la sympathie et la bourse de la comtesse de Chambord ; il trouvera encore dans les archives du presbytère voisin de Durban de quoi entreprendre les travaux de restauration de son église et de son presbytère ; mais il y trouvera aussi des documents alchimistes lui permettant de lire de nombreux signes de son église et d’une chapelle voisine : ainsi, d’un triangle se trouvant sculpté sur le porche d’entrée, ainsi des premières lettres des saints dont les statues décorent l’église : le G de Sainte Germaine, le R de Saint Roch, Le A de Saint Antoine l’ermite, encore le A de Saint Antoine de Padoue, ce qui donne GRAA. Le L manquant étant dans une chapelle proche avec une statue de Sainte Lucie, pour donner finalement le GRAAL. etc etc… la littérature sur la question abonde et le tourisme ésotérique se porte bien à Rennes le Château. Il était venu là pour servir, ce qui ne l’empêcha pas de se servir : construction d’une belle et grande maison où il pouvait mener grand train, recevant avec sa vaisselle de luxe tout le gratin des environs. Pas vraiment un saint homme.
La France s’est taillé sa zone d’influence en Asie en établissant un protectorat sur l’Annam-Tonkin. Dans la foulée, l’amiral Courbet occupe Formose et bombarde l’arsenal de Fuzhou, à Mawei… crée en 1867 par Prosper Giquel, un officier de marine français, qui avait constitué une force franco-chinoise pour mater la révolte des Taiping en 1863. Cet homme, qui avait appris rapidement le chinois avait joué un rôle important dans la modernisation du pays. Il avait encore crée une école de français après la fin de sa période d’administration directe de l’arsenal en 1874, codirecteur de la Mission chinoise d’instruction en 1877, dont l’objectif était de fournir une instruction technique avancée pour compléter le programme d’instruction de l’arsenal, et de former ainsi les premiers ingénieurs chinois. Quand la politique de la canonnière prend le pas sur la vision à long terme… on arrive à ce genre d’absurdité.
C’est encore l’époque de la lutte, essentiellement à l’initiative des Anglais, contre l’esclavage : L’opinion exigeait que les gouvernements interviennent pour mettre un terme à l’origine même de l’esclavage, au cœur de l’Afrique noire, en empêchant l’action des marchands d’esclaves et en bloquant les colonnes infernales conduisant les malheureux jusqu’aux ports de la Méditerranée ou de l’Océan Pacifique. La Grande Bretagne exerça alors un rôle prépondérant de gendarme des mers, allant jusqu’à contrôler la cargaison des navires suspects. Elle s’engagea aussi à l’intérieur des terres. D’abord à partir de Zanzibar, principal port négrier en direction de l’Arabie, dont elle obtint du sultan l’arrêt de la traite en échange d’une confortable indemnisation. Mais aussi en remontant le Nil au nom du Khédive égyptien afin de bloquer le commerce des esclaves à partir du Soudan. La réaction fut immédiate et le soulèvement du Mahdi contre les Occidentaux culmina avec la mort en 1885 de Gordon Pacha, gouverneur britannique du Soudan anglo-égyptien assiégé dans Khartoum. Partout les Arabes défendirent farouchement leur si lucratif commerce d’esclaves. Soit ils prirent les armes contre ceux qui avaient l’idée de les en empêcher, soit ils soutinrent la résistance des autorités indigènes elles-mêmes impliquées dans ce commerce. C’est ainsi qu’en Ouganda, où les missionnaires catholiques et protestants étaient actifs en dehors de toute présence coloniale européenne, les Arabes réussirent en 1888 à faire proclamer un royaume musulman et à rétablir la traite négrière, au prix du massacre des chrétiens Blancs et Noirs, premiers martyrs africains que le pape François est allé célébrer en novembre 2015.
Le conflit opposait donc chrétiens et musulmans. Toutefois, comme on entend dire aujourd’hui que tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais que tous les terroristes sont des musulmans, on pourrait dire qu’à l’époque tous les musulmans n’étaient pas esclavagistes mais tous les esclavagistes étaient musulmans. C’est que de nombreux versets du Coran encouragent en effet explicitement l’esclavage des non-musulmans par les musulmans. Tidiane N’Diaye en fait la longue liste dans son livre Le Génocide voilé. L’Islam semblait donc cautionner l’esclavage quand celui-ci était devenu odieux au monde chrétien qui l’avait lui-même pratiqué pendant trois siècles dans des conditions identiques.
Philippe San Marco. Sortir de l’impasse coloniale. Mon petit éditeur 2016
Marie de Sormiou poétesse, 1865-1956, née Marie-Thérèse Charlotte Buret à Paris se voit offrir par son mari Alfred de Ferry 14 hectares dont le principal constitue la calanque éponyme, accessible par terre par un chemin muletier, joyau de la côte méditerranéenne de l’embouchure du Rhône à La Ciotat. Au XXI° siècle, ses sept descendants gèrent par la SCI Marie de Sormiou, veillant avec un soin jaloux au maintien en l’état – ni électricité ni eau courante – des 126 cabanons existants dont ils sont propriétaires. Intégré au parc National des Calanques, interdite de voiture, sauf aux résidents, la calanque reste accessible à pied toute l’année. Mais il se trouve tout de même des résidants pour affirmer avec force que le port et la plage, [que 300 mètres tout au plus séparent] y’a rien de commun, c’est deux mondes différents. Si, il y a une chose de commun : la connerie. Mais ici, cette dernière fait partie du paradis que forme l’ensemble.

au loin, l’île de Riou

_____________________________________________________________________________________
[1] le volcan lui-même se nomme en fait Perbuatan, et c’est la toute petite île – 24 km² – sur laquelle il se trouve qui se nomme Krakatoa.
[2] Au départ, le cow-boy était un convoyeur de bétail du Texas – principal héritage du passé espagnol – vers les gares d’Abilene et de Dodge City où ils étaient embarqués avec comme destination finale les abattoirs de Chicago.
[3] L’Éthiopie, conquise en 1935, ne fut colonie italienne que six brèves années sous Mussolini (1936-1941).