| Publié par (l.peltier) le 2 décembre 2008 | En savoir plus |
05 1337
Philippe VI s’empare de la Guyenne, alors anglaise : les manuels d’histoire disent que c’est là le début de la guerre de cent ans, le grand règlement de comptes entre Plantagenets et Capétiens. Édouard III, roi d’Angleterre lui fait alors porter un défi : à Philippe de Valois, qui se dit roi de France.
Ferdinand Lot estime que la France comptait alors 23 à 24 millions d’habitants.
Les manuels d’enseignement secondaire ont ancré dans l’esprit des Français que la guerre de Cent Ans, a commencé en 1337, qu’elle a duré cent ans et qu’elle n’a été marquée que par une série d’éclatantes défaites françaises : Crécy, Poitiers, Azincourt, le tout se terminant par l’apothéose de Jeanne d’Arc. C’est là une idée d’une fausseté si remarquable, qu’on s’étonne – mais peut-être faudrait-il au contraire ne pas s’en étonner – qu’elle persiste encore de nos jours. La guerre de Cent Ans a commencé en réalité au XII° siècle, quand Henri II a épousé Aliénor d’Aquitaine ; elle ne s’est en réalité terminée qu’à la paix d’Amiens au début du XIX° siècle quand le roi d’Angleterre a cessé de revendiquer le titre de roi de France.
[…] C’est au XIV° siècle que naît en effet l’idée d’une nation anglaise. La guerre qui, pour n’être pas constante, n’en existe pas moins toujours entre la France et l’Angleterre, sépare les deux pays, va faire éclater cette solidarité intellectuelle et morale franco-normande qui, pendant plusieurs siècles, avait uni, en dépit de leurs divisions apparentes, les conquérants de l’Angleterre à leurs anciens compatriotes. Sous l’influence de ce sentiment le français va cesser d’être la langue employée en Angleterre et l’on verra apparaître, ou plutôt prendre la prépondérance, la langue des vaincus d’Hastings, un anglo-saxon évolué assoupli, enrichi de mots français qui deviendra l’anglais.
Alfred Fichelle. Le monde slave. 1986
La guerre de Cent Ans n’a pas existé. Anglais et Français ne se sont pas battus continuellement pendant un siècle. La première guerre franco-anglaise s’achève avec la bataille de Poitiers (1356) et la paix de Calais (1360), sous Jean II le Bon. Puis vient le règne réparateur de Charles V (1364-1380) prolongé par les trente premières années du règne de Charles VI (1380-1422), où le royaume connaît une prospérité et une explosion culturelle remarquables. Mais Charles VI est devenu fou en 1392, et le reste malgré des moments de lucidité. La vie politique française s’en trouve gravement perturbée. La rivalité entre les princes devient de plus en plus vive. […] C’est désormais la guerre entre Bourguignons et Armagnacs.
Le roi d’Angleterre Henri V en profite pour reprendre la guerre contre la France. Il remporte la victoire d’Azincourt en 1415. Cette guerre affreuse dure jusqu’en 1453. Ce n’est qu’avec le règne de Louis XI (1461-1483) que commence la lente reconstruction du royaume.
Bernard Guénée. L’Histoire. Octobre 2002
Et, la signature de l’un de ces multiples traités de paix donnait lieu à une fête de la paix :
Et tous les bons faire les feux de joie
Et tout partout tous crier monjoie
Et dresser tables parmi ces carrefours
Apporter vins et rôtis et pâtés de fours
Acollant l’un l’autre par bonne amour
Chanter, danser, criant jusqu’au jour
Nous avons paix ! Dieu en soit loué !
Tant que chacun sera tout enroué.
Pierre de Nesson Lay de guerre, après 1424
1338/1339
Le peintre de Sienne Ambrogio Lorenzetti choisit pout thème l’Allégorie et effets du Bon et du Mauvais Gouvernement.
Dans la salle de la Paix du Palazzo Pubblico, des conseillers tirés au sort forment, de 1287 à 1355, le gouvernement des Neuf et administrent la République siennoise pour une durée de deux mois. La République est toutefois en danger, menacée depuis le XIVe siècle par une forme d’autocratie qu’on appelle alors seigneurie. C’était hier, mais ça ressemble à aujourd’hui : la cohésion sociale chancelle sous le poids de la concentration des richesses, les ambitions personnelles minent les décisions collectives, et les luttes politiques intestines corrodent l’esprit civique. Le langage se corrompt, l’oligarchie pointe à l’horizon. Elle oppose la force au droit, critique l’égalitarisme et réclame au pouvoir un homme fort.
C’est alors que le gouvernement des Neuf commande au peintre lettré Ambrogio Lorenzetti une fresque pour encadrer les magistrats et rappeler à la ville comme à ses édiles les effets du bon et du mauvais gouvernement. Déployée sur trois murs et trente-cinq mètres de long, la peinture réalisée en 1338-1339 est un plaidoyer pour le régime communal. Sur la paroi nord, face à la fenêtre du mur sud qui s’ouvre sur l’arrière du Palazzo Pubblico et la campagne siennoise (le contado), est représentée l’allégorie du bon gouvernement. Dépeintes sous les traits de personnages féminins, la Sagesse, la Concorde et la Justice siègent en compagnie d’une figure masculine – suzerain aux couleurs noir et blanc de Sienne ou incarnation du Bien commun – au-dessus des représentants de la ville, reliés ensemble par une corde qu’ils tiennent dans la main.
La paroi est décrit les effets du bon gouvernement sur la ville et le contado: une cité prospère faite de briques et de pierres où l’on s’affaire, animée par des maçons sur le toit des maisons, des orfèvres et des tailleurs dans leurs ateliers. Comme l’ont relevé maints critiques d’art, la città (la ville) ainsi dépeinte apparaît comme une dolce vita : des danseurs font une ronde en pleine rue alors qu’un fauconnier accompagne une noble chasse à travers les paysages de champs cultivés, de flore et de faune des collines toscanes. Face à elle, la paroi ouest dépeint les effets du mauvais gouvernement : une campagne fantomatique de terre brûlée où l’on guerroie et où l’on pille, une ville cadavérique aux tons délavés où l’on vole et viole sous le regard sarcastique, bouffonnant et effrayant du tyran.
Artiste savant et philosophe, Ambrogio Lorenzetti place sous les effets du bon gouvernement l’inscription suivante : Tournez les yeux pour admirer, vous qui exercez le pouvoir, celle qui est peinte ici. Car l’œuvre a été réalisée pour édifier. C’est plus qu’un lieu, c’est un événement, affirme l’historien Patrick Boucheron, auteur de Conjurer la peur. Sienne, 1338. Essai sur la force politique des images (Seuil, 2013). Un événement esthétique et politique toujours d’actualité. Car la fresque ne date pas du XIVe siècle, elle existe depuis le XIVe siècle, précise l’historien. Ce qui signifie qu’elle nous parle encore. Qu’elle est toujours active. Elle fait même partie de ces images qui alertent, comme La Mort de Marat (1793), de David (1748-1825), annonciatrice de la dégénérescence de la Révolution française et de la réaction thermidorienne, ou encore Guernica (1937), de Picasso (1881-1973), figuration picturale de la déflagration du fascisme qui ne sera pas circonscrite à la guerre d’Espagne. […]
Nicolas Truong Le Monde du 1° octobre 2023
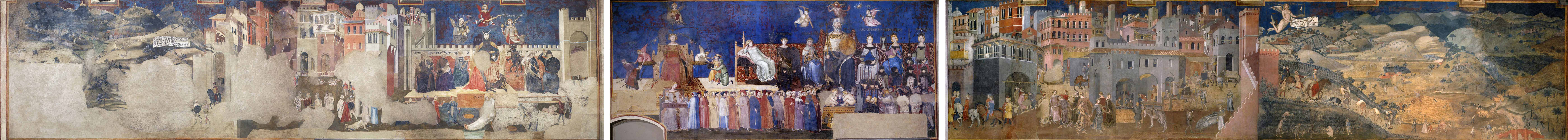
Reproduction des trois pans de la fresque « Allégorie et effets du Bon et du Mauvais Gouvernement » (1338-1339) d’Ambrogio Lorenzetti. A gauche, la paroi ouest décrit les effets du mauvais gouvernement et son allégorie. Au centre, la paroi nord représente l’allégorie du bon gouvernement. A droite, la paroi est dépeint les effets du bon gouvernement sur la ville et le « contado » (la campagne siennoise).©GIACOMSARTI/OPALE.PHOTO

La paroi ouest de la fresque « Allégorie et effets du Bon et du Mauvais Gouvernement » (1338-1339), d’Ambrogio Lorenzetti, décrit les effets du mauvais gouvernement et son allégorie. ©GIACOMSARTI/OPALE.PHOTO. Depuis novembre 2021, en cours de restauration.

La paroi nord de la fresque d’Ambrogio Lorenzetti représente l’allégorie du bon gouvernement. ©GIACOMSARTI/OPALE.PHOTO

La paroi est de la fresque de Lorenzetti dépeint les effets du bon gouvernement sur la ville et le « contado » (la campagne siennoise). ©GIACOMSARTI/OPALE.PHOTO
1339
Création de l’université de Grenoble par le pape Benoît XII.
1340
Enfreignant les interdits religieux, Louis d’Anjou autorise la faculté de Médecine de Montpellier à disséquer, une fois par an, un cadavre de supplicié dans le cadre des études d’anatomie.
Robert d’Anjou, roi de Naples, successeur de Frédéric II pour le titre de roi de Jérusalem, et sa seconde épouse Sancia de Majorque ont pris le temps qu’il fallait pour négocier auprès du sultan du Caire l’installation définitive des Franciscains à Jérusalem pour y devenir gardiens des Lieux Saints, principalement l’église du Saint Sépulcre et le mont Sion. Le tout sera conforté par une lettre du pape Clément VI en 1342.
1341
Le volcanisme sème la désolation en Islande :
Éruption volcanique du Mont Hekla. Il tomba tant de cendres et de pierres ponces et il se produisit dans le sol des fissures si grandes que des falaises tombèrent dans les flammes, faisant un tel vacarme qu’on l’entendit d’un bout à l’autre du pays. Il faisait si noir pendant que la pluie de cendres était à son maximum qu’il n’y avait pas assez de lumière pour lire dans les églises les plus proches de la source du feu. Grande famine. Grande hécatombe de cheptel (mouton et bétail). Rien qu’entre les jours du déménagement [à la fin mai] et la Saint Pierre [1° août] quatre-vingts têtes de bétail appartenant à Skálholt périrent.
Annales de Skálholt, à l’année 1341
1342
Mathieu d’Arras est appelé à Prague pour y construire la cathédrale.

Il faudra attendre le début du XX° siècle pour la voir achevée.
1343
Guillaume de Machaut, chanoine de la cathédrale de Reims, est le premier compositeur à écrire seul une messe : la Messe de Notre Dame. Il échappe à la peste en s’enfermant chez lui. C’est sous son influence que se développe l’école Ars Nova et avec elle, le chant polyphonique.
À nouveau, inondations à Chambéry : les édiles procéderont à des travaux d’endiguement.
Cola (abréviation de Nicola) di Rienzo, notaire romain, fait partie d’une ambassade romaine dépêchée auprès de Clément VI, pape nouvellement intronisé en Avignon, pour le persuader de revenir à Rome, qui dépérit faute de souverain – pontife comme non pontife -. La démarche ne sera pas couronnée de succès, mais Clément VI prendra en amitié cet homme au penchant marqué pour l’exaltation et qui n’est pas au bout de ses aventures.
01 1344
La guerre de succession de Bretagne avait vu le seigneur Olivier de Clisson, époux de Jeanne de Belleville, soupçonné par le roi de France de trahison auprès des Anglais, arrêté et décapité sans autre forme de procès le 2 août 1343. En 1342, une flotte anglaise avait débarqué 10 000 hommes sous les murailles de Vannes, où commandaient Hervé de Léon et Olivier de Clisson. Alors qu’Édouard III d’Angleterre était venu personnellement superviser le siège de Vannes, Olivier de Clisson avait été fait prisonnier. En janvier 1343, la trêve de Malestroit avait mis fin temporairement aux hostilités entre Blois et Montfort, Clisson avait été échangé contre le comte de Stanford.
on prétend que, pendant que les armées françaises et anglaises étaient en présence près de Vannes, Clisson suivit l’exemple de plusieurs autres seigneurs et traita avec l’Angleterre.
Si cette trahison ne fut jamais vraiment prouvée, elle était arrivée cependant aux oreilles du roi de France Philippe VI, qui fit, contre le droit des gens et les prérogatives de la chevalerie, arrêter Clisson dans un tournoi et, sans aucune forme de procès, lui fit trancher la tête.
[…] Aussitôt que la nouvelle du supplice d’Olivier de Clisson fut parvenue en Bretagne, ses nombreux amis se réunirent et allèrent offrir leurs services à Jeanne de Belleville, sa veuve. Cette femme était douée d’un grand caractère, et au lieu de se livrer à une douleur stérile, le désir de venger un outrage aussi cruel lui inspira une résolution extraordinaire.
Armand Désiré de La Fontenelle de Vaudoré, 1825.
Le courroux de Jeanne de Belleville s’abat d’abord sur la place forte de Château-Thébaud, commandé par Galois de la Heuse. Ce fidèle de Charles de Blois, qui n’est pas encore au courant de l’exécution d’Olivier de Clisson, accueille sa femme avec tous les honneurs dus à son rang. La place forte est mise à sac par les 400 partisans que Jeanne a rassemblé, composés notamment de plusieurs seigneurs bretons : ainsi débuta la légende de celle que l’on surnomma rapidement la tigresse bretonne, puis la lionne des mers, quand elle décida d’armer, avec l’aide des Anglais trois navires à bord desquels elle mena la vie dure aux navires battant pavillon français ;
commandant elle-même sa flotte, Jeanne de Belleville fera subir aux partisans de Charles de Blois et du roi de France de nombreuses pertes, s’attaquant aux bateaux de guerre français moins forts que les siens et à tous les vaisseaux marchands, elle mettait à mort sans merci tous les Français tombés entre ses mains.
La Chronique Normande du XIV° siècle
Bien peu de faits, beaucoup de légende, essentiellement créée par le romancier breton Robert de la Croix : Pirate sanguinaire à la tête de sa flotte noire, trois bateaux dont les coques avaient été peintes en noir et qui arboraient des voiles rouge sang, Jeanne de Belleville s’embarquait toujours avec ses fils, à qui elle avait fait jurer de venger la mémoire de leur père. Pendant plus de dix ans, elle aurait écumé la Manche et les rivages de l’Atlantique…puis par Emile Préhant, poète breton ami de Victor Hugo, à partir de 1868.
Épouse pour finir d’un lieutenant du roi d’Angleterre, Gautier de Bentley, elle mourra dans un lit, à Hennebont en 1359, chez Jeanne de Flandre, veuve de Jean de Montfort.
1344
Depuis le XI° siècle, c’est le seizième séisme qui frappe Byzance. Le sultan turc crée le corps des Janissaires ; originaires des steppes asiatiques, les Turcs étaient excellents cavaliers, mais piètres fantassins. Et, plutôt que de payer des mercenaires adultes, pourquoi ne pas se servir en jeunes chrétiens, de 10 à 15 ans, pris en pays conquis ? On commencera par en faire de bons petits musulmans, puis de très bons soldats. Leur statut d’esclave ne les empêchera pas d’accéder souvent à des postes de responsabilité : de 1453 à 1623 presque tous les vizirs seront des janissaires. Ils acquerront rapidement un rôle de garde prétorienne, deviendront un maillon du pouvoir au sein de la cour du sultan ; les réformes ne toucheront jamais leurs privilèges.
La confrérie religieuse, mystique des Bektachi, au sein desquels on trouve des derviches tourneurs, encadre alors la vie spirituelle de l’élite ottomane, – un équivalent de nos Jésuites – élite dont font partie les futurs janissaires : morale islamique et esprit de corps. Le chef suprême des janissaires, l’Ağa, est même membre à part entière des Bektachi, fondés au XIII° siècle, par Hâddjdjï Bektash Wâli (Veli), venu d’Iran, qui avait uni en une Trinité, Allah, Mahomet et Ali. Les alévis, qui regroupent les différentes confréries de derviches tourneurs, sont musulmans mais n’ont pas l’obligation des cinq prières quotidiennes ni du hadj à la Mecque : pour eux, le véritable pèlerinage se fait autour de la véritable Kaaba, le Cœur de l’Homme. Leur lieu de culte n’est pas la mosquée mais le cemevi, – cem evi qui signifie maison ou lieu du rassemblement -, où femmes et hommes assis côte à côte sont égaux devant leur Créateur. Ils célèbrent leurs cérémonies religieuses avec une danse giratoire sacrée, le semah au rythme du baglama. De nos jours, les alévis existent toujours en Turquie, se réclamant de libéralisme et de modernité : ce sont essentiellement eux qui agiteront Istanbul en juin 2013, en s’opposant à l’intégrisme soft du premier ministre Erdogan.
Par ordonnance, le parlement se voit accordé le droit de présenter des remontrances au roi.
17 04 1345
Le Conseil Supérieur de la République de Venise abroge la loi qui interdisait jusqu’alors aux citoyens de la Sérénissime l’achat de terrains en terre-ferme : la mesure fit affluer les capitaux dans l’arrière-pays, essentiellement tout au long des berges du canal de la Brenta. Naquirent ainsi des villas [nom dont la signification recouvre une gamme de bâti beaucoup plus large qu’en français ; très souvent il s’agit le plus souvent pour la langue française de véritables châteaux ou palais], résidences de campagne réunissant en un seul lieu la demeure patronale et les édifices destinés aux différents services. Il ne pouvait être question d’avoir un parc, des arbres, des pelouses à Venise ; d’autre part, il ne pouvait pas non plus être question de construire des monastères au fond d’une forêt pour rester à l’écart du tumulte du monde. Il fallait être vu, et pour cela, quel meilleur endroit que les berges d’un canal qui draine l’essentiel du trafic entre Venise et Padoue : ainsi naquit la Villa Veneta, épanouissement de la villégiature, qui ne prendra fin qu’avec la chute de la république de Venise, en 1797. En un peu plus de trois siècles, ce sont environ 2 000 villas, dont 70 sur les berges du canal de la Brenta, qui auront été construites, pour une vie parfois de labeur, mais le plus souvent de fête. On les qualifiera de palladiennes, en hommage au plus célèbre, mais pas le seul, de leurs architectes : Andrea Palladio. Pisani, véritable palais et ses dix hectares de parc, Widmann, Foscari, dite la Malcontenta d’Andra Palladio avec son monumental pronaos donnant sur le canal… etc…etc…
Cette balade est une bien belle journée qu’il est préférable de faire dans le sens Venise-Padoue que Padoue-Venise, ce qui permet d’éviter le très rude choc en débarquant à Venise après une journée de découverte dans le calme, après l’arrivée magique par la mer : une foule tapageuse et bruyante, des commerces qui vendent tous les mêmes médiocres articles, bouchant la vue, des escaliers de franchissement de canal défigurés par des tubulures visant à adoucir leur pente, des paquebots-camp de concentration qui font penser à un tank qui voudrait se garer dans un parking souterrain etc… En quittant Venise tôt le matin, on évite ces désagréments.

Casa Foscari La Malcontenta. Architecte : Andrea Palladio

Casa Foscari

Villa Pisani

Villa Widmann


1345
À Florence, des cardeurs et d’autres ouvriers de l’Art de la laine revendiquent depuis plusieurs mois le droit de s’organiser, en créant une confrérie. Leur chef, Ciuto Brandini, est arrêté et condamné à mort.
19 05 1346
Il est fait pour la première fois mention de la tarte lors des fêtes données pour l’élection du pape Clément VI.
20 05 1347
Cola di Rienzo nourrit une immense nostalgie de la Rome antique et verrait bien son rêve devenir réalité : il fomente une révolte populaire, principalement composée de popolani , farouchement antinobiliaires, qui lui confère les pleins pouvoirs pour restaurer le régime communal.
Surpris, le pape Clément VI légalise le coup de force. Les nobles sont contraints à l’obéissance, une milice est armée, l’approvisionnement de la ville est assuré. Mais, très rapidement, ce tribun érudit, se proclamant libérateur de la sacrée république romaine, prétend rendre à sa ville son importance universelle : Rome est déclarée capitale du monde, et c’est au peuple romain qu’est dévolue l’élection impériale ; les Italiens sont citoyens romains et jouissent de la liberté romaine. La commune de Rome ressuscite, parée, dans l’esprit de Cola, de toutes les vertus de la République antique. En août 1347, lui-même révèle qu’il est une sorte de messie-empereur. Dès lors, il inquiète : le légat Bertrand du Deux est chargé par Clément VI de le poursuivre comme hérétique. Victorieux d’une révolte des barons, il s’aliène par des violences arbitraires et incohérentes une population éprouvée par la disette. Une émeute le décide à déposer sa charge le 15 décembre 1347.
Encyclopædia Universalis
Il quittera Rome, puis l’Italie, ira retrouver le pape, qui, dans un premier temps, le mettra à l’ombre, puis, sur l’insistance de Pétrarque le libérera, et le renverra à Rome où les Orsini, les Colonna contestaient à nouveau son autorité. En 1354, Innocent IV, le nouveau pape, lui envoie, en soutien, le cardinal Albornoz, mais en août, après son entrée triomphale à la suite de laquelle il est élu sénateur, les Colonna montent le peuple contre lui et le 8 octobre, il est décapité, son corps jeté dans les eaux du Tibre.
29 05 1346
L’ordonnance de Brunoy donne naissance au premier code forestier royal.
26 8 1346
Édouard III, roi d’Angleterre, a débarqué à Saint Vaast la Hougue, dans le Cotentin, le 12 juillet. Il a pris Avranches, Ducey, Saint James, brûlé Caen qui avait tenté de résister, pris Lisieux, Elbeuf, franchi la Seine à Poissy et traverse la Somme pour camper à Crécy en Ponthieu – au nord d’Abbeville – où les chevaliers de Philippe VI de Valois chargent à découvert les archers d’Édouard III, fort bien entraînés, munis d’arcs qui lançaient trois flèches en même temps ; ils essuient en retour le tir des canons anglais : c’est la première apparition du canon en Occident. Le corps des arbalétriers génois, mercenaires au service de la France, était équipé d’arc ne tirant qu’une seule flèche. Fatigués, rechignant à aller au combat, ils se firent, sur ordre du roi de France, bousculer par la cavalerie française ! On enleva Philippe VI à la mort sur le champ de bataille.
À la vêprée, tandis que le jour tombait, partit le roi Philippe tout déconforté… Il chevaucha tout lamentant et plaignant ses gens jusqu’au château de la Broye. Quand il vint à la porte, il la trouva fermée et le pont levé, car il était toute nuit et il faisait fort brun et sombre. Alors fit le roi appeler le châtelain, car il voulait entrer dedans. Il fut appelé et vint avant sur les guérites et demanda tout haut : Qui est là qui erre à cette heure ? Le roi Philippe, qui entendit la voix, répondit et dit : Ouvrez, ouvrez, châtelain, c’est l’infortuné roi de France ! Le châtelain sortit aussitôt qui reconnut la parole du roi de France et savait déjà que les siens étaient déconfits, par quelques fuyards qui étaient passés vers le château. Il abaissa le pont et ouvrit la porte. Alors entra le roi dedans et toute sa troupe. Ils furent là jusqu’à minuit et le roi n’eut conseil d’y demeurer et s’y enfermer. Il but un coup et ainsi firent ceux qui avec lui étaient et puis partirent et sortirent du château et montèrent à cheval et prirent guide pour les mener… Et chevauchèrent tant qu’au point du jour ils entrèrent en la bonne ville d’Amiens… Vous devez savoir que la déconfiture et la perte, pour les Français, fut fort grande et fort horrible et trop y demeurèrent sur le champ de bataille de nobles et vaillants hommes, ducs, comtes, barons et chevaliers, desquels le royaume de France fut depuis fort affaibli d’honneur, de puissance et de conseils.
Froissart
L’averse, violente, fut de courte durée. Quand la pluie cessa, Ralph baissa les yeux vers la vallée et vit que l’ennemi était arrivé. Il tressaillit. Les Anglais occupaient une crête rocheuse qui courait du sud-ouest au nord-est. Sur leur arrière, au nord-est, s’étendait une forêt ; devant et sur les côtés, le terrain était vallonné. Le flanc droit dominait la ville de Crécy-en-Ponthieu, nichée dans une vallée traversée par la rivière Maye.
Les Français arrivaient par le sud.
Ralph se trouvait sur le flanc gauche. Les hommes du comte Roland, sous les ordres du jeune prince de Galles, avaient pris la formation qui avait démontré toute son efficacité lors des combats contre les Écossais. Cette tactique, d’une nouveauté radicale, consistait à déployer les archers en deux triangles à droite et à gauche, les bataillons disposés en dents de scie, et à regrouper au centre non seulement les hommes d’armes, mais aussi les chevaliers à pied. On comprendra donc qu’elle n’ait pas la faveur de ces derniers, qui se sentaient vulnérables, privés de leurs destriers. Las, le roi avait été implacable : tout le monde irait à pied ! A l’avant, le terrain avait été creusé de trous carrés, profonds d’un pied, destinés à faire trébucher les montures ennemies.
Sur la droite de Ralph, tout au bout de la crête, des machines, d’une extraordinaire innovation technique elles aussi, avaient été installées. Elles lançaient des pierres rondes grâce à l’utilisation d’une poudre explosive. Appelées bombardes ou canons, ces machines étaient au nombre de trois. Elles avaient été tractées à travers toute la Normandie au gré de la campagne militaire, mais n’avaient pas encore servi. On ignorait donc si elles fonctionneraient. Aujourd’hui, face à un ennemi entre quatre et sept fois supérieur, le roi Édouard avait ordonné de les monter, déterminé qu’il était à utiliser tous les moyens à sa disposition.
Sur le flanc gauche, les hommes du comte de Northampton avaient été placés eux aussi selon cette même formation en herse. Derrière cette ligne de front, un troisième bataillon mené par le roi se tenait en réserve, conforté sur l’arrière par deux remparts. Le premier était constitué par les chariots de l’intendance disposés en cercle et servant de muraille aux bêtes de somme et à tous ceux qui ne participaient pas au combat : des cantiniers aux ingénieurs, en passant par les palefreniers ; le second était le bois lui-même où les survivants de l’armée anglaise, étant à pied, pourraient s’enfuir en cas de défaite sans être poursuivis par les chevaliers français dont les destriers seraient incapables de se frayer une voie à travers les taillis.
Les Anglais attendaient là depuis les premières heures du matin, le ventre creux, n’ayant reçu pour pitance que de la soupe aux pois et des oignons. Sous son armure, Ralph souffrait de la chaleur. Il avait accueilli l’averse d’orage avec d’autant plus de bonheur qu’elle avait rendu la pente boueuse et traîtreusement glissante, ce qui ralentirait l’assaut des Français.
Il devinait déjà leur tactique. Les Génois tireraient à l’arbalète, dissimulés derrière leurs pavois, pour affaiblir les lignes de front anglaises. Puis, quand ils considéreraient avoir causé suffisamment de dommages, ils s’écarteraient pour céder le passage aux chevaliers français, qui s’élanceraient à l’assaut sur leurs chevaux de bataille.
Rien n’était plus terrifiant que cette charge. Appelée fureur francisque, c’était l’arme ultime de la noblesse française. Juchés sur des bêtes prodigieuses, des êtres monstrueux recouverts de fer de la tête aux pieds déferlaient telle une vague sur les archers tapis derrière leurs boucliers, de même que sur les hommes d’armes brandissant leurs épées.
Cette tactique, bien sûr, ne leur garantissait pas systématiquement la victoire car l’assaut pouvait être repoussé, en particulier lorsque le terrain favorisait les défenseurs comme c’était le cas ici, mais les Français ne se laissaient pas décourager : fidèles à leur code de l’honneur, ils chargeraient encore, au mépris du danger.
Face à leur colossale supériorité numérique, les Anglais ne résisteraient pas indéfiniment, se disait Ralph avec effroi. Pour autant, il ne regrettait pas d’être là. Depuis sept ans déjà, il menait la vie qu’il avait toujours souhaité vivre, une vie où les forts étaient les rois et où les faibles ne comptaient pas. Il avait vingt-neuf ans, un âge qu’atteignaient rarement les hommes d’action. Il avait commis mille péchés dont il avait toujours été absous, notamment ce matin même par l’évêque de Kingsbridge en personne, lequel se tenait à présent à côté de son père, le comte de Shiring, armé d’une massue car les prêtres n’étaient pas censés répandre le sang. Mais cette règle, ils la détournaient en ramassant les armes émoussées sur les champs de bataille.
Les arbalétriers dans leurs capes blanches avaient atteint le pied de la colline. Les archers anglais, restés assis jusque-là, leurs flèches fichées dans le sol devant eux, se mirent debout et bandèrent leurs arcs. Ralph se dit que la plupart d’entre eux devaient éprouver un sentiment identique au sien, où se mêlaient le soulagement de voir une longue attente s’achever enfin et la peur que la chance ne leur sourie pas aujourd’hui.
Les combats ne commenceraient pas avant longtemps. Les Génois n’avaient pas encore leurs grands pavois, élément essentiel de leur tactique. Les Français ne livreraient pas bataille tant que leurs arbalétriers n’auraient pas leurs défenses, Ralph en était convaincu.
Des milliers de chevaliers se déversaient dans la vallée par le sud, se répartissant à droite et à gauche derrière les lignes des arbalétriers. Le soleil réapparut, faisant étinceler les couleurs des bannières et des caparaçons des chevaux. Ralph reconnut celles du comte d’Alençon, Charles, le frère du roi Philippe.
Les arbalétriers s’arrêtèrent au pied de la colline. Ils étaient des milliers. Soudain, comme s’ils répondaient à un signal donné, ils se mirent à pousser des cris effrayants, et certains même à sauter en l’air. Les trompettes sonnèrent.
C’était le cri de guerre, un cri censé terroriser l’ennemi, mais qui laissa les Anglais de marbre : en six semaines de campagne, ils avaient eu le temps de s’y habituer.
Mais voilà qu’à l’ébahissement de Ralph, les Génois levèrent leurs armes. Que faisaient-ils ? Ils n’avaient même pas leurs boucliers !
Éclata soudain le bruit terrifiant de cinq mille flèches en fer traversant les airs. Mais les Anglais étaient hors d’atteinte. Les arbalétriers auraient-ils oublié qu’ils tiraient vers le haut ? Étaient-ils éblouis par le soleil de l’après-midi, que les Anglais avaient dans le dos ? Quelle qu’en soit la raison, les flèches retombèrent sans avoir touché personne.
Il y eut alors, au milieu de la ligne de front anglaise, l’éclair d’une flamme, suivi d’un craquement aussi retentissant que le tonnerre. Ralph vit de la fumée s’élever de l’endroit où les nouvelles machines étaient installées. Le vacarme était impressionnant. Quand il reporta les yeux sur l’ennemi, il constata que les bombardes n’avaient pas causé grand dommage dans les rangs ennemis. À défaut, elles avaient à ce point stupéfié les arbalétriers qu’ils en avaient oublié de recharger leurs armes.
Le prince de Galles en profita pour donner à ses archers l’ordre de tirer. Deux mille arcs de guerre se levèrent ensemble.
Se sachant trop éloignés, les archers ne tirèrent pas parallèlement au sol mais visèrent le ciel, devinant intuitivement le tracé que suivraient leurs flèches. Tous les arcs se courbèrent simultanément comme les épis d’un champ ployant sous une brise soudaine, et les flèches furent lâchées dans un bruit de tocsin. Elles escaladèrent le ciel plus vite que l’oiseau le plus vif et retombèrent en piqué pour s’abattre sur les arbalétriers telle une averse de grêle.
L’ennemi se massait en rangs serrés. Leurs pourpoints matelassés n’offraient aux Génois qu’une protection dérisoire. Sans leurs pavois, ils étaient vulnérables. Ils s’écroulèrent par centaines, morts ou blessés.
Ce n’était que le début du combat. Les survivants rechargèrent leurs armes, les Anglais tirèrent à nouveau. Un archer n’avait pas besoin de plus de quatre ou cinq secondes pour arracher du sol la flèche plantée devant lui, la poser sur la corde, bander son arc, viser et tirer, et il lui fallait moins de temps encore s’il était expérimenté. En l’espace d’une seule minute, vingt mille flèches s’abattirent sur des arbalétriers privés de toute protection.
Ce fut un massacre. La conséquence, prévisible, ne se fit pas attendre : ils tournèrent les talons et s’enfuirent à toutes jambes.
En un instant, les Génois furent hors de portée. Les Anglais cessèrent le tir, riant à ce triomphe auquel ils ne s’attendaient pas, raillant l’ennemi.
Les Génois qui fuyaient en un troupeau compact se retrouvèrent nez à nez avec la masse des chevaliers français sur le point de charger. Ce fut le chaos !
Ralph fut alors témoin d’une scène stupéfiante : les ennemis se battaient entre eux. Les chevaliers brandissaient leurs épées contre les archers, et ceux-ci, en retour, visaient les chevaliers ou les attaquaient au couteau. Les nobles auraient dû s’employer à faire cesser le carnage, mais apparemment ceux qui portaient les armures les plus riches et montaient les chevaux les plus grands étaient les premiers à taillader leurs propres soldats, et cela avec une fureur redoublée.
Les chevaliers forcèrent les fuyards à remonter la pente jusqu’à se trouver à nouveau à portée des Anglais.
Le prince de Galles, bien évidemment, donna l’ordre de tirer à ses archers. Leurs flèches, à présent, s’abattirent sur les chevaliers français aussi bien que sur les Génois. En sept années de guerre, Ralph n’avait jamais vu cela. Les ennemis gisaient par centaines sur le sol, morts ou blessés. Et pas un seul Anglais n’avait reçu une simple égratignure !
Les chevaliers français finirent par sonner la retraite. Ce qui restait des arbalétriers se dispersa dans la campagne, laissant le flanc de colline jonché de corps juste en dessous des positions anglaises.
Des soldats originaires du pays de Galles et de Cornouailles s’élancèrent alors des rangs anglais pour achever les Français blessés et ramasser les flèches réutilisables. Et aussi, certainement, pour dépouiller les cadavres. Pendant ce temps, les coursiers filèrent s’approvisionner en flèches auprès de l’intendance et les rapportèrent aux premières lignes des forces anglaises.
Il y eut une pause, elle fut de courte durée.
Les chevaliers français s’étaient regroupés. Des forces nouvelles venaient s’adjoindre à celles du comte d’Alençon ; elles arrivaient par centaines et par milliers. Les voyant apparaître, Ralph en scruta les rangs. Il reconnut les couleurs des Flandres et de la Normandie.
Les troupes du comte d’Alençon s’avancèrent en première ligne, les trompettes sonnèrent et les cavaliers se mirent en mouvement.
Ralph abaissa son heaume et sortit son épée du fourreau. Il eut une pensée pour sa mère. Il savait qu’elle priait pour lui chaque fois qu’elle allait à l’église et il éprouva subitement pour elle une chaleureuse gratitude. Puis il reporta les yeux sur l’ennemi.
Entravés par le poids de leurs cavaliers en armure, les énormes chevaux étaient lents à démarrer. Les rayons du soleil couchant se reflétaient sur les casques d’acier des Français et leurs bannières claquaient dans la brise du soir. Peu à peu, le tintement des sabots résonna plus fortement et l’allure des chevaux s’accéléra. Les chevaliers flattaient leurs montures et se hurlaient des encouragements l’un à l’autre, en agitant leurs piques et leurs épées. La vitesse à laquelle ils déferlaient telle une vague sur la plage créait l’impression qu’ils étaient de plus en plus nombreux à mesure qu’ils se rapprochaient. Ralph avait la bouche sèche, son cœur battait comme un tambour.
Les Français étaient arrivés à portée de tir, et le prince, une fois de plus, donna l’ordre de tirer. À nouveau, les flèches s’élevèrent dans le ciel et retombèrent comme une pluie mortelle.
Les chevaliers lancés à l’assaut de la colline étaient recouverts de la tête aux pieds par leur armure et c’était un miracle lorsqu’une flèche trouvait la jointure entre deux plaques de métal. Leurs montures, en revanche, n’avaient que le museau et l’encolure protégés par une plaque de métal ou une cotte de mailles, et lorsqu’une flèche se plantait dans leur flanc ou leur poitrail, soit ils s’immobilisaient, soit ils s’écroulaient, soit ils faisaient demi-tour. Les collisions entre chevaux causaient de nombreuses chutes et leurs cavaliers, à l’instar des archers, se retrouvaient alors écrasés par ceux qui arrivaient derrière et qui, emportés par leur élan, leur passaient sur le corps.
Mais aujourd’hui, les chevaliers se comptaient par milliers, et il en arrivait encore et encore ! Les rangs des archers s’effilochaient, leurs tirs perdaient en précision. Lorsque les Français ne furent plus qu’à quelques centaines de pas, ils changèrent leurs flèches en pointe pour d’autres à bout carré, capables de perforer les armures. À présent, ils étaient en mesure de tuer les cavaliers, même si abattre leurs montures s’avérait presque aussi efficace.
Le sol était détrempé par la pluie. Dans quelques instants, les Français parviendraient à la partie de terrain creusée par les Anglais. À la vitesse qui était la leur, les bêtes allaient trébucher et même s’écrouler si elles posaient le pied dans un trou. Et leurs cavaliers, bien souvent projetés au sol, se retrouveraient sous les pattes mêmes des autres chevaux.
Comme l’avaient prévu les Anglais, les chevaliers qui arrivaient à la charge s’écartèrent sur la droite et sur la gauche pour éviter les archers. C’est alors qu’ils se découvrirent canalisés dans un étroit goulot, devenus la cible de tirs venant des deux côtés à la fois.
La stratégie anglaise allait démontrer toute sa raison d’être. L’ordre intimé aux chevaliers anglais de combattre à pied prenait maintenant tout son sens. À cheval, ils n’auraient pas résisté à la tentation de s’élancer à la rencontre des Français et les archers auraient cessé de tirer de peur de tuer leurs propres combattants. Mais comme les chevaliers et les hommes d’armes campaient sur les positions qui leur avaient été assignées, l’ennemi put être massacré sans que les Anglais ne subissent de pertes.
Hélas, face au nombre et à la bravoure des Français, cette ruse ne suffit pas. L’assaut se poursuivit et les Français finirent par atteindre les chevaliers et les soldats anglais, massés entre les deux groupes d’archers. La bataille, alors, commença véritablement.
Si les cavaliers français étaient parvenus à enfoncer les premiers rangs des lignes anglaises, malgré le terrain glissant et la pente, ils n’étaient plus en nombre suffisant pour affronter le gros des troupes anglaises massé là.
Brutalement plongé au cœur de la mêlée, Ralph s’efforçait du mieux qu’il pouvait d’éviter les coups que lui portaient les chevaliers français du haut de leurs montures. À grand renfort de moulinets, il cherchait à trancher les jarrets des chevaux, moyen le plus facile et le plus rapide d’invalider l’animal. La bataille faisait rage. Les Anglais n’avaient pas de base de repli. Quant aux Français, ils savaient que, s’ils battaient en retraite, ils subiraient à nouveau la même averse de flèches qu’en montant.
Autour de Ralph, les hommes s’écroulaient, pourfendus par les épées et les haches de guerre et aussitôt piétinés par les puissants sabots des destriers. Ralph vit le comte Roland déraper et tomber sous les coups d’épée d’un Français et l’évêque Richard faire tournoyer sa massue pour protéger son père à terre. Mais un cheval de guerre percuta l’évêque et le comte fut piétiné sous les sabots de la bête.
Les Anglais étaient contraints de reculer. Ralph se rendit compte brusquement que les Français s’étaient concentrés sur le prince de Galles. À vrai dire, il n’éprouvait pas une affection particulière pour ce garçon de seize ans, mais il savait que la mort ou la capture de l’héritier du trône porterait un coup terrible au moral des Anglais. Il recula donc vers la gauche et rejoignit plusieurs de ses camarades qui formaient une défense autour de leur prince. Las, les Français intensifiaient leurs efforts, et ils étaient à cheval.
À un moment, Ralph se retrouva épaule contre épaule avec le prince qu’il reconnut à son pourpoint : fleurs de lys sur fond bleu et lions héraldiques sur fond rouge.
L’instant était critique.
Il bondit sur l’attaquant du prince et parvint à introduire son épée sous son bras, à l’endroit précis où les deux parties de son armure se rejoignaient. Avec quel plaisir il sentit la pointe de son arme entailler la chair du Français et vit le sang jaillir de la blessure.
Un guerrier s’était jeté à califourchon sur le prince tombé à terre et le protégeait en balançant son épée, déterminé à empêcher quiconque, homme et cheval, d’approcher de son maître. Ralph reconnut en lui Richard Fitzsimon, le porte-étendard du prince. Il avait laissé choir son drapeau, dissimulant ainsi le prince aux yeux de l’ennemi. Ralph se battit comme un lion à ses côtés, sans même savoir si le fils du roi était mort ou vivant.
Des renforts arrivèrent. Le comte d’Arundel apparut à la tête de nouvelles troupes. Ces hommes, nombreux et reposés, se lancèrent dans la mêlée avec ardeur et surent inverser la situation. Les Français commencèrent à reculer.
Le prince de Galles se redressa sur les genoux. Ralph leva son heaume et l’aida à se mettre debout. Il avait été touché mais sa blessure ne semblait pas être grave. Ralph se retourna pour reprendre le combat.
Les Français se dispersaient. Leur courage suppléant à leur folie, ils étaient presque parvenus à briser les lignes anglaises, mais n’avaient pas réussi à les mettre en déroute et, maintenant, c’étaient eux qui fuyaient pour rejoindre leurs lignes, se livrant aux flèches des archers. Il en tomba un grand nombre tandis qu’ils dévalaient la pente couverte de sang. Un cri de joie monta des forces anglaises, épuisées mais radieuses.
Une fois de plus, les Gallois envahirent le champ de bataille, tranchant la gorge aux blessés et ramassant des milliers de flèches. Les archers récoltèrent aussi les tiges, pour renouveler leurs munitions. Des cantonniers apparurent de l’arrière, avec des jarres de bière et de vin, et les chirurgiens se précipitèrent pour soigner les nobles blessés.
Ralph vit William de Caster penché sur son père. Le comte Roland respirait encore, mais il avait les yeux fermés et il semblait bien près de mourir.
Ralph essuya dans l’herbe le sang de son épée et releva sa visière pour boire une chope de bière. Le prince de Galles s’avança vers lui.
– Comment t’appelles-tu?
– Ralph Fitzgerald, de Wigleigh, mon seigneur.
– Tu t’es battu bravement. Demain, tu seras sieur Ralph si le roi daigne m’écouter.
Ralph eut un sourire resplendissant. Je vous remercie, mon seigneur. Le prince lui décocha un gracieux signe de tête et poursuivit son chemin.
Ken Follet. Un monde sans fin. Robert Laffont 2008
J’ai vu Crécy, j’ai visité ce sombre champ de bataille. J’ai fait le tour du vieux moulin de pierre qui marque la place où l’attaque a commencé. Je suis descendu au fond de ce vallon où les dolabres et les haches d’armes ont si rudement travaillé. Le village est assez pittoresque. J’en ai dessiné l’église, laquelle a vu la bataille. Il y a aussi, au milieu de la place du village, une vieille fontaine romane qui a du étancher bien du sang ce jour-là. Fontaine curieuse et unique pour moi jusqu’à ce jour. Grosses nervures de brique à plein cintre. Piliers trapus en pierre avec chapiteaux sculptés. Trois étages, dont deux sont déformés.
Victor Hugo. Lettre à Adèle. Bernay, 5 septembre 1837
4 08 1347
Après onze mois de siège, – on y mangeait toutes ordures par droite famine, et il devenait inutile de perdre corps et âme par rage de faim – les Anglais prennent Calais.
Il ne restait plus aux gens de Calais qu’à se donner à l’ennemi, s’il voulait bien d’eux. Mais les Anglais les haïssaient mortellement, comme marins, comme corsaires…
Il était assez probable que le roi d’Angleterre, qui s’était tant ennuyé devant Calais, qui y était resté un an, qui, en une seule campagne, avait dépensé la somme, énorme alors, de près de dix millions de notre monnaie, se donnerait la satisfaction de passer les habitants au fil de l’épée ; en quoi certainement il eut fait plaisir aux marchands anglais. Mais les chevaliers d’Edouard lui dirent nettement que s’il traitait ainsi les assiégés, ses gens n’oseront plus s’enfermer dans les places, qu’ils auraient peur des représailles. Il céda et voulut bien recevoir la ville à merci, pourvu que quelques uns des principaux bourgeois vinssent, selon l’usage, lui présenter les clefs, tête nue, pieds nus, la corde au col.
Il y avait danger pour les premiers qui paraîtraient devant le roi. Mais ces populations des côtes, qui, tous les jours, bravent la colère de l’océan, n’ont pas peur de celle d’un homme. Il se trouva sur le champ, dans cette petite ville dépeuplée par la famine, six hommes de bonne volonté pour sauver les autres. Il s’en présente tous les jours autant et davantage dans les mauvais temps, pour sauver un vaisseau en danger. Cette grande action, j’en suis sûr, se fit tout simplement, et non piteusement, avec larmes et long discours, comme l’imagine le chapelain Froissart.
Il fallut pourtant les prières de la reine et des chevaliers pour empêcher Édouard de faire prendre ces braves gens. On lui fit comprendre sans doute que ces gens-là s’étaient battus pour leur ville et leur commerce plutôt que pour le roi ou le royaume. Il repeupla la ville d’Anglais, mais il admit parmi eux plusieurs Calaisiens, qui se tournèrent Anglais, entre autres Eustache de Saint-Pierre, le premier de ceux qui lui avaient rapporté les clefs.
Jules Michelet. Histoire de France 1876-1877
Six notables apportèrent donc les clés de la ville au roi d’Angleterre nus pieds et nus chefs, en leurs linges draps tant seulement, les harts au col.
Quand le roi d’Engleterre fut venu premièrement devant la ville de Calais, ainsi que celui qui moult la désiroit à conquérir, il l’assiégea par grand’manière et de bonne ordonnance, et fit bâtir et ordonner entre la ville et la rivière et le pont de Nieulai hôtels et maisons, et charpentes de gros merrein, et couvrir les dites maisons, qui étaient assises et ordonnées par rues bien et faiticement, d’estrain et de genets, ainsi comme s’il dut là demeurer dix ou douze ans ; car telle était son intention qu’il ne s’en partiroit, par hiver ni par été, tant qu’il l’eut conquise, quel temps ni quelle peine il y dut mettre ni prendre.
[…] Messire Jean de Vienne [le capitaine de Calais] vint au marché et fit sonner la cloche pour assembler toutes gens en la halle. Au son de la cloche vinrent hommes et femmes, car ils désiraient fort entendre nouvelles, eux qui étaient si accablés de famine que plus ne la pouvaient supporter. Quand ils furent tous venus et assemblés en la halle, hommes et femmes, messire Jean de Vienne leur démontra doucement les paroles du roi et leur dit qu’il n’en pouvait être autrement et qu’ils eussent sur ce avis et brève réponse. Quand ils entendirent ce rapport, ils commencèrent tous à crier et pleurer tellement et si amèrement qu’il n’est si dur cœur au monde, s’il les eût vus ou entendus, qui n’en eût pitié. Ils n’eurent pour l’heure pouvoir de répondre et de parler, et de même messire Jean de Vienne en avait telle pitié qu’il larmoyait fort tendrement. Un moment après se leva le plus riche bourgeois de la ville qu’on appelait sire Eustache de Saint-Pierre et il dit devant tous ainsi :
– Seigneur, grand pitié et grand mal ce serait de laisser mourir un tel peuple qu’il y a ici par famine ou autrement quand on y peut trouver autre moyen. Et ce serait grande grâce envers Notre Seigneur à qui pourrait le garder d’un tel mal. J’ai si grande espérance d’avoir grâce et pardon de Notre Seigneur, si je meurs pour ce peuple sauver, que je veux être le premier et me mettrai volontiers en chemise, le chef nu, la hart au col à la merci du roi d’Angleterre.
Quand Eustache de Saint-Pierre eut dit cette parole, chacun en eut pitié ; et plusieurs hommes et femmes se jetaient à ses pieds, pleurant tendrement et c’était grand pitié d’être là et de les ouïr, écouter et regarder. Secondement, un autre très honnête bourgeois et de grande affaire, et qui avait pour filles deux belles demoiselles, s’éleva et dit aussi qu’il ferait compagnie à son compère, sire Eustache de Saint-Pierre. Il s’appelait sire Jean d’Aire. Après, se leva le troisième qui s’appelait sire Jacques de Wissant, qui était riche homme de meubles et d’héritage, et dit qu’il ferait compagnie à ses deux cousins. Aussi fit Pierre de Wissant, son frère, puis le cinquième, puis le sixième ; et là se dévêtirent ces six bourgeois, tout nus en leurs braies et leur chemise, en la ville de Calais, et mirent hart (corde) au cou, comme l’ordonnance le portait, et prirent les clés de la ville et du château, chacun en tenant une poignée. Les six bourgeois s’acheminent ainsi vers le camp royal.
Le roi était à cette heure en sa chambre avec grande compagnie de comtes, de barons et de chevaliers. Il entendit dire que ceux de Calais venaient en l’attirail qu’il avait ordonné et il vint dehors et se tint en la place devant son hôtel et tous ses seigneurs après lui et encore grand foison qui survinrent pour voir ceux de Calais et mêmement la reine d’Angleterre, qui était fort enceinte, suivit le roi son seigneur. Et vint messire Gautier de Mauny et les bourgeois qui le suivaient et il descendit vers la place et s’en vint vers le roi et lui dit :
– Sire, voici la représentation de la ville de Calais à votre ordonnance.
Le roi se tint coi et les regarda fort cruellement, car il haïssait les habitants de Calais à cause des grands dommages que ce temps passé lui avaient faits. Ces six bourgeois se mirent à genoux devant le roi, et, joignant leurs mains, dirent :
– Gentil sire et gentil roi, voyez-nous ici six qui avons été d’ancienneté bourgeois de Calais et grands marchands, nous vous apportons les clés de la ville et du château de Calais et vous les rendons à votre plaisir, et nous mettons au point que vous voyez en votre volonté pour sauver le reste du peuple de Calais qui a souffert grand malheur. Veuillez avoir de nous pitié et merci par votre très haute noblesse.
Certes, il n’y eut en la place seigneur, chevalier ni vaillant homme qui pût s’abstenir de pleurer de pitié et qui pût parler. Et vraiment ce n’était pas merveille, car c’est grand pitié de voir hommes de bien tombés en tel état. Mais le roi ne se laisse pas si facilement attendrir : il ordonne qu’on leur coupe la tête. Les seigneurs intercèdent en faveur de ces hommes, mais sans résultat :
– Ceux de Calais ont fait mourir tant de mes hommes qu’il convient que ceux-ci meurent aussi.
Alors fit la noble reine d’Angleterre [Philippa de Hainaut] grande humilité ; elle était durement enceinte et pleurait si tendrement de pitié qu’elle ne se pouvait soutenir. Elle se jeta à genoux par-devant le roi, son seigneur, et dit ainsi :
– Ah ! gentil sire ! Depuis que je repassai la mer en grand péril comme vous savez, je ne vous ai rien requis ni demandé ; or, je vous prie humblement et requiers comme don que pour le Fils Sainte Marie et pour l’amour de moi vous veuillez avoir pitié de ces six hommes.
Le roi attendit un peu avant de parler et regarda la bonne dame sa femme qui pleurait à genoux fort tendrement ; cela lui amollit le cœur, car il aurait eu peine de la courroucer au point où elle était ; et il dit :
– Ah! dame, j’aurais mieux aimé que vous fussiez autre part qu’ici. Vous me priez si fort que je ne vous ose éconduire. Et, bien que j’aie peine à le faire, tenez, je vous les donne, faites-en votre plaisir.
La bonne dame dit :
– Monseigneur, très grand merci.
Alors se leva la reine et fit lever les six bourgeois et leur fit ôter les cordes d’entour leurs cous et les emmena avec elle en sa chambre et les fit revêtir et donner à dîner tout à l’aise, puis donna à chacun six nobles (pièces de monnaie), et les fit conduire hors de l’armée, en sûreté, et ils s’en allèrent habiter et demeurer en plusieurs villes de Picardie.
Froissart
Dans L’Histoire n° 380 d’octobre 2012, Philippe Contamine, affirme que tout cela est faux, sans le prouver, ce qui est embêtant ; mais il renvoie au livre de Jean-Marie Moeglin – Les Bourgeois de Calais, Albin Michel 2002 -, qui lui, paraît-il, le prouve.

Les bourgeois de Calais, par Auguste Rodin 1889. Ils se nomment Eustache de Saint Pierre, Jean d’Aire, Pierre de Wissant, Jacques de Wissant, Andrieu d’Andres, riches marchands et gros propriétaires, et Jean de Fiennes, capitaine de la garnison.
Soldats et bourgeois n’étaient pas toujours les seuls en première ligne. Un petit village des environs de Compiègne, Longueil-Sainte-Marie, dans l’Oise, a connu les exploits de deux paysans, Guillaume l’Aloue et son compagnon, une sorte de géant à la force incroyable, qu’on appelait le Grand Ferré. Ils avaient réuni autour d’eux une troupe d’environ 200 paysans. Les Anglais, qui occupaient la forteresse de Creil, dans l’Oise, pensèrent faire bon marché de la résistance de ces rustres ; mais, par deux fois, ils furent mis en déroute.
Leurs bras s’élevaient en l’air et puis s’abattaient avec une telle violence qu’il n’y avait guère de leurs coups qui ne fussent mortels. À la seconde attaque, Guillaume l’Aloue fut atteint mortellement. Le Grand Ferré en redoubla d’ardeur, chargeant les Anglais qui ne lui arrivaient même pas à la hauteur de l’épaule, il brandit sa hache et en assena de tels coups, et si redoublés, qu’il faisait devant lui place nette. Car il ne touchait pas un ennemi, le frappant d’un coup droit sur la tête, sans lui fendre le casque et le renverser lui-même par terre, la cervelle répandue. Or le combat venait de finir et les Anglais étaient mis en déroute. Le Grand Ferré tout en sueur, car il faisait une chaleur excessive, échauffé d’ailleurs par cette besogne, but une grande quantité d’eau froide. Il fut pris presque aussitôt d’un accès de fièvre. Alors, il quitta ses compagnons et, ayant regagné sa chaumière située près de là à Rivecourt, il se mit au lit, se sentant fort malade, non sans toutefois garder près de lui sa hache de fer qui était si pesante qu’un homme ordinaire n’aurait pu qu’avec peine la lever des deux mains jusqu’aux épaules. À la nouvelle de la maladie du Grand Ferré, les Anglais se réjouirent fort parce que, lui présent, nul d’entre eux n’aurait osé se risquer à venir du côté de Longueil. Craignant qu’il ne guérît, ils envoyèrent secrètement douze d’entre eux pour l’égorger dans son habitation. Mais sa femme, qui de loin les vit venir, courut en toute hâte vers le lit où il était gisant et lui dit :
– Hélas! Ferré, mon bien-aimé, voilà les Anglais et je crois bien que c’est à toi qu’ils en veulent. Que vas-tu faire ?
Mais lui alors, oubliant son mal, se met précipitamment en état de défense et, saisissant sa lourde hache avec laquelle naguère il avait frappé mortellement tant d’ennemis, il sort de son logis et s’en vient en une petite cour d’où, apercevant les Anglais, il leur crie :
– Brigands, vous êtes donc venus pour me prendre dans mon lit, mais vous ne me tenez pas encore !
Et, s’adossant contre un mur pour ne pas être entouré, il fond impétueusement sur eux et joue de sa hache avec la force et la vaillance des meilleurs jours… Les Anglais s’enfuirent. Mais il s’était échauffé à force de donner des coups. Il but de nouveau de l’eau froide en abondance de sorte que la fièvre le reprit plus fort. Les accès ayant redoublé de violence, le Grand Ferré, peu de jours après, reçut les sacrements et quitta ce monde. On l’enterra dans le cimetière de son village. Il fût bien pleuré de ses compagnons et de tout le pays, car, lui vivant, jamais Anglais n’y aurait mis le pied.
Jean de Venette, carme de Paris
Une autre épidémie de peste noire [1] ravage le pays, apportée de la Mer Noire par les galères génoises : le khan tatar Djanibek assiégeait la colonie génoise de Caffa – aujourd’hui Feodosiya ou Théodosie -, en Crimée. Ses troupes ayant été touchées par la peste, il la propagea aux Génois en catapultant des rats[2] – Rattus rattus – contaminés sur leurs navires. La peste vient d’Asie, le principal foyer étant en Chine, dès 1331. On estime la population de l’empire à 125 millions cette année-là ; en 1393, elle n’était plus que de 90 millions. Vers 1338, la peste est attestée sur les plateaux d’Asie centrale et aux environs du lac Baïkal : elle va suivre la route de la soie.
Péra, colonie génoise de Constantinople, a été touchée dès l’été 1347, la Sicile en octobre, Gênes et Marseille en novembre [3], la Sardaigne et la Corse en décembre, Pise et Venise en janvier 1348, les villes du Languedoc en février, Toulouse et Lyon en avril, Barcelone et Valence en mai, Bordeaux et Rouen en juin, Paris dans l’été, qui perdra ainsi près du quart de sa population en 1349.
Les gens n’étaient malades que deux ou trois jours et mouraient rapidement, le corps presque sain. Celui qui aujourd’hui était en bonne santé, demain était mort et porté en terre.
[…] Quand l’épidémie, la pestilence et la mortalité eurent cessé, les hommes et les femmes qui restaient se marièrent à l’envi… Les femmes survivantes eurent un nombre extraordinaire d’enfants… Hélas ! de ce renouvellement du monde, le monde n’est pas sorti amélioré. Les hommes furent après encore plus cupides et avares, car ils désiraient posséder bien plus qu’auparavant ; devenus plus cupides, ils perdaient le repos dans les disputes, les brigues, les querelles et les procès.
Jean de Venette, carme de Paris
Pendant deux années, la mort frappa avec une rage que jamais l’humanité n’avait connu. La terre s’ouvrait pour la faire disparaître. Les hommes paraissaient étrangers au monde. Les fosses étaient pleines, les charniers laissés à l’air libre et recouverts de chaux formaient des collines blanches au milieu des champs. Il y avait des villages de cadavres où personne n’osait aller, des tables ouvertes pour les corbeaux et la vermine. Les chiens et les chevaux n’y échappaient pas. Ils crevaient sur les routes désertes et leurs carcasses abritaient des vies grouillantes. La vie réduisait sa taille, involuait dans ce qu’elle avait de plus primitif, reculant aux temps anciens où aucun homme n’avait encore été engendré. Dieu ne punissait pas la vie mais les pêcheurs. Et les flèches de la peste préparaient peut-être un monde purifié offert à une sainte vermine qui rachèterait les fautes de tous les fils d’Adam.
[…] Le voyage jusqu’à Marseille lui montra le fracas de la peste et le bien qu’elle laissait au monde : des routes désertes, des villages silencieux, des rues et des places délabrées. Les hommes s’évitaient et masquaient leurs visages. Les regard ne portaient que terreur et découragement. Chacun se recroquevillait derrière ses murs. L’horizon s’arrêtait aux barrières des maisons. La société des hommes avait volé en éclats. Marchés, fêtes, cérémonies ne mélangeaient plus les humains. Les cœurs s’étaient fermés. Ne restaient plus que des clans qui défendaient leur famille et leur territoire. Les hommes ressemblaient aux loups que la pestilence avait rendus plus nombreux et plus redoutables. La famine et le froid avaient ramassé la faux que la maladie avait abandonné et tuaient maintenant autant qu’elle. Les canailles vous égorgeaient pour un morceau de viande, personne n’osait plus voyager et Guillaume ne dut sa vie sauve qu’à son habit de dominicain, car les gens respectaient Dieu depuis qu’ils avaient vu le diable.
Antoine Sénanque Croix de cendre Grasset 2023
6 cardinaux et 93 membres de la cour des papes en Avignon en meurent, mais l’apothicaire du pape Clément VI (1342 à 1352), en le murant dans sa chambre, le mit à l’abri du fléau. Ce pape aimait Avignon et, un an plus tard, en 1348, acheta la part de la bonne ville qui manquait à la papauté à Jeanne d’Anjou, reine de Naples, comtesse de Provence, pour 80 000 florins, laquelle faisait peut-être une affaire, mais cherchait surtout à se faire pardonner un crime qu’elle n’avait peut-être pas commis, mais que lui imputait la rumeur publique : l’assassinat de son mari André, à Averse, à la veille de devenir roi des Deux Siciles. C’est Clément VI qui acheva la construction du palais avec le Palais Neuf. Le comtat Venaissin, qui entoure Avignon était possession pontificale depuis 1274.
Vont s’installer des décennies de disette, rendant les seigneurs, par ailleurs ruinés par les guerres, durs à l’excès avec leurs vassaux : c’est entre un tiers et un quart de la population du royaume qui en meurt ; dans les villes entre la moitié et un tiers, jeunes comme vieux, riches comme pauvres.
La meilleure prévention s’avérera être la fermeture des portes des villes à l’annonce de l’arrivée du fléau. Encore une fois, on ne pourra bien souvent s’empêcher de trouver des boucs émissaires… qui seront les juifs en priorité : 12 000 d’entre eux seront brûlés à Mayence, 40 à Toulon en 1348, près de 900 à Strasbourg fin 1348. La vieille croyance de la punition divine avait aussi la vie dure, celle que plus tard dénoncera La Fontaine : ce Mal que le Ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre.
Le clergé maintient le rituel de la mort, organise des processions et très souvent se trouve au premier rang pour sauver ceux qui peuvent l’être. En Angleterre, le clergé bouscule l’ordre des choses : La présente pestilence, dont la contagion se répand en tous lieux, a laissé beaucoup de paroisses vides de prêtres. Comme on n’en trouve plus […], de nombreux malades décèdent sans les derniers sacrements. Annoncez à tous que, s’ils sont sur le point de mourir ils peuvent se confesser les uns aux autres, et même à une femme.
L’évêque de Bath and Wells
Puis donc par tous païs une maladie que l’on clame épidémie couroit, dont bien la tierce partie du monde mourut.
Froissart – Rapporté par Saint Genis
Guy de Chauliac, lozérien, médecin du pape Clément VI en Avignon, obtint de ce dernier une mesure alors révolutionnaire, car elle était jusqu’alors limitée à une fois l’an : l’autorisation des faire des autopsies sur les pestiférés à Montpellier pour tenter de comprendre et soigner la maladie. Dans l’immédiat, il a ordonné d’allumer des brasiers dans tous les quartiers de la ville, Palais des papes inclus : l’opinion générale était que le mal venait de l’air et des atmosphères putrides. Chanoine dès 1344, il laissera un livre majeur : La Grande chirurgie. À force de côtoyer la maladie, il l’attrapera, mais incisera lui-même ses ganglions … et guérira.. Il mourra en 1368 et ses proches lui laisseront cette épitaphe : Ici [monastère Saint Just de Mende] est enseveli Guy et avec lui la piété, le savoir, la loyauté, la science du ciel et la médecine.
Les épidémies qu’on avait connu jusque là, n’occupèrent qu’une région, celle-ci tout le monde, celles-là étaient remédiables en quelqu’un, celle-ci en nul
[…] En Avignon, elle fut de deux sortes : la première dura deux mois avec fièvres continues et crachement de sang, et on en mourait dans trois jours. La seconde fut, tout le reste du temps, aussi avec des fièvres continues, et apostèmes et carboncles et parties internes principalement aux aisselles et aines, et on mourait dans cinq jours… Elle occupa tout le monde ou peu s’en fallut, car elle commença en Orient, et ainsi jetant ses flèches contre le monde, passa par notre région vers l’Occident et fut si grande qu’à peine elle laissa la quatrième partie des gens.
La Grande chirurgie. 1363
Le père ne visitait plus le fils
Le fils ne visitait plus le père
La charité était morte
Et l’espérance abattue
Quelle marge de manœuvre restait-il au commun des mortels, sinon ce conseil ? Pars de bonne heure, parcours une longue route et ne reviens pas avant longtemps. Les conséquences économiques seront graves : dès lors que l’objectif de chacun est de fuir l’épidémie, si elle n’a pas gagné son village, il n’en bouge plus :
Du drapier au maçon, les maîtres survivants se retrouvèrent sans compagnon, sans valet, sans apprenti.
Jean Favier
Hausse des prix agricoles : le paysage est en place pour les jacqueries à venir : les Jacques de la plaine de France en 1358, les Travailleurs anglais du Kent et de l’Essex en 1381, lesquelles avaient été précédées de celles des Karls de la Flandre de 1323 à 1328.
Henri Mollaret, spécialiste de la peste à l’Institut Pasteur, situe le nombre de morts sur l’Europe, de 1348 à 1350, entre le tiers et la moitié de la population, soit au moins 25 millions de morts, trois fois plus que les soldats tués pendant la première guerre mondiale. Les 3 pandémies depuis le début de l’ère chrétienne auraient tué environ 200 millions de personnes. Si la peste fut aussi meurtrière, c’est parce qu’elle frappait un Occident en général sous-alimenté.
La mort travaillait à grande lame et fauchait sans préférence ni discernement.
[…] Ils parlaient tous un mélange savant de langue d’oïl et de langue d’oc. La bataille de Muret [Simon de Montfort, représentant de Philippe-Auguste, roi de France contre les Occitans le 12 septembre 1213] n’avait pas assuré tout de suite et partout la suprématie de l’idiome vainqueur et, deux cents ans après la croisade contre les Albigeois, l’oïl et l’oc se heurtaient encore en une lente bataille jamais gagnée, jamais perdue.
Pierre Magnan. Chronique d’un château hanté. Denoël 2008
Dans cet interminable déroulement, ne se signale qu’un gouffre exceptionnel, visible dès la première observation – un Hiroshima, dit Guy Blois : le repli dramatique, l’effondrement de la population française et européenne de 1350 à 1450, sous le triple signe de la famine de la Peste Noire et de la guerre de Cent Ans. À la France comme à l’Occident, il faudra au moins un siècle (1450-1550), voire deux siècles (1450-1650), pour que se guérisse cette blessure profonde, restée longtemps béante : le quart, le tiers, la moitié, parfois jusqu’à 70 % de la population ayant disparu.
Cependant, de 1450 à nos jours, aucune catastrophe de cette fabuleuse ampleur ne se produit plus. La différence est incalculable, la vraie clef d’une explication d’ensemble : 1450 est une coupure comme il n’en existe ensuite aucune autre de pareille signification, dans tout ce que nous connaissons de notre histoire.
[…] Au terme de ce calvaire, la population française est terriblement amoindrie. Si, en 1328, le royaume comptait de 20 à 22 millions d’habitants, acceptons qu’en 1450, il en compte au plus 10 à 12, chiffre supérieur, probablement, à ce qu’il était à l’époque de Charlemagne. Mais quel recul !
Fernand Braudel. L’Identité de la France. Arthaud Flammarion 1986
Évoquons ce que j’ai appelé l’unification microbienne du monde. […] J’ai noté la peste au milieu du premier millénaire ou du second tiers d’icelui. Elle provient de la région des sources du Nil autour desquelles fleurissait un immense complexe de contagions : sur la Méditerranée, elle aborde l’Europe et la dévaste. La seconde vague des pestes intervient nettement plus tard, à partir des année 1340. Elle prend naissance, cette fois, non plus en Afrique nilotique, mais parmi les rats et les puces de l’Asie centrale. Elle tire avantage, si l’on peut dire, de l’unification de l’Eurasie réalisée au siècle précédent par Gengis Khan. Les caravanes des routes de la soie apportent ce fléau jusqu’en Crimée et de là, via la Méditerranée, une fois de plus, vers Venise, Gênes, Marseille et Barcelone. L’Europe occidentale, voire centrale, perd 30 % de sa population et bientôt 50 %, surtout en France de 1348 à 1450 environ. Pierre Chaunu, pour les siècles immédiatement ultérieurs, a mis en évidence, après les historiens de l’école de Berkeley, le second grand acte de cette unification microbienne du monde, consommé avec l’arrivée des Européens au Mexique et au Pérou. Le choc des épidémies importées d’Europe au XVI° siècle frappe les population indigènes d’Amérique : au Mexique, encore lui, celles-ci ont préalablement et progressivement perdu, depuis des milliers d’années, une grande partie des immunités dont jouissaient leurs ancêtres quand ceux-ci résidaient encore à l’ouest du détroit de Behring. Le choc entre les conquistadors espagnols sains de corps, mais porteurs de ces miasmes redoutables, et ces habitants fut effroyable. J’ai tenté jadis d’en convaincre l’excellent Jacques Chirac, qui parlait, pas toujours avec raison, du génocide consommé de la sorte sur le nouveau continent. Je lui expliquai que la cause tenait quelque peu, comme il le pensait, aux arquebuses et aux épées tranchantes des Espagnols. Mais, pour l’essentiel, ce qu’il fallait incriminer, c’était l’impact mortel de nombreuses maladies contagieuses – variole, même rougeole, etc – sur des peuplements non immunisés. Le Mexique aztèque et autre, peuplé de 20 à 25 millions d’habitants avant l’arrivée de Cortés, tombe à 2 millions de personnes vers le fin du XVI° siècle. Les isolats démographiques des îles du Pacifique seront également touchés, pour certains d’entre eux, par ce phénomène.
Emmanuel Leroy Ladurie. Une vie avec l’histoire. Tallandier 2014
Quelle époque désastreuse que celle dont nous venons de présenter le tableau ! aucun refuge sur la terre pour l’homme paisible ; la guerre, la peste et la famine se suivent sur toute la surface de la terre ; des nuées de sauterelles, durant trois années consécutives, causèrent, en beaucoup de pays, d’effroyables ravages, et furent en France, comme en Allemagne, les messagères des fléaux qui alloient fondre sur les peuples ; des secousses répétées de tremblement de terre, des tourbillons de vapeurs mortelles sortis de son sein, précédèrent la peste, et l’occasionnèrent, disent un grand nombre d’historiens : on croit le plus communément, que des vaisseaux marchands en apportèrent le funeste germe en Europe. Ce terrible fléau se promena sur toute la surface du globe, et moissonna, sur son passage, le tiers de la population, dans les campagnes aussi bien que dans les villes ; les animaux de même que les hommes en furent atteints : les grandes cités ressembloient à des cimetières, et les morts étoient traînés au tombeau par les mourans : on ne regardoit le ciel que pour y lire les plus sinistres présages qui aggravoient encore le mal. Dans presque toute l’Asie, les campagnes désertes restèrent sans culture, et la famine fit périr ceux que la peste avoit épargnés ; la contagion étoit générale : pour ne parler que de l’Europe, on compta, dans Londres, cinquante mille victimes de la peste, soixante mille à Florence, quatre-vingts dix mille à Lubeck, plus de soixante mille à Basle : plus de cinq cents morts sortoient, par jour, du seul Hôtel-Dieu de Paris. Venise demeura presque sans habitans ; le nombre des nobles du grand conseil se trouva réduit, de douze cent cinquante à trois cent quatre-vingt. Le doge, André Dandolo, effrayé de la solitude de sa patrie, attira de nouveaux habitans dans Venise, en leur accordant les privilèges les plus avantageux : presque tous les malades mouroient dans l’abandon.
Le sénat de Berne, en Suisse, pour distraire la jeunesse de ces pensées funèbres qui agitoient les cœurs, l’envoya, escortée d’un grand nombre de musiciens, dans la belle vallée de Simmenthal : Que celui qui veut faire pénitence, disoient les jeunes gens, vienne plutôt prendre part à nos festins et se réjouir avec nous d’avoir échappé à la grande mortalité.
Dans plusieurs villes d’Italie, au rapport de Bocace, un grand nombre d’hommes, pensoient que boire, chanter, satisfaire tous ses appétits, et n’avoir ni souci, ni crainte, étoit le meilleur remède qu’on put opposer à la contagion. Cependant, si nous en exceptons ce petit nombre d’exemples, la consternation étoit générale ; les peuples n’avoient les yeux fixés que sur la tombe, et sembloient tous se trouver devant le tribunal redoutable de la divinité ; on n’entendoit de tous côtés que pleurs et gémissemens ; un voyageur isolé étoit regardé comme l’antéchrist.
Une terreur religieuse glaça tous les esprits exaltés par le spectacle des calamités publiques ; ils crurent voir dans ces fléaux, les avant-coureurs de la destruction de l’Univers : un passage de l’Apocalypse, faussement interprété, fortifioit ce préjugé superstitieux. Les guerriers uniquement occupés de leur salut, ne songeoient plus à la défense de l’État ; les travaux de l’agriculture furent interrompus ; le bruit de la fin du monde se répandoit en tous lieux ; on n’entendoit plus que des gémissemens et des cris de pénitence ; on ne voyoit de toutes parts que des bandes d’hommes et de femmes qui se flagelloient et se déchiroient le corps; on auroit cru que la trompette fatale, dont le son doit réveiller un jour la cendre de toutes les générations, reténtissoit aux oreilles des peuples.
Mais l’ambition de quelques rois ne parut pas fort effrayée, et ils ne se montraient pas moins attentifs à s’agrandir sur cette terre arrosée de pleurs, et menacée d’une destruction prochaine.
Comme si la peste n’eût pas détruit assez d’hommes, les Juifs furent poursuivis avec acharnement, et l’on imputoit les malheurs de la nature à ces étrangers proscrits, dont le peuple en fureur, brûla une grande quantité, en France, en Allemagne, en Bohême, ainsi qu’en Italie.
Le spectacle que présente l’Égypte ne paroît pas moins lugubre ; ce fut, dans cette période, la contrée la plus malheureuse de la terre, sans en excepter la France elle-même ; la peste et la famine désolèrent cette contrée. Les Égyptiens consternés, crurent que des esprits mal-faisans, sortis des ruines des anciennes cités, avoient corrompu l’air : une si grande famine désola l’Égypte que les hommes, dit l’histoire, dévoroient les animaux morts, recouroient aux plus vils alimens, et que des mères mangeoient leurs propres enfans. Traités comme des esclaves par une milice étrangère, accablés par tant de maux, les Égyptiens perdirent jusqu’au souvenir de la gloire de leurs ancêtres.
Il semble que l’Univers vacille et menace ruine ; c’est pourtant, au milieu de ces malheurs, de ces convulsions, que l’homme augmente les moyens de destruction, par l’invention de la poudre et de l’artillerie.
M.E. Jondot. Tableau historique des nations. 1808
L’Égypte certes, mais encore l’ensemble de l’Afrique de l’hémisphère nord : Au milieu du VIII° siècle [notre XIV° siècle], la civilisation, à l’est comme à l’ouest, fut visitée par une peste destructrice qui dévasta les nations et fit disparaître les populations…. La civilisation déclina avec l’humanité. Les cités et les maisons furent abandonnées, les routes disparurent, les terres et les demeures restèrent vides, les dynasties et les tribus s’affaiblirent. Tout le monde habité changea…
Par conséquent, il est nécessaire qu’aujourd’hui quelqu’un entreprenne de faire un relevé systématique de la situation du monde dans toutes les régions et dans toutes les races, ainsi que les coutumes et les croyances sectaires qui ont changé pour ceux qui y adhèrent.
Ibn Khaldoun. Al Muqaddimah
En ces temps troublés, dans le sud du pays, une personnalité hors du commun, le flamboyant Gaston III, qui se fit appeler Phébus parce que sa chevelure d’un blond roux le couronnait de soleil, ne cesse d’oser, avec un culot qui force le respect :
Gaston Fébus est un incroyable héros médiéval, lettré, d’une audace sans pareil à la guerre comme en politique, follement adonné à la chasse et à l’amour, sans scrupule dans la répudiation de sa femme comme dans le meurtre de son fils, accompli de sa main, mais qui le plongera dans le remords, au moins littéraire, génie militaire, génie artistique [on le dit auteur de l’hymne de toute l’Occitanie : Se Canta. ndlr] , génie financier, Gaston Fébus le démesuré est, deux cents ans avant Henri IV, la première figure légendaire du Béarn. C’est lui qui, à dix sept années de distance, refusera l’hommage au roi de France d’abord, en 1347, au Prince noir, fils du roi d’Angleterre, ensuite, en 1364, affirmant au visage de ces deux rois qu’il ne tenait son pays de Béarn que de Dieu et de nul homme au monde, et convoquant des notaires pour que cette affirmation inouïe fût consignée pour l’éternité. C’est lui qui construira autour du Béarn un appareil de forteresses sans précédent. C’est lui qui le dotera d’une armée populaire, mobilisable à tout instant et d’une organisation administrative d’avant-garde. C’est lui qui, laissant à sa mort un trésor inouï de plus de 700 000 florins, permettra à ses descendants d’envisager une politique d’indépendance pourvue de véritables moyens financiers, réalité sans exemple à l’époque où la politique des plus grands se nourrit d’expédients.
Le miracle, né de l’histoire et sans doute aussi de la géographie, fut que cette principauté pyrénéenne, prise en tenailles entre l’impérialisme français et l’impérialisme espagnol, un pou entre deux singes comme dira le grand père d’Henri IV, puisse au travers des siècles sauver et renforcer son indépendance.
François Bayrou. Henri IV, le Roi libre. Flammarion. 1994
Gaston Phébus est aussi au temps de la rupture d’équilibre entre langue d’oc et langue d’oïl, au profit de cette dernière : vers 1350, il écrit en occitan l’Elucidarid las propietatz, une encyclopédie traduite du latin, mais, entre 1387 et 1391, il écrit en français le Livre de chasse, richement illustré :



On peut trouver des perceptions identiques de la condition humaine qui traversent les siècles : un texte de troubadours dit : Se as pas des, as pas de a perdre – Si tu n’as rien, tu n’as rien à perdre. À peu près 700 ans plus tard, Bob Dylan chantera dans Like a Rolling Stone : When you ain’t got nothing, you got nothing to loose.
In extremis de Georges Brassens
On voit quelques oiseaux encore mais grosso modo
Ça ne se fait plus
Tout ce chantier multicolore
Au fond, ça salissait la rue
On avait de nombreuses plaintes pour trouble à la normalité
Chanter dans une langue éteinte, c’est sûr
Ça n’a rien arrangé
Les buissons servaient de repère
Les arbres servaient de maquis
On a tout jeté ça par terre
On est plus tranquille aujourd’hui
Ceux qui ont survécu au carnage
Ceux qui étaient les moins suspects
On les trimbale dans des cages, on les a rendus muets
On parle tous la même langue
Comme ça on peut suivre l’écho
De la même voix qui rabâche sur la même chaine d’info
Pour les amoureux du folklore
Loin dans quelques quartiers perdus
On voit quelques oiseaux encore
Mais grosso modo, ça ne se fait plus
Malgré la ronde des vigiles
Qui veillent au silence absolu
Il reste un murmure fragile
Comme un refrain défendu
Qui vibre au cœur de chaque pierre comme un reproche lointain
Tenace comme le lierre
Et qui nous dit d’où l’on vient
Tenace comme le lierre
Et qui nous dit d’où l’on vient
13 01 1349
En Flandres, des soviets avant l’heure ? On parle de 6 000 victimes.
Nulle part l’esprit révolutionnaire ne déploya plus d’ardeur mystique, plus d’esprit de propagande internationale, plus d’âpreté dans la poursuite des revendications de classe et de la dictature ouvrière qu’aux Pays Bas. Là, des centaines de milliers d’hommes luttèrent avec une énergie farouche, avec une bravoure extraordinaire que souillèrent de hideux excès, pour le triomphe de leur idéal, contre les nobles, les clercs et surtout les bourgeois. Ils caressèrent la chimère de l’égalité des fortunes et de la suppression de toute hiérarchie, de toute autorité, en dehors de celle des travailleurs manuels. Une première expérience avait déjà été tentée à Ypres et à Bruges (1323 et 1328), à la faveur de la Jacquerie de la Flandre maritime, par deux ouvriers, Guillaume de Decken et Jacques Peit, qui avaient décrété la guerre aux riches et aux prêtres, et fait régner la terreur jusqu’au moment où la bourgeoisie coalisée avec la noblesse, leur infligea le désastre de Cassel [1328]. Une seconde, plus longue grave encore, fut faite par un tribun éloquent et hardi, un grand bourgeois, le drapier Jacques Arteveld. Celui-ci réalisa un moment, par l’entente des classes ouvrières et d’une partie de la bourgeoisie, son plan d’établissement de l’hégémonie de Gand en Flandre, avec l’appui du roi d’Angleterre (1338-1375). Mais il fut bientôt débordé par la démocratie des tisserands, impatients d’établir le gouvernement exclusif de la classe ouvrière. Cette dernière dictature, qui débuta par l’émeute, où périt Arteveld, eut pour moyens l’emprunt forcé, le massacre, les confiscations, le pillage ; elle mit aux prises les ouvriers les uns avec les autres, opposa les foulons qui furent écrasés (2 mars 1345) aux tisserands. Elle finit par la chute de ces derniers (13 janvier 1349), contre lesquels s’étaient unis, princes, nobles, clercs, paysans, bourgeois et petits artisans. Une partie des vaincus émigra en Angleterre, les autres préparèrent leur revanche ; ils la tentèrent en 1359 et surtout en 1378.
Cette fois le mouvement ouvrier gantois faillit avoir en Occident un immense contrecoup, et y déchaîner la révolution internationale. Les meneurs de Gand prétendaient inaugurer une dictature ouvrière sans mélange, spolier et détruire la bourgeoisie, soulever les compagnons contre les patrons, les salariés contre les grands entrepreneurs, les paysans contre les seigneurs et les clercs. On prétendit qu’ils avaient prémédité l’extermination de toute la classe bourgeoise, à l’exception des enfants de six ans, de même que celle de la noblesse.
Prosper Boissonnade. Le travail dans l’Europe chrétienne au Moyen Age V°-XV ° siècle. F Alcan Paris 1930
1349
Philippe VI de Valois, roi de France, achète la ville de Montpellier et son port de Lattes à Jacques III, roi de Majorque. C’est alors un foyer culturel cosmopolite : on y parle hébreu, grec, latin, avec une prédominance de la science et, donc de la langue arabe. On s’y sentira vite français, au point de nommer un boulevard Bonne Nouvelle, quatre vingt ans après que Jeanne d’Arc ait libéré Orléans. Arnaud de Villeneuve, 1238-1313, y pratique la chimie, dont celle du vin :
Les Vins Doux Naturels [VDN] sont trop souvent nommés à tort vins cuits alors que ces vins sont produits selon la méthode du mutage découverts par Arnaud de Vilanova, Médecin à la cour des Rois de Majorque, Recteur de l’Université de Montpellier et Alchimiste au XIII° siècle, qui consiste à ajouter au cours de la fermentation un peu d’alcool pur au vin afin de stopper la transformation du sucre en alcool et d’obtenir un vin doux grâce à ces sucres résiduels. Non contente de leur apporter de la douceur, cette technique était surtout un moyen de conserver les vins qui ne tenaient pas lors des transports. Une fois fortifiés, ces vins étaient plus à même de voyager et de vieillir sans le moindre souci.
Dominique Laporte, meilleur sommelier de France
Le 16 juillet, c’est le Dauphiné qu’il met dans son escarcelle ; la Maison de Savoie se tourne alors vers l’Italie, et, en achetant Nice, se donne un débouché maritime. Le terme de Dauphin commença par être, au XI° siècle, le surnom des comtes d’Albon, maîtres du Viennois, qui deviendra, en s’agrandissant, le Dauphiné. À l’origine se trouvait une mère anglaise qui donna à son fils un prénom anglais : Delphin, qui est donc en anglais aussi le nom du plus humain des mammifères marins : en faire un prénom était donc pour ce peuple de marins une forme d’hommage rendu à l’animal. Humbert, véritable panier percé toujours en manque d’argent, mais gardant sa fierté, n’eût plus que son nom à vendre au Roi de France, ce dernier s’engageant à donner ce nom à celui de ses enfants qui hériterait du trône : le premier dauphin est Charles, fils aîné de Jean qui succédera à Philippe VI en 1350, sous le nom de Jean II le Bon.
vers 1350
Dans l’actuel Pérou septentrional, les Chimús fondent une civilisation vivant d’agriculture intensive – maïs et pomme de terre -. Ils construisent aussi de nombreuses routes, sont habiles dans l’art de la céramique : ce sont les précurseurs des Incas. Pour s’installer là, il leur a fallu combattre un autre peuple installé dans la vallée de Lambayeques, qui était là depuis l’an 850 à peu près : on découvrira 119 squelettes d’hommes, femmes, enfants sur une pyramide de Túcume. Les Lambayeques avaient construit quantité de pyramides, dont la plus grande avait 700 mètres de long ; elles n’étaient pas hautes : 20 m. en moyenne. Construite en adobe – mélange de paille et d’argile – elles n’auraient pu être plus hautes. La pluie se chargera de leur érosion, de même qu’elle s’était chargé de l’érosion de nos premiers châteaux forts, eux aussi en terre, dont il ne nous reste que des noms de villages : La Motte, La Motte Servolex, la Motte Beuvron, La Motte Chalençon, La Motte d’Aveillans. Par contre, on a trouvé de forts beaux masques funéraires, et de nombreux couteaux sacrificiels en or – les tumis -.

25 03 1351
La tradition chevaleresque connaît l’une de ses dernières manifestations avec le combat des Trente, au cours duquel 30 chevaliers bretons vainquirent 30 chevaliers anglais : l’affaire, qui fit grand bruit, se déroula sur la lande de la Mi-Voie, entre Josselin et Ploërmel. Quand on dit que la perte des traditions peut causer des dommages irréparables… on ne parle pas pour ne rien dire : la mort d’une quarantaine de chevaliers, c’est tout de même moins grave que celle de millions d’hommes. Et ne disons donc pas trop de mal non plus des légendes : il est bien possible que ce soit celle des Horace et des Curiace qui ait inspiré cette tradition chevaleresque.
Nicolas Oresme, fils de paysans normands aisés, publie le Traité des Monnaies : il y est dit beaucoup de choses qui n’ont guère vieilli :
la stabilité des prix est un impératif, car celui qui investit doit avoir une vue claire de l’avenir. L’augmentation de la masse monétaire est une cause de désordre économique, car elle crée l’instabilité des prix en augmentant leur niveau. La stabilité monétaire ne peut être garantie avec certitude que par l’indépendance de l’autorité monétaire par rapport au roi. Le roi doit résoudre ses problèmes financiers par la fiscalité.
Devenu plus tard évêque de Lisieux, il traduira Aristote, accompagnant sa traduction de commentaires favorables à l’astronomie héliocentrique… de façon suffisamment prudente pour ne pas être inquiété, mais assez claire pour ébranler un des ses lecteurs nommé… Copernic. On est normand ou on ne l’est pas. Charles V, qui l’écouta, fût surnommé le Sage[4]. Charles VI ne l’écouta pas, revenant aux dévaluations et à l’inflation : on l’appela d’abord le Bien Aimé, puis le Fou.
1352
Une ordonnance de Jean le Bon fait défense à toute personne de préparer tout médicament. Cela va permettre aux communautés d’apothicaires de s’opposer à la vente des drogues de composition illicite par tous les charlatans, les sorcières aux vastes connaissances qui faisaient une concurrence sérieuse aux officiels, les guérisseurs et empiriques qui commercialisaient des remèdes sans activité thérapeutique. Seul l’apothicaire pouvait exercer la pharmacie ; chaque médicament, préparé selon la prescription du médecin, était destiné à un malade déterminé ; à coté de ces médicaments sur mesure s’étaient constitués des médicaments préparés à l’avance, qui prendront vite le nom de remèdes secrets : leur composition était tenue secrète, car c’était le seul moyen de protéger l’inventeur du produit. Le droit de fabriquer des remèdes secrets n’appartenait à personne, pas plus aux apothicaires qui devaient respecter la prescription médicale et le qui pro quo [5], qu’aux médecins.
12 09 1354
Montpellier voit se déchaîner dame Nature : vent à abattre de gros arbres, grêle à casser les tuiles, bêtes de somme noyées, etc :
Ce jour-là, après le couvre-feu, il tomba une telle giboulée de grêle, et si drue, avec un tel déluge que ces grêlons brisèrent la plus grande partie des tuiles des maisons de Montpellier car, à ce que racontaient certains, il tomba des grêlons qui pesaient une livre et il y en avait qui pesaient quatre livres, et 10, et 25 livres. La tempête qui se déchaîna fut si forte qu’elle détruisit les clochers de Saint Martin de Prunet et de Notre Dame de Chaulet, et elle détruisit une grande quantité d’arbres, des grands et des gros, de façon extraordinaire et de maisons. Il tomba un tel déluge que sept bêtes de somme chargées de ballots d’étoffe qui venaient de la foire de Pézenas et passaient à la pointe Saint Christophe furent emportés par le flot jusqu’au petit portail de Saint Barthélémy où elles se noyèrent. Jacme dels Gorce, dont c’était le jardin, se noya au même endroit et il se produisit bien d’autres catastrophes.
Le mardi suivant, il y eut une éclipse de lune. Cette même année, on modifia la monnaie le 2 décembre. Cette même année, Mgr Peytavin, de bonne mémoire, qui fut évêque de Maguelone, puis fût fait évêque d’Albi et, parti d’Albi, fut fait cardinal, mourut et fut enterré à Maguelone.
Le Petit Thalamus, manuscrit AA9, Archives municipales de Montpellier.
1354
La concertation n’est pas la qualité première de l’archevêque de Narbonne : depuis quelques dizaines d’années a été entrepris la construction de la cathédrale, et on a commencé par le chœur, avec des dimensions impressionnantes : des voûtes de plus de quarante mètre de haut ; mais la construction de la nef impose la destruction partielle du mur d’enceinte de la ville, et cela, les consuls ne peuvent l’accepter : c’est donc l’arrêt de la construction de la cathédrale ; quelques 5 siècle plus tard, quand la croissance de la ville aura mis par terre ce mur d’enceinte, Viollet le Duc tentera de reprendre le chantier, mais ce jour-là, il aurait mieux fait de rester au lit : cela nous aurait évité les vilaines tourelles qui enlaidissent la tentative de construction d’une nef. À l’heure actuelle, l’ouverture du chœur sur la nef a été fermée, et, un espace nommé place de Sainte Eutrope est encadré par la croisée des transepts et 2 chapelles pentagonales de la nef, qui aurait dû en comprendre 10.
1355
Le gouverneur royal d’Artois autorise les gens d’Aire-sur-la-Lys à construire un beffroi dont les cloches sonneront les heures des transactions commerciales et du travail des ouvriers drapiers, car il convient que la plupart des ouvriers journaliers aillent et viennent à leur travail à des heures fixes.
Rome percevait sa dîme au Groenland : on sait qu’elle avait été payée en 1282, non en espèces mais en nature : défenses de morses et peaux d’ours polaire ; en 1327, on sait encore que le Groenland avait bénéficié d’une remise de dîme de six ans, mais après, il y eut une interruption si longue que Rome monta finalement une expédition qui ne put que constater la disparition totale de la colonie ; déjà, les Vikings avaient subi les effets d’un net refroidissement du climat, isolés sur la côte ouest par les glaces qui encombraient le cap Farewell, au sud de l’île ; de plus, les produits qu’ils exportaient (fourrures, ivoire) avaient perdu peu à peu leurs débouchés. Ils furent peut-être aussi victimes de la peste noire qui décima la colonie, après avoir fauché en 1349 le tiers de la population de Bergen, qui, en Norvège, avait l’exclusivité du commerce avec le Groenland. Les fouilles effectuées en 1921 par Paul Nordlund mirent à jour des corps étonnamment conservés dans le sol glacé, vêtus à la mode du temps de Charles VII et de Louis XI (1420-1480), dont les squelettes portaient les traces de la dégénérescence : nanisme, débilité osseuse, mortalité infantile, rétrécissement du bassin – signe de stérilité chez les femmes -. Un rapport envoyé de la ville de Gadhar à la cour de Norvège entre 1341 et 1348 est, peut-être, le commentaire le plus éloquent de ces fouilles :
Partout la terre est désertique. La grande église de Vestribygdh fût la cathédrale et le siège de l’évêque.
Les Skraelinjar [6] ont complètement pillé Vestribygdh au point qu’il ne subsiste que chèvre, mouton, vache et veau, à l’état sauvage. Plus un homme, ni chrétien, ni païen. Tel est ce que dit Ivar Bardsen qui administra quelques années l’évêché de Gardhar. Il a tout vu par lui-même […] Attivé à Vestribygdh, il ne trouva absolument personne. […]
On trouve dans un roman de l’entre deux guerres un récit légèrement différent, très plausible lui aussi, encore qu’il taise toute présence autochtone d’eskimos, et le fait qu’avant d’avoir la peau de l’ours et du phoque, on a leur viande :
Éric le Rouge et ses fils, bannis d’Islande, voguèrent longtemps sur une mer embrumée avant de découvrir un pays verdoyant, si verdoyant qu’ils le nommèrent la Terre verte, le Groenland. Le Gulf Stream n’avait pas, alors, le même cours qu’aujourd’hui. Sur cette terre qu’il réchauffait poussèrent des arbres fruitiers, et les pâturages y nourrissaient d’immenses troupeaux. Éric et ses fils étendirent leur domaine. Leif découvrit même l’Amérique, où ils songèrent un instant à s’installer. Mais le riche Groënland nourrissait bien la pauvre Islande, et le commerce était florissant. Le Groënland se couvrit alors d’églises magnifiques, dont on découvre peu à peu les restes, ensevelis aujourd’hui sous les neiges séculaires. Deux ou trois siècles plus tard, le Gulf Stream eut un caprice et modifia sa course. Le Groënland se mit à se refroidir. Les arbres disparurent. Les pâturages devinrent moins bons. Les bœufs moururent. Cependant, les Groënlandais se tiraient d’affaire parce qu’ils étaient bons chasseurs de phoques et d’ours blancs, et qu’ils se mirent à échanger les fourrures de ces animaux contre la morue sèche des Islandais. Des navires arrivaient d’Islande une fois l’an, débarquaient leur cargaison de poisson et enlevaient la marchandise. L’opération se faisait toujours sur la même pointe de terre.[…] Puis, une année, il y eut la guerre civile en Islande, et les navires ne partirent pas pour le Groënland. L’année d’après , lorsque les Islandais voulurent reprendre le trafic, ils ne virent pas les gens du Groënland les attendre, comme de coutume, en chantant et ne leur faisant des signaux. Les Islandais débarquèrent et cherchèrent. Ils trouvèrent auprès de l’église les cadavres de toute la population. Les derniers descendants d’Eric le Rouge étaient morts faute d’avoir été ravitaillés…
Maurice Constantin Weyer. La nuit de Magdalena. Sequana 1933
Le climat s’est réchauffé après le dernier âge de glace, il y a environ quatorze mille ans : la température des fjords du Groenland n’était désormais plus que froide, au lieu de glaciale, et des forêts de petits arbres commencèrent à s’y développer. Mais le climat du Groenland n’est pas devenu stable au cours des derniers quatorze mille ans : il s’est refroidi à certaines époques, puis il s’est radouci. Ces fluctuations climatiques eurent une grande importance pour les colons amérindiens qui peuplèrent le Groenland avant l’arrivée des Scandinaves. Si les espèces animales pouvant être chassées sont peu nombreuses dans l’Arctique – le renne, le phoque, la baleine et les poissons -, ces quelques espèces sont souvent présentes en abondance. Mais il peut arriver que, lorsque l’espèce chassée habituellement disparaît ou migre, les chasseurs n’aient pas la possibilité de se rabattre sur une autre alternative, comme ils peuvent le faire à des latitudes plus basses, où les espèces sont beaucoup plus variées. C’est pourquoi l’histoire de l’Arctique (et celle du Groenland ne fait pas exception) est faite de peuples qui arrivent, occupent de vastes territoires pendant plusieurs siècles, puis déclinent, ou disparaissent, ou sont contraints de modifier leur mode de vie sur une vaste échelle spatiale lorsque les changements climatiques entraînent des changements dans la nature des espèces chassées.
Ces conséquences des changements climatiques sur les chasseurs indigènes au Groenland ont pu être directement observées au cours du XX° siècle. Au début de ce siècle, une augmentation de la température de la mer entraîna la quasi-disparition des phoques du sud du Groenland. La chasse au phoque put reprendre lorsque le climat se refroidit à nouveau. Puis, lorsque le climat connut un fort refroidissement, entre 1959 et 1974, les populations d’espèces migratoires de phoques chutèrent en raison de l’importante augmentation de la glace de mer. Le nombre total de prises effectuées par les Groenlandais autochtones diminua, mais les Groenlandais évitèrent la famine en se concentrant sur les phoques annelés, dont la population demeura constante, car ces phoques sont capables de creuser des trous dans la glace pour pouvoir respirer. Des fluctuations climatiques similaires entraînant d’importants changements dans la nature des espèces chassées ont peut-être contribué à la première colonisation du Groenland par des Amérindiens vers 2500 avant J.C, à leur déclin ou à leur disparition vers 1500 avant J.C, à leur retour puis à leur nouveau déclin, et enfin à leur totale disparition du sud du Groenland quelque temps avant l’arrivée des Scandinaves, vers 980. C’est la raison pour laquelle les Scandinaves ne rencontrèrent au départ aucun Indien autochtone, alors qu’ils trouvèrent des ruines témoignant du passage d’anciennes populations. Malheureusement pour les Scandinaves, le climat doux qui caractérisait la période de leur arrivée permit en même temps aux Inuits de se répandre rapidement vers l’est, du détroit de Bering à travers l’Arctique canadien, parce que les glaces qui avaient empêché tout passage entre les îles du nord du Canada pendant les siècles de froid commencèrent à fondre durant l’été, ce qui permit aux baleines boréales, qui constituaient la principale source de subsistance des Inuits, d’emprunter ces passages maritimes de l’Arctique canadien. Ce changement climatique permit aux Inuits de pénétrer le nord-ouest du Groenland en partant du Canada vers 1200, ce qui eut de lourdes conséquences pour les Scandinaves.
Entre l’an 800 et le début du XIV° siècle, les carottes glaciaires nous indiquent que le climat du Groenland était relativement doux, semblable à ce qu’il est aujourd’hui, voire un peu plus chaud. On appelle ces siècles l’optimum climatique du Moyen Âge. Ainsi, les Scandinaves atteignirent le Groenland à un moment favorable à la fauche du foin et à l’élevage du bétail (favorable étant entendu relativement aux moyennes climatiques du Groenland sur les derniers quatorze mille ans). Cependant, au début du XIV° siècle, le climat de l’Atlantique Nord commença à se refroidir et devint plus variable d’une année à l’autre, marquant le début d’une période froide appelée le petit âge de glace, qui dura jusqu’au XIX° siècle. Vers l’an 1420, le petit âge de glace était bien installé, et l’augmentation estivale des glaces dérivant entre le Groenland, l’Islande et la Norvège mit fin à la communication maritime entre le Groenland nordique et le monde extérieur. Ces conditions climatiques froides étaient tolérables, voire bénéfiques, pour les Inuits, qui pouvaient chasser le phoque annelé, mais elles furent défavorables aux Scandinaves, qui dépendaient de la fauche du foin. Le commencement du petit âge de glace participa à la disparition des Vikings du Groenland. Mais on avait déjà assisté à de courtes périodes de froid avant le XIV° siècle, auxquelles les Scandinaves avaient survécu, et il y eut de courtes périodes de réchauffement après le XV° siècle qui ne suffirent pas à les sauver. Aussi la question est-elle plutôt de savoir pourquoi les Vikings n’apprirent pas à s’accommoder du froid du petit âge de glace en observant la manière dont les Inuits relevaient le même défi.
L’environnement du Groenland n’est pas seulement climatique et météorologique, mais également fait d’espèces végétales et animales indigènes. La végétation dont le développement est optimal est confinée dans les régions de climat doux protégées des embruns dans les longs fjords intérieurs des Établissement de l’Est et de l’Ouest, sur la côte sud-ouest du Groenland. Là, la végétation qui pousse dans des zones où le bétail ne vient pas paître varie en fonction de sa localisation. Aux altitudes élevées, où les températures sont froides, et dans les fjords côtiers proches de la mer où la croissance végétale est contrainte par le froid, le brouillard et les embruns, la végétation est essentiellement constituée de laîches, qui sont plus basses que les herbes et dont la valeur nutritionnelle est moindre pour les bêtes. Les laîches peuvent pousser dans ces régions pauvres parce qu’elles sont plus résistantes à la privation d’eau que les herbes, et qu’elles peuvent donc prendre racine dans des graviers dont la rétention d’eau est moindre. À l’intérieur des terres, dans des zones protégées des embruns, les montagnes abruptes et les sites exposés au froid et au vent à proximité des glaciers ne sont quasiment que roche nue dépourvue de toute végétation. Dans les régions moins hostiles de l’intérieur des terres, on trouve essentiellement une végétation de lande constituée d’arbustes nains. Les meilleures terres intérieures – c’est-à-dire celles qui sont situées à faible altitude, dont les sols sont de bonne qualité, qui sont protégées du vent, bien irriguées et qui, par leur orientation au sud, bénéficient de plus d’ensoleillement – sont faites de zones boisées où poussent de petits bouleaux et de petits saules, ainsi que quelques genévriers et quelques aulnes, qui pour la plupart ne dépassent pas les cinq mètres de hauteur, même si dans les zones les plus privilégiées certains bouleaux peuvent mesurer jusqu’à dix mètres.
Dans les zones où, aujourd’hui, paissent moutons et chevaux, la végétation se présente différemment, comme ce devait déjà être le cas à l’époque des Nordiques. Des prairies humides sur des pentes douces, comme on en voit autour de Gardar et de Brattahlid, sont constituées d’herbes grasses pouvant atteindre trente centimètres de hauteur et parsemées de fleurs. Des petits bosquets de saules et de bouleaux nains que viennent brouter les moutons n’atteignent que cinquante centimètres de hauteur. Dans des champs plus secs, plus pentus et exposés au vent, on trouve des herbes ou des saules nains ne mesurant que quelques centimètres. Ce n’est qu’aux endroits protégés des moutons et des chevaux, comme dans le périmètre autour de l’aéroport de Narsarsuaq, que j’ai pu voir des petits saules et des petits bouleaux mesurant jusqu’à deux mètres, dont la croissance avait été stoppée par les vents froids soufflant d’un proche glacier. Quant aux animaux sauvages du Groenland, ceux qui avaient potentiellement le plus d’importance pour les Nordiques et les Inuits étaient les mammifères terrestres et marins, ainsi que les oiseaux, les poissons et les invertébrés marins. L’unique grand herbivore terrestre indigène du Groenland vivant dans les anciennes régions d’occupation viking (nous ne prendrons donc pas en compte le bœuf musqué vivant à l’extrême nord) est le caribou, que les Lapons et d’autres peuples indigènes du continent eurasiatique domestiquèrent sous le nom de renne, mais qui ne fut jamais domestiqué ni par les Vikings ni par les Inuits. Au Groenland, on ne pouvait voir des ours polaires et des loups que dans les régions situées au nord des colonies Scandinaves. On trouvait aussi du petit gibier : des lièvres, des renards, des oiseaux terrestres (dont les plus grands représentants étaient des oiseaux de la famille de la grouse appelés lagopèdes), des oiseaux d’eau douce (les plus grands étant le cygne et l’oie) et des oiseaux de mer (notamment des eiders et des pingouins, autrement dit des alcidés). Les mammifères marins les plus importants étaient des phoques de six espèces différentes, qui n’avaient pas la même signification pour les Vikings et pour les Inuits, en raison de différences dans leur distribution et dans leur comportement que j’expliquerai ultérieurement. La plus grande de ces espèces était le morse. On trouvait de nombreuses espèces de baleines le long de la côte, et celles-ci furent chassées avec succès par les Inuits, mais pas par les Scandinaves. Les rivières, les lacs et les océans regorgeaient de poisson, et les crevettes et les moules étaient les plus appréciés des invertébrés marins comestibles.
D’après les sagas et les récits médiévaux, aux environs de l’an 980, Érik le Rouge, un Norvégien au tempérament violent, fut accusé de meurtre et exilé en Islande, où il se rendit rapidement coupable de quelques autres meurtres et fut chassé dans une autre région de l’Islande. Là encore, au cours d’une, altercation, il fit quelques autres victimes, et cette fois il fut bel et bien banni d’Islande, pour une durée de trois ans à compter de l’an 982.
Erik se rappela que, plusieurs dizaines d’années auparavant, un certain Gunnbjôrn Ulfsson avait été dévié de sa course par une tempête alors qu’il faisait voile vers l’Islande et qu’il avait aperçu quelques petites îles pelées, dont nous savons aujourd’hui qu’elles sont situées à peu de distance des côtes sud-est du Groenland. Ces îles avaient été à nouveau visitées vers 978 par un lointain parent d’Erik, Snaebjôrn Galti, qui naturellement s’était lui aussi battu avec les membres de son équipage et avait été dûment assassiné. Érik se rendit sur ces îles pour y tenter sa chance, passa les trois années suivantes à explorer la plus grande partie des côtes du Groenland et découvrit de bons pâturages dans les profondeurs des fjords. À son retour en Islande, une condamnation pour une autre violente querelle l’obligea à prendre la tête d’une expédition de vingt-cinq navires qui partit coloniser les terres nouvellement explorées, qu’il appela astucieusement Groenland (le pays vert). Les Islandais ayant entendu dire que de bonnes terres n’attendaient que d’être cultivées au Groenland, trois nouvelles expéditions quittèrent l’Islande au cours de la décennie suivante. Ce qui fait que, vers l’an mil, la quasi-totalité des terres susceptibles d’accueillir une ferme des Établissements de l’Est et de l’Ouest étaient occupées, et que la population Scandinave avait atteint un chiffre dont on estime aujourd’hui qu’il était approximativement de cinq mille âmes : environ un millier d’individus occupaient l’Établissement de l’Ouest, et l’Établissement de l’Est comptait dans les quatre mille habitants.
Au départ de leurs colonies, les Scandinaves se lancèrent dans des explorations et des chasses annuelles vers le nord en suivant la côte ouest, bien au-delà du cercle arctique. Il est possible que l’une de ces expéditions ait atteint une latitude de 79° Nord, à seulement mille kilomètres du pôle Nord, où l’on a retrouvé, sur un site archéologique inuit, de nombreux objets Scandinaves, parmi lesquels une cotte de mailles, un rabot de charpentier et des rivets de bateaux. Confirmant avec plus de certitude encore ces explorations vers le nord, on a également mis au jour, à une latitude de 73° Nord, un cairn contenant une pierre runique (c’est-à-dire une pierre gravée dans l’alphabet runique norrois) établissant que Erling Sighvatsson, Bjarni Thordarson et Eindridi Oddson avaient érigé ce cairn le samedi précédant le jour des Rogations Mineures (le 25 avril), probablement au début du XIV° siècle.
Les Vikings du Groenland assurèrent leur subsistance en pratiquant à la fois le pastoralisme (élevage d’animaux domestiques) et en chassant des animaux sauvages pour leur viande. Érik le Rouge avait dans un premier temps emporté avec lui du bétail domestique d’Islande, puis les Vikings du Groenland s’habituèrent à consommer de la viande d’animaux sauvages en bien plus grande proportion qu’en Norvège et en Islande, où le climat plus doux permettait aux habitants de satisfaire la plus grande partie de leurs besoins alimentaires uniquement par le pastoralisme et – en Norvège – par les cultures vivrières.
Les colons du Groenland commencèrent par vouloir élever les mêmes espèces que celles dont se nourrissaient les riches chefs norvégiens : beaucoup de vaches et de porcs, un peu moins de moutons et encore moins de chèvres, sans oublier quelques chevaux, des canards et des oies. Ainsi que permet de le déduire le décompte des os d’animaux identifiés dans les dépotoirs du Groenland datés au radiocarbone sur différentes périodes d’occupation Scandinave, il apparut rapidement que l’élevage de ces multiples espèces, jugé idéal en Norvège, ne convenait pas aux conditions climatiques plus froides du Groenland. Les canards et les oies de basse-cour furent immédiatement abandonnés, peut-être même dès la traversée vers le Groenland : aucune trace archéologique ne permet de dire s’il y en eut jamais sur ces terres. Les porcs trouvaient de grandes quantités de glands à manger dans les forêts de Norvège, et les Vikings appréciaient la viande de porc plus que toute autre, mais les porcs s’avérèrent terriblement destructeurs et peu rentables dans les forêts clairsemées du Groenland, dont ils détruisaient la végétation et les sols fragiles par leurs fouilles. En un bref laps de temps, il n’en resta plus que quelques-uns, s’ils ne disparurent pas totalement. Les fouilles archéologiques, qui ont mis au jour des bâts et des traîneaux, ont montré que les Vikings élevaient des chevaux qu’ils utilisaient comme bêtes de somme. Cependant ils ne les mangeaient pas, car la religion chrétienne l’interdisait, c’est pourquoi on ne trouve que très rarement des os de chevaux dans les dépotoirs. Dans le climat du Groenland, il était bien plus difficile d’élever des vaches que des moutons ou des chèvres, car elles ne pouvaient paître que pendant les trois mois d’été sans neige. Le reste de l’année, il fallait les garder à l’étable et les nourrir de fourrage, dont la préparation devint la principale corvée estivale des fermiers groenlandais. On peut penser qu’il eût été préférable pour les Groenlandais d’abandonner l’élevage de ces vaches qui leur causait tant de travail, et dont le nombre diminua effectivement au cours des siècles, mais les vaches étaient dotées d’un statut symbolique trop important pour qu’elles soient totalement éliminées.
On retrouva donc bientôt à la base de l’alimentation des Groenlandais des races résistantes de moutons et de chèvres, qui étaient bien mieux adaptées aux climats froids que les bovins. Ces bêtes avaient également l’avantage, contrairement aux vaches, de pouvoir creuser sous la neige pour trouver de l’herbe pendant l’hiver. Au Groenland, aujourd’hui, on peut laisser les moutons paître à l’extérieur pendant neuf mois de l’année (trois fois plus longtemps que les vaches) et il ne faut les mettre à l’abri et les nourrir que pendant les trois mois où la couche de neige est la plus épaisse. Sur les sites groenlandais les plus anciens, il y eut au départ un nombre de moutons et de chèvres à peu près égal à celui des vaches, puis ce nombre augmenta dans le temps jusqu’à ce qu’on atteigne huit moutons ou chèvres pour une vache. Quant à la différence entre les moutons et les chèvres, les Islandais élevaient six moutons ou plus pour une chèvre, rapport qu’on retrouva dans les meilleures fermes du Groenland durant les premières années de la colonisation, mais qui évolua dans le temps jusqu’à ce que le nombre de chèvres vienne rivaliser avec le nombre de moutons. Cela était dû au fait que les chèvres, contrairement aux moutons, sont capables de digérer les branchages et les arbres nains qui constituaient l’essentiel de la végétation des pâturages pauvres du Groenland. Ainsi, alors que les Vikings arrivèrent au Groenland avec une préférence pour les vaches par rapport aux moutons et alors qu’ils préféraient encore ces derniers aux chèvres, ce sont les chèvres qui finirent par l’emporter, en raison de leur plus grande adaptabilité aux conditions climatiques du Groenland. La plupart des fermes (en particulier celles de l’Établissement de l’Ouest, qui était le plus septentrional, et dont les conditions étaient par conséquent les plus difficiles) durent finalement se contenter d’élever plus de chèvres, animaux méprisés, et moins de vaches, qui étaient pourtant les plus valorisées ; seules les fermes les plus productives de l’Établissement de l’Est parvinrent à satisfaire leur préférence pour les vaches.
[…] Au cours de l’hiver, les vaches étaient nourries avec le fourrage récolté pendant l’été, et si les quantités n’étaient pas suffisantes, le complément était fourni par des algues qui se déposaient à l’intérieur des terres. Les vaches, n’appréciant pas ce complément, finissaient par diminuer en taille et en poids. Vers le mois de mai, lorsque la neige commençait à fondre et que l’herbe recommençait à pousser, on pouvait enfin sortir les vaches pour qu’elles aillent paître, mais elles étaient alors si faibles qu’elles ne pouvaient plus marcher et il fallait les porter dehors. Au cours des hivers les plus rigoureux, lorsque les réserves de fourrage et d’algues étaient épuisées avant le retour de l’été, les fermiers ramassaient les premières branches de bouleau et de saule du printemps qu’ils faisaient manger à leurs bêtes pour éviter qu’elles ne meurent de faim.
Les vaches, les brebis et les chèvres du Groenland étaient élevées plus pour leur lait que pour leur viande. Après que les bêtes avaient mis bas, en mai ou en juin, elles ne donnaient du lait que pendant les quelques mois d’été. À partir de ce lait, les Scandinaves fabriquaient alors du fromage, du beurre et cette sorte de yaourt appelée skyr, qu’ils stockaient dans de grandes barriques gardées au froid soit dans des torrents de montagne soit dans des locaux de tourbe ; ils consommaient ces produits pendant toute la durée de l’hiver. Ils élevaient également les chèvres et les moutons pour leur laine, qui était d’une qualité exceptionnelle car, dans ces climats froids, les moutons produisaient une laine grasse naturellement imperméable. Ils ne pouvaient consommer la viande de leur bétail que lors des périodes d’abattage, en automne notamment, lorsque les fermiers calculaient le nombre de bêtes qu’ils pourraient nourrir pendant l’hiver avec la quantité de fourrage qu’ils venaient de récolter. Ils abattaient tous les animaux restants pour lesquels ils estimaient qu’ils n’auraient pas assez de fourrage. Parce qu’il y avait peu de viande d’animaux d’élevage, presque tous les os des animaux abattus étaient fendus et brisés pour en extraire toute la moelle qu’on pouvait y trouver, pratique bien plus courante au Groenland que dans les autres contrées vikings. On constate que sur les sites archéologiques des Inuits du Groenland, qui étaient de bons chasseurs et qui rapportaient bien plus de gibier que les Vikings, on retrouve beaucoup de ces larves de mouches qui se nourrissent de moelle avariée et de graisse. En revanche elles sont rares sur les sites vikings, où elles ne durent guère trouver de quoi se nourrir.
Pendant la durée d’un hiver groenlandais moyen, il fallait plusieurs tonnes de fourrage pour garder une vache en vie, et beaucoup moins pour un mouton. C’est pourquoi la principale occupation de la plupart des Groenlandais Scandinaves à la fin de l’été consistait à couper, sécher et stocker le foin. Les quantités de foin accumulées à ce moment-là étaient d’une importance capitale, car elles déterminaient le nombre de bêtes pouvant être nourries au cours de l’hiver suivant, mais ce nombre dépendait aussi de la durée de l’hiver, qui ne pouvait être précisément déterminée à l’avance. C’est pourquoi, tous les ans au mois de septembre, les Scandinaves devaient prendre la terrible décision du nombre de têtes de bétail à abattre, en fondant cette décision sur la quantité de fourrage disponible et sur leurs prévisions quant à la durée de l’hiver à venir. S’ils tuaient trop de bêtes en septembre, ils se retrouvaient au mois de mai avec du fourrage inutilisé et un tout petit cheptel, et le terrible regret de n’avoir pas fait le pari de pouvoir nourrir plus de bêtes. Mais s’ils tuaient trop peu de bêtes en septembre, ils pouvaient se trouver à court de fourrage avant le mois de mai, et risquaient donc de faire mourir de faim tout le cheptel.
[…] Fait marquant, le poisson est quasi absent des sites archéologiques scandinaves, bien que les Groenlandais scandinaves aient été les descendants de Norvégiens et d’Islandais, grands pêcheurs et consommateurs de poisson. Les os de poisson ne représentent que 0.1 % des os d’animaux retrouvés sur les sites archéologiques des Groenlandais scandinaves, que l’on peut comparer aux 50 à 95 % d’os de poisson retrouvés sur la plupart des sites en Islande, au nord de la Norvège et sur les îles Shetland à la même époque.
[…] Personnellement, je préfère prendre les choses telles qu’elles sont : même si les Vikings du Groenland appartenaient à une société de mangeurs de poisson, peut-être ont-ils développé un tabou leur interdisant de la consommer. […] La raison essentielle pour laquelle la viande et le poisson sont si souvent l’objet de tabous tient au fait qu’ils sont plus susceptibles que les aliments d’origine végétale de développer des bactéries ou des protozoaires qui peuvent empoisonner ou parasiter le consommateur. Le risque est tout particulièrement élevé en Islande et en Scandinavie, où l’on emploie de nombreuses méthodes de fermentation assurant la longue conservation de poissons odorants, qui supposent entre autres l’utilisation de bactéries mortelles pouvant être cause de botulisme. J’aime imaginer qu’Érik le Rouge, dans les premières années de la colonisation du Groenland, fut victime d’une terrible intoxication alimentaire suite à la consommation d’un poisson. Sitôt rétabli, il aurait déclaré à qui voulait l’entendre que le poisson était un aliment dangereux et que les Groenlandais, qui étaient un peuple propre et fier, ne s’abaisseraient jamais à manger la même chose que les Islandais et les Norvégiens, malpropres condamnés à l’ichtyophagie.
[…] Le Groenland, qui était l’avant-poste le plus lointain d’Europe, resta émotionnellement attaché à l’Europe. Cette attitude serait restée bien innocente si ces liens ne s’étaient matérialisés que dans des peignes à deux rangées de dents et dans la manière dont les bras d’un mort étaient positionnés dans la tombe. Mais cette volonté inflexible d’affirmer une appartenance européenne fut infiniment plus préjudiciable lorsqu’elle conduisit à vouloir à tout prix continuer à élever des vaches dans un climat comme celui du Groenland, à entraîner les hommes qui auraient pu participer aux récoltes de foin à la chasse dans la Nordrseta, à refuser d’adopter les techniques inuits qui auraient pu se révéler très utiles, pour finir par mourir de faim. Pour nous qui appartenons à une société moderne et laïque , il est difficile d’imaginer pourquoi et comment les Groenlandais en arrivèrent à cette dramatique situation. Mais pour eux qui avaient autant le souci de leur survie sociale que de leur survie biologique, il était hors de question d’investir moins dans les églises, d’imiter les Inuits ou de se marier avec eux, car une telle attitude leur aurait fait encourir une condamnation à l’enfer éternel pour avoir simplement voulu survivre un hiver de plus sur terre. Dans cette volonté farouche qu’avaient les Groenlandais de maintenir leur image de chrétiens européens, il est possible d’identifier une des raisons de ce conservatisme évoqué plus haut : plus européens que les Européens eux-mêmes, ils n’eurent pas les moyens culturels de pratiquer les changements dans leur mode de vie qui les auraient aidés à survivre.
[…] Le rôle majeur dans l’histoire de la disparition des Vikings du Groenland est tenu par les Inuits. Ce sont eux qui marquent la différence essentielle entre l’histoire de la société viking du Groenland et celle de la société viking d’Islande : si, par comparaison avec les Vikings du Groenland, les Islandais profitèrent d’un climat moins rude et de plus courtes routes commerciales permettant d’échanger avec la Norvège, leur plus grand avantage résida néanmoins dans le fait qu’ils ne furent jamais menacés par les Inuits. Dans la pire des configurations, les attaques des Inuits ou les menaces qu’ils firent peser sur les Vikings furent peut-être directement à l’origine de l’extinction de la société viking. Toutefois, les Inuits offraient aux Vikings un exemple de survie, mais ces derniers refusèrent de le suivre.
Aujourd’hui, dans notre représentation, les Inuits sont l’unique peuple autochtone du Groenland et de l’Arctique canadien. En réalité, ils ne sont que le peuple le plus récent d’une série qui, d’après les archéologues, comptait au moins quatre peuples différents dont l’expansion s’était effectuée à travers le Canada vers l’est et qui pénétrèrent au Groenland par le nord-ouest sur une période de près de quatre mille ans avant l’arrivée des Vikings. Ces peuples immigrèrent en plusieurs vagues, ils demeurèrent au Groenland pendant des siècles, puis ils disparurent, nous laissant en héritage l’énigme de leur effondrement. Cependant, nous sommes trop peu renseignés sur ces disparitions lointaines pour qu’elles puissent être étudiées dans cet ouvrage autrement qu’au titre d’arrière-plan permettant de comprendre les raisons de la disparition de la société viking. Bien que les archéologues aient donné à ces lointaines cultures des noms comme Point Independence I, Point Independence II et Saqqaq, selon les sites sur lesquels des objets leur appartenant ont été retrouvés et identifiés, la langue et les noms de ces peuples nous sont à jamais inconnus.
Les prédécesseurs immédiats des Inuits furent un peuple que les archéologues nomment les Dorsets, en référence au Cap Dorset, sur l’île canadienne de Baffin, où furent retrouvés les premiers vestiges de cette société. Après avoir occupé la majeure partie de l’Arctique canadien, ils pénétrèrent au Groenland vers l’an 800 avant J.C. et s’installèrent pour une période d’environ un millier d’années dans de nombreuses régions de l’île, notamment dans celles du Sud-Ouest qui, ultérieurement, allaient être colonisées par les Vikings. Pour des raisons inconnues, aux alentours de l’an 300, ils disparurent ensuite du Groenland et de la plus grande partie de l’Arctique canadien, pour se retirer vers des régions situées au cœur du Canada. Cependant, vers l’an 700, ils reprirent leur expansion pour s’en aller occuper à nouveau le Labrador et le nord-ouest du Groenland même si, lors de cette migration, ils n’allèrent pas jusqu’au sud, ultérieurement peuplé par les Vikings. Dans les Etablissements de l’Ouest et de l’Est, les premiers colons vikings déclarèrent n’avoir vu que des ruines de maisons inhabitées, des morceaux de bateaux en peau et des outils de pierre dont ils devinèrent qu’ils avaient été abandonnés par des autochtones disparus, vestiges identiques à ceux qu’ils avaient aperçus en Amérique du Nord lors de leur exploration du Vinland.
[…] Les six colonies vikings de l’Atlantique Nord constituent six expériences parallèles d’établissements de sociétés ayant toutes les mêmes origines ancestrales. Mais elles eurent chacune des issues différentes : les colonies des Orcades, des îles Shetland et des îles Féroé perdurèrent pendant plus de mille ans sans que leur survie soit jamais sérieusement remise en question ; la colonie islandaise, elle aussi, persista, mais eut à surmonter la misère et de graves difficultés politiques ; la colonie viking du Groenland disparut après quatre cent cinquante ans ; et la colonie du Vinland fut abandonnée dès la première décennie de son existence. Ces évolutions différentes sont très clairement liées aux différents environnements des colonies, marqués par quatre variables : les distances à parcourir en mer ou la durée de la traversée en bateau entre ces colonies et la Norvège et la Grande Bretagne ; la résistance qui fut opposée par les indigènes, lorsque les terres étaient habitées ; le potentiel agricole, qui dépendait en particulier de la latitude et du climat local ; et de la fragilité de l’environnement (propension des sols à subir une érosion et risque de déforestation, notamment).
[…] De toutes les sociétés européennes médiévales, la société du Groenland viking est celle dont les ruines ont été le mieux préservées, précisément parce que ses sites furent abandonnés en l’état, contrairement à la quasi-totalité des sites médiévaux majeurs de Grande Bretagne et d’Europe continentale, qui continuèrent d’être occupés et qui furent ensevelis sous des constructions postmédiévales.
Jared Diamond. Effondrement. Gallimard 2005
________________________________________________________________________________________________
[1] Il existe deux pandémies : la peste noire, dite encore peste bubonique, qui se propage par contact cutané : elle peut épargner 10 à 20 % de malades, et la peste pulmonaire, qui se propage par les voies respiratoires : elle n’épargne personne. Chacune des deux peut évoluer en peste septicémique : les bactéries sont alors présentes dans le sang : la mort peut-être foudroyante.
[2] Gabriele de Mussis, témoin du siège de Caffa dit que c’étaient les cadavres des pestiférés eux-mêmes.
[3] Parmi les victimes, le grand amour de Pétrarque, Laure de Noves.
[4] Sage on veut bien, mais était-il vraiment bien sage, pour construire la fameuse vis du Vieux Louvre, de se faire livrer en provenance du cimetière des Saints-Innocents, dix tombes pour en faire des marches ? De nos jours, on nomme cela profanation. En ce temps là, que pouvait bien être une profanation ?
[5] En latin médiéval, médicament donné, volontairement ou non, à la place d’un autre.
[6] Les indigènes, en l’occurrence les eskimos.
