| Publié par (l.peltier) le 11 novembre 2008 | En savoir plus |
28 05 1608
L’Arianna, un opéra de Claudio Monteverdi est donné à Mantoue : et c’est un triomphe. Ariane est abandonnée par Thésée sur l’île de Naxos. La réalité de la vie de Monteverdi le mettait en symbiose avec cette histoire : sa femme Claudia est morte il y a moins d’un an. Caterina Martinelli, la jeune maîtresse – 18 ans – du duc de Mantoue, est morte de la variole deux mois plus tôt : c’est elle qui aurait dû jouer Ariane. Sa remplaçante n’aura que deux semaines pour apprendre sa partition. 8 ans plus tard, Monteverdi dira : L’Arianna m’inspire une juste plainte.
Et les malheurs n’ont pas pris fin : à cette époque, on n’imprimait pas les partitions… trop cher. En 1630 l’empereur du Saint empire germanique Ferdinand II, envahit et met à sac Mantoue, palais ducal compris, qui contient les manuscrits de l’Arianna, d’Andromède etc…, qui partent donc en fumée. Mais Monteverdi a recopié le Lamento d’Arianne, pensant en donner une version adaptée à la liturgie catholique où La Vierge aurait pris le rôle d’Ariane, manuscrit qui n’est pas à Mantoue. Et c’est ainsi que ne nous reste de cet Arianna de 2 h 30’ que le Lamento d’Ariane de 12’. L’Arianna qu’on a pu voir à Saint Louis, aux États-Unis, en 1998, n’est qu’une reconstitution faite par Alexander Goehr en 1994 à la manière de … qui ne doit d’avoir été représentée, qu’au chef d’œuvre qu’est le Lamento.
1608
La vigne est déjà bien présente en Savoie, et les cépages, alors très nombreux, portaient des noms savoureux : la douce noire, le durif, le hibou – noir ou blanc -, les gouais, la rogettaz, le verpellin, l’étraire de l’adui, le servanin, le joubertin, la marsanne, la mollette, la verdesse, la jacquère, la malvoisie, la mondeuse blanche, la roussane ou bergeron, l’altesse, le monterminod, la roussette, le gringet. Le progrès tuera presque toute cette merveilleuse diversité, que l’État parviendra parfois à conserver à titre de specimen ; ainsi au domaine de L’INRA à Marseillan, dans l’Hérault, puis Gruissan dans l’Aude où l’on conserve 4 000 variétés issues de 50 pays : on y voit des noms dont la lecture procure le plaisir du gourmand dans une bonne pâtisserie : verdabel, chatus, œillade, persan, sérènèze, mècle, bia, salagnin, onchette, carménere et petit verdot, cot ou malbec, sémillon, cesar, melon de bourgogne, barbarossa, braquet, brun-fourcat, calitor, camarese, castets, counoise, durif, fuella [autre nom de la folle noire], nielluccio, petit-brun, picardan, sciacarello, tibouren, vaccarese, colombard, doucillon, maccabéo, mayorquin, vermentino [autre nom du rolle], poulsard, trousseau, savagnin ou nature, bourboulenc, maccabéo, mauzac, tourbat, cot, grolleau, folle-blanche [autre nom du gros plant], melon de bourgogne [autre nom du muscadet], romorantin, saint-pierre, tressalier, jacquere ou plan des abymes, abouriou, alicante, aramon, bouchales, courbu noir, duras, fer, garonnet, malbec, mansenc noir, mérille, milgranet, morterille, négrette, plantet, portugais bleu, tannat, valdiguier, varousset, villard noir, arrufiac, baco, baroque, camaralet, chenin blanc, claverie, colombard, enrageat, folle blanche, graisse, clauzet, len de l’el, listan, mansenc, meslier st francois, muscadelle, ondenc, raffiat, rouchelein…
Sur tout le chemin entre Chambéry et Aiguebelle, je vis une abondance infinie de ceps plantés au pied des Alpes de chaque coté de la route, en si grandes quantités qu’ils étaient deux fois plus nombreux pour un espace aussi restreint que dans le reste de la France… leur nombre était si grand, sur une longueur de dix mille entiers, qu’on ne pouvait apercevoir de place vide et inculte. Tout était planté de vignes sur les deux versants, je crois qu’il devait bien y avoir quatre mille clos. Ces vignes, à mon grand étonnement, étaient situées dans des endroits si merveilleusement escarpés qu’il semblait presque impossible que des vignerons puissent y travailler tant était forte la pente…
T. Coryat, voyageur anglais
Il a existé des centaines de variétés de pinot noir ! Dans toute l’Europe, les cépages sont nés de vignes sauvages. Depuis le Moyen-Âge, les paysans utilisaient les résidus des récoltes comme engrais, donc répandaient des pépins. Quand un pépin germait et donnait une belle vigne, ils la multipliaient, lui donnaient un nom. Mais les variétés étaient infinies. Et ces pinots anciens se sont croisés avec le gouais blanc, cela a donné le chardonnay, l’aligoté, le gamay, et même le melon de Bourgogne, devenu … le muscadet en Loire-Atlantique ! Porté par les moines, le pinot noir a même essaimé partout en Europe, en Italie (le lagrein), en Autriche (le saint-laurent)
Jean-Claude Rateau, vigneron à Beaune. Télérama 3427 du 16 09 2015
Au XX° siècle, l’essor touristique de la Savoie entraînera un renouveau de ses vins, dû en partie à la culture de ses cépages autochtones et anciens : jacquère, altesse, persan, molette, gringet… La douce noire – un cépage pour vin rouge aussi appelé corbeau – revient. Très répandu jusqu’à son interdiction en 1958, l’ironie de l’histoire veut qu’il ait été ramené en Argentine où il était devenu le premier cépage sous l’appellation bonarda. Aujourd’hui, autorisé à nouveau, depuis 2008, cinq vignerons font de la douce noire, un cépage idéal pour des assemblages avec la mondeuse et le persan.
Mais si l’on veut retrouver des conditions de travail aussi difficiles que celle décrites au XVII° siècle par l’Anglais Coryat, c’est dans le Valais suisse qu’il faut aller : en Savoie, la réglementation en vigueur limite la vigne à 500 mètres d’altitude.
Marie-Thérèse Chappaz cultive tant sur l’ubac que l’adret onze hectares de vignes à Fully, à une portée de flèche en amont de Martigny, dans le Valais, en Suisse. Vingt-cinq cépages différents, dont la syrah rhodanienne bien sûr, mais aussi de nombreux autochtones tels que cornalin, petite arvine, humagne rouge ou blanc, gamaret… L’adret, plus ensoleillé, malgré sa pente abrupte, est davantage recouvert de vignes, travaillées en petites terrasses, retenues par des murs en pierres sèches. Des terrasses qui n’ont parfois que dix ceps !
[…] Pour ses 17 ans, son père, lui avait offert quinze ares de vignes. Elle souhaitait être sage-femme, mais ce cadeau l’avait fait réfléchir. Un peu plus tard, elle avait hérité à Fully de la maison de son oncle écrivain Maurice Chappaz : son domaine viticole prenait forme. Située à 500 mètres d’altitude, la demeure s’ouvre d’un côté sur le Rhône et sur la commune très urbanisée de Fully, de l’autre sur la montagne, parée de forêts de châtaigniers, de pâturages et de vignes qui grimpent jusqu’à 900 mètres. Depuis les années 2010, elle ne peut plus utiliser un funiculaire pour transporter du matériel d’une terrasse de vigne à l’autre – un problème de normes. Autre difficulté, elle cultive en biodynamie depuis sa visite, à la fin des années 1990, chez Michel Chapoutier à Tain-l’Hermitage. C’est fou comme cette culture a changé le profil de mes vins. Pour contourner la mécanisation difficile et l’emploi de la chimie, elle jonche le sol de paille bio qu’elle va chercher dans une ferme. Un travail de titan pour une œuvre d’art. Je ressens vraiment la sensibilité des plantes. Gagner de l’argent n’est pas un but dans la vie, moi je préfère voir du beau. C’est ça qui me nourrit, même si le chemin est plus difficile.
Le jésuite Roberto de Nobili, missionnaire en Inde, décide de s’adresser directement aux brahmanes, et pour ce faire, le devient lui-même. Il s’instruit auprès d’un pénitent de la côte de Malabar, achète le bonnet rouge feu, le voile, le vêtement de mousseline des saniasis, se rase la tête, se peint le front avec la pâte de bois de santal et se retire dans une hutte de gazon proche de Madurai, au cœur du pays Tamoul, où, pendant un an, il vit en solitaire, se nourrissant d’eau claire et de légumes. Il étudie en même temps les livres sacrés des Hindous et parvient bientôt à connaître à fond leur religion. Sa renommée s’étend, des savants viennent le voir… il leur dit : La religion primitive de l’Inde possédait quatre Védas ou lois. Vous en enseignez trois mais vous avouez qu’aucune des trois ne peut opérer le salut. Celui-ci est dans la quatrième loi que je vous apporte de l’Occident. Vous l’avez perdue mais Dieu nous l’a révélée.
Beaucoup de brahmanes se convertirent, dont celui qui l’avait instruit. Il avait obtenu de Rome et des autorités religieuses de Goa que les néophytes puissent conserver une série de signes distinctifs : linea (fil), curumby (toupet), sandalum (santal) et lavatorias (ablutions). À sa mort, en 1656, la mission comptait 100 000 chrétiens.
Samuel Champlain, né dans la belle cité fortifiée de Brouage, construite vers 1555 avec façon et gentillesse, par les soins de Pierre de Conti, seigneur de la Motte d’Argencourt et Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban, au cœur de bien des guerres, de la lutte contre La Rochelle à la fronde des princes, fonde la ville de Québec : aucun lieu ne peut-être plus commode ni mieux situé : pointe de terre avancée dans le fleuve Saint Laurent, juste à l’amont de son estuaire, la rade y est excellente, les rivières alentour nombreuses, les fourrures troquées avec les Indiens abondantes et la terre fertile. L’étroitesse du fleuve à cet endroit permettait d’en contrôler facilement l’accès. Il aurait pu la nommer, comme tant d’autres sans imagination, le firent ailleurs, la Nouvelle Rouen ou la Nouvelle Beaucaire, il préféra un nom huron pour désigner l’endroit où un fleuve se rétrécit : Kebec. Merci, Monsieur Champlain, même si vous ne nous avez pas dit pourquoi vous avez donné la préférence à ce nom-là plutôt qu’à l’ancien Stadacone. On peut encore regretter que les fondateurs de Ville-Marie, 40 ans plus tard, renommée Montréal, ne vous aient pas suivi en reprenant son nom indien : Hochelaga. En 1615-1616, il atteindra le lac Ontario.
Hans Lippershey, fabricant hollandais de bésicles à Middlebourg, accole deux lentilles, l’une convexe, l’autre concave au bout d’un tube et obtient ainsi l’image grandie d’un objet lointain. Le premier usage de la lunette sera militaire, lors de la guerre d’indépendance des Pays-Bas face à l’Espagne.
Bruits de bottes dans les principautés allemandes : un groupe de princes protestants et calvinistes avec à sa tête Frédéric IV du Palatinat fonde l’Union Évangéliste qui, comme son nom ne l’indique pas, est une armée ; l’année suivante Maximilien, duc de Bavière, fonde la Ligue Catholique allemande, elle encore une armée.
4 02 1609
Pierre de Lancre lance une vaste enquête contre la sorcellerie dans le Labourd, province basque : environ six cents personnes passeront au bûcher ; trois prêtres sont brûlés : l’évêque de Bayonne parviendra à le faire mettre hors jeu neuf mois plus tard. Il n’en fallait pas beaucoup pour être taxé de sorcellerie… il suffisait par exemple d’être rousse ; on estime à vingt mille le nombre de femmes qui passèrent au bûcher pour cette seule raison sur l’ensemble du XVII° siècle ! Dès le Moyen Age, les traîtres étaient représentés en rouge : Caïn, Judas, Dalila… Dans l’ensemble de l’Europe, du milieu du XVI° siècle à la fin du XVII°, – la grande époque de la chasse aux sorcières – les régions qui auront le plus à souffrir des procès en sorcellerie seront le sud-ouest de l’Allemagne (l’actuel Bade Wurtemberg), l’Ecosse, une fois acquise à la Réforme, la Scandinavie – Suède, Norvège, Laponie -, la Lorraine et les cantons suisse de Zürich, Soleure et Lucerne.
Le roi Jacques I° d’Angleterre revient chez lui avec la princesse Anne, sœur du roi du Danemark, qu’il est venu épouser à Copenhague. Ils essuient une rude tempête. Cela finira par un procès en sorcellerie fait à de nombreuses femmes de la cour.
Près de 2 000 procès de sorcières furent consignés dans les archives écossaises, la plupart entre 1620 et 1680. Selon l’historien Christopher Smout, 2 500 sorcières ont été tuées en Écosse entre 1563 et 1727.
Liste des principales places où se tinrent des procès en sorcellerie, de 1428 à 1783
| 1428–1447 |
Valais, Suisse ; Briançon, France depuis 1349. |
| 1505, 1518 |
Val Camonica, nord du lac Iseo, entre Bergame et Brescia, Italie |
| 1562–1563 |
Wiesensteig, Bad Würtenberg, Allemagne |
| 1581–1593 |
Trèves, Rhénanie Palatinat, sur la Moselle, Allemagne |
| 1588 |
Triora, nord de San Remo, Italie. |
| 1589–1593 |
Warboys, nord de Londres, est de Birmingham, Angleterre |
| 1590 |
North Berwick, province East-Lothian, Écosse. |
| 1603–1606 | Fulda, Hesse, Allemagne |
| 1608–1615 | Køge Huskors, Danemark – exécution de 15 à 20 femmes |
| 1611 | Possessions d’Aix-en-Provence |
| 1612 | Sorcières de Pendle, Northamptonshire, Samlesbury, Lancashire, Angleterre |
| 1613 | En Sicile, les Benandanti vouaient un culte à la fertilité ; l’esprit des hommes combattait les fléaux, l’esprit des femmes faisait la noce. Carlo Ginsbourg estime qu’il y a un lien entre les Benandanti et le chamanisme. Les procès ne donnèrent lieu à aucune exécution. Roermond, province du Limbourg, Pays Bas. |
| 1614 | À Cassis. France 3 femmes exécutées. |
| 1616 | Spa. Belgique |
| 1617 | Finspång, Suède. 9 femmes mises à mort. |
| 1619 | Belvoir, Jura français |
| 1620 | Werewolf. Ban de la Roche, Alsace |
| 1621 | Vardø, extrême nord-est de la Norvège, port de la mer de Barents, où il est question de femmes ensorcelées se saoûlant en compagnie du diable etc …. On dénombrera 91 femmes brûlées pour sorcellerie au XVII° siècle. Au début du XXI° siècle, les Norvégiens leur dresseront un mémorial à Steilneset, au fond du fjord de Varanger. |
| 1626–1631 | Wurtzbourg, sur le Rhin, Allemagne ; Bamberg, Bavière Allemagne |
| 1630 | Molsheim, Alsace. |
| 1634 | Affaire des démons de Loudun. France |
| 1634 | Ramsele, Suède |
| 1645, 1662 | Bury St. Edmunds, West Suffolk Angleterre. 18 femmes pendues dans la seule journée du 27 août 1645 par Matthew Hopkins, qui s’auto-proclamait Witch Finder Generall – chasseur de sorcières en chef -. Sharpe a estimé que tous les procès pour sorcellerie tenus en Angleterre entre le début du XV° siècle et le début du XVIII° siècle ont mené à l’exécution d’environ 500 femmes. |
Mais d’où vient que les démons ne s’associent qu’avec des femmes stupides qui ne savent pas reconnaître leur main droite de leur main gauche ? C’est un grand mystère… Il semble qu’ils ne s’intéressent à personne d’autre que de pauvres vieilles femmes, si l’on en croit les nouvelles qui nous viennent de Bury, ces jours-ci. Plusieurs ont été condamnées, certaines exécutées et d’autres vont l’être. La vie est précieuse et une inquisition sérieuse est nécessaire pour qu’elle soit enlevée.
Moderate Intelligencer, journal parlementaire
| 1647 | Possessions de Louviers, France |
| 1656 | Sorciers, père et fils, de Kirkjuból, nord-ouest de l’Islande |
| 1662–1663 | Vardø, Norvège |
| 1669 | Mora, Suède |
| 1675 | Torsåker, Suède |
| 1675–1681 | Salzbourg, Autriche |
| 1678 | Moravie du Nord, est de la Tckéquie |
| 1679 | Affaire des Poisons, Versailles France |
| 1684 | Bideford, Devon, Angleterre |
| 1692 | Salem, Massachusetts. Colonie anglaise d’Amérique. 20 mis à mort, dont 7 hommes. |
| 1696 | Paisley, Angleterre |
| 1703 | Fürsteneck, près de Fulda, en Bavière, Allemagne |
| 1711 | Islandmagee, Irlande du Nord |
| 1728–1729 | Szeged, Hongrie : 34 sorcières condamnées à mort, pour avoir provoqué une grêle sur des vignes ! |
| 1782 | Anna Göldin, canton de Glaris, Suisse |
| 1783 | Doruchów, Pologne |
Dans son rapport sur le procès de Triora, adressé à l’évêque de la ville d’Albenga, le vicaire Girolamo Del Pozzo déclara à toute fin justificative n’avoir utilisé le supplice des braises que sur cinq sorcières, assurant que le feu mis sous les pieds n’avait pas dépassé le temps maximum d’une heure et concluait que toutes les femmes avaient été assez bien traitées, aux frais de la communauté, et que les tourments n’avaient pas excédé la règle : si quelqu’une pensait avoir subi un tort, parce qu’estropiée ou brûlée dans les supplices, ceci était dû aux mauvais soins des médecins ou de la famille reçus après l’interrogatoire.
Il apparaît que la majorité des femmes accusées de sorcellerie étaient des herboristes, c’est-à-dire des guérisseuses, des femmes-médecines. Il devenait facile, dès lors, à partir de l’équation femme-médecine-sorcière, de leur attribuer la grêle, le mauvais temps et la disette ; la figure de la sorcière permettait toutes les accusations, mêmes les plus absurdes et les plus invraisemblables. Et, pour l’essentiel, elles représentaient pour les gens de l’art la concurrence, et contre cela, on n’hésite pas à aller très loin, très vite, très fort ; il suffit de voir avec quelle célérité, le conseil de l’ordre des médecins de France condamne aujourd’hui les médecines parallèles.
Le culte de Diane prévoyait, selon Mircea Eliade, un scénario mythico-rituel composé de deux groupes rivaux incarnant plus ou moins le masculin et le féminin. Il semble que la sensibilité de ces deux groupes ait eu des orientations différentes sur l’actualité politique du temps. Le groupe masculin dont faisait partie le chanoine Faraldi était composé de faux-monnayeurs, avait créé une disette fictive par le biais de la spéculation, était probablement filo-savoyard et pensait faire passer Triora aux mains du Duc de Savoie. La congrégation féminine en revanche gagnait sa vie par l’exercice, illicite puisque relevant de la sorcellerie, de la médecine traditionnelle à laquelle tout le monde, riche ou pauvre, avait recours. Le groupe féminin entretenait en outre, probablement, des rapports avec les huguenots, se livrait à la contrebande en général, faisait circuler des livres de l’Église réformée, et pensait sans doute arracher Triora tant aux Génois qu’aux Savoyards pour créer une zone franche en Ligurie. Les choses pourraient s’être précipitées au moment où ces femmes décidèrent de ne plus passer au Protestantisme, considérant qu’elles n’avaient rien à y gagner, les protestants se comportant exactement comme les catholiques relativement aux dites sorcières qu’elles étaient. La congrégation masculine avait donc pris le dessus quand elle se rendit compte que le long bras de l’Inquisition pourrait bien arriver à découvrir la pratique de la fausse monnaie, et que les hommes auraient eux-mêmes bien pu finir brûlés comme sorciers. Mais il était désormais bien tard pour faire marche arrière.
Il est évident que toutes ces condamnations ne reflètent en rien la réalité de la sorcellerie : quels aveux ne peut-on obtenir sous la torture ? C’est le règne de l’obscurantisme, la mise au pinacle de tous les comportements dénoncés par une justice fondée en droit : la simple dénonciation suffit à vous envoyer au bûcher, sans même l’embryon d’une preuve ; le processus en vigueur est celui du bouc émissaire : une catastrophe naturelle survient-elle – tempête, grêle – ? C’est le fait du démon, donc il faut trouver qui s’est mis à son service pour que le contrat ait été exécuté. Un tribunal ecclésiastique n’est pas nécessaire : les laïcs, aussi fanatiques que les religieux, s’y entendent aussi bien pour juger sans preuve…
La torture remplit notre terre d’Allemagne de sorcières et y fait apparaître une méchanceté inouïe, et pas seulement l’Allemagne, mais toute nation qui en use. Si nous n’avons pas tous avoués être sorciers, c’est que nous n’avons pas tous été torturés.
F. Spee, jésuite. Cautio criminalis 1631
2 09 1609
Henry Hudson, fameux marin anglais, a déjà atteint en 1607 la latitude de 80°23’N. Ce jour-là, il est à l’embouchure du fleuve qui portera son nom :
Silence.
Les dernières vagues atlantiques se jettent sur une pointe de rochers brun pourpre et s’y déchirent. Un cri de mouette.
De chaque côté du promontoire, la marée gonfle et remonte les estuaires. À droite, la nuit commence à cacher les collines. À gauche, descend un soleil jaune soufre.
L’Amérique est grande, déjà. D’une grandeur anonyme, d’une immensité sidérale. Immobiles, repliés sur eux-mêmes comme un germe, ces lieux qui seront New York attendent de naître.
La lune se lève. Elle éclaire sans agrément des solitudes où il ne se passe rien depuis des millions d’années…
Silence de commencement du monde. Mer vide, sans une voile. Les voiles s’en vont plus au nord, vers l’Amérique française ou anglaise, plus au sud, vers l’Amérique suédoise ou espagnole. Jamais elles ne s’abaissent ici.
Près d’un siècle auparavant, le Florentin Verrazzano, envoyé par le roi de France pour chercher une route septentrionale des Indes et découvrir des terres nouvelles, a passé cependant devant ces rochers. Dans sa lettre du 8 juillet 1542, datée de Dieppe, il décrit à François I° des lieux qui semblent bien être ceux-ci. Mais il ne s’est pas arrêté…
Un matin de septembre 1609, un bruit de chaînes trouble enfin ce repos qui semblait éternel. Des ancres tombent au fond de l’eau. La Demi-Lune, envoyée par des marchands hollandais à travers l’Atlantique, vient de mouiller. Son capitaine, l’Anglais Hudson, debout sur la poupe pontée, scrute l’horizon ; à bâbord et à tribord, il voit la mer s’enfoncer dans les terres ; sont-ce là des fleuves ou le passage maritime qu’il cherche depuis si longtemps et qui, unissant l’Atlantique au Pacifique, lui permettra d’atteindre enfin la Chine ? Hudson se décide pour le bras de mer du Nord. Il remonte la rivière qui portera son nom et qu’il croit être la vraie route de la soie, objet de sa mission comme de toutes les explorations européennes.
Sur les rives, c’est la forêt, la sylve préhistorique. L’eau seule arrête les arbres qui couvrent tout le continent d’un pelage rougi par l’automne… Au bout de trois mois, Hudson s’aperçoit qu’il racle le fond. Son bateau fait demi-tour et revient au bord de l’Atlantique.
– A wénik yülil swänak ! manito ci maxtän towx… ? (Quel est ce peuple de la mer, de bons ou de mauvais esprits ?)
En surveillant le rivage du haut de la hune, les gabiers hollandais ont aperçu, cachés dans les rochers, des hommes rouges, couleur du sol. On voit même quelques huttes rondes et de la fumée s’élever d’un trou central. Bientôt les indigènes se risquent à la nage autour du bateau européen ; d’autres poussent à l’eau des barques de paille ; ils sont nus, une arête de poisson dans le nez, les reins ceints de peaux de blaireau. Ils font comprendre qu’ils habitent une île nommée Manhatte ou Manhattan. Les Hollandais descendent à terre et vont au chef assis devant sa maison d’écorce ; ils échangent avec lui le message de paix, wampun, où les mots sont représentés par des perles enfilées. Aussitôt les femmes à bandeaux plats et luisants, qui s’étaient enfuies, recommencent à piler le maïs ; les vieillards taciturnes reprennent leur tricotage, les hommes abattent des arbres avec leurs haches de pierre, les filles grattent la terre, les enfants ramassent de grosses huîtres et le rivage, par endroits, est blanc de coquilles ouvertes. Les Faces Pâles, au corps protégé, offrent quelques pipes, une bouteille d’eau-qui-brûle. Le vieux chef ou sachem, ayant revêtu son manteau de plumes, fait de son côté hommage de tabac et de peaux de renards, de loutres, d’ours. Fêtes indiennes où l’on enterre le tomahawk, en signe de paix. Premiers échanges.
– Hoewell ? – Combien ?
Les explorateurs hollandais rentrent chez eux. D’Amsterdam à Rotterdam, on sait bientôt que, s’ils n’ont pas trouvé la route du Cathay, ils ont découvert des terres nouvelles, couvertes de forêts, où des indigènes nus, nommés Algonquins, donnent pour rien des fourrures ; ces sauvages adorent le diable et ne connaissent ni ne désirent les richesses…
Les hommes à collerette et à grand chapeau noir rapprochent leurs têtes autour d’une table, comme dans la Leçon d’anatomie. Ils vont disséquer le Nouveau Monde. Pendant trois ans, on prépare une nouvelle expédition, mais en secret, pour ne pas attirer l’attention des Anglais. Enfin, au printemps de 1613, un nouveau bâtiment, court et ventru comme un marchand, le Tigre, pousse au large, avec Adrien Block pour capitaine.
Block arrive en Amérique ; il continue ce qu’Hudson avait commencé. Mais son bateau prend feu, est détruit. Avec des arbres de la forêt, il en reconstruit un autre et le baptise L’Inquiétude (Onrest).
Il ne faut pas voir dans tout ceci d’inertes détails ; ces faits épiques sont aux États-Unis ce que le vase de Soissons et le cor de Roland sont à la France. Mais nos manuels d’histoire nous ont-ils jamais parlé de l’Amérique ?
À la pointe du promontoire rocheux apparaissent maintenant quelques baraques en planches, où l’on achète aux Indiens des pelleteries ; le soir, les Hollandais se retirent et se barricadent le dos à la mer, dans un fortin en terre battue.
Décidément, les affaires des deux dernières années n’ont pas été mauvaises. Aux Pays-Bas, les marchands au grand chapeau sourient dans leur barbe rousse… Bientôt, dans une criante plume d’oie, ils signent leur nom en carmin au bas de l’acte constitutif d’une nouvelle société, dite Compagnie commerciale de la Nouvelle-Hollande, pour laquelle ils obtiennent le monopole des fourrures… Leur société s’agrandit. Elle devient une affaire nationale et prend le titre de Compagnie des Indes occidentales ; les États généraux étendent encore son privilège en lui octroyant l’exclusivité de tout le commerce avec l’Amérique.
Le gouvernement hollandais voudrait faire maintenant de sa nouvelle colonie quelque chose de mieux qu’un comptoir ; or, pour cela il ne faut plus envoyer seulement des marins dont le séjour est précaire, mais des colons qui se fixeront sur place. Qui veut partir? Voici justement qu’arrivent de Wallonie, de Flandre, de Picardie, d’Artois, des huguenots français. Les gens des Provinces-Unies les considèrent comme des frères, à cause de leur religion ; pauvres et durs au travail, ces petites gens, drapiers, tisserands, teinturiers, ont préféré quitter les terres du roi de France que d’abjurer la foi protestante. On embarque une trentaine de familles sur un brick, la Nouvelle-Hollande. Le nom de ces braves Français est aujourd’hui perdu mais leur noblesse américaine vaut bien celle du Mayflower ; au cours des siècles qui vont venir, on peut les suivre, eux et leur descendance, à New York, où, avec les Anglais, ils ont formé une aristocratie respectée pour ses vertus. Dans son beau livre sur New York, Roosevelt nous le dit : Les huguenots français constituaient ici, comme dans toute l’Amérique, les meilleurs éléments de l’immigration.
Une affaire: en 1626, Peter Minuet, d’origine française, achète aux Indiens leur île de Manhattan pour vingt-quatre dollars, payables en perles de verre.
Le fort, à l’extrémité du promontoire, reçoit quelques canons et devient Fort-Amsterdam. La ville prend le nom de Nouvelle-Amsterdam. Un mur de pieux traverse maintenant l’île de part en part, protégeant le bétail contre les incursions des ours et des loups. De ce mur (wall), il ne reste qu’un nom : Wall Street ; aujourd’hui le mur est démoli et les loups peuvent entrer.
Les Hollandais organisent.
D’immenses domaines sont distribués aux premiers membres de la Compagnie des Indes qui s’installent en Amérique. Ces patrons (patroons) doivent amener avec eux cinquante personnes, au moins ; ceux qui composent leur suite ne sont pas libres : ce sont des serfs, des vassaux de la Compagnie ; ils se groupent autour de leur chef. La démocratie new-yorkaise commence par une féodalité.
Ces patriarches protestants ont reçu en bordure de la mer et de la rivière des concessions qui, faute de frontières, s’étendent idéalement vers l’intérieur : d’où des difficultés avec les voisins anglais au sud et des guerres contre les Indiens. À l’époque où, chez nous, Corneille donne Le Cid, les hommes rouges, Algonquins ou Mohawks, pénètrent parfois dans Broadway pour y massacrer les habitants.
Hors du mur de défense se risquent, parmi les arbres défrichés, quelques fermes, quelques moulins. Nous savons qu’un Français, le père Jogues, y a vu un fort en étoile, un moulin, une vingtaine de maisons, des canots indiens… le logis du gouverneur, dit-il, est bâti de briques, assez gentiment. Il peut bien y avoir dans cette Isle de Manhatte quatre à cinq cents hommes de différentes sectes et dix-huit sortes de langues. Il n’y a de religion que la calviniste et les ordres portent de n’admettre autre personne que calviniste…
Les Hollandais qui ont débarqué ici n’ont pas commandé : Feu ! comme, aux Antilles, les Espagnols. Ils n’ont pas, à genoux, remercié Dieu, ainsi que les Quakers de Pennsylvanie. Ils ont dit : Hoeweel ? – Combien ? Derrière eux sont venus quelques catholiques irlandais, des Allemands fuyant la conscription, des Juifs d’Amsterdam, d’autres chassés d’Espagne, enfin des esclaves africains amenés du Brésil. Ainsi, du premier coup, New York s’affirme ce qu’il ne cessera d’être : une place de commerce et une ville d’étrangers.
Un agent commercial, représentant la Compagnie, ensuite des gouverneurs nommés par les États généraux, règnent sur ce mélange de bourgeois, d’honnêtes marchands, de flambarts, de trappeurs et de bandits. Tout ce monde marche droit sous l’œil sévère des fonctionnaires vêtus de noir, dont le plus célèbre, dans l’histoire américaine, est l’aristocrate Stuyvesant, l’homme à la jambe de bois, type de riche pionnier et de Juste selon l’Écriture.
Ce Stuyvesant sera le dernier gouverneur hollandais. En septembre 1664, des frégates de ligne mouillent à l’improviste dans l’estuaire de l’Hudson. Sous les ordres du colonel Nicolls, sans déclaration de guerre, sans un coup de feu, les Anglais s’emparent de la Nouvelle-Amsterdam et du territoire de la Nouvelle-Hollande. L’instigateur de l’expédition a été le frère du roi Charles II, le duc d’York, plus tard Jacques II. Désormais, de la Floride à l’Acadie, le Nouveau Monde appartient au roi d’Angleterre.
Les Hollandais de Hollande font la grimace, mais ceux de la Nouvelle-Amsterdam prennent leur parti de voir leur ville s’appeler maintenant New York. Les hautes classes, anglaise et hollandaise, qui ont tant de liens communs, si loin des métropoles se rapprochent aisément ; de même qu’à cette époque il est assez difficile de distinguer un meuble anglais d’un meuble hollandais, de même ici se confondent les deux peuples. Les Hollandais essaient de reprendre leur ville, mais un traité la rend, un peu plus tard, aux Stuarts. Ces Stuarts, bien que catholiques, laissent leurs colonies observer en paix la religion réformée et se gouverner assez librement. Quand le protestant hollandais Guillaume d’Orange montera sur le trône d’Angleterre, la fusion deviendra plus complète encore. Cette religion est sœur du commerce ; lorsqu’il s’agira de faire front contre le roi de France, les huguenots français de New York ne seront pas les derniers à demander des lettres de marque. New York, qui vit de la mer, trouve son compte à armer en course contre les Espagnols et les Français catholiques, à s’emparer de leurs galions et des esclaves guinéens ; embusquées aux Bermudes, aux Bahamas, ou derrière le cap Hatteras, ses frégates se laissent glisser, comme des squales, dans les eaux chaudes des Antilles. Le trésor du capitaine Kidd, de célèbre mémoire, son or en barils rapporté du Sud et caché dans Long Island où il se trouve encore, est bien l’expression de cette époque rude.
New York s’allonge. À l’intérieur des terres, sous le mur de terre battue, à part quelques vergers, ce ne sont qu’impénétrables forêts que la hache abat peu à peu et qu’elle continuera d’abattre jusqu’à ce qu’il n’y ait plus un arbre jusqu’aux Rocheuses. À l’heure où les seigneurs français coupent leurs futaies pour se tailler des parterres dans le goût de Versailles, les rustres américains déboisent à la cognée pour semer du blé. Après les trappeurs, les paysans. Les moulins tournent. Les armes actuelles de New York portent des tonneaux de farine sur une volée de quatre ailes, en souvenir de la loi anglaise qui donna à la ville le monopole de la mouture et assura ainsi sa prospérité première. La cité qui comptait quinze cents habitants à la fin de l’occupation hollandaise, en atteint vingt mille sous les Anglais. Une large avenue plantée d’arbres la coupe désormais en deux dans le sens de la longueur : c’est l’ancien Breetweg hollandais, dont les Anglais font Broadway. Le fort en demi-lune, à sept canons, qui protégeait les premières transactions, est devenu un gros ouvrage avec une batterie de cinquante bouches à feu, qui défend l’entrée des deux rivières. Autour se groupent de charmantes maisons hollandaises au toit en escalier, à tuiles brillantes en écailles de poisson, comme on pourra en voir, non seulement à Amsterdam, mais bien loin de la Hollande, de Curaçao aux bords de la Néva. L’intérieur, tels que nous l’ont conservé tant de musées et de milliardaires américains, est sombre ; une grande pièce commune au rez-de-chaussée, enfumée, avec des clair-obscur à la Rembrandt, des bancs, des tables massives et un rayon de soleil sur les casseroles de cuivre rose ; au premier, lorsque s’ouvrent les volets de bois, on aperçoit un luxe caché importé d’Europe, argenteries, vaisselle de Delft, jacinthes et tulipes, beau linge et soies de Chine, lits de plume encastrés dans les boiseries des alcôves. C’est la Hollande, – moins les vaches et les polders, – la Hollande, avec ses canaux. Le samedi, on lave les seuils…
À part une révolte des esclaves nègres, qui formaient alors près de la moitié de la population, à part les guerres contre les Français et contre les Indiens, rien ne vient troubler dans son développement ce New York anglais de la première moitié du XVIII° siècle. Cependant la vieille tradition européenne d’exploitation des colonies au seul bénéfice de la métropole prévaut encore, à Londres comme à Madrid : cela va coûter presque toute l’Amérique à la cour de Saint-James. En 1765, le Parlement britannique commet l’erreur de voter le fameux Acte du timbre. Un congrès se réunit à New York où, déjà, neuf des treize colonies sont représentées et envoient à S. M. le roi George III une adresse de protestation. La société secrète des Fils de la liberté prépare l’insurrection. Le premier sang répandu en Nouvelle-Angleterre l’est en 1770, à New York.
Le 8 juillet 1776, la Déclaration d’indépendance est lue dans le parc de l’Hôtel de Ville. Le lendemain, la statue équestre du roi d’Angleterre est jetée à bas. C’est la guerre. Mais New York est aussi vulnérable qu’un gros galion et ses marchands ne sont pas des soldats. Les Anglais font un sérieux effort pour conserver cette base importante, dont la perte risquerait de les précipiter à la mer. Lord Howe et ses mercenaires hessois occupent Long Island. Le général Washington doit battre en retraite et évacuer New York le 4 septembre de la même année. Sa victoire sur les hauteurs de Harlem n’empêche pas les frégates anglaises de remonter l’Hudson après en avoir forcé les lignes de défense, et pendant sept ans, alors que le reste des États-Unis se libère, les Anglais continuent d’y tenir garnison. New York attend. Un incendie l’a presque entièrement détruit en 1776 ; sur ces ruines, les officiers de l’armée anglaise dansent, désireux de montrer à ces provinciaux qu’on peut se battre vaillamment tout en continuant à donner des bals et la comédie. Du haut du fort George, les habits rouges [nom donné familièrement aux soldats anglais avant 1914. ndlr.] surveillent l’Hudson et la rive rocheuse de New Jersey. Ils pointent leurs pièces de bronze sur les maisons et les vergers de Manhattan, sur la banlieue aux chaumières de bois où vivent les mulâtres et les nègres, sur les fermes de Chelsea et de Greenwich. L’hiver arrive. Entre ses deux fleuves glacés, New York, tout calciné, rasé, détruit par les boulets, attend sa libération.
Enfin, le 25 novembre 1783, les troupes anglaises se rembarquent. Le général Washington fait son entrée dans une ville à demi morte. Cette cité du commerce préfère la paix aux combats. C’est en effet après les guerres napoléoniennes et après celle de 1812 contre l’Angleterre que New York commence à devenir une métropole. C’est après la guerre de Sécession que la ville moyenne prend son essor ; c’est après la campagne de Cuba et la victoire sur l’Espagne, que New York atteint Central Park ; enfin le développement complet de la ville haute et l’extraordinaire prospérité du Bronx datent de 1918.
À la fin du XVIII° siècle, New York n’est encore qu’une ville d’importance secondaire et fait médiocre figure à côté de Boston et de Philadelphie. La plupart des voyageurs du temps ne la mentionnent pas. A quoi doit-elle donc le rang qu’elle tient actuellement ? Au début du XIX° siècle, l’Amérique entière s’est transformée, jusqu’à devenir méconnaissable. Lorsque trente ans après Atala, Chateaubriand reprend la rédaction de son voyage, à l’occasion de la publication de ses Mémoires d’outre-tombe, il est obligé de décrire un tout autre pays que celui qu’il a connu… Là où j’ai laissé des forêts… champs cultivés ; là où étaient des halliers… grandes routes ; où le Mississippi, dans sa solitude… plus de deux cents bateaux à vapeur… Ce qui est vrai des États-Unis l’est plus encore de New York. La grande cause de sa croissance fut la création par de Witt Clinton, en 1825, du canal de l’Érié qui, en reliant les Grands Lacs intérieurs à l’océan, plaça New York à la tête de tout le réseau des voies d’eau américaines ; plus tard, les chemins de fer se développant, New York profita le premier de la concentration et de la répartition rapide des marchandises. Le port de l’Hudson répondit parfaitement au rôle qu’on attendait de lui. La découverte de la navigation à vapeur eut pour conséquences l’extension et la régularisation du commerce transatlantique, qui facilita aussitôt l’immigration européenne. New York devint alors le grand marché de la main-d’œuvre, étant déjà celui des capitaux et des marchandises.
C’est pourquoi, en 1820, Manhattan compte 125 000 habitants et, en 1840, près d’un million.
Paul Morand. New York. 1930
New York est un jeune géant de trois cents ans, haut de vingt kilomètres et couché sur le dos ; ses pieds sont à la Batterie, sa colonne vertébrale, si droite, c’est la Cinquième Avenue, ses côtes sont les rues transversales, ses yeux sont Broadway et Park Avenue son foie ; son ventre, les deux gares, sa tête est à Harlem ; ses bras s’étendent au-dessus des rivières ; son argent, il le met dans sa botte, en un endroit sûr, appelé Wall Street. Quant à son cœur, il n’en a pas …
Sarah Lockwood
29 11 1609
Le prince de Condé s’enfuie à Bruxelles auprès des Espagnols avec son épouse, Charlotte-Marguerite de Montmorency. Le mariage a été abondamment pourvu de cadeaux par le roi… fou amoureux de la belle, âgée d’à peu près 15 ans : Henri IV espère avoir ainsi acquis ses grâces, mais le jeune Condé, qu’il pensait plus soumis, n’a pas accepté de jouer le jeu. L’histoire se greffe sur un contentieux délicat lié à la succession du duc de Klève et de Jülich – villes allemandes, la première proche de la frontière des Pays Bas, au nord-ouest d’Essen, la seconde au nord-est d’Aix la Chapelle. Le duc est mort le 25 mars sans laisser d’héritier direct. La position stratégique de ces domaines, au contact de l’Empire germanique, des Pays Bas et de la France excite les convoitises qui sont protestantes et allemandes d’une part et catholiques et espagnoles d’autre part ; la gifle du jeune Condé met Henri IV du coté des Allemands et le voilà parti pour la guerre. La France a mobilisé près de 100 000 hommes. Le roi doit rejoindre une armée de 37 000 hommes rassemblés à Chalons sur Marne le 19 mai. Ainsi donc, pour mettre quelque territoire plutôt lointain dans le giron de la France et surtout pour moucher un jeune duc qui a eu l’impertinence de ne pas céder sa jeune épouse au roi, on allait mettre en jeu la vie de quelques milliers d’hommes ! On ne sait pas exactement ce qu’il advint de ces préparatifs après l’assassinat du roi, mais Marie de Médicis dut très probablement démobiliser ces 100 000 hommes : je vais faire savoir au jeune Condé qu’il peut rentrer en son pays puisque sa jeune Charlotte n’a plus rien à craindre de feu mon époux et oublions au plus vite toutes ces foutaises de succession du duc de Clèves.
1609
En Bohême, faute de catholiques, on se bat entre protestants : Une paix profonde régnait en Bohême, lorsqu’un schisme éclata parmi les luthériens de ce pays. Les schismatiques, célèbres sous le nom de Calixtins, reconnurent la suprématie du pape, et son titre de successeur de S. Pierre ; ce changement excita la jalousie des Évangéliques, qui prirent les armes, et enfoncèrent les portes de Prague. L’archiduc Léopold, sous prétexte d’épouser la cause de l’empereur, entra dans la Bohême à la tête d’une armée, ravagea le royaume ; les protestans et les catholiques s’y firent une guerre opiniâtre, et les deux partis réconciliés un moment, reprenant l’ancienne fierté des Bohémiens, se disposèrent à revendiquer les privilèges dont la maison d’Autriche avait dépouillé la nation.
M.E. Jondot. Tableau historique des nations. 1808
Le maréchal d’Ornano, lieutenant en Guyenne ne s’embarrasse par de circonlocutions pour dire au roi qu’il est haï du peuple plus que son prédécesseur ne l’avait jamais été, à cause des charges accablantes qu’il lui fait porter. Et Pierre de l’Estoile, dans son Journal, dit que le peuple était trop chargé et les marchands tous morfondus
1609 – 1614
Près de 300 000 Morisques sont expulsés d’Espagne. Ils sont sa meilleure main d’œuvre – Qui fera nos souliers ? s’exclame l’archevêque de Valence – mais considérés comme inassimilables. Nombre d’entre eux s’installeront en Tunisie, où ils reçurent bon accueil et requinquèrent l’économie. Il en fût de même de l’agriculture de la côte nord du Maroc. Ce ne fut pas la même chose en Algérie.
La hausse des prix est continuelle : souvent 100 % sur 50 ans ; le catholicisme intransigeant de la monarchie pèsera aussi lourd dans le déclin de l’Espagne que le tarissement des mines d’argent de Zacatecas et Taxco au Mexique et du Potosi péruvien.
La monarchie ibérique n’est pas seulement la grande perdante des guerres du XVII° siècle. Pour l’opinion éclairée, les vainqueurs protestants de l’Europe du nord l’ont emporté à bon droit, par leur créativité scientifique et technique, par leur travail et leur commerce. À l’inverse, l’Europe juge sévèrement l’Espagne déchue : indolence, incurie, nullité intellectuelle mal déguisée par la morgue aristocratique, et surtout bigoterie et fanatisme. L’expulsion des morisques résume toute l’accusation. Un peuple pacifique, intelligent, laborieux et même chrétien, est persécuté, puis expulsé sous le seul prétexte qu’il ne partage pas les coutumes de ses vainqueurs : le vêtement, l’habitude des bains, la langue… Le départ forcé des morisques ruine des provinces entières, le fanatisme aveugle des Espagnols aboutit au déclin du royaume, là où la tolérance aurait assuré la prospérité.
[…] Seul un mince pourcentage de la population morisque embrasse avec ferveur le christianisme, en particulier des femmes dont certaines meurent en martyres lors de la révolte des Alpujarras, de 1569 à 1571. Mais la grande majorité des morisques s’enracine dans un islam plus antichrétien que celui des élites du monde islamique, ce dont témoigne par exemple leur rejet de la virginité de Marie – qu’admet l’islam orthodoxe… Canovas del Castillo souligne les innombrables blasphèmes et sacrilèges commis par les morisques sur les autels et les hosties consacrées et qui les rendent odieux à des Espagnols dont le catholicisme est devenu le trait identitaire majeur. Il y ajoute les avanies que doit subir le cortège du roi Philippe II, en marche vers Barcelone en 1585, dans la traversée des villages morisques d’Aragon. Même la vaisselle utilisée par le roi et sa suite, abandonnée aux villageois, est brisée par les morisques en haine du porc et du vin qu’elle a contenus. À Alger au début du XVII° siècle, les morisques sont les pires ennemis des prisonniers espagnols.
[…] On peut certes éprouver pour eux une compassion légitime. Mais on ne peut pas prétendre, comme le font les libéraux, que leur assimilation était en cours, ni qu’ils étaient les fidèles sujets du roi. Tout montre au contraire qu’ils étaient à l’affût de la moindre faiblesse de l’Espagne, et qu’ils ont favorisé tous ses ennemis, Turcs d’Alger ou protestants du Béarn.
Gabriel Martinez-Gros. L’Histoire Mai 2011
Le Morisque est resté inassimilable. L’Espagne n’a pas agi par haine raciale [laquelle semble presque absente dans cette lutte], mais par haine de civilisation, de religion. Et l’explosion de sa haine, l’expulsion, est l’aveu de son impuissance.
[…] La lame de fond n’a pu tout emporter de ce qui s’était fiché à jamais dans le sol de l’Ibérie : ni les yeux noirs des Andalous, ni les mille toponymes arabes, ni les milliers de mots embarqués dans le vocabulaire des anciens vaincus, devenus les nouveaux vainqueurs. Héritage mort, dira-t-on ; et peu importe que les recettes culinaires, que les métiers, que les fonctions de commandement parlent encore de l’Islam dans la vie quotidienne de l’Espagne ou du Portugal son voisin. Et pourtant, en plein XVIII° siècle, à l’époque de la prépondérance française, se maintient, dans la Péninsule, un art vivant, véritable art mudejar, avec ses stucs, ses céramiques et la douceur de ses azulejos.
Fernand Braudel. La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II. Armand Collin 5°édition 1982
1609 – 1759
Pour protéger les Indiens Guaranis du servage colonial et des razzias des chasseurs d’esclaves, Philippe III d’Espagne et le supérieur général des Jésuites autorisent la fondation d’un État autonome dans la région du cours moyen et supérieur des fleuves Parana et Uruguay :
Sitôt après la prise en charge du continent par Christophe Colomb au nom des souverains d’Espagne (ceux du Portugal, puis de France lui ayant refusé leur concours), le pape Alexandre VI (Borgia, donc espagnol) avait pris l’initiative de faire signer par les cours de Madrid et de Lisbonne le traité de Tordesillas (1594) délimitant les deux empires – les Castillans se voyant attribuer les terres situées à l’ouest, les Lusitaniens celles situées à l’est du méridien 50, à 500 kilomètres des Açores, non loin du Sâo Paulo actuel -. Cette délimitation totalement arbitraire était, en dépit de l’union théorique des couronnes espagnole et portugaise en 1580, la source de perpétuels conflits dans lesquels va s’inscrire l’histoire des réductions.
Si virulente qu’elle fût, la rivalité entre Espagnols et Portugais n’était pas seulement de nature diplomatique et étatique, à propos de frontières et de terres. Elle était aussi culturelle, méthodologique. On n’écrira pas que la colonisation espagnole du continent amérindien fut douce ni rationnelle. Le massacre en fut d’abord la règle. Mais à partir de rudes mises en garde de Las Casas et des franciscains de Cortés, le pouvoir espagnol tenta de civiliser ses approches et de procéder moins par rapine et extermination que par l’influence et la persuasion, mettant en cause la pratique de l’esclavage qui sera progressivement condamnée pour des raisons plus politiques que morales : maints docteurs se réclamaient d’Aristote et de la justification qu’il donnait de la servitude des Barbares. Mais il apparaissait que les tribus préféraient résister que la subir.
Les idées de Las Casas progressaient dans les colonies espagnoles ; en 1543, des lois nouvelles préparaient l’extinction de l’esclavage, tout en maintenant l’encomienda, la mise de l’indigène à la disposition du colon qui était maître, non plus de son corps, mais de sa force de travail, à condition de l’amener à la foi chrétienne... Rien n’était moins propre à convaincre les Indiens de se rallier à l’Évangile que cette espèce de servage, qu’il soit pratiqué sous sa forme radicale ou atténuée (mita). L’encomienda pouvait prendre des formes si féroces, dans les mines d’argent de Potosi par exemple, que les pauvres Indiens expédiés en ces lieux étaient contraints, avant le départ du convoi, d’entendre l’office des morts…
Si terrible qu’il fût, le joug espagnol était soumis à des règles, certes fondées sur le rendement plutôt que sur des exigences humaines, mais que des gouverneurs, à Lima, Buenos Ayres ou Asunciôn, s’appliquaient à faire observer. En territoire portugais régnait la pire loi de la jungle. Le colon était roi ou dieu. En dépit des exhortations d’un grand missionnaire jésuite, Antonio Vieyra, l’Indien n’y était vu que comme un bétail, une force brute, à chasser comme du gibier. D’autant que les plus puissantes familles de Sâo Paulo avaient levé des bandes de métis indo-portugais, si féroces qu’on les appelait les mameloucos – souvenir de l’occupation de la péninsule ibérique par les Maures -, qui avaient pour unique tâche de capturer les sauvages.
Dès lors que le pouvoir espagnol visait à s’amender en donnant mission à des religieux novateurs de transformer les relations entre le monde indien et l’ordre européen, les forces brutales auxquelles la faible administration portugaise accordait licence de se déchaîner à partir de Sâo Paulo ne pouvaient manquer de le combattre : deux pouvoirs, deux visions du monde, deux siècles même – celui de la pure rapine à l’Est, celui de la colonisation à l’Ouest – allaient s’affronter sans merci. C’est dans le cadre de ce conflit terrible que s’insère l’aventure de la république des Guaranis, de 1610 à 1767.
Le territoire où se déroule notre histoire ne doit pas, en dépit de la légende, être confondu avec ce qu’on appelle aujourd’hui le Paraguay. C’est à partir de cette région que s’est développé le mouvement dont Asunciôn fut en quelque sorte la base de départ. Mais l’entreprise a pour berceau la province dite du Guairâ, pays des Guaranis, qui s’étend maintenant sur deux provinces du Brésil, le Paranâ et le Rio Grande Do Sul, et le nord de l’Argentine (les provinces du Misiones et de Corrientes).
En fait, l’histoire de la république des Guaranis, que l’on appela dans la Compagnie le Paracuaria, n’est pas immobile : elle ressemble à une navigation le long de trois fleuves – Paraguay, Paranâ, Uruguay – et a pour axe fondamental le second de ces cours d’eau. C’est sur la rive ouest du haut Paranâ que prirent naissance les premières cités, c’est sur le Paranapanema, son affluent, que débuta le grand exode de 1630 ; et c’est dans l’Entre-Rios, entre Paranâ et Uruguay, que s’établit enfin la confédération qui, un siècle et demi durant, fit l’étonnement du monde.
Si l’on se réfère aux frontières actuelles, on constate que sur trente réductions [1] qui survécurent, pendant des décennies, aux pillards, massacreurs et chasseurs d’esclaves mameloucos, quinze étaient situées en Argentine, huit au Paraguay, sept au Brésil, le tout sur un territoire de 800 kilomètres sur 300 (environ 350 000 kilomètres carrés), les deux tiers à peu près de la France actuelle. Elles mirent en cause environ 200 000 Indiens Guaranis et un peu plus de 200 pères jésuites dont près de 30 furent, pour une raison ou une autre, massacrés.
Jean Lacouture. Jésuites. Les Conquérants. Seuil 1991
L’expérience missionnaire n’était évidemment pas nouvelle : les premiers étaient venus dans les bagages de Colomb. Celle des Jésuites ne l’était pas non plus : vers le milieu du XVI° siècle, les pères Manuel de Nobrega et José de Anchieta, le fondateur de Sao Paulo, avaient posé les premiers jalons jésuites à partir de Bahia, vers le Pérou, le Rio de la Plata et le Paraguay où un collège jésuite était fondé en 1595. Ces communautés se nommaient aldeas. C’est d’ailleurs là que fut décidé l’envoi de jésuites au pays Guairá, le pays des Guaranis sur le rio Paraná, sur la demande de l’évêque de Tucuman, Francisco de Victoria, qui s’était adressé au supérieur général des jésuites, Claudio Aquaviva.
L’expérience des réductions n’était pas unique : en janvier 1653 quatre jésuites accostent au Maranhão, proche de l’estuaire de l’Amazone, menés par un extraordinaire prêcheur : Antonio Vieira. Ils vont prendre le contrepied des Franciscains déjà présents qui visitaient les Indiens dans leur habitat naturel, en les regroupant en des lieux choisis par eux et approuvés par l’autorité, situés à la confluence du fleuve et de ses affluents, comme à la tête de tentacules d’une colonisation poussée vers l’intérieur… Vieira rêvait de l’avènement d’un cinquième empire du monde, l’Empire portugais, à la suite des Assyriens, Perse, Grecs et Romain. Une soixantaine de villages furent fondés entre 1653 et 1759 dans l’ensemble du bassin amazonien, chaque village regroupait en moyenne 470 personnes, soit au total près de 30 000 Indiens urbains pour une population de 50 000 en Amazonie. Les Indiens y vivaient en autosuffisance, isolés des colons portugais qui voyaient d’un mauvais œil cette main d’œuvre d’esclaves potentiels leur échapper. À la fin du XVII° siècle les clauses du traité de Tordesillas commencèrent à devenir caduques et les Portugais grignotèrent de plus en plus de territoire jusqu’alors espagnol. La richesse, le pouvoir des Jésuites se mirent à indisposer la Couronne qui finit par séculariser ces villages missionnaires, tout en abolissant l’esclavage des Indiens, de 1755 à 1757.
À cette même période, des esclaves noirs se révoltent au Brésil et fondent un territoire politiquement autonome, en étendue à peu près un tiers du Portugal : un quilombo, dans le Nordeste, au sud-ouest de Récife : los Palmares, dans l’État d’Algoas. Zumbi – 1655-1695 – fût un de leurs chefs légendaires. Leurs rangs grossiront : indiens, déserteurs blancs ou paysans sans terre et ils se compteront jusqu’à 30 000, vivant très communautairement avec une hiérarchie réduite au minimum, pratiquant une polyculture qui les rendait autosuffisants. Pendant pratiquement 100 ans, ils tinrent tête aux troupes portugaises comme aux Hollandais dans les années 1630 ; Zumbi est décapité et sa tête exposée à Rio de Janeiro en 1695. Il sera déclaré national le 20 novembre 2010. Ce n’est qu’en 1694 qu’ils seront vaincus et contraints à se disperser… pour reformer ailleurs d’autres quilombos.
Les Guaranis sur lesquels se porta le choix des Jésuites étaient des semi-nomades pratiquant une culture simple sur semis brûlis. Petit souci pour les Jésuites, ils étaient polygames et anthropophages, mais, on s’arrangera… ce qu’il faut avant tout, c’est pouvoir se comprendre, aussi, dès 1615, aucun Jésuite ne sera envoyé en mission s’il ne parlait pas leur langue. Et, pour les gagner à leur cause, plutôt que d’arriver les bras chargés de l’habituelle verroterie, ils se munirent essentiellement de haches, de socs de charrue, harpons, hameçons, autant de nouveautés qui provoqueront une véritable révolution culturelle.
Mais, les expériences antérieures n’ayant pas connu de franc succès, il fallait améliorer le type de structure sociale qu’on allait leur proposer.
Les Guaranis ne connaissaient pas de pouvoir contraignant institutionnalisé, les chefs caciques n’exerçant qu’une autorité provisoire balancée par celle des chamanes.
Ce qui caractérisait ce type de société, c’était que les uns et les autres, caciques et chamanes, avaient plus de compte à rendre à la collectivité que de moyens de coercition à son endroit : dette du chef au groupe plutôt que du groupe au chef. Qu’on l’en loue ou qu’on l’en plaigne, la communauté guarani, d’ailleurs fort individualiste hors du cadre de la famille nucléaire, était tout simplement une société sans État, sinon sans pouvoir d’en-haut.
[…] Le projet consistant à faire des Guaranis, compte tenu de leurs mœurs plus douces et de leurs croyances plus élevées, une sorte de communauté modèle, après les avoir arrachés à la razzia permanente de femmes et d’esclaves, au servage de l’encomienda et au semi-nomadisme, ne naquit pas dans le cerveau d’un seul jésuite ou fonctionnaire colonial. Sous l’égide du gouverneur Hernandarias et sous l’impulsion d’un grand jésuite, Diego de Torrés-Bollo, il se forma sur place, progressivement, dans les toutes premières années du XVII° siècle, du synode d’Asunciôn (1603) aux ordonnances dites d’Alfaro (1611), quelquefois précédé par des initiatives de jésuites impatients d’agir (c’est en 1609 qu’est fondée la première réduction, celle de Loreto).
Les ordonnances édictées par le magistrat Francisco de Alfaro inspiré par le génie inventif de Torres – lui-même au courant d’un projet établi par Bartolomé de Las Casas et par des tentatives sporadiques dues aux franciscains -, peuvent être résumées ainsi :
a) Interdiction de toute forme d’esclavage et de l’encomienda pour les Indiens convertis.
b) Regroupement des tribus en villages fixes dotés d’un cacique et d’un conseil municipal autonome, le cabildo.
c) Interdiction aux Espagnols, Portugais, nègres et métis de pénétrer dans ces communautés.
Tels furent les principes qui servirent de loi-cadre à la grande entreprise : refus de l’esclavagisme, regroupement, clôture, que l’on peut appeler aussi ségrégation… Le pouvoir civil espagnol y joua un rôle déterminant du fait de fonctionnaires intelligents, convaincus de la nocivité de l’exploitation effrénée, et enclins à penser qu’un adoucissement de la colonisation, confié à ces experts de la pratique sociale et de la persuasion spirituelle qu’étaient les jésuites, servait mieux les intérêts de la couronne (notamment contre les ambitions portugaises déshonorées par les esclavagistes paulistes) que la férocité des émules de Pizarre et des colons. À l’origine il y eut donc convergence entre les objectifs du roi et ceux de la Compagnie. À l’origine…
[…] C’est sur ce modèle que s’établirent les dix premières réductions entre 1609 et 1630, dans la région du Paraná. Torrés tenta de pousser ses hommes en direction du Chaco, en zone habitée par les Gaycurus. Mais l’importation du cheval par les Espagnols ayant donné des ailes à leur férocité nomade, les Gaycurus se révélèrent intraitables. L’avenir des réductions était au sud où, refoulés par les cavaliers du nord, Roque Gonzalez déployait son génie d’athlète complet du jésuitisme missionnaire.
Jean Lacouture. Jésuites. Les Conquérants. Seuil 1991
En cent cinquante ans, les jésuites créèrent trente huit réductions [2], groupant cent dix mille indigènes sur un territoire grand comme la moitié de la France : la confédération des villages guaranis dépendait directement du roi d’Espagne et lui payait ses impôts. Mais aucun européen autre que les pères jésuites ne devait pénétrer sur son sol. Deux religieux assistés par un conseil de notables élus dirigeait chaque réduction. Les habitants étaient groupés dans des agglomérations de plusieurs milliers d’habitants ; à l’école, on apprenait la langue indigène : une grande place était accordée aux fêtes, théâtre et aux sports, dont le manga ñembosarai – jeu de ballon avec les pieds , dans lequel d’aucuns veulent aujourd’hui voir l’ancêtre du football – : le ballon était conçu à partir d’une boule de sable humide, recouverte de plusieurs couches de résine de mangaisi – l’arbre à caoutchouc -. Les Guarani faisaient une incision verticale sur le tronc pour extraire le liquide épais et collant et, pour gonfler la sphère, ils utilisaient une paille de bambou. Le jeu consistait à se faire passer le ballon sans le laisser tomber. Il n’y avait ni but ni temps de jeu déterminé : le match se terminait lorsque l’une des deux équipes décidait d’abandonner. Des paris étaient réalisés sur le vainqueur. Ce football primitif est également mentionné dans les cartas anuas – lettres annuelles -, rapports que les jésuites envoyaient à leurs supérieurs à Rome. Même le très sérieux Osservatore romano, le journal officiel du Vatican, publiera un article en 2010 Quand les Guarani inventaient le football : il y a trois siècles les Guarani jouaient déjà au football avec une grande dextérité. Ils sont les vrais inventeurs du football. Il est bien possible que les Anglais se soient inspirés du manga ñembosarai pour créer le football moderne : des Guarani emmenés en Espagne par les jésuites auraient pratiqué le jeu devant la cour espagnole, en présence de groupes d’Anglais.
Les habitants étaient groupés dans des agglomérations de plusieurs milliers d’habitants ; à l’école, on apprenait la langue indigène : une grande place était accordée aux sports, aux fêtes et au théâtre. La peine de mort était inconnue. Toutes les maisons étaient semblables. Il n’y avait ni riches, ni pauvres, ni salaire, ni argent. Tout était commun. On donnait un logement aux jeunes mariés. On abritait dans un local particulier les femmes veuves ou seules. On cultivait le maté et les céréales ; on travaillait le textile et un peu le fer. L’État avait un commerce avec l’extérieur et aussi une armée qui, à partir de 1641, fut capable de protéger les Guarani contre les razzias des esclavagistes : l’une de leurs expéditions fut taillée en pièces. À la fin du XVIII° siècle, on y comptait 800 000 têtes de bétail qui faisait, avec la production de maté, une boisson très appréciée dans toute la partie sud de cette Amérique, la fortune de la province. En 1750, le traité de Madrid partagea les réductions entre l’Espagne et le Portugal. Une guerre s’ensuivit entre les Guaranis, opposés au partage et les Espagnols alliés pour l’heure aux Portugais. Les jésuites furent soient massacrés, soit rappelés : en février 1756, les Indiens seront écrasés. En 1767, les réductions n’existeront plus.
Dans son Essai sur les mœurs, Voltaire, pourtant peu suspect de sympathie pour les Jésuites, parlera de la République guaranique comme d’un triomphe de l’humanité.
Chaque bourgade était gouvernée par deux missionnaires qui dirigeaient les affaires spirituelles et temporelles des petites républiques. Aucun étranger ne pouvait y demeurer plus de trois jours… Dans chaque Réduction, il y avait deux écoles, l’une pour les premiers éléments de lettres, l’autre pour la danse et la musique… Dès qu’un enfant avait atteint l’âge de sept ans, les deux Religieux étudiaient son caractère. S’il paraissait propre aux emplois mécaniques, on le fixait dans un des ateliers de la Réduction… Il devenait orfèvre, doreur, horloger, serrurier, charpentier… Les jeunes gens qui préféraient l’agriculture étaient enrôlés dans la tribu des laboureurs…
La République Chrétienne n’était point absolument agricole, ni tout à fait tournée vers la guerre, ni privée entièrement des lettres et du commerce. Elle avait un peu de tout, mais surtout des fêtes en abondance.
Chateaubriand. Génie du Christianisme, livre quatrième, chap. 4-5, 1802
Il a été donné à la Société de Jésus, de réaliser, une fois, sur un peuple, l’idéal de ses doctrines ; pendant une durée de cent cinquante ans, elle est parvenue à faire passer tout entier son principe dans l’organisation de la république du Paraguay… Au sein des solitudes de l’Amérique du midi, un vaste territoire lui est accordé avec la faculté d’appliquer à des peuplades toutes neuves, aux Indiens des Pampas, son génie civilisateur. Il se trouve que sa méthode d’éducation, qui éteignait les peuples dans leur maturité, semble quelque temps convenir à merveille à ces peuples enfants ; elle sait avec une intelligence vraiment admirable les attirer, les parquer, les retenir dans un éternel noviciat. Ce fut une république d’enfants où se montra un art souverain, à tout leur accorder, excepté ce qui pouvait développer l’homme chez le nouveau-né
Chacun de ces étranges citoyens de la république des Guaranis doit se voiler la face devant les pères, baiser le bas de leur robe… Le bréviaire dans une main, la verge dans l’autre, quelques hommes conduisent et conservent comme un troupeau les derniers débris des empires des Incas…
Edgar Quinet. Des Jésuites
Au Paraguay, elles [les missions jésuites] atteignirent le niveau le plus élevé ; en un peu plus d’un siècle et demi (1603-1768), elles montrèrent la capacité et les buts de leurs créateurs. Les jésuites attirèrent, par le langage de la musique, les Indiens guaranis qui avaient cherché refuge dans la forêt ou qui y étaient restés à l’écart du processus civilisateur des encomenderos et des latifondistes. Cent cinquante mille Indiens guaranis purent ainsi reconstituer leur organisation communautaire primitive et appliquer à nouveau leurs propres techniques dans les métiers et dans les arts. Le latifondo n’existait pas dans les missions ; la terre était cultivée en partie pour satisfaire aux besoins individuels et en partie pour développer des œuvres d’intérêt général et acquérir les instruments de travail indispensables, qui étaient propriété collective. La vie des Indiens était savamment organisée ; dans les ateliers et les écoles, on formait des musiciens et des artisans, des agriculteurs, des tisserands, des acteurs, des peintres, des constructeurs. On ne connaissait pas l’argent ; l’entrée des commerçants était interdite et ceux-ci devaient négocier en s’installant dans des hôtels, à une certaine distance.
La Couronne céda finalement aux pressions des encomenderos nationaux et les jésuites furent expulsés. Les propriétaires terriens et les esclavagistes se lancèrent à la chasse aux Indiens. Les cadavres pendaient aux arbres dans les missions et des villages entiers furent vendus sur les marchés du Brésil. De nombreux Indiens retournèrent chercher refuge dans la forêt. Les bibliothèques des jésuites finirent comme combustible dans les fours ou furent utilisées pour fabriquer des gargousses de poudre.
Eduardo Galeano. Les veines ouvertes de l’Amérique Latine. Terre humaine. Plon
En 1610, le roi Philippe III [1598-1621] d’Espagne décide d’affranchir les Indiens des travaux forcés au bénéfice de particuliers. Désormais, les Indiens dépendent directement de la couronne. Celle-ci déléguait à des franciscains, surtout à des jésuites, le soin d’administrer les Indiens dans les régions encore relativement ignorées par les Européens.
C’est la même année que les jésuites fondent la première réduction. Il s’agit en fait d’un village de mission, créé en pleine région éloignée. On commence par défricher un périmètre ; puis on implante au centre une petite église, convenablement décorée ; alentour, on construit des maisons basses, des jardins individuels, une école, une maison pour les vieux, un hôpital, une résidence pour les veuves, une autre pour les étrangers et les voyageurs. Le premier village jésuite fut baptisé Réduction de Saint-Ignace.
Entre 1610 et 1700, il en sortira de terre un peu plus de trente. Deux à trois mille habitants (en majorité des Guaranis) s’installèrent dans ces nouveaux villages. Contrairement à la légende, les jésuites n’imposèrent pas une espèce de communisme des origines, comme l’affirme à tort la légende. Si l’église, l’école, les hôpitaux, les terres défrichées et les instruments aratoires appartenaient à ce qu’on peut appeler une municipalité embryonnaire, chaque chef de famille possédait sa maison, son jardin et disposait d’un morceau du domaine collectif. Il devait l’exploiter, garder pour lui environ la moitié de ses revenus, verser le reste à la commune. C’est cet argent qui permettait l’entretien et l’extension des villages, le paiement des impôts dus à la couronne.
Ces mini-États jésuites ne furent pas condamnés et détruits par des conspirations et des raids de colons horrifiés par cette abolition de fait du travail forcé ; mais tout simplement parce qu’au fil des années, l’expérience des réductions s’essoufflait. Il était impossible de constituer une espèce de royaume jésuite. D’autant qu’il existait des réductions à l’est de Bogota, le long de l’Amazone, non loin de La Paz et, enfin, au nord-est d’Asunciôn ; des lieux extrêmement éloignés les uns des autres. Sans doute aurait-il fallu imaginer une extension prudente du système, mais en déléguant les initiatives à d’autres ordres, voire à des groupes de laïcs. Après 1750, les réductions disparaissent progressivement, mais les jésuites avaient appris à des milliers d’Indiens ce qu’était le travail, et en même temps, en avaient fait des chrétiens.
Georges Suffert. Tu es Pierre. Éditions de Fallois 2000
Il est regrettable que Georges Suffert, constamment préoccupé de rétablir la vérité face à des récits émanant souvent d’historiens marxistes, ne prenne pas la peine de démontrer que la répression de 1756 contre les Guaranis est une fiction, se contentant de proclamer du haut de son magistère : ceci est vrai, ceci est faux, sans jamais apporter une seul petit embryon de preuve. Contrairement à la légende est une expression qu’il utilise fréquemment, et qu’il est important de savoir traduire : tout ce que peuvent raconter sur un sujet donné ceux qui ne partagent pas mon avis ressort de la légende.
film de Roland Joffé.
7 01 1610
Galiléo Galilei, – francisé en Galilée -, né à Pise en 1564, est professeur de mathématiques, mécanique, astronomie et architecture militaire. Il va passer sa vie entre Venise, Florence et Rome.
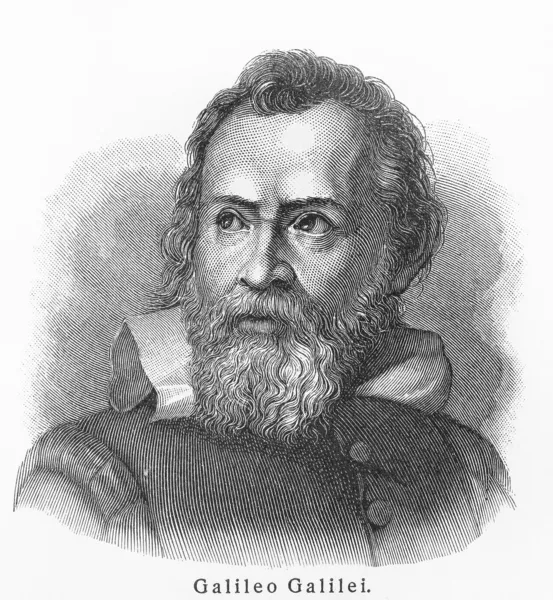
Un télescope avait été acheté par le doge de Venise en 1609 et Galilée avait appris que l’instrument comportait deux lentilles, une à chaque extrémité du tube. Ses connaissances étaient telles qu’il put reproduire l’instrument sans difficulté ; d’un instrument qui grossissait trois fois, il parvint assez vite à le perfectionner pour arriver à un grossissement de 30.
Mais Galilée n’avait pas inventé le télescope. L’exemplaire présenté à Venise provenait des Pays-Bas et c’était là qu’en octobre 1608, un fabricant de bésicles de Middelburg, Hans Lippershey, avait déposé un brevet d’invention pour un instrument destiné à voir à longue distance (le mot télescope fut crée en 1611 en Italie). Cependant Lippershey n’était pas seul à revendiquer cette découverte ; moins de quinze jours après, une seconde demande de brevet fut déposée auprès des États généraux (le Parlement du Pays Bas), bientôt suivie d’une revendication similaire, émanant d’un autre opticien de Middelburg, Zacharie Jansen. L’histoire de cette découverte est encore compliquée par le fait que Della Porta revendiqua lui aussi cette invention – et il est indéniable qu’un télescope italien de 1590 est signalé dans des documents contemporains – et que des prétentions très fermes furent également émises par des Anglais, notamment par Leonard et Thomas Digges. Le véritable inventeur du télescope fait toujours l’objet de discussions.
Colin Ronan. Histoire mondiale des sciences. Seuil 1988
L’on voit que la Lune n’est pas d’une surface égale, lisse et polie comme beaucoup de gens le croient d’elle comme des autres corps célestes.
À Venise, Galilée Lettre au Grand Duc de Toscane
Il est le premier à appliquer le télescope à l’observation des astres : J’ai vu le plus beau et le plus ravissant spectacle qui soit (…) des sujets de grand intérêt pour tous les observateurs des phénomènes naturels (…) d’abord pour leur excellence intrinsèque, ensuite pour leur absolue nouveauté, et enfin à cause de l’instrument même qui m’a permis d’en avoir l’appréhension. Le télescope nous met clairement sous les yeux d’autres étoiles que nul n’a jamais vues encore, et dont le nombre est dix fois plus élevé au moins que celui des étoiles déjà connues.
[…] Toutes les controverses qui, depuis tant de siècles, agitent les philosophes sont d’un seul coup balayées par le témoignage irréfutable de nos yeux, et nous voici libérées des dissensions verbeuses sur ce sujet, car la Galaxie n’est rien d’autre qu’une masse d’étoiles innombrables, réparties en différents groupes. Sur quelque partie de cette masse que l’on dirige le télescope, aussitôt une foule d’étoiles apparaît.
Extrait de Sidereus nuncius
Pour Galilée, la découverte la plus importante était celle des 4 satellites de Jupiter, preuve que la terre n’était pas un cas unique. Reconnaissant dans le système de Jupiter et de ses satellites un modèle réduit du système postulé par Copernic, il valide ainsi l’hypothèse de l’astronome polonais, et c’est là son génie : Nous disposons d’un solide argument, propre à vaincre les scrupules de ceux qui admettent la rotation des planètes autour du Soleil dans le système de Copernic, mais sont si troublés par l’idée que la lune puisse se déplacer autour de la Terre alors que l’une comme l’autre décrivent une orbite d’une année autour du Soleil, qu’ils tiennent cette théorie de l’univers pour irrecevable : car nous n’avons plus affaire maintenant à une seule planète tournant autour d’une autre, et toutes deux parcourant une vaste orbite autour du Soleil, mais notre vue même nous présente quatre satellites qui tournent autour de Jupiter, [qui, plus tard, seront nommés Io, Europe, Ganymède et Callisto. ndlr] à la façon de la Lune autour de la Terre, tandis que l’ensemble du système décrit une énorme orbite autour du Soleil en l’espace de douze ans.
Il va recevoir la tonsure, c’est à dire qu’il va être membre du clergé, même si la tonsure n’engage pas de façon irrévocable ; il rencontrera un triomphe à Rome en 1611 – reçu par le pape Paul V, des sociétés savantes… et même par les Jésuites ! Il acceptera la mission d’expertiser les textes et illustrations qu’avait ramenés du Mexique le médecin Hernandez, le postulat de base de la démarche étant que tout ce qui était inconnu alors de la science occidentale ne pouvait être que tenu pour faux : J’ai vu les peintures de cinq cents plantes indiennes et je devais confirmer si c’étaient des faux, en niant l’existence de telles plantes sur le globe, ou si elles existaient ; et en ce cas, dire si elles étaient intéressantes et utiles.
En 1615, il écrira à la duchesse Marie Christine de Lorraine, grande duchesse de Toscane : L’Écriture n’apprend pas comment est le ciel mais comment on va au ciel.
Et, un autre courrier, à la même duchesse, qui cadre tout le conflit encore en sommeil : Je me déclare prêt à souscrire entièrement aux opinions des savants théologiens […] à condition que ces théologiens examinent avec le plus grand soin les expériences et les observations, les arguments et les démonstrations des philosophes et des astronomes soit dans un sens, soit dans un autre. Alors ils pourront avec assez de sécurité déterminer ce que les divines inspirations leur dicteront. Mais on ne saurait admettre qu’ils puissent se permettre de formuler des conclusions sans s’être livrés à une étude très attentive de tous les arguments dans un sens ou dans l’autre, et sans s’être assurés de l’exactitude des faits […]. En somme il n’est pas possible qu’une conclusion soit déclarée hérétique alors que l’on n’a pas encore démontré qu’elle n’est pas vraie. Vaine sera la peine de ceux qui prétendent condamner la mobilité de la Terre et la stabilité du Soleil, si d’abord ils ne démontrent pas que cette proposition est impossible ou fausse… La prééminence royale n’appartient à la théologie qu’en raison de la sublimité de son objet et de l’excellence de son enseignement sur les révélations divines, qui nous apportent des conclusions concernant essentiellement l’acquisition de la béatitude éternelle que les hommes ne peuvent pas acquérir et comprendre par d’autres moyens […] La théologie n’a donc pas à s’abaisser jusqu’aux plus humbles spéculations des sciences inférieures. Aussi ses ministres et ses professeurs ne devraient pas s’arroger le droit de rendre des arrêts sur des disciplines qu’il n’ont ni étudiées, ni exercées.
Il y a piété à dire et sagesse à soutenir que la Sainte Écriture ne peut jamais mentir chaque fois que son vrai sens a été saisi. Or je crois que l’on ne peut nier que, bien souvent, ce sens est caché et qu’il est très différent du pur sens des mots. Il s’ensuit que, si l’on voulait s’arrêter toujours au sens littéral, on risquerait de faire indûment apparaître dans les Écritures non seulement des contradictions et des propositions éloignées de la vérité, mais de graves hérésies et même des blasphèmes.
Galilée, à Marie Christine de Lorraine, grande duchesse de Toscane.
Tout était dit. On ne pouvait tenter de laïciser plus hardiment la science, rejetant sur les clercs la charge de la preuve de l’hérésie ou même de l’erreur d’interprétation. En un sens, ce texte est à l’Église en tant qu’institution un défi aussi audacieux que la révélation de Copernic à l’autorité des Écritures. Les Messieurs de Rome sentirent passer le vent du boulet, et réagirent avec les moyens qui étaient les leurs. Trois mois plus tard, en février 1616, était instruit à Rome le procès, non de Copernic, mort soixante ans plus tôt, mais du copernicisme, alors incarné par Galilée.
Jean Lacouture. Jésuites. Les Conquérants. Seuil 1991
Christophe Scheiner, jésuite et astronome allemand qui disputait à Galilée l’antériorité de la découverte des tâches solaires, s’ouvrit de sa découverte à son supérieur provincial, qui conclut l’entretien en ces termes : J’ai lu plusieurs fois mon Aristote entier, et je puis vous assurer que je n’y ai rien trouvé de semblable. Allez, mon fils, tranquillisez-vous et soyez certain que ce sont des défauts de vos verres ou de vos yeux que vous prenez pour des tâches de soleil. Plus tard, son ami Velser publiera trois de ses lettres que les aristotéliciens dénoncèrent violemment : on ne peut imaginer opinion plus erronée que celle qui impose de l’ordure à l’œil du monde, lequel Dieu a établi pour être le flambeau de l’univers.
24 02 et 5 03 1616
La Congrégation de l’Index puis le Saint-Office décrètent :
– La proposition que le Soleil soit au centre du monde et soit immobile est absurde et fausse en philosophie, et formellement hérétique, étant contraire à la Sainte Écriture.
– La proposition que la Terre n’est pas le centre du monde et n’est pas immobile, mais qu’elle se meut et aussi d’un mouvement diurne, est également une proposition absurde et fausse en philosophie, et considérée en théologie ad minus erronae in fide
Bien que présentée comme un simple avertissement, la condamnation était claire, mais pas nominale. Galilée n’était pas [encore. ndlr] directement mis en cause, ni soumis à un reniement, à tel ou tel interdit.
Jean Lacouture. Jésuites. Les Conquérants. Seuil 1991
Galilée obtient du cardinal jésuite Bellarmin ce certificat, auquel il donne sa préférence sur l’avertissement de la Congrégation de l’Index et du Saint Office : Nous, Robert Bellarmin, ayant entendu dire que le sieur Galileo Galilei a été calomnié, comme ayant abjuré entre nos mains, et d’avoir, à cet effet, reçu des pénitences salutaires, sollicité de dire la vérité, nous affirmons que le susdit Galilée n’a abjuré ni entre nos mains ni aux mains de personne à Rome, ni ailleurs à notre connaissance, aucune opinion ni doctrine ; qu’il n’a pas, en conséquence, reçu de pénitences salutaires ni d’aucune sorte. Il lui a seulement été notifié la déclaration de Sa Sainteté le pape, publiée par la Sacrée Congrégation de l’Index, à savoir que la doctrine de Copernic, touchant le mouvement de la Terre et la stabilité du Soleil au centre du monde, sans se déplacer d’orient vers l’occident, est contraire à la Sainte Écriture, et par conséquent ne doit être ni défendue ni adoptée.
13 05 1610
Marie de Médicis a longuement insisté pour être sacrée et couronnée, estimant cela nécessaire pour affirmer son autorité sur le royaume : la cérémonie se déroule à Saint Denis. Elle vient consacrer un état de fait : il y avait 7 ans que la reine participait au Conseil.
*****

Salle de conférences du Palais Bourbon. Réplique en plâtre du bronze du sculpteur Nicolas Raggi.
14 05 1610
Henri IV s’en va rendre visite à Sully à l’Arsenal. À la sortie du Louvre, il décide d’inspecter les décorations préparées pour l’entrée solennelle de la reine. François Ravaillac, catholique fervent et plus que fanatique, illuminé venu d’Angoulême, met à profit un arrêt dû aux encombrements rue de la Ferronnerie pour assassiner le roi de deux coups de couteau.
Ravaillac, s’élançant sur lui de furie, avec un couteau qu’il tenait en sa main, en donna deux coups l’un sur l’autre dans le sein de Sa Majesté, dont le dernier porta droit au cœur, duquel il coupa l’artère
Pierre de l’Estoile
Le matin même, il avait reçu le duc de Vendôme, le fils qu’il avait eu de Gabrielle d’Estrée, venu le mettre en garde, et lui demandant de ne pas oublier la sombre prédiction de l’astrologue La Brosse, selon laquelle il devait être frappé en carrosse un quatorze mai, à la première grande magnificence qu’il feroit.
Le mercredi 8 septembre 1610, la nouvelle est arrivée d’Espagne à Mexico, on a su qu’ils avaient assassiné le roi de France, don Henri IV, et celui qui l’a assassiné était un vassal, c’était un de ses serviteurs et de ses pages ; ce n’était pas un chevalier, pas un noble, mais un homme du peuple. On a su qu’il l’a égorgé en pleine rue alors que le roi allait dans son coche en compagnie de l’évêque-nonce. Pour l’égorger, le serviteur lui a remis une lettre dans son coche afin que le roi se penchât pour la regarder. C’est alors qu’il l’a égorgé sans qu’on sache pourquoi. Le roi circulait dans la ville, il parcourait une rue afin de voir si elle était convenablement décorée pour les célébrations données en l’honneur de son épouse qu’on allait couronner reine de France.
Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin
Qui est donc ce monsieur ? C’est un noble chalca, une seigneurie indienne au sud de la vallée de Mexico. Il a relaté cet événement lointain dans son journal. Il est chrétien et même convers de l’ordre des Antonins : à ce titre il est en charge d’un ermitage extra-muros, à Xoloco, au sud de Mexico, et comme la charge s’avère plutôt légère, il peut consacrer beaucoup de temps à son amour de l’écriture. Sans aucunement renier ses origines, il prend ses distances avec elles : Nos aïeux les anciens, qui étaient encore païens, ne savaient rien de cela (il s’agit de la prédiction d’une éclipse) et c’est pour cette raison qu’ils étaient si troublés.
La relation de l’assassinat de Henri IV a mis 4 mois pour aller de Paris à Mexico, via Madrid, Séville, l’Atlantique et le Mexique. On ne peut pas dire que les vagues de l’Atlantique aient beaucoup déformé les faits qui, pour l’essentiel, sont conformes à ce que l’on en a su. 4 mois, c’est bien évidemment très long à nos yeux, mais rien n’allait bien vite alors : sur des distances bien moindres, la nouvelle de la Saint Barthélemy mettra 10 jours pour arriver à Barcelone, 14 à Madrid. Celle de Lépante, 11 jours pour arriver à Venise, 17 à Naples, 18 à Lyon et 24 à Paris et Madrid. Si cet indien de petite noblesse, cultivé, a estimé que cet événement avait sa place dans son journal, c’est peut-être qu’il reprenait à son compte les arrière pensées de son Souverain universel : Philippe III d’Espagne, que la conversion d’Henri IV n’avait pas vraiment convaincu. Mais c’est surtout parce qu’il habitait Mexico, qui avait été la plus grande ville du monde à cette époque, carrefour de la plupart des civilisations, des nouvelles du monde et des circuits commerciaux. S’y côtoyaient Espagnols, Portugais, Flamands, Indiens, métis, mulâtres et Noirs d’Afrique et aussi des Français, des Italiens, et même un bon millier d’Asiatiques débarqués des Philippines, de la Chine ou du Japon. D’aucuns disent qu’il flottait dans l’air comme un parfum de ce que l’on nomme aujourd’hui mondialisation, et l’intérêt pour la France faisait partie de cet universalité nouvelle.
15 05 1610
Marie de Médicis vient au Parlement en un lit de justice pour se faire officiellement proclamer régente. Un lit de justice, c’est une procédure jusqu’alors utilisé de façon tout à fait exceptionnelle, par le roi, devant le parlement pour l’obliger à entériner une décision sur laquelle il est en désaccord, une sorte d’article 13 ou de 49-3, si l’on veut. Marie de Médicis crée ainsi un précédent, auquel donneront suite désormais les souverains pour souligner l’absolutisme royal. Le roi Louis XIII, âgé de 8 ans, par la voix du chancelier, confie la régence à sa mère : le roi séant en son lit de justice déclara la reine mère régente en France, pour avoir soin de l’éducation, de la nourriture de sa personne, et l’administration des affaires de son royaume pendant son bas âge.
Pierre de l’Estoile. Mémoires
Marie de Médicis, résolument catholique, rêve de mariages qui ancrent la France dans la catholicité, en rapprochant la France du Saint empire germanique, donc des Habsbourg, et elle y parviendra puisque Louis XIII, son fils ainé, épousera Anne d’Autriche, fille du roi Philippe III d’Espagne, mère de Louis XIV, et que Elisabeth, sa fille, sœur de Louis XIII épousera Philippe IV d’Espagne. C’était le double mariage espagnol.
Les commentateurs de tous poils ont quelque peine à admettre de prime abord qu’une tragédie de cette importance soit l’œuvre d’une homme seul : et donc ils sont nombreux à se demander : qui a armé le bras ? Au cours des siècles se construira une légende de Marie de Médicis donnant l’ordre d’assassiner son mari, et ce ne sera pas le fait que d’obscurs amateurs de sensationnel : on comptera Michelet parmi eux ! Certes, le duc d’Épernon, proche de Marie, pouvait rêver de la disparition du roi, mais cela ne suffit pas à faire de Marie la tête du complot ! Marie de Médicis commencera par conserver les ministres de Henri IV, à l’exception de Sully, puis sa compagne de jeu, venue d’Italie dans ses bagages, Leonora Galigaï, fut amenée de plus en plus sur le devant de la scène et surtout son mari, Concino Concini, à partir de septembre 1616. C’est cet entourage italien de Marie de Médicis qui nous apporta l’opéra.
15 11 1610
Des Espagnols partis du Mexique se perdent dans le Pacifique : ils arrivent au Japon : Don Rodrigo de Vivero, venant du Japon, près de la Chine, a fait son entrée dans la ville de Mexico (…) Il s’était égaré sur la mer lors de son retour sur Mexico et il a perdu toute sa cargaison, mais une tempête a jeté son navire sur les côtes du Japon ; don Rodrigo est arrivé devant l’empereur du Japon, il a conversé avec lui et s’est fait son ami, tant et si bien que l’empereur lui a prêté la fortune que Rodrigo a rapportée à Mexico, et il a en outre amené quelques Japonais avec lui.
Chimalpahin.
25 11 1610
L’astronome De Peiresc découvre la nébuleuse d’Orion.
1610
Charles Emmanuel I°, souverain de Savoie, ordonne la construction d’une nouvelle route entre Turin et Nice : c’est la route du col de Tende. La France adopte avec empressement l’usage de la glace, qui nous vient d’Italie.
vers 1610
La peste aurait ravagé la côte est américaine, décimant les tribus indiennes.
Simon Lewis et Mark Maslin, deux savants anglais, ont démontré l’existence d’une légère baisse de concentration de CO² atmosphérique de 1570 à 1620 : seraient en cause la chute des essartages en Amérique du Nord, la destruction des 9/10° de la population autochtone du Sud par les maladies infectieuses, tout cela entraînant une régénération de la couverture végétale qui fait augmenter la capture du carbone par la végétation.
06 1611
Henry Hudson commande le Discovery, armé par les Merchants Aventurer ; avec un équipage d’une vingtaine d’hommes, il cherche le passage du Nord-Ouest. Il arrive tardivement en août dans la baie qui porte son nom. Cap au sud… et il passe un terrible hivernage dans la Baie de Rupert, donnant sur la Baie James, où le navire est bloqué par les glaces… et lorsque Hudson annonce la poursuite de l’expédition, c’est la mutinerie : 14 mois sans avoir vu le pays, c’est trop : Hudson, son fils de 16 ans, ainsi que 7 membres de l’équipage sont abandonnés sur une barque à la dérive : on ne les reverra jamais. Les mutins, non sans plusieurs décès, parviendront à rejoindre l’Angleterre, via l’Irlande : seuls Habacuc Prickett et Robert Bylot seront acquittés… pour les autres ce sera la prison.
29 10 1611
Un an plus tôt, les moscovites avaient offert le trône à Wladislaw, fils du roi de Pologne Sigismond III, sous réserve de sa conversion à l’orthodoxie, ce que le père ne put accepter, décidant alors de conquérir le pays manu militari ; Zolkieski s’en chargea, aidé des Suédois. Sigismond est bien le seul souverain étranger à être parvenu à s’installer durablement – plus d’un an – à Moscou : Napoléon, puis la Wehrmacht de Hitler s’y casseront les dents. Moscou sera libéré en novembre 1612, par une armée populaire.
1611
Début à Paris de l’enfermement des pauvres dans des hôpitaux où ils partagent leur temps entre les exercices religieux et le travail forcé.
1612
En Islande, éruption de l’Eyjafjallajökull.
02 1613
En Russie, l’Assemblée des États, – le Zemski sobor – choisit pour tzar Michel Fedorovitch Romanov, petit neveu d’Ivan le Terrible. La dynastie va rester au pouvoir jusqu’en 1917. Mme de Staël, parlera de despotisme mitigé par la strangulation.
4 03 1614
Une ambassade japonaise, en route pour Rome, fait halte à Mexico. Tous les Japonais veulent se faire chrétiens. Plaise à Dieu Notre Seigneur que tout se passe bien, qu’en eux s’affirme constamment la grâce divine comme ils le désirent et le souhaitent, et si réellement ils viennent de leur entière volonté, que Dieu Notre Seigneur les aide et les sauve pour qu’en Sa présence ils puissent être et vivre éternellement. Amen.
Chimalpahin, chroniqueur mexicain
1614
L’écossais John Napier invente les logarithmes. Par exemple, le logarithme de mille en base dix est 3, car 1000 = 10³. Le logarithme de x en base b est noté logb(x). Ainsi log10(1000) = 3. Pendant trois siècles, les tables de logarithmes et les règles à calcul ont été utilisées pour réaliser des calculs, jusqu’à leur remplacement, à la fin du XX° siècle, par des calculatrices.
L’émigration, de saisonnière, devient souvent permanente : le Savoyard se dirige vers les Allemagnes : les marchands de Souabe se plaignent de la concurrence des colporteurs savoyards. Certains vont en Autriche. En 1614, on compte 300 familles d’émigrants en Valais. Cette forte émigration explique une alphabétisation plus importante que dans les plaines, car cela permettait à l’émigré de conforter ses compétences professionnelles et d’entretenir les attaches familiales pendant les longues séparations.
À Lyon en 1586, les 2/3 de Lyon sont enfants descendus de Savoyens et comme sujets de Victor Amédée.
H. Ménabréa.
Février 1615
Des États généraux ont été convoqués le 27 octobre 1614, essentiellement pour lever de nouveaux impôts pour se préparer à la guerre contre l’Espagne. Les 464 députés ne se sont pas accordés sur une solution, et dès lors, un accord unanime se fait pour tout arrêter. Ceux du tiers-état demandaient que le roi soit souverain en son État, ne tenant sa couronne que de Dieu seul.
Dès les premières réunions, deux personnages s’affirment.
Le premier est un représentant auvergnat du tiers état, Jean Savaron. Il se fait remarquer en apostrophant le roi en ces termes : Qu’auriez-vous dit, Sire, si vous aviez vu dans vos pays de Guyenne et d’Auvergne les hommes paître l’herbe à la manière des bêtes ? Soulignant avec insistance la misère extrême d’un peuple économiquement à bout, Savaron développe au passage sur la situation des finances publiques une argumentation qui va au-delà des simples principes politiques pour se rapprocher de nos analyses économiques modernes. Il explique à sa manière que trop d’impôt tue l’impôt et que la bonne solution pour assainir la situation est de baisser les dépenses. Il propose de réduire ce qu’il appelle les pensions, c’est-à-dire les dépenses de personnel. Mais comme les hauts emplois sont tenus par des nobles, sa proposition se heurte à leur opposition et reste lettre morte.
Le second représente le clergé : c’est l’évêque de Luçon, un certain Armand Jean du Plessis de Richelieu. Avec beaucoup de finesse, il fait en sorte que la situation financière de l’Église ne soit jamais abordée. Sa présence s’est tellement imposée qu’il lui revient de prononcer le discours de clôture des États. Remarqué par Marie de Médicis, il entre dans les cercles du pouvoir. Par la suite, parvenu au sommet, Richelieu gardera en mémoire les affrontements entre les membres des États généraux et en tirera la conclusion que, pour que la France soit bien gouvernée, il faut un pouvoir fort et déterminé. Avec lui se mettront en place les rouages de ce qui deviendra la monarchie absolue louis-quatorzième.
Quant à Savaron, ses positions suscitent une abondante littérature de soutien. Parmi ceux qui écrivent pour le défendre, on trouve un gentilhomme normand plutôt fantasque qui, en cousin de Corneille qu’il est, se veut surtout poète et écrivain : Antoine de Montchrestien. En 1615, il rassemble ses textes en faveur de Savaron dans un livre qu’il appelle Traité d’économie politique. Étant le premier à utiliser de façon aussi explicite l’expression, il est considéré comme le premier économiste de l’Histoire. Les États généraux de 1614 ont donc, en quelque sorte, porté la science économique sur les fonts baptismaux.
Le traité de Montchrestien conseille au roi de ne pas augmenter les impôts mais de rechercher la croissance économique. Il lui recommande pour y parvenir d’augmenter la quantité de monnaie en circulation en dégageant des excédents extérieurs et en utilisant cette armée qui coûte si cher à rançonner les pays voisins. Montchrestien est un des théoriciens de ce que l’on appellera par la suite le mercantilisme et qui s’incarnera dans la politique de Colbert. Partisan convaincu de l’expansion monétaire, Montchrestien ne se contente pas de parler. Il agit et va jusqu’au bout de sa démarche : il meurt sous les coups de la maréchaussée, qui le pourchasse comme faux-monnayeur !
Jean-Marc Daniel. Le Monde du 21 juin 2014
2 04 1615
Salomon de Brosse entreprend la construction pour Marie de Médicis du palais du Luxembourg, qui sera achevé en 1621. Au milieu du XIX° siècle, on disait de lui qu’il était le plus beau du monde. Marie de Médicis inaugure ainsi une pratique des reines de France : le mécénat. L’un des plus éminents artiste à en bénéficier sera Pierre Paul Rubens.
24 04 1615
Champlain s’embarque encore et toujours pour le Canada, en compagnie de 4 pères récollets, religieux réformés de Saint François. Il marche hardiment vers l’ouest à la tête d’un parti de Hurons : cours de l’Ottawa, lac Huron, lac Oneida, au sud-est de l’Ontario, où il se heurte aux Iroquois. Il ne cessera de rêver de porter le drapeau blanc sur les rives du Pacifique, mais mourra avant que d’y être parvenu, le jour de Noël 1635. L’un de ses amis exprimait en vers sa pensée :
Fy les lasches poltrons qui ne bougent d’un lieu.
Leur vie, sans mentir, me paroit trop mesquine (…)
Il nous promet encore de passer plus avant
Réduire les Gentils et trouver le Levant
Par le nord, ou le sud, pour aller à la Chine (…)
28 11 1615
Louis XIII épouse à Bordeaux Anne d’Autriche
mai 1616
Baffin et Bylot, marins anglais ayant une grande expérience de pilote, longent à bord du Patience les côtes du Groenland jusqu’aux îles d’Upernivik. Ils atteignent 77°45’N, coupent le détroit de Smith, longent la Terre Ellesmere puis découvrent les îles Carrey et le détroit de Jones. Plus loin, ils découvrent l’entrée du détroit de Lancaster, sans réaliser qu’ils sont tout près de forcer le passage du Nord-Ouest. Ils font demi-tour et, de retour au pays – l’Angleterre – affirment que ce n’est pas par là qu’il faut passer !
septembre 1616
Le prince de Condé, révolté pendant 9 mois, de septembre 1615 à juin 1616, est embastillé, sur ordre de Marie de Médicis. Depuis octobre 1614, la régence a pris fin puisque Louis XIII vient d’entrer dans sa quatorzième année, âge de la majorité royale : Marie de Médicis est donc devenue chef du conseil, conseil confié à un ministère de combat où Richelieu est aux Affaires étrangères et à la guerre, le tout sous l’ostensible protection de Concini qui accède alors, – mais alors seulement – à un rôle politique gouvernemental.
1616
Les hollandais Wilhem Schouten et Jacob Lemaire reconnaissant la pointe sud de l’Amérique du sud et lui donnent le nom de leur port d’origine : Hoorne… qui sera simplifié en Horn. Ils poursuivirent leur voyage sur les Tuamotu, les Tonga et Futuna (îles Hoorne). Dans l’exploration du Pacifique, les Hollandais, dont l’indépendance vis à vis des Espagnols est encore fraîche, supplantent rapidement ces derniers.
24 04 1617
Louis XIII, pour monter sur le trône, – il a 16 ans -, bien que timide et bègue, donne ordre à Monsieur de Vitry d’arrêter Concini ; en fait-il trop ? avait-il des ordres non écrits ? toujours est-il qu’il va au-delà et l’assassine ; sa mère est exilée à Blois ; elle ne l’avait jamais aimé, reportant son amour sur son second. Il confie le gouvernement à Charles d’Albert de Luynes. Leonora Galigaï ne survivra que quelques mois à son époux Concini : décapitée puis brûlée.
1617
Gustave Adolphe de Suède fait de son pays la grande puissance de l’Europe du Nord : il a vaincu les Russes, il va vaincre les troupes du Saint Empire.
Grâce à nos victoires, les marchands et les négociants de nos villes ont un centre à Narva pour tout le commerce russe dont maintenant ils pourront tirer de gros profits. Il leur est désormais possible de poursuivre leurs échanges commerciaux avec toute la Russie, partout où il leur plaira. […] Aussi, je vous demande à vous, les nobles, et à tous les autres qui réclament des octrois de terre […] partez vers ces nouvelles terres, et construisez-vous des fermes aussi grandes que vous voudrez, ou du moins d’une étendue que vous puissiez gérer ! Je vous accorderai des privilèges et des exemptions ; je vous accorderai toutes les faveurs.
7 03 1618
Le Palais de Justice de Paris prend feu. La Sainte Chapelle, la Chambre dorée et la Conciergerie sont épargnées de justesse. On ne saura pas si l’incendie était accidentel ou criminel. Quatre ans plus tard, la reconstruction était terminée sur les plans de Salomon de Brosse. Fleurit dans les jours suivants ce gentil quatrain :
Certes ce fut un triste jeu
Quand à Paris dame Justice
Pour avoir mangé trop d’épices
Se mit le Palais tout en feu
21 04 1618
Le père Pedro Paez Jamarillo, jésuite espagnol accompagne le roi d’Abyssinie dans une promenade à cheval, aux abords du lac Tana, ce qui l’amène à découvrir les sources du Nil Bleu, à proximité du village de Gish Abay, au sud du lac. À sa confluence avec le Nil Blanc, il apporte 80 % du débit d’eau, et peut donc légitimement être considéré comme le cours principal du Nil, même si sa longueur n’atteint pas celle du Nil Blanc.
J’avoue ma joie, à avoir devant les yeux ce que dans les temps anciens Cyrus et son fils Cambyse, comme Alexandre le Grand et Jules César, ont tant désiré voir et connaître.
Jusqu’à son arrivée en Abyssinie, la vie du père Paez aura été une étonnante succession d’aventures : du paludisme aux pirates, de sa capture par les Turcs, aux tortures et la prison, et finalement sa vente comme esclave à un sultan du Yémen. Puis la traversée du désert pieds nus, se nourrissant de sauterelles. Paez a parcouru et décrit des zones comme le désert de Hadramaut et Rub-al-Khali, dont d’autres Européens s’attribueront deux siècles plus tard la découverte. En 1603, il partit évangéliser l’Éthiopie, se faisant appeler Abdullah et y restant vingt ans, pendant lesquelles il y jouit d’une immense popularité. Il sera le Matteo Ricci de l’Éthiopie. Il parle de bien des choses, dont le café dans Historia da Etiópia a Alta e Abassia. Il mourra en 1622, à Gomora en Ethiopie.
23 05 1618
Les États de Bohème étaient parvenus à obtenir de l’Empereur de Bohème-Hongrie une Lettre de Majesté, édit de tolérance permettant la coexistence pacifique des différentes églises. Son successeur Ferdinand II de Habsbourg, ou encore Ferdinand de Styrie se mit à favoriser les catholiques à l’excès, et les dissidents, emmenés par Gábor Bethlen, calviniste devenu voïvode de Transylvanie, relevèrent la tête en convoquant un congrès pour porter plainte et exposer ses doléances à l’empereur : mais ce dernier fit interdire la réunion où devait être lue sa réponse ; le congrès convoqua alors les deux gouverneurs catholiques de Prague de l’Empereur, Jarsoslav Borita de Martinic et Vilem Slavata de Chlum à qui étaient confiés l’administration des pays tchèques ; ils furent écoutés une journée et, le lendemain, jetés par les fenêtres du château de Hradschin, le château de Prague : la Défenestration marque le début de la guerre de Trente ans… même si les deux lieutenants et Fabricius, le secrétaire de l’empereur, ne furent que légèrement blessés, car leur chute fût amortie par un tas de fumier ! Les catholiques voulurent y voir un miracle et en remercièrent la Vierge.
Assez schématiquement, on aura d’un coté les protestants et de l’autre coté les catholiques, avec, dans chaque camp des ambitions de pouvoir et d’extension de la zone d’influence si ce n’est du territoire ; du coté protestant, les rois du Danemark puis de Suède, un éphémère roi de Bohème, les Provinces Unies, appuyés plus ou moins directement par la France ; du coté catholique l’empereur du Saint Empire romain germanique, l’Espagne.
Le refus par les principautés allemandes et par l’Europe de l’unité de l’Allemagne broya celle-ci. Elle fût déchiquetée par des guerres continuelles commencées en 1546 et achevées en 1648 par les traités de Westphalie qui mirent fin à la guerre de Trente Ans [3] et à toute existence de l’Allemagne. Cette guerre fut d’une sauvagerie inconnue jusque-là et qui restera inégalée jusqu’en 1940. Presque tous les grands États européens s’y engagèrent mais seul le territoire de l’Allemagne la subit. Entre le quart et le tiers de la population allemande fut anéantie et, en bien des endroits, beaucoup plus…
Le pays était si dévasté que, sans aucun combat, dix-sept mille hommes moururent de faim en trois mois… Les chances de revenir d’une campagne étaient très inférieures à celles d’un poilu de Verdun… Pendant trente ans, de 1618 à 1648 , la France s’employa à éradiquer toute possibilité d’une puissance catholique allemande unifiée. Ce faisant, elle suscita un sentiment de haine dont les Allemands parlent encore quatre cents ans plus tard. C’est de cette époque que date la notion d’ennemi héréditaire et l’ennemi héréditaire ce fut d’abord les Français pour les Allemands, non l’inverse. Il faut bien mesurer ce que fût la guerre de Trente Ans. C’est comme si la guerre de 14 s’était poursuivie d’une seule traite jusqu’en 1944 avec un rythme de destruction de la population allemande égal à celui des pires années de la Seconde Guerre mondiale. Imaginez une guerre qui coûterait dix-sept millions de morts à la France d’aujourd’hui !
Philippe Delmas. De la prochaine guerre avec l’Allemagne. Odile Jacob 1999
Grimmelshausen, qui a participé à la guerre de Trente Ans, rend compte de son expérience à travers les aventures de Simplicius Simplissimus. On est ici à la bataille de Wittstock, dans les années 1630 :
Sous la rafale, les froussards se tapirent comme s’ils voulaient rentrer en eux-mêmes, tandis que les soldats courageux, qui en avaient vu bien d’autres, laissaient passer la mitraille sans pâlir. Dans la bataille, chacun cherchait à prévenir la mort en massacrant le premier qui s’offrait à lui. L’affreuse fusillade, le cliquetis des armures, le fracas des piques, les cris des blessés et des assaillants, s’ajoutant aux accents des trompettes, au bruit des tambours, aux coups de sifflet, tout cela faisait une musique terrible. On ne voyait rien qu’un épais nuage de fumée et de poussière qui semblait vouloir voiler l’horrible spectacle des morts et des blessés. On entendait les plaintes déchirantes des moribonds.
[…] La terre, qui a coutume de recouvrir les morts, était alors semée de cadavres : ici gisait une tête que son propriétaire naturel avait perdu, là un corps auquel il manquait la tête ; certains avaient les entrailles affreusement arrachées du corps ; d’autres avaient la tête fracassée et la cervelle en bouillie. On voyait des corps inanimés privés de leur sang et des vivants souillés de sang étranger. Il y avait des bras arrachés dont les doigts remuaient encore comme s’ils voulaient se jeter à nouveau dans la mêlée. Le sol était couvert de jambes séparées du tronc. On voyait des soldats mutilés qui suppliaient qu’on hâtât leur trépas, bien que leur mort ne fît pas de doute. Pour résumer d’un mot, la vue de ces misères était navrante.
[…] Les choses que j’avais vues et entendues ce même jour occupèrent sans relâche ma réflexion ; […] mais en ma niaiserie je ne pus rien imaginer, sinon conclure qu’il y avait surement deux sortes de gens au monde qui ne descendaient pas du seul Adam, mais qu’il y en avait de sauvages et d’apprivoisés, comme d’autres animaux dépourvus de raison, puisqu’ils se persécutaient les uns les autres si cruellement (chap. XV trad : Jean Amsler)
Et il est aussi cru pour dire l’exploitation du petit peuple : Tout le faix reposait sur eux et les accablait au point qu’il leur faisait suer l’argent de leurs bourses et livrer même celui qui était caché derrière sept serrures. Et quand l’argent n’était point livré, les commissaires des vivres les étrillaient si bien […] qu’ils leur tiraient des soupirs du cœur, les larmes des yeux, le sang de dessous les ongles et la moelle des os.
Grimmelshausen. La vie de l’aventurier Simplicius Simplissimus, 1668
L’enrichissement rapide des chefs de guerre – Wallenstein [4] et Tilly chez les catholiques, mais aussi Mansfeld, Thurn, chez les protestants – s’explique essentiellement par le système des contributions que la plupart de ces condotierri imposent aux territoires qu’ils contrôlent. Il s’agit à l’origine d’un contrat signé entre un chef de guerre et un prince (ou l’empereur lui-même) qui autorise le premier à prélever, en contrepartie de sa protection, un tribut sur les habitants des territoires occupés. Le système se généralise à partir des années 1623-1625. Il entraîne la démission de fait du pouvoir politique, et donne ainsi aux bandes armées, et à ceux qui les dirigent, une indépendance presque totale. On a estimé à 1 500 le nombre des condottieri ainsi employés par contrat pendant la guerre de Trente Ans.
Jean Delumeau Une Histoire du Monde aux Temps Modernes. Larousse 2005
1618
Construction des premiers microscopes. S’il n’en est pas l’inventeur, Athanasius Kircher – 1601-1680 – en sera au moins l’un des premiers à l’utiliser pour observer le sang : jésuite aux connaissances encyclopédiques, – on le nommera Le Maître aux cent savoirs -.
22 02 1619
Marie de Médicis s’évade de Blois.
30 04 1619
Le traité d’Angoulême met fin aux hostilités entre Marie de Médicis et son fils Louis XIII.
9 05 1619
Jens Eriksen Munk, militaire danois et grand pêcheur à la baleine, parvient à persuader son roi Christian IV de lui confier l’organisation d’une expédition vers le Nord-Ouest : il appareille avec le Enhjørningen – Licorne – et le Lamprenen – Lamproie -, qui portent 60 hommes d’équipage. Arrivés dans le détroit d’Hudson, une tempête de nuit sépare les deux navires. Ils se retrouvent 2 semaines plus tard et un premier hivernage commence à l’embouchure de la rivière Churchill : le scorbut s’ajoute au froid pour faire trépasser quasiment tout le monde… Au printemps, il ne reste que 3 survivants qui vont se nourrir de racines, de baies, de feuilles et d’herbes. L’un des 2 navires est devenu une fosse commune où se décomposent les cadavres. À la mi-juin, les trois rescapés trouvent suffisamment d’énergie pour organiser leur retour : ils repartent à la mi-juillet sur le Lamprenen, arrivent à la mi-août dans le détroit d’Hudson … le scorbut revient… ils vont braver plusieurs tempêtes, et le Lamprenen, qui n’est plus qu’une épave flottante, finit par toucher les côtes norvégiennes après plus de 60 jours de navigation.
1619
Sir Thomas Roe est ambassadeur d’Angleterre à la cour du Grand Moghol, en Inde : il cadre les missions de la Compagnie des Indes Orientales [5] : le principe vaudra encore jusqu’à la fin du XVIII° siècle, et ceux qui voudront y déroger le paieront : Celui qui cherche des profits doit tenir la mer et mener pacifiquement son commerce ; mais s’embarrasser, de gaieté de cœur, de garnisons et d’expéditions, c’est pure folie.
Charles Fleury, flibustier de Rouen et aussi capitaine protestant, collectionne les ratés depuis une dizaine d’années aux Antilles, aux Açores, en Acadie, mais il ne se décourage pas et en 1618, il appareille de Dieppe avec 2 navires et 2 barques muni d’une lettre de marque l’autorisant à piller tout bien espagnol ou portugais ; et là encore le mauvais sort, bien aidé par les disputes et l’amateurisme, mena l’affaire au bord du désastre : aussi, début 1619, séparé des autres navires, l‘Espérance de Fleury, remontant vers les Antilles, donnait de plus en plus l’image de la désespérance, avec les allures de vaisseau fantôme : En cet état, notre navire était comme abandonné, hors duquel on jetait tous les jours des corps qui mouraient, l’un demandant du pain, l’autre de l’eau, l’autre en blasphémant et maudissant sa vie, l’autre celle de celui qui était cause qu’il s’était embarqué audit voyage, l’autre en baillant et faisant comme s’il eut mangé quelque chose, de sorte que c’était chose épouvantable à voir et entendre ces diversités de plaintes, qui étaient prononcées d’une voix si cassée et languissante, qu’on eut dit qu’elle sortait de quelque caverne souterraine tant elle était confuse. D’ailleurs, on ressemblait à de vrais squelettes, ou corps qui eussent été enterrés quelques jours car depuis la plante des pieds jusqu’à la tête, nous étions couverts d’une crasse si noire et tenante et gluante, que nous ressemblions plutôt à des fantômes qu’à des hommes, qui fut la cause que quand nous arrivâmes aux Indes, les sauvages croyaient que nous fussions des diables, disant que les Français n’étaient pas faits comme nous.
Le chroniqueur du bord.
En Hollande, on se dispute, mais pas au point d’oublier de faire des affaires : Les Provinces-Unies ne jouirent pas longtemps des avantages que leur garantissait la trêve de 1609 : grâce à la protection de la France, regardées par l’Espagne comme un État libre et indépendant, elles venaient de se ranger au nombre des puissances de l’Europe : ses immenses richesses, le nombre de ses flottes, le courage de ses soldats permettoient à la nouvelle république d’y tenir une place distinguée. Deux sectes, celle des Arminiens et des Gomaristes, déchirèrent le sein de la Hollande : ceux-ci, plus puissants, plus nombreux, avoient pour chef le stathouder Maurice de Nassau ; ceux-là, le vertueux vieillard Barneveldt qui, par la sagesse de sa conduite, par ses lumières, son zèle, n’avoit pas rendu moins de services à la patrie que Guillaume et Maurice. Le savant Grotius partageoit et les vues et les opinions de Barneveldt, lesquelles tendoient toutes à resserrer, dans de justes bornes, le pouvoir de Maurice ; ce fût donc plutôt une querelle d’ambition que de fanatisme. Les Gomaristes, arrêtèrent, jugèrent, condamnèrent et firent décapiter Barneveldt en 1619 : ces discordes n’empêchèrent point la Hollande d’être florissante au dehors ; la puissance de cette république s’accrut chaque jour ; ses nombreux vaisseaux rapportoient dans les ports les richesses du monde ; elle pesa, d’une manière sensible, dans la balance de l’Europe.
M.E. Jondot. Tableau historique des nations. 1808
Le système politique de la Hollande est complexe. Les provinces de ce qui est officiellement une république fédérale s’administrent séparément. Seule une prééminence de fait est reconnue aux deux hommes qui dirigent la Hollande, la plus grande des provinces, où se trouve La Haye, la capitale fédérale. L’un est le grand pensionnaire, qui représente les intérêts des marchands, l’autre le stathouder, toujours choisi dans la famille d’Orange, qui défend ceux de la noblesse et de l’armée. Les deux s’opposent sans cesse. Peut-être est-ce cette division du pouvoir qui empêche l’autoritarisme et fait du pays un des rares îlots de liberté dans l’Europe du temps. La tolérance y est de mise. Les catholiques y sont mal considérés, mais non persécutés. Les Juifs, chassés d’Espagne et du Portugal, viennent y chercher refuge. Les idées circulent. À cause de la hardiesse de celles qu’il défend, le grand philosophe Spinoza (1632-1677) est exclu de la communauté juive d’Amsterdam pour hérésie, mais jamais poursuivi par les autorités. La censure n’existe pas et on peut y imprimer sans patente. La Gazette de Hollande ou Les nouvelles de Leyde sont lues partout en Europe parce qu’elles sont les seules publications à donner des informations exactes.
François Reynaert. La Grande Histoire du Monde. Fayard 2016
Dans les Indes néerlandaises, pour organiser leurs activités commerciales, les Hollandais détruisent le petit port de Jayakarta, à l’emplacement duquel ils fondent la ville de Batavia, avec un quartier européen pour la construction duquel, faute de main d’œuvre locale fiable, le gouverneur Jan Pieterszoon Coen fait appel à de la main d’œuvre chinoise recrutée sur la côte sud avec des procédés proches de la déportation. Une fois la construction terminée, la plupart de ces Chinois resteront sur place en travaillant dans les usines de sucre.
18 et 19 07 1620
Nicolo Rusca, archiprêtre de Sondrio, dans la Valteline, une vallée lombarde attachée aux Grisons suisses est mort deux ans plus tôt sous la torture de tribunaux protestants, qui lui reprochaient d’avoir voulu s’opposer à la création d’une école protestante, à la demande de l’évêque de Côme, et, plus grave l’accusaient de trahison pour s’être allié au parti espagnol contre le parti protestant de Thusis, allié à Venise. [Il sera béatifié en 2013]. Les catholiques se déchaînent en massacrant à Tirano, Teglio et Sondrino 600 à 700 protestants, pour rompre l’assujetissement aux Grisons : Sacro Macello – Saint Massacre – . Seuls 70 réformés italiens parvinrent à se réfugier en Engadine. Il ne reste aujourd’hui que le seul Val Bregaglia [d’où est originaire Giacometti] à être italophone et à majorité protestante, mais cela ne concerne que 1 600 habitants.
8 11 1620
Ferdinand II de Habsbourg, champion de la Contre Réforme écrase les Tchèques conduits par l’électeur palatin Frédéric V sur le plateau de la Montagne Blanche, proche de Prague : le destin des pays tchèques était scellé pour plusieurs siècles.
21 11 1620
Le Mayflower, trois mâts de 27 mètres, après des erreurs de navigation, mouille sur les rives de l’Hudson, proche de Cape Cod, en un lieu qu’on baptisera Plymouth ; à son bord, 102 émigrants, dont 41 puritains anglais, les Pilgrim Fathers, avec à leur tête William Bradford, considérés comme les pères fondateurs des États-Unis ; ils ont rédigé un contrat, le Mayflower Compact, qui contient les bases de la démocratie américaine ; ce sont des protestants rigoureux, empêchés de pratiquer à leur guise en Angleterre, et tout d’abord réfugiés pendant 14 ans en Hollande, pour repousser et dénier toute accointance avec l’impiété et la mauvaiseté.

réplique
On ne sait pas exactement quelle idée ils se faisaient de l’Amérique, mais elle ne devait pas être bien éloignée de celle de Hegel, quelque 200 ans plus tard dans La Philosophie de l’Histoire : Nous découvrons d’énormes fleuves qui n’ont pas encore réussi à se fabriquer leur lit. […] L’infériorité de ces individus [les Indiens] est, sous tous les aspects, pleinement évidente.
Ces protestants aux belles mains blanches n’y connaissaient évidemment rien en agriculture et l’aide des Indiens durant l’hiver leur fût précieuse – à telle enseigne qu’ils voulurent s’en souvenir avec le Thanksgiving day – ; il n’empêche que, 16 ans plus tard, les premières hostilités étaient déclenchées contre les Pequots, la tribu indienne qui occupe les actuels Connecticut et Rhode Island.
Ceux qui échappèrent au feu périrent taillés en pièces ou passés au fil de l’épée. Ils furent rapidement dispersés et seul un petit nombre réussit à s’échapper. On a parlé de quatre cents morts rien que pour ce jour-là. C’était un spectacle horrible que de les voir se tordre dans les flammes et tout ce sang répandu sur le sol. Tout aussi horrible était la puanteur qui se dégageait de cet endroit. Mais la victoire semblait comme un doux sacrifice à Dieu, qu’ils remercièrent d’avoir œuvré si merveilleusement pour eux et de leur avoir ainsi livré leurs ennemis, permettant une rapide victoire sur un si vaillant et si exécrable ennemi.
William Bradford. History of the Plymouth plantation
vers 1620
Le métier de médecin est d’adoucir les peines et les douleurs, lorsque cet adoucissement peut conduire à la guérison, mais aussi lorsqu’il peut servir à procurer une mort calme et douce.
Francis Bacon. 1561 -1626
À peu près dans le même temps, les frères Chamberlen, Peter le Vieux 1560-1631 et Peter le Jeune 1572-1626, (Chamberlaine, Chamberlayne) sont médecins, huguenots français d’origine normande mais exerçant à Paris, ayant émigré en Angleterre en 1569 pour fuir les violences religieuses perpétrées en France. Le père Guillaume et le fils aîné Pierre (1560-1631), devenu aussi chirurgien accoucheur, exercent d’abord à Southampton puis s’installent à Londres. Ils inventent le forceps obstétrical, un pince toute simple qui permettait d’attraper le bébé par la tête pour l’extraire du ventre de sa mère et l’amener au monde ; ils vont garder cela secret, qui ne sera partagé que par la seule famille, et cette ineptie durera un siècle : espoir de faire monter les enchères et que cette invention apporte la fortune un jour à la famille ? De toute façons, étroitesse d’esprit qui les empêchera d’inventer l’outil pour leur ouvrir le cœur.
1620
Le Bosphore gèle. Claude Ballaloud, originaire du Valais, s’est fixé dans le Faucigny où il fonde le premier atelier d’horlogerie au hameau de la Corbassière. C’est le début d’une épopée industrielle qui va faire un bond grâce à Claude-Joseph, son petit-fils, qui se mettra en chemin pour Nuremberg, où il va perfectionner le savoir et les techniques venues de son grand-père. De retour au pays, il va former de nombreux ouvriers à Saint Sigismond, qui iront monter leurs propres ateliers dès 1720 dans les villages alentour, La Frasse, Nancy-sur-Cluses, Arâches ou Morillon. L’épopée de l’horlogerie était née ; elle engendrera le décolletage, aux applications plus larges.
1621
Sur les îles Banda, dans l’archipel des Moluques, le Hollandais Jan Pieterszoon Cœn, gouverneur général de la Vereenigde Oostindische Compagnie, fait exécuter quarante aristocrates de Banda Neira par ses supplétifs japonais. Les Moluques étaient les îles aux épices, sujet de convoitises incessantes de la part des blancs. Un par un, ces orang kaya que les Hollandais accusaient de ne pas avoir respecté les accords régissant le monopole batave sur la noix de muscade, sont décapités au sabre.
31 08 1622
Montpellier a manifesté jusqu’à présent un peu trop de sympathies pour les Protestants pour que le roi se fasse une raison et c’est le début d’un siège de 48 jours qui verra tomber sur la ville 13 000 boulets, tirés par 43 canons. La ville avait eu le temps de se doter de solides fortifications construites sous la direction de Pierre Conty d’Argencour. Les troupes royales y perdirent plus de 1 000 hommes, et 2 000 en plus, de maladie. Les assiégés eurent 400 morts et plus de 3 000 de maladie. Le 12 octobre 1622, de duc de Rohan, représentant des Montpelliérains conclura une trêve avec les représentants du roi et le 18 octobre, Louis XIII entrera triomphalement dans la ville : l’Édit de Montpellier confirme l’Édit de Nantes, étend la liberté d’exercice de culte des protestants, réduit à deux le nombre de places de sureté des protestants : La Rochelle et Montauban, et Benjamin de Rohan Soubise, le chef de guerre des Huguenots, est réintégré dans ses biens, honneurs et pensions.

10 09 1622
À Nagasaki, sur la colline de Nishizaka, 23 chrétiens sont brûlés au poteau et 22 sont décapités. Parmi les neuf jésuites martyrisés se trouvent le Père Charles Spinola et le Père japonais Sébastien Kimura, membre de la Société depuis 1582.

Anonyme japonais du XVII° siècle Le Grand Martyre de Nagasaki, Résidence du Gesù, Rome
1622
Première compagnie de mousquetaires de la garde du Roi : ce seront ceux d’Alexandre Dumas père, vêtus de gris et montant des chevaux gris. À leurs cotés, on pouvait aussi trouver un régiment de cavaliers croates auxquels on a voulu attribuer l’origine de la cravate, car ils avaient pour habitude de porter un foulard noué autour du cou. En langue croate, ce nom s’écrit Hvart et la prononciation ressemble beaucoup à cravatte. Même si l’on trouve dans la langue française ce mot utilisé antérieurement à la présence de Croates en France, la mode dont bénéficia alors la cravatte semble bien due au port de ce foulard par ces mercenaires croates.
En Inde, le gourou Arjoun, chef religieux des Sikhs, est exécuté pour avoir hébergé Khousrau, prince fugitif en rébellion contre son père, l’empereur Jahanguir : jusque là paisible communauté religieuse, – le sikhisme est apparu en Inde un siècle plus tôt, syncrétisme de l’islam et de l’hindouisme – les Sikhs vont devenir une communauté guerrière.
Le Bosphore gèle : c’est le détroit qui à Istanbul, sépare l’Europe de l’Asie, et relie la Mer Noire à la Méditerranée.
L’Église catholique a très tôt mis en avant l’indigénisation des cadres religieux. L’impulsion est donnée dès 1622 avec la déclaration du pape Grégoire XV, qui fonde la Congrégation pour la propagation de la foi et donne instruction de former un clergé indigène, mais sans concession culturelle et encore moins doctrinale aux cultures et religions locales. Dès 1628 avait été crée à Rome la première école pour former un clergé indigène, la Congrégation pour l’évangélisation des peuples.
Olivier Roy. La Sainte ignorance. Seuil 2008
Njinga Mbandi est chargée d’une mission auprès de la colonie portugaise de Luanda [les premiers contours du futur Angola] par Ngola Mbande, roi du Ndongo, en Afrique centrale. Le gouverneur Correia de Sousa l’invite à s’asseoir devant lui à même le sol, comme c’est la coutume. Mais Njinga veut traiter d’égal à égal et appelle une servante qui lui servira de siège ! Elle marque un point. L’objectif était de chasser les Portugais de la forteresse d’Ambaca que le prédécesseur de Sousa, Mendes de Vasconcelos, avait construite en 1618 sur son territoire, de récupérer certains de ses sujets tenus captifs, notamment des groupes de serfs ijiko, et de convaincre le gouverneur de faire cesser les raids des mercenaires imbangala à son service. Le gouverneur accède à toutes ses demandes et signe un traité de paix. Elle adopte le nom de Dona Ana de Sousa en hommage à l’épouse du gouverneur, qui est également sa marraine. Le Portugal n’honorera cependant pas sa part du traité, refusant de se retirer d’Ambaca, de rendre les sujets du Ndongo et de contenir les assauts des Imbangala.
En 1624, elle prendra le pouvoir au Ndongo grâce à une secte militaire nomade, les Jagas. Pendant quarante ans, la reine Njinga tiendra en respect les Portugais. Sans armes à feu. Par la terreur, la ruse et la diplomatie. Son génie relève avant tout d’un sens inépuisable de la mobilité. Les Portugais se livrent au commerce d’esclaves ? Elle, qui règne sur un peuple où l’esclavage des ennemis et des étrangers est coutumier, en fait une monnaie d’échange. Les Imbangala dévastent tout ? Elle en épouse un et adopte leurs coutumes, efficace instrument de terreur. Les Hollandais débarquent ? Elle s’allie avec eux contre les Portugais. Elle poussera l’art de la métamorphose jusqu’à se convertir pour de bon au christianisme, et à consacrer ses dix dernières années à y convertir son peuple
Nzinga assura la régence de son neveu et fils de son frère, Kaza, alors sous la garde des Imbangala, elle enverra des émissaires le chercher, puis le fera assassiner. Elle prendra ensuite le pouvoir au Ndongo. En 1624, elle signait ses lettres Madame du Ngondo puis, à compter de 1626, elle prendra le titre de Reine du Ndongo.
En 1641, les Pays-Bas, soutenus par le royaume du Kongo, s’empareront de Luanda. Nzinga s’empressera de leur envoyer un émissaire et conclura une alliance avec eux contre le Portugal. Espérant, grâce à l’aide des Pays-Bas, reconquérir ses territoires perdus, elle déplacera sa capitale vers Kavanga, au nord des anciens domaines du Ndongo. En 1644, elle vaincra l’armée portugaise à Ngoleme mais ne pourra conclure. Deux ans plus tard, elle essuiera une défaite à Kavanga, verra sa sœur capturée et ses archives saisies, ce qui révélera son alliance avec le Kongo. Les Pays-Bas enverront alors des renforts à Nzinga depuis Luanda et cette dernière remporta une victoire en 1647 avant d’assiéger la capitale portugaise de Masangano. Avec l’aide du Brésil, le Portugal, reprendra Luanda l’année suivante et Nzinga se repliera sur Matamba d’où elle continuera à défier les armées portugaises.
En 1657, sur ses vieux jours, Nzinga signera un traité de paix avec le Portugal, y insérant une clause engageant les Portugais à soutenir le maintien de sa famille au pouvoir et, faute d’un fils pour lui succéder, elle tentera de marier sa sœur à João Guterres Ngola Kanini, qui malheureusement, était déjà marié ailleurs.
Elle eut à déjouer de nombreuses tentatives de coups d’État, en particulier du Kasanje, dont les groupes imbangala tenaient le sud, mais elle mourut paisiblement le 17 décembre 1663 au Matamba, à 80 ans. Une guerre civile éclatera mais Francisco Guterres Ngola Kanini parviendra à lui succéder.
vers 1622
Les années 1622-1626 sont les grandes années du libertinage. Cela pouvait entraîner une condamnation à mort… mieux valait être prudent.
Qu’on parle de Dieu le père
De toute la Trinité
Qu’une vierge soit la mère
D’un sauveur ressuscité
Et que l’esprit en colombe
Descende comme une bombe
Je me fous de leur destin
Pourvu que j’ai du vin
Pourquoi prêcher ma mort aux hommes ?
Ce sont des discours superflus.
Elle n’est pas tant que nous sommes
Quand elle est, nous ne sommes plus.
Ah ! qu’ils sont insensés ces bougres
Avec leurs illusions
De croire ce qui est en poudre
Sujet à résurrection !
Pourquoi tant de cloches, de messes ?
Peut-on ressusciter des morts ?
Nous devons croire avec sagesse
Que l’âme meurt avec le corps.
Anonyme. Cité dans Histoire du libertinage. Didier Foucault Perrin 2007
de 1621 à 1627
Alger est au sommet de sa gloire et puissance barbaresque : on y compte quelque 20 000 captifs, pour moitié gens de la meilleure chrétienté : Portugais, Flamands, Écossais, Anglais, Danois, Irlandais, Hongrois, Esclavons, Espagnols, Français, Italiens ; pour moitié hérétiques ou idolâtres, Syriens, Égyptiens et mêmes des Japonais et des Chinois, des gens de la Nouvelle Espagne, des Éthiopiens. Les corsaires algérois passent Gibraltar, aidés en cela, dit-on, par Simon Danser, alias Simon Raïs, de son vrai nom Simon Simonsen, redoutable corsaire hollandais. La course musulmane s’est mariée à la course océane.
05 1624
Trente familles wallonnes et huguenotes débarquent sur l’île aux Noix, aujourd’hui Governor’s Island, face à Manhattan et y fondent la Nouvelle Amsterdam, qui va devenir New York le 10 novembre 1674.
15 06 1624
Diego Carillo Mendoza Pimentel, marquis de Gelves, vice roi de la Nouvelle Espagne, face au développement non contrôlé de la population, met en place des organes de surveillance, qui permettront de condamner les vagos – sans domicile fixe – à un exil de 6 ans de l’autre coté du Pacifique, c’est à dire aux Philippines. Le petit peuple de Mexico, Indiens, Noirs, Métis, se révolte durant 3 jours, et met à sac le palais ; le clergé séculier est à leurs cotés. La noblesse mexicaine et les franciscains parviennent à ramener le calme, mais le vice-roi a bel et bien été chassé…
Dans l’autre vice-royauté espagnole, en Amériques du sud, au plus près de l’argent du Potosi, les rivalités entre Basques, Castillans, Estremaduriens ont fait rage pendant 2 ans et ont pris des tournures de guerre civile.
1624
Plus de 100 ans après l’arrivée en Europe de la syphilis, plus de 70 ans après la disparition des bains publics, la répulsion pour l’hygiène, l’eau et la toilette restent aussi marquées : Nous nous en (des salles de bains) pouvons plus commodément passer que les Anciens, à cause de l’usage du linge que nous avons, qui nous sert aujourd’hui à tenir le corps net, plus commodément que ne pouvaient le faire les étuves et bains aux Anciens, qui étaient privés de l’usage et commodité du linge.
Louis Savot. Architecture française des bastiments particuliers
Il ne tient qu’à nous de faire de grands bains, mais la propreté de notre linge et l’abondance que nous en avons valent mieux que tous les bains du monde.
Charles Perrault. Parallèles des Anciens et des Modernes.1688
Le Hollandais Cornelius Van Drebbel essaie à Londres le premier prototype de sous-marin : il est en bois, recouvert de cuir graissé ; il dispose de 6 rames et peut transporter 16 personnes à une profondeur de 5 mètres. Mais l’amirauté ne s’y intéressera pas.

Les deux compagnies néerlandaises – VIC et VOC, compagnies des Indes Occidentales et Orientales – s’attaquent aux colonies portugaises au Brésil, en Afrique et en Asie. Au Brésil, les Néerlandais prennent à partir de 1624 le contrôle des principaux comptoirs portugais mais finissent par en être définitivement chassés en 1654 : ils avaient mis à profit l’affaiblissement de l’Empire colonial Portugais durant l’union personnelle des deux couronnes [Portugal – Espagne] pour établir dans le Nordeste une colonie qu’ils avaient nommé Nouvelle Hollande, entre Sergipe et Maranhão, ayant pour capitale Mauritsstad, (aujourd’hui Recife). En Afrique, ils échoueront dans leur tentative de conquête de l’Angola, qu’ils ne conserveront que de 1641 à 1648 mais expulsent et prennent la place des Portugais sur la Côte de l’Or. En Asie par contre, ils seront sont vainqueurs, prenant aux Portugais les Moluques, Malacca, Ceylan et leurs comptoirs sur la côte de Malabar, et obtiennent le monopole du commerce avec le Japon.
Cette guerre pose les bases de l’empire colonial néerlandais, qui va dominer le commerce mondial jusqu’en 1713. On nommera ces pillages – enlève-toi de là que je m’y mette – la guerre du sucre, qui prendra fin avec le traité du La Haye du 6 août 1661 : la Nouvelle-Hollande est vendue au Portugal pour huit millions de florins (l’équivalent de 63 tonnes d’or). Cette somme sera versée chaque année par le Portugal pendant 40 ans et sous la menace d’une invasion de Lisbonne et du Nordeste. Le Portugal cède Ceylan et les îles Moluques à la Hollande et concède ses privilèges sur le commerce du sucre. En retour la Hollande reconnait la souveraineté portugaise totale sur le Brésil et l’Angola. Cette guerre amorce le déclin de l’empire colonial portugais qui, s’il conserve le Brésil et ses plus importantes colonies africaines, perd définitivement sa prééminence en Asie.
1625
Avec l’ouvrage Droit de la guerre et de la paix, le juriste hollandais Hugo de Groot, [Grotius] jette les prémices du droit international, première tentative de codification du droit de la guerre : J’ai remarqué dans tout le monde une licence si effrénée par rapport à la guerre que les nations les plus barbares en devraient rougir. On court aux armes ou sans raison ou pour de très légers sujets ; […] on foule aux pieds tout droit divin et humain ; comme si, dès lors, on était autorisé et fermement résolu à commettre toute sorte de crime sans retenue.
Le normand Pierre Belain d’Esnambuc débarque sur l’île Saint Christophe, entre Guadeloupe et Porto Rico, qui devient la première colonie française des Antilles. Placé sous l’autorité et puissance du roi, il est autorisé à coloniser les îles voisines.
Antonio de Andrade et Manuel Marques, jésuites, sont en route pour pénétrer au Thibet : ils sont les premiers occidentaux à le faire : si leur foi n’est pas parvenue à busculer les montagnes, elle est tout de même parvenue à les maintenir en vie, là où bien d’autres l’y auraient laissée.
Cette contrée (le Ladak ?) et encore soumise au prince de Serenagar, [Srinagar] les naturels diffèrent de ses autres sujets pour les mœurs et le langage. Ils mangent le mouton cru à mesure qu’ils l’ont égorgé ; la graisse et les nerfs du pied passent pour les morceaux friands ; ils déchirent les entrailles et les mangent assez mal lavées. Quelquefois, ils font cuire la viande mais très peu ; car ils prétendent que la viande entièrement cuite perd son goût et sa saveur. Ils mangent la neige comme nous mangeons le pain. Voyant un enfant d’environ deux ans qui s’amusait à manger un morceau de neige, je le lui ôtai des mains, craignant qu’il ne se fit mal, et lui donnai quelques grains de raisin. Il les mit dans sa bouche et les rejeta bientôt, en pleurant le mets que je lui avais enlevé.
En un mot, les hommes de tous les rangs mangent de la chair crue, le riz et les légumes comme on les apporte des champs ; cependant ils sont tous bien portants et ne connaissent pas les coliques, si fréquentes parmi les Indiens. Les femmes labourent les champs, et les hommes filent ; elles portent, au lieu de perles, des feuilles semblables à celle du palmier, entrelacées et roulées comme deux fuseaux, qui sortent des oreilles, s’entortillent ensemble autour du visage et sont longues d’une palme et demie.
Nous nous arrêtâmes dans le dernier village nommé Manà, pour attendre la fonte des neiges dans un désert qui conduit au Thibet, et par lequel on ne peut passer que durant deux mois de l’année ; pendant les dix autres mois tous les chemins sont obstrués. C’est là que commencent d’énormes montagnes que l’on ne peut franchir en moins de vingt jours. On n’y trouve ni habitations, ni arbres, ni herbes, rien, en un mot, que des rochers presque toujours couverts de neige. Pendant les deux mois où le chemin est praticable, la terre est découverte en certains endroits, et dans d’autres, la neige est si solide qu’on peut marcher dessus. Il ne s’y trouve point de bois, ni même aucun combustible, de manière que les voyageurs ne peuvent manger que de l’orge grillé ; ils le jettent dans l’eau aux heures des repas, et font ainsi un mets dans lesquels ils trouvent à boire et à manger : c’est leur unique aliment dans ce désert. Ils en mangent une grande quantité. Tant par le malaise que par une certaine exhalaison pestilentielle qui sort de la terre, tout-à-coup on éprouve une révolution violente et intérieure qui vous fait périr en un quart d’heure. J’attribue ces morts subites à la cessation de la chaleur naturelle interceptée par le grand froid, et surtout à la mauvaise nourriture.
Quand on présume que le passage est libre et praticable, les gouverneurs des pagodes envoient au roi du Thibet des ambassades avec des présents, pour lui demander la permission d’expédier des caravanes dans ses États. Tandis que nous attendions la réponse, disposés à partir avec la première caravane, le roi de Sérénagar envoya des ordres pour qu’on se saisit de nos personnes et qu’on nous amenât vers lui les pieds et mains liés. Alors je résolus de partir secrètement et de traverser ce désert, quoique ce ne fut pas encore le moment. Après avoir pris tous les renseignements nécessaires, je laissai mon compagnon dans le village, avec la certitude qu’on ne lui ferait aucun mal, et me mis en chemin avant le jour, avec deux serviteurs chrétiens et un homme du pays pour nous servir de guide. Nous avions chacun un balandran pour nous couvrir, et une besace où étaient quelques comestibles. Nous marchâmes deux jours et hâtâmes le pas le plus qu’il nous fut possible, les neiges commençant déjà à nous donner bien de la peine. Le matin de la troisième journée, nous vîmes arriver trois hommes envoyés par le gouverneur du lieu d’où nous étions partis. Ils nous dirent que nous n’avions qu’à retourner sur nos pas, si nous ne voulions pas nous exposer aux plus grands châtiments ; et se tournant vers notre conducteur, ils lui annoncèrent que sa femme et ses enfants étaient en prison, qu’ils y mourraient, que sa fortune était déjà confisquée ; ensuite, ils m’adressèrent des menaces terribles, et ajoutèrent que je mourrais immanquablement de fatigue au milieu des déserts. On se doute bien que notre guide ne fut pas longtemps fidèle ; il rebroussa chemin. Quant à moi, qui savais celui que je devais suivre, je passai outre avec mes deux valets ; et les émissaires n’eurent pas le courage de nous en empêcher. Alors, nous nous engageâmes dans le désert avec d’autant plus de difficulté, que de temps en temps nous enfoncions dans la neige, tantôt jusqu’à la poitrine, et tantôt jusqu’aux épaules. Pour l’ordinaire, nous en avions jusqu’aux genoux ; souvent nous fûmes obligés de nous traîner de notre long sur la neige, comme si nous nagions : de cette manière, nous enfoncions infiniment moins. Tels étaient les travaux du jour ; la nuit n’était pas propre à nous reposer. Obligés d’étendre un de nos manteaux sur la neige, nous nous couchions dessus, et nous nous couvrions des deux autres le mieux que nous pouvions. La première journée, il neigea si fortement depuis quatre heures après midi jusqu’à la pointe du jour, que nous ne pouvions pas nous voir, quoique nous fussions tous trois côtes à côte. Pour ne pas rester ensevelis sous la neige, nous étions obligés de nous lever et de secouer nos manteaux. Nous avons perdu le sentiment dans différentes parties du corps, principalement aux pieds, aux mains, au visage. Une fois en voulant prendre quelque chose, il me tomba un morceau du doigt ; je ne le sentis pas et ne m’en aperçus qu’en voyant le sang couler le long de ma main. Nos pieds s’enflèrent et devinrent su engourdis, que nous n’aurions pas senti un fer chaud. En outre, nous n’avions plus d’appétit et nous manquions d’eau. Il y avait bien quelques fontaines et la rivière Ganga n’était pas loin, mais tout était couvert ; et pour remédier à notre soif, nous fûmes obligés de manger de la neige. Quand le soleil paraissait, nous la faisions fondre dans un plat d’airain. Nous cheminâmes de cette façon jusqu’à arrivâmes au sommet de toutes ces montagnes où on voit le lac d’où sortent la rivière de Ganga et une autre qui arrose les terres du Thibet. Nous avions alors presque perdu la vue ; mais j’avais moins souffert que mes deux valets, par les soins que j’avais pris. Cependant je restai plus de vingt-cinq jours sans pouvoir lire une lettre de mon bréviaire.
Après ces hautes montagnes, on trouve les immenses plaines du Thibet ; mais malheureusement nous ne pouvions plus rien distinguer ; il nous était même impossible de reconnaître les chemins et les passages fréquentés ; nos yeux fatigués et éblouis ne voyaient partout que du blanc. Alors nous perdîmes les marques et points de reconnaissance qui nous avaient jusqu’alors guidés dans notre marche, et nous désespérâmes d’arriver jamais au terme de notre voyage. Cependant nous n’étions qu’à cinq lieues de la ville royale ; mais ne découvrant qu’une plaine couverte de neige, et manquent de provisions et de forces, nous conférâmes sur ce que nous avions à faire. Cette nuit-là, il fut décidé entre nous, que nos serviteurs s’en retourneraient au village, où nous avions laissé mon compagnon ; ils pouvaient s’y rendre en six jours. Quant à moi, je devais rester au pied de la montagne, blotti dans un coin où la neige serait fondue et où je trouverais une grande pierre pour ma garantir du vent. Le lac dont j’ai parlé m’aurait fourni amplement de l’eau, et j’avais encore assez de provisions pour six à huit jours, en attendant l’arrivée de mon compagnon ou de quelque voyageur qui pourrait me conduire au Thibet.
Dès le grand matin, j’engageai mes serviteurs à partir, el leur recommandant de presser le pas. Pour les encourager et les déterminer, je leur représentais qu’ils connaissaient déjà la route et qu’ils n’avaient qu’à descendre. Mais bientôt, ils fondirent tous en larmes et me dirent qu’ils n’avaient pas le courage de m’abandonner, ni de faire quatre pas sans moi. J’insistai sans rien obtenir, heureusement pour eux, car ils seraient immanquablement morts en route. Je fus donc obligé de retourner sur mes pas avec eux, non sans crainte d’être retenu prisonnier dans ce village. Le chemin me paraissait d’autant plus aisé qu’il n’y avait qu’à descendre. Cependant mes valets eurent beaucoup de mal ; les ampoules de leurs pieds les empêchaient de marcher. Nous nous traînâmes ainsi durant trois jours et demi consécutifs. Vers la fin du jour, nous entendîmes la voix d’un homme qui criait dans le désert et quoiqu’il nous fut impossible de l’apercevoir, nous dirigeâmes nos pas vers l’endroit d’où cette voix partait. Nous rencontrâmes un paysan qui nous donna des nouvelles de mon compagnon. Les habitants de Manà, loin de s’opposer à son départ, voulaient qu’il le hâtât ; ils étaient en outre très inquiets sur mon sort, et regrettaient beaucoup de m’avoir laissé partir seul, parce que le roi les rendrait responsables des accidents qui pourraient m’arriver. Ces nouvelles, et surtout, la convalescence de mon compagnon, me comblèrent de joie. En outre, je ne craignais plus d’être arrêté et retenu prisonnier. Le guide qu’on avait envoyé au-devant de nous, m’assura que les habitants de Manà avaient prié et payé le gouverneur, pour qu’il permit à mon compagnon de venir me joindre. Cet homme était chargé de m’apporter quelques rafraîchissements, de la farine d’orge, du miel, et quelques habits pour nous défendre contre le froid. Après avoir marché trois jours sous sa conduite, nous arrivâmes à trois journées de Manà dans un endroit où il était tombé très peu de neige et où l’on trouvait plusieurs cabanes pour se mettre à couvert. Nous nous y reposâmes quelques jours ; et pendant notre séjour, mon compagnon arriva avec la caravane. Il ne me reconnut que lorsque je lui sautai au col pour l’embrasser. Cependant je me portais alors mieux que jamais, et je n’avais d’autre incommodité qu’une grande faiblesse d’yeux qui ne me permettait pas de supporter la lumière. Mais les naturels mêmes du pays qui nous accompagnèrent, n’étaient pas beaucoup mieux. Ils souffraient infiniment, malgré les instruments dont ils se servent pours se garantir de la réverbération du soleil sur la neige. Nous restâmes un mois et demi dans cet endroit pour attendre la fonte des neiges, ensuite nous prîmes le chemin par lequel j’avais déjà passé ; mais il était alors praticable.
Le roi du Thibet était déjà informé de notre arrivée, et sachant que nous venions d’un pays très éloigné, il avait donné ordre aux chefs de la caravane de prendre soin de nous, et qu’on me fit entendre qu’il me procurerait tout ce que je voulais de son empire. Trois jours avant notre arrivée, nous reçûmes de sa part trois chevaux, pour moi, pour mon compagnon et notre valet. Ils ne pouvaient venir plus à propos ; car à notre arrivée dans la ville, le peuple se précipitait en foule autour de nous, et toutes les femmes étaient aux fenêtres pour nous voir comme des objets extrêmement rares et curieux.
António de Andrade, S.J. Avec son frère en religion Manuel Marques, ils ouvriront en 1626 une mission à Tsaparang, capitale du royaume Gugé dans le Tibet occidental.
1625 à 1637
Dernière épidémie de peste : Qu’un seul jour de ce mois (juin) on compta mille cinq cents cadavres sur le pavé causant une puanteur suffocante ; il en décédait alors vingt huit d’un soleil à l’autre (…) De tant de morts ou malades, on n’a pas eu le moyen d’en secourir cinq cents…
Dominique de Lautaret, docteur de l’Université de Montpellier, à propos de la peste à Digne en l’an 1629
À Toulouse, où, de 1628 à 1631, la peste fit plus de 50 000 victimes, on mit la main sur quatre malfrats qui profitaient de l’épidémie pour s’introduire dans les maisons abandonnées et contaminées, et détrousser les cadavres et les moribonds, et ce, sans être le moins du monde inquiétés par le redoutable fléau.
Quatre voleurs y furent convaincus, lors de l’ancienne grande peste, qu’ils alloient chez les pestiférés, les étrangloient dans leur lit et après voloient leurs maisons. Ce pourquoy ils furent condamnés à estre brûlés vifs et, pour qu’on leur adoucit la peine et éviter d’estre pendus, ils découvrirent leur secret.
Archives du Parlement de Toulouse
La recette venait des Franciscains : c’était macérât de vinaigre composé de nombreuses plantes aromatiques : absinthe, romarin, sauge, menthe, rue des jardins, lavande, acore odorant cannelle, girofle, muscade, ail camphre. Ils s’en enduisaient le corps et en répandaient autour d’eux avant de commettre leurs méfaits.
Le vinaigre des 4 voleurs [il aurait été plus honnête de le nommer vinaigre des Franciscains, mais probablement moins vendeur], tel qu’il fut composé par les médecins lors de la peste de Marseille, est un excellent préservatif contre tout air contagieux. Il faut en mettre dans le creux de la main, échauffer la liqueur puis la respirer et s’en frotter les tempes. On peut en boire à jeun une cuillerée à café dans un verre lorsqu’on est obligé d’approcher les personnes atteintes de maladies pestilentielles. Ce vinaigre est particulièrement recommandé contre les maladies des gens de mer, contre l’air infect et corrompu qu’on ne respire que trop souvent dans les vaisseaux.
31 07 1626
La Déclaration royale de Nantes ordonne la destruction des châteaux forts sans utilité stratégique.
18 11 1626
Le pape Urbain VIII consacre la basilique Saint Pierre de Rome. Wikipedia donne un très bon récit de sa construction. Les architectes se sont succédés, non qu’ils aient été renvoyés, mais simplement parce qu’ils arrivaient à la fin de leur vie et donc mouraient… la décision de la construction avait été prise 120 ans plus tôt …
Une succession de génies, tous plus talentueux les uns que les autres… Bramante, Giovano da Sangallo, Giovanni Giocondo, Raphaël, Baldassare Peruzzi, Antonio da Sangallo le jeune, Michel Ange, Sangallo, Vignola, Giorgio Vasari, Carlo Maderno ; en 1602, Nicola Zabaglia, maître maçon pour la coupole, Giovanni Poleni, physicien, pour la coupole, Francesco Borromini pour le baldaquin, Luigi Vanvitelli, architecte pour l’ensemble, Giacomo della Porta et Domenico Fontana, pour la construction du dôme.

_________________________________________________________________________________________________
[1] Ainsi nommées à tort, mais entérinons l’erreur puisque c’est sous ce nom qu’elles sont le mieux connues. Réduction est inapproprié… les espagnols pueblos ou portugais aldeas conviennent mieux… quant au Paraguay, il est très marginal dans l’affaire, puisque les territoires concernés correspondent aux Misiones et Corrientes, régions de l’actuelle Argentine, et au Parana et Rio Grande Do Sul, régions de l’actuel Brésil. En gros, au nord du Rio de la Plata, un triangle dont la pointe sud se trouve au nord de Montevideo, Asuncion à l’ouest et Porto Alegre à l’est.
[2] C’est le thème de la pièce de théâtre Sur la terre comme au ciel, de l’allemand Fritz Hochwälder, – 1952 – , et encore des films Mission de l’Anglais Roland Joffé en 1981, avec Robert de Niro, puis République Guarani du Brésilien Silvio Back en 1986.
[3] On estime le nombre de morts à 2 071 000, plus que les 1 869 000 des guerres napoléoniennes. La Traité de Westphalie reconnaissait aux Habsbourg le droit de ne tolérer dans leurs possessions que la religion catholique.
[4] Le bonhomme, dans la catégorie escroc, était une sacrée pointure : né en 1583 dans le luthéranisme, il avait commencé par se convertir au catholicisme pour faire carrière dans l’armée impériale, épousé ensuite une très riche veuve, s’était approprié une bonne partie des biens des Tchèques tuées à la bataille de la Montagne Blanche, et avait pu ainsi passer marché avec l’empereur pour lui proposer son armée personnelle. Renvoyé en 1630 car devenu trop puissant, il fut assassiné en 1634. Dans Wallenstein. 1799, Schiller lui prêtera une noblesse d’âme que les faits ont sans cesse infirmée :
Il ne sera pas dit de moi que j’ai
Démembré l’Allemagne et l’ai vendue
À l’étranger pour me tailler ma part.
Je veux que l’empire respecte en moi son protecteur,
Le prince d’empire que je suis veut s’asseoir
Dignement auprès des princes impériaux.
Je ne souffrirai pas qu’un État étranger
Prenne pied dans l’Empire.
Les Goths moins que tout autre, ces crève-misère
Qui lorgnent de leurs regards avides et envieux
Les biens de notre belle Allemagne.
Je veux qu’ils m’aident dans mes projets
Sans rien avoir à se mettre sous la dent
[5] Ce sont deux agents de la Compagnie anglaise des Indes orientales, le colonel Watson et le vice-résident Weeler, qui, au début du XVIII° siècle, commenceront à exporter l’opium du Bengale en Chine : 150 ans plus tard l’affaire sera devenue si florissante que les Anglais ne reculeront pas devant une guerre pour l’imposer de façon officielle à la Chine.
