| Publié par (l.peltier) le 18 octobre 2008 | En savoir plus |
17 07 1830
Barthélemy Thimonnier, tailleur à Amplepuis, invente la machine à coudre. En 1848, il cédera le brevet à l’américain Singer.
25 07 1830
Quatre ordonnances de Jules de Polignac limitant le droit de vote et la liberté de la presse vont balayer le régime en trois jours de violents combats – les 27, 28 et 29 juillet, les Trois Glorieuses -. Pour s’armer, les émeutiers avaient pillé le musée de l’Artillerie et c’est ainsi que, dans cette insurrection du XIX° siècle, on vit briller le casque de Godefroi de Bouillon, l’arquebuse à mèche de Charles IX et la lance de François I°.
Louis Blanc. Histoire de dix ans.
La monarchie est à la Chambre, l’usurpation au Palais Royal (la résidence du duc d’Orléans, futur Louis-Philippe I°), la république à l’Hôtel de Ville. […] Encore un gouvernement qui se jette des Tours de Notre Dame.
Chateaubriand
Il est des destins qui se nouent autour d’un moment, parfois quelques minutes, parfois quelques heures, voire même quelques jours, mais le après ne sera plus jamais comme l’avant : Jeanne d’Arc en 1429 quand elle reçut mission de bouter les Anglais hors du royaume de France, Claudel quand la foi l’illuminera à Notre Dame de Paris à Noël 1886, de Gaulle quand le destin l’appellera à Londres le 17 juin 1940. Pour l’heure, ce sont les Trois Glorieuses qui vont nouer celui de Jules Michelet, 32 ans, qui va être nommé directeur de la section historique des Archives Nationales : ce sera la monumentale Histoire de la France, dix-sept volumes de 1833 à 1867 !
Cette œuvre laborieuse d’environ quarante ans fut conçue d’un moment, de l’éclair de juillet. Dans ces jours mémorables, une grande lumière se fit, et j’aperçus la France.
Elle avait des annales, et non point une histoire. Des hommes éminents l’avaient étudié, surtout au point de vue politique. Nul n’avait pénétré dans l’infini détail des développements divers de son activité (religieuse, économique, artistique etc…) Nul ne l’avait encore embrassé du regard dans l’unité vivante des éléments naturels et géographiques qui l’ont constituée. Le premier je la vis comme une âme et comme une personne.
Jules Michelet. Préface de l’Histoire de France 1869
Roland Barthes dira bien plus tard : Michelet n’écrit pas l’Histoire, il la broute.
30 07 1830
Robert Schumann, 20 ans, écrit à sa mère [son père est mort quatre ans plus tôt] : Ma vie a été une longue lutte de vingt ans entre la poésie et la prose, ou si tu veux entre la musique et le droit. À Leipzig, j’ai rêvé et flâné, ici [Heidelberg] j’ai travaillé davantage, mais ici comme là-bas, je me suis irrémédiablement voué à l’art. Si je puis suivre mon génie, il me conduira à l’art, et, je le crois, sur le bon chemin. Sa mère s’oppose à son choix. Il demande à son professeur, Friedrich Wieck, d’intercéder en sa faveur : il écrit on ne peut plus clairement à Christina Schumann : Je prends la responsabilité de votre fils qui, grâce à son talent et à sa personnalité, deviendra l’un des plus grands pianistes de notre temps. Il épousera sa fille Clara, virtuose du piano, son interprète favorite. À la fois pauvre et riche, abattu et vigoureux, las de la vie et plein d’ardeur. Pour perfectionner l’agilité des autres doigts, il s’était confectionné une attelle mariant annulaire droit et majeur, ce qui aboutit à une paralysie définitive de la main ! Il eut sept enfants mais cette vie familiale de bonheur ne put empêcher les poisons de la folie de le conduire à la mort : il avait 46 ans.
2 08 1830
Charles X abdique, laissant le trône à son petit fils de 10 ans, le duc de Bordeaux, lequel en exil, prendra le titre de comte de Chambord, car propriétaire du château éponyme ; Louis Philippe d’Orléans va s’empresser de s’asseoir sur cette disposition, ce sera lui le roi et le comte de Chambord passera sa vie en exil, son intransigeance obtuse le détournant de toutes les occasions de remonter sur le trône. Enveloppés d’un drapeau tricolore, La Fayette, commandant à 73 ans de la Garde nationale, et Louis-Philippe d’Orléans s’embrassent devant une fenêtre de l’Hôtel de Ville,
Le baiser de La Fayette fit un roi. Chateaubriand.
Le Roi des Français ne pouvait supporter le terme républicain : aussi le parti qui se réclamait de la république dût-il choisir un autre nom : ils devinrent les Radicaux. Son arrière grand père était le frère de Louis XIV. Il sauva de la ruine le château de Versailles en en faisant un musée consacré à toutes les gloires de la France.
Chateaubriand s’avance en éclaireur sur le front du droit d’ingérence : Le mélange des gouvernements représentatifs et des monarchies absolues ne saurait durer : il faut que les uns ou les autres périssent ; … la douane d’une frontière ne peut, désormais, séparer la liberté de l’esclavage ; un homme ne peut plus être pendu de ce coté-ci d’un ruisseau, pour des principes réputés sacrés de l’autre coté du ruisseau.
4 10 1830
La Belgique, avec, à sa tête, Charles Rogier, proclame son indépendance, mettant ainsi fin à son appartenance aux Pays-Bas de Guillaume I° dont le fils, Frédéric, à la tête de 14 000 hommes avait dû reculer face aux émeutiers de Bruxelles ; il s’était replié sur Anvers où, rebelote, il dut affronter de violents combats. Un congrès national est élu afin d’établir une nouvelle constitution. C’est en 1915, au congrès de Vienne qu’avait été entérinée cette union Belgique-Hollande dans laquelle les Alliés voyaient une barrière contre l’expansionnisme français.

Épisode des journées de septembre 1830 où l’on reconnaît Louis de Potter embrassant le drapeau belge, Gustave Wappers (1834), musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.
Dans les années 2020, on pourra entendre Virginie Effira déclarer : Et puis, que voulez-vous, j’ai passé vingt-cinq ans de ma vie en Belgique, donc je ne peux pas être totalement sérieuse.
15 10 1830
Lamennais, Lacordaire, tous deux prêtres et le comte de Montalembert créent L’Avenir, quotidien inspiré par le catholicisme libéral. Moins de deux ans plus tard, l’encyclique Mirari vos de Grégoire XIV condamnera les orientations du journal. Lamennais quittera l’Église en 1834. Lacordaire y restera, entrera chez les Dominicains, qu’il rétablira en France, et finira sa vie en dirigeant le collège militaire de Sorrèze, près de Revel, devenu aujourd’hui hôtel.
Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
Cette citation, extraite des Conférences de Notre-Dame de Paris s’insère bien dans une défense de la loi mais c’est de la loi divine qu’il s’agit et, plus précisément de celle que Moïse, descendant du Sinaï, rapportait à son peuple […] : Tu sanctifieras le septième jour, et tu t’y reposeras. C’est du repos dominical qu’il est question.
Elle sera mise en exergue de nombreux ouvrages de droit, surtout la dernière partie – c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit – ces chers professeurs ne reculant pas devant ce qui est à l’évidence tout proche de l’escroquerie intellectuelle : comment peut-on laisser supposer que loi divine et loi humaine soient une seule et même chose ?
27 10 1830
Julius August Walther von Goethe, 41 ans, meurt en Italie de la petite vérole : quand son père Johann Wolgang von Goethe, 80 ans, l’apprendra, il aura ces sobres mots : Allons ! par-dessus les tombeaux… en avant. Et il se remettra au travail.
29 11 1830
Devant la prétention du tzar Nicolas I° à vouloir lever des troupes en Pologne pour intervenir en Belgique, les cadres de l’armée polonaise se révoltent. Le 25 janvier 1831, la Diète déclare l’indépendance de la Pologne. Les Russes vont écraser l’insurrection et Varsovie capitulera en septembre 1831 : dissolution de l’armée, fermeture de l’université, abolition de la Constitution, destruction de l’industrie et du commerce, pendaisons, confiscations, déportations en Sibérie et dans le Kouban – rive nord-est de la Mer Noire -. Dix mille personnes émigreront, dont les deux tiers à Paris.

Le Prométhée polonais, 1831 – Emile Jean Horace Vernet. Paris. Société historique et littéraire polonaise.
1830
Huit ans plus tôt, Adèle Foucher a épousé Victor Hugo, son ami d’enfance. Ils ont eu cinq enfants :
- Léopold Victor Hugo ( – ) ;
- Léopoldine Hugo(28 août 1824-4 septembre 1843) ;
- Charles Hugo ( – ) ;
- François Victor Hugo ( – ) ;
- Adèle Hugo ( – ).
Elle est lasse de toutes ces grossesses, – l’air se fait rare autour de cet homme encombrant – et va voir ailleurs si l’herbe est plus verte et c’est dans le pré de Sainte Beuve qu’elle le trouve. Hugo, de son côté, s’éprend de Juliette Drouet, qui joue au théâtre de la Porte Saint Martin, qui sera sa compagne jusqu’à la fin de sa vie, exil à Guernesey inclus.
Dix-neuf ans avant la France, Charles Félix, Roi de Piémont Sardaigne, met en service les premiers timbres poste : les cavalini. Diffusion de la cigarette. Positivisme d’Auguste Comte. Première ligne ferroviaire commerciale entre Manchester et Liverpool.
Le voyage en chemin de fer à grande vitesse n’est pas possible car les passagers, incapables de respirer, mourraient par asphyxie.
Dionysius Lardner
La France compte 572 machines à vapeur, 29 hauts-fourneaux au coke, 379 au charbon de bois ; elle extrait 2,5 millions de tonnes de houille. C’est environ un tiers des nouveau-nés qui est abandonné.
François Guizot crée un poste d’Inspecteur des Monuments Historiques, qui sera confié en 1834 à l’écrivain Prosper Mérimée. Il entreprendra un premier classement, et sera aidé à partir de 1837 par une commission des Monuments historiques, que rejoindront en 1907 des architectes en chef des Monuments historiques. Auparavant, Prosper Mérimée avait voyagé en Espagne, où il avait découvert, plus de vingt ans avant qu’Eugénie de Montijo ne les importe en France, les combats de taureaux – le mot corrida n’existait pas encore -. C’était devenue un loisir très populaire depuis quelques dizaines d’années seulement, quand des employés des abattoirs s’étaient mis à faire évoluer leur travail d’abattage en jeu qui s’était peu à peu ritualisé, enjolivé et popularisé :
Madrid, 25 octobre 1830,
Monsieur,
Les courses de taureaux sont encore très en vogue en Espagne ; mais, parmi les Espagnols de la classe élevée, il en est peu qui éprouvent une espèce de honte à avouer leur goût pour un genre de spectacle certainement fort cruel ; aussi cherchent-ils plusieurs graves raisons pour le justifier. D’abord, c’est un amusement national. Ce mot national suffirait seul, car le patriotisme d’antichambre est aussi fort en Espagne qu’en France. Ensuite, disent-ils, les Romains étaient encore plus barbares que nous, puisqu’ils faisaient combattre des hommes contre des hommes. Enfin, ajoutent les économistes, l’agriculture profite de cet usage, car le haut prix des taureaux de combat engage les propriétaires à élever de nombreux troupeaux. Il faut savoir que tous les taureaux n’ont point le mérite de courir sus aux hommes et aux chevaux, et que sur vingt, il s’en trouve à peine un assez brave pour figurer dans un cirque, les dix-neuf autres servant à l’agriculture. Le seul argument que l’on n’ose présenter et qui serait pourtant sans réplique, c’est que, cruel ou non, ce spectacle est si intéressant, si attachant, produit des émotions si puissantes, qu’on ne peut y renoncer lorsqu’on a résisté à l’effet de la première séance. Les étrangers, qui n’entrent dans le cirque la première fois qu’avec une certaine horreur, et seulement afin de s’acquitter en conscience des devoirs de voyeurs, les étrangers, dis-je, se passionnent bientôt pour les courses de taureau autant que les Espagnols eux-mêmes. Il faut en convenir, à la honte de l’humanité, surtout pour ceux qui la contemplent à l’abri.
Saint Augustin raconte que, dans sa jeunesse, il avait une répugnance extrême pour les combats de gladiateurs, qu’il n’avait jamais vus. Forcé par un de ses amis, de l’accompagner à une des ces pompeuses boucheries, il s’étai juré à lui-même de fermer les yeux pendant tout le temps de la représentation. D’abord, il tint assez bien sa promesse et s’efforça de penser à autre chose ; mais, à un cri que poussa tout le peuple en voyant tomber un gladiateur célèbre, il ouvrit les yeux ; il les ouvrit et ne put les refermer. Depuis lors, et jusqu’à sa conversion, il fut un des amateurs les plus passionnés des jeux du cirque.
Après un aussi grand saint, j’ai honte de me citer ; pourtant vous savez que je n’ai pas les goûts d’un anthropophage. La première fois que j’entrais dans le cirque de Madrid, je craignis de ne pouvoir supporter la vue du sang que l’on y fait libéralement couler ; je craignais surtout que ma sensibilité, dont je me méfiais, ne me rendit ridicule devant les amateurs endurcis qui m’avaient donné une place dans leur loge. Il n’en fut rien. Le premier taureau qui parut fut tué ; je ne pensais plus à sortir. Deux heures s’écoulèrent sans le moindre entracte, et je n’étais pas fatigué. Aucune tragédie au monde ne m’avait intéressé à ce point. Pendant mon séjour en Espagne, je n’ai pas manqué un seul combat, et, je l’avoue en rougissant, je préfère les combats à mort à ceux où l’on se contente de harceler des taureaux qui portent des boules à l’extrémité de leurs cornes. Il y a la même différence qu’entre les combats à outrance et les tournois à lance mornées. Pourtant, les deux espèces de courses se ressemblent beaucoup ; mais seulement, dans la seconde, le danger pour les hommes est presque nul.
Prosper Mérimée. Les combats de taureaux en 1830. Lettres d’Espagne, 1831

Alfred Dehodencq. Course de taureaux au Novillada à l’Escurial. 1850 Musée Goya de Castres.
Peu avant que le Japon ne s’ouvre au monde occidental le Japonais Hokusai (qui signifie étoile polaire : celle qui ne bouge pas) réalise une série d’estampes Les trente-six vues du Mont Fuji, dont La Grande vague de Kanagawa, qui marquera beaucoup les Impressionnistes. En fait, quarante six estampes, et ces quelques mots, à la fin :
Depuis l’âge de six ans, j’avais la manie de dessiner la forme des objets. Vers l’âge de cinquante ans, j’avais publié une infinité de dessins, mais tout ce que j’ai produit avant l’âge de soixante-dix ans ne vaut pas la peine d’être compté. C’est à l’âge de soixante-treize ans que j’ai compris à peu près la structure de la nature vraie, des animaux, des herbes, des arbres, des oiseaux, des poissons et des insectes. Par conséquent, à l’âge de quatre-vingt ans, j’aurai fait encore plus de progrès ; à quatre-vingt dix ans, je pénètrerai le mystère des choses ; à cent ans, je serai résolument parvenu à un degré de merveille, et quand j’aurai cent dix ans, chez moi, soit un point, soit une ligne, tout sera vivant. Je demande à ceux qui vivront autant que moi de voir si je tiens parole.
Gakyōjin. (Le vieillard fou de dessin), 1835. (Il mourra en fait à 89 ans)
Il ne faisait pas bon vivre alors au Japon, sous le totalitarisme des samouraï qui avaient pour dicton : le clou qui dépasse appelle le marteau. Un film, Hokusai, sortira en mai 2023.

La Grande vague de Kanagawa. Hokusai. Gravure sur bois nishiki-e. Hauteur 25.7 cm; Largeur : 37.9 cm

Le modèle. symétrique. Photo fournie par Gentside en 2023
Aux États-Unis, Joseph Smith fonde l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, soit, plus brièvement les Mormons : il dit avoir découvert dans l’État de New York des saintes écritures gravées sur des plaques d’or, qu’il nommera Le Livre des Mormons. L’Église est très exigeante avec ses fidèles : un dixième de leurs revenus, des services de trois heures chaque dimanche, le renoncement à l’alcool, au café, au thé au tabac, mais…. la polygamie est autorisée. Ceci compense-t-il cela ?
Simple coïncidence ? Dans les mêmes États-Unis, le féminisme connaît de vigoureux commencements : Je ne demande aucune faveur particulière pour mon sexe. Je n’abandonnerai pas notre revendication d’égalité. Tout ce que je demande à nos frères, c’est qu’ils lèvent le pied de dessus nos têtes et qu’ils nous permettent de nous tenir debout sur la terre que Dieu nous a, à nous aussi, confiée. (…) Il est parfaitement clair à mes yeux que tout ce qu’un homme a moralement le droit de faire, la femme y est également autorisée.
Sarah Grimké
Lucas Alaman, premier ministre du Mexique, veut donner à son pays les moyens d’une industrialisation : il crée pour cela une banque nationale, la Banque d’Équipement. Un impôt sur les importations textiles permettra d’acheter les machines à tisser le coton, jusqu’alors exporté à l’état brut : 14 ans plus tard, les grands tissages de Puebla fabriquaient 1.4 million de coupes de cotonnades rustiques, plus que la demande du marché intérieur. Encore dix ans plus tard, l’instabilité politique, les pressions des commerçants anglais et français et de leurs puissants associés à l’intérieur du pays auront eu raison de ce début réussi d’industrialisation.
Le souffle de la liberté, de l’égalité et de la fraternité se fait sentir jusqu’à la tête de l’empire ottoman : Je fais la distinction entre mes sujets, les musulmans à la mosquée, les chrétiens à l’église et les juifs à la synagogue, mais il n’y a pas de différence entre eux dans quelque autre mesure. Mon affection et mon sens de la justice pour tous parmi eux est fort et ils sont en vérité tous mes enfants.
Mahmoud II, sultan de l’empire ottoman.
D’avril à novembre, Victor Jacquemont, botaniste explore la flore de l’Himalaya : il en rapporte 2 158 plantes, dont le pavot, présent dans chaque jardin familial. Il mourra du choléra à Bombay à 31 ans.
Les Anglais se prennent à nommer hindouisme le mode de vie des hindous, et l’on verra que les mots peuvent devenir des bombes : Quand vous ne tracez pas vous-même vos frontières, soyez tranquille, on s’en chargera pour vous… Il est vrai qu’hindous et musulmans, pendant de longues périodes, ont cohabité paisiblement en Inde. Oui, mais seulement jusqu’à l’arrivée des Anglais. Jusqu’à ce que l’étranger anglican invente l’hindouisme, mot qui n’apparaît qu’en 1830. Le way of life hindou a trois millénaires, la religion hindouiste est une création anglaise qui n’a pas deux siècles. La religion des Hindous n’a pas de mot pour religion, comme la plupart des cultes africains, si concrètement imbriqués dans la vie quotidienne que les enquêtés dans les villages ne comprennent simplement pas la question qui leur est posée par les préposés au recensement venus de la capitale (quelle est votre religion ? ). On connaît en Asie community, en Afrique tribu, on ne connaît pas religio, catégorie romano-chrétienne exportée chez les non-chrétiens par la grâce coloniale du principe de classement, entre le normal et l’anormal. Nous vivons notre identité de l’intérieur dans l’insouciance, et souvent comme un tremplin de liberté, pour d’heureux renouvellements. Arrive l’autre qui gèle le jeu, et vous boucle dans une case. Ce n’est pas qu’il soit particulièrement malveillant. C’est qu’il ne peut lui-même se doter d’un corps propre sans nous en donner un autre, sans construire la dissemblance de son voisin le plus semblable. Moi-même et l’autre, c’est un seul baptême en double. Rien de tel, pour faire du pieux, que de montrer du doigt l’impie, la fabrication imaginaire de l’étranger fait partie intégrante de la délimitation pratique d’un nous.
Nos identités personnelles s’échangent dans un chassé-croisé d’expectorations excommuniantes, un collage d’ismes dans le dos où chacun n’en peut mais. Son alter ego lui en trouvera toujours un pour son service. Christianisme a été inventé par un antichrétien d’Antioche, marxisme par un antimarxien de Paris. L’isme est en général un sobriquet fabriqué par un type bien pour dévaluer un sale type, ou encore par un colon pour construire son objet d’étude, et mieux s’approprier l’objet de ses convoitises. Confucianisme n’est pas un terme chinois. C’est l’invention des missionnaires jésuites au XVII° siècle. Le cléricalisme, voilà l’ennemi : avec ce slogan, Gambetta a reconstruit la République. Et l’Église catholique déclinante au début du XX° siècle s’est revigorée en combattant le laïcisme. Le mot en isme est un fortifiant, il nous donne du noir pour nous laver plus blanc. Au forum, chacun a intérêt à affubler le voisin d’une cocarde repoussante pour afficher par contraste sa bonne mine (progressistes/nationalistes, souverainistes/européistes, fascistes/droits de l’hommiste, ad libitum). Portons au crédit de feu la passion politique ce procédé expéditif de classification, substitut aux boussoles confessionnelles, d’avoir jadis prêté à des millions de sinistrés une identité light, et donc le moyen de s’orienter dans le chaos. Jusqu’au jour où, pris à la gorge, le léger se fissure et le lourd remonte.
[…] Rappelons-nous que polythéisme n’est pas un mot grec ou romain, mais probablement l’invention d’un juif hellénisé du I° siècle, Philon d’Alexandrie. Comme monothéisme n’est pas un mot juif, chrétien ou musulman, mais l’invention d’un sceptique. À Athènes, Jérusalem et Rome, on n’était pas plus monothéiste ou polythéiste que nous ne sommes gravitationnistes parce que la gravitation nous retient pieds sur terre. On vivait dans la lumière naturelle des rites et des pratiques, sans isme superfétatoire.
Régis Debray. Le feu sacré. Fayard 2003
L’opinion que l’on se fait du Savoyard en France ne s’encombre pas de circonlocutions : Qui ne sait que, dans l’étranger, le nom de Savoyard ne signifie plus un individu né en Savoie, mais qu’il n’indique plus autre chose, puisqu’il faut le dire, qu’un décrotteur, un ramoneur, un porteur de marmottes, un commissionnaire, de quelque pays qu’il soit, car la plupart de ces individus n’appartiennent pas à notre pays. Et par l’effet de cette habitude d’associer constamment l’idée d’une basse profession au nom de Savoyard, ce nom ne représente plus au yeux des étrangers qu’un individu quelconque, grossier, sans éducation et sans instruction.
Mémoires de la Société Académique de Savoie. 1830. G.M. Raymond.
Monsieur Raymond, malheureusement pour les Savoyards, n’était pas atteint du tout de paranoïa, et il avait largement de quoi justifier son constat, car il s’agit bien d’un état d’esprit général… dès 1830 et encore 50 ans et 100 ans plus tard. Qu’on en juge :
Les Savoyards sont des décrotteurs.
Dictionnaire Étymologique de la Langue Française, Paris 1829.
Savoyard : Homme sale, grossier et brutal, on emploie le mot Savoyard par mépris.
Dictionnaire Universel. Paris 1834.
Savoyard : Dans un langage très familier on emploie ce mot pour désigner un homme grossier, rustre.
Dictionnaire des Dictionnaires. Paris 1837.
Un Savoyard est un rustre.
Dictionnaire Historique, Étymologique et Anecdotique de l’Argot Parisien, Paris 1873.
Il peut arriver que l’on rencontre un fonctionnaire français, ouvert, honnête et qui, de plus, sait de quoi il parle : aussitôt, le son de cloche est différent, et il fait de son mieux pour gommer le mépris : Savoisiens, Savoyards.- Les habitants de la Savoie sont désignés généralement sous le nom de Savoisiens. – L’épithète de Savoyard n’est plus prise aujourd’hui qu’en mauvaise part.
Advielle. Vocabulaire explicatif des principales appellations et locutions en usage, en Savoie, dans le langage administratif et judiciaire. Vers 1875
Un Savoyard est un saligaud, sale comme un ramoneur.
Dictionnaire Provençal-Français de Frédéric Mistral, Paris, 1879
Il se dit populairement d’un homme grossier : c’est un Savoyard. Savoyarde : petite barque chargée de fumier.
Dictionnaire de la langue française. Paul Émile Littré. Paris 1883
On emploie, dans la Somme, le terme de Sâvoyâr (sic) pour désigner l’écouvillon qui sert à nettoyer les fours des boulangers.
Atlas Linguistique de la France, Paris 1910
À Lyon, dans la Confrérie des Canuts (ouvriers du tissage) un Savoyard est un contrepoids suspendu à l’une des extrémités du rouleau sur lequel est monté le poil des velours frisés et des velours coupés.
Dictionnaire Historique de la Langue Française, Paris 1992
L’ancien cuistot, noir comme un Savoyard, passait ses pouvoirs.
Roland Dorgelès. Les Croix de Bois. 1919
Un capon ! un Savoyard ! un Paltroquet ! une Canaille ! Et un bédouin ! Savoyard de bédouin !
Eugène Labiche. Deux Merles Blancs, Acte III Scène 7. 1858
Tiens, polognard, soûlard, bâtard, hussard, tartare, calard, cafard, mouchard, savoyard, communard !
Alfred Jarry. Ubu Roi, Acte V Scène 2. 1896
Le terme de Savoyard, à la consonance péjorative, n’a pas été inventé par des républicains pressés de mettre au pas les habitants d’une province annexée, soucieux avant tout du maintien de leurs privilèges : dès 1647, on trouve le terme :
Il fût résolu dans une assemblée de trois mille hommes tous armés, qu’on ne les appellerait plus Savoyards mais Savoisiens.
Favre de Vaugelas. Remarques sur la Langue Française, 1647
Cette terminaison péjorative commença par être appliquée aux montagnards, tant que la montagne n’inspirait guère que la crainte. L’aspect péjoratif du terme se perdit à la fin du XVIII°, quand elle commença à plaire. Si la consonance péjorative du terme Savoyard a aujourd’hui disparu, elle a eu tout de même la vie dure. La France n’apprécie d’ailleurs pas du tout qu’on appose cette terminaison en ard à ses habitants : le caricaturiste Siné fût condamné en 1995 par la 17° chambre du Tribunal de Paris pour avoir publié les termes franchouillard et frankaoui.
Mais il faut bien reconnaître qu’auprès des beaux messieurs, les Bretons sont encore plus mal lotis, et cela commence très tôt : Traître à sa foi, le peuple breton ne conserve de chrétien que le nom : car d’œuvre, de culte, de religion, plus de trace. Nul égard pour les enfants, ni pour les veuves, ni pour les églises : le frère et la sœur partagent le même lit, le frère prend l’épouse du frère ; tous vivent dans l’inceste et dans le crime.
Ernold Le Noir, début IX° siècle.
Les Bretons sont plus pauvres de combinaisons intellectuelles que ne le sont les Mohicans et les Peaux Rouges de l’Amérique septentrionale… ils mènent une guerre dont les atrocités eussent peut-être été reniées par les cannibales… ma femme est comme frappée par la foudre en entendant les sons rauques d’une voix bretonne.
Honoré de Balzac Les Chouans. 1829
Elle eut un air aussi stupide que peut l’être celui d’un paysan breton écoutant le prône de son curé.
Honoré de Balzac La femme de trente ans. 1831
La Bretagne est une colonie comme l’Alsace et les Basques, plus que la Guadeloupe.
Jules Michelet 1831
J’aime la Bretagne, j’y trouve le sauvage, le primitif. Quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j’entends le son sourd, mat et puissant que je cherche en peinture.
Paul Gauguin 1888
Multiplions les écoles, créons pour l’amélioration morale de la race humaine quelques-unes de ces primes que nous réservons aux chevaux ; faisons que le clergé nous seconde en n’accordant la première communion qu’aux enfants qui parleront français… La Basse-Bretagne est une contrée à part et qui n’est plus la France. Elle devrait être soumise à une sorte de régime colonial.
Auguste Romieu, sous-préfet de Quimperlé. 1831
Il faut, par tous les moyens possibles, favoriser l’appauvrissement, la corruption du breton, jusqu’au point où, d’une commune à l’autre, on ne puisse pas s’entendre (…) Car alors la nécessité de communication obligera le paysan d’apprendre le français. Il faut absolument détruire le langage breton.
Les préfets de Côtes du Nord et du Finistère à Monsieur de Montalivet, ministre de l’Instruction Publique. 1831
Croyez-moi, Monsieur, le catalan qui me faisait tant enrager n’est qu’un jeu d’enfant auprès du bas-breton. C’est une langue que celle-là. On peut la parler fort bien, je crois, avec un bâillon dans la bouche, car il n’y a que des entrailles qui paraissent se contracter quand on cause le bas-breton. Il y a surtout l’h et le c’h qui laissent loin derrière la jota espagnole. Les gens qui parlent cette belle langue sont bons diables, mais horriblement sales (…) On voit dans les villages les enfants et les cochons se roulant pêlemêle sur le fumier, et la pâtée que mangent les premiers serait probablement refusée par les cochons du Canigou.
Prosper Mérimée. Lettre à Jaubert de Passa. 1835
Vous saurez d’abord que c’est vers la Bretagne, la douce et la bretonnante, que se sont dirigées mes courses cette année (…) Quant aux naturels du pays, hélas ! c’est la province sans soleil. Croiriez-vous que j’ai fait quatre cents lieues en Bretagne sans déboutonner ma braguette. Impossible de toucher sans pincette les personnes du sexe de Brest, Morlaix, Saint Brieux (sic), Rennes, Vannes, Quimper. Ce n’est qu’à Nantes que la Providence m’a envoyé soulagement (…) Au lieu de votre joli patois dont on comprend toujours quelque chose, c’est une langue que le diable a inventé que l’on parle là-bas.
Prosper Mérimée. Lettre à Requien. 1836
Depuis que je suis en Bretagne, je suis dans l’ordure. Pour se laver de la Bretagne, il faut bien l’Océan. Cette grande cuvette n’est qu’à la mesure de cette grande saleté.
[…] Les assiettes bretonnes sont comme les formations [les couches sédimentaires]. Il faudrait pénétrer plusieurs couches de je ne sais quoi avant d’arriver à la faïence. Si les puces marchaient, elles y laisseraient certainement l’empreinte de leurs petits pieds.
[…] Toute cette Bretagne, au reste, vaut la peine d’être vue. Quelquefois dans une petite bourgade, comme Lassay, par exemple, vous trouvez tout à coup trois admirables châteaux dans le même tas. Pauvre Bretagne ! qui a tout gardé, ses monuments et ses habitants, sa poésie et sa saleté, sa vieille couleur et sa vieille crasse par-dessus. Lavez les édifices, ils sont superbes ; quant aux Bretons, je vous défie de les laver. Souvent, dans un de ces beaux paysages de bruyères, sous des ormes qui se renversent lascivement, sous de grands chênes qui portent leurs immenses feuillages à bras tendu, dans un champ de genêts en fleurs au milieu duquel s’envole à votre passage un énorme corbeau verni qui reluit au soleil, vous avisez une charmante chaumière, qui fume gaiement à travers le lierre et les rosiers ; vous admirez, vous entrez. Hélas, mon pauvre Louis, cette chaumière dorée est un affreux bouge breton où les cochons couchent pêlemêle avec les Bretons. Il faut avouer que ces cochons sont bien sales.
[…] Le fait est que les Bretons ne comprennent rien à la Bretagne. Quelle perle et quels pourceaux !
Victor Hugo. Voyage en Bretagne 1835 Lettres à Adèle et à Louis Boulanger
[…] on entendait sonner les rauques syllabes celtiques mêlées au grognement des animaux et au claquement des charrettes.
[…] Le paysan breton mange comme un porc : il va retrouver sa galette de sarrasin et sa jatte de bouillie de maïs cuite depuis huit jours dont il se nourrit toute l’année, à coté des porcs qui rôdent sous la table et de la vache qui rumine là sur son fumier, dans un coin de la même pièce.
Gustave Flaubert Voyage en Bretagne
Parfois, on en trouve même qui étalent avec suffisance leur ignorance : Les paysans bretons sont tellement crédules qu’ils croient à une influence de la Lune sur les marées.
Francisque Sarcey, dans le journal Le Temps
Dieu merci, on trouve d’autres mots qui font preuve d’intelligence : Entre la terre et la mer s’étalent des campagnes pélagiennes, frontières indécises entre deux éléments : l’alouette de champ y vole avec l’alouette marine ; la charrue et la barque, à un jet de pierre l’une de l’autre, sillonnent la terre et l’eau.
Le navigateur et le berger s’empruntent mutuellement leur langue : le matelot dit les vagues moutonnent, le pâtre dit des flottes de moutons. Des sables de diverses couleurs, des bancs variés de coquillages, des varechs, des franges d’écume argentée dessinent la lisière blonde ou verte des blés.
Chateaubriand. Mémoires d’outre tombe.1849
À l’autre bout, c’est Brest, le grand port militaire, la pensée de Richelieu, la main de Louis XIV ; fort, arsenal et bagne, canons et vaisseaux, armées et millions, la force de la France entassée au bout de la France : tout cela dans un port serré, où l’on étouffe entre deux montagnes chargées d’immenses constructions. Quand vous parcourez ce port, c’est comme si vous passiez dans une petite barque entre deux vaisseaux de haut bord ; il semble que ces lourdes masses vont venir à vous et que vous allez être prises entre elles. L’impression générale est grande, mais pénible. C’est un prodigieux tour de force, un défi porté à l’Angleterre et à la nature. J’y sens partout l’effort, et l’air du bagne et la chaîne du forçat. C’est justement à cette pointe où la mer, échappée du détroit de la Manche, vient briser avec tant de fureur que nous avons placé le grand dépôt de notre marine. Certes, il est bien gardé. J’y ai vu mille canons. L’on n’y entrera pas ; mais l’on n’en sort pas comme on veut. Plus d’un vaisseau a péri à la passe de Brest. Toute cette côte est un cimetière. Il s’y perd soixante embarcations chaque hiver. La mer est anglaise d’inclination ; elle n’aime pas la France ; elle brise nos vaisseaux ; elle ensable nos ports.
Rien de sinistre et formidable comme cette côte de Brest ; c’est la limite extrême, la pointe, la proue de l’ancien monde. Là, les deux ennemis sont en face : la terre et la mer, l’homme et la nature. Il faut voir quand elle s’émeut, la furieuse, quelles monstrueuses vagues elle entasse à la pointe Saint-Mathieu, à cinquante, à soixante, à quatre-vingt pieds ; l’écume vole jusqu’à l’église où les mères et les sœurs sont en prière. Et même dans les moments de trêve, quand l’Océan se tait, qui a parcouru cette côte funèbre sans dire ou sentir en soi : Tristis usque ad mortem ?
C’est qu’en effet il y a là pis que les écueils, pis que la tempête. La nature est atroce, l’homme est atroce, et ils semblent s’entendre. Dès que la mer leur jette un pauvre vaisseau, ils courent à la côte, hommes, femmes et enfants ; ils tombent sur cette curée. N’espérez pas arrêter ces loups, ils pilleraient tranquillement sous le feu de la gendarmerie. Encore s’ils attendaient toujours le naufrage, mais on assure qu’ils l’ont souvent préparé. Souvent, dit-on, une vache, promenant à ses cornes un fanal mouvant, a mené ces vaisseaux sur les écueils. Dieu sait alors quelles scènes de nuit ! On en a vu qui, pour arracher une bague au doigt d’une femme qui se noyait, lui coupaient le doigt avec les dents.
L’homme est dur sur cette côte. Fils maudit de la création, vrai Caïn, pourquoi pardonnerait-il à Abel ? La nature ne lui pardonne pas. La vague l’épargne-t-elle quand, dans les terribles nuits de l’hiver, il va par les écueils attirer le varech flottant qui doit engraisser son champ stérile, et que si souvent le flot apporte l’herbe et emporte l’homme ? L’épargne-t-elle quand il glisse en tremblant sous la pointe du Raz, aux rochers rouges où s’abîme l’enfer de Plogoff, à coté de la Baie des Trépassés, où les courants portent les cadavres depuis tant de siècles ? C’est un proverbe breton : Nul n’a passé le raz sans mal et sans frayeur. Et encore : Secourez-moi, grand Dieu, à la pointe du Raz, mon vaisseau est si petit, et la mer est si grande !
Là, la nature expire, l’humanité devient morne et froide. Nulle poésie, peu de religion ; le christianisme y est d’hier. Michel Noblet fut l’apôtre de Batz en 1648. Dans les îles de Sein, de Batz, d’Ouessant, les mariages sont tristes et sévères. Les sens y semblent éteints ; plus d’amour, de pudeur, ni de jalousie. Les filles font, sans rougir, les démarches pour leur mariage. La femme y travaille plus que l’homme, et, dans les îles d’Ouessant, elle y est plus grande et plus forte. C’est qu’elle cultive la terre ; lui, il reste assis au bateau, bercé et battu par la mer, sa rude nourrice. Les animaux aussi s’altèrent et semblent changer de nature. Les chevaux, les lapins sont d’une étrange petitesse dans ces îles.
Asseyons-nous à cette formidable pointe du Raz, sur ce rocher miné, à cette hauteur de trois cents pieds d’où nous voyons sept lieues de côtes. C’est ici, en quelque sorte, le sanctuaire du monde celtique. Ce que vous apercevrez par-delà la baie des Trépassés [1] est l’île de Sein, triste banc de sable, sans arbre et presque sans abri… Tous ces rochers que vous voyez sont des villes englouties ; c’est Douarnenez, c’est Ys la Sodome, Sodome bretonne ; ces deux corbeaux qui vont toujours volant lourdement au rivage ne sont rien d’autre que les âmes du roi Gradlon et de sa fille, et ces sifflements qu’on croirait ceux de la tempête sont les cris, ombres des naufragés qui demandent la sépulture.
Jules Michelet. Tableaux de la France 1834
J’aime la Bretagne, j’y trouve le sauvage, le primitif. Quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j’entends le son sourd, mat et puissant que je cherche en peinture.
Paul Gauguin. 1888
La vraie cause de l’abandon de la langue bretonne, ce sont les Bretons eux-mêmes qui en portent la responsabilité. Cela fut, à cette époque comme un vent violent qui a balayé toute la Bretagne et a bouleversé de fond en comble les institutions, confondant l’attrait pour la modernité avec la honte des origines, identifiant l’héritage ancestral à la crainte de l’arriération, redoutant la pauvreté abjecte dans laquelle depuis des siècles, les ruraux avaient parfois survécu, et que l’État, craignant les failles identitaires avaient maintenu. (Ce n’est pas pour rien que Gauguin est allé s’installer à Pont-Aven,, où il décrit les Bretons et les petites Bretonnes comme cinq ans plus tard il décrira les Tahitiennes).
[…] Non, il ne faut pas regretter le temps de la paysannerie traditionnelle bretonne, même si cette mémoire laisse un goût doux-amer de ce qui ne pourra plus jamais revenir : les toits de chaume si bellement tressés, les poutres sculptées à l’herminette, les bois flottés récupérés pour les voliges, la terre battue mêlée au sang de mouton pour les sols durs et brillants comme le porphyre, les cheminées monumentales, et tous ces meubles extraordinaires, venus du fond des âges, armoires, lits-clos, tables, bancs, coffres de mariage, et la vaisselle de grès brun accrochée aux clous des vaisseliers, les marmites noires de suie, la bilig pour les galettes, la casserole pour le youd, le porridge d’avoine commun aux Bretons, aux Écossais et aux Gallois.
J.M.G Le Clézio. Chanson bretonne suivi de L’Enfant et la guerre. Deux Contes. Gallimard 2020
L’idéologie crétinisante du Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, sur laquelle s’appuieront plus tard tous les propos et visuels touristiques, n’était pas encore en place et ces opinions devaient se diffuser sans obstacle chez le lecteur. Elles sont souvent blessantes… mais sont-elles fausses ? Le même Victor Hugo qui décoche ses flèches contre les Bretons est à même de tenir des propos on ne peut plus élogieux sur les Basques …
Les ourques, [un ancien gabarit tombé en désuétude], de Biscaye, même les plus pauvres, étaient dorées et peintes. Ce tatouage est dans le génie de ces peuples charmants, un peu sauvages. Le sublime bariolage de leurs montagnes, quadrillées de neiges et de prairies, leur révèle le prestige âpre de l’ornement quand même. Ils sont indigents et magnifiques ; ils mettent des armoiries à leurs chaumières ; ils ont de grands ânes qu’ils chamarrent de grelots et de grands bœufs qu’ils coiffent de plumes ; leurs chariots, dont on entend à deux lieues grincer les roues, sont enluminés, ciselés, et enrubannés. Un savetier a un bas-relief sur sa porte ; c’est saint Crépin et une savate, mais c’est en pierre. Ils galonnent leur veste de cuir ; ils ne recousent pas le haillon, mais ils le brodent. Gaîté profonde et superbe. Les basques sont, comme les grecs, des fils du soleil. Tandis que le valencien se drape nu et triste dans sa couverture de laine rousse trouée pour le passage de la tête, les gens de Galice et de Biscaye ont la joie des belles chemises de toile blanchie à la rosée. Leurs seuils et leurs fenêtres regorgent de faces blondes et fraîches, riant sous les guirlandes de maïs. Une sérénité joviale et fière éclate dans leurs arts naïfs, dans leurs industries, dans leurs coutumes, dans la toilette des filles, dans les chansons. La montagne, cette masure colossale, est en Biscaye toute lumineuse ; les rayons entrent et sortent par toutes ses brèches. Le farouche Jaïzquivel est plein d’idylles. La Biscaye est la grâce pyrénéenne comme la Savoie est la grâce alpestre. Les redoutables baies qui avoisinent Saint-Sébastien, Leso et Fontarabie, mêlent aux tourmentes, aux nuées, aux écumes par-dessus les caps, aux rages de la vague et du vent, à l’horreur, au fracas, des batelières couronnées de roses. Qui a vu le pays basque veut le revoir. C’est la terre bénie. Deux récoltes par an, des villages gais et sonores, une pauvreté altière, tout le dimanche un bruit de guitares, danses, castagnettes, amours, des maisons propres et claires, les cigognes dans les clochers.
Victor Hugo. L’homme qui rit. Gallimard 2002
25 02 1831
En Italie, les insurrections contre les pouvoirs en place, y compris les États Pontificaux se succèdent les unes après les autres : ils viennent de prendre Terni et Spolète : parmi eux, le jeune Louis Napoléon – notre futur Napoléon III -, qui écrit à son père Louis, demi-frère de Napoléon, qui s’est révélé ne pas être en fait son père biologique pour le rassurer : L’enthousiasme de ce pays est ici très grand. […] L’armée des patriotes s’achemine vers Rome qui doit tomber inévitablement avant huit jours. Toutes les troupes du pape sont pour le parti libéral. […] Mon cher papa, au nom du ciel, soyez tranquille, voyez dans l’avenir, voyez tous les peuples de l’Europe qui recouvrent leurs droits et qui sauront les conserver.
À la même période, c’est Giuseppe Mazzini [2], ardent défenseur de l’unité italienne qui a du se réfugier à Marseille, qui écrit à Charles-Felix : Sire, n’avez-vous jamais porté le regard, un de ces regards d’aigle qui découvre un monde, sur cette Italie, belle du sourire de la nature, couronnée par vingt siècles de souvenirs sublimes, patrie du génie, rendue puissante par d’infinis moyens auxquels il ne manque que l’union, entourée de telles défenses qu’une volonté forte et quelques poitrines courageuses suffiraient à la protéger de l’insulte de l’étranger ? […]
Sire ! Repoussez l’Autriche ! Laissez la France […] Mettez-vous à la tête de la nation et écrivez sur votre drapeau UNION, LIBERTÉ, INDÉPENDANCE ! Proclamez la sainteté de la pensée. Déclarez-vous vengeur, interprète des droits du peuple, régénérateur de l’Italie entière ! Libérez la patrie des barbares ! Édifiez l’avenir ! Donnez votre nom au siècle […] Soyez le Napoléon de la liberté italienne […]
9 03 1831
Louis Philippe crée la Légion Étrangère : elle aura pour premier terrain d’exercice l’Espagne de 1835 à 1838, pour y combattre les carlistes.
17 03 1831
Napoléon Louis, frère de Louis Napoléon, de quatre ans son aîné, meurt à 27 ans à Forli, près de Livourne, victime d’une épidémie de rougeole. Son frère n’en sera que malade, que sa maman va rapidement tirer de ce guêpier.
11 04 1831
Création de la caisse des retraites militaires.
27 04 1831
Charles Albert arrive sur le trône de Piémont Sardaigne ; il promulgue d’importantes réformes, en particulier un code civil inspiré de celui de Napoléon.
06 1831
James Clark Ross, toujours basé sur le Krusentern de son oncle John Ross, à Félix Harbor, atteint le pôle nord magnétique par 69°34’N et 94°54′ O sur la côte ouest de l’île Boothia. Il avait quitté l’Angleterre en 1829. Ils hiverneront encore deux ans et rentreront en Angleterre en 1833.
22 07 1831
Révoltées depuis septembre 1830 contre les provinces néerlandaises auxquelles elles avaient été rattachées en 1815, les provinces belges mettent fin à ce statut en devenant une monarchie : le premier souverain belge se nomme Léopold I° de Saxe Cobourg : il a eu la faveur des Anglais, ce qui n’était pas le cas du premier élu, le duc de Nemours, qui avait dû renoncer à la couronne. La Constitution, très libérale, est composée de 40 000 membres, parlant tous exclusivement français, devenu la langue officielle en novembre 1830. La suite de l’histoire sera marquée par le dédain des Wallons, francophones, et la lente montée des revendications des Flamands : S’il est une chose dont le Belge est pénétré, c’est de son insignifiance.[…] Cela, en revanche, lui donne une incomparable liberté – un salubre irrespect, une tranquille impertinence, frisant l’insouciance.
Pierre Ryckmans, alias Simon Leys. Texte inaugural du Studio de l’inutilité, Flammarion 2012, consacré à son compatriote Henri Michaux
21 08 1831
Nat Turner, esclave de 31 ans dans une plantation proche de Jérusalem, petite ville de Virginie, intelligent, cultivé, porté sur le prophétisme religieux 24 h/24, a décidé de se révolter contre ses maîtres. Avec quatre complices il les assassine et part pour une mortelle randonnée, suivi de près de soixante esclaves, qui va coûter la vie à 59 hommes, femmes et enfants. Les Blancs se mettent alors sur le pied de guerre et vont se livrer à une répression aveugle qui tuera des centaines d’esclaves, jusqu’à retrouver, au bout de deux mois, Nat Turner, terré au fond d’une grotte. Il sera pendu le 11 novembre. C’est dans la révolte sanglante de Nat Turner que les affrontements violents à venir entre les communautés blanches et noires puiseront leurs racines.
22 11 1831
Venus de la Croix Rousse, de la Guillottière et de Vaise, les canuts – les ouvriers lyonnais de la soie – occupent la ville que l’armée évacue. Ils ne peuvent plus accepter de voir leurs salaires baisser et se bornent à demander l’application de la réglementation, ce à quoi se refusent certains patrons. À la tête de 20 000 hommes, le maréchal Soult y mettra bon ordre le 5 décembre. Trois ans plus tard, la répression d’une nouvelle insurrection, en réaction contre un projet de loi contre les associations et l’arrestation de six mutualistes, fera plus de 200 morts. L’histoire, celle de l’image d’Épinal, leur attribuera une chanson qui, en fait, ne verra le jour que 60 ans plus tard, écrite et mise en musique par Aristide Bruant vers 1894 :
Pour chanter Veni Creator
Il faut une chasuble d’or.
Nous en tissons pour vous, grands de l’Église
Et nous, pauvres canuts, n’avons pas de chemise,
C’est nous les canuts,
Nous sommes tout nus.
Pour gouverner, il faut avoir
Manteaux ou rubans en sautoir.
Nous en tissons pour vous, grands de la terre,
Et nous, pauvres canuts, sans draps on nous enterre…
Aristide Bruant n’était pas vraiment le personnage immortalisé par Toulouse Lautrec : Costume de velours noir à grosses côtes, écharpe rouge rejetée dans le dos et feutre à larges bords : la silhouette d’Aristide Bruant – telle qu’elle fut immortalisée par le crayon de Toulouse-Lautrec – fait désormais partie de notre mémoire collective. Bien plus, à vrai dire, que sa voix, qui nous est pourtant parvenue par le miracle des premiers enregistrements sur cylindres et des disques 90/100 tours, ancêtres des 78 tours.
Mais, au-delà de la seule silhouette, il y a toute une mythologie Bruant, soigneusement cultivée par le chanteur lui-même, qui veillera toujours à peaufiner son image et sa légende, tout au long d’une carrière courant sur près d’un demi-siècle. Au point que – avec le temps… – le véritable Aristide Bruant s’est progressivement effacé derrière le mythe, tirant un solide rideau de confusion entre la postérité et lui. Et, quitte à écorner un brin l’icône, il faut bien oser reconnaître que, quel qu’ait pu être son talent (au demeurant immense), une bonne part de la popularité du chantre des barrières de Paris repose sur un malentendu, pour ne pas dire une imposture. En effet, sous prétexte qu’il chantait les apaches, les gigolettes, les souteneurs et les filles-mères, et parsemait ses refrains des noms des faubourgs les plus populaires (Belleville-Ménilmontant, À La Glacière, À La Villette, À la Goutte d’Or, etc.), tout en insultant le bourgeois venu s’encanailler chez lui, nombreux sont ceux qui veulent voir en lui un authentique porte-parole du petit peuple de la rue. Une sorte de chroniqueur social, voire de moraliste plus ou moins anarchisant, alors qu’à de rares exceptions près il fit surtout œuvre de caricaturiste.
[…] Né le 6 mai 1851, à Courtenay, dans le Loiret, d’une famille d’honnête bourgeoisie, Aristide Louis Armand Bruand (il changera le d final pour un t ), fréquente le collège jusqu’à l’âge de dix-sept ans, ce qui est assez exceptionnel pour l’époque et le démarque déjà de ce peuple des humbles qu’il se plaira à dépeindre. Engagé volontaire – comme franc-tireur – pendant la guerre de 70, il exercera plusieurs petits métiers (coursier chez un avoué, expéditionnaire à la Compagnie des Chemins de Fer du Nord, etc.) avant de se tourner vers la chanson, qu’il aborde tout d’abord en essayant déjouer la carte du dandysme (jaquette noire, pantalon bois de rose, gilet à ramages, souliers vernis et chapeau tube). Il ne trouvera finalement son véritable style qu’après que Jules Jouy et Arthur Marcel-Legay l’auront introduit au Chat Noir, le fameux cabaret de Rodolphe Salis. Dès lors, son personnage ne variera plus, et lorsque Salis déménage vers des locaux plus vastes (1885), Bruant, qui a envie de voler de ses propres ailes, récupère le lieu pour y créer le Mirliton, dont il confie la décoration à ses amis Steinlen et Lautrec. Rapidement le Mirliton devient l’endroit à la mode, où il est de bon ton de venir finir sa soirée ; et parmi les bourgeois ravis de se faire houspiller par le maître de céans se glisse parfois un grand-duc russe ou le prince de Galles en personne.
Créateur prolifique, doublé d’un excellent homme d’affaires, Bruant fait rapidement ; au point d’acheter le Concert de l’Epoque (futur Pacra) et le château de Courtenay, son village natal, où il finit par se retirer pour mener l’existence prospère d’un hobereau conformiste, élevant son fils dans le culte de l’Armée et de l’Église ; ce qui ne laisse pas de surprendre de la part de l’auteur de À Biribi et de tant de couplets farouchement anticléricaux. Une apparente incohérence qui, pourtant, n’étonnera qu’à moitié ceux qui n’ont pas oublié que le chanteur s’était présenté aux élections législatives, dans le quartier de Belleville, en 1898, c’est-à-dire en pleine affaire Dreyfus, sous l’étiquette : Candidat républicain, socialiste, patriote et antisémite. Un programme pour lequel il ne récoltera que 525 suffrages.
À partir de 1917, profondément affecté par la mort de son fils, tué sur le plateau de Craonne en avril 1917, lors de l’offensive de Nivelle, il ne quitte pratiquement plus Courtenay, mais fait une dernière apparition à l’Empire, en 1924, avant de s’éteindre quelques semaines plus tard, le 11 février 1925.
Marc Robine. Anthologie de la chanson française. Albin Michel 1994
Dans le même temps, les soyeux décrivent l’organisation de leur profession au nouveau préfet, Antoine Gasparin : La production des tissus de soie n’est pas, comme celle des autres tissus, concentrée dans quelques grands ensembles réunissant des masses d’ouvrier […] La production dont il s’agit se répartit, au contraire, entre plusieurs centaines de maisons qui reçoivent en premier lieu, les commandes des mains des commissionnaires, leurs intermédiaires avec les pays de consommation. Elle est ensuite distribuée par chaque maison entre des chefs d’atelier qui, possédant chacun, un ou plusieurs métiers exploités par eux-mêmes ou par des ouvriers logés chez eux, sont de fait à la tête de petites manufactures dont la réunion compose à proprement parler la Fabrique de Lyon.
25 12 1831
Sur l’île de la Jamaïque, d’abord colonie espagnole, puis anglaise, Samuel Daddy Sharpe, diacre noir baptiste, prend la tête d’une grève – en fait une révolte – de 150 esclaves munis de machette. Il va ainsi mobiliser de 60 000 à 300 000 esclaves jusqu’au 4 janvier suivant.
La réponse est, comme à l’accoutumée, d’une violence inouïe : des centaines d’esclaves sont massacrés sur place. Environ 340 sont exécutés selon un rituel épouvantable, ils sont pendus, puis des partie de leur corps sont exposées à l’entrée des plantations. On coupe les têtes, on les plante sur des piquets, parfois on place aussi des bras. Sharpe est pendu, après avoir organisé sa défense au nom de la Bible et de l’égalité entre tous les hommes : rien ne justifie l’esclavage des Noirs par les Blancs, ni des Blancs par les Noirs.
[…] Après plusieurs dizaines de bateaux dans les années 1820, le dernier navire de traite quitte Nantes en 1833. Désormais et jusqu’à la fin du siècle, la traite de contrebande s’organise à partir du Brésil et de Cuba. […] La Grande Bretagne, depuis toujours liée au Portugal par des accords de commerce, toléra la traite au sud de l’équateur jusqu’en 1840, autant dire, si l’on regarde la carte les échanges entre Mozambique, Congo et Angola d’une part, et Brésil d’autre part, puisque celui-ci n’interdit définitivement la traire qu’en 1850.
Catherine Coquery-Vidrovitch. Histoire des traites africaines, VI° – XX° siècle. Espace libre Albin Michel 2018
27 12 1831
Charles Darwin, naturaliste anglais de 22 ans, embarque sur le Beagle et l‘Adventure, pour une expédition de 5 ans sur les côtes de Patagonie, de la Terre de Feu, du Chili et du Pérou. Robert Fitz Roy, propriétaire du Beagle dirige l’expédition ; il en est aussi le mécène et irascible capitaine. Disciple du physionomiste Lavater, il avait failli laisser Darwin à terre, en raison de la forme de son nez, censée traduire un manque d’énergie et de détermination. Et en plus, Darwin est du parti des Whigs alors que lui-même est Tory ! Mais aucun des deux n’étant idiot, ils finiront par s’apprécier. Ils exploreront l’estuaire de la Santa Cruz, reconnu 300 ans plus tôt par le Santiago de l’expédition de Magellan, peu avant d’être jeté à la côte par une tempête. Plus au sud, dans le détroit de Magellan, rien ne trouve grâce à ses yeux, que ce soit la nature elle-même ou les indiens : Les bois étaient si profonds qu’il fallait constamment recourir à la boussole. Les ravins profonds offraient un spectacle de désolation funeste défiant toute description ; à l’extérieur, les bourrasques soufflaient, mais dans ses trous, pas un souffle n’agitait les feuilles des arbres les plus hauts. Les ravins étaient si froids, humides et sinistres que pas même un champignon, de la mousse ou des fougères ne pouvaient y pousser.
[…] ces individus étaient les créatures les plus abjectes et les plus misérables que j’ai jamais vues nulle part […] ces Fuégiens en canoë étaient presque nus ; une femme adulte était même complètement nue. Il pleuvait fort et l’eau douce mêlée aux embruns marins ruisselait sur son corps. Dans un autre port, non loin de là, une femme qui nourrissait au sein un enfant nouveau-né vint un jour près de notre vaisseau et resta là pendant que la neige tombait et fondait sur sa poitrine nue et sur la peau nue de son enfant. Ces pauvres hères étaient retardés dans leur croissance, leur visage hideux barbouillé de peinture blanche, leur peau sale et grasse, leurs cheveux emmêlés, leurs voix discordantes, leurs gestes violents et sans dignité. En voyant de tels êtes, on a du mal à croire qu’ils soient nos frères humains et les habitants du même monde que nous. […] ils n’échappent pas non plus à la famine et, en conséquence, se livrent à une forme de cannibalisme liée au parricide […] ils étaient les seigneurs misérables d’une terre misérable.
Charles Darwin
Cette focalisation sur nos références culturelles est probablement péché de jeunesse. D’autres occidentaux s’installeront dans les parages, à l’heure de la colonisation de la Patagonie par les éleveurs de moutons, qui trouveront à ces Indiens une subtilité que n’avait pas su voir Darwin : ainsi Thomas Bridges, installé à quelques 40 kilomètres de la baie d’Ushuaia : Combien de langues possèdent plus de trente mots pour désigner les vents ? Les Yamanas définissaient chaque chose, chaque élément, avec une précision recherchée. On ne marche pas, chez eux. On marche avec une légère brise de dos ou on avance face à un violent souffle qui oblige à se courber. Et tout est à l’avenant. C’est à Thomas Bridges que l’on doit cette réhabilitation. Il est l’un des premiers colons à s’installer en Terre de Feu, à une quarantaine de kilomètres de la baie d’Ushuaia, dans une estancia qu’il nommera Harberton. Il écrira un étonnant dictionnaire anglais-yamana d’une richesse exemplaire. Plus de trente mille mots indiens y sont répertoriés, une variété supérieure à l’anglais de l’époque.
Christian Clot. Ultima cordillera, la dernière terre inconnue. Arthaud 2007
Ils vont découvrir le canal qu’ils nommeront Beagle, dernier passage de l’Atlantique au Pacifique avant le cap Horn. Le but premier de l’expédition est l’installation de stations chronométriques, la fabrication des chronomètres ayant été supervisée par Thomas Earnshaw, considéré comme le père du chronomètre marin. L’amirauté avait demandé au professeur Henslow de lui recommander un naturaliste, et son choix se porta sur son meilleur élève : Darwin, qui avait aussi été marqué par un autre professeur : Charles Lyell, lequel avait déjà jeté les premières bases de l’évolutionnisme, en émettant une doctrine de l’histoire de la Terre, que l’on appellera plus tard uniformitarisme, selon laquelle point n’était besoin de catastrophes pour expliquer la formation de notre monde : les forces à l’œuvre encore aujourd’hui y suffisaient, et ce depuis le début.
En conclusion, il m’apparaît que rien ne peut être plus profitable à un jeune naturaliste qu’un voyage dans des pays lointains. Il aiguise et, à la fois tempère en partie ce besoin et cette soif qu’un homme […] éprouve en dépit de la pleine satisfaction de chacun de ses sens corporels. L’excitation née de la nouveauté des objets, ainsi que l’éventualité du succès, stimulent son activité. En outre, comme un grand nombre de faits isolés ont tôt faits de devenir intéressants, l’habitude de comparer le porte à généraliser ; d’un autre coté, comme le voyageur ne séjourne qu’un court laps de temps dans chaque lieu, sa description doit généralement se composer de simples esquisses, au lieu d’une observation détaillée. Il en résulte, comme j’ai découvert à mes dépens, une tendance constante à combler les vastes lacunes de la connaissance au moyen d’hypothèses approximatives et superficielles.
Mais j’ai été trop profondément enchanté par ce voyage pour ne pas recommander à tout naturaliste de saisir toutes les chances, et de partir pour des expéditions terrestres si la chose est possible, ou s’il en est autrement pour un long voyage. Il peut être sur qu’il ne rencontrera pas, sauf dans de rares cas, de difficultés ni de dangers qui approchent ceux qu’il redoutait en imagination avant de partir. D’un point de vue moral, l’effet devrait en être de lui apprendre la patience dans la bonne humeur, l’altruisme, l’habitude de s’aider soi-même, et de tirer le meilleur parti de chaque chose, ou le meilleur contentement : en bref, il devrait partager les qualités caractéristiques du plus grand nombre des marins.
Charles Darwin
Ces cinq ans d’observation l’amenèrent à émettre la théorie de l’évolution, plus tard baptisée darwinisme, présentée dans l’Origine des espèces. Mais il faut aussi mentionner son cadet de 10 ans, Alfred Russel Wallace, qui contribua grandement à l’élaboration de cette théorie.
1858 : Charles Robert Darwin a 49 ans. C’est un naturaliste anglais reconnu, notamment à la suite de sa mission de cinq ans (1831-1836) autour du monde comme observateur scientifique sur le HMS Beagle, voilier de Sa Majesté britannique. De cette mission, il a rapporté un grand nombre d’échantillons de végétaux et d’animaux vivants et fossiles et de roches dont l’étude, par des spécialistes des sciences naturelles, en majorité anglais, va alimenter sa longue et lente réflexion sur l’origine et l’évolution des espèces. C’est un membre influent des sociétés savantes britanniques qui correspond avec les meilleurs naturalistes occidentaux de l’époque.
Le 18 juin 1858, il reçoit un manuscrit en provenance de Bornéo posté par Alfred Russell Wallace, géographe et naturaliste anglais avec qui il entretient une correspondance occasionnelle. Le contenu de ce manuscrit est, pour Darwin, une énorme surprise : Wallace y suggère une théorie tout à fait nouvelle sur l’origine des espèces qui, sur de nombreux points, est semblable à celle que lui-même a secrètement élaborée depuis une vingtaine d’années. Nous reviendrons sur cette théorie ; disons rapidement qu’elle propose une origine commune pour toutes les espèces vivantes et fossiles et une modalité de naissance des espèces nouvelles à partir de l’apparition fortuite de petites variations. Wallace demande à Darwin d’évaluer sa contribution et, éventuellement, de la faire publier. Chez ce dernier, la panique rejoint la surprise : il se voit menacé de se faire doubler sur le poteau quant à la paternité d’une théorie qu’il sait révolutionnaire et qu’il a construite lentement depuis son retour de l’expédition sur le Beagle.
Pourquoi Darwin a-t-il travaillé silencieusement, secrètement – ou presque -, pendant vingt ans alors qu’il avait conscience de la nouveauté de la théorie qu’il échafaudait ? À cela deux raisons principales :
Tout d’abord ce n’est pas un scientifique fulgurant mais un chercheur consciencieux, d’une grande honnêteté intellectuelle, soucieux d’accumuler une ample documentation et d’en peser et vérifier la validité. D’où une lenteur certaine préparée par son long séjour sur le Beagle. Selon l’expression de Boris Vian, le génie est une longue patience.
C’est aussi un bourgeois, enrichi par la révolution industrielle britannique, qui participe de la contestation de la suprématie de l’aristocratie foncière soutenue par l’Église anglicane. Et il est risqué, pour un notable, de remettre en cause le créationnisme prôné par cette dernière, d’autant plus lorsqu’on est marié à une femme très religieuse et qu’on a songé un moment à devenir pasteur. À Cambridge, le milieu universitaire qu’il fréquente est croyant et hostile aux idées remettant en cause le créationnisme. Ce sera avec le soutien actif de rares scientifiques de la jeune génération, le botaniste Joseph Hooker et le biologiste marin Thomas Huxley, que Darwin tentera de populariser les bases de sa théorie naturelle de l’évolution des espèces. Il faut remarquer que ses deux collègues, comme lui, ont participé de missions maritimes dans l’hémisphère Sud où ils ont pris conscience de la diversité du monde vivant.
Au XIX° siècle, on accepte la théorie des créations d’espèces séparées et successives telle qu’elle est exposée par la Bible. Ainsi, dans les couches sédimentaires des bassins de Londres et Paris, on récolte des fossiles marins inconnus, dont on admet qu’ils ont été créés par Dieu et ont disparu dans des catastrophes [4]. Des savants renommés comme le zoologiste et géologue suisse-américain Louis Agassiz, qui a mis en évidence en Europe les traces de la grande glaciation quaternaire, mais aussi le paléontologiste français Georges Cuvier soutiennent cette vision.
Suite au transformisme de Lamarck, qui avait en Erasmus Darwin, grand-père de Darwin, un ardent défenseur, on admet cependant qu’à un moment donné les arthropodes ont dominé le monde animal. Plus tard, c’étaient les poissons, puis les reptiles, puis les mammifères, et l’Homme couronnant cette évolution du vivant marquée par une complexification croissante.
Voyons qui étaient Darwin et Wallace son collègue et concurrent partiellement oublié, comment est née leur théorie de l’évolution des espèces et comment celle-ci s’est répandue puis a été amendée par l’arrivée de la génétique.
Charles Darwin (1809-1882), cinquième enfant d’une fratrie de six, est né dans une famille bourgeoise aisée du Shropshire, dans l’ouest de l’Angleterre. Son père était médecin et s’intéressait à la finance. Des études à l’Université d’Édimbourg le familiarisent avec la médecine, puis à Cambridge avec la théologie. Dans cette dernière université, sous la houlette du révérend John Henslow, professeur de botanique et féru de géologie, il va progressivement se tourner vers les sciences naturelles. Comme son collègue Wallace, il va devenir un fervent collectionneur habitué à distinguer les infimes différences séparant deux individus d’une même espèce.
À 22 ans, il embarque sur le Beagle comme naturaliste non payé. Cinq années de croisière lui fourniront la matière première de sa théorie de l’évolution des espèces.
En 1839, à 30 ans, il se marie avec sa cousine Emma Wedgwood, héritière d’une riche famille de faïenciers. À ce moment, Darwin bénéficie d’une rente le dispensant d’avoir à travailler pour faire vivre sa famille. Il s’installe à Down House dans la campagne du Kent, à environ vingt-cinq kilomètres de Londres, où il peut se consacrer entièrement à la science, au rythme qu’il souhaite.
Alfred Russell Wallace (1823-1913), anglais lui aussi, est le huitième enfant d’une fratrie de neuf. Sa famille est pauvre et, tôt, il doit quitter l’école pour travailler. C’est un autodidacte. Il apprend le métier de géomètre avec l’un de ses frères et devient professeur de dessin et cartographie à Leicester dans le centre de l’Angleterre. C’est là qu’il côtoie un jeune entomologiste, Henry Bâtes. Cette rencontre va décider de sa carrière. De 1848 à 1852, en sa compagnie, il parcourt les bassins de l’Amazone et du Rio Negro, récoltant des spécimens d’insectes, de papillons et d’oiseaux destinés à être vendus à des collectionneurs ou des musées occidentaux. Le bateau le ramenant en Angleterre prend feu et, dans le naufrage, Wallace perd ses carnets d’observations et ses spécimens, dont la vente devait financer ses futures expéditions. Seul son journal est sauvé. C’est au cours de cette expédition que germe en lui l’idée de la transmutation des espèces.
Entre 1854 et 1862, il effectue un second long voyage en Indonésie où il séjournera huit ans, vivant sobrement. Cette fois, il en rapportera plus de cent mille spécimens, essentiellement des insectes, dont près de mille espèces nouvelles. Cette collecte exceptionnelle, jointe à la célébrité attachée à sa participation à la formulation de la théorie de l’origine des espèces, lui fournira une aisance financière.
Ce séjour lui servira de base à la rédaction de The Malay Archipelago, publié en 1869, dédié à Darwin et admiré par le romancier anglais d’origine polonaise, Joseph Conrad qui s’en inspirera.
À compter des années 1870, Wallace parcourt le monde occidental pour y diffuser ses idées. Il adhère au socialisme, critique la société anglaise jugée corrompue et milite en faveur d’une réforme agraire qui donnerait aux pauvres accès aux terres de l’aristocratie. Plus étonnant, il se rapproche du spiritualisme, ce qui le conduira à exclure l’homme de sa théorie de l’évolution du vivant : des lois naturelles aveugles ne peuvent pas s’appliquer à celui qu’il considère comme d’origine divine.
Wallace est, dans la première partie de sa vie, un scientifique original, ouvert à la nouveauté, peu formaté par l’establishment. Par la suite, il développera volontiers un discours radical. Tout au long de sa vie, il restera un loyal défenseur de Darwin, ne développant aucune envie ou jalousie à son égard.
En quoi consiste la théorie de l’origine des espèces proposée par Darwin et Wallace ? Trois idées fortes, partagées par les deux chercheurs, en forment le socle : Toutes les espèces, celles vivantes aujourd’hui comme celles disparues et retrouvées fossilisées dans les roches, ont une origine commune. La blatte, le trilobite, la fougère, le diplodocus, le bonobo et, pour Darwin, l’homme dont la place sera âprement discutée, étaient potentiellement en germe, préfigurés, dans les premières bactéries vivant voici 3 milliards d’années. C’est l’image d’un arbre de vie dont le toit de la frondaison, représenté par les espèces actuellement en vie (1 à 2%), coiffe une hécatombe d’espèces parentes disparues représentant 98 à 99 % de l’ensemble de la biodiversité planétaire.
Ce sont de petites variations au niveau des individus, comme celles constatées par les éleveurs d’animaux et de végétaux, qui sélectionnées aboutissent à la grande variété d’espèces aujourd’hui constatée. Ce point est bien exposé sous le nom de descendance avec modifications. L’espèce linnéenne, immuable, telle qu’elle a été définie au XVIII° siècle, varierait constamment !
Les petites variations décrites proposent d’infinies possibilités dont le milieu dispose via la sélection naturelle, rapprochée par Darwin de la sélection artificielle qu’il a étudiée chez les éleveurs. Celle-ci n’est pas, comme on l’a souvent écrit, le triomphe de l’individu le plus apte, le plus fort. Dans le temps, l’espèce qui survit, et donc laisse une descendance, est celle qui présente le plus grand potentiel de variations susceptibles d’être sélectionnées. Pour Darwin qui, en cela, et bien qu’il s’en défende, rejoint Lamarck, sulfureux héritier de la Révolution française, l’environnement participe de la sélection ; pour Wallace, il est passif, agissant comme un simple filtre.
Comment cette théorie révolutionnaire a-t-elle germé dans le cerveau de Darwin et Wallace ?
Pour le premier, on affirme fréquemment que les observations décisives, durant la croisière du Beagle, ont été faites dans l’archipel des Galapagos. C’est partiellement vrai. Sur toutes ces îles, Darwin va, par exemple, constater que les animaux bons nageurs ou volant bien sont identiques. En revanche, des organismes apparentés ne volant pas ou mal et/ou ne nageant pas ou mal tendent à présenter, sur chaque île, des différences notables. Cela vient renforcer les observations qu’il a faites sur certains mammifères fossiles du Quaternaire d’Argentine, notamment les tatous, qui ressemblent étrangement, et en quelque sorte annoncent, les espèces rencontrées aujourd’hui. En somme germe l’idée d’une filiation possible entre des espèces voisines, géographiquement ou/et temporellement séparées. C’est au retour à Londres que les échantillons récoltés dans les Galapagos vont jouer un rôle décisif, et notamment les fameux spécimens de pinson, mauvais voiliers, incapables de franchir de grandes distances. Selon le zoologiste anglais chargé de leur identification, les petites différences notées par Darwin, notamment au niveau du bec, et qu’il avait interprétées comme de simples variations au sein d’une espèce unique, caractérisent des espèces différentes. Chaque île a donc sa propre espèce de pinson différant notamment par la morphologie du bec qui est associée aux régimes alimentaires différents. Et celles-ci se sont probablement développées à partir d’une espèce originelle commune venue du continent sud-américain. De quoi susciter une réflexion sur l’impact de l’insularité, c’est-à-dire de l’isolement géographique, sur la spéciation chez les pinsons.
Quant à Wallace, c’est en Amazonie, autour de 1850, qu’il remarque que des barrières géographiques comme des reliefs, de larges fleuves, individualisent des provinces faunistiques et floristiques peuplées d’espèces différentes. Là aussi, intervient un confinement géographique qu’il vérifiera en Indonésie.
La notion de sélection naturelle, tous deux l’ont empruntée à l’économiste anglais Thomas Robert Malthus et à son Essai sur le principe de population, publié en 1838. Dans une communauté humaine ou animale, la population croît toujours plus vite (en progression géométrique 1, 2, 4, 8 ) que les ressources alimentaires (en progression arithmétique 1, 2, 3, 4) dont elle dispose. Quand un groupe humain dispose de ressources minimales, seuls les mieux adaptés survivent. Les autres, c’est-à-dire les plus pauvres, périssent. Malthus, pasteur anglican, y voit une intervention divine favorisant la survie et le progrès de la race humaine dans ce qu’elle a de meilleur. Ici se situe l’origine du darwinisme social qui conduira à l’eugénisme de Francis Dalton, jeune cousin de Darwin, qui préconisera l’amélioration de la race humaine notamment en éliminant les plus faibles. Ceci conduira à la stérilisation de 60 000 Américains, surtout des Noirs, autour de 1930, et de 300 000 Allemands non aryens entre 1934 et 1939.
Comment la communauté scientifique britannique a-t-elle arbitré le différend entre Darwin et Wallace quant à la primauté de la découverte ? En juin 1858, Darwin transmet le manuscrit de Wallace à la Société linnéenne (de zoologie) de Londres. Le géologue Charles Lyell et le botaniste Joseph Hooker en prennent connaissance et tentent de trouver un compromis. Amis de Darwin, tous deux savent que celui-ci a élaboré secrètement une théorie sur l’évolution du vivant à partir de 1838, donc une vingtaine d’années avant Wallace. Ils en connaissent l’essentiel divulgué sous la forme de confidences, de rapports inédits ou dans des correspondances. Ils savent qu’elle est similaire à celle proposée par Wallace.
Le 1er juillet 1858, Lyell et Hooker convoquent une réunion de la Société linnéenne où, au nom des deux scientifiques absents – Wallace est en mission à Bornéo et Darwin empêché – ils présentent trois notes : le manuscrit transmis par Wallace De la tendance des variétés à s’écarter indéfiniment du type original, clair et concis ; l’extrait d’un manuscrit que Darwin a rédigé en 1844 et le résumé de sa théorie tel qu’il figure dans une lettre adressée en 1857 au botaniste américain Asa Gray. Ces deux derniers documents, non destinés à la publication, sont touffus, difficiles à lire.
L’objectif de Lyell et Hooker est d’associer les deux savants à la découverte de la théorie de l’évolution des espèces, tout en indiquant que Darwin a été le premier à l’élaborer.
Ces trois communications publiées en septembre 1858 passent inaperçues. Il faudra attendre un peu plus d’un an, le 24 novembre 1859, et la publication par Darwin de De l’origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle pour que le monde scientifique réalise la nouveauté des idées avancées. Et le scandale arrive quand la puissante Église anglicane va, en dénonçant violemment les idées défendues par Darwin, faire une énorme publicité. Timide, maladif, mal préparé à la confrontation, celui-ci verra ses idées triompher grâce au formidable appui de Huxley, habile débatteur et provocateur, surnommé le bouledogue de Darwin, de Hooker, solide et fidèle compagnon et de Lyell, géologue, l’ami de toujours.
Rapidement, Huxley aura l’intelligence de faire prendre un tournant au débat scientifique violent, créationnisme versus évolutionnisme illustré notamment par la diatribe féroce de Samuel Wilberforce, archevêque d’Oxford dit Sam le Savonneux tant sa pensée était tortueuse. Il va lui donner une orientation sociétale plus ample et le présenter comme une contribution de la nouvelle science anglaise à la solution des multiples problèmes qu’affronte, à la fin du XVIII° siècle, la jeune industrie victorienne.
Dans le gros livre de 1859, qui connaîtra cinq rééditions de son vivant, Darwin détaille et étoffe la théorie, fournit des exemples qu’il commente. Il entrouvre les carnets secrets qu’il tient depuis 1837 et où la lente maturation de sa pensée apparaît. Il est évident que sa réflexion est plus complexe, plus dense, plus mature que celle de son collègue Wallace.
Très vite, on oubliera les trois notes de 1858 pour ne retenir que le livre de Darwin. À la théorie révolutionnaire de l’origine des espèces restera accroché le nom de celui-ci, grand scientifique reposant dans l’abbaye de Westminster aux côtés du vénéré Isaac Newton. La contribution de Wallace, qui reste le codécouvreur voire, si l’on s’en réfère aux pratiques actuelles de publication qui valorisent les articles parus dans les revues, le véritable découvreur de cette théorie, sera oubliée. Et ce au mépris de toute déontologie.
Que reste-t-il aujourd’hui de la théorie de l’évolution des espèces dans sa forme actualisée, la théorie synthétique de l’évolution ou néodarwinisme ?
Les mécanismes à l’œuvre dans la descendance avec modifications n’ont pas été identifiés par Darwin et Wallace. Et pour cause ! Au milieu du XIX° siècle, certaines notions essentielles faisaient défaut : celle de gène n’apparaîtra qu’autour de 1900, tout comme celle de mutation, c’est-à-dire d’altération des gènes, proposée par le botaniste hollandais Hugo de Vries. De plus, dans l’Occident de cette époque, les informations scientifiques circulaient mal et des données disponibles n’ont pas été utilisées par Darwin dans les révisions de son livre. Par exemple, les travaux de Gregor Mendel, moine augustin de l’Empire austro-hongrois, publiés en 1865 sous le titre Expériences sur les plantes hybrides et qui fondent la génétique. En croisant des petits pois de formes et de couleurs différentes et en analysant la descendance, Mendel découvre les lois de l’hérédité du monde végétal : chaque parent petit pois transmet, au hasard, la moitié de ses caractéristiques.
Ainsi, entre 1900 et 1950, la révolution génétique, initiée par Mendel, aboutira à l’avènement de la théorie synthétique de l’évolution héritière de la théorie de l’évolution des espèces dont elle contestera certains aspects.
La sélection naturelle favorise le développement préférentiel de certains organismes mais n’engendre pas de nouveauté.
Les petites modifications, qui apparaissent chez certains individus et qu’exploitent les éleveurs en pratiquant la sélection artificielle, ne sont pas héréditaires. Elles définissent des variétés qui sont les germes potentiels d’espèces nouvelles.
L’évolution n’est pas progressive comme cela était implicitement suggéré. Elle se fait par bonds, au rythme des mutations.
En revanche, l’origine commune de tous les êtres vivants et leur parenté, résumées dans la superbe image de l’arbre de vie ou du massif coralliaire dont seule la tranche supérieure exposée à la lumière est vivante, demeure. Tout comme persiste l’idée, pourtant durement combattue par les religions, que l’évolution est le fruit du hasard, qu’elle ne poursuit aucun dessein particulier. En effet, il est difficile d’accepter que des processus aveugles renouvelés à l’infini supplantent une intervention, une volonté divine.
Ce sont les deux points qui permettent à la théorie de l’évolution des espèces de Darwin et Wallace d’être encore d’actualité aujourd’hui.
La gestation de la théorie de l’origine des espèces apparaît comme une histoire entièrement anglaise. D’abord par le lieu où elle se déroule : Londres et le centre de l’Angleterre. Et aussi par les protagonistes tous anglais, Darwin, Wallace, Lyell, Malthus, Henslow et tous membres de la jeune bourgeoisie héritière de la révolution industrielle britannique. Tous, sauf Wallace le roturier. Cela rappelle quelque peu les liens parfois ambigus qui unissaient les savants de la Révolution française, Buffon, Cuvier, Lamarck et les Lumières.
Pourquoi ce tout anglais ? D’abord à cause de la révolution industrielle qui, très tôt dans ce pays, a permis l’émergence d’une bourgeoisie aisée, entreprenante, cultivée. Et puis, il y a cette volonté des naturalistes anglais, d’étudier la géologie, les faunes et les flores de l’hémisphère Sud, reconnu par James Cook lors ses voyages dans le Pacifique.
La découverte et l’étude des habitants mais aussi des faunes et flores vivantes et fossiles, rencontrés au-delà des mers, avaient toute chance de déboucher sur la constatation de la grande variété du monde vivant et de conduire à s’interroger sur l’origine de cette diversité.
Somme toute l’histoire terriblement et uniquement british d’une immense découverte scientifique !
Roland Trompette, Daniel Nahon. Science de la Terre, Science de l’Univers. Odile Jacob 2011
Il est utile aussi de citer dans son intégralité l’Analyse de l’œuvre, publié en annexe du Voyage aux origines de l’espèce, au Cercle du Bibliophile, Genève 1970 écrite par H.E.L. Mellersh, de la Linnean Society. Beaucoup plus qu’une analyse de l’œuvre, il s’agit d’un véritable état des lieux de l’ensemble des sciences concernées par les travaux de Darwin au milieu du XIX° siècle :
[…] Darwin ne travaillait pas devant une table rase, pas plus que ne le fit jamais aucun homme de science. À l’époque du jour mémorable où il s’était rendu à Plymouth en compagnie du capitaine Fitz Roy pour s’embarquer sur le Beagle, il existait déjà un petit cercle de gens qui inclinaient à penser que la variété des êtres vivants sur la terre pouvait s’expliquer en ayant recours à quelque processus plausible d’évolution. Toutefois il ne s’agissait que d’un très petit nombre, et c’était l’explication exactement contraire qui s’imposait à la très grande majorité des gens, hommes de science compris, à savoir que les différentes espèces et les différents genres du monde végétal et animal avaient été créés une fois pour toutes au commencement du monde pour demeurer ensuite foncièrement les mêmes. Darwin a dit avoir cru lui aussi à l’immutabilité des espèces à l’époque de son embarquement.
Il faut ajouter qu’en l’état des connaissances, cette conviction n’était pas le moins du monde une croyance absurde ou contre nature comme nous pourrions le penser aujourd’hui. C’était une conception parfaitement naturelle. Nous autres humains ne vivons pas assez longtemps pour être témoins des modifications importantes opérées par l’évolution organique. Il s’en faut de milliers de fois. De fait, ce que nos yeux enregistrent nous convaincrait plutôt du contraire. Qu’y a-t-il en apparence de plus évident que la pérennité fondamentale des formes de la vie et que la conception d’une Création dont l’acte originel ne s’est jamais répété ?
Cette conception s’appuyait en outre sur un arrière-plan religieux. La Bible elle-même ne s’ouvre-t-elle pas sur cette déclaration solennelle : Au commencement Dieu créa les cieux et la terre ? Et ne poursuit-elle pas en expliquant clairement comment Dieu s’y est pris ? Ne trouve-t-on pas dans la Bible le récit du Déluge provoqué par la colère de Dieu contre les fils des hommes, et qui recouvrit la terre ; et comment Noé sauvegarda les animaux par couples afin d’assurer son repeuplement ? Il faut aussi se rappeler combien ce sentiment religieux était fort, tout particulièrement à l’époque et dans le pays de Darwin. Le XVIII° siècle avait été une époque de légèreté, de libre pensée séculière. Mais il avait abouti à la Révolution française, athée et redoutable, elle-même suivie de l’avènement de Napoléon, le tyran. L’Europe continentale avait traversé là une expérience traumatisante dont elle émergeait convaincue de savoir désormais quels maux pouvaient résulter d’une mise en question de la Parole de Dieu et de la tradition reçue ; elle se croyait prémunie contre toute tentation de recommencer à le faire. Donc on ne mettait pas en doute la Genèse.
Malheureusement pourtant le développement de la connaissance posait bien des problèmes à son sujet. Des hommes s’étaient penchés sur toutes les formes de vie pour en dresser le catalogue, et ils n’avaient pas manqué de s’apercevoir de bien des ressemblances significatives ; et cela durait depuis l’ère des grandes découvertes alors que l’Occident avait vu s’ouvrir le reste du monde avec toute sa flore et toute sa faune étrange et insoupçonnée. Le Suédois Linné (1707-1778) – dont la fameuse société de biologistes britanniques portait le nom – avait passé sa vie à classer les variétés de la Nature selon les genres et les espèces, en prenant garde dans les dernières éditions de son œuvre de ne pas s’opposer à la possibilité de l’apparition de nouvelles espèces. Un Français, Buffon, né la même année que Linné, avait publié une Histoire naturelle, que nous appellerions de nos jours un best-seller, et dans cet ouvrage de Buffon on aurait pu trouver, si on l’avait voulu, dispersés au long des pages, presque tous les éléments des principales observations que Darwin allait par la suite ordonner en un tout clair et convaincant. Ensuite était venu un autre trouble-fête de l’orthodoxie, le baron Cuvier (1762-1832), grand anatomiste qui distingua les diverses catégories fondamentales du squelette des mammifères et qui montra, à l’étonnement général, les ressemblances elles aussi fondamentales communes à toute la lignée des mammifères, qu’il s’agît des espèces actuelles ou de celles disparues au cours du passé.
C’est ainsi que la notion importante de passé s’était imposée. De leur côté les géologues s’étaient acharnés à découvrir des ossements fossilisés.
Ils avaient également mis en évidence bien d’autres choses. Ils avaient découvert, à proprement parler, la notion du temps. Ils avaient démontré sans réfutation possible, sinon de la part d’ultraconservateurs que rien au monde n’aurait fait changer d’opinion, que la terre existait depuis très longtemps, depuis bien plus longtemps qu’une interprétation littérale de la Bible n’avait permis de le croire, et que, par conséquent, la vie sur cette terre avait duré en proportion. En observant les effets de l’érosion due aux conditions atmosphériques, les dépôts charriés par les fleuves jusqu’à la mer, l’usure des roches et la conséquences des tremblements de terre et des éruptions volcaniques, James Hutton (1726 -1797) en était venu, avec raison, à penser que l’écorce terrestre était en continuel travail d’éruption et d’érosion ; il avait fallu des milliers et des milliers de siècles pour lui donner son aspect actuel. William Smith (1769-1839), surnommé Strata Smith, avait observé, alors qu’il contrôlait l’état des canaux, la superposition des couches du sol, la stratification des roches, dont on pouvait calculer l’ordre ; il avait énoncé une double affirmation : 1) plus la couche est profonde et plus elle est ancienne ; 2) on peut sans risque d’erreur déterminer l’âge d’une couche par le genre de fossiles qu’elle contient.
Or certains des fossiles mis à jour paraissaient bien étranges. C’est ainsi que des carriers découvrirent dans d’anciennes couches de molasse rouge des euryptérides, sorte de scorpions géants aux pinces ouvertes qu’ils baptisèrent en toute candeur séraphins, les prenant assurément pour des anges tombés du ciel. Il va sans dire que de telles explications ne pouvaient contenter ni beaucoup de gens ni pour longtemps. Les défenseurs de l’interprétation littérale de la Bible en étaient troublés. Il leur fallait établir la preuve qu’aucune espèce ne s’était jamais éteinte, qu’il n’y avait eu pour toujours qu’un seul acte créateur. Ils se replièrent quelque peu sur une nouvelle position. Ils affirmèrent que ces êtres fossilisés pouvaient appartenir à l’ère antédiluvienne, soit à des espèces abandonnées hors de l’arche. Ces défenseurs allèrent plus loin encore dans leur trouble. Peut-être, concédèrent-ils, y avait-il eu plusieurs catastrophes comparables au Déluge ; chacune d’elles avait détruit partiellement, ou plus vraisemblablement encore la totalité des êtres vivants, et Dieu s’était vu contraint de procéder à une nouvelle fournée de créatures. Ces interprètes-là se nommaient eux-mêmes les catastrophistes alors que ceux qui soutenaient l’opinion contraire s’appelaient les uniformistes, surnom qui revêt pour nous un sens devenu plutôt équivoque. Ces derniers soutenaient, d’après la thèse de Hutton, que le monde n’avait jamais cessé de se transformer et qu’il continuait à se comporter de nos jours comme toujours, c’est-à-dire selon un processus uniforme. En vérité la vie y existait depuis des millions d’années et elle s’était beaucoup modifiée au long des siècles ; vouloir en appeler à des catastrophes imaginaires, non prouvées, voilà qui était absurde. Le grand patron des uniformistes était Sir Charles Lyell (1797-1875) et nous allons voir que Darwin lui devra beaucoup. Nous en arrivons enfin à ces prédarwiniens qui ont défendu pratiquement des théories évolutionnistes. L’un des deux principaux n’avait été personne d’autre que le propre grand-père de Charles Darwin ; l’autre le chevalier Jean-Baptiste Lamarck (1744 – 1829), un Français à l’imagination fertile dont les thèses particulières ne cesseront plus d’attirer, de séduire et de préoccuper les théoriciens de l’évolution. Erasme Darwin (1731-1802) pratiquait l’art de la médecine, mais c’est en tant que poète qu’il se fit une réputation. Il avait choisi, il est vrai, tout le domaine de la nature pour thème de sa verve poétique, et il en fut un observateur pertinent. Il avait écrit également un ouvrage en prose intitulé Zoonomia ou Appellation de la Vie. Au long des passages ornés de sa poésie et des notes marginales de sa prose, il se laisse aller à de vastes spéculations, voire, de l’avis de son petit-fils, à des spéculations audacieuses. Il affirme témérairement que l’âge de la terre doit se calculer en millions d’époques et que tout ce qui y vit peut être considéré comme appartenant à une seule famille remontant à un seul parent. En outre, puisque toutes les familles animales et végétales sont de manière évidente en état de perpétuelle amélioration et de perpétuelle dégénérescence, il est urgent de déterminer la cause de ces changements. Or cette cause, estime Erasme Darwin, réside dans le pouvoir que possède la vie de s’annexer de nouveaux éléments et de nouvelles tendances, et de transmettre par la génération à sa descendance de siècle en siècle les qualités acquises.
Lamarck a partagé le même point de vue mais il l’a exposé plus méthodiquement. Le pouvoir inné qu’a la vie de se modifier se traduit par l’usage particulier, ou par le renoncement à cet usage, qu’un être fait de ses membres et de ses facultés dans un nouveau milieu. Un animal qui élit domicile dans l’obscurité d’une caverne finira par perdre l’usage de la vue au cours des générations par manque d’emploi. En sens inverse, et cela importe davantage, une créature placée dans un nouveau milieu fera effort pour utiliser et accroître les organes de son corps qui lui seront le plus utiles. De plus, comme l’affirmait aussi Erasme Darwin, ces caractères acquis par l’usage – ou perdus faute d’utilisation – passeront par hérédité à la descendance et modifieront progressivement l’espèce.
C’étaient là des opinions nouvelles, mystérieuses et inquiétantes. Elles ne se trouvaient pourtant point étayées par une expérimentation quelconque ou par un raisonnement déductif sûr : elles n’étaient que pure spéculation. Darwin les rejeta, à tort peut-être, comme relevant purement et simplement du domaine des erreurs.
Néanmoins il avait lu aussi bien son grand-père que Lamarck et, lorsque Sir Charles Lyell avait publié, à l’époque du voyage du Beagle, des Principes de Géologie en plusieurs tomes, il s’était jeté avec ardeur et sans tarder sur eux pour les étudier avec soin.
Revenons donc à Charles Darwin. Notons tout d’abord que, bien qu’il ait affirmé par la suite avoir cru, en orthodoxe, à l’immutabilité des espèces à l’époque du voyage, il n’en soupçonnait pas moins également une explication contraire à ce moment déjà. Il serait en vérité plus juste de souligner ceci : chaque fois qu’en cours d’expédition son flair put soupçonner la moindre des choses touchant à la controverse transformiste, il s’est précipité dessus avec la rapidité d’une abeille sur un champ de trèfles ou d’un papillon sur un bosquet en fleurs.
Nous allons énumérer rapidement celles des expériences faites au cours du voyage qui semblent avoir infléchi la pensée de Darwin vers les perspectives évolutionnistes. Rappelons d’abord les observations strictement géologiques. En février 1835, il fut témoin du puissant tremblement de terre qui anéantit Concepcion ; en humanitaire il en fut bouleversé, mais en homme de science il y trouva un puissant intérêt. Une fois l’événement passé, il nota un certain soulèvement du niveau du sol. Dès lors il repéra d’autres signes, plus marquants encore, de soulèvements analogues lors de ses expéditions dans les Andes ou, en compagnie de Fitz Roy, en remontant la vallée du Santa Cruz. Il découvrit des coquillages fossilisés jusqu’à une altitude de 3 600 m. ! Ce qui pour le capitaine n’était que preuves du Déluge devenait pour Darwin – qui voyait dans les Andes une chaîne montagneuse de formation relativement récente -, autant d’indices aptes à prouver le bien-fondé des thèses uniformistes et l’absurdité de celles des catastrophistes.
Puis Darwin observa que la vie présentait des caractères différents de part et d’autre de la chaîne des Andes. Était-ce donc que le milieu façonne la vie ? À Punta Alta il fit la découverte saisissante d’ossements de mammifères disparus, le Megatherium et le Mylodon, appartenant à des espèces géantes éteintes et pourtant très proches par leurs caractères de celle des paresseux et de celle des tatous contemporains.
Ce qui était vrai des fossiles devait l’être des espèces actuellement en vie. Darwin observa un serpent possédant des rudiments de membres postérieurs, ce qui pouvait être un indice du chemin emprunté par la Nature pour passer des lézards aux serpents. On lit cette réflexion dans son carnet de notes mais il ne la mentionne pas dans son Journal. Il releva qu’un pingouin se sert de ses ailerons, sous l’eau, comme de nageoires, d’où il conclut qu’il y a là un exemple très particulier d’adaptation au milieu du membre antérieur des mammifères, dont le type fondamental s’est développé selon tant de formes et pour tant d’usages. L’être humain n’échappe pas non plus à la thèse darwinienne de l’influence du milieu. Darwin fut à la fois rebuté et fasciné par l’aspect primitif des Fuégiens qui continuaient à peupler dans des conditions si précaires un habitat dont le choix pouvait étonner. Lorsque arriva enfin le jour où le Beagle quitta les rivages de l’Amérique du Sud pour faire voile vers les îles Galápagos, Darwin était en mesure de se lancer dans les anticipations les plus audacieuses ; il savait en effet que le problème de la vie sur les îles perdues dans l’océan jette, d’une manière générale, un sérieux défi au dogme de la fixité des espèces, à cause des flores et des faunes distinctes qu’elles possèdent, pour ne rien dire du fait que plantes et animaux aient pu s’y installer.
Les Galápagos ne déçurent pas Darwin. Ces îles volcaniques sont particulièrement séparées et étranges. Outre quelques prouesses auxquelles il se livra – on voit Darwin enfourcher des tortues géantes et tirer la queue des lézards – il s’appliqua à observer et à noter avec une passion qu’on peut imaginer sans cesse grandissante. Il apprit ainsi que non seulement la faune des Galápagos dans son ensemble possédait maints caractères distinctifs, mais que celle de chacune des îles, prise séparément, révélait des traits particuliers à un observateur attentif. La chose était frappante par exemple dans l’étonnante variété des becs dans la famille par ailleurs si diverse des pinsons, becs adaptés à la nourriture propre à chaque île. Le capitaine Fitz Roy leva malheureusement l’ancre au moment où Darwin venait de faire ces observations captivantes. Le naturaliste en fut contrarié mais il se garda d’oublier ce qu’il avait vu.
Venons-en au Darwin de la maturité. Les péripéties du voyage ne se sont point estompées dans sa mémoire. Il est arrivé au terme de ses expériences sur les bernacles ; il a appris beaucoup de choses et il a fait nombre d’expériences. Cependant il hésite toujours à publier. Il a trouvé dans l’ouvrage du l’économiste T. R. Malthus : Essai sur le Principe de Population, une citation bien propre à combler une lacune dans sa théorie. Concernant les hommes, disait Malthus, il y a toujours une lutte pour l’existence, car l’espèce humaine pourrait se multiplier selon une progression géométrique, ce qui n’est assurément pas le cas de l’alimentation nécessaire à sa subsistance. Pour Darwin le même principe devait être applicable à toutes les formes de la vie. Il eut soudain la clef d’un problème sur lequel il achoppait depuis longtemps, à savoir comment les mutations opérées au cours du processus d’évolution pouvaient devenir assez importantes pour provoquer l’apparition d’une espèce entièrement nouvelle. Il comprit que la vie possédait en soi une telle propension à se répandre à la surface du globe et à s’adapter à un milieu nouveau qu’il devenait possible que des êtres, ainsi transplantés et adaptés aux conditions d’un autre lieu, ne soient plus en état de se reproduire avec l’espèce originale si, d’occasion, ils venaient à se retrouver au lieu de leur premier habitat, tant ils avaient subi de transformations.
Cependant Darwin gardait toujours ses idées pour lui, alors même que son grand ami Lyell l’avertissait qu’à trop attendre il courait le risque de voir un autre le précéder. Darwin estimait de son devoir de disposer du maximum de faits et de preuves irréfutables. Aussi se consacrait-il à des expériences extrêmement détaillées et de très longue durée, allant par exemple jusqu’à mesurer la résistance des semences à l’action de l’eau salée dans laquelle il les immergeait. Ce détail avait son importance pour l’étude qu’il faisait de la propagation de la vie sur des îles lointaines.
Puis vint le coup de semonce. Il éclata sous la forme d’un pli trouvé dans la boîte à lettres de Down House. Ce pli était aussi important, quoique d’effet moins agréable, que celui reçu vingt sept ans auparavant dans le courrier de son père et qui contenait la proposition de postuler à l’expédition du Beagle. Darwin avait fait la connaissance d’un naturaliste et explorateur, Alfred Russel Wallace, et avait correspondu avec lui. Wallace s’intéressait aussi au problème de la mutabilité des espèces. Le document qui venait de tomber chez les Darwin était un essai de ce M. Wallace intitulé : De la tendance des variétés de provenir indéfiniment d’un type originel. Une note respectueuse et amicale l’accompagnait, où l’auteur disait espérer que sa thèse paraîtrait aussi nouvelle à Darwin qu’elle semblait l’être à ses yeux, et estimer qu’elle comblait la lacune subsistant dans l’explication de l’origine des espèces. Il ajoutait qu’il attendait de Darwin qu’il voulût bien la lire et la transmettre à Lyell.
Darwin la transmit en effet à Lyell en disant, en termes très mesurés, qu’elle lui paraissait digne d’être lue. Puis il lui avouait sans plus de réticences : Votre prédiction d’une revanche, je veux dire du danger de me voir précédé, se réalise. Je n’ai jamais vu coïncidence aussi frappante ; si M. Wallace avait eu en mains les notes de mon voyage, écrites en 1842, il n’aurait pu en faire un meilleur résumé ! Il emploie aujourd’hui les termes mêmes dont je me suis servi pour mes têtes de chapitre.
Cet événement se révéla heureux en fait ; c’était un hommage rendu à l’idée commune et au jugement fondé de tous ceux qui étaient impliqués dans le débat. Devant la Société linnéenne, on donna lecture d’un travail commun basé aussi bien sur l’essai de Wallace que sur le résumé du texte de Darwin gardé secret depuis 1842. Wallace fit preuve, par la suite, de beaucoup de générosité envers Darwin ; il reconnut d’emblée qu’il devait beaucoup aux écrits de Darwin antérieurs aux siens, puis, plus tard, que dans L’Origine des Espèces son ami avait accumulé une telle quantité de preuves et de faits qu’il était normal de lui attribuer tous les mérites. En vérité tel était bien le cas. Mais que Wallace, un homme aussi noble d’attitude, soit tombé, par comparaison, presque totalement dans l’oubli, nous paraît d’une ingratitude excessive. Quel est le thème essentiel de cette nouvelle théorie de l’évolution organique ? On peut le résumer sans lui faire trop de tort et aussi brièvement que possible, dans les 6 propositions suivantes :
1) Dans tous ses modes et à toutes les époques, la vie atteste une variation extraordinaire, mais il s’agit d’une variation qui laisse apparaître de frappantes ressemblances de formes et la persistance du modèle.
2) Les formes variées de la vie s’adaptent à leur milieu particulier d’une manière très appropriée.
3) Ces faits nous amènent à supposer non pas une infinité d’actes créateurs séparés, mais un processus de transformation graduelle, ou une évolution.
4) On peut comprendre comment cette évolution s’est produite en prenant en considération deux phénomènes naturels : a) La lutte pour l’existence. Dans toutes les formes il y a surproduction de descendants, dont seuls quelques-uns pourront survivre. b) La mutabilité des espèces. Des modifications apparaissent dans toutes les formes d’existence et sont transmises héréditairement : les descendants ne sont pas entièrement ou exactement les mêmes que leurs parents.
5) Ces deux phénomènes concourent à créer un processus de tri qu’on peut appeler sélection naturelle ; ainsi seuls pourront survivre ceux des modes de variation qui sont le mieux adaptés à leur milieu.
6) Ce processus suffit à expliquer, si l’on tient compte d’une durée assez longue, la transformation graduelle des formes de la vie et l’apparition de nouvelles espèces, soit une évolution organique.
Certes ce résultat peut nous paraître relativement modeste pour être celui de toute une expédition à laquelle se sont ajoutées vingt années de réflexion. Encore ne faut-il pas oublier ceci : comme pour toutes les découvertes philosophiques ou scientifiques, il a fallu compter avec le poids incalculable des préjugés à vaincre. Il importe donc de souligner ce qui a pris valeur de signification historique ; à savoir, premièrement, que deux hommes aient fait simultanément la même découverte, ce qui nous montre à quel point l’idée était dans l’air, n’attendant que le choc cristallisateur pour revêtir sa forme ; et, secondement, semble-t-il, en ce qui concerne Darwin, qu’elle ait été exprimée comme elle l’a été dans L’Origine des Espèces, avec tant de force, de preuves convaincantes et de logique. Pour tout esprit non prévenu et apte à bien comprendre l’ouvrage de Darwin, la vérité fondamentale de la nouvelle doctrine était irréfutable.
Les esprits cherchèrent néanmoins à se soustraire à cette évidence et on peut bien le dire, en y mettant pas mal de véhémence et en employant des procédés plutôt rancuniers. C’est là un troisième aspect de cette signification historique.
On aurait tort de s’en étonner. La théorie de L’Évolution organique par voie de sélection naturelle entraînait deux conséquences graves et fort alarmantes. Tout d’abord elle ouvrait largement les portes à une interprétation non littérale du premier chapitre de la Genèse. Cette nouvelle interprétation était inévitable et certainement point à regretter. Toutefois on s’acharna contre elle avec une ardeur féroce et souvent déraisonnable ; nombre de personnes à la tournure d’esprit conservatrice y virent une atteinte portée à un domaine bien plus vaste, à l’autorité dont jouissait la Bible prise dans son ensemble dans l’opinion des hommes. La seconde conséquence s’apparentait à la première, et elle était plus grave encore. Bien des gens estimèrent que les thèses de Darwin tendaient à substituer à la divine Providence une puissance obscure voire sanguinaire : la Nature – cette nature dont Tennyson avait dit qu’elle a les dents et les griffes rouges de sang – et qu’elles mettaient donc en doute l’existence de Dieu, et jusqu’à la nécessité de cette existence.
Il est évident qu’on pouvait tirer de tout autres conclusions. Et c’est ce que faisait Darwin : Si la sélection naturelle et la survivance des mieux adaptés constituent l’instrument dont se sert la vie dans son évolution, il s’ensuit que nous pouvons attribuer aux luttes dans la nature, à la faim, à la soif, une conséquence fort exaltante : l’apparition des espèces les plus évoluées du monde animal. Il est noble de se représenter qu’au commencement la vie, avec toutes ses possibilités, s’est développée à partir d’un nombre très restreint de formes, voire d’une forme unique, comme l’émanation du souffle créateur. Puis d’imaginer l’infinité des formes progressivement apparues, jusqu’aux plus belles, aux plus admirables, toutes provenant d’une origine aussi simple, tandis que la planète accomplit ses révolutions selon les lois immuables de la gravitation.
Tout était donc pour le mieux, et cependant la plupart des gens ne pouvaient souscrire à ce qu’ils tenaient pour un optimisme injustifiable. Évidemment ils étaient excusables de penser ainsi. Pendant les cinquante dernières années, une bonne part des publications les plus autorisées, faites par les géologues et les biologistes dont nous avons parlé, avaient défendu le point de vue opposé : la vie était la création d’un Dieu bienveillant, et sa merveilleuse adaptation au milieu attestait l’intention providentielle du Créateur. Un pieux gentleman n’avait-il pas légué par testament une fortune pour permettre la publication d’une suite d’ouvrages – la célèbre Bridgewater Series – sur le thème suivant : La puissance, la sagesse et la bonté de Dieu sont rendues manifestes dans la Création.
Notons encore ce corollaire qui découle de tout ce que nous venons de dire, corollaire redoutable s’il en fut : dans ce système impie, l’homme lui-même était ravalé à n’être plus que le produit de forces aveugles et profanes. L’homme descendait du singe !
Voilà une affirmation que Darwin n’avait pas prononcée et qu’il ne prononcera jamais. Certes cette inévitable et terrible implication ne lui avait pas échappé ; mais il était conscient de l’horreur qu’elle inspirait et il avait opté pour la prudence. Tout ce qu’il s’autorisa à dire c’est que, selon toute probabilité, la race humaine descendait de quelque créature arboricole ; et dans L’Origine des Espèces, il se contente de prédire que beaucoup de lumière serait projetée sur l’origine de l’homme et sur son histoire. C’était d’ailleurs suffisant ! L’implication sautait aux yeux. L’orage pressenti ne tarda pas à éclater. Darwin courba l’échine pour le laisser passer, sans pour autant se rétracter jamais. Il avait de solides amis, et ce sont eux qui se battirent pour lui publiquement. Nommons Charles Lyell, lequel pourtant hésita longtemps avant de le suivre jusqu’au bout ; Wallace, le collègue qui l’avait jeté dans la bataille ; et encore deux jeunes et ardents écrivains biologistes, Joseph Hooker et Thomas Huxley, celui qu’on surnommera plus tard le bulldog de Darwin.
Une occasion se présenta qui, pour l’opinion générale, parut rendre compte de toute la controverse. Il n’est pas suffisant de mentionner cet événement tel qu’il fut simplifié par le public ; néanmoins il eut son importance et mérite d’être rappelé ici. Il survint dans le cadre de l’assemblée annuelle de l’Association britannique pour le développement scientifique (British Association for the Advancement of Science) qui se tenait en cette année 1860 à Oxford, le bastion de l’anglicanisme. Les assemblées de l’Association britannique étaient d’importantes sessions – elles le sont encore ; les hommes de science, connus ou peu connus, s’y rendaient de tous les coins du royaume pour venir lire leurs communications devant leurs collègues et devant le public intéressé. C’est ainsi que Fitz Roy, l’ancien capitaine du Beagle devenu depuis lors amiral, membre de la Royal Society, et un pionnier en météorologie, se trouvait aussi à Oxford. Il devait présenter une conférence sur sa spécialité et il assistait à celles qui l’intéressaient. Il en allait de même pour ses collègues. Or quel sujet eût pu les captiver davantage que le thème controversé de la théorie de Darwin ? Le premier jour de l’assemblée il ne se passa rien de particulier ; mais dès le second déjà il y eut de l’électricité dans l’air. L’un des anatomistes les plus connus de l’époque était Sir Richard Owen, un homme violent mais à tous égards sympathique, qui avait été naguère un ami de Darwin et l’auteur d’un exposé scientifiques parus à la suite du voyage. Mais après la publication de L’Origine des Espèces, Owen s’était livré à une virulente critique de l’ouvrage dans la Revue d’Édimbourg. Lors de cette assemblée, Owen et le jeune Thomas Huxley participèrent à une conférence sur le sujet suivant : Les causes finales de la sexualité des plantes, avec référence particulière à l’ouvrage de M. Darwin sur l’origine des espèces.
À la suite de cette conférence, favorable à Darwin, Huxley fut invité à prendre la parole. Mais il refusa d’entrer en discussion sur le sujet controversé des thèses darwiniennes, si chargé d’émotivité, devant un auditoire public qui, il tenait à le dire, mêlerait à tort le sentiment à la recherche intellectuelle. Sir Richard Owen ne s’embarrassa pas de tels scrupules et, faisant longuement allusion à la référence du conférencier, il traita de crânes et de singes en proclamant que le cerveau du gorille présentait plus de différences comparé à celui de l’homme que comparé aux cerveaux des quadrumanes les plus inférieurs et les plus contestés (prosimiens et simiens). Dès qu’il eut fini Huxley se leva pour le contredire ouvertement. II reconnut par la suite qu’il n’aurait pas dû le faire dans une session publique de la British Association : de plus Owen était Sir Richard et de beaucoup son aîné. La température de l’assemblée monta considérablement. Le jour suivant les événements prirent une tournure extraordinaire. II est assez naturel que le rapport officiel ne traduise pas l’émotion qui a pénétré les débats. Tel n’était pas son rôle. Nous avons par contre les rapports de quelques-unes des parties en cause et bien que, naturellement aussi, ils ne concordent pas absolument, ils ont assez de traits communs pour nous permettre de nous faire une idée assez exacte de ce qui s’est passé. On avait annoncé que l’évêque d’Oxford en personne prendrait la parole. L’évêque d’Oxford était alors Samuel Wilberforce, le fils du grand émancipateur des esclaves, ecclésiastique influent, orateur de premier plan. Les membres du clergé d’Oxford décidèrent d’aller l’appuyer, en compagnie de leurs épouses. Le semestre universitaire venait d’être clôturé, mais il y avait encore un certain nombre d’étudiants résidents ; quelques-uns d’entre eux décidèrent aussi d’aller non point nécessairement prendre parti dans le débat, mais voir le spectacle. Owen ne devait pas être présent, mais on laissait entendre qu’il avait pourvu son ami l’évêque en munitions anti-darwiniennes. Huxley et Hooker qui par tempérament redoutaient toute discussion sentimentale sur le sujet, ne se laissèrent persuader de participer qu’à la dernière minute. On leur fit place sur l’estrade, tandis que le vieil Henslow, le professeur qui jadis avait permis à Darwin de tenter sa chance, présidait la séance. L’évêque était là comme promis. Le conférencier, un certain Dr Draper de New York, relativement peu connu, parla sur le sujet semblait-il anodin du Développement intellectuel de l’Europe ; mais un aiguillon se cachait dans le sous-titre: compte tenu des vues de M. Darwin et de quelques autres. Personne ne s’intéressait aux quelques autres.
On ne prêta pas grande attention à la conférence qui dura une heure entière. N’allait-on pas en rester là ? L’auditoire, les étudiants surtout, commençait à s’agiter. Les deux orateurs suivants furent chahutés. Le troisième avait un accent bizarre et sa méthode l’était aussi. Il dessina un diagramme au tableau noir : Admettons, disait-il, que ce point A représente l’homme et ce point B le chinge.. .
– Chinge ! Chinge ! clamèrent les étudiants ravis. L’orateur s’assit à son tour.
L’évêque se leva. Il était, nous l’avons dit, bon orateur, et l’auditoire était tendu. Ceux de son parti jugèrent qu’il avait été étonnant. À cela pas de doute. Quelqu’un du parti opposé dit qu’il avait postillonné pendant une demi-heure avec esprit et mauvaise foi, pour ne rien dire. Il se montra tout d’abord jovial et amusant, puis brutalement moqueur. Il tourna les preuves de Darwin en ridicule. Mais il alla trop loin. Dans sa triomphale péroraison il fit de la plate dérision. Se tournant vers Huxley, il lui demanda si c’était par son grand-père ou par sa grand-mère qu’il prétendait descendre du singe.
Huxley en fut tout d’abord abasourdi, mais ensuite il se ressaisit. À l’oreille d’un Hooker éberlué il glissa ces mots enchantés : Le Seigneur l’a livré entre mes mains !
Il se leva alors, pâle et ému. Il fit une impression d’autant plus grande qu’il contrasta par son calme avec son prédécesseur. Il prit, sobrement, la défense de la théorie de Darwin. Puis il se fit plus posé et plus grave encore. Il n’aurait pas honte, dit-il, d’avoir un singe dans la lignée de ses ancêtres, mais par contre il aurait honte d’un homme capable de prostituer les dons de la culture et de l’éloquence en les mettant au service des préjugés et du mensonge. [on voit sous d’autres plumes une réponse un peu différente : Entre avoir pour grand-père un misérable singe ou un homme richement doué par la nature et possédant une grande influence, mais qui utilise cependant ses facultés et cette influence dans le but d’introduire le ridicule dans une grave discussion scientifique, j’affirme sans hésiter ma préférence pour le singe. ndlr]
Ces mots soulevèrent un tollé général. Une dame, dit-on, se sentit mal. Une fois le calme rétabli, d’autres prirent encore la parole, dont l’amiral Robert Fitz Roy. Il proclama – en brandissant semble-t-il, une Bible – sa confiance dans un livre dont l’autorité ne pouvait être contestée ; il ajouta qu’il avait souvent reproché à son ami, au cours de leur voyage, de mettre cette autorité en doute, et qu’il déplorait la publication de L’Origine des Espèces.
Voilà pour ce qui concerne l’aspect sentimental du débat. Il donne un aperçu du climat et de la mentalité de l’époque. Il est certain qu’à l’issue de cette assemblée, on se sépara persuadé, de part et d’autre, de l’avoir emporté. En réalité les antidarwiniens ne s’étaient pas moins battus pour une cause perdue et il n’est pas exclu qu’ils s’en étaient rendu compte. Alfred Wallace montra, dans une intervention dont il faut le louer, que l’ouvrage de Darwin révolutionnait l’étude de l’histoire naturelle et que sa théorie de la sélection naturelle reposait sur tant de preuves qu’elle s’était acquise l’adhésion des meilleurs esprits contemporains. Or dans la mesure où ces meilleurs esprits faisaient autorité, le reste finirait bien par suivre.
Cette théorie n’échappait certes pas à toute critique fondée. Elle y prêtait bel et bien le flanc et Darwin était le premier à le reconnaître. On peut dire qu’il passa le reste de sa vie à faire face à la critique et à perfectionner sa doctrine. Il estima que son premier devoir était de faire un exposé clair de ce qu’il n’avait fait qu’esquisser dans son Origine des Espèces : dans quelle mesure l’homme participait-il au processus évolutionniste. Il se mit au travail non sans hésiter et élabora sans hâte l’ouvrage qu’il ne devait publier qu’en 1871 sous le titre de La Descendance de l’Homme ; il y joignit une dissertation sur la Sélection sexuelle. C’est dans ce nouvel ouvrage qu’on trouve l’affirmation à laquelle nous avons déjà fait allusion : nous devons admettre que l’homme descend d’un quadrupède à fourrure et doté d’une queue, probablement de l’espèce arboricole ! Il est vrai que cette affreuse implication avait été complètement digérée entre-temps, de sorte que l’ouvrage, quelle que fût son importance, ne provoqua aucune réaction du genre de celles suscitées par L’Origine des Espèces.
Il ne faudrait pas en conclure que la critique de la théorie générale darwinienne eût cessé de se développer. Bien au contraire. À certains moments Darwin fut même contraint à se rétracter, à juste titre d’ailleurs, mais sur des points secondaires il faut le dire.
Quoi qu’il en soit, si nous voulons apprécier à sa juste valeur la portée universelle du darwinisme, dont le point de départ reste l’expédition du Beagle, nous avons à nous demander maintenant :
a) si cette théorie était vraiment fondée,
b) si elle reste valable aujourd’hui pour nous, et
c) si elle a résisté à l’épreuve du temps.
Nous consacrerons la fin de cette analyse à répondre à ces questions et à voir de quel crédit les thèses de Darwin jouissent encore de nos jours.
Darwin n’a jamais cherché à dissimuler les difficultés de sa théorie et les points sur lesquels elle laissait à désirer. On peut dire que la valeur persuasive de ses deux ouvrages tient en partie à l’honnêteté de l’auteur. Les deux lacunes majeures de sa doctrine, ou, pour nous exprimer mieux, les deux points où Darwin donne l’impression de s’aventurer sur une couche de glace fragile, sont l’insuffisance de ses références dans le domaine des fossiles, et l’absence d’une information suffisante quant au mécanisme de l’hérédité. En ce qui concerne le premier point : – où donc avait-on la preuve de l’évolution d’un animal quel qu’il soit à travers les âges dans les ossements fossilisés alors à disposition ? Et en ce qui concerne le second point : si la Nature supprime dans sa progéniture et sans ménagement tout ce qui est le moins bien adapté au milieu, comment peut-on expliquer la transmission à la descendance privilégiée des caractères les plus avantageux appartenant aux créatures les mieux adaptées ? En d’autres termes quel est le mécanisme de l’hérédité ?
À la première question de la critique, Darwin donna la seule réponse correcte possible, à savoir qu’il n’est pas facile de se référer à une observation parfaite du monde végétal ou animal, surtout en ce qui concerne les espèces actuellement en vie qui ne donnent des fossiles que par chance exceptionnelle ; néanmoins, au fur et à mesure que se poursuivront les recherches, le matériel ira s’enrichissant progressivement et continuellement. De fait Darwin eut finalement sa revanche ; elle tarda à venir mais elle fut éclatante : l’évolution du cheval à partir d’une petite créature pentadactyle a été par exemple démontrée. Quant à prouver l’évolution de l’homme, le problème est plus complexe et nous y reviendrons.
Pour le second des problèmes soulevés, Darwin ne bénéficia pas des circonstances.
En vérité on ignorait tout du mécanisme de l’hérédité à l’époque où il publia ses thèses. On savait naturellement comment s’opérait la fécondation par le sperme mâle de l’ovule femelle dans l’acte sexuel, et comment une vie nouvelle se développait. On savait aussi que ce nouvel organisme allait hériter des caractères de ses parents, bien qu’en proportion variable et imprévisible. Mais au-delà de cette information, tout demeurait obscur. On pourrait penser naturellement qu’il importait peu de connaître le mécanisme de l’hérédité pour que la théorie de Darwin soit reconnue valable, et qu’il suffisait de vérifier si les caractères modifiés se transmettaient bien, ce qu’on pouvait effectivement observer. Cette observation n’était pourtant pas tout à fait exacte, comme nous le verrons et comme allait le faire remarquer un certain ingénieur écossais versé dans la recherche scientifique, M. Fleeming Jenkin.
En 1868, soit neuf ans après la publication de L’Origine des Espèces, Darwin fit paraître un ouvrage sur La Variation des animaux et des plantes à l’état domestique. Il y émet une hypothèse sur la transmission des caractères. À son avis les cellules mâles et femelles devaient évidemment contenir d’une façon ou d’une autre les caractères des organismes dont elles provenaient. Il proposait d’admettre que toutes les cellules d’un corps émettaient des particules infimes, qu’il appela des gemmules, et que ces particules venues de toutes les parties du corps s’accumulaient dans les cellules sexuelles. En fait il n’était pas si loin de la vérité. Quoi qu’il en soit il ne pouvait prouver son hypothèse et son opinion n’était guère convaincante.
C’est à peu près à ce moment que l’ingénieur écossais dont nous avons parlé, M. Jenkin, posa sa question embarrassante dans un article de la North British Review. Pour lui toute la théorie darwinienne de l’évolution reposait bel et bien sur l’hypothèse d’une transmission héréditaire des mutations particulières qui favorisaient une adaptation meilleure de l’être vivant à son milieu. Mais alors, demandait Jenkin, comment cela peut-il se faire ? De tels caractères exceptionnels n’allaient-ils pas être rapidement effacés par les croisements subséquents et rétrogrades avec la masse des individus qui, eux, ne les possédaient pas ? La réponse ne faisait pas de doute : il est certain que le caractère favorable ne tarderait pas à être progressivement dilué, pour finir par disparaître. Darwin était sûr qu’on devait pouvoir donner une explication satisfaisante mais il ne la trouva jamais. On pouvait évidemment admettre que le caractère favorable se consolide au point de forcer son passage dans la descendance. Mais cette manière de penser laissait planer un doute sur le caractère purement fortuit de la mutation, thèse centrale de la théorie de Darwin. Celui-ci chercha à gagner du temps en remontant jusqu’aux hypothèse de Lamarck sur l’emploi et le non-emploi. Mais il ne parvint jamais à résoudre ce problème. Autre difficulté à laquelle il se heurta : celle de la durée du temps écoulé, autre sujet dès longtemps controversé. La lutte contre les fidèles de la Genèse avait été gagnée et on acceptait pratiquement partout dans le monde l’idée d’un âge de la terre, et de la vie sur cette terre, d’une durée énorme. Les géologues s’appliquaient à mesurer cette durée, mais leur effort de précision ne posait aucun problème aux tenants de l’Évolution, puisqu’il était entendu qu’elle était considérable ; il fallait compter en effet par centaines plutôt que par dizaines de millions d’années le temps nécessaire à la lente accumulation de mutations fortuites impliquées dans le processus évolutif. Mais voici qu’intervint Lord Kelvin, physicien de renom. Il exposa en termes mesurés et convaincants sa thèse de la lente mais inévitable déperdition de la chaleur solaire. Il s’inscrivit en faux contre les géologues et traita de haut l’évolutionnisme des darwiniens en n’attribuant à la terre pas plus un long passé qu’un long avenir. Son passé ne pouvait excéder, à son avis, 20 millions d’années. À ce sujet Darwin écrivit à son vieil ami Lyell, en 1868 : tout ce qui a trait au soleil me préoccupe beaucoup. Et sur ce point encore il lui fallut faire une concession à la critique en admettant dans la mutation des espèces la possibilité de sauts beaucoup plus marqués et relevant par conséquent moins du hasard. En ce qui concernait l’homme, le problème particulier d’une vérification inadéquate, en partant des fossiles, ne troubla pas exagérément, semble-t-il, le Darwin des dernières années. Néanmoins l’opinion générale demeurait embourbée sur ce point, et elle ne fut guère plus éclairée jusqu’à la mort de Darwin. On inventa le terme du chaînon manquant, c’est-à-dire de la créature qui restait à découvrir dans le passé pour que soit comblé le fossé ; pour le public ce fossé était celui qui sépare l’homme du singe, et pour le milieu scientifique, celui qui sépare l’homme d’une créature de l’ordre des primates, parente éloignée à la fois de l’homme et du singe. On admettait depuis longtemps que les quadrumanes appartenaient tous à des espèces étroitement apparentées comme l’avait affirmé Owen – mais sans que l’on mît pour autant en doute la fixité de ces espèces. On avait beaucoup épilogué sur l’existence probable de tribus humaines primitives dont les représentants devaient être à mi-chemin du singe. Jusqu’à un certain point Darwin souscrivit à cette hypothèse peu féconde. Il avait été plus proche de la vérité que la plupart des autres chercheurs le jour où, en compagnie de Fitz Roy, il avait pris congé des Fuégiens qui regagnaient leur terre. Il avait écrit alors dans son Journal : contrairement à ce qu’on a souvent prétendu, il a suffi pratiquement de trois années pour transformer ces sauvages en parfaits Européens d’adoption, du moins pour ce qui a trait à leur comportement.
On commençait à exhumer des squelettes humains du paléolithique. Mais nous savons qu’il s’agit là de documents si récents dans le processus de l’évolution qu’ils sont entièrement conformes au type moderne tant pour la boîte crânienne que pour l’ossature ; aussi les darwinistes en furent-ils quelque peu déconcertés. Ils le furent davantage encore lorsqu’en 1856 et en 1886 on découvrit les restes du Neandertal. On crut avoir trouvé une créature humaine de la préhistoire, mais la boîte crânienne paraissait plus grande que celle de l’homme moderne. Les darwinistes ne s’attendaient pas à cela, tant s’en faut ; ils prévoyaient au contraire une créature à la démarche traînante, aux bras longs, au crâne aplati, quelque chose entre le gorille et un Hottentot. – Les Hottentots représentaient alors ce qu’on tenait pour le plus bas échelon des sauvages, depuis la découverte qu’en avaient faite au XVII° siècle les marins hollandais et sur la base des rapports bien approximatifs qu’ils en avaient donnés.
Un tel chaînon eût-il fini par se découvrir que Darwin n’eût pas été au bout de ses peines. Les difficultés subsistaient. Il avait à combattre un nouveau contradicteur, un noble cette fois, lui aussi versé dans les sciences, le duc d’Argyll. Ce gentleman fit remarquer que l’homme, sauf pour ce qui a trait à son cerveau, se révèle faible et désarmé en comparaison des autres animaux. Mais alors, demandait-il, comment un homme, qui n’aurait évolué qu’avec lenteur, aurait-il pu survivre tout en s’affaiblissant progressivement ? Darwin qui commençait probablement à ressentir la fatigue, répondit que l’homme avait peut-être assumé ses mutations à l’abri de quelque île protectrice, voire sur un continent isolé comme l’Australie.
Darwin mourut en 1882, reconnu comme un grand précurseur en science, digne d’être enseveli à l’Abbaye de Westminster aux côtés de Sir Isaac Newton. Cependant, comme nous venons de le voir, sa doctrine paraissait sérieusement entamée et, à l’époque de sa mort comme dans les années qui la suivirent immédiatement, sa renommée était descendue à un niveau plutôt bas. Puis vint le retournement des choses, et une revanche presque totale. De nos jours, sa théorie semble plus établie que jamais, après avoir été rajeunie sur certains points et corroborée scientifiquement par une quantité de preuves nouvelles.
Les trois sciences modernes qui sont venues appuyer les thèses darwiniennes sont la génétique, la paléontologie et la physique atomique. Nous allons les énumérer dans l’ordre inverse, et, pour la première, les choses sont vite dites : elle balaye la suffisance et les prétentions de Lord Kelvin d’un seul coup – car on peut bien dire qu’en l’état actuel de nos connaissances, elle ne laisse subsister aucun doute. Le soleil ne se consume pas à la manière d’un feu. C’est un producteur d’énergie atomique qui utilise la matière à un rythme si lent qu’il ne nous laisse pas nécessairement qu’un avenir de peu de durée et de peu d’importance, et notre passé peut fort bien se mesurer en centaines de millions d’années. Il offre donc à l’évolution tout le temps dont elle peut avoir besoin.
En second lieu, la paléontologie, la science des êtres et des choses des temps géologiques. Elle s’intéresse à l’étude des fossiles et spécialement aujourd’hui des fossiles d’origine humaine. Les progrès de cette science ont virtuellement vidé de tout sens le terme de chaînon manquant. On a pu suivre l’évolution de l’homme à ses différents stades à partir d’une créature se rattachant à l’espèce préprimate. La chaîne n’est certes pas complète – on pourrait même parler au pluriel de chaînons manquants – mais cette chaîne existe.
Nous ne pouvons ici entrer dans le détail ; nous allons plutôt nous borner à interpréter le sens des découvertes qui ont été faites. La première importante a été celle de l’Homme de Java, le Pithecanthropus erectus d’Eugène Dubois. À cette découverte vinrent s’ajouter beaucoup d’autres au XX° siècle, faites la plupart au profond des vallées de l’Afrique centrale orientale, par des hommes tels que Raymond Dart et Robert Broom, et plus récemment, le professeur Leakey. Beaucoup de ces découvertes appartiennent à la classe du Pithécanthrope, quelques-unes sont de celle de l’Australopithèque, terme qui ne signifie pas Homme-Singe, mais Singe austral. On a trouvé en outre beaucoup de crânes de l’Homme de Cro-Magnon, le premier Homo sapiens achevé d’Europe, et bien d’autres exemplaires de l’Homme du Neandertal, l’étonnante variété dont nous avons parlé. On a découvert pour le perdre ensuite – un Eoanthropus, ou Homme de l’origine, représenté par le crâne de Piltdown.
Le crâne de Piltdown présente un intérêt particulier pour la simple raison qu’il releva d’une supercherie et que l’on put ainsi se rendre compte de la facilité avec laquelle les gens sont amenés à croire qu’ils ont trouvé ce qu’ils désirent trouver et, dans ce cas-là, de ce qu’on souhaitait découvrir dans les premières décennies du XX° siècle. Dans les années cinquante de ce siècle on a démontré que les découvertes connues sous le nom de crâne de Piltdown comprenaient la mâchoire d’un chimpanzé et une boîte crânienne humaine du néolithique, soit d’un homme moderne. S’il avait existé, cet être aurait eu la démarche du singe et le cerveau de l’Homo sapiens.
On pense maintenant que le processus d’évolution a suivi en réalité une marche inverse. L’homme a commencé par se tenir debout, se débarrassant ainsi de son allure simiesque, avant de développer de façon appréciable la capacité de son cerveau. Ensuite, le fait d’avoir libéré ses mains pour un usage plus différencié a créé une symbiose féconde entre sa main, son cerveau et ses yeux, ce qui a permis dans l’évolution un progrès proprement extraordinaire. Il est significatif que le chercheur Wallace, le compagnon de Darwin, qui a vécu jusqu’en 1912 et avait bien compris ce que le cerveau humain représentait d’unique, n’ait jamais accordé de valeur probante au crâne de Piltdown alors même qu’il lui eût été difficile de croire à une mystification. Quoi qu’il en soit, on avait trouvé la réponse à donner au duc d’Argyll : si faible qu’ait pu être physiquement le premier homme, le parti qu’il pouvait tirer, pour survivre, d’un cerveau mieux meublé, suffit à expliquer cette survivance.
Il en va de même pour l’Homme du Neandertal ; il est considéré comme une créature tardive et l’on pense aujourd’hui en général qu’il n’est pour rien dans l’apparition de l’Homo sapiens. Là encore, si l’on tient compte de tous les éléments, il est significatif aussi de s’apercevoir que, plus les ossements du Neandertal sont de date récente, plus ils s’éloignent de notre propre ossature – et non point le contraire. Il semble donc que l’être du Neandertal ait appartenu à une branche généalogique qui promettait beaucoup, mais qui a disparu ; peut-être était-il spécialisé à l’excès à l’époque glaciaire et n’a-t-il plus pu s’adapter à de nouvelles conditions d’existence ?
L’histoire du développement de la génétique et la manière dont cette science a comblé la lacune que laissait subsister dans le darwinisme la conception qu’on se faisait au XIX° siècle du mécanisme de l’hérédité, est extraordinaire et, dans une certaine mesure, dramatique. La solution du problème était à portée de Darwin mais il l’a ignorée.
En février 1865, soit 5 ans et trois mois après la publication de L’Origine des Espèces, le Père Gregor Mendel, un prêtre catholique autrichien, donna deux conférences à Brünn devant la Société des Sciences naturelles. Le sujet en était : l’expérimentation dans l’hybridation des plantes et Mendel y faisait état de ce que nous connaissons maintenant sous le nom de théorie de Mendel sur la génétique. Environ une quarantaine de personnes l’entendirent et en furent sans doute impressionnées ; le texte fut dûment enregistré, au protocole de la Société – mais le monde scientifique extérieur, ignora tout de ces exposés. Le drame fut d’abord pour Mendel qui ne connut jamais la célébrité qu’il avait espérée dans ce milieu scientifique et qu’il eût d’ailleurs largement méritée. Mais il fut, bien que dans une moindre mesure, aussi pour Darwin, qui eût trouvé chez Mendel de quoi faire taire l’ingénieur écossais et sauver son hypothèse hasardeuse des gemmules.
Il n’est pas besoin ici de connaître dans le détailles découvertes de Mendel pour pouvoir apprécier leur valeur dans l’évolutionnisme. Comme on sait, il fit ses expériences sur les végétaux, surtout sur les pois de senteur, en observant comment certains caractères, par exemple la couleur de la fleur et l’aspect de la graine, se répétaient à travers les générations au fur et à mesure des croisements qu’il opérait. Il découvrit ainsi la loi aujourd’hui bien connue des caractères héréditaires dominants et des caractères récessifs.
Ce n’est pas cette découverte-là qui fut la plus importante, mais bien celle, plus générale et plus fondamentale, de ce qu’on appelle aujourd’hui l’hérédité particulaire. Ou pour nous exprimer de façon plus accessible, la découverte que les caractères des parents ne se perdaient pas, ne s’effaçaient pas, comme l’avait prétendu avec tant d’insistance Fleeming Jenkin. Ils continuaient bien plutôt à réapparaître chez les descendants et, quand ce n’était pas le cas, ils subsistaient comme en sommeil pour revenir par la suite dans une génération favorable. Par exemple une personne aux yeux bleus en se mariant à une autre aux yeux bruns peut engendrer des enfants aux yeux bruns ; mais les caractères bleus n’ont pas disparu à jamais, puisque des parents ayant tous deux des yeux bruns peuvent avoir un enfant aux yeux bleus.
Ces découvertes de Mendel furent refaites en 1900 et, chose curieuse, séparément cette fois par trois botanistes, un Allemand, un Autrichien et un Hollandais. La conséquence en fut un progrès décisif en cytologie, ou science de la cellule vivante ; on peut même dire qu’une nouvelle science était née, la génétique (ou science des origines de la vie). Cette discipline se révéla pleine de promesses.
En Angleterre William Bateson (qui baptisa cette science) et en Amérique Thomas Hunt Morgan lui firent faire les plus grands progrès. On démontra que la théorie de Mendel s’appliquait aussi bien au règne animal qu’au règne végétal. On démontra que les chromosomes, ces éléments filiformes contenus dans le noyau de toutes les cellules vivantes et que l’on connaissait déjà, portaient le long de leur filament les gènes qui n’étaient rien d’autre que les facteurs des lois de l’hérédité déjà observées par Mendel. On démontra que des transformations importantes, bien que rares, les mutations, s’opéraient dans les gènes. On démontra encore, avec l’appui d’expériences poussées (faites par exemple sur des êtres à reproduction rapide comme les drosophiles, les mouches à fruits ordinaires) et basées sur des statistiques tout aussi poussées et précises, dans quelle mesure exacte les gènes et leurs mutations engendraient des modifications physiques au cours des générations successives. Les processus sont fort compliqués et enchevêtrés, de sorte que certains généticiens ne parlent plus, de nos jours, de gènes simples mais du gène complexe. L’important c’est qu’ils ont prouvé de manière irréfutable comment s’opèrent à partir des gènes les modifications de la vie qui rendent possible l’intervention d’une sélection naturelle. Finalement donc Darwin a eu sa revanche.
La génétique moderne a eu encore un autre résultat qui est la réfutation en tout, et par tout le monde – à l’exception peut-être des esprits les plus bornés -, des thèses de Lamarck pour qui les caractères et les comportements qu’un être s’est acquis par l’emploi – ou par le non-emploi – de ses organes peuvent se transmettre à la génération suivante. Il est important de noter ce point car la théorie lamarckienne a toujours séduit un grand nombre d’évolutionnistes aussi bien avant qu’après Darwin. Il reste encore un aspect du darwinisme à prendre en considération avant de dresser le bilan de l’influence universelle de cette grande doctrine et de prendre congé de son promoteur. Cet aspect nous ramène au fougueux évêque d’Oxford.
Ne nous faisons pas d’illusions, la théorie de Darwin avait alerté non seulement les chrétiens convaincus mais tous les esprits sérieux de l’époque. Allait-il falloir ramener tout le développement de la vie, celui de l’homme compris, à l’œuvre d’un destin aveugle et au sort affligeant du hasard ? Certes pas ! L’insistance d’un Lamarck sur l’importance des habitudes acquises et du comportement, l’affirmation d’une existence qui, consciemment ou inconsciemment, tendait à son amélioration, finiraient bien par trouver une justification. Samuel Butler, un utopiste victorien, s’était dressé violemment contre Darwin de son vivant. Plus tard c’est le philosophe français Bergson qui postulera son Élan vital, une impulsion toute chargée d’évolution ; puis George Bernard Shaw lui succédera avec sa pièce Retour à Mathusalem où il fait l’éloge de l’évolution créatrice. Mais la science ne peut leur apporter sa caution pour la raison que l’hypothèse, fondamentale pour Lamarck, d’une transmission des caractères acquis n’a pas pu être démontrée.
Et pourtant il y a moyen d’échapper de manière constructive au pur matérialisme du darwinisme tel qu’il a été défini à l’origine et tel que l’ont propagé ses disciples. Tout d’abord il faut souligner que ce pur matérialisme a été inutilement exagéré. À certains égards Darwin a été desservi par ses disciples ; par exemple des hommes tels que Herbert Spencer en Angleterre, ou Ernst Haeckel en Allemagne ont, semble-t-il, pris plaisir à insister sur l’idée que la vie n’est rien d’autre que la lutte égocentrique d’une espèce contre une autre, et à l’intérieur de chaque espèce de chaque individu contre les autres. C’est Spencer qui inventa l’argument de la survivance du plus capable, et il est certain que Darwin eût déploré une telle interprétation. En second lieu, on s’est peu à peu rendu compte qu’il était possible d’accepter le darwinisme, sans pour autant verser dans un froid matérialisme, en discernant derrière l’évolution de la vie la réalisation d’un dessein, ou tout au moins quelque chose de plus satisfaisant que l’œuvre d’un hasard aveugle. Il faut citer ici deux noms : celui du prêtre jésuite français (décédé en 1955) Teilhard de Chardin, et celui du professeur de zoologie d’Oxford, Sir Alister Hardy. Nous ne pouvons malheureusement rendre justice ni à l’un ni à l’autre dans le cadre de cette étude, mais nous nous efforcerons de donner très brièvement l’essentiel de leur enseignement tel que nous le comprenons.
Chardin a mis l’accent sur le fait que la vie atteste une tendance au progrès dans une perspective bien caractérisée qui est celle d’un accroissement graduel du rôle joué par le cerveau, c’est-à-dire par l’esprit. L’homme est le protagoniste et l’illustration par excellence de ce phénomène, il est la créature dotée du plus grand cerveau, celle qui peut modifier effectivement tout l’avenir de l’évolution. Sir Julian Huxley, le petit-fils de celui qu’on surnommait le bulldog de Darwin partage l’opinion de Chardin sur ce point. Pour sa part, Sir Alister Hardy apporte aux fidèles de Lamarck de nouvelles raisons d’espérer. Non pas, il faut bien le dire, en sanctionnant l’idée d’un transmission des caractères acquis ; mais, dit Sir Alister, si telle faune voit son milieu se modifier, il lui faudra nécessairement aussi modifier ses habitudes et sa conduite. En conséquence des transformations vont s’opérer, tôt ou tard, à l’intérieur du gène complexe de cette faune et elles provoqueront des modifications dans la structure de l’animal qui lui faciliteront son adaptation au milieu. Les individus qui hériteront de cette nouvelle structure, et seront par là rendus plus efficaces, auront tendance à l’emporter sur les moins bien adaptés. En d’autres termes, si, en apparence, nous assistons au même processus que celui évoqué par Lamarck, ce sera pour des raisons purement darwiniennes de sélection naturelle. Ajoutons que ce processus est conditionné par le comportement de l’animal. La vie sous toutes ses formes est énergie, recherche ; à son stade le plus élevé elle est même prospection, entreprise. On peut donc dire qu’elle se sert de la sélection naturelle. Voilà pour la position de ces deux hommes. Encore une fois nous n’avons fait qu’esquisser leur thèse telle que nous l’avons comprise. Nous n’avons pas à nous justifier de les avoir cités ici. Le lecteur a le droit d’avoir sa propre idée, son idée favorite de l’évolution – la plupart d’entre nous sommes dans ce cas – et il nous saura gré de l’avoir mis au courant des dernières tendances, qu’elles soient ou non conformes à l’orthodoxie.
Ceci nous amène tout naturellement à notre dernier devoir qui est de rappeler combien de nouvelles perspectives se sont ouvertes à la réflexion humaine depuis l’avènement du transformisme darwinien. Le changement est évident pour notre manière de penser.
Nous pouvons certes discuter des moyens et de la portée de l’Évolution, mais cela ne nous empêche pas d’en accepter le fait.
Nos conceptions sont, ipso facto, absolument différentes de ce qu’elles étaient il y a un siècle. Nous ne pouvons plus imaginer le monde comme statique, créé une fois pour toutes et pour l’éternité. Toutes choses nous apparaissent en mouvement, en transformation, en évolution. Et ce n’est pas en biologie seulement, mais dans toutes les autres sciences, que Darwin a ouvert ces perspectives, ces conceptions nouvelles et vivifiantes. Il en va de même pour l’éthique et la philosophie. L’homme se sent une nouvelle responsabilité, une responsabilité d’autre nature, envers le reste des êtres vivants auquel il se sait maintenant étroitement lié.
À ce sujet, donnons à Darwin l’occasion de conclure. Nous citons ce passage tiré du dernier paragraphe de La Descendance de l’Homme : On ne peut tenir rigueur à l’homme d’éprouver quelque orgueil de son ascension au sommet de l’échelle des êtres vivants, lors même qu’il ne le doit pas à ses propres efforts ; et le fait qu’il ait été ainsi élevé à cette place plutôt que de l’avoir occupée dès l’origine, l’autorise à espérer un destin plus haut encore dans un lointain avenir…
Prenons donc congé de Darwin sur ces paroles optimistes et de pieuse espérance. Nous n’y trouverons pas un prétexte à sourire avec condescendance. Darwin fut un Victorien, et les Victoriens ont cultivé l’optimisme et la sainte espérance – ce qui n’a pas été nécessairement une faute de leur part. Mais c’est encore par tempérament que Darwin fut optimiste, humain, aimable et bienveillant. On s’en aperçoit en lisant son Voyage du Beagle, sa relation de l’événement qui marqua toute sa vie et qu’il dut se remémorer souvent et avec un brin de nostalgie sans doute.
Le jeune équipage du Beagle l’avait surnommé le philosophe, un peu par plaisanterie, beaucoup par admiration. Il ne croyait pas si bien dire.
H. E. L. Mellersh, Linnean Society, 1970
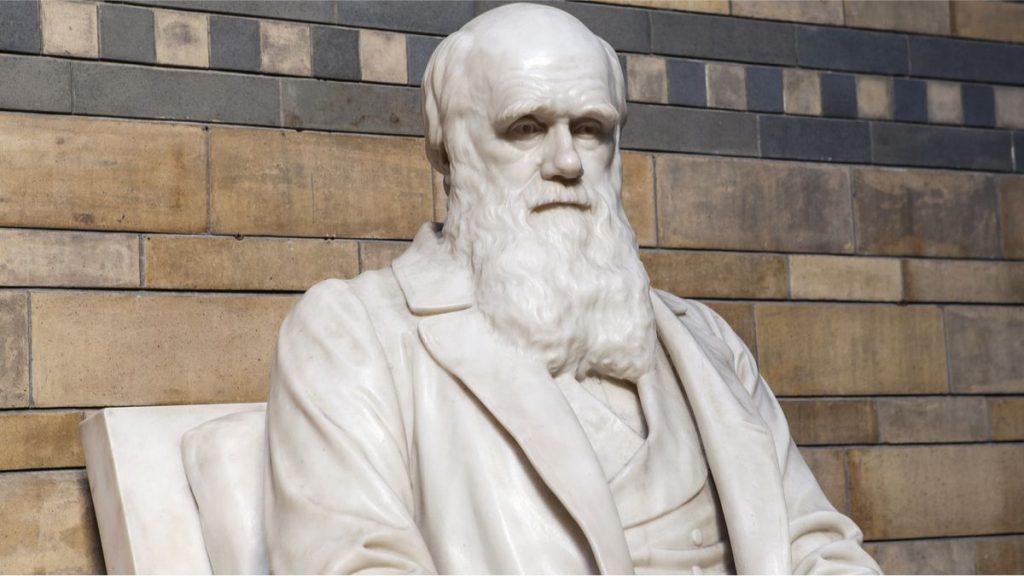
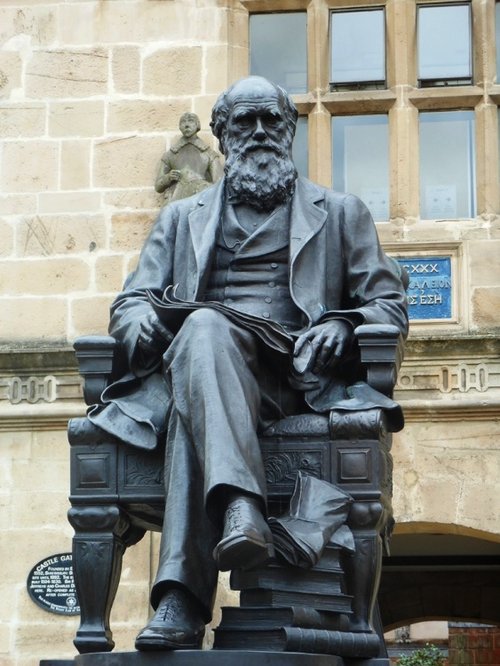
Statue de Darwin, Shrewsbury Library
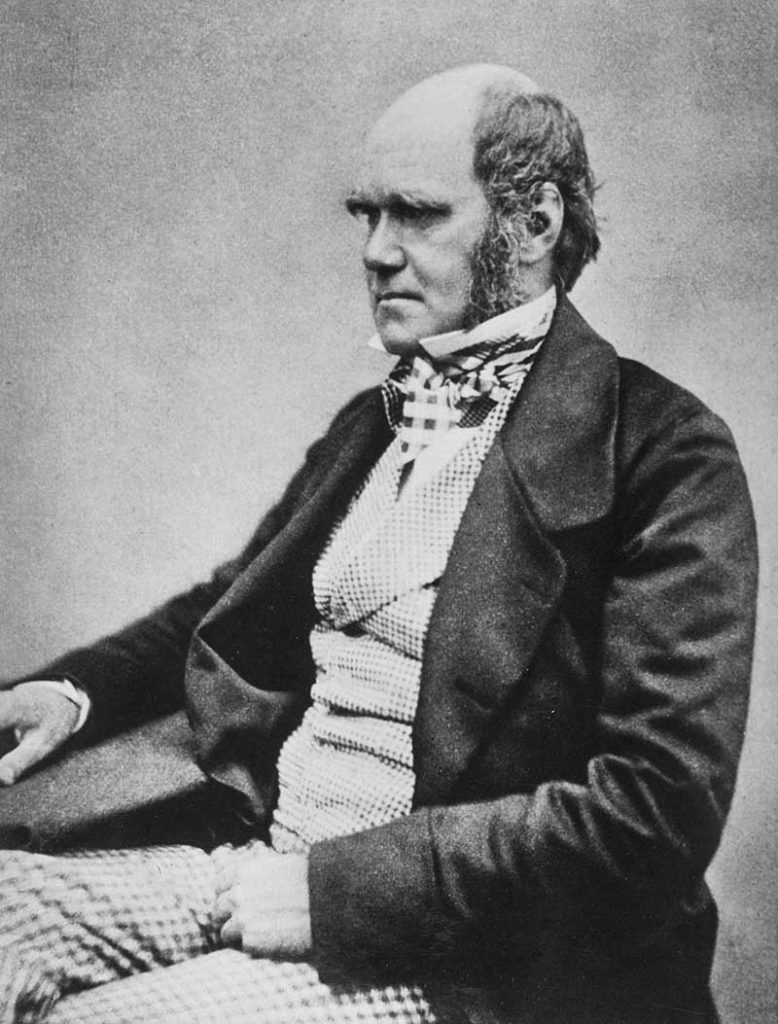
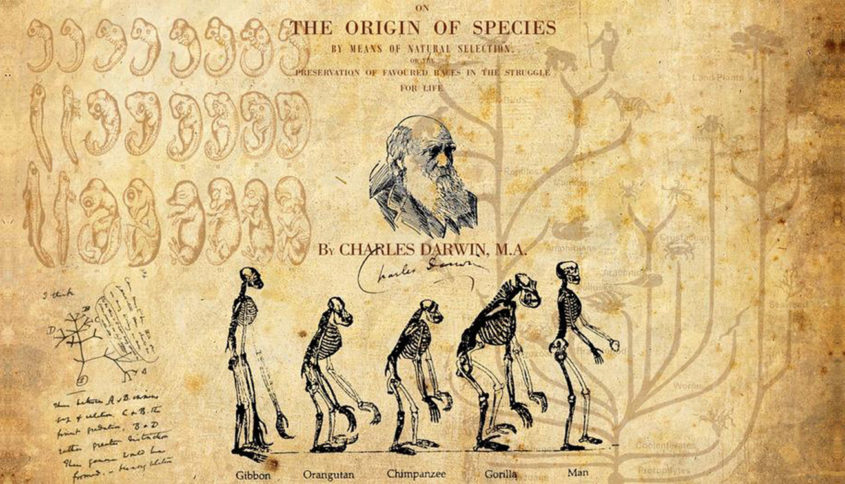

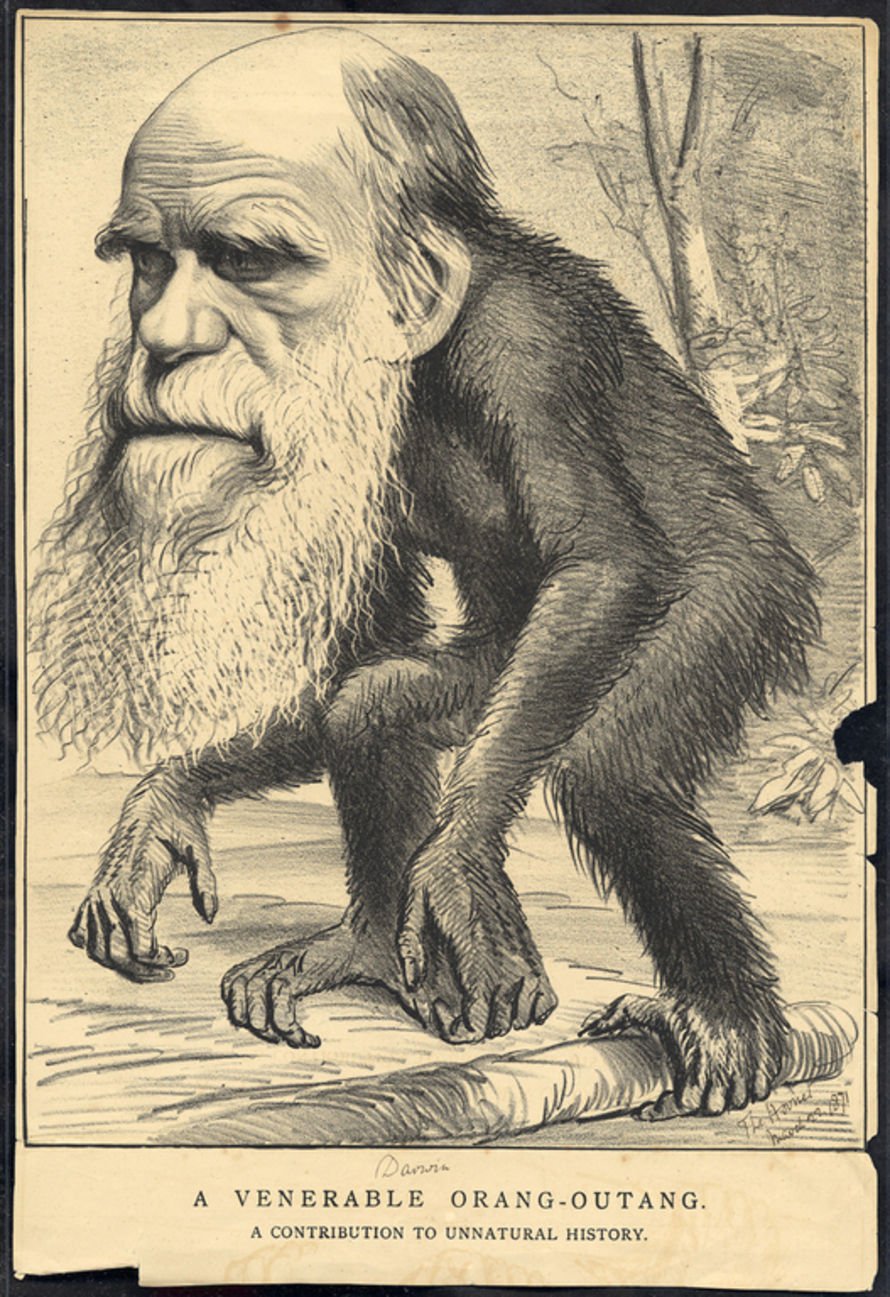
et fleurirent les caricatures, puisque s’exerçait déjà la liberté d’expression, véritable vache sacrée… à même d’engendrer une grande variété de singes


Pascal Picq, sur le site Kaizen, Propos recueillis par Sabah Rahmani avril 2020 :
Vous écrivez que notre lignée devient humaine en inventant la coévolution. Qu’est-ce que la coévolution ?
La coévolution signifie qu’aucune espèce n’évolue par elle-même. Elle est influencée par de multiples facteurs : la biologie, l’environnement et le milieu technoculturel. Par exemple, en mangeant, on modifie notre microbiote. On sait que notre nourriture et notre environnement conditionnent notre physiologie, mais aussi nos capacités cognitives. Cela est vrai pour toutes les espèces. Cela peut paraître simple, mais il y a encore vingt-trente ans, l’idéologie du progrès, en médecine notamment, affirmait que l’homme s’était affranchi des contraintes de la nature, et que tout ce qui était lié à la sélection naturelle et aux mécanismes d’évolution en général ne s’appliquait plus. Le transhumanisme technohalluciné en est la forme actuelle. Que nenni ! On s’aperçoit aujourd’hui que nos comportements, la pollution, nos habitudes sociales, notre alimentation, etc., modifient les expressions de nos gènes et se transmettent en partie ; c’est l’épigénétique. Car nous sommes en réalité des espèces très plastiques d’un point de vue physiologique, cognitif et morphologique : on peut changer très vite de taille et de forme. Outre notre environnement naturel, nous sommes aussi modulés, sélectionnés, transformés par nos environnements technique et culturel : c’est l’évolution bioculturelle.
Par exemple ?
Les personnes de ma génération, les baby-boomers, ont eu plus d’accès à l’éducation et à la culture, à la médecine, à une meilleure alimentation, à plus de confort et d’hygiène, à de meilleures conditions de travail, aux avancées sociales, etc. Au final, que s’est-il passé ? 10 à 15 centimètres de taille corporelle en plus et vingt-cinq ans d’espérance de vie gagnés en moyenne. En une génération ! Voilà comment nous, les humains, en changeant notre environnement technique, culturel et social, on peut changer très vite. Je souligne que ces avancées étaient avant tout inscrites dans un projet de société, pas seulement technique, qui est remis en cause de nos jours en raison de ses conséquences sur la planète. En effet, quel succès ! Depuis que je suis né, la population mondiale a triplé et a consommé et voyagé comme jamais. Mais on oublie deux règles de l’évolution : plus on a de succès, plus il faut s’adapter aux conséquences de ce succès et quoi qu’on fasse, toute évolution est un compromis jusqu’à ce que les avantages butent sur les désavantages.
C’est le cas actuellement ?
La plasticité peut aller dans le bon comme le mauvais sens. La révolution numérique a des effets négatifs sur notre morphologie, car elle induit plus de sédentarité, des risques d’obésité, une perte de la vue de loin et de la robustesse des muscles de la nuque ; par ailleurs, elle modifie les relations sociales, la libido, etc.
Il y a deux millions d’années, l’humanité avait déjà connu une révolution technique généralisée qui a modifié l’ensemble de l’adaptation de son espèce : le feu ! La cuisson des végétaux, plus que celle de la viande, a eu des conséquences très rapides ; la taille corporelle d’Homo erectus a augmenté rapidement à l’échelle de l’évolution, et en cinq cent mille ans, le volume du cerveau a doublé. Grâce au feu et aux outils de pierre et de bois qui vont avec, les humains ont construit des abris pour se protéger du monde extérieur, leur permettant de conquérir des niches écologiques où jamais aucun singe ou grand singe ne s’étaient aventuré, notamment vers les hautes latitudes. L’évolution bioculturelle d’Homo lui confère une puissance écologique qui ne cesse de croître, avec une accélération effarante au XX° siècle. Voilà comment la technologie du feu a pu modifier notre évolution, et peu à peu modifier la face de la planète.
Ce mauvais sens, c’est ce que vous nommez la mal évolution ?
Si la plasticité humaine est un don de notre évolution, cela veut dire aussi que l’on peut changer très vite en fonction des perturbations de nos environnements, notamment urbains puisque, depuis 2007, la majorité de la population mondiale est urbanisée, et que cela va en augmentant. Depuis vingt ans, les problèmes liés aux pollutions sont devenus les premières sources de maladies au monde. D’après les rapports récents de l’OMS (2018), les pollutions des atmosphères intérieures et extérieures de nos logements sont chacune responsables de quatre millions de morts prématurées dans le monde. Les insecticides et les perturbateurs endocriniens affectent considérablement notre santé, notamment celle des femmes enceintes et celle des enfants, lesquels sont victimes de maladies respiratoires. Les hommes ont perdu la moitié de leurs spermatozoïdes. Tous les aspects de notre biologie liés à la reproduction se montrent très sensibles à nos changements d’environnement. Les allergies sont quant à elles devenues plus nombreuses, de même que l’on observe une augmentation des maladies auto-immunes. Ce qui a été un progrès, comme l’hygiène et l’asepsie, se retourne contre nos systèmes immunitaires, ce qu’on appelle l’hypothèse hygiéniste ou les vieux amis. Nous avons besoin d’être en contact avec des micro-organismes plus ou moins pathogènes pour édifier nos défenses naturelles, d’enrichir notre microbiote pour que nos systèmes immunologiques se développent et ne se retournent pas contre nous. Donc, d’un côté nous ne sollicitons plus les héritages immunologiques acquis et transmis par nos ancêtres et, en plus, nous modifions nos environnements et nos habitudes comme jamais. Si vous voulez comprendre ce qui se passe, je vous invite à relire et revoir la fin de La Guerre des mondes, le livre de H.G. Wells, comme le film de Steven Spielberg. Nous ne sommes jamais sortis de la guerre des mondes microbiotiques.
Les climatosceptiques mettent en avant le fait que l’humanité a déjà survécu à des changements climatiques durant les âges glaciaires, et que celui que nous vivons aujourd’hui n’est donc pas à craindre pour notre espèce. Qu’en pensez-vous ?
Ils ont raison, l’homme va survivre puisque nous sommes 7,7 milliards. Mais la question est de savoir qui va survivre et comment ? Les climatosceptiques, qui opposent leurs convictions au doute méthodologique de la science – c’est tout le problème de la pensée cartésienne –, pensent que ce sont eux qui vont survivre. Je rappelle qu’il ne reste qu’une seule espèce d’homme sur la Terre alors qu’il y a encore cinquante mille ans – hier -, il y en avait au moins six contemporaines, dont la nôtre, Sapiens. L’homme a survécu, mais seulement une partie de l’humanité de la fin de la préhistoire. Alors, qui aura le plus de chance de survivre dans les décennies qui viennent avec les dérèglements climatiques, le vieillissement des populations, la détérioration des communautés écologiques et, comme le rappelle dramatiquement l’actualité, l’émergence de nouveaux virus et autres agents pathogènes, comme le coronavirus en Chine. Si je devais faire un pari, je pense que les peuples dit racines ou traditionnels à la périphérie des mégalopoles ont plus de chance de contribuer à l’humanité de demain en cas de pandémie.
Vous parlez aussi de l’importance de la cosmologie, des représentations du monde, de la dimension immatérielle dans l’évolution et les civilisations. En quoi celle-ci peut-elle faire la différence ?
La dimension idéelle pose en effet la question du sens. Par exemple, utilise-t-on les technologies dans une volonté de toute-puissance, comme l’ont beaucoup fait les Occidentaux, ou avec l’idée d’améliorer les conditions humaines ? La technologie est une arme à double tranchant. Ce qui m’inquiète, c’est l’idée de prétendre, comme le font les transhumanistes, qu’elle va améliorer, trouver des solutions et sauver le système dans lequel nous sommes, sans le refonder. C’est comme pour la décroissance ; pour moi, ce n’est pas une question de croître ou décroître, c’est le modèle qui n’est plus bon. Décroître dans un système qui ne marche pas, ça ne marchera pas non plus. Il devient urgent d’abandonner le modèle de l’économie linéaire qui a prévalu pendant les deux siècles de la civilisation industrielle : prélever-transformer-produire-vendre-utiliser-jeter. Il faut développer les économies circulaires et écosystémiques.
La technologie n’est un progrès qu’à partir du moment où elle participe d’un autre projet inscrit dans une vision du monde partagée, pas pour solutionner les défauts d’un modèle moribond, même si, historiquement, celui-ci a permis des avancées. Elle peut être un formidable outil, notamment pour l’écologie. Depuis quelques années, on parle de plus en plus d’écosystèmes. Or rien de plus complexe qu’un écosystème, car il faut analyser des milliers, voire des millions de données. C’est possible grâce aux puissances de calcul, aux données et aux algorithmes de l’intelligence artificielle. Mais n’oublions pas que les usages des appareils connectés ont aussi de profonds impacts sur l’écosystème terrestre, notamment en termes de consommation d’énergie.
Alors, comment édifier une cosmogonie commune à toute l’humanité de demain ? Toute cosmogonie évoque une origine. Ce grand récit est celui de la paléoanthropologie : toutes les femmes et les hommes, tous les Sapiens, partagent une origine commune et récente et, contrairement aux apparences, nous avons une faible diversité génétique. Reste à construire une politique de civilisation qui s’appuie sur cette unité d’origine et orientée vers une destinée commune, mais dans la diversité.
Comment ?
Cela ne va pas être simple, mais j’espère que la mobilisation sociétale, poussée par les personnes les plus actives dans les questions environnementales, va aider à une plus grande prise de conscience dans toutes les sociétés du monde. Et que l’on soit capable d’apprendre, comme disait l’anthropologue Claude Lévi-Strauss, de la diversité des autres cultures et d’autres rapports à la nature. Aucune culture n’a tout bon ou tout faux, on peut s’inspirer les uns des autres. Or aujourd’hui, nous n’avons pas de grand projet pour l’humanité et la situation nous dépasse. Mais cela peut advenir avec la révolution écologique et la révolution numérique qui fait que, de nos jours, nous sommes tous connectés.
Vous écrivez que les espèces comme les civilisations vivent sur leurs adaptations du passé, mais leur survie dépend de leur capacité à inventer les adaptations à un monde qu’elles ont contribué à modifier.
Ce que je veux dire par là, c’est que notre évolution est une coévolution. Les théories de l’évolution sont des théories des variations, des diversités. Notre culture ne comprend rien à l’évolution en dehors du champ de la biologie. Darwin, ce n’est pas la loi du plus fort, c’est pourquoi il y a des variations, d’où viennent-elles, comment certaines se diffusent et d’autres pas. Le concept le plus fondamental est que toute différence est une chance potentielle pour s’adapter à un monde qui change. Face à l’incertain, il faut de la diversité. Par conséquent, toute destruction potentielle d’une espèce ou d’un écosystème nuit à nos capacités de nous adapter à un monde que nous contribuons tant à transformer
Il existe trois types de biodiversités indissociables, sur lesquelles nous avons une influence : la biodiversité naturelle, la biodiversité des espèces domestiquées (plantes et animaux) et la diversité culturelle. On parle souvent de la perte de la biodiversité naturelle, mais on assiste aussi à une perte de biodiversité des espèces domestiquées en privilégiant les monocultures et l’élevage intensif de certaines races au détriment d’autres. Pourtant, une graine est aussi le fruit de centaines d’années de coévolution avec des techniques agricoles, des savoir-faire qui ne peuvent pas être préservés dans une banque de semences ! [75 % des semences anciennes ont disparu depuis vingt-cinq ans. ndlr.] Si des entreprises comme Monsanto ou Syngenta ne comprennent rien à l’évolution, il faudrait aussi s’interroger sur l’enseignement de la philosophie et de l’histoire dans les grandes écoles d’ingénieurs !
D’où les changements peuvent-ils venir ?
Il y a cinquante ans, des jeunes dans le monde entier ont bousculé les archaïsmes des sociétés issues de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, Greta Thunberg et beaucoup d’autres dans le monde utilisent les réseaux et manifestent dans les villes. D’autre part, les appareils connectés et les créations d’applications favorisent le développement de nombreuses formes d’économie sociale et solidaire. Et il n’y a pas que les jeunes. Aux USA, ce sont les jeunes seniors qui créent le plus de start-up (ceux de 1968). Des juniors et des seniors. Et les autres, celles et ceux qui sont les plus actifs ? Là aussi, ça change.
Le 19 août 2019, le Business Roundtable a réuni à New York 181 patrons des plus grandes entreprises ; ils ont publié une charte disant qu’on ne pourrait pas continuer ainsi dans les quinze ans à venir au vu de la détérioration de l’écologie et de l’augmentation des inégalités sociales. Ils ont compris que même s’ils continuent de rémunérer les actionnaires (stakholders), ils ne pourront pas prospérer dans un contexte de plus en plus détérioré dont ils sont en partie responsables. On parle d’entreprises hybrides, qui font la part entre les intérêts des actionnaires et des parties prenantes de la société (shareholders). On n’en est qu’au début, mais avec l’arrivée de milléniaux aux postes de décision comme dans les fonds d’investissement éthiques, verts ou autres, cela peut changer rapidement, sans oublier que les jeunes diplômés sont plus regardants sur les authentiques approches RSE des entreprises, et les clients plus attentifs à la dimension sociale et écoresponsable. Les entreprises qui se risquent aujourd’hui au greenwashing ou au socialwashing prennent de vrais risques.
Une étude de la Harvard Business School note quant à elle que si les entreprises développaient jusqu’au bout les politiques RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) actuellement engagées et que et si les objectifs étaient atteints, cela représenterait un gain de richesse mondiale de 1 400 milliards de $ par an et 400 000 millions d’emplois créés d’ici 2025. En France, ces études sont peu connues, car on confond trop souvent entreprises, capitalisme et néolibéralisme. Évidemment, les gens autour de Donald Trump n’ont que faire de ces initiatives. Mais une partie des business models est en train de changer et annonce, je l’espère, une profonde mutation des entreprises et de toutes leurs parties prenantes, internes et externes.
Pas de naïveté ni d’optimisme exagéré. On n’a pas à tout inventer. Les solutions existent. Mais il reste le plus difficile : en faire une nouvelle synthèse créatrice pour l’avenir de Sapiens.
Le mot Sapiens signifie à l’origine sagesse, celui qui sait. Est-il nécessaire de remettre de la sagesse et du sens dans tout ce que l’humain entreprend ?
Oui, d’autant que nous sommes les derniers survivants du genre Homo ; nous sommes seuls face à notre espèce et cela change tout. Notre vision du passé a complètement changé. Aujourd’hui, plus que jamais, nous commençons à prendre conscience de notre place dans l’évolution et de notre responsabilité face à la situation actuelle, et même vis-à-vis de la disparition d’autres espèces. Tout cela nous amène à repenser notre devenir commun. Il fut un temps où l’on pensait que l’évolution de la vie allait vers l’avènement de Sapiens, ce qu’on appelle l’hominisation. Une loi immanente qui exclut notre responsabilité. Un dévoiement de l’évolution forgé par l’idéologie du progrès et chère aux climatosceptiques. Mais aussi un dévoiement de la pensée de Pierre Teilhard de Chardin pour qui l’hominisation, concept dont il est l’inventeur, définit l’état unique d’une espèce qui prend conscience de sa place dans l’histoire de la vie et qui en devient responsable ; autrement dit, devient Sapiens. On n’a plus beaucoup de temps.
Pascal Picq. Propos recueillis par Sabah Rahmani. Kaizen avril 2020
1831
Alexis de Tocqueville est envoyé aux États-Unis pour étudier le système pénitentiaire ; il ne passera pas tout son temps derrière les barreaux et en rapportera De la démocratie en Amérique, qui deviendra un des grands classiques de la philosophie politique, publié en 1835. Il n’avait probablement pas pris le temps d’aller voir de près comment les Américains s’arrangeaient avec les Indiens, et fera confiance à ses interlocuteurs qui lui raconteront bien ce qu’ils voulaient sur la question : Pourvu que les Indiens demeurassent dans l’état sauvage, les Américains ne se mêlent nullement de leurs affaires […] Ils ne se permettent point d’occuper leurs terres sans les avoir dûment acquises […] alors, ils les prennent fraternellement par la main et les conduisent eux-mêmes mourir hors du pays de leur pères […] On ne saurait détruire les hommes en respectant mieux les droits de l’humanité.
Il concluait en prophétisant : Il y a aujourd’hui deux grands peuples qui, partis de points différents, semblent s’avancer vers le même but : ce sont les Russes et les Anglo-Américains […]. L’Américain lutte contre les obstacles que lui oppose la nature ; le Russe est aux prises avec les hommes. L’un combat le désert […], l’autre la civilisation […] L’un a pour principal moyen d’action la liberté ; l’autre, la servitude […] néanmoins, chacun semble appelé par un dessein secret de la Providence à tenir un jour dans ses mains les destinées de la moitié du monde.
Michelet, quant à lui, définit la France comme suit : La France est le pays de la prose. Que sont tous les prosateurs du monde à coté de Bossuet, de Pascal, de Montesquieu et de Voltaire ? Or qui dit la prose dit la forme la moins figurée et la moins concrète, la plus abstraite, la plus pure, la plus transparente, autrement dit, la moins matérielle, la plus libre, la plus commune à tous les hommes, la plus humaine. (…) Ainsi chaque pensée solitaire des nations est révélée par la France. Elle dit le Verbe de l’Europe, comme la Grèce a dit celui de l’Asie. Qui lui mérite cette mission ? C’est qu’en elle, plus vite qu’en aucun peuple, se développe, et pour la théorie et pour la pratique, le sentiment de la généralité sociale.
Et, en se plaçant dans une perspective plus sociale, plus identitaire, dans l’Introduction à l’histoire universelle, de 1831 : Mais il ne faut pas prendre ainsi la France, pièce à pièce, il faut l’embrasser dans son ensemble. C’est justement parce que la centralisation est puissante, la vie commune forte et énergique que la vie locale est faible. Je dirai même que c’est là la beauté de notre pays. Il n’a pas cette tête de l’Angleterre monstrueusement forte d’industrie, de richesse, mais il n’a pas non plus le désert de la Haute Écosse, le cancer de l’Irlande. Vous n’y trouvez pas, comme en Allemagne et en Italie vingt centres de science et d’art, il n’en a qu’un de vie sociale. L’Angleterre est un empire, l’Allemagne un pays, une race, la France est une personne.
Face à un tel étalage de suffisance bouffie, on ne peut s’étonner de la haine que peut susciter à l’étranger, dans nombre de chancelleries, la grande nation, toute empêtrée d’orgueil et de narcissisme. Certes, d’autres que Michelet s’étaient employés avant lui à enorgueillir la France, au premier rang desquels Louis XIV, Napoléon, mais comment laisser la vénération vouée à un historien majeur étouffer tout sens critique au point de valider ce paragraphe qui donne ses lettres de noblesse au nationalisme, et même au chauvinisme étriqué. La route était bien balisée pour faire du Tour de France de deux enfants un incroyable succès 50 ans plus tard. L’auteur, Mme Alfred Fouillée, née Augustine Tuillerie, sous le pseudonyme de G. Bruno, distillera dans un goutte à goutte toxique un esprit revanchard qui nous mènera tout droit à la plus grande tuerie de l’Histoire.
Ce n’est pas nouveau : déjà Pétrarque, quelque cinq cents ans plus tôt, le dénonçait : Que le Gaulois dresse à présent l’oreille et que sa crête insolente retombe afin d’écouter non pas éternellement ce qui lui fait plaisir, mais parfois aussi ce qui est vrai.
Et si l’on tient à définir la France, éloignons-nous de la pompe, de la suffisance et de la morgue avec Gustave Flaubert : Le vent est tiède sans volupté, le soleil doux sans ardeur ; tout le paysage enfin joli, varié dans sa monotonie, léger, gracieux, mais d’une beauté qui caresse sans captiver, qui charme sans séduire et qui, en un mot, a plus de bon sens que de grandeur et plus d’esprit que de poésie : c’est la France.
________________________________________________________________________________________________
[1] Pour des yeux du XXI° siècle, la baie des Trépassés est un endroit superbe, encadrée par les pointes du Raz et du Van.. Elle n’est d’ailleurs trépassée que par un glissement phonétique en breton : elle se nommait autrefois bien banalement bae an Aod, c’est-à-dire baie de la Côte, quand un esprit chagrin la fit évoluer un jour en bae an Anaon, c’est-à-dire baie des morts, baie des trépassés, ce qui la mettait plus en adéquation avec les nombreuses légendes circulant dans le coin, plus portées sur le morbide que sur la vie.
[2] Giuseppe Mazzini… dont Metternich dira : J’ai dû lutter avec le plus grand des soldats, Napoléon. Je suis arrivé à mettre d’accord entre eux les empereurs, les rois et les papes. Personne ne m’a donné plus de tracas qu’un brigand italien : maigre, pâle, en haillons, mais éloquent comme la tempête, brûlant comme un apôtre, rusé comme un voleur, désinvolte comme un comédien, infatigable comme un amant, qui a pour nom : Giuseppe Mazzini.
[3] Le dandy aime la nuit, il ne sait vivre que la nuit: ce sont, dit-il, les niais qui vivent le jour ; il n’y a que les bourgeois et les sauvages qui adorent le soleil.
Delphine de Girardin
[4] la version la plus courante étant celle des animaux qui n’ayant pu trouver de place à bord de l’Arche de Noé, se sont noyés !